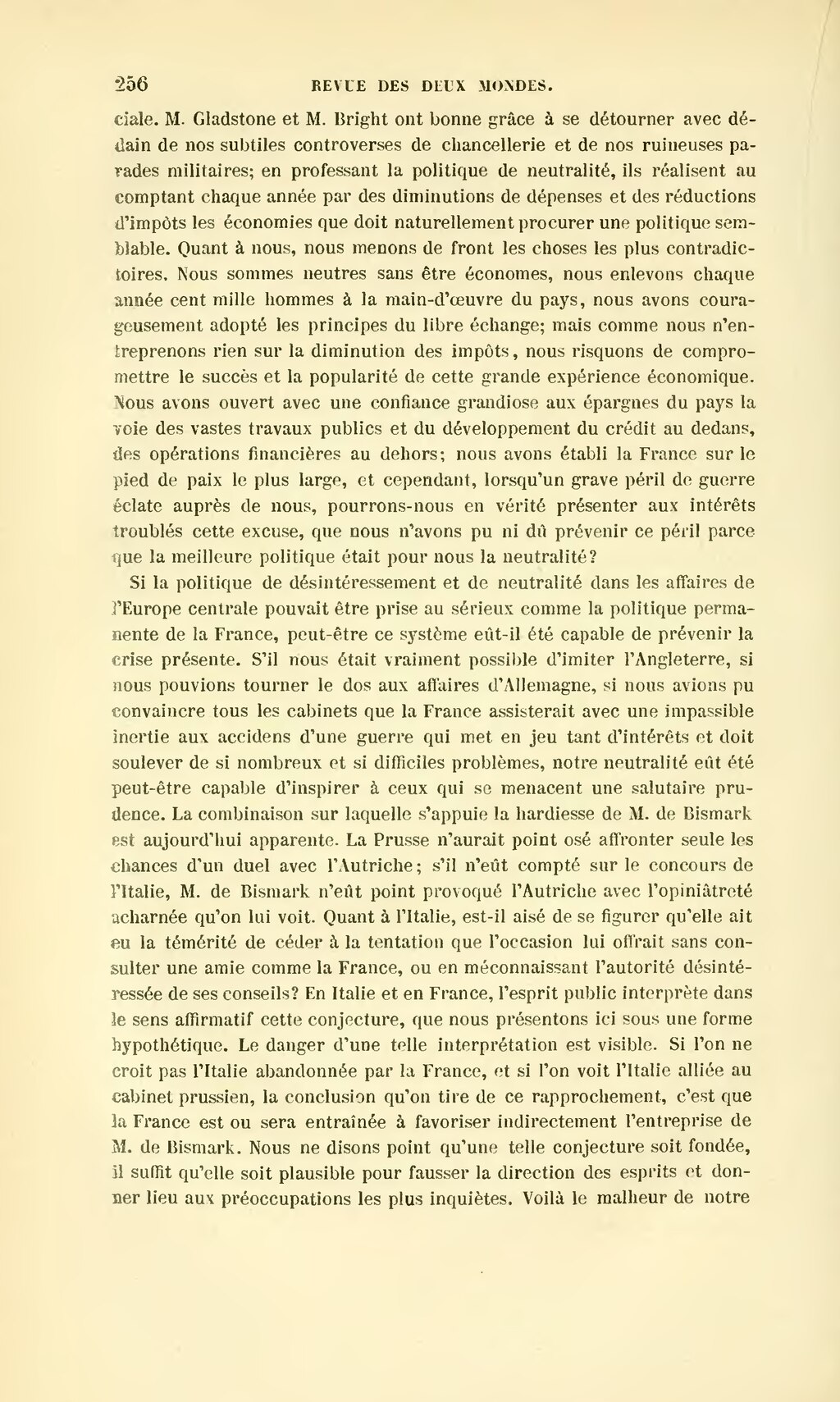commerciale. M. Gladstone et M. Bright ont bonne grâce à se détourner avec dédain de nos subtiles controverses de chancellerie et de nos ruineuses parades militaires ; en professant la politique de neutralité, ils réalisent au comptant chaque année par des diminutions de dépenses et des réductions d’impôts les économies que doit naturellement procurer une politique semblable. Quant à nous, nous menons de front les choses les plus contradictoires. Nous sommes neutres sans être économes, nous enlevons chaque année cent mille hommes à la main-d’œuvre du pays, nous avons courageusement adopté les principes du libre échange ; mais comme nous n’entreprenons rien sur la diminution des impôts, nous risquons de compromettre le succès et la popularité de cette grande expérience économique. Nous avons ouvert avec une confiance grandiose aux épargnes du pays la voie des vastes travaux publics et du développement du crédit au dedans, des opérations financières au dehors ; nous avons établi la France sur le pied de paix le plus large, et cependant, lorsqu’un grave péril de guerre éclate auprès de nous, pourrons-nous en vérité présenter aux intérêts troublés cette excuse, que nous n’avons pu ni dû prévenir ce péril parce que la meilleure politique était pour nous la neutralité ?
Si la politique de désintéressement et de neutralité dans les affaires de l’Europe centrale pouvait être prise au sérieux comme la politique permanente de la France, peut-être ce système eût-il été capable de prévenir la crise présente. S’il nous était vraiment possible d’imiter l’Angleterre, si nous pouvions tourner le dos aux affaires d’Allemagne, si nous avions pu convaincre tous les cabinets que la France assisterait avec une impassible inertie aux accidens d’une guerre qui met en jeu tant d’intérêts et doit soulever de si nombreux et si difficiles problèmes, notre neutralité eût été peut-être capable d’inspirer à ceux qui se menacent une salutaire prudence. La combinaison sur laquelle s’appuie la hardiesse de M. de Bismark est aujourd’hui apparente. La Prusse n’aurait point osé affronter seule les chances d’un duel avec l’Autriche ; s’il n’eût compté sur le concours de l’Italie, M. de Bismark n’eût point provoqué l’Autriche avec l’opiniâtreté acharnée qu’on lui voit. Quant à l’Italie, est-il aisé de se figurer qu’elle ait eu la témérité de céder à la tentation que l’occasion lui offrait sans consulter une amie comme la France, ou en méconnaissant l’autorité désintéressée de ses conseils ? En Italie et en France, l’esprit public interprète dans le sens affirmatif cette conjecture, que nous présentons ici sous une forme hypothétique. Le danger d’une telle interprétation est visible. Si l’on ne croit pas l’Italie abandonnée par la France, et si l’on voit l’Italie alliée au cabinet prussien, la conclusion qu’on tire de ce rapprochement, c’est que la France est ou sera entraînée à favoriser indirectement l’entreprise de M. de Bismark. Nous ne disons point qu’une telle conjecture soit fondée, il suffit qu’elle soit plausible pour fausser la direction des esprits et donner lieu aux préoccupations les plus inquiètes. Voilà le malheur de notre