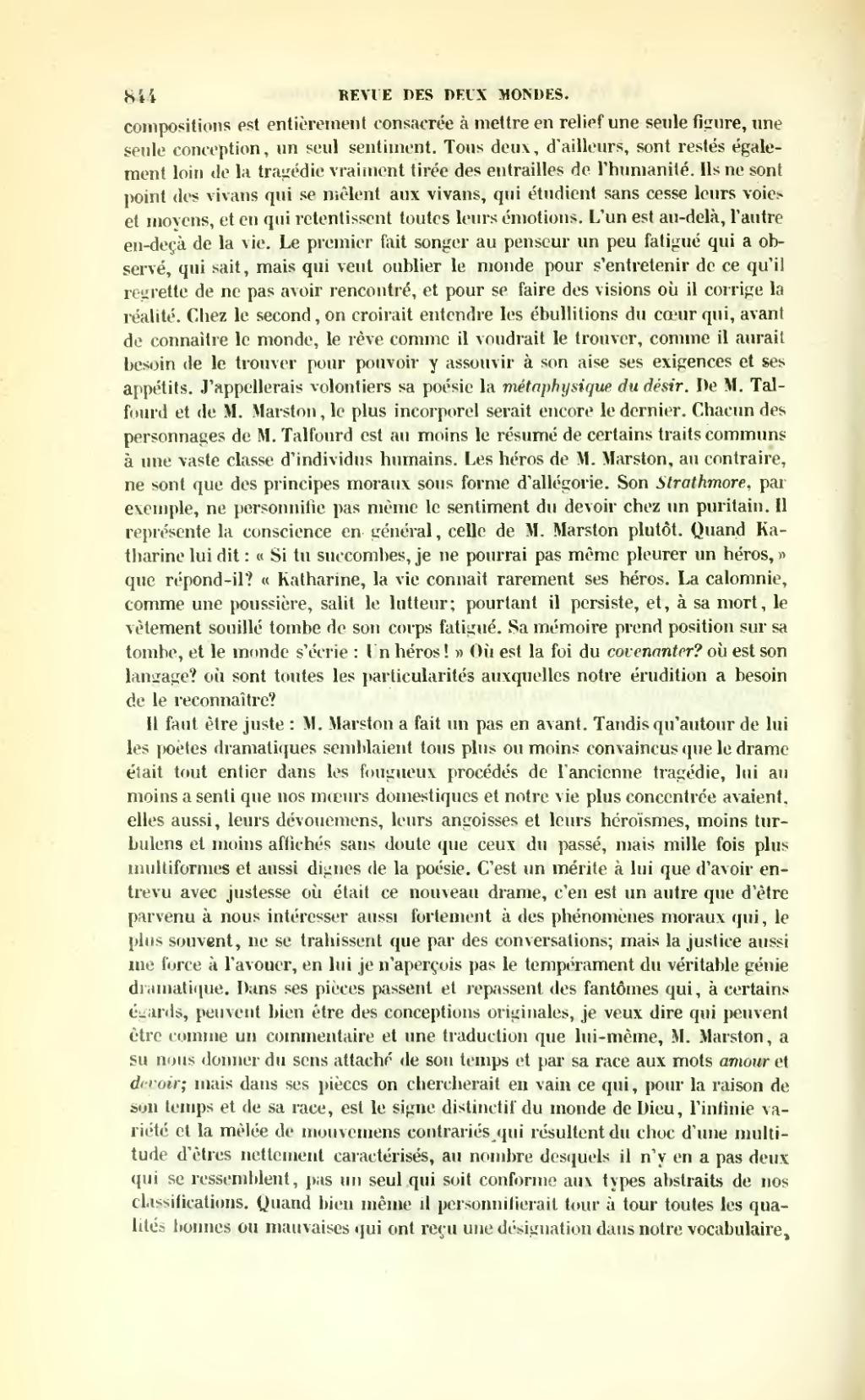compositions est entièrement consacrée à mettre en relief une seule figure, une seule conception, un seul sentiment. Tous deux, d’ailleurs, sont restés également loin de la tragédie vraiment tirée des entrailles de l’humanité. Ils ne sont point des vivans qui se mêlent aux vivans, qui étudient sans cesse leurs voies et moyens, et en qui retentissent toutes leurs émotions. L’un est au-delà, l’autre en-deçà de la vie. Le premier fait songer au penseur un peu fatigué qui a observé, qui sait, mais qui veut oublier le monde pour s’entretenir de ce qu’il regrette de ne pas avoir rencontré, et pour se faire des visions où il corrige la réalité. Chez le second, on croirait entendre les ébullitions du cœur qui, avant de connaître le monde, le rêve comme il voudrait le trouver, comme il aurait besoin de le trouver pour pouvoir y assouvir à son aise ses exigences et ses appétits. J’appellerais volontiers sa poésie la métaphysique du désir. De M. Talfourd et de M. Marston le plus incorporel serait encore le dernier. Chacun des personnages de M. Talfourd est au moins le résumé de certains traits communs à une vaste classe d’individus humains. Les héros de M. Marton, au contraire ne sont que des principes moraux sous forme d’allégorie. Son Strathmore, par exemple, ne personnifie pas même le sentiment du devoir chez un puritain. Il représente la conscience en général, celle de M. Marston plutôt. Quand Katharine lui dit : « Si tu succombes, je ne pourrai pas même pleurer un héros, que répond-il ? « Katharine, la vie connaît rarement ses héros. La calomnie, comme une poussière, salit le lutteur ; pourtant il persiste, et, à sa mort, le vêtement souillé tombe de son corps fatigué. Sa mémoire prend position sur sa tombe, et le monde s’écrie : Un héros ! » Où est la foi du covenanter ? où est son langage ? où sont toutes les particularités axquelles notre érrudition a besoin de le reconnaître ?
Il faut être juste : M. Marston a fait un pas en avant. Tandis qu’autour de lui les poètes dramatiques semblaient tous plus ou moins convaincus que le drame était tout entier dans les fougueux procédés de l’ancienne tragédie, lui au moins a senti que nos mœurs domestiques et notre vie plus concentrée avaient elles aussi, leurs dévouemens, leurs angoisses et leurs héroïsmes, moins turbulens et moins affichés sans doute que ceux du passé, mais mille fois plus multiformes et aussi dignes de la poésie. C’est un mérite à lui que d’avoir entrevu avec justesse où était ce nouveau drame, c’en est un autre que d’être parvenu à nous intéresser aussi fortement à des phénomènes moraux qui, le plus souvent, ne se trahissent que par des conversations ; mais la justice aussi me force à l’avouer, en lui je n’aperçois pas le tempérament du véritable génie dramatique, dans ses pièces passent et repassent des fantômes qui, à certains égards, peuvent bien être des conceptions originales, je veux dire qui peuvent être comme un commentaire et une traduction que lui-même, M. Marston, a su nous donner du sens attaché de son temps et par sa race aux mots amour et devoir ; mais dans ses pièces on chercherait en vain ce qui, pour la raison de son temps et de sa race, est le signe distinctif du monde de Dieu, l’infime variété et la mêlée de mouvemens contrariés qui résultent du choc d’une multitude d’êtres nettement caractérisés, au nombre desquels il n’y en a pas deux qui se ressemblent, pas un seul qui soit conforme aux types abstraits de nos classifications. Quand bien même il personnifierait tour à tour toutes les qualités bonnes ou mauvaises qui ont reçu une désignation dans notre vocabulaire,