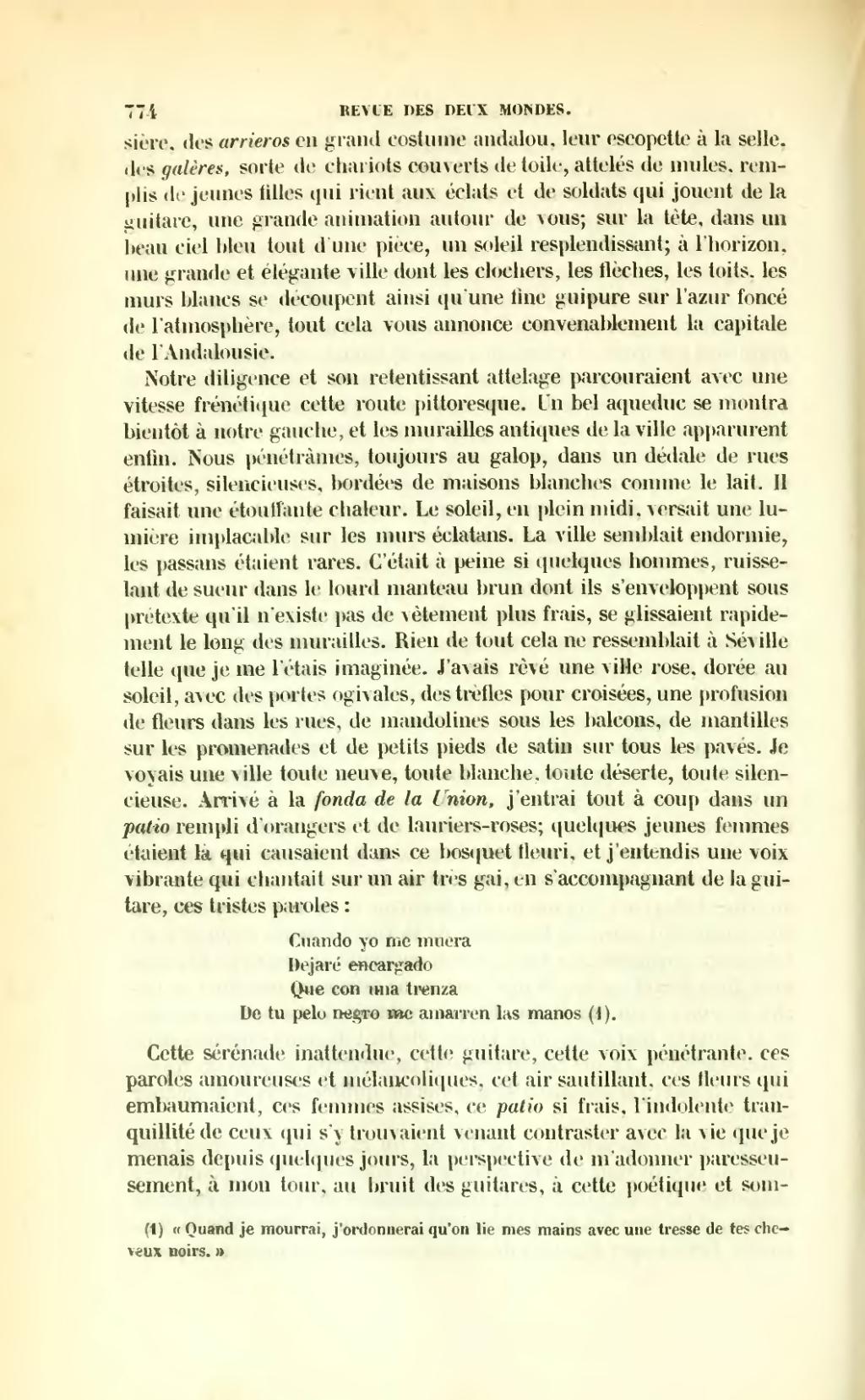sière, des arrieros en grand costume andalou, leur escopette à la selle des galères, sorte de chariots couverts de toile, attelés de mules, remplis de jeunes filles, qui rient aux éclats et de soldats qui jouent de la guitare, une grande animation autour de vous ; sur la tête, dans un beau ciel bleu tout d’une pièce, un soleil resplendissant ; à l’horizon, une grande et élégante ville dont les clochers, les flèches, les toits, les murs blancs se découpent ainsi qu’une fine guipure sur l’azur foncé de l’atmosphère, tout cela vous annonce convenablement la capitale de l’Andalousie.
Notre diligence et son retentissant attelage parcouraient avec une vitesse frénétique cette route pittoresque. Un bel aqueduc se montra bientôt à notre gauche, et les murailles antiques de la ville apparurent enfin. Nous pénétrâmes, toujours au galop, dans un dédale de rues étroites, silencieuses, bordées de maisons blanches comme le lait. Il faisait une étouffante chaleur. Le soleil, en plein midi, versait une lumière implacable sur les murs éclatans, la ville semblait endormie, les passans étaient rares. C’était à peine si quelques hommes, ruisselant de sueur dans le lourd manteau brun dont ils s’enveloppent sous prétexte qu’il n’existe pas de vêtement plus frais, se glissaient rapidement le long des murailles. Rien de tout cela ne ressemblait à Séville telle que je me l’étais imaginée. J’avais rêvé une ville rose, dorée au soleil, avec des portes ogivales, des trèfles pour croisées, une profusion de fleurs dans les rues, de mandolines sous les balcons, de mantilles sur les promenades et de petits pieds de satin sur tous les pavés. Je voyais une ville toute neuve, toute blanche, toute déserte, toute silencieuse. Arrivé à la fonda de la Union, j’entrai tout à coup dans un patio rempli d’orangers et de lauriers-roses ; quelques jeunes femmes étaient là qui causaient dans ce bosquet fleuri, et j’entendis une voix vibrante qui chantait sur un air très gai, en s’accompagnant de la guitare, ces tristes paroles :
Cuando yo me muera
Dejaré encargado
Que con una trenza
De tu pelo negro me amarren las manos[1].
Cette sérénade inattendue, cette guitare, cette voix pénétrante, ces paroles amoureuses et mélancoliques, cet air sautillant, ces fleurs qui embaumaient, ces femmes assises, ce patio si frais, l’indolente tranquillité de ceux qui s’y trouvaient venant contraster avec la vie que je menais depuis quelques jours, la perspective de m’adonner paresseusement, à mon tour, au bruit des guitares, à cette poétique et som-
- ↑ « Quand je mourrai, j’ordonnerai qu’on lie mes mains avec une tresse de tes cheveux noirs. »