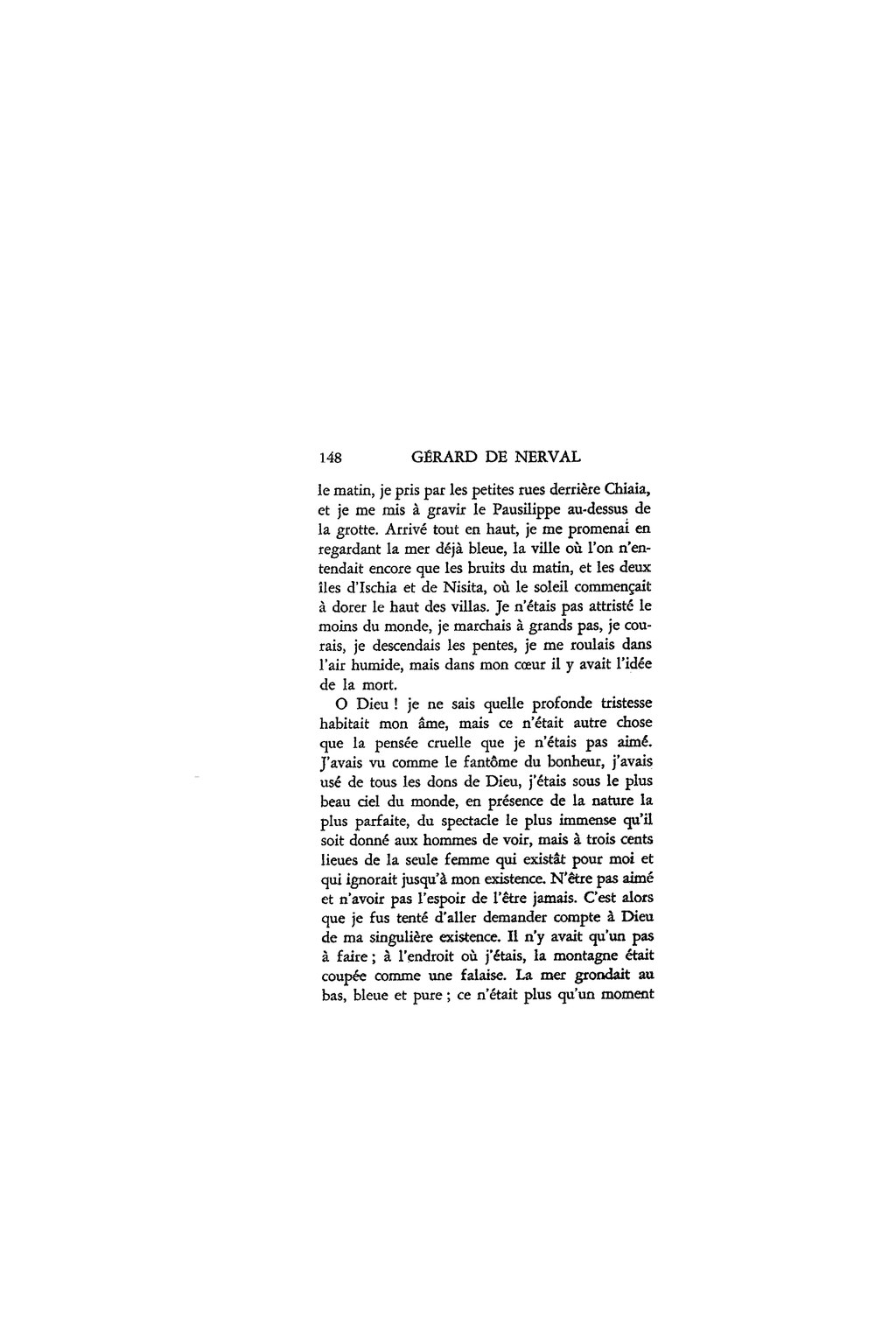le matin, je pris par les petites rues derrière Chiaia, et je me mis à gravir le Pausilippe au-dessus de la grotte. Arrivé tout en haut, je me promenai en regardant la mer déjà bleue, la ville où l’on n’entendait encore que les bruits du matin, et les deux îles d’Ischia et de Nisita, où le soleil commençait à dorer le haut des villas. Je n’étais pas attristé le moins du monde, je marchais à grands pas, je courais, je descendais les pentes, je me roulais dans l’air humide, mais dans mon cœur il y avait l’idée de la mort.
Ô Dieu ! je ne sais quelle profonde tristesse habitait mon âme, mais ce n’était autre chose que la pensée cruelle que je n’étais pas aimé. J’avais vu comme le fantôme du bonheur, j’avais usé de tous les dons de Dieu, j’étais sous le plus beau ciel du monde, en présence de la nature la plus parfaite, du spectacle le plus immense qu’il soit donné aux hommes de voir, mais à trois cents lieues de la seule femme qui existât pour moi et qui ignorait jusqu’à mon existence. N’être pas aimé et n’avoir pas l’espoir de l’être jamais. C’est alors que je fus tenté d’aller demander compte à Dieu de ma singulière existence. Il n’y avait qu’un pas à faire ; à l’endroit où j’étais, la montagne était coupée comme une falaise. La mer grondait au bas, bleue et pure ; ce n’était plus qu’un moment