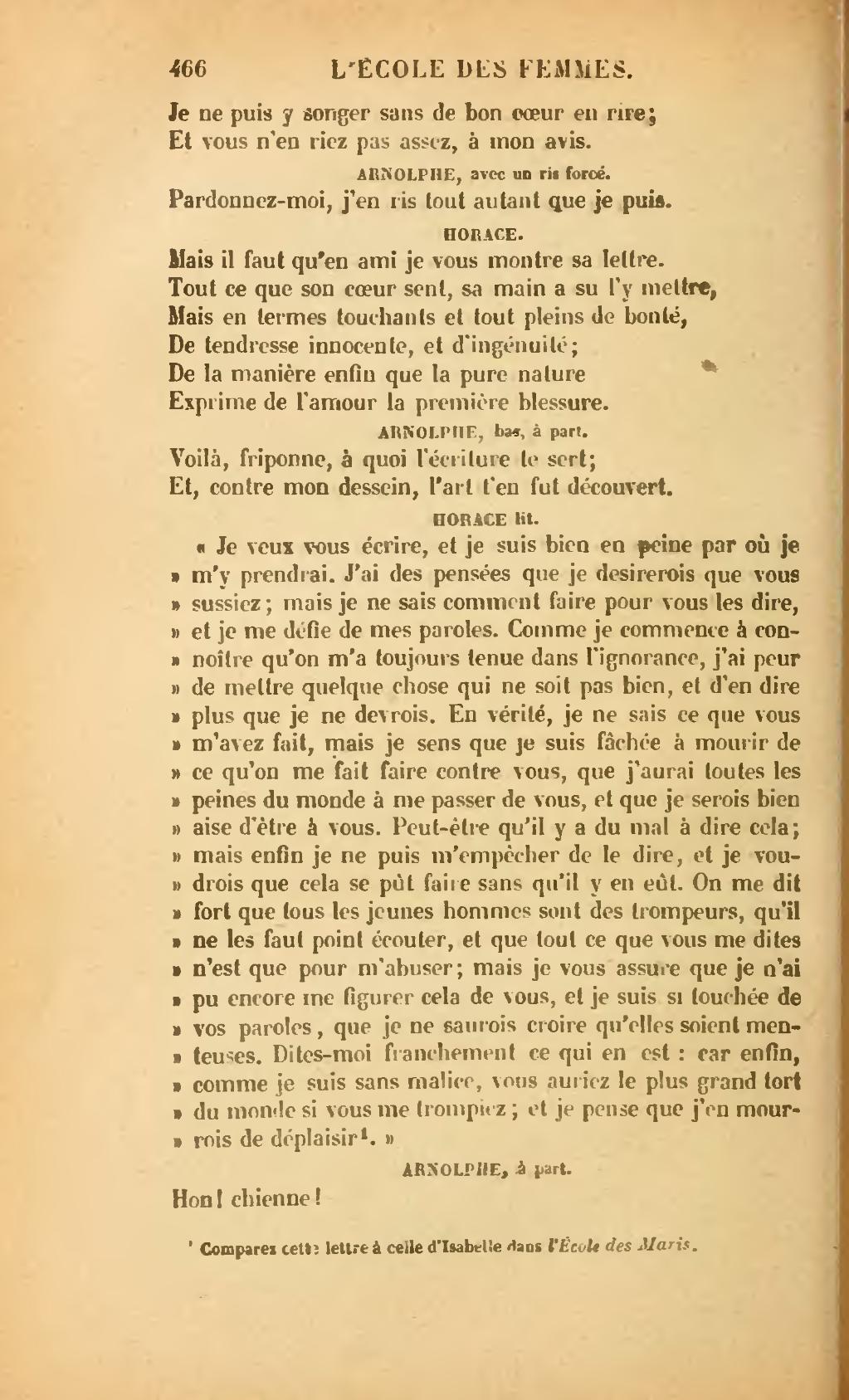Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire :
Et vous n’en riez pas assez, à mon avis.
Arnolphe, avec un ris forcé.
Pardonnez-moi, j’en ris tout autant que je puis.
Horace.
Mais il faut qu’en ami je vous montre la lettre.
Tout ce que son cœur sent, sa main a su l’y mettre,
Mais en termes touchants et tous pleins de bonté,
De tendresse innocente et d’ingénuité,
De la manière enfin que la pure nature
Exprime de l’amour la première blessure.
Arnolphe, bas.
Voilà, friponne, à quoi l’écriture te sert ;
Et contre mon dessein l’art t’en fut découvert.
Horace lit.
« Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m’y prendrai. J’ai des pensées que je désirerais que vous sussiez ; mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu’on m’a toujours tenue dans l’ignorance, j’ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d’en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m’avez fait ; mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu’on me fait faire contre vous, que j’aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serais bien aise d’être à vous. Peut-être qu’il y a du mal à dire cela ; mais enfin je ne puis m’empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu’il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu’il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n’est que pour m’abuser ; mais je vous assure que je n’ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touchée de vos paroles, que je ne saurais croire qu’elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est ; car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde, si vous me trompiez ; et je pense que j’en mourrais de déplaisir. »
Arnolphe.
Hon ! chienne !
Horace.
Page:Molière - Édition Louandre, 1910, tome 1.djvu/568
Cette page n’a pas encore été corrigée