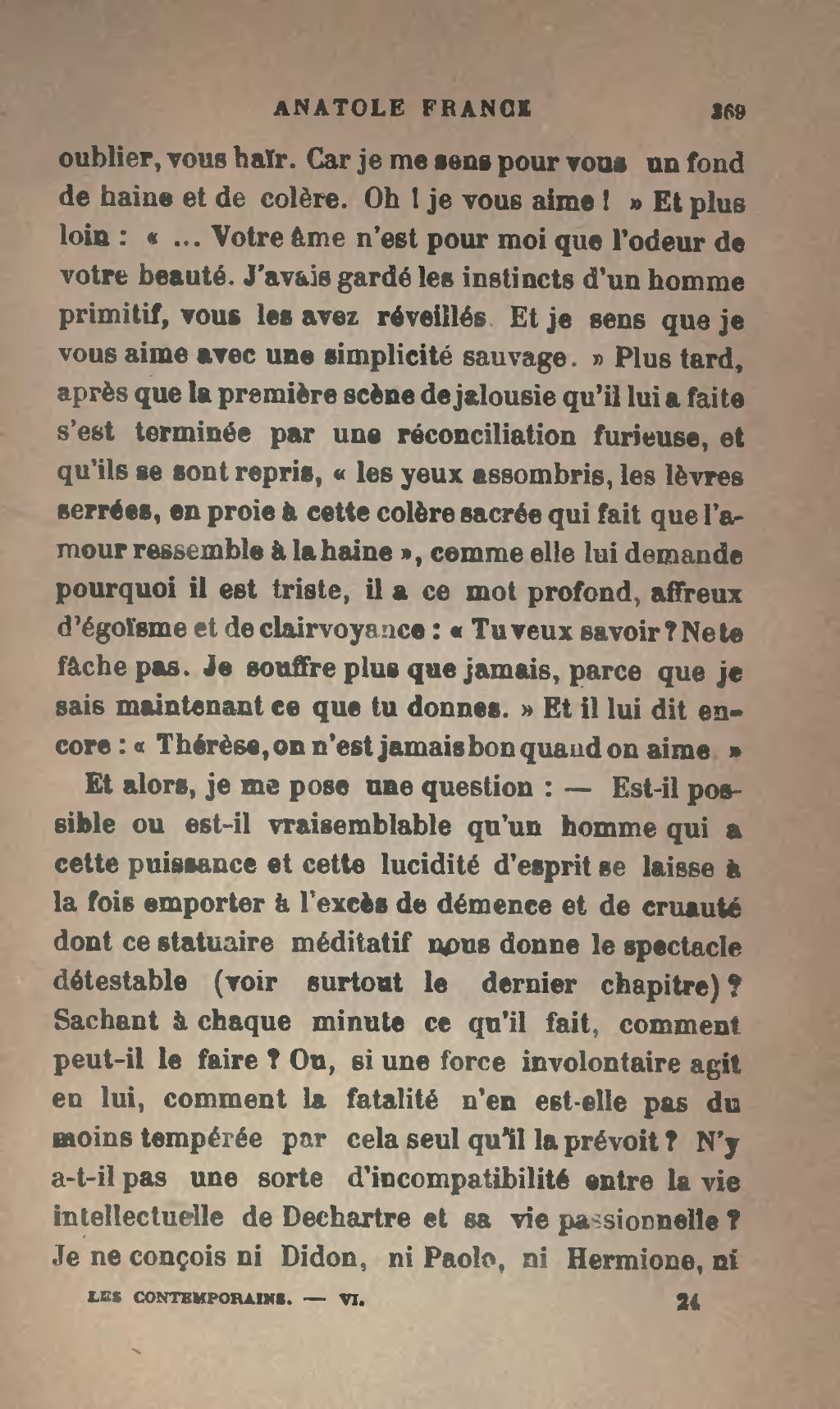oublier, vous haïr. Car je me sens pour vous un fond de haine et de colère. Oh ! je vous aime ! » Et plus loin : «… Votre âme n’est pour moi que l’odeur de votre beauté. J’avais gardé les instincts d’un homme primitif, vous les avez réveillés. Et je sens que je vous aime avec une simplicité sauvage. » Plus tard, après que la première scène de jalousie qu’il lui a faite s’est terminée par une réconciliation furieuse, et qu’ils se sont repris, « les yeux assombris, les lèvres serrées, en proie à cette colère sacrée qui fait que l’amour ressemble à la haine », comme elle lui demande pourquoi il est triste, il a ce mot profond, affreux d’égoïsme et de clairvoyance : « Tu veux savoir ? Ne te fâche pas. Je souffre plus que jamais, parce que je sais maintenant ce que tu donnes. » Et il lui dit encore : « Thérèse, on n’est jamais bon quand on aime ».
Et alors, je me pose une question : — Est-il possible ou est-il vraisemblable qu’un homme qui a cette puissance et cette lucidité d’esprit se laisse à la fois emporter à l’excès de démence et de cruauté dont ce statuaire méditatif nous donne le spectacle détestable (voir surtout le dernier chapitre) ? Sachant à chaque minute ce qu’il fait, comment peut-il le faire ? Ou, si une force involontaire agit en lui, comment la fatalité n’en est-elle pas du moins tempérée par cela seul qu’il la prévoit ? N’y a-t-il pas une sorte d’incompatibilité entre la vie intellectuelle de Dechartre et sa vie passionnelle ? Je ne conçois ni Didon, ni Paolo, ni Hermione, ni