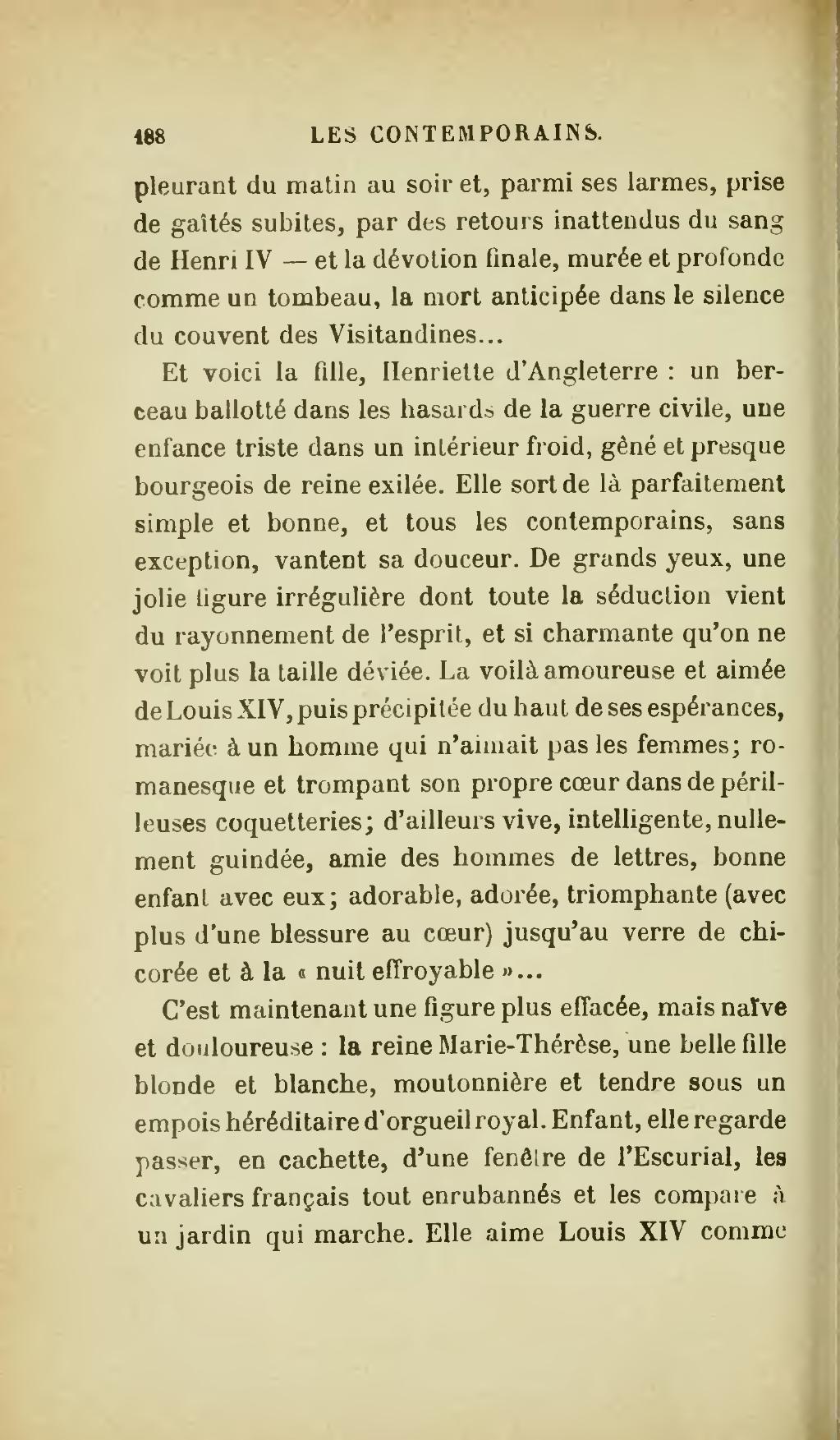pleurant du matin au soir et, parmi ses larmes, prise de gaîtés subites, par des retours inattendus du sang de Henri IV — et la dévotion finale, murée et profonde comme un tombeau, la mort anticipée dans le silence du couvent des Visitandines…
Et voici la fille, Henriette d’Angleterre : un berceau ballotté dans les hasards de la guerre civile, une enfance triste dans un intérieur froid, gêné et presque bourgeois de reine exilée. Elle sort de là parfaitement simple et bonne, et tous les contemporains, sans exception, vantent sa douceur. De grands yeux, une jolie figure irrégulière dont toute la séduction vient du rayonnement de l’esprit, et si charmante qu’on ne voit plus la taille déviée. La voilà amoureuse et aimée de Louis XIV, puis précipitée du haut de ses espérances, mariée à un homme qui n’aimait pas les femmes ; romanesque et trompant son propre cœur dans de périlleuses coquetteries ; d’ailleurs vive, intelligente, nullement guindée, amie des hommes de lettres, bonne enfant avec eux ; adorable, adorée, triomphante (avec plus d’une blessure au coeur) jusqu’au verre de chicorée et à la « nuit effroyable »…
C’est maintenant une figure plus effacée, mais naïve et douloureuse : la reine Marie-Thérèse, une belle fille blonde et blanche, moutonnière et tendre sous un empois héréditaire d’orgueil royal. Enfant, elle regarde passer, en cachette, d’une fenêtre de l’Escurial, les cavaliers français tout enrubannés et les compare à un jardin qui marche. Elle aime Louis XIV comme