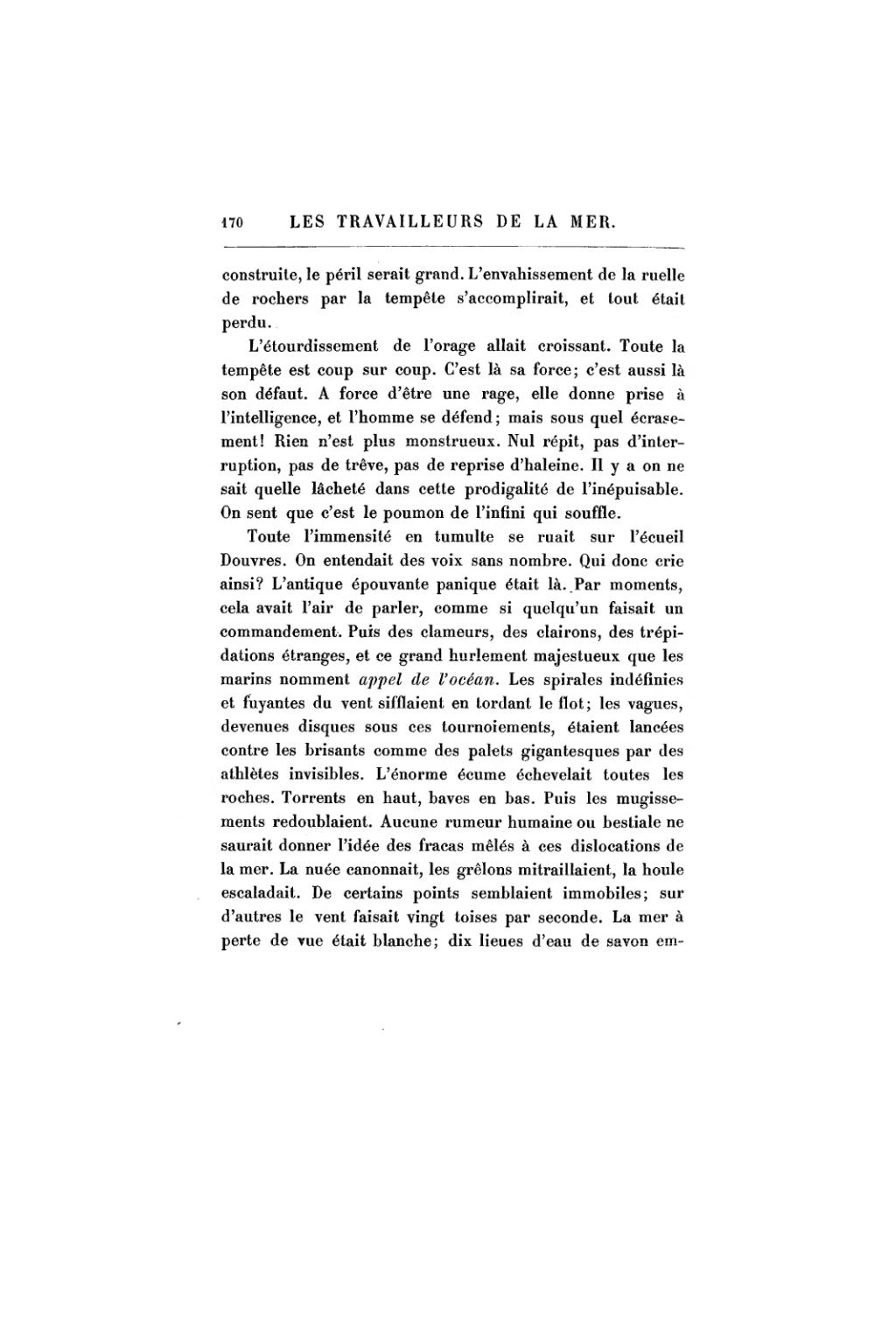construite, le péril serait grand. L’envahissement de la ruelle de rochers par la tempête s’accomplirait, et tout était perdu.
L’étourdissement de l’orage allait croissant. Toute la tempête est coup sur coup. C’est là sa force ; c’est aussi là son défaut. À force d’être une rage, elle donne prise à l’intelligence, et l’homme se défend ; mais sous quel écrasement ! Rien n’est plus monstrueux. Nul répit, pas d’interruption, pas de trêve, pas de reprise d’haleine. Il y a on ne sait quelle lâcheté dans cette prodigalité de l’inépuisable. On sent que c’est le poumon de l’infini qui souffle.
Toute l’immensité en tumulte se ruait sur l’écueil Douvres. On entendait des voix sans nombre. Qui donc crie ainsi ? L’antique épouvante panique était là. Par moments, cela avait l’air de parler, comme si quelqu’un faisait un commandement. Puis des clameurs, des clairons, des trépidations étranges, et ce grand hurlement majestueux que les marins nomment appel de l’océan. Les spirales indéfinies et fuyantes du vent sifflaient en tordant le flot ; les vagues, devenues disques sous ces tournoiements, étaient lancées contre les brisants comme des palets gigantesques par des athlètes invisibles. L’énorme écume échevelait toutes les roches. Torrents en haut, baves en bas. Puis les mugissements redoublaient. Aucune rumeur humaine ou bestiale ne saurait donner l’idée des fracas mêlés à ces dislocations de la mer. La nuée canonnait, les grêlons mitraillaient, la houle escaladait. De certains points semblaient immobiles ; sur d’autres le vent faisait vingt toises par seconde. La mer à perte de vue était blanche ; dix lieues d’eau de savon em-