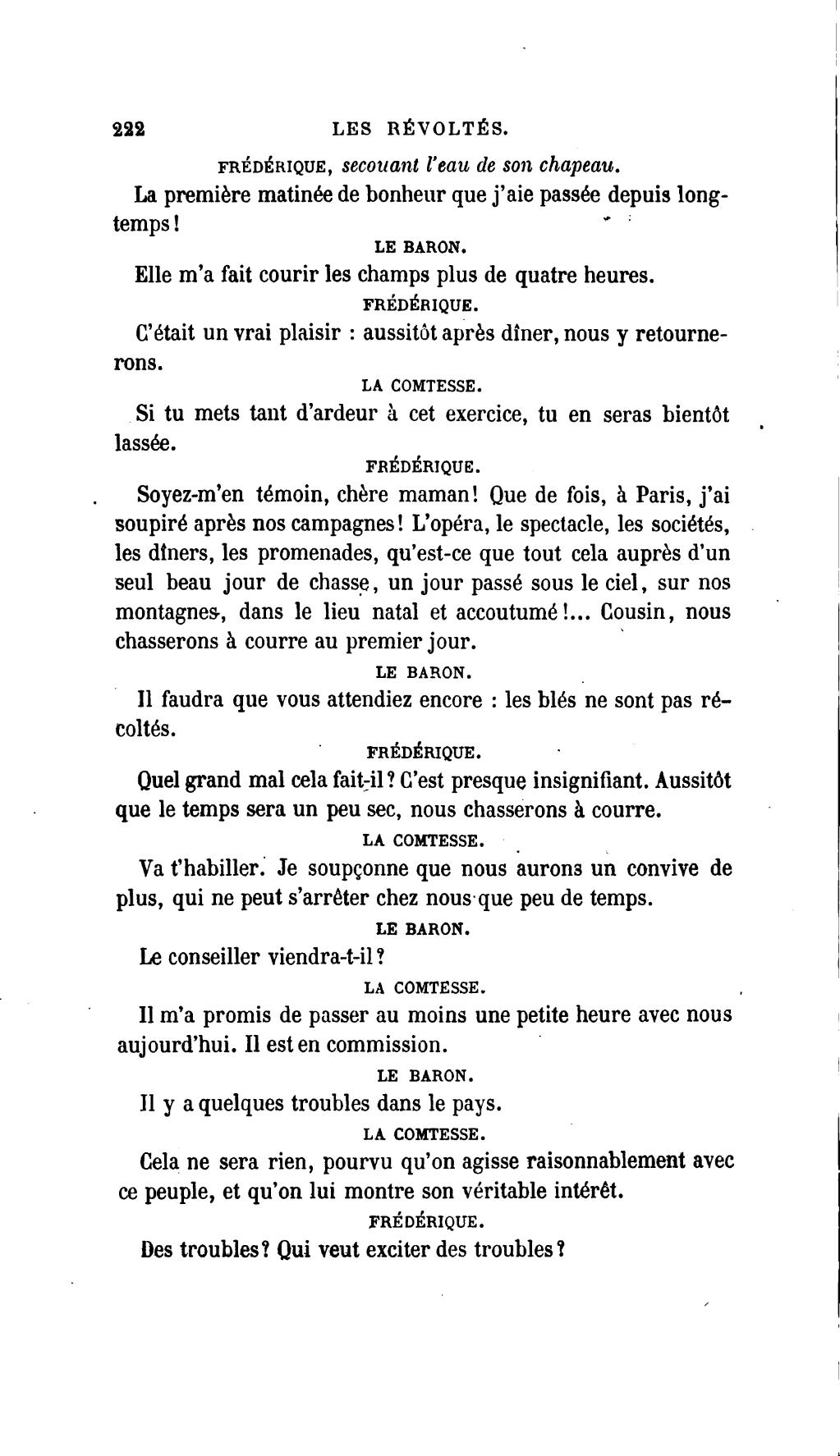La première matinée de bonheur que j’aie passée depuis longtemps !
Elle m’a fait courir les champs plus de quatre heures.
C’était un vrai plaisir : aussitôt après dîner, nous y retournerons.
Si tu mets tant d’ardeur à cet exercice, tu en seras bientôt lassée.
Soyez-m’en témoin, chère maman ! Que de fois, à Paris, j’ai soupiré après nos campagnes ! L’opéra, le spectacle, les sociétés, les dîners, les promenades, qu’est-ce que tout cela auprès d’un seul beau jour de chasse, un jour passé sous le ciel, sur nos montagnes, dans le lieu natal et accoutumé !… Cousin, nous chasserons à courre au premier jour.
Il faudra que vous attendiez encore : les blés ne sont pas récoltés.
Quel grand mal cela fait-il ? C’est presque insignifiant. Aussitôt que le temps sera un peu sec, nous chasserons à courre.
Va t’habiller. Je soupçonne que nous aurons un convive de plus, qui ne peut s’arrêter chez nous que peu de temps.
Le conseiller viendra-t-il ?
Il m’a promis de passer au moins une petite heure avec nous aujourd’hui. Il est en commission.
Il y a quelques troubles dans le pays.
Cela ne sera rien, pourvu qu’on agisse raisonnablement avec ce peuple, et qu’on lui montre son véritable intérêt.
Des troubles ? Qui veut exciter des troubles ?