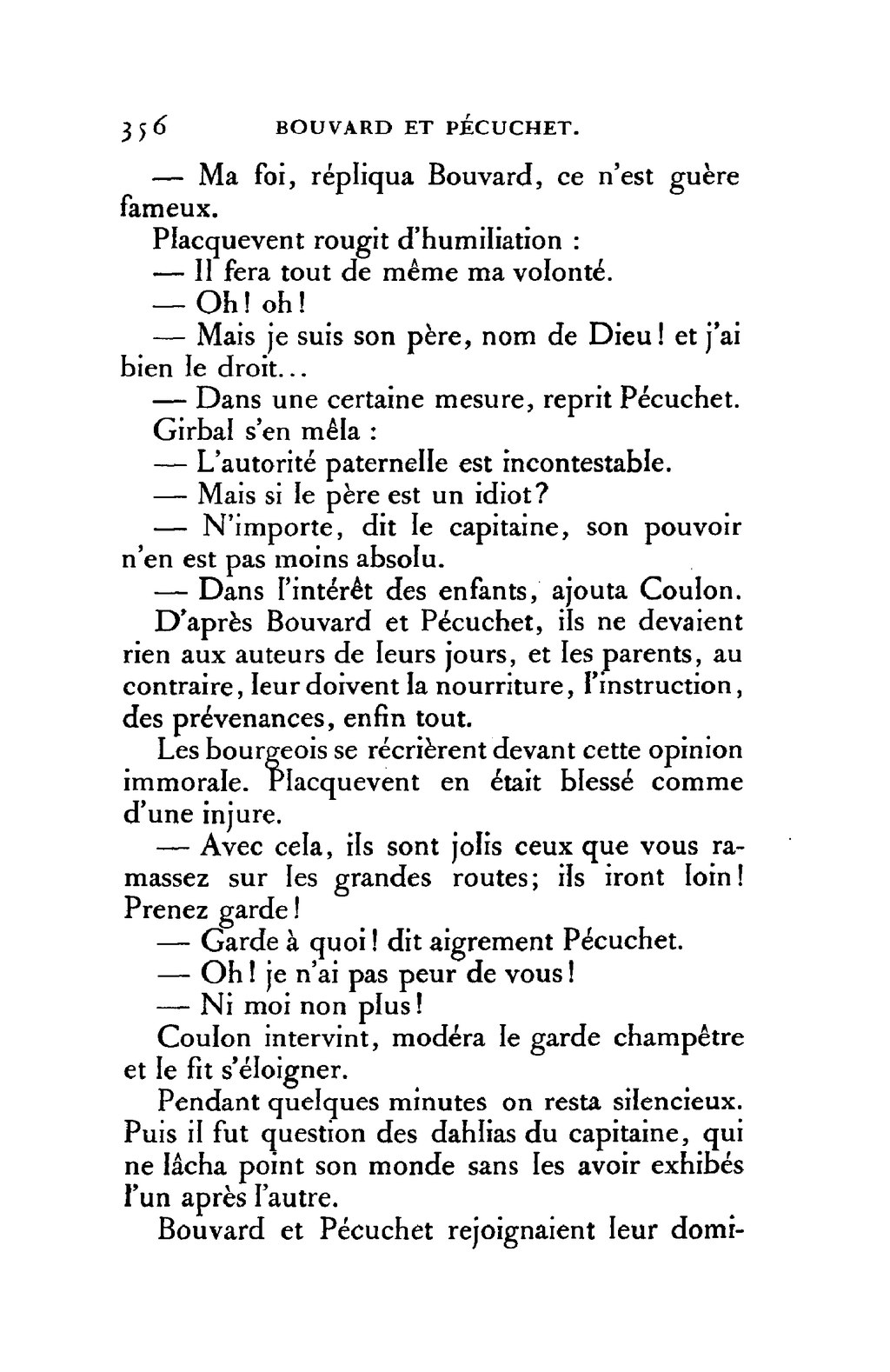— Ma foi, répliqua Bouvard, ce n’est guère fameux.
Placquevent rougit d’humiliation :
— Il fera tout de même ma volonté.
— Oh ! oh !
— Mais je suis son père, nom de Dieu ! et j’ai bien le droit…
— Dans une certaine mesure, reprit Pécuchet.
Girbal s’en mêla :
— L’autorité paternelle est incontestable.
— Mais si le père est un idiot ?
— N’importe, dit le capitaine, son pouvoir n’en est pas moins absolu.
— Dans l’intérêt des enfants, ajouta Coulon.
D’après Bouvard et Pécuchet, ils ne devaient rien aux auteurs de leurs jours, et les parents, au contraire, leur doivent la nourriture, l’instruction, des prévenances, enfin tout.
Les bourgeois se récrièrent devant cette opinion immorale. Placquevent en était blessé comme d’une injure.
— Avec cela, ils sont jolis ceux que vous ramassez sur les grandes routes ; ils iront loin ! Prenez garde !
— Garde à quoi ! dit aigrement Pécuchet.
— Oh ! je n’ai pas peur de vous !
— Ni moi non plus !
Coulon intervint, modéra le garde champêtre et le fit s’éloigner.
Pendant quelques minutes on resta silencieux. Puis il fut question des dahlias du capitaine, qui ne lâcha point son monde sans les avoir exhibés l’un après l’autre.
Bouvard et Pécuchet rejoignaient leur domicile,