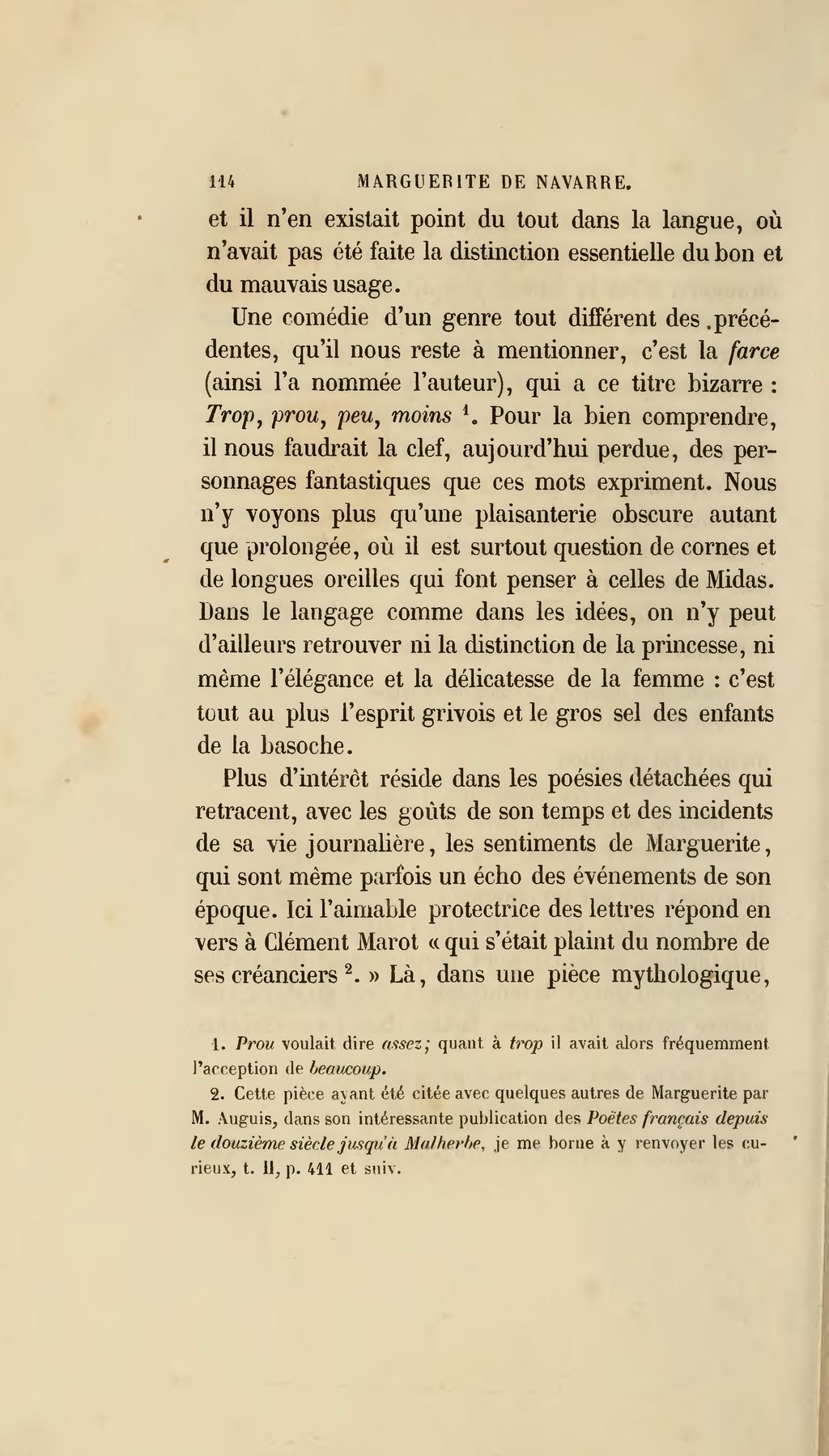et il n’en existait point du tout dans la langue, où n’avait pas été faite la distinction essentielle du bon et du mauvais usage.
Une comédie d’un genre tout différent des précédentes, qu’il nous reste à mentionner, c’est la farce (ainsi l’a nommée l’auteur), qui a ce titre bizarre : Trop, prou, peu, moins[1]. Pour la bien comprendre, il nous faudrait la clef, aujourd’hui perdue, des personnages fantastiques que ces mots expriment. Nous n’y voyons plus qu’une plaisanterie obscure autant que prolongée, où il est surtout question de cornes et de longues oreilles qui font penser à celles de Midas. Dans le langage comme dans les idées, on n’y peut d’ailleurs retrouver ni la distinction de la princesse, ni même l’élégance et la délicatesse de la femme : c’est tout au plus l’esprit grivois et le gros sel des enfants de la basoche.
Plus d’intérêt réside dans les poésies détachées qui retracent, avec les goûts de son temps et des incidents de sa vie journalière, les sentiments de Marguerite, qui sont même parfois un écho des événements de son époque. Ici l’aimable protectrice des lettres répond en vers à Clément Marot ce qui s’était plaint du nombre de ses créanciers[2]. » Là, dans une pièce mythologique,
- ↑ Prou voulait dire assez ; quant à trop il avait alors fréquemment l’acception de beaucoup.
- ↑ Cette pièce ayant été citée avec quelques autres de Marguerite par M. Auguis, dans son intéressante publication des Poètes français depuis le douzième siècle jusqu’à Malherbe, je me borne à y renvoyer les curieux, t. II, p. 411 et suiv.