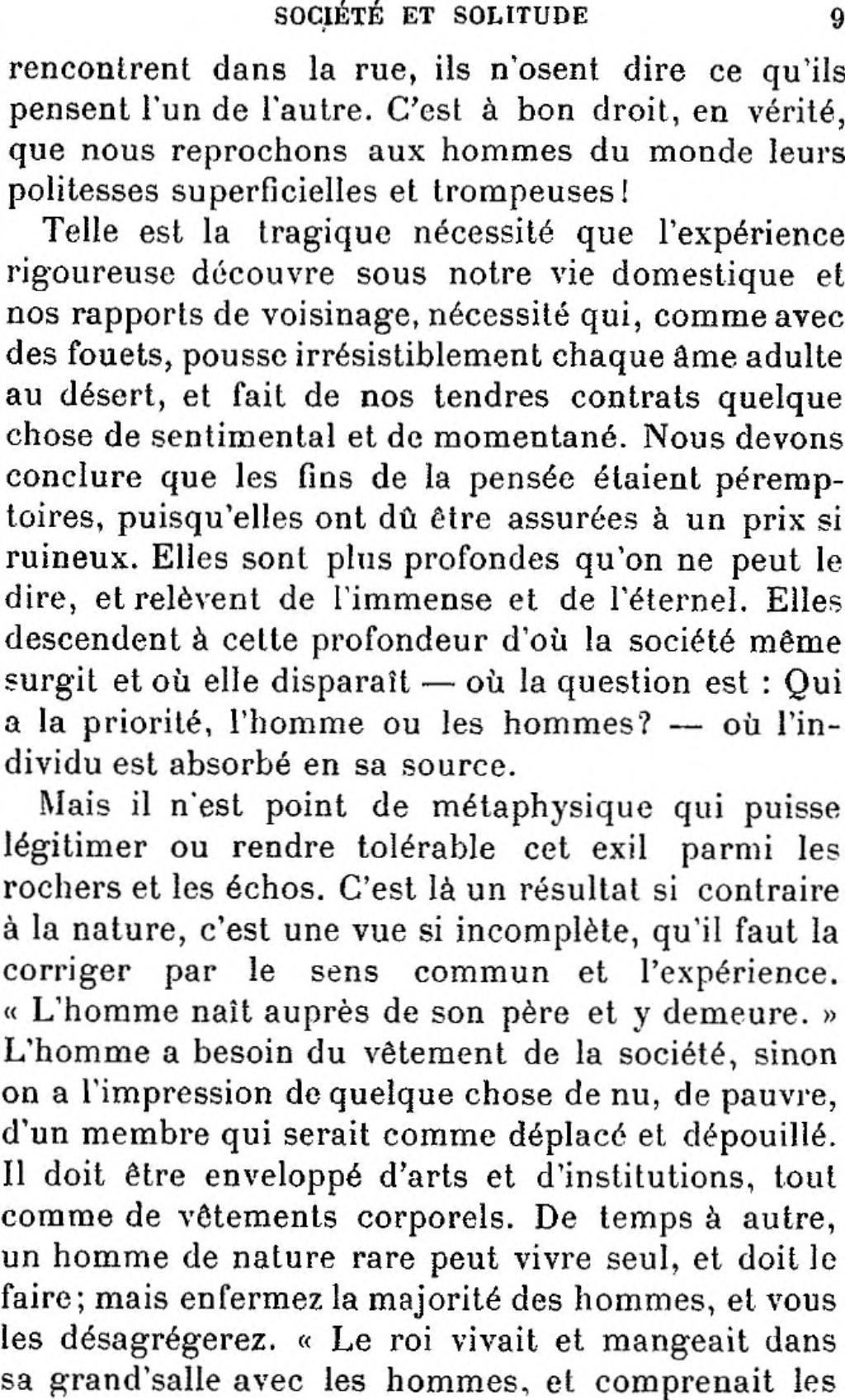rencontrent dans la rue, ils n’osent dire ce qu’ils pensent l’un de l’autre. C’est à bon droit, en vérité, que nous reprochons aux hommes du monde leurs politesses superficielles et trompeuses !
Telle est la tragique nécessité que l’expérience rigoureuse découvre sous notre vie domestique et nos rapports de voisinage, nécessité qui, comme avec des fouets, pousse irrésistiblement chaque âme adulte au désert, et fait de nos tendres contrats quelque chose de sentimental et de momentané. Nous devons conclure que les fins de la pensée étaient péremptoires, puisqu’elles ont dû être assurées à un prix si ruineux. Elles sont plus profondes qu’on ne peut le dire, et relèvent de l’immense et de l’éternel. Elles descendent à cette profondeur d’où la société même surgit et où elle disparaît — où la question est : Qui a la priorité, l’homme ou les hommes ? — où l’individu est absorbé en sa source.
Mais il n’est point de métaphysique qui puisse légitimer ou rendre tolérable cet exil parmi les rochers et les échos. C’est là un résultat si contraire à la nature, c’est une vue si incomplète, qu’il faut la corriger par le sens commun et l’expérience. « L’homme naît auprès de son père et y demeure. » L’homme a besoin du vêtement de la société, sinon on a l’impression de quelque chose de nu, de pauvre, d’un membre qui serait comme déplacé et dépouillé. Il doit être enveloppé d’arts et d’institutions, tout comme de vêtements corporels. De temps à autre, un homme de nature rare peut vivre seul, et doit le faire ; mais enfermez la majorité des hommes, et vous les désagrégerez. « Le roi vivait et mangeait dans sa grand’salle avec les hommes, et comprenait les