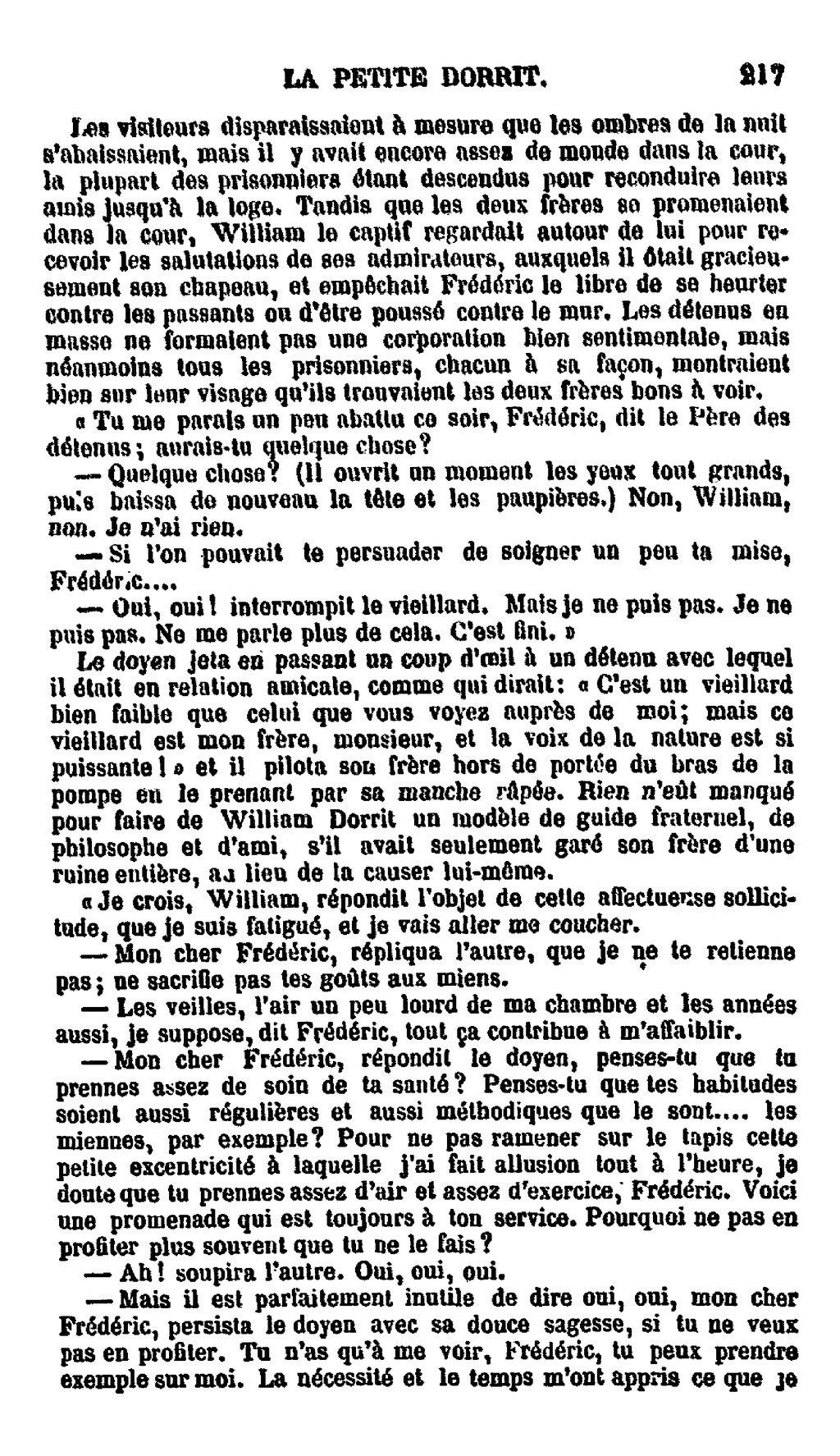Les visiteurs disparaissaient à mesure que les ombres de la nuit s’abaissaient, mais il y avait encore assez de monde dans la cour, la plupart des prisonniers étant descendus pour reconduire leurs amis jusqu’à la loge. Tandis que les deux frères se promenaient dans la cour, William le captif regardait autour de lui pour recevoir les salutations de ses admirateurs, auxquels il ôtait gracieusement son chapeau, et empêchait Frédéric le libre de se heurter contre les passants ou d’être poussé contre le mur. Les détenus en masse ne formaient pas une corporation bien sentimentale, mais néanmoins tous les prisonniers, chacun à sa façon, montraient bien sur leur visage qu’ils trouvaient les deux frères bons à voir.
« Tu me parais un peu abattu ce soir, Frédéric, dit le Père des détenus ; aurais-tu quelque chose ?
— Quelque chose ? (Il ouvrit un moment les yeux tout grands, puis baissa de nouveau la tête et les paupières.) Non, William, non. Je n’ai rien.
— Si l’on pouvait te persuader de soigner un peu ta mise, Frédéric…
— Oui, oui ! interrompit le vieillard. Mais je ne puis pas. Je ne puis pas. Ne me parle plus de cela. C’est fini. »
Le doyen jeta en passant un coup d’œil à un détenu avec lequel il était en relation amicale, comme qui dirait : « C’est un vieillard bien faible que celui que vous voyez auprès de moi ; mais ce vieillard est mon frère, monsieur, et la voix de la nature est si puissante ! » et il pilota son frère hors de portée du bras de la pompe en le prenant par sa manche râpée. Rien n’eût manqué pour faire de William Dorrit un modèle de guide fraternel, de philosophe et d’ami, s’il avait seulement garé son frère d’une ruine entière, au lieu de la causer lui-même.
« Je crois, William, répondit l’objet de cette affectueuse sollicitude, que je suis fatigué, et je vais aller me coucher.
— Mon cher Frédéric, répliqua l’autre, que je ne te retienne pas ; ne sacrifie pas tes goûts aux miens.
— Les veilles, l’air un peu lourd de ma chambre et les années aussi, je suppose, dit Frédéric, tout ça contribue à m’affaiblir.
— Mon cher Frédéric, répondit le doyen, penses-tu que tu prennes assez de soin de ta santé ? Penses-tu que tes habitudes soient aussi régulières et aussi méthodiques que le sont… les miennes, par exemple ? Pour ne pas ramener sur le tapis cette petite excentricité à laquelle j’ai fait allusion tout à l’heure, je doute que tu prennes assez d’air et assez d’exercice, Frédéric. Voici une promenade qui est toujours à ton service. Pourquoi ne pas en profiter plus souvent que tu ne le fais ?
— Ah ! soupira l’autre. Oui, oui, oui.
— Mais il est parfaitement inutile de dire oui, oui, mon cher Frédéric, persista le doyen avec sa douce sagesse, si tu ne veux pas en profiter. Tu n’as qu’à me voir, Frédéric, tu peux prendre exemple sur moi. La nécessité et le temps m’ont appris ce que je