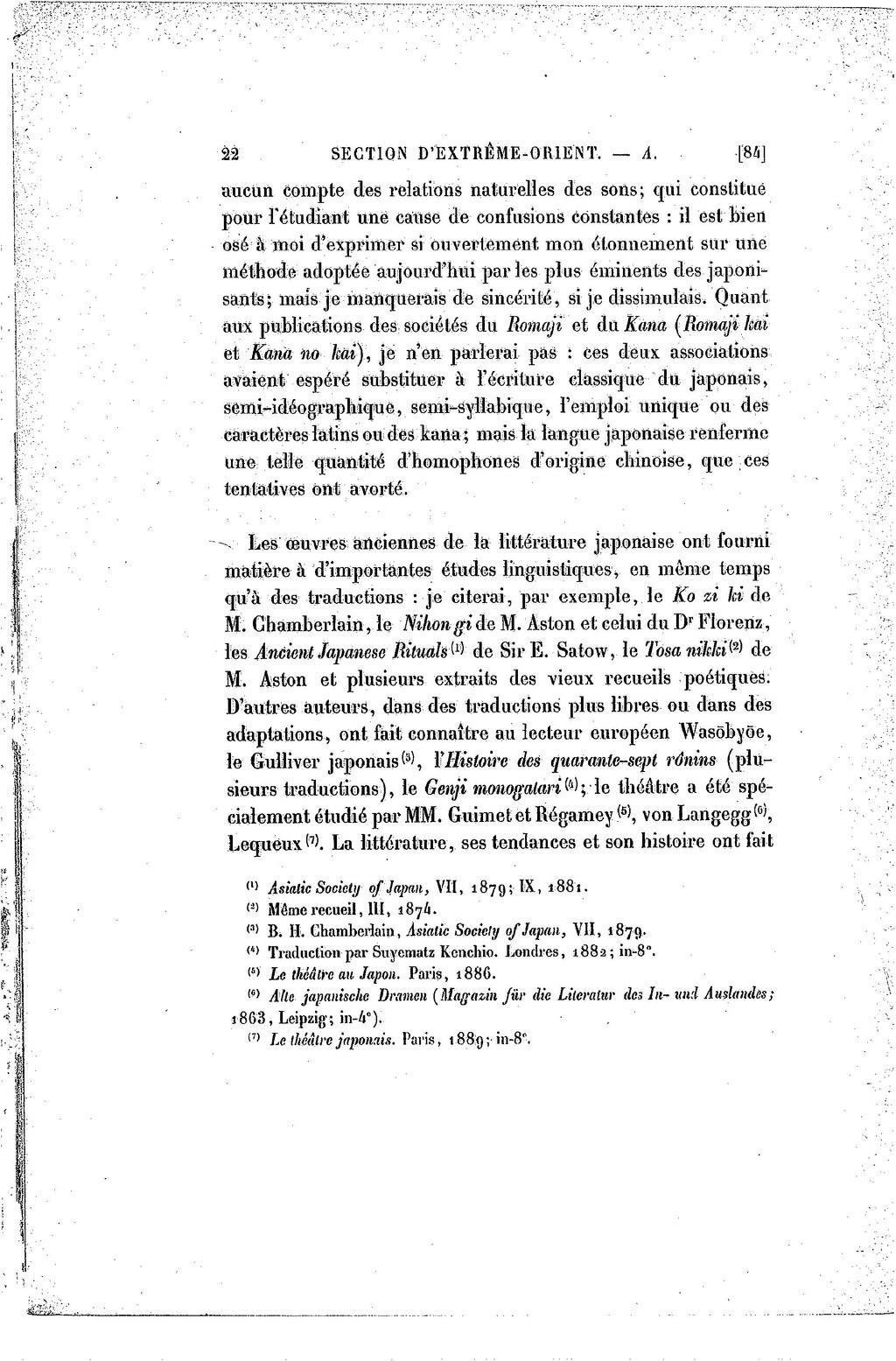aucun compte des relations naturelles des sons ; qui constitué pour l’étudiant une cause de confusions constantes : il est bien osé à moi d’exprimer si ouvertement mon étonnement sur une méthode adoptée aujourd’hui par les plus éminents des japonisants ; mais je manquerais de sincérité, si je dissimulais. Quant aux publications des sociétés du Romaji et du Kana (Romaji kai et Kana no kai), je n’en parlerai pas : ces deux associations avaient espéré substituer à l’écriture classique du japonais, semi-idéographique, semi-syllabique, l’emploi unique ou des caractères latins ou des kana ; mais la langue japonaise renferme une telle quantité d’homophones d’origine chinoise, que ces tentatives ont avorté.
Les œuvres anciennes de la littérature japonaise ont fourni matière à d’importantes études linguistiques, en même temps qu’à des traductions : je citerai, par exemple, le Ko zi ki de M. Chamberlain, le Nihon gi, M. Aston et celui du Dr Florenz, les Ancient Japanese Rituals[1] de Sir E. Satow, le Tosa nikki[2] de M. Aston et plusieurs extraits des vieux recueils poétiques. D’autres auteurs, dans des traductions plus libres ou dans des adaptations, ont fait connaître au lecteur européen Wasōbyōe, le Gulliver japonais[3], l’Histoire des quarante-sept rônins (plusieurs traductions), le Genji monogatari[4] ; le théâtre a été spécialement étudié par MM. Guimet et Régamey[5], von Langegg[6], Lequeux[7]. La littérature, ses tendances et son histoire ont fait
- ↑ Asiatic Society of Japan, VII, 1879 ; IX, 1881.
- ↑ Même recueil, III, 1874.
- ↑ B. H. Chamberlain, Asiatic Society of Japan, VII, 1879.
- ↑ Traduction par Suyematz Kenchio. Londres, 1882 ; in-8o.
- ↑ Le théâtre au Japon. Paris, 1886.
- ↑ Alte japanische Dramen (Magazin für die Literalur des In- und Auslandes ; 1863, Leipzig ; in-4o).
- ↑ Le théâtre japonais. Paris, 1889 ; in-8o.