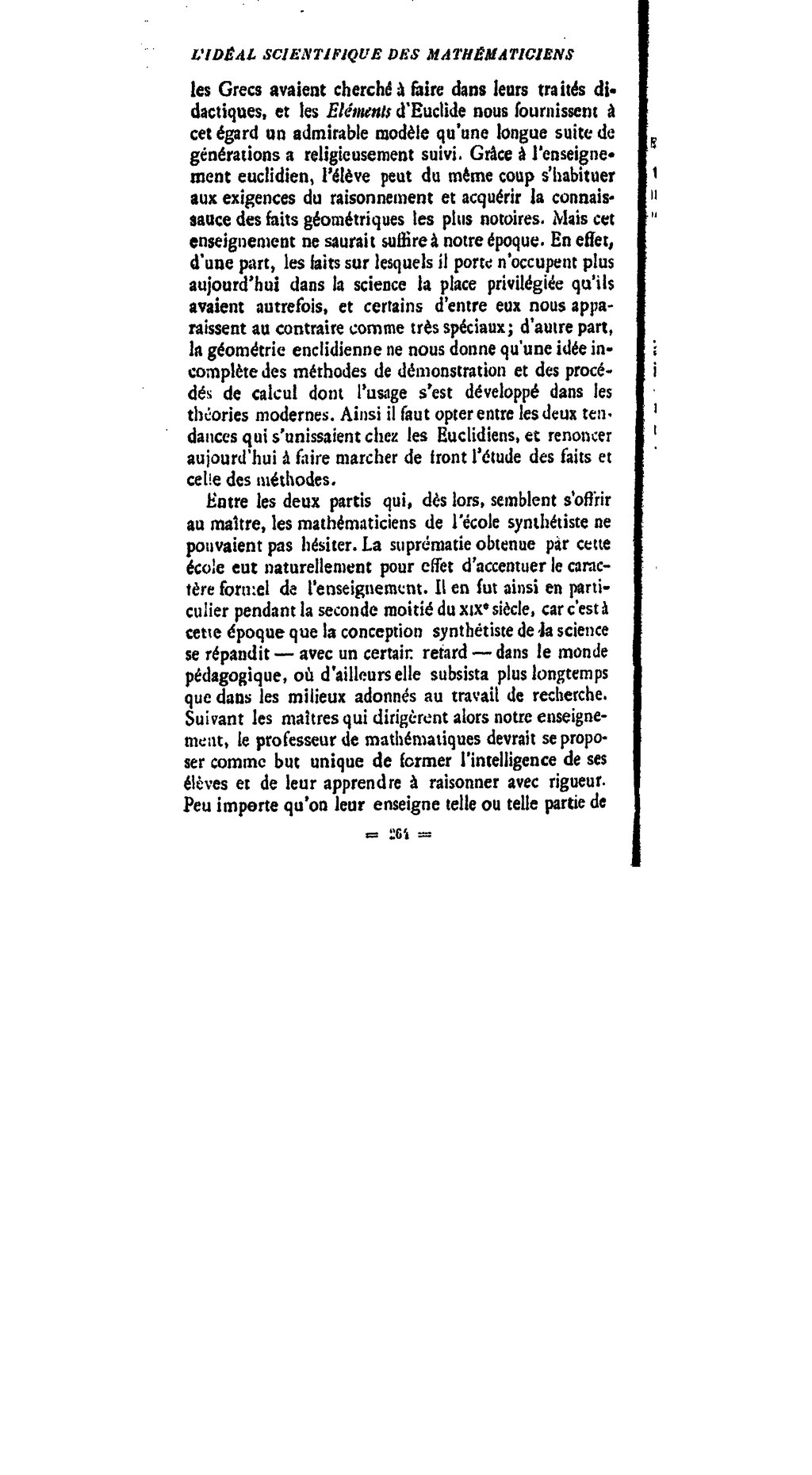les Grecs avaient cherché à faire dans leurs traités didactiques, et les Éléments d’Euclide nous fournissent à cet égard un admirable modèle qu’une longue suite de générations a religieusement suivi. Grâce à l’enseignement euclidien, l’élève peut du même coup s’habituer aux exigences du raisonnement et acquérir la connaissance des faits géométriques les plus notoires. Mais cet enseignement ne saurait suffire à notre époque. En effet, d’une part, les faits sur lesquels il porte n’occupent plus aujourd’hui dans la science la place privilégiée qu’ils avaient autrefois, et certains d’entre eux nous apparaissent au contraire comme très spéciaux ; d’autre part, la géométrie euclidienne ne nous donne qu’une idée incomplète des méthodes de démonstration et des procédés de calcul dont l’usage s’est développé dans les théories modernes. Ainsi il faut opter entre les deux tendances qui s’unissaient chez les Euclidiens, et renoncer aujourd’hui à faire marcher de front l’étude des faits et celle des méthodes.
Entre les deux partis qui, dès lors, semblent s’offrir au maître, les mathématiciens de l’école synthétiste ne pouvaient pas hésiter. La suprématie obtenue par cette école eut naturellement pour effet d’accentuer le caractère formel de l’enseignement. Il en fut ainsi en particulier pendant la seconde moitié du xixe siècle, car c’est à cette époque que la conception synthétiste de la science se répandit — avec un certain retard — dans le monde pédagogique, où d’ailleurs elle subsista plus longtemps que dans les milieux adonnés au travail de recherche. Suivant les maîtres qui dirigèrent alors notre enseignement, le professeur de mathématiques devrait se proposer comme but unique de former l’intelligence de ses élèves et de leur apprendre à raisonner avec rigueur. Peu importe qu’on leur enseigne telle ou telle partie de