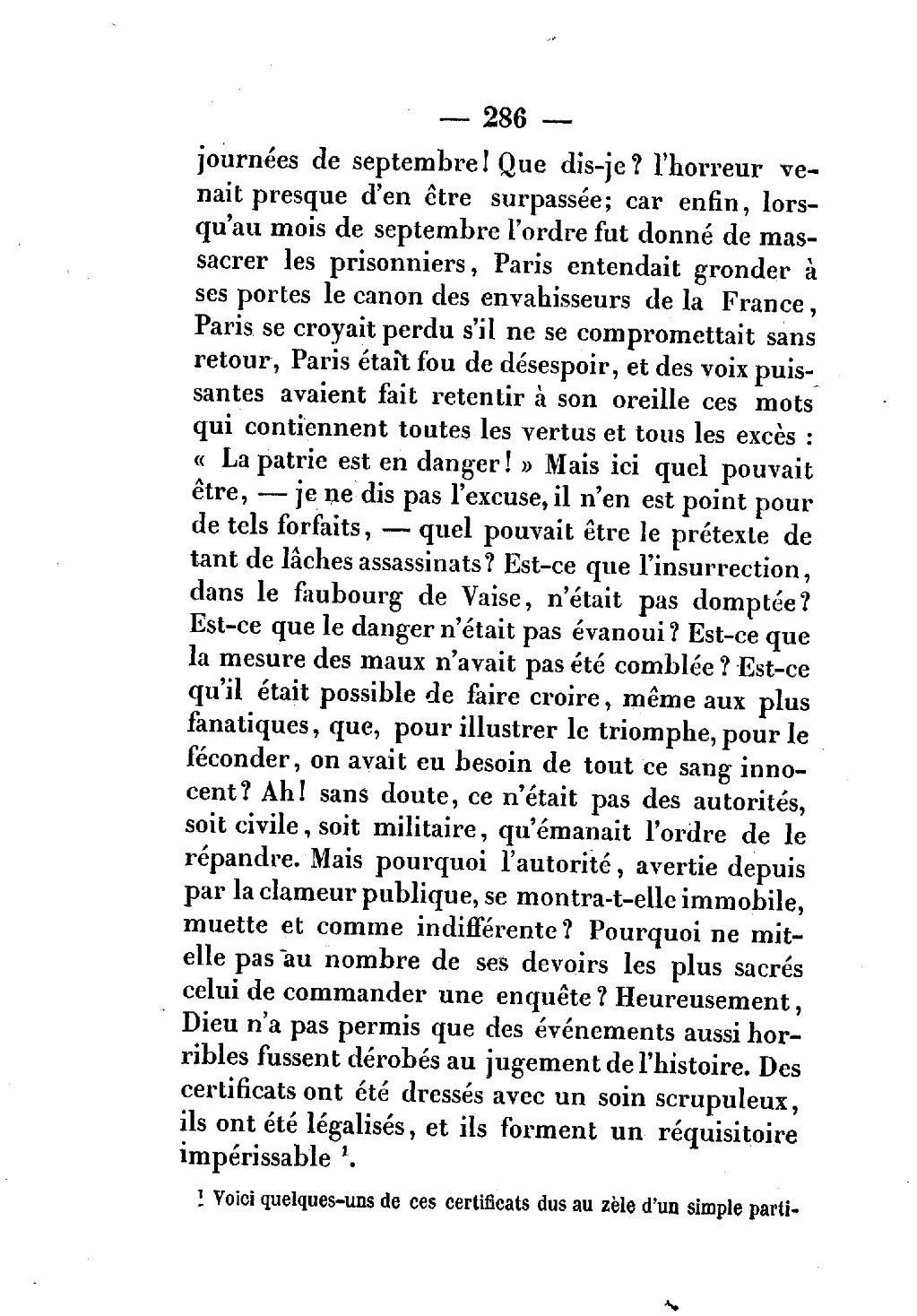journées de septembre ! Que dis-je ? l’horreur venait presque d’en être surpassée ; car enfin, lorsqu’au mois de septembre l’ordre fut donné de massacrer les prisonniers, Paris entendait gronder à ses portes le canon des envahisseurs de la France, Paris se croyait perdu s’il ne se compromettait sans retour, Paris était fou de désespoir, et des voix puissantes avaient fait retentir à son oreille ces mots qui contiennent toutes les vertus et tous les excès : « La patrie est en danger ! » Mais ici quel pouvait être, — je ne dis pas l’excuse, il n’en est point pour de tels forfaits, — quel pouvait être le prétexte de tant de lâches assassinats ? Est-ce que l’insurrection, dans le faubourg de Vaise, n’était pas domptée ? Est-ce que le danger n’était pas évanoui ? Est-ce que la mesure des maux n’avait pas été comblée ? Est-ce qu’il était possible de faire croire, même aux plus fanatiques, que, pour illustrer le triomphe, pour le féconder, on avait eu besoin de tout ce sang innocent ? Ah ! sans doute, ce n’était pas des autorités, soit civile, soit militaire, qu’émanait l’ordre de le répandre. Mais pourquoi l’autorité, avertie depuis par la clameur publique, se montra-t-elle immobile, muette et comme indifférente ? Pourquoi ne mitelle pas au nombre de ses devoirs les plus sacrés celui de commander une enquête ? Heureusement, Dieu n’a pas permis que des événements aussi horribles fussent dérobés au jugement de l’histoire. Des certificats ont été dressés avec un soin scrupuleux, ils ont été légalisés, et ils forment un réquisitoire impérissable[1].
- ↑ Voici quelques-uns de ces certificats dus au zèle d’un simple parti-