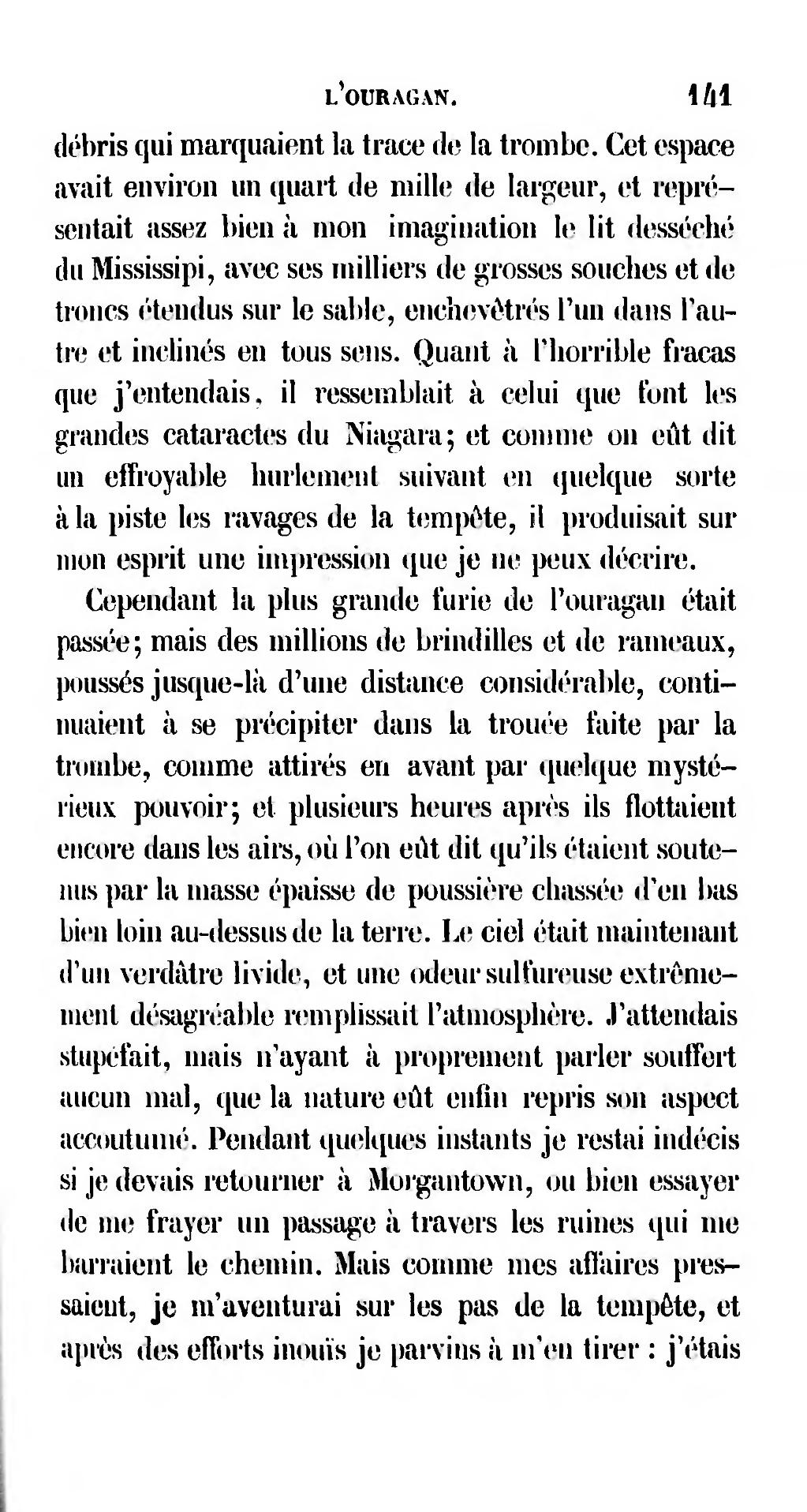débris qui marquaient la trace de la trombe. Cet espace avait environ un quart de mille de largeur, et représentait assez bien à mon imagination le lit desséché du Mississipi, avec ses milliers de grosses souches et de troncs étendus sur le sable, enchevêtrés l’un dans l’autre et inclinés en tous sens. Quant à l’horrible fracas que j’entendais, il ressemblait à celui que font les grandes cataractes du Niagara ; et comme on eût dit un effroyable hurlement suivant en quelque sorte à la piste les ravages de la tempête, il produisait sur mon esprit une impression que je ne peux décrire.
Cependant la plus grande furie de l’ouragan était passée ; mais des millions de brindilles et de rameaux, poussés jusque-là d’une distance considérable, continuaient à se précipiter dans la trouée faite par la trombe, comme attirés en avant par quelque mystérieux pouvoir ; et plusieurs heures après ils flottaient encore dans les airs, où l’on eût dit qu’ils étaient soutenus par la masse épaisse de poussière chassée d’en bas bien loin au-dessus de la terre. Le ciel était maintenant d’un verdâtre livide, et une odeur sulfureuse extrêmement désagréable remplissait l’atmosphère. J’attendais stupéfait, mais n’ayant à proprement parler souffert aucun mal, que la nature eût enfin repris son aspect accoutumé. Pendant quelques instants je restai indécis si je devais retourner à Morgantown, ou bien essayer de me frayer un passage à travers les ruines qui me barraient le chemin. Mais comme mes affaires pressaient, je m’aventurai sur les pas de la tempête, et après des efforts inouïs je parvins à m’en tirer : j’étais