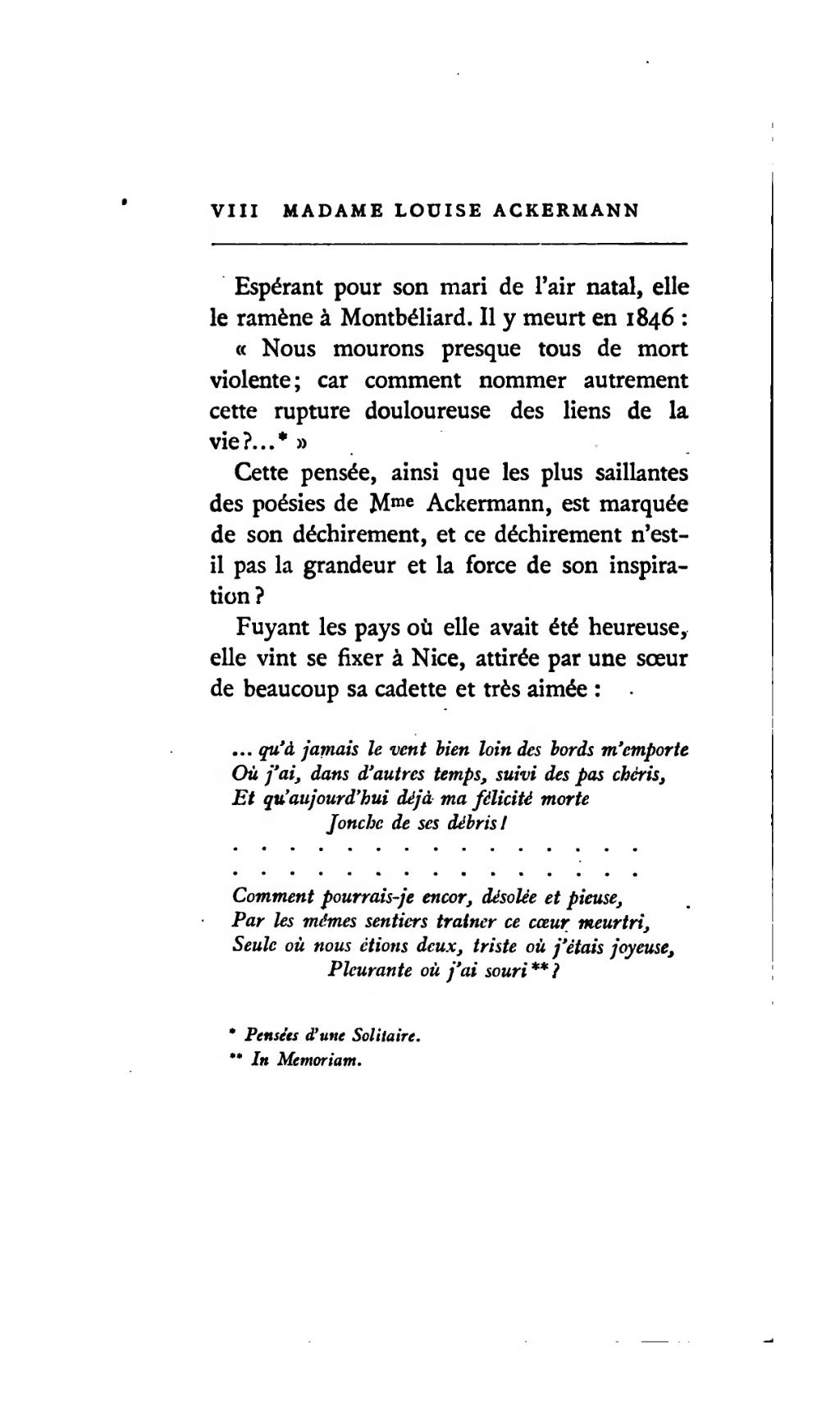Espérant pour son mari de l’air natal, elle le ramène à Montbéliard. Il y meurt en 1846 :
« Nous mourons presque tous de mort violente ; car comment nommer autrement cette rupture douloureuse des liens de la vie ?…[1] »
Cette pensée, ainsi que les plus saillantes des poésies de Mme Ackermann, est marquée de son déchirement, et ce déchirement n’est-il pas la grandeur et la force de son inspiration ?
Fuyant les pays où elle avait été heureuse, elle vint se fixer à Nice, attirée par une sœur de beaucoup sa cadette et très aimée :
… qu’à jamais le vent bien loin des bords m’emporte
Où j’ai, dans d’autres temps, suivi des pas chéris,
Et qu’aujourd’hui déjà ma félicité morte
Jonche de ses débris !
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Comment pourrais-je encor, désolée et pieuse,
Par les mêmes sentiers traîner ce cœur meurtri,
Seule où nous étions deux, triste où j’étais joyeuse,
Pleurante où j’ai souri[2] ?