Les Sept Cordes de la lyre (Recueil)/Texte entier
LE DIEU INCONNU — LA FILLE D’ALBANO

LES SEPT CORDES DE LA LYRE
MAÎTRE ALBERTUS.
HANZ |
ses élèves. |
MÉPHISTOPHÉLÈS
Un Poëte
Un Peintre.
Un Maître de chapelle.
Un Critique.
L’Esprit de la Lyre.
Les Esprits célestes
THÉRÈSE, gouvernante d’Hélène.
ACTE PREMIER
Dans la chambre de maître Albertus. Il écrit. Wilhelm entre sur la pointe du pied. Il fait nuit. On entend dans le lointain le bruit d’une fête.
Scène PREMIÈRE. — MAÎTRE ALBERTUS, WILHELM.
MAÎTRE ALBERTUS, sans tourner la tête. Qui est là ? Est-ce-vous, Hélène ?
WILHELM, à part. Hélène ! Est-ce qu’elle entre quelquefois dans la chambre du philosophe à minuit ? (Haut.) Maître, c’est moi, Wilhelm.
ALBERTUS. Je te croyais à la fête.
WILHELM. J’en viens. J’ai vainement essayé de me divertir. Autrefois, il ne m’eût fallu que respirer l’air d’une fête pour sentir mon cœur tressaillir de jeunesse et de bonheur ; aujourd’hui, c’est différent !
ALBERTUS. Ne dirait-on pas que l’âge a glacé ton sang ! C’est la mode, au reste ! Tous les jeunes gens se disent blasés. Encore, s’ils quittaient les plaisirs pour l’étude ! mais il n’en est rien. Leur amusement consiste à se faire tristes et à se croire malheureux. Ah ! la mode est vraiment une chose bizarre !
WILHELM. Maître, je vous admire, vous qui n’êtes jamais ni triste ni gai ; vous qui êtes toujours seul, et toujours calme ! L’allégresse publique ne vous entraîne pas dans son tourbillon ; elle ne vous fait pas sentir non plus l’ennui de votre isolement. Vous entendez passer les sérénades, vous voyez les façades s’illuminer, vous apercevez même d’ici le bal champêtre avec ses arcs en verres de couleur et ses légères fusées qui retombent en pluie d’or sur le dôme verdoyant des grands marronniers ; et vous voilà devisant philosophiquement peut-être sur le rapport qui peut exister entre votre paisible subjectivité et l’objectivité délirante de tous ces petits pieds qui dansent là-bas sur l’herbe ! Comment ! ces robes blanches qui passent et repassent comme des ombres à travers les bosquets ne vous font pas tressaillir, et votre plume court sur le papier comme si c’était une ronde de watchmen qui interrompt le silence de la nuit ?
ALBERTUS. Ce que j’éprouve à l’aspect d’une fête ne peut t’intéresser que médiocrement. Mais toi-même, qui me reproches mon indifférence, comment se fait-il que tu rentres de si bonne heure ?
WILHELM. Cher maître, je vous dirai la vérité ; je m’ennuie là où je suis sûr de ne pas rencontrer Hélène.
ALBERTUS, tressaillant. Tu l’aimes donc toujours autant ?
WILHELM. Toujours davantage. Depuis qu’elle a recouvré la raison, grâce à vos soins, elle est plus séduisante que jamais. Ses souffrances passées ont laissé une empreinte de langueur ineffable sur son front ; et sa mélancolie, qui décourage Carl et qui déconcerte Hanz lui-même, est pour moi un attrait de plus. Oh ! elle est charmante ! Vous ne vous apercevez pas de cela, vous, maître Albertus ! Vous la voyez grandir et embellir sous vos yeux, vous ne savez pas encore que c’est une jeune fille. Vous voyez toujours en elle une enfant ; vous ne savez pas seulement si elle est brune ou blonde, grande ou petite.
ALBERTUS. En vérité, je crois qu’elle n’est ni petite ni grande, ni blonde ni brune.
WILHELM. Vous l’avez donc bien regardée ?
ALBERTUS. Je l’ai vue souvent sans songer à la regarder.
WILHELM. Eh bien, que vous semble-t-elle ?
ALBERTUS. Belle comme une harmonie pure et parfaite. Si la couleur de ses yeux ne m’a pas frappé, si je n’ai pas remarqué sa stature, ce n’est pas que je sois incapable de voir et de comprendre la beauté ; c’est que sa beauté est si harmonieuse, c’est qu’il y a tant d’accord entre son caractère et sa figure, tant d’ensemble dans tout son être, que j’éprouve le charme de sa présence, sans analyser les qualités de sa personne.
WILHELM, un peu troublé. Voilà qui est admirablement bien dit pour un philosophe ! et je ne vous aurais jamais cru susceptible…
ALBERTUS. Raille, raille-moi bien, mon bon Wilhelm ! C’est un animal si déplaisant et si disgracieux qu’un philosophe !
WILHELM. Oh ! mon cher maître, ne parlez pas ainsi. Moi, vous railler ! oh ! mon Dieu ! vous le meilleur et le plus grand parmi les plus grands et les meilleurs des hommes !… Mais si vous saviez combien je suis heureux que vous n’aimiez pas les femmes !… Si, par hasard, vous alliez vous trop apercevoir des grâces d’Hélène, que deviendrais-je, moi, pauvre écolier sans barbe et sans cervelle, en concurrence avec un homme de votre mérite !
ALBERTUS. Cher enfant, je ne ferai jamais concurrence ni à toi ni à personne, je sais trop me rendre justice ; j’ai passé l’âge de plaire et celui d’aimer.
WILHELM. Que dites-vous là, mon maître ! Vous avez à peine atteint la moitié de la durée moyenne de la vie ! Votre front, un peu dévasté par les veilles et l’étude, n’a pourtant pas une seule ride ; et, quand le feu d’un noble enthousiasme vient animer vos yeux, nous baissons les nôtres, jeunes gens que nous sommes, comme à l’aspect d’un être supérieur à nous, comme à l’éclat d’un rayon céleste !
ALBERTUS. Ne dis pas cela, Wilhelm ; c’est m’affliger en vain. La grâce et le charme sont le partage exclusif de la jeunesse ; la beauté de l’âge mûr est un fruit d’automne qu’on laisse gâter sur la branche, parce que les fruits de l’été ont apaisé la soif. (Une pause.) À vrai dire, Wilhelm, je n’ai point eu de jeunesse, et le fruit desséché tombera sans avoir attiré l’œil ou la main des passants.
wilhelm. On me l’avait dit, maître, et je ne pouvais le croire. Serait-il vrai, en effet, que vous n’eussiez jamais aimé ?
albertus. Il est trop vrai, mon ami. Mais tout regret serait vain et inutile aujourd’hui.
wilhelm. Jamais aimé ! Pauvre maître !… Mais vous avez eu tant d’autres joies sublimes dont nous n’avons pas d’idée.
albertus, brusquement. Eh oui ! sans doute, sans doute. — Wilhelm ! tu veux donc épouser Hélène ?
wilhelm. Cher maître, vous savez bien que, depuis deux ans, c’est mon unique vœu.
albertus. Et tu quitterais tes études pour prendre un métier ? car enfin il te faut pouvoir élever une famille, et la philosophie n’est pas un état lucratif.
wilhelm. Peu m’importe ce qu’il faudrait faire. Vous savez bien que, lorsqu’il fut question de mon mariage avec Hélène, le vieux luthier Meinbaker, son père, avait exigé que je quittasse les bancs pour l’atelier, l’étude des sciences pour les instruments de travail, les livres d’histoire et de métaphysique pour les livres de commerce. Le bonhomme ne voulait pour gendre qu’un homme capable de manier la lime et le rabot comme le plus humble ouvrier, et de diriger sa fabrique comme lui-même. Eh bien, j’avais souscrit à tout cela : rien ne m’eût coûté pour obtenir sa fille. Déjà j’étais capable de confectionner la meilleure harpe qui fût sortie de son atelier. Pour les violons, je ne craignais aucun rival. Dieu aidant, avec mon petit talent et le mince capital que je possède, je pourrais encore acheter un fonds d’établissement, et monter un modeste magasin d’instruments de musique.
albertus. Tu renoncerais donc sans regret, Wilhelm, à cultiver ton intelligence, à élargir le cercle de tes idées, à élever ton âme vers l’idéal ?
wilhelm. Oh ! voyez-vous, maître, j’aime. Cela répond à tout. Si, au temps de sa richesse, Meinbaker, au lieu de sa charmante fille, m’eût offert son immense fortune, et avec cela les honneurs qu’on ne décerne qu’aux souverains, je n’eusse pas hésité à rester fidèle au culte de la science, et j’aurais foulé aux pieds tous ces biens terrestres pour m’élever vers le ciel. Mais Hélène, c’est pour moi l’idéal, c’est le ciel, ou plutôt c’est l’harmonie qui régit les choses célestes. Je n’ai plus besoin d’intelligence ; il me suffit de voir Hélène pour comprendre d’emblée toutes les merveilles que l’étude patiente et les efforts du raisonnement ne m’eussent révélées qu’une à une. Cher maître, vous ne pouvez pas comprendre cela, vous, c’est tout simple. Mais, moi, je crois que par l’amour j’arriverai plus vite à la foi, à la vertu, à la Divinité, que vous par l’étude et l’abstinence. D’ailleurs, il en serait autrement que je serais encore résolu à perdre l’intelligence afin de vivre par le cœur…
albertus. Peut-être tes sens te gouvernent à ton insu, et te suggèrent ces ingénieux sophismes, que je n’ose combattre, dans la crainte de te paraître infatué de l’orgueil philosophique. Cher enfant, sois heureux selon tes facultés, et cède aux élans de ta jeunesse impétueuse. Un jour viendra certainement où tu regarderas en arrière, effrayé d’avoir laissé ton intelligence s’endormir dans les délices…
wilhelm. De même, maître, qu’après une carrière consacrée aux spéculations scientifiques, il arrive à l’homme austère de regarder dans le passé, effrayé d’avoir laissé ses passions s’éteindre dans l’abstinence.
albertus. Tu dis trop vrai, Wilhelm !… Tiens, regarde cette lyre. Sais-tu ce que c’est ?
wilhelm. C’est la fameuse lyre d’ivoire inventée et confectionnée par le célèbre luthier Adelsfreit, digne ancêtre d’Hélène Meinbaker. Il la termina, dit-on, le jour même de sa mort, il y a environ cent ans ; et le bon Meinbaker la conservait comme une relique, sans permettre que sa propre fille l’effleurât même de son haleine. C’est un instrument précieux, maître, et dont l’analogue ne se retrouverait nulle part. Les ornements en sont d’un goût si exquis, et les figures d’ivoire qui l’entourent sont d’un travail si admirable, que des amateurs en ont offert des sommes immenses. Mais, quoique ruiné, Meinbaker eût mieux aimé mourir de faim que de laisser cet instrument incomparable sortir de sa maison.
albertus. Pourtant cet instrument incomparable est muet. C’est une œuvre de patience et un objet d’art qui ne sert à rien, et dont il est impossible aujourd’hui de tirer aucun son. Ses cordes sont détendues ou rouillées, et le plus grand artiste ne pourrait les faire résonner…
wilhelm. Où voulez-vous en venir, maître ?
albertus. À ceci : que l’âme est une lyre dont il faut faire vibrer toutes les cordes, tantôt ensemble, tantôt une à une, suivant les règles de l’harmonie et de la mélodie ; mais que, si on laisse rouiller ou détendre ces cordes à la fois délicates et puissantes, en vain l’on conservera avec soin la beauté extérieure de l’instrument, en vain l’or et l’ivoire de la lyre resteront purs et brillants ; la voix du ciel ne l’habite plus, et ce corps sans âme n’est plus qu’un meuble inutile.
wilhelm. Ceci peut s’appliquer à vous et à moi, mon cher maître. Vous avez trop joué sur les cordes d’or de la lyre ; et, pendant que vous vous enfermiez dans votre thème favori, les cordes d’airain se sont brisées. Pour moi, ce sera le contraire. Je brise volontairement les cordes célestes que vous avez touchées, afin de jouer avec une ivresse impétueuse sur les cordes passionnées que vous méprisez trop.
albertus. Et tous deux nous sommes inhabiles, incomplets, aveugles. Il faudrait savoir jouer des deux mains et sur tous les modes…
wilhelm, sans l’écouter. Maître Albertus, vous avez tant d’empire sur l’esprit d’Hélène ! Voulez-vous vous charger de lui renouveler mes instances, afin qu’elle m’accepte pour mari ?
albertus. Mon enfant, je m’y emploierai de tout mon cœur et de tout mon pouvoir, car je suis persuadé qu’elle ne pourrait faire un meilleur choix.
wilhelm. Soyez béni, et que le ciel couronne vos efforts ! Bonsoir, mon bon maître. Pardonnez-moi d’être si peu philosophe. Oubliez le disciple ingrat qui vous abandonne, mais souvenez-vous de l’ami dévoué qui vous reste à jamais fidèle.
Scène II. — ALBERTUS, seul.
Ô sublime philosophie ! c’est ainsi qu’on déserte tes autels ! Avec quelle facilité on te délaisse pour la première passion qui s’empare des sens ! Ton empire est donc bien nul, et ton ascendant bien dérisoire ? — Hélas ! quelle est donc la faiblesse des liens dont tu nous enchaînes, puisque, après des années d’immolation, après la moitié d’une vie consacrée à l’héroïque persévérance, nous ressentons encore avec tant d’amertume l’horreur de la solitude et les angoisses de l’ennui !…
Souverain esprit, source de toute lumière et de toute perfection, toi que j’ai voulu connaître, sentir et voir de plus près que ne font les autres hommes, toi qui sais que j’ai tout immolé, et moi-même plus que tout le reste, pour me rapprocher de toi en me purifiant ! puisque toi seul connais la grandeur de mes sacrifices et l’immensité de ma souffrance, d’où vient que tu ne m’assistes pas plus efficacement dans mes heures de détresse ? D’où vient qu’en proie à une lente agonie, je me consume au dedans comme une lampe dont la clarté jette un plus vif éclat au moment où l’huile va manquer ? D’où vient qu’au lieu d’être ce sage, ce stoïque dont chacun admire et envie la sérénité, je suis le plus incertain, le plus dévoré, le plus misérable des hommes ? (s’approchant du balcon.) Principe éternel, âme de l’univers, ô grand esprit, ô Dieu ! toi qui resplendis dans ce firmament sublime et qui vis dans l’infini de ces soleils et de ces mondes étincelants, tu sais que ce n’est point l’amour d’une vaine gloire ni l’orgueil d’un savoir futile qui m’ont conduit dans cette voie de renoncement aux choses terrestres. Tu sais que, si j’ai voulu m’élever au-dessus des autres hommes par la vertu, ce n’est pas pour m’estimer plus qu’eux, mais pour me rapprocher davantage de toi, source de toute lumière et de toute perfection. J’ai préféré les délices de l’âme aux jouissances de la matière périssable ; et tu sais, ô toi qui lis dans les cœurs, combien le mien était pur et sincère ! Pourquoi donc ces défaillances mortelles qui me saisissent ? Pourquoi ces doutes cruels qui me déchirent ? Le chemin de la sagesse est-il donc si rude, que, plus on y avance, plus on rencontre d’obstacles et de périls ? Pourquoi, lorsque j’ai déjà fourni la moitié de la carrière, et lorsque j’ai passé victorieux les années les plus orageuses de la jeunesse, suis-je, dans mon âge mûr, exposé à des épreuves de plus en plus terribles ? Regretterais-je donc, à présent qu’il est trop tard, ce que j’ai méprisé alors qu’il était temps encore de le posséder ? Le cœur de l’homme est-il ainsi fait que l’orgueil seul le soutienne dans sa force, et ne saurait-il accepter la douleur si elle ne lui vient de sa propre volonté ? — On dit toujours aux philosophes qu’ils sont orgueilleux !… S’il était vrai ! Si j’avais regardé comme une offrande agréable à la Divinité des privations qu’elle repousse ou qu’elle voit avec pitié comme les témoignages de notre faiblesse et de notre aveuglement ! si j’avais vécu sans fruit et sans mérite ! si j’avais souffert en vain ! — Mon Dieu ! des souffrances si obstinées, des luttes si poignantes, des nuits si désolées, des journées si longues et si lourdes à porter jusqu’au soir ! — Non, c’est impossible ; Dieu ne serait pas bon, Dieu ne serait pas juste s’il ne me tenait pas compte d’un si grand labeur ! Si je me suis trompé, si j’ai fait un mauvais usage de ma force, la faute en est à l’imperfection de ma nature, à la faiblesse de mon intelligence, et la noblesse de mes intentions doit m’absoudre !… M’absoudre ? Quoi ! rien de plus ? Le même pardon que, dans sa longanimité dédaigneuse, le juge accorderait aux voluptueux et aux égoïstes !… M’absoudre ? Suis-je donc un dévot, suis-je un mystique pour croire que la Divinité n’accueille dans son sein que les ignorants et les pauvres d’esprit ? Suis-je un moine pour placer ma foi dans un maître aveugle, ami de la paresse et de l’abrutissement ? — Non ! la Divinité que je sers est celle de Pythagore et de Platon, aussi bien que celle de Jésus ! Il ne suffit pas d’être humble et charitable pour se la rendre propice, il faut encore être grand ; il faut cultiver les hautes facultés de l’intelligence aussi bien que les doux instincts du cœur pour entrer en commerce avec cette puissance infinie, qui est la perfection même, qui conserve par la bonté, mais qui règne par la justice… C’est à ton exemple, ô perfection sans bornes, que l’homme doit se faire juste, et il n’est point de justice sans la connaissance. — Si tu n’as pas cette connaissance, ô mon âme misérable, si tes travaux et tes efforts ne t’ont conduite qu’à l’erreur, si tu n’es pas dans la voie qui doit servir de route aux autres âmes, tu es maudite, et tu n’as qu’à te réfugier dans la patience de Dieu, qui pardonne aux criminels et relève les abjects… Abject ! criminel ! moi dont la vertu épouvante les cœurs tendres et désespère les esprits envieux… Orgueilleux ! orgueilleux ! Il me semble que, du haut de ces étoiles, une voix éclatante me crie : « Tu n’es qu’un orgueilleux ! »
Ô vous qui passez dans la joie, vous dont la vie est une fête, jeunes gens dont les voix fraîches s’appellent et se répondent du sein de ces bosquets où vous folâtrez autour des lumières, comme de légers papillons de nuit ! belles filles chastes et enjouées qui préludez par d’innocentes voluptés aux joies austères de l’hyménée ! artistes et poètes qui n’avez pour règle et pour but que la recherche et la possession de tout ce qui enivre l’imagination et délecte les sens ! hommes mûrs, pleins de projets et de désirs pour les jouissances positives ! vous tous qui ne formez que des souhaits faciles à réaliser, et ne concevez que des joies naïves ou vulgaires, vous voilà tous contents ! Et moi, seul au milieu de cette ivresse, je suis triste, parce que je n’ai pas mis mon espoir en vous, et que vous ne pouvez rien pour moi ! Vous composez à vous tous une famille dont nul ne peut s’isoler et où chacun peut être utile ou agréable à un autre. Il en est même qui sont aimés ou recherchés de tous. Il n’en est pas un seul qui n’ait dans le cœur quelque affection, quelque espérance, quelque sympathie ! Et moi, je me consume dans un éternel tête-à-tête avec moi-même, avec le spectre de l’homme que j’aurais pu être et que j’ai voulu tuer ! Comme un remords, comme l’ombre d’une victime, il s’acharne à me suivre, et sans cesse il me redemande la vie que je lui ai ôtée. Il raille amèrement l’autre moi, celui que j’ai consacré au culte de la sagesse ; et, quand il ne m’accable pas de son ironie, il me déchire de ses reproches ! Et quelquefois il rentre en moi, il se roule dans mon sein comme un serpent, il y souffle une flamme dévorante ; et, quand il me quitte, il y laisse un venin mortel qui empoisonne toutes mes pensées et glace toutes mes aspirations ! Ô enfants de la terre, ô fils des hommes ! à cette heure, aucun de vous ne pense à moi, ne s’intéresse à moi, n’espère en moi, ne souffre pour moi ! et pourtant je souffre, je souffre ce qu’aucun de vous n’a jamais souffert et ne souffrira jamais ! (La lyre rend un son plaintif. — Albertus, après quelques instants de silence.) Qu’ai-je donc entendu ? Il m’a semblé qu’une voix répondait par un soupir harmonieux au sanglot exhalé de ma poitrine. Si c’était la voix d’Hélène ! Ma fille adoptive serait-elle touchée des secrètes douleurs de son vieil ami ? La faible clarté de cette lampe… Non ! je suis seul ! Oh ! non, Hélène dort. Peut-être qu’à cette heure elle rêve que, soutenue par le bras de Wilhelm, elle erre avec lui sur la mousse du parc, aux reflets d’azur de la lune, ou bien qu’elle danse là-bas dans le bosquet, belle à la clarté de cent flambeaux, entourée de cent jeunes étudiants qui admirent la légèreté de ses pieds et la souplesse de ses mouvements. Hélène est fière, elle est heureuse, elle est aimée… Peut-être aime-t-elle aussi !… Elle ne saurait penser à moi. Qui pourrait penser à moi ? Je suis oublié de tous, indifférent à tous. Qui sait ? haï, peut-être ! Haï ! ce serait affreux ! (La lyre rend un son douloureux.) Pour le coup, je ne me trompe pas ; il y a ici une voix qui chante et qui pleure avec moi… Est-ce le vent du soir qui se joue dans les jasmins de la fenêtre ? est-ce une voix du ciel qui résonne dans les cordes de la lyre ? — Non, cette lyre est muette, et plusieurs générations ont passé sans réveiller le souffle éteint dans ses entrailles. Tel un cœur généreux s’engourdit et se dessèche au milieu des indifférents qui l’oublient ou le méconnaissent. Ô lyre, image de mon âme ! entre les mains d’un grand artiste, tu aurais rendu des sons divins ; et, telle que te voici, abandonnée, détendue, placée sur un socle pour plaire aux yeux, comme un vain ornement, tu n’es plus qu’une machine élégante, une boîte bien travaillée, un cadavre, ouvrage savant du créateur, mais où le cœur ne bat plus, et dont tout ce qui vit s’éloigne avec épouvante… Eh bien, moi, je te réveillerai de ton sommeil obstiné. Un instrument mort ne peut vibrer que sous la main d’un mort… (Il s’approche du socle et prend la lyre.) Que vais-je faire, et quelle folle préoccupation s’empare de moi ? Quand même cette lyre détendue pourrait rendre quelques sons, ma main inhabile ne saurait la soumettre aux règles de l’harmonie. Dors en paix, vieille relique, chef-d’œuvre d’un art que j’ignore ; je vois en toi quelque chose de plus précieux, le legs d’une amitié à laquelle je n’ai pas manqué et le pacte d’une adoption dont je saurai remplir tous les devoirs. (Il replace la lyre sur le socle.) Essayons de terminer ce travail. (Il se remet devant sa table. — S’interrompant après quelques instants de rêverie.) Comme Wilhelm songe à ma pupille ! Quelle puissance que l’amour ! Ô passion fatale ! celui qui te brave est courageux ; celui qui te nie est insensé… Hélène acceptera-t-elle celui qu’elle a déjà refusé ?… Il me semble qu’elle préfère Hanz !… Hanz a une plus haute intelligence ; mais Wilhelm a le cœur plus tendre, et les femmes ont peut-être plus de plaisir à être beaucoup aimées qu’à être bien dirigées et bien conseillées… Carl aussi est amoureux d’elle… c’est une tête légère… mais c’est un bien beau garçon… Je crois que les femmes sont elles-mêmes légères et vaines, et qu’un joli visage a plus de prix à leurs yeux qu’un grand esprit… Les femmes ! Est-ce que je connais les femmes, moi ?… Quel sera le choix d’Hélène ? Que m’importe ? Je lui conseillerai ce qui me semblera le mieux pour son bonheur, et je la marierai, après tout, selon son goût… — Puisse cette belle et pure créature n’être pas flétrie par le souffle des passions brutales !… Ah ! décidément, je ne travaille pas… Ma lampe pâlit. Il faudra bien que ceci suffise pour la leçon de demain. Essayons de dormir ; car, dès le jour, mes élèves viendront m’appeler. (Il se couche sur son grabat.) Hélène n’a guère d’intelligence non plus. C’est un esprit juste, une conscience droite ; mais ses perceptions sont bornées, et la moindre subtilité métaphysique l’embarrasse et la fatigue… Wilhelm lui conviendrait mieux que Hanz… Je m’occupe trop de cela. Ce n’est pas le moment… Mon Dieu, réglez selon la raison et la justice les sentiments de mon cœur et les fonctions de mon être. Envoyez-moi le repos !… (Il s’endort.)
Scène III. — MÉPHISTOPHÉLÈS, sortant de la lampe au moment où elle s’éteint ; ALBERTUS, endormi.
méphistophélès. Quel triste et plat emploi que celui de veiller sur un philosophe ! Vraiment, me voici plus terne et plus obscurci que la flamme de cette lampe, au travers de laquelle je m’amusais à faire passer sur son papier la silhouette d’Hélène et de ses amoureux. Ces logiciens sont des animaux méfiants. On travaille comme une araignée autour de leur froide cervelle pour les enfermer dans le réseau de la dialectique ; mais il arrive qu’ils regimbent et prennent le diable dans ses propres filets. Oui-da ! ils se servent de l’ergotage pour résister au maître qui le leur a enseigné ! Celui-ci emploie la raison démonstrative pour arriver à la foi, et ce qui a perdu les autres le sauve de mes griffes. Pédant mystique, tu me donnes plus de peine que maître Faust, ton aïeul. Il faut qu’il y ait dans tes veines quelques gouttes du sang de la tendre Marguerite, car tu te mêles de vouloir comprendre avec le cœur ! Mais vraiment on ne sait plus ce que devient l’humanité ! Voici des philosophes qui veulent à la fois connaître et sentir. Si nous les laissions faire, l’homme nous échapperait bien vite. Holà ! mes maîtres ! croyez et soyez absurdes, nous y consentons ; mais ne vous mêlez pas de croire et d’être sages. Cela ne sera pas, tant que le diable aura à bail cette chétive ferme qu’il vous plaît d’appeler votre monde.
Or, il faudra procéder autrement avec toi, cher philosophe, qu’avec feu le docteur Faust. Celui-là ne manquait ni d’instincts violents ni de pompeux égoïsme ; et, au moment d’en être affranchi par la mort, l’insensé perdant patience, et regrettant de n’avoir pas mis la vie à profit, je sus le rajeunir et le lancer dans l’orage. Sa froide intelligence s’en allait tout droit à la vérité, si je n’eusse chauffé ses passions à temps et allumé en lui une flamme qui dévora madame la conscience en un tour de main ; mais, avec celui-ci, il est à craindre que les passions ne tournent au profit de la foi. Il a plus de conscience que l’autre ; l’orgueil a plus de prise sur lui, la vanité aucune. Il a si bien terrassé la luxure, qu’il est capable de comprendre la volupté angélique et de se sauver avec sa Marguerite, au lieu de la perdre avec lui. C’est donc à ton cœur que j’ai affaire, mon cher philosophe ; quand je l’aurai tué, ton cerveau fonctionnera à mon gré. Voyons, tourmentons un peu ce cœur qui se mêle d’être sympathique, et, au lieu de le rajeunir, enterrons-le sous les glaces d’une vieillesse prématurée. Il faudrait commencer par dégrader Hélène, ou l’abrutir en la mariant à un butor ; mais les niais trouveraient encore moyen de poétiser ses vertus domestiques. Le mieux, c’est de l’avilir en la prostituant à tous ces apprentis philosophes qui encombrent la maison du matin au soir. En la voyant souillée, ce beau penseur prendra en horreur la jeunesse, la beauté, l’ignorance. Tout ce qui tranchera du romanesque lui semblera criminel, il deviendra franchement cuistre, c’est là que je l’attends… Allons un peu trouver la fille. J’ai là quelques bons reptiles immondes que je promènerai sur son front pendant qu’elle sommeille… Mais il est un obstacle entre elle et moi, et il faut le détruire. Je comptais m’en servir pour perdre le philosophe par l’enthousiasme. Si je procède par les contraires, je dois anéantir le talisman qui allumerait ici les flammes du cœur. Holà ! lutins et fées ! à moi, mes braves serviteurs crochus ! Prenez la lyre et mettez-la en pièces avec vos griffes, réduisez-la en cendres avec votre haleine… Et vite !…
CHŒUR D’ESPRITS INFERNAUX. Eh vite ! eh vite ! brisons la lyre ! Un esprit rebelle aux arrêts de l’enfer habite son sein mystérieux. Un charme le retient enchaîné. Brisons sa prison, afin qu’il retourne à son maître, et qu’il ne puisse plus converser avec les hommes. Eh vite ! eh vite ! brisons la lyre !
Esprit qui fus jadis notre frère, et qui te flattes maintenant d’être réhabilité par l’expiation et replacé au rang des puissances célestes, tu vas sortir d’ici. Que ton maître te reprenne et te châtie ! Tu ne te purgeras pas de ta faute en travaillant au salut des hommes. Eh vite ! eh vite ! brisons la lyre !
LA VOIX DE LA LYRE. Arrière, cris de l’enfer ! Vous ne pouvez rien sur moi. Une main pure doit me délivrer. Maudit ! c’est en vain que tu excites contre moi tes légions à la voix rauque. Une seule note céleste couvre tous les rugissements de l’enfer. Arrière et silence !
MÉPHISTOPHÉLÈS. Que vois-je ! mes légions épouvantées prennent la fuite ! et cette puissance enchaînée est plus forte que moi dans ma liberté !
CHŒUR D’ESPRITS CÉLESTES. Dieu te permet d’exciter au mal, mais tu ne peux l’accomplir toi-même. Tu ne peux remuer une paille dans l’univers ; tu verses ton poison dans les cœurs, mais tu ne saurais faire périr un insecte. Ta semence est stérile si l’homme ne la féconde par sa malice, et l’homme est libre de faire éclore un démon ou un ange dans son sein.
MÉPHISTOPHÉLÈS. Voilà mon homme qui s’éveille. Allons voir si je ne trouverai pas quelque mortel qui haïsse la musique autant qu’un diable, et qui m’aide à briser cette lyre. (Il s’envole.)
ALBERTUS, s’éveillant. J’ai entendu une musique céleste, et les merveilles de l’harmonie, auxquelles je n’ai jamais été sensible, viennent de m’être révélées dans un songe… Mais qui pourrait, dans la réalité, reproduire pour moi une telle harmonie ? Mon cerveau même n’en peut conserver la moindre trace… Il me semblait pourtant qu’à mon réveil je pourrais chanter ce que j’ai entendu… Mais déjà tout est effacé, et je n’entends que le cri perçant des coqs qui s’éveillent. Le jour est levé. Remettons-nous au travail ; car les élèves vont arriver, et je ne suis pas prêt pour la leçon. (On frappe.) Déjà ! Tout professeur devrait avoir chez lui une fille à marier. L’ardeur que cela donne aux élèves pour fréquenter sa maison est vraiment merveilleuse ! Je ne sais pas si la philosophie y gagne beaucoup, et si le philosophe doit en être bien fier ! (Il va ouvrir.)
Scène IV. — HANZ, CARL, WILHELM, ALBERTUS.
ALBERTUS. Soyez les bienvenus, mes chers enfants ! J’admire votre exactitude. Autrefois, j’étais souvent obligé d’aller vous éveiller, et maintenant à peine me laissez-vous le temps de dormir.
HANZ. Mon cher maître, si nous sommes venus d’aussi bonne heure sans crainte de vous réveiller, c’est qu’en passant sous vos fenêtres nous avons entendu de la musique.
ALBERTUS. Vous raillez, mon cher Hanz. Personne dans ma maison ne connaît la musique, et vous savez que je suis un barbare sous ce rapport.
WILHELM. C’est précisément pourquoi nous avons été fort surpris d’entendre une harmonie vraiment admirable sortir de votre appartement. Nous avons cru que vous aviez enfin consenti à faire apprendre la musique à Hélène, et qu’il y avait ici quelque habile professeur de harpe ou de piano, quoique à vrai dire nous n’ayons pu nous rendre compte de la nature de l’instrument qui produisait les sons enchanteurs dont nos oreilles ont été frappées.
ALBERTUS. Parlez-vous sérieusement ? Il n’y a chez moi aucun autre instrument de musique que cette vieille lyre d’Adelsfreit, et vous savez qu’elle est en trop mauvais état pour produire un son quelconque. Cependant, je vous dirai que tout à l’heure, tandis que je dormais encore, j’ai cru aussi entendre une admirable mélodie. J’ai attribué cette audition à un songe : mais je commence à croire que quelque musicien est venu s’établir ici près.
CARL. Peut-être Hélène cultive-t-elle la musique à votre insu. Je gagerais qu’elle cache quelque guitare sous son chevet, et qu’elle en joue pendant votre sommeil. Aussi, quelle fantaisie avez-vous, mon bon maître, de la contrarier ainsi dans ses goûts ? C’était bien assez que, du vivant de son père, cette privation lui eût été imposée. Les médecins ne savent ce qu’ils disent. Comment pouvez-vous leur accorder quelque confiance ?
ALBERTUS. Les médecins ont eu raison en ceci, mon cher Carl. Toute excitation nerveuse était absolument contraire à l’état d’exaltation névralgique de cette jeune fille, et toutes mes notions sur l’hygiène psychique aboutissaient au même résultat que leurs observations sur l’hygiène physiologique. L’âme et le corps ont également besoin de calme pour recouvrer l’équilibre qui fait la santé et la vie de l’un et de l’autre. Vous voyez que mes soins ont été couronnés d’un prompt succès. Tandis qu’un régime doux et sain rétablissait la santé de cette enfant, une instruction sage et paternelle ramenait son esprit à une juste appréciation des choses. J’ai été le médecin de son âme, et j’ai eu le bonheur d’éclairer et de fortifier cette belle organisation. Celui de vous qui obtiendra la main d’Hélène doit donc voir en moi un père, et peut-être quelque chose de plus.
WILHELM. Oui, sans doute, un ange tutélaire, un ami investi d’une mission divine. Qu’il est beau de faire de semblables miracles, mon cher maître !
CARL. Vraiment, maître Albertus, croyez-vous qu’Hélène ait beaucoup de dispositions pour la métaphysique ? Il semble qu’elle s’éclaire par la confiance beaucoup plus que par la conviction. Elle croit en vous avec une sorte d’aveuglement qui n’est que de la piété filiale ; mais, si elle comprend la philosophie, et si vos leçons l’amusent, je veux bien l’aller dire à Rome.
albertus. Vous parlez comme un enfant.
hanz. Excusez son langage un peu trivial. Moi, je vous dirai en d’autres termes quelque chose d’approchant. Ce n’est pas que je ne vous admire et ne vous bénisse d’avoir su, par un traitement tout moral, rendre la raison à notre chère sœur adoptive ; mais permettez-moi d’engager avec vous, à propos d’elle, une discussion purement spéculative. L’heure de votre cours n’est pas encore sonnée ; nous pouvons bien causer avec vous quelques instants, car votre conversation est toujours pour nous un enseignement et un bienfait.
albertus. Mes enfants, mon temps vous appartient. Je m’instruis souvent à vous écouter plus qu’à vous répondre ; car vous savez beaucoup de choses que j’ignore, ou que j’ai oubliées.
hanz. Eh bien, maître, je dirais presque que, lorsqu’on est fou d’une certaine manière, c’est un malheur d’en guérir. L’exaltation d’un cerveau poétique est peut-être bien préférable au calme d’un jugement froid. Ne pensez-vous pas qu’Hélène était heureuse lorsque ses yeux, animés par la fièvre, semblaient contempler les merveilles du monde invisible ? Oh ! oui ! alors elle était plus belle encore avec son regard inspiré et l’étrange sourire qui errait sur sa bouche entr’ouverte, qu’aujourd’hui avec son regard voilé et sa pudique mélancolie ! Elle est aussi devenue plus triste, ou du moins plus sérieuse, à mesure qu’elle a senti son cœur battre plus lentement. La matière peut faire un effort pour se reprendre à la vie matérielle ; mais l’esprit n’aime point à descendre du trône qu’il s’est bâti dans les nuées, pour venir s’éteindre ici-bas dans des luttes obscures et pénibles. Maître, qu’en pensez-vous ? Croyez-vous qu’Hélène, en retrouvant la santé physique, ne sente pas son âme se refroidir et tomber dans une langueur douloureuse ? Croyez-vous qu’elle ne regrette pas ses extases, ses rêves, et ses danses avec Titania au lever de la lune, et ses concerts avec le roi des gnomes au coucher des étoiles ? Quel est celui de nous qui ne donnerait au moins la moitié de sa grosse santé bourgeoise pour avoir à la place les visions dorées de la poésie ?
albertus. Hanz, vous ne parlez pas selon mes sympathies. Êtes-vous un poëte ou un adepte de la sagesse ? Si vous êtes poëte, faites des vers et quittez mon école. Si vous êtes mon disciple, n’égarez pas l’esprit de vos frères par des rêveries fantasques et des paradoxes romantiques. Toutes ces inspirations de la fièvre, toutes ces métaphores délirantes constituent un état de maladie purement physique durant lequel le cerveau de l’homme ne peut produire rien de vrai, rien d’utile, par conséquent rien de beau. Je comprends et je respecte la poésie ; mais je ne l’admets que comme une forme claire et brillante, destinée à vulgariser les austères vérités de la science, de la morale, de la foi, de la philosophie en un mot. Tout artiste qui ne se propose pas un but noble, un but social, manque son œuvre. Que m’importe qu’il passe sa vie à contempler l’aile d’un papillon ou le pétale d’une rose ? J’aime mieux la plus petite découverte utile aux hommes, ou même la plus naïve aspiration vers le bonheur de l’humanité. Les exaltés sont, selon vous, des sibylles inspirées, prêtes à nous révéler de célestes mystères. Il est possible que, sous l’empire d’une exaltation étrange, ils aient un sens très-étendu pour sentir la beauté extérieure des choses ; mais, s’ils se trouvent une langue intelligible pour nous associer à leur enthousiasme, cette contention de l’esprit dans une pensée d’isolement ne peut être qu’un état dangereux pour eux, inutile pour les autres.
hanz. Eh bien, maître, il est temps que je vous le dise franchement, je suis poëte ! Et pourtant je ne fais pas de vers, et pourtant, à moins que vous ne me chassiez, je ne vous quitterai point ; car je suis philosophe aussi, et l’étude de la sagesse ne fait qu’exalter mon penchant à la poésie. Pourquoi suis-je ainsi ? et pourquoi êtes-vous autrement ? et pourquoi Hélène est-elle autrement encore ? Je puis concilier les idées d’ordre et de logique avec l’enthousiasme des arts et l’amour de la rêverie. Vous, au contraire, vous proscrivez la rêverie et les arts ; car, à vos yeux, l’une ne peut être convertie en une laborieuse méditation, et les autres s’inspirent souvent, avec succès, des désordres de la pensée et des excès de la passion. Hélène, dans sa folie, appartient encore à un autre ordre de puissance. Elle est absorbée dans une poésie si élevée, si mystérieuse, qu’elle semble être en commerce avec Dieu même, et n’avoir aucun besoin de sanction dans les arrêts de la raison humaine.
albertus. Et que voulez-vous conclure, mon enfant ?
hanz. Maître, souffrez que le disciple récite d’abord sa leçon devant vous. Dieu nous a jetés dans cette vie comme dans un creuset où, après une existence précédente dont nous n’avons pas souvenir, nous sommes condamnés à être repétris, remaniés, retrempés par la souffrance, par la lutte, le travail, le doute, les passions, la maladie, la mort. — Nous subissons tous ces maux pour notre avantage, pour notre épuration, si je puis parler ainsi, pour notre perfectionnement. De siècle en siècle, de race en race, nous accomplissons un progrès lent, mais certain, et dont, malgré la négation des sceptiques, les preuves sont éclatantes. Si toutes les imperfections de notre être et toutes les infortunes de notre condition tendent à nous épouvanter et à nous décourager, toutes les facultés supérieures qui nous sont accordées pour comprendre Dieu et désirer la perfection, tendent à nous sauver du désespoir, de la misère et même de la mort ; car un instinct divin, de plus en plus lucide et puissant, nous fait connaître que rien ne meurt dans l’univers, et que nous disparaissons du milieu où nous avons séjourné pour reparaître dans un milieu plus favorable à notre développement éternel.
albertus. Telle est ma foi.
hanz. Et la mienne aussi, maître, grâce à vous ; car le souffle pernicieux du siècle, les railleries d’une fausse philosophie, l’entraînement des passions, m’avaient ébranlé, et je sentais l’instinct divin s’affaiblir et s’agiter en moi comme une flamme que le vent tourmente. Par des arguments pleins de force, par une logique pleine de clarté, par une véritable notion de l’histoire universelle des êtres, par un profond sentiment de la vérité dans l’histoire des hommes, par une conviction ardente, fondée sur les travaux de toute votre vie respectable, vous avez ramené mon esprit à la vérité. Par une vertu sans tache, une bonté sans bornes, une touchante sympathie pour tous les êtres qui vous ressemblent, soit dans le passée soit dans le présent ; par une généreuse patience envers ceux qui vous nient ou vous persécutent, vous vous êtes emparé de mon cœur, et vous avez mis d’accord en moi les besoins de la raison et ceux du sentiment. Que voulez-vous de plus de moi, maître ? Si vous avez un disciple plus dévoué, plus respectueux, plus affectionné, préférez-le à moi ; car celui-là qui vous comprend le mieux est celui qui vous ressemble le plus, et celui-là est le meilleur d’entre nous. C’est peut-être Wilhelm, c’est peut-être Carl. Bénissez-les, mais ne me maudissez pas ; car je vous aime de toute la puissance de mon être.
albertus. Mon enfant, mon enfant, ne doute pas de ma tendresse pour toi. Doute plutôt de ma raison et de ma science. Maintenant, parle… tu as des idées…
hanz. Les voici. L’humanité est un vaste instrument dont toutes les cordes vibrent sous un souffle providentiel, et, malgré la différence des tons, elles produisent la sublime harmonie. Beaucoup de cordes sont brisées, beaucoup sont faussées ; mais la loi de l’harmonie est telle que l’hymne éternel de la civilisation s’élève incessamment de toutes parts, et que tout tend à rétablir l’accord souvent détruit par l’orage qui passe…
albertus. Ne saurais-tu parler autrement que par métaphore ? Je ne puis m’accoutumer à ce langage.
hanz. J’essayerai de prendre le vôtre. Nous concourons tous à l’œuvre du progrès, chacun selon ses moyens. Chacun de nous obéit donc à une organisation particulière. Mais nous avons une telle action les uns sur les autres, que l’on ne peut supposer un individu en dehors de toute relation d’idées avec ses semblables sans supposer un individu existant dans le vide. Nous sommes donc tous fils de tous les hommes qui nous ont précédés et tous frères de tous les hommes qui vivent avec nous. Nous sommes tous une même chair et un même esprit. Pourtant, Dieu, qui a fait la loi universelle de la variété dans l’uniformité, a voulu que, de même qu’il n’y eût pas deux feuilles semblables, il n’y eût pas deux hommes semblables ; et il a divisé la race humaine en diverses familles que nous appelons des types, et dont les individus diffèrent par des nuances infinies. L’une de ces familles s’appelle les savants, une autre les guerriers, une autre les mystiques, une autre les philosophes, une autre les industriels, une autre les administrateurs, etc. Toutes sont nécessaires, et doivent également concourir au progrès de l’homme en bien-être, en sagesse, en vertu, en harmonie. Mais il en est encore une qui résume la grandeur et le mérite de toutes les autres ; car elle s’en inspire, elle s’en nourrit, elle se les assimile ; elle les transforme pour les agrandir, les embellir, les diviniser en quelque sorte ; en un mot, elle les propage et les répand sur le monde entier, parce qu’elle parle la langue universelle… Cette famille est celle des artistes et des poëtes. On vit de ses émotions ; on les aspire par tous les sens ; et l’esprit le plus froid, l’âme la plus austère, ont besoin des créations et des prestiges de l’art pour sentir que la vie est autre chose qu’une équation d’algèbre. Pourtant, on traite les artistes comme les accessoires frivoles d’une civilisation raffinée. La raison les a condamnés ; et, s’ils ont encore la permission de respirer, c’est parce qu’ils sont nécessaires aux sages, pour les aider à supporter l’ennui et la fatigue de leur sagesse.
albertus. Hanz, vous parlez avec amertume. Je ne vois pas que les sages d’aucune nation traitent les artistes et les poëtes en parias ; je ne vois pas que la misère ou l’obscurité soient leur partage dans la société. Une danseuse mène, dans ce siècle-ci, la vie de Cléopâtre, et le philosophe vit d’un pain amer et grossier, entre la misère et l’apostasie.
hanz. Oh ! oui, maître, je conviens de cela. Mais je pourrais vous répondre qu’au nom de la philosophie tel ambitieux occupe les premières charges de l’État, tandis que, martyr de son génie, tel artiste vit dans la misère, entre le désespoir et la vulgarité. Ce n’est pas sous ce point de vue que j’envisage le malheur du poëte. Le poëte ambitieux peut tout dans la société, aussi bien que le philosophe ambitieux, car l’un et l’autre peuvent abjurer ou trahir la vérité. Dans l’ordre de considérations où je m’élève ici, je ne parle pas des infortunes sociales ni des souffrances matérielles. Je regarde plus haut, et, ne m’occupant guère des individus, je considère l’ensemble du progrès que la poésie et les arts doivent accomplir. Ce progrès serait le plus certain, le plus rapide, le plus magnifique, sans l’obstination des hommes à réprimer toute entreprise hardie, à refroidir toute inspiration ardente chez les poëtes. Je dis les poëtes, cette dénomination comprend tous les vrais artistes. La génération présente tout entière s’acharne à les faire marcher à petits pas, parce que, vaine de son petit bon sens et infatuée de sa petite philosophie, elle veut qu’on ait égard à sa médiocrité, en ne lui montrant que des œuvres médiocres. Des gens qui ne comprennent que les petites actions et les petits sentiments ont créé le mot de vraisemblance pour tout ce qui répond à leur étroitesse d’intelligence et de cœur. Ils ont rangé dans l’impossible et dans l’absurde tout ce qui les dépasse. De là vient que tous les grands artistes travaillent en martyrs du présent pour l’amour de la postérité ; et, s’ils n’ont une grande vertu, s’ils ne sont d’augustes fanatiques, ils se résignent à divertir leurs contemporains comme des saltimbanques, et à déshériter l’avenir des fruits de leur génie.
albertus. Eh bien, mon enfant, tu fais, sans le savoir, le procès à ces artistes avares de leur gloire, qui divorcent avec le présent pour avoir dans l’avenir une place plus distinguée. Je conçois ce genre d’ambition ; c’est le plus raffiné. Mais, crois-moi, si ces génies étaient bien pénétrés de l’importance de leur mission sur la terre, s’ils étaient dévorés du désir d’accomplir le progrès, ils transigeraient avec leur orgueil, et feraient, pour l’amour de l’humanité, ce qu’avec raison ils refusent de faire pour de vaines richesses et de vaines distinctions sociales. Ils ne rougiraient pas de rétrécir ou d’abaisser leur forme, afin de parler à cette génération vulgaire un langage intelligible pour elle, et de lui inoculer les grandes vérités de l’avenir avec un levain qui puisse s’assimiler à sa grossière substance.
wilhelm. Maître, vous oubliez que l’art est une forme, et rien autre chose. Si on l’abaisse, si on la rétrécit au gré des gens qui n’aiment pas le beau et le grand, il n’y a plus d’art, parce qu’il n’y a plus ni beauté ni grandeur dans la forme.
albertus. Et toi aussi, Wilhelm ! Vraiment, je ne me serais pas douté que j’étais environné de jeunes artistes, et je vois dans ce fait la plus parfaite critique de ma pauvre philosophie.
hanz. Maître, rien n’est plus beau que la philosophie ; mais il y a quelque chose d’aussi beau, c’est la poésie. La poésie est à la fois mère et fille de la sagesse.
albertus. Fille, oui ! elle devrait se le tenir pour dit, et ne jamais faire un pas sans sa mère. Mais qu’elle soit mère à son tour, je le nie.
hanz. Maître, le premier homme qui conçut la pensée de Dieu ne fut ni un géomètre, ni un mathématicien, ni un philosophe ; ce fut un poëte.
albertus. C’est possible. Le premier homme qui conçut la pensée de Dieu était encore grossier. Son esprit ne pouvait s’élever jusqu’à la grande cause par l’abstraction. Ses sens lui révélèrent une force extérieure supérieure à la sienne. Ensuite, son intelligence ratifia le jugement des sens, et ne l’invoqua plus. La poésie redevint pour toujours fille de la sagesse.
hanz. Maître, ce ne fut pas le jugement des sens qui révéla l’existence de Dieu à l’homme, ce fut l’instinct du cœur. Le ravissement des sens, à l’aspect de la création, ne fut qu’accessoire à cet élan de l’âme humaine, qui, jetée sur la terre, se sentit forcée aussitôt à rêver, à désirer, à aimer l’idéal. L’esprit était encore trop peu exercé aux subtilités de la métaphysique pour se mettre en peine de prouver Dieu ; mais l’âme était assez complète et assez puissante pour vouloir Dieu. Elle le devina et le sentit longtemps avant de songer à le définir. Cette révélation, cette intuition première, c’est la poésie, mère de toute religion, de toute harmonie, de toute sagesse. Je définis donc, pour me résumer, la métaphysique, l’idée de Dieu ; et la poésie, le sentiment de Dieu.
albertus. Ton explication ne me déplaît pas, et je consens de toute mon âme, cher poëte, à ce que vous soyez mon père. Mais j’exige que vous le prouviez. Voyons, instruisez-moi ; faites éclore en moi quelque idée nouvelle. Prenez votre flûte, et jouez-moi une valse. Si, pendant ce temps, il me vient une solution aux grands problèmes qui m’occupent, je serai de bonne foi, et, vous remerciant de votre prédication, je me dirai à jamais, comme au bas d’une lettre de nouvel an, votre fils soumis et reconnaissant.
hanz. Je ne pourrais ouvrir le ciel avec cette mauvaise flûte que vous venez de découvrir dans la poche de mon gilet. Mais, si je n’ai qu’un chétif talent, si je ne possède qu’un pauvre grain de poésie, la faute en est à vous, maître ; car c’est vous qui proscrivez les arts de nos études, et nous sommes obligés de jouer du violon ou de la clarinette à la dérobée dans les cabarets, bien loin de votre demeure. Sans les arrêts sévères que vous avez portés contre la musique, je serais peut-être un grand artiste, un poëte, un magicien comme Adelsfreit ; et, dans ce moment-ci, je pourrais faire un miracle et vous convertir. La chose serait importante, croyez-moi ; car le grand malheur de la poésie n’est nullement d’être méconnue par les jurés et les inspecteurs des beaux-arts ; c’est d’être ignorée des hommes comme vous, maître ; car, de même qu’un grand poëte tient l’avenir de la philosophie dans ses mains, un grand philosophe tient dans les siennes l’avenir de la poésie. Un ministre peut faire cent bévues par jour, et une coterie cent intrigues par heure, et l’avenir de la poésie ne sera pas entravé au delà de l’existence de ce ministre ou de cette coterie. Mais, si Albertus se trompe, l’avenir de la poésie peut être entravé pour des siècles. Les sots ont pour refuge l’impunité ; les grands esprits n’ont pas le droit d’errer sur un seul point de la destinée humaine.
albertus. Mais enfin, que me reproches-tu ? N’ai-je pas toujours enseigné que les arts étaient de nobles et puissants moyens pour hâter l’éducation du genre humain ? Si j’ai condamné les artistes modernes comme exerçant sur vous, par leur frivolité moqueuse ou leur amer scepticisme, une action funeste, n’ai-je pas toujours salué dans l’avenir les grands poëtes qui s’attacheront à être les auxiliaires et les propagandistes de la sagesse ?
wilhelm. Vous croyez donc, maître, qu’il n’existe pas dès aujourd’hui de ces poëtes-là ?
albertus. Je ne veux rien dire des personnes ; je dis seulement qu’aujourd’hui la poésie n’a pas encore trouvé le mot de sa destinée providentielle sur la terre. Il est quelques productions de l’art que j’admire, parce que je les comprends, parce que tout le monde peut les comprendre, et qu’elles ont un but louable… Vous souriez, et je sais d’avance ce que vous allez dire. Ces œuvres que vous m’avez vu approuver vous semblent vulgaires, et ceux qui les ont créées ne méritent, selon vous, ni le titre de poëtes ni celui d’artistes. D’où vient donc cela ? Le beau est-il relatif ? est-il le résultat d’une convention ? et ce qui est beau pour l’un ne l’est-il plus pour l’autre ?
hanz. Le beau est infini : c’est l’échelle de Jacob qui se perd dans les nuées célestes ; chaque degré qu’on monte vous révèle une splendeur plus éclatante au sommet. Ceux qui se tiennent tout en bas n’ont qu’une idée confuse de ce que d’autres, placés plus haut, voient clairement ; mais ce que ceux-là voient, les autres ne le comprennent pas et refusent de le croire. C’est qu’il est diverses manières de gravir cet escalier sacré : les uns s’y cramponnent lentement et péniblement avec les pieds et les mains, d’autres ont des ailes et le franchissent légèrement.
albertus. Toujours tes métaphores ! Tu veux dire que, vous autres artistes, vous êtes des colombes, et nous, logiciens, des bêtes de somme. Eh bien, si le genre humain se compose d’être vulgaires, et que les poëtes, par une intuition divine, pénètrent seuls dans le conseil de Dieu, qu’ils nous le révèlent, mais qu’ils se fassent comprendre avant tout.
hanz. Ils vous le disent par toutes les voix de l’art et de la poésie ; mais mieux ils le disent, moins vous les comprenez ; car vous fermez vos oreilles avec obstination. Ils ont gravi jusqu’au ciel, ils ont entendu et retenu les concerts des anges, ils vous les traduisent le mieux qu’ils peuvent ; mais leur expression retient toujours quelque chose d’élevé qui vous semble mystérieux, parce que votre organisation se refuse à sortir des bornes de la raison démonstrative. Eh bien, modifiez cette organisation imparfaite par une attention sérieuse aux œuvres d’art, par l’étude des arts, et surtout par une grande et entière adhésion au développement et au triomphe des arts et de la poésie. La philosophie y gagnera ; car, je le répète, elle est autant la fille que la mère de la poésie, et, si vous n’aviez pas vu les chefs-d’œuvre de la statuaire antique, vous n’auriez jamais bien compris Platon.
albertus. C’est que ce sont en effet des chefs-d’œuvre. Nul ne les conteste ; le beau est donc appréciable pour tous.
hanz. Vous les avez vus sans les bien comprendre ; mais, comme leur perfection était consacrée par l’admiration des siècles passés, vous ne vous êtes pas mis en garde contre l’instinct naturel qui vous révélait, à vous aussi, cette perfection. Cependant, il existe, dans les siècles les moins féconds en génies, des hommes capables de succéder à Phidias ; on les méconnaît, et on les étouffe. C’est parce qu’on s’est contenté de jeter un coup d’œil sur les œuvres de Phidias, sans croire qu’il fût nécessaire de les étudier. Eh bien, maître, les dispensateurs de récompenses et de distinctions créées par les princes sont, par nature et par éducation, ennemis du beau. Le devoir du logicien serait de chercher partout le beau, de le découvrir, de le proclamer et de le couronner. En passant à côté de lui avec indifférence, vous faites aux hommes un aussi grand mal que si vous laissiez périr un monument de la science. Tous les hommes ont soif du beau ; il faut que leur âme boive à cette source de vie ou qu’elle périsse. Les organisations humaines diffèrent : les unes aspirent à l’idéal par l’esprit, d’autres par le cœur, d’autres par les sens. Si vous voulez que les organisations humaines se perfectionnent, et qu’arrivant à un équilibre magnifique, elles conçoivent également l’idéal par l’esprit, par le cœur et par les sens, n’éteignez aucune de ces facultés ; car n’espérez pas amener d’abord tous les hommes à la vérité par les mêmes moyens. À ceux chez qui la beauté idéale ne peut se manifester que par les sens, donnez, pour préservatif contre la débauche, la nudité sacrée de la Vénus de Milo. Voyez votre erreur, à vous autres moralistes, qui vous détournez avec crainte de cette beauté matérielle comme d’un objet impudique et propre à troubler les sens ! Si vous compreniez l’art, vous sauriez que le beau est chaste, car il est divin. L’imagination s’éloigne de la terre et remonte aux cieux en contemplant le produit d’une inspiration céleste ; car ce produit, c’est l’idéal.
albertus. Mon fils, tes idées sur ce point me paraissent dignes d’être méditées. En effet, ceux qui s’adonnent à la recherche de l’idéal doivent, par tous les moyens, travailler au perfectionnement de leur organisation. Peut-être la grossièreté de la mienne, sous le rapport des arts, m’a-t-elle induit jusqu’ici en erreur sur beaucoup de choses. Mais l’heure de l’étude est sonnée, sans doute tous les élèves sont déjà dans la salle ; ne les faisons pas attendre. Je reprendrai cet entretien avec plaisir. Rien ne m’est plus doux que d’être redressé par ceux à qui je voudrais pouvoir tout apprendre.
hanz, Il l’embrasse et le prend par le bras pour sortir. Excellent maître, âme vraiment grande ! (Wilhelm et Carl les suivent.)
wilhelm. Que de bonté et de simplicité !
carl. Il est parfois bien original, mais on ne peut se défendre de l’aimer de tout son cœur.
Scène V. — HÉLÈNE.
Ils sont partis. Je vais ranger les livres et les papiers de mon bon maître. Ô Dieu ! que vous m’avez donné un noble ami ! Pourquoi ne puis-je en être digne ! Je voudrais, pour reconnaître ses soins, le contenter dans tous ses goûts, et satisfaire le modeste amour-propre qu’il met à m’instruire. Son plus cher désir serait de me voir savante ; mais, hélas ! j’ai l’esprit si borné et la mémoire si faible, que je ne puis faire de progrès. Ah ! cette longue maladie a épuisé ma pauvre tête. Quelle langueur pénible s’empare de moi quand j’ouvre ces gros livres ! Rien que leur odeur de parchemin moisi me fait défaillir, et tous ces caractères alignés et pressés avec une désespérante symétrie me donnent des vertiges. Ce brave maître ! sa douceur et sa patience ajoutent à ma honte et à mes remords. Je vois bien qu’il est affligé du peu d’honneur que je lui fais ; mais jamais il ne témoigne le moindre mécontentement. Hier encore, j’ai pris l’objectivité pour la subjectivité, et, cette nuit, je me suis endormie sur la définition de l’absolu. J’ai rêvé que j’étais dans une belle prairie, et que je regardais couler un ruisseau d’eau vive. Il me semblait qu’il y avait des paroles écrites au fond de son lit transparent, et j’y lisais toute sorte de belles choses comme dans un livre. Je me promettais de les réciter à mon maître Albertus, et je pensais qu’il serait bien content de moi. Mais, quand je me suis éveillée, je ne me souvenais plus de rien, si ce n’est d’avoir vu le ciel bien pur et bien bleu dans une eau bien claire et bien courante… Mon Dieu, pourquoi m’avez-vous donné une intelligence si vulgaire ? Maître Albertus dit tous les jours : « Ce sera mieux demain ; » mais le lendemain ne vaut pas mieux que la veille… Voyons : je veux étudier ma leçon en conscience. (Elle s’assied à la table de maître Albertus, et ouvre un livre.) Essayons de retenir par cœur, car je ne comprends pas du tout. — Quand il m’explique les choses lui-même, je les conçois ; mais ses vieux bouquins me tuent. — Quels mots barbares !… — Ah ! le rossignol !… (Elle court à la fenêtre.) Non, c’est une linotte ; quel frais gosier !… Oh ! la jolie modulation ! Pauvre petite, on ne t’a rien appris, à toi, tu en sais pourtant plus long que moi… (Elle laisse tomber son livre.) Comme le soleil est déjà chaud !… Il entre ici comme un fleuve de poudre d’or… J’ai envie d’aller cueillir un beau bouquet pour orner le cabinet de maître Albertus. Il me dira : « Comment, vous avez pensé à moi, chère enfant ?… » Quoique, après tout, il n’aime pas beaucoup les fleurs ; il y jette un coup d’œil en disant : « C’est bien beau ! » mais il me trouve niaise de regarder si sérieusement un brin de muguet. — Oh ! je ne veux pas lui mettre de fleurs sous les yeux, car hier il a parlé de me donner un professeur de botanique… Ah ! ciel ! s’il me fallait apprendre tous vos noms en grec et en latin, je ne vous aimerais bientôt plus, mes pauvres petites ! Oh ! le soleil ! que c’est bon ! Et la brise du matin… Ah ! bonjour, hirondelle ! ne vous gênez pas, continuez votre nid à la fenêtre. Oh ! mon Dieu, si cela vous intimide, je ne vous regarderai pas travailler… Comme vos petits pieds sont jolis ! — Il faut pourtant que je ferme la fenêtre et le rideau ; car maître Albertus n’aime pas beaucoup l’éclat du jour. Il a tant usé ses yeux à travailler la nuit !… C’est pourtant dommage de ne plus voir le soleil donner sur les rayons de la bibliothèque. Je vais m’amuser à regarder la lyre, mais je n’y toucherai pas. C’était la manie de mon père de se fâcher quand j’en approchais. Pauvre père ! Cela me rappelle bien des choses confusément… mais des choses tristes !… Je ne veux pas me souvenir. (Elle essuie une larme. — Méphistophélès entre sous la figure d’un vieux juif.)
Scène VI. — MÉPHISTOPHÉLÈS, HÉLÈNE.
méphistophélès, à part. Eh ! vite ! tâchons de la distraire ; car, si elle touche à la lyre, elle est perdue pour nous ! (Haut.) Pardon, ma belle demoiselle, si j’entre ici sans votre permission ; je croyais trouver maître Albertus.
hélène, à part. Quel vilain petit vieux ! (Haut.) Monsieur, qu’y a-t-il pour votre service ? Maître Albertus donne sa leçon.
méphistophélès. Vous ne me remettez pas, ma chère demoiselle ? J’ai eu l’honneur de vous voir souvent quand vous étiez toute petite ; j’étais très-lié avec votre respectable père. Ne lui avez-vous pas entendu parler quelquefois de Jonathas Taer ?
hélène. Certainement, monsieur. Il avait fait beaucoup d’affaires avec vous. Vous êtes brocanteur, je crois ?
méphistophélès. Précisément. Je vois que vous avez autant de mémoire que de grâce et de beauté.
hélène. Monsieur, je n’aime pas beaucoup les compliments, et je vous assure que je n’en mérite aucun sur ma mémoire.
méphistophélès. Je gage que vous vous rappelez pourtant le dernier piano que j’ai procuré à monsieur votre père ?
hélène. Hélas ! oui, monsieur. J’avais commencé à en jouer, lorsque, au bout de trois leçons, je tombai malade, et mon père le fit emporter de ma chambre, et me retira mon maître de musique.
méphistophélès. Il fit bien. La musique vous aurait tuée, délicate comme vous êtes. Mais veuillez écouter le motif de ma visite aujourd’hui. J’ai une affaire à vous proposer.
hélène. À moi, monsieur ? Veuillez revenir quand maître Albertus aura fini sa leçon ; il est mon tuteur.
méphistophélès. J’aime mieux en causer avec vous, car cela ne regarde que vous. Je veux vous acheter votre héritage.
hélène. Vous plaisantez, monsieur ? Je n’ai pas d’héritage ; mon pauvre père est mort ruiné. Toutes ses dettes ont été payées ; il ne m’est rien resté du tout.
méphistophélès. C’est bien malheureux !
hélène. Oh ! je vous assure que cela m’est fort égal.
méphistophélès. Mais, moi, je n’en puis dire autant ; j’ai été extrêmement frustré dans cette banqueroute.
hélène. Il n’y a pas eu de banqueroute, monsieur ; mon père a laissé de quoi payer tout ce qu’il devait.
méphistophélès. En ce cas, votre tuteur voudra bien me solder une petite créance de cinq cents sequins, dont j’apporte la reconnaissance. Cette dette n’a pas été acquittée.
hélène. Juste ciel ! Et comment faire ? Il ne me reste rien ! Donnez-moi du temps, monsieur, je travaillerai.
méphistophélès. Vous travaillerez ! Et que savez-vous faire, ma belle enfant ?
hélène. Hélas ! rien ; mais j’apprendrai, j’aurai du courage. Oh ! maintenant, je sens le prix de l’éducation.
méphistophélès, ricanant. Vous apprendrez la philosophie… hein ? Savez-vous ce qu’on gagne avec la philosophie ?… Des rhumatismes et des ophthalmies !…
hélène. Monsieur, vous êtes bien cruel !
méphistophélès. Pas tant que vous croyez, mon enfant ; car je viens, comme je vous le disais, vous proposer une affaire. Vous avez un héritage, quoi que vous en disiez, outre vos beaux yeux et votre joli corsage, qui peuvent devenir un assez joli fonds de commerce…
hélène. Monsieur, je vous prie de m’épargner vos plaisanteries. Je ne suis pas gaie.
méphistophélès. De quoi vous fâchez-vous ? Étant aussi jolie, vous pouvez trouver un bon parti, et vous marier avantageusement. Mais allons au fait : outre votre beauté et vos dix-sept ans, vous avez encore une lyre d’Adelsfreit ; c’est un instrument précieux, quoiqu’il soit en très-mauvais état. Avec quelques réparations, je me fais fort de la vendre au moins six cents sequins. Donnez-la-moi, et je déchire le billet de votre père, et je vous compte encore cent sequins pour votre toilette, qui est plus que modeste, à ce que je vois.
hélène. La lyre ! vendre la lyre ! Oh ! c’est impossible ! Mon père y tenait plus qu’à sa vie. C’est la seule chose qui me reste de lui. Vous ne savez pas, monsieur, qu’il avait sur cet instrument des idées toutes particulières. Il pensait que c’était un talisman, et qu’elle lui portait bonheur.
méphistophélès. Ce qui ne l’a pas empêché de se ruiner et de mourir de chagrin.
hélène. Et il m’a recommandé plus de cent fois de ne jamais m’en séparer, quoi qu’il arrivât.
méphistophélès. Il y tenait tant, que, lorsque vous faisiez mine d’y toucher, il entrait dans une colère épouvantable.
hélène. C’est la vérité.
méphistophélès. Et, un jour, la curiosité l’emportant sur l’obéissance, vous osâtes y porter la main.
hélène. Oh ! vous me rappelez un souvenir qui s’était effacé, et qui me tourmentait pourtant comme un remords. La lyre rendit un son terrible… Je crois l’entendre encore.
méphistophélès. Et votre père entra au même instant dans la chambre, avec un geste menaçant et un regard furieux.
hélène. Je tombai évanouie, et, depuis, j’ai été malade bien longtemps et bien dangereusement, à ce qu’on dit.
méphistophélès. Oui, vous avez été folle.
hélène. Folle ! oh ! que dites-vous là ? Folle ! Mais c’est affreux ! On ne m’a jamais dit que j’eusse été folle !
méphistophélès. Je vous demande pardon si j’ai manqué à la galanterie ; mais il n’est pas étonnant que vous soyez folle : monsieur votre père était fou.
hélène. Ce n’est pas vrai, vous êtes un méchant homme et un imposteur.
méphistophélès. Demandez à maître Albertus, à Wilhelm, que vous avez refusé d’épouser, à M. Hanz, qui vous fait la cour… et à M. Carl, qui ne vous déplaît peut-être pas.
hélène. Vous êtes un insolent.
méphistophélès. Ne nous fâchons pas. Votre père était monomane, voilà tout. Très-judicieux sur tout le reste, il extravaguait sur son aïeul Adelsfreit, qu’il croyait avoir été sorcier, et sur sa lyre, qu’il croyait ensorcelée. Le fait est qu’il vous fit une si belle peur le jour où il vous surprit grattant les cordes du pauvre instrument, que vous en eûtes une fièvre cérébrale. Il est de la nature de ces maladies de recommencer avec les causes qui les ont fait naître. Voilà pourquoi maître Albertus vous a défendu de toucher à la lyre. S’il était plus prudent, il la cacherait ; car vous n’avez qu’à avoir la fantaisie d’y toucher encore, et, cette fois, vous seriez folle pour toute votre vie. Cela serait fâcheux pour lui ; car vous ne pourriez pas vous marier, et vous resteriez à sa charge. Le cher homme n’est pas riche. Il est forcé, par manque d’argent autant que par amour pour la philosophie, de porter ses habits un peu râpés, et son potage est aussi maigre que sa personne.
hélène, s’éloignant de la lyre avec effroi. Oh ! oui, Albertus vit de privations, et, moi, je ne manque de rien. C’est la vérité. Comment n’ai-je pas encore songé à la dépense que je lui occasionne ? Je ne pense à rien, moi !… Ah ! j’épouserai qui l’on voudra pour le débarrasser de moi.
méphistophélès. Moi, je vous conseille de prendre Carl. C’est le mieux tourné, le plus riche et le moins pédant des trois. Mais cela ne me regarde pas, direz-vous. Au reste, votre tuteur vous aime tant, qu’il pourra vous épouser lui-même, quoiqu’il soit d’âge à être votre père. Il est vrai que, s’il a des enfants, il faudra qu’il demande l’aumône… Mais, quand on aime, tout est bonheur et poésie, n’est-ce pas ?
hélène. Tout ce que vous dites est amer comme du fiel. J’aimerais mieux mendier moi-même que d’augmenter la gêne de mon respectable ami.
méphistophélès. Il faudra pourtant bien qu’il se gêne encore un peu, car j’ai besoin de mon argent. Je veux partir demain pour Venise, et il faut que j’aie achevé ce soir de rentrer dans tous mes fonds. Vous ne voulez pas me vendre la lyre ?
hélène. Mon Dieu, mon Dieu !
méphistophélès. Vous y tenez, vous avez raison. Oh ! ne vous gênez pas, il y a ici de quoi me payer Le mobilier est encore assez propre.
hélène. Mais rien ici n’est à moi ; vous n’avez pas le droit de saisir le mobilier de mon tuteur.
méphistophélès. Mais j’ai le droit de vous envoyer en prison. Et, comme votre tuteur ne voudra pas vous y laisser aller, et comme il n’a pas d’argent, il faudra bien qu’il laisse vendre ses meubles et ses effets. Bah ! voilà un bon manteau accroché à la muraille. C’est du luxe pour un philosophe. Un philosophe ne doit pas craindre le froid. Et son lit ! mais c’est un voluptueux ; une paillasse doit suffire à un stoïque.
hélène, se jetant à genoux. Oh ! ne le dépouillez pas, ne le faites pas souffrir. Il n’est plus jeune, il est souvent malade, et déjà il ne s’impose que trop de privations. Faites-moi conduire en prison ! qu’il ne le sache pas !…
méphistophélès. Quel bien cela me fera-t-il, que vous soyez en prison ? Je n’y vois qu’un avantage, c’est de me faire solder par votre tuteur… Allons, je vais lui dépêcher mon huissier, je n’ai pas un instant à perdre. J’ai dix affaires pareilles à finir aujourd’hui.
hélène. Oh ! monsieur, attendez que maître Albertus revienne. Je lui dirai de vous vendre la lyre.
méphistophélès. Il ne le voudra jamais. Maître Meinbaker la lui a confiée comme un dépôt. C’est toute votre fortune. Il aimera mieux vendre son lit. J’en ferais autant à sa place. Quand on a une pupille aussi jolie !…
hélène, se relevant. Taisez-vous, malheureux, et prenez la lyre. Elle est à vous. Rendez-moi ce billet.
méphistophélès. Un instant ! je ne puis prendre la lyre moi-même. Vous croiriez que je veux gagner dessus.
hélène. Et que m’importe ? Gagnez ce que vous pourrez ; puisqu’il faut que je m’en sépare, emportez-la tout de suite.
méphistophélès, à part. Peste soit du charme ! Il m’est interdit de la toucher moi-même. Il faut que je la fasse emporter par mes dupes. (Haut.) Non, mademoiselle, je ne traite pas les affaires ainsi. Il y va pour moi de l’honneur. J’ai déjà brocanté la lyre, mais je veux que le marché soit conclu devant vous. Les personnes qui veulent l’acquérir sont ici à deux pas, je cours les chercher. Songez que, si vous gagnez quelque chose en retour, vous pourrez l’employer à soulager la misère de maître Albertus. (Il sort.)
hélène, seule. Il a raison. Comment se fait-il qu’un homme si cupide et si grossier ait une sorte de délicatesse ?… Folle ! J’ai été folle !… Je le suis peut-être encore ! Oh ! oui, c’est pour cela que je ne puis rien apprendre, et que je suis simple et bornée comme un enfant. C’est pour cela aussi que je ne puis être amoureuse de personne, ni me décider à me marier. Si je suis folle, au reste, je fais bien de ne pas vouloir me mettre comme une infirme à la charge d’un mari. Et je ne dois pas être mère, car la folie est héréditaire… Mais je vais donc rester à la charge de maître Albertus !… Quel fardeau pour lui !… Oh ! ami trop généreux ! Oh ! malheureuse que je suis !… Je me tuerai… il le faut… Ah ! ce méchant juif m’a éclairée sur toutes mes infortunes.
Scène VII. — MÉPHISTOPHÉLÈS, LE MAÎTRE DE CHAPELLE, LE POËTE, LE PEINTRE, LE CRITIQUE, HÉLÈNE.
méphistophélès, à part, en entrant. Allons, mes gaillards, si vous ne brisez pas la lyre, si vous ne l’écorchez pas, si vous ne la jetez pas en lambeaux dans la boue, je ne me connais plus en plagiaires et en vandales. (Haut et se courbant jusqu’à terre devant eux.) Entrez, mes nobles seigneurs ! Par ici, mes illustres maîtres ! Que Vos Seigneuries daignent jeter les yeux sur cette merveille de l’art, sans oublier pourtant (Montrant Hélène et baissant la voix) de jeter aussi un petit regard sur cette merveille de la nature.
hélène, à part. Ah ! quelles figures déplaisantes ! C’est dans leurs mains que va passer le trésor de mon père. Je n’assisterai point au marché. Cela me ferait trop de mal ! (Elle sort.)
le maestro. Je tiens, avant tout, à essayer cet instrument incomparable. On le dit d’une qualité de sons si merveilleuse ! Je compte l’introduire dans l’orchestre de Sa Majesté. J’ai déjà composé un solo tout exprès dans ma symphonie en ré.
le peintre. Quant à cela, je crains qu’on ne vous ait trompé. On m’a dit, à moi, que personne n’avait entendu le son de cette lyre, parce que le propriétaire ne souffre pas qu’on y touche ; mais mon ami Lottenwald m’a parlé des figurines d’ivoire qui couronnent l’instrument et qui sont les plus belles statuettes de sirènes qu’il ait jamais vues.
le poëte. Lottenwald s’y connaît ! Quant à moi, je compte mettre en vers la légende fantastique qui se rattache à la lyre d’Adelsfreit. On assure, maître Jonathas, que vous seul connaissez la véritable version. C’est une tradition qu’on dit fort curieuse, et que feu Meinbaker le luthier ne racontait à ses meilleurs amis que sous le sceau d’un secret inviolable. J’espérais, en qualité de poëte de la cour, avoir assez de droits à sa considération pour qu’il me confiât cette histoire mystérieuse ; mais il ne voulut jamais s’y prêter.
le peintre. Parce que vous comptiez la raconter au public sous le sceau d’un secret inviolable… Moi, je me serais montré moins exigeant. J’aurais désiré copier les figurines, afin d’en orner les cadres des portraits de la famille impériale. Sa Majesté eût été sensible à cette invention : elle aime particulièrement les cadres des tableaux ; on peut même dire qu’elle daigne les préférer aux tableaux mêmes. Aussi c’est ce que je soigne le plus dans le choix des peintures dont elle me charge de composer sa galerie.
le maestro. Mauvais plaisant, taisez-vous ; qu’importe que Sa Majesté comprenne les arts, pourvu qu’elle les protége ?
méphistophélès, il leur montre la lyre sur le piédestal. Voilà, messieurs, cet admirable instrument. On ne vous a pas trompés, comme vous voyez : son pareil n’existe pas dans le monde.
le maestro. Ah ! c’est cela ? Je m’attendais à autre chose.
le peintre. Je vous demande mille pardons, monsieur Jonathas, mais je me connais un peu à ces sortes d’instruments : ceci n’est point un Adelsfreit.
méphistophélès. Comment, monsieur ! daignez seulement jeter les yeux sur la table d’harmonie, vous y pourrez lire en toutes lettres le nom du fameux luthier, et la date… la date authentique, le jour de sa mort.
le peintre. Et la devise dont on m’avait parlé ?
méphistophélès. La voici, incrustée en argent sur l’ébène de la table.
le maestro. Ce sont des caractères imperceptibles.
le critique. Ah bon ! je les lirai d’emblée, j’ai la vue d’un lynx. Écoutez, écoutez !
À qui vierge me gardera,
La richesse ;
À qui bien parler me fera,
La sagesse ;
À quiconque me violera,
La folie ;
Et, s’il me brise, il le paîra
De sa vie.
le poëte. Baste ! ce n’est pas fort !
le peintre. Eh ! eh ! il y a de la couleur locale dans ces vers-là. Mais, franchement, que vous semble des figures sculptées ?
le poëte. Admirables ! sublimes !
le maestro. Et les ornements ! quel goût exquis ! quelle délicatesse dans ces guirlandes de fleurs ! quels feuillages élégants ! quelles arabesques coquettes et déliées ! C’est un bijou.
le peintre. Eh bien, je suis fâché de ne pas partager votre enthousiasme. Tout cela est mesquin, maniéré, de mauvais goût ; c’est du rococo tout pur ! Nous faisons mieux que cela aujourd’hui.
le critique. J’en doute. Aujourd’hui, l’on ne fait rien qui vaille, et ceci est un chef-d’œuvre.
le peintre. En admirant ceci, vous vous sentez à l’aise. On n’est pas jaloux des morts.
le poëte. Ah ! mon cher, on ne saurait nier que votre art ne soit en pleine décadence…
le peintre. Ma foi, je n’ai pas lu, depuis dix ans, une seule strophe qui valût celle-ci.
le maestro. La strophe n’est pas mauvaise, je la mettrai en musique ; mais je me garderai bien de la faire accompagner sur un instrument de ce genre. Il est d’une construction détestable, et la musique, aujourd’hui, est trop savante, trop étendue, trop compliquée, pour être exécutée par de pareils chaudrons.
le critique. La musique, la peinture et la poésie sont ensevelies dans le même cercueil, mes chers amis, Il n’y a plus qu’une puissance, la critique.
le peintre. Et à quoi sert-elle ? que gouverne-t-elle, cette puissance ? S’il n’y a plus d’art, il n’y a plus rien à critiquer, et la critique peut se coucher tout de son long sur notre tombe, comme un chien sur la dépouille de son maître. Voyons, franchement, à quoi sert-elle ?
le critique. Elle sert à tracer des épitaphes.
le peintre. C’est-à-dire que vous faites un métier de croque-mort. Peu m’importe, mon bon ami. Jette à ton aise des fleurs sur mon tombeau ; j’ai toujours ouï dire que les arrêts de la critique portaient bonheur aux artistes. En attendant, fais-moi l’amitié de tenir un peu la lyre… comme cela… bien ! Je vais me hâter de faire un croquis des figurines, pendant que vous débattrez le prix avec maître Jonathas ; car, pour moi, je n’achète pas.
le critique. Vous voulez les copier, toutes mauvaises qu’elles sont ? Vraiment, les modernes sont bien bons d’emprunter aux anciens, lorsqu’ils sont tellement supérieurs à ce genre mesquin et rococo !
méphistophélès, à part. Je ne me presserai pas d’entrer en marché ; il est bon de les laisser s’échauffer dans la conversation. Avant dix minutes, ils vont se disputer. S’ils pouvaient briser la lyre sans sortir d’ici, ce serait le plus prompt et le plus sûr.
le peintre. Tiens toujours… Un peu plus droite, bon… j’y suis.
le critique. Cette tête de muse, qui est au sommet et vers laquelle les deux sirènes se courbent avec tant de grâce, est digne de l’antiquité.
le maestro. C’est Polymnie ou sainte Cécile ?
le poëte. C’est Érato. La lyre est bien plus l’emblème de la poésie que celui de la musique.
le maestro. Voilà une singulière prétention ! Essayez donc de faire résonner un instrument en récitant des vers ! Vous ne feriez même pas vibrer une guimbarde avec tous vos sonnets, mon cher ami.
le poëte. La lyre n’était, chez les anciens, qu’un accessoire, un accompagnement de la déclamation, un moyen de soutenir la voix et de scander le vers sur une certaine mesure… Par exemple, tenez…
le maestro, riant. Ah ! bon ! vous allez jouer de la lyre à présent ?
le poëte. Pourquoi non ? Il ne s’agit que de connaître la gamme sur les cordes et de suivre le rhythme poétique. Écoutez !
méphistophélès, à part. Ô lyre, voici ta fin ! (Le poëte déclame des vers en touchant les cordes de la lyre, qui reste muette.) Peste soit de l’esprit rebelle qui n’a pas voulu parler !
LE CRITIQUE, bas, au peintre. Voilà les plus mauvais qu’il ait encore faits.
LE POËTE. Eh bien, que dites-vous de cela ?
LE MAESTRO. Les vers sont beaux.
LE POËTE. Mais l’accompagnement ? vous ne m’auriez pas cru capable d’accompagner ainsi ?
LE MAESTRO. Comment, l’accompagnement ?
LE PEINTRE. Vous avez remué les doigts avec beaucoup de grâce !
LE MAESTRO, au critique. Est-ce que vous avez entendu un accompagnement ?
LE CRITIQUE. Monsieur s’est accompagné de beaux gestes, de poses très-nobles et d’une expression de visage vraiment remarquable.
LE POËTE. Monsieur, vous cherchez en vain à me rendre ridicule. Je ne suis pas musicien ; ma profession est plus relevée. Si j’ai tiré de cette lyre des sons harmonieux, tout l’honneur en revient à l’ouvrier habile qui l’a fabriquée.
LE MAESTRO. Mais, mon ami, c’est vous qui voulez vous amuser à nos dépens ! Je vous donne ma parole d’honneur que vous n’avez tiré aucune espèce de son de cet instrument.
LE POËTE. Je vous trouve plaisant, vous aussi ! Un maître de chapelle sourd ! Cela nous explique vos symphonies !
LE CRITIQUE, au maestro. Ne contrariez pas monsieur : c’est un des plus beaux privilèges de la poésie de voir et d’entendre dans les ténèbres et dans le silence.
LE PEINTRE, esquissant toujours. Quant à moi, j’ai été tellement ravi et absorbé par les vers de monsieur, que je n’ai pas bien saisi l’accompagnement.
Le poëte. Je ne vous demande pas d’éloges ; je tiens seulement à vous faire constater la beauté des sons que j’ai tirés de cette lyre, tenez ! est-il rien de plus pur et de plus puissant que cet accord ? (Il touche la lyre, qui reste muette.)
Le maestro. Eh bien ?
Le peintre. Vous avez entendu quelque chose ?
Le critique. Rien du tout.
Le poëte. Allons, vous êtes de mauvais plaisants ! Je suis bien fou de m’y laisser prendre ! Je jouerai pour moi seul. (Il joue en parlant.) Quelle sonorité ! quelle harmonie céleste ! — Eh ! mais cela est étrange ! les sons se produisent d’eux-mêmes, et viennent, comme par miracle, vibrer sous mes doigts. Écoutez ! quelle pureté dans mon jeu, quelle légèreté dans ces arpèges, quelle puissance dans ces accords sublimes ! poésie, reine de l’univers, c’est à toi que je dois un talent que j’ignorais, que je regardais comme secondaire, et qui, par la puissance de mon génie, s’élève jusqu’au ciel ! — Vous restez muets, vous autres, étonnés, atterrés, foudroyés par mon jeu ! Misérables ouvriers, il vous faudrait dix ans d’études pour arriver à jouer médiocrement sur un chalumeau. Et moi, sans avoir jamais appris la musique, sans connaître ni les règles de cet art ni le mécanisme d’aucun instrument, je déploie ici sans effort, sans soin, sans méditation, les trésors de mon âme ; je fais ruisseler presque involontairement des torrents d’harmonie ; je vois tout s’animer autour de moi : ces colonnes se balancent, ces fresques se tordent, et la voûte s’entr’ouvre pour laisser monter jusqu’à l’empyrée l’hymme glorieux qui s’exhale de moi !… (La lyre est restée muette.)
Le maestro. Quel dommage ! notre pauvre ami est devenu fou ! Qui me fera mes libretti maintenant ?
Le critique, avec ironie. Je ne trouve pas monsieur plus fou que de coutume.
Le peintre, il rit aux éclats et se renverse sur sa chaise. Je meurs, j’étouffe ; je n’ai jamais rien vu de si divertissant !
Le poëte. C’est vous qui excitez mon ironie et ma pitié ! Votre jalousie perce enfin, et je vois qu’au moment où ma force éclate, votre haine à tous ne peut plus se contenir. Vous avez toujours été mes ennemis, je le savais, allez ! et, si j’écoutais avec patience vos flatteries, c’est que mon mépris vous préservait de mon indignation ; mais il est temps que je sorte de cette atmosphère impure. Je me sépare de vous, je vais remplir le monde de ma gloire, et, comme le divin Orphée, porter aux hommes les bienfaits de la civilisation dans la langue sacrée dont j’ai dérobé le secret aux dieux ! (Il s’enfuit à travers le jardin, son chapeau à la main.)
Méphistophélès, à part. Malédiction sur toi, cervelle de singe ! Voilà qu’il prend son chapeau pour la lyre ! Laissons un peu ceux-ci se chamailler. (Il se retire à l’écart.)
Le peintre, riant toujours aux éclats. Regardez-le, regardez-le donc ! Quelle démarche théâtrale ! quelles contorsions ! Les cheveux épars, le manteau flottant dans la nuée orageuse, le chapeau dans les mains comme si c’était la harpe d’Ossian ! Parfait ! parfait ! L’excellente caricature !
Le maestro. Vous en riez ! mais il est fou, réellement fou ! C’est un accès de fièvre cérébrale.
Le peintre. Bah ! ce n’est qu’un accès de vanité délirante. Il est habitué à cette maladie ; il n’en mourra pas.
Le maestro. Mais il fait des extravagances ! Voyez-le donc saluer et bénir autour de lui, comme s’il voyait une population prosternée ! Le voilà qui monte sur une caisse d’oranger, et qui se pose en statue comme sur un piédestal.
Le critique. En Apollon ! C’est très-bien. Le chapeau représente admirablement la lyre. Je gage qu’il prend la queue de sa perruque pour celle d’une comète.
Le maestro. Je ne trouve point cela risible. Cette lyre est ensorcelée.
À quiconque me violera,
La folie.
Voilà une prédiction réalisée.
Le critique. Il ne faut pas beaucoup de sorcellerie pour prédire qu’un fou fera des folies, et je vous jure que toutes les machinations de l’enfer ne pouvaient rien ajouter à l’extravagance d’un homme aussi content de lui-même.
Le peintre. N’importe ! il faut que je me dépêche d’achever ce croquis… Maudit fou, qui m’a dérangé !
Le maestro. Pendant que le juif n’y fait pas attention, j’ai envie de démonter la lyre pour en connaître le mécanisme intérieur : cela me dispenserait de l’acheter.
Méphistophélès, à part. Oui, oui, à ton aise, je ne demande pas mieux. (Le maestro veut prendre la lyre.)
Le peintre. Ah ! de grâce, un instant !…
Le maestro. Mais à quoi vous amusez-vous donc là, mon cher peintre ? ne perdez pas le temps à faire autre chose.
Le peintre. Qu’est-ce que vous dites ? Vous ne voyez pas mes deux sirènes ? Il me semble que j’ai saisi la courbe avec le sentiment de la chose.
Le critique. Facétieux ! Vos deux satyres ne sont pas mal ; mais j’aime mieux les sirènes. Pourquoi, d’ailleurs, des satyres sur un pareil instrument ? LE PEINTRE. Voilà la véritable manière du critique. On lui donne à juger un poëme héroïque, et, quand il désespère d’y trouver à mordre, il taille sa plume et il écrit : « En tant que poëme, celui-ci renferme certainement quelques beautés ; mais, si nous le considérons (comme nous devons et comme nous voulons le considérer) sous le rapport général de la géométrie et des sciences naturelles, nous sommes forcé de le classer au-dessous de tout ce qu’il y a de plus médiocre en ce genre, » etc., etc. (Au maestro.) C’est cela, n’est-ce pas ?
Le maestro. De quoi parlez-vous ? de la critique ou de votre dessin ?
Le peintre. Laissons la critique, je m’en moque. — Mes sirènes, ah !…
Le maestro. Vos satyres ?…
Le peintre. Vous aussi ? Bien ! courage !… C’est égal, elles sont parfaites.
Le critique. Vous avez la fantaisie de faire des satyres au lieu de sirènes ; il ne faut jamais discuter sur la fantaisie de l’artiste ; mais à quoi bon regarder cette lyre, comme si vous faisiez semblant de copier ? Vous n’imitez pas seulement la pose.
LE MAESTRO. Sans doute. Au lieu de ces deux figures si souples et penchées l’une vers l’autre avec tant de grâce, vous tordez en arrière deux troncs grotesques, et vous les disposez dans un plan tout à fait inverse du modèle. Il est possible que cela soit original ; mais je n’y vois aucun rapport avec la lyre d’Adelsfreit.
LE PEINTRE. Cher maestro, vous êtes trop lourd pour faire de l’esprit ; contentez-vous de piller les grands maîtres et de nous donner pour les inspirations de votre muse des vols infâmes mal déguisés sous une broderie de mauvais goût ; laissez l’ironie légère à monsieur, qui s’en sert si bien, comme chacun sait, et dont les anathèmes sont, pour les hommes comme moi, des brevets d’immortalité. (au critique.) Oui, monsieur, je vous brave et vous méprise ; vous le savez bien. En voyant cette simple esquisse empreinte d’une grandeur à laquelle vous ne sauriez atteindre, vous pâlissez de rage ; et, ne pouvant comprendre ni la beauté ni la grâce, vous affectez de voir des sujets grotesques dans ces emblèmes charmants de la séduction…
LE CRITIQUE, au maestro. Emblèmes de la séduction ! deux satyres hideux, pris de vin et se renversant avec un rire obscène !
LE MAESTRO, au peintre. Sur l’honneur ! mon maître, vous avez la vue troublée ou l’esprit égaré. Ces deux hommes à pieds de bouc sont une composition indigne de vous. Remettez-vous, je vous prie ; ouvrez les yeux, et ne prenez point en mauvaise part l’avis, que je vous donne dans votre intérêt, de les anéantir.
LE CRITIQUE. C’est mon avis aussi.
MÉPHISTOPHÉLÈS, à part. Allons donc ! battez-vous.
LE PEINTRE, en colère. Oui, vous voudriez bien qu’il en fut ainsi. Mes bons amis, je vous connais. Vous m’avez trahi tant de fois, que j’ai appris à faire de vos conseils le cas qu’ils méritent. En qualité de misérables plagiaires, vous voyez avec désespoir grandir les talents d’autrui ; toute supériorité vous écrase, et, habitués que vous êtes à copier servilement, vous criez à la bizarrerie et à l’exagération lorsque, dans l’imitation d’une œuvre d’art, vous voyez le génie de l’artiste surpasser son modèle. Eh bien, vous avez raison ! mes deux sirènes ne ressemblent point à celles de la lyre, pas plus que vos ouvrages, à l’un et à l’autre, ne ressemblent aux ouvrages que vous avez imités ; mais avec cette différence que vous gâtez grossièrement tout ce que vous touchez, tandis que j’ai donné un cachet sublime à la copie d’un sujet assez médiocre. Les sirènes de cette lyre sont deux jolies filles, les miennes sont deux déesses, et vos efforts seront vains : l’univers les jugera et confondra votre plate jalousie ou votre stupide aveuglement. (Il sort, emportant son album.)
LE MAESTRO. Ceci est de plus en plus étrange. Lui aussi, pris de vertige et devenu fou pour avoir seulement regardé cette lyre ! Oui, la prédiction se réalise ; le délire de la vanité s’empare des talents médiocres qui violent la virginité du talisman. Ô lyre magique ! je reconnais la puissance surnaturelle qui réside en toi ; et, puisque tu promets la sagesse et la prospérité à celui qui te fera parler dignement, je m’approche de toi avec une confiance respectueuse, et je me flatte de tirer de toi des harmonies telles, que toutes les puissances du ciel ou de l’enfer qui ont présidé à ta formation viendront se soumettre à moi et m’obéir comme au grand Adelsfreit lui-même.
LE CRITIQUE. Prenez garde : ce qui s’est passé sous nos yeux tient en effet du prodige, et doit vous servir d’enseignement…
LE MAESTRO. Vous doutez de ma puissance ?
LE CRITIQUE. Oui, j’en doute, permettez-moi de vous le dire. Je vous ai assez loué en public, je vous ai rendu assez de services pour que vous ayez en moi un peu de confiance. Contentez-vous des couronnes que ma bienveillance vous a décernées ; contentez-vous de la renommée que ma plume vous a acquise. Vous avez abusé les hommes ; ne vous jouez point aux esprits d’un autre ordre…
LE MAESTRO. Je ne sais ce que vous voulez dire, et je crains que, pour avoir porté une main profane sur la lyre, vous aussi, vous n’ayez perdu l’esprit. Je ne dois ma renommée qu’à mes chefs-d’œuvre, et ce n’est point la plume vénale d’un folliculaire qui peut décerner des couronnes. Le génie se couronne lui-même ; il cueille ses lauriers de ses propres mains, et il méprise les conseils intéressés des flatteurs qui voudraient le faire douter de sa force, afin de se donner de l’importance.
LE CRITIQUE, lui tendant la lyre. Vous le voulez ! Soit : que votre témérité insensée porte ses fruits, et que votre destinée s’accomplisse.
LE MAESTRO. Tombez à genoux, valet !
MÉPHISTOPHÉLÈS.. Ah ! Cette fois, lyre, tu es perdue !
LE MAESTRO, il prend la lyre et en tire des sons aigres et discordants. Voilà qui est étrange. Muette ! muette pour moi comme pour le poète !
LE CRITIQUE. Vous appelez cela être muette ! Plût au ciel ! Vous m’avez fait saigner les oreilles !
LE PEINTRE, rentrant avec le poëte. Quelle épouvantable cacophonie ! Ah ! c’est vous, cher maestro, qui nous donnez ce concert diabolique ? Je ne suis plus étonné de ce que je viens de souffrir.
LE POËTE, tenant l’album du peintre entr’ouvert. Je n’ai jamais éprouvé rien de si désagréable que d’entendre ce grincement affreux, si ce n’est de voir ces monstrueux satyres faisant la nique au masque ignoblement bouffon du Silène placé là entre les deux, au lieu de la ravissante tête de muse qui surmonte la lyre.
LE PEINTRE. Et, en disant cela, mon bon ami, vous contemplez avec amour la corne de votre chapeau, que vous persistez à prendre pour la lyre d’Orphée.
LE MAESTRO. Les puissances infernales me sont contraires. Je vous invoque, ô esprits du ciel ! venez rendre la vie à cette harmonie captive ; faites qu’elle se ranime sous mes doigts, et qu’au souffle créateur de mon intelligence, elle se répande en sons divins ! (Il touche la lyre ; elle répand des sons de plus en plus discordants et insupportables, qu’il n’entend pas.)
LE PEINTRE. Pour l’amour de Dieu, finissez ; vous nous faites grincer les dents.
LE POËTE. Quels abominables sifflements ! On dirait d’un combat de chats sur les toits, ou d’un sabbat de sorcières sur leurs manches à balais.
LE MAESTRO. Votre folie continue ; j’en suis fâché pour vous. Quant à moi, je puis dire que, si je n’ai pas fait parler la lyre, du moins je ne l’ai pas violée ; car le délire ne s’est pas emparé de moi, et je ne me suis pas imaginé entendre une musique céleste émaner d’un instrument muet.
LE POËTE. Comment, vous n’entendez pas crier, grincer et rugir sous vos doigts ces cordes aigres et fausses ? Si vous n’êtes pas devenu fou, du moins vous êtes devenu sourd. Je vous le disais bien. Vous n’entendez pas mes divins accords, et vous n’entendez pas non plus l’épouvantable vacarme que vous faites.
LE PEINTRE. Tenez, tenez ! la leçon du professeur Albertus en est interrompue. Voyez là-bas. Les élèves se regardent avec effroi, et les voisins cherchent de tous côtés d’où peut partir un si détestable tintamarre. Faut-il leur annoncer que c’est le début de votre nouvelle symphonie ?
LE MAESTRO. Je ne réponds pas aux insultes d’un fou. Mais je suis fou moi-même d’avoir cru que cet instrument vermoulu renfermait une puissance magique. Je vois bien qu’il n’a rien de merveilleux, qu’il ne résonne pas parce que la table est fendue et que les cordes sont rouillées. Il n’y a rien ici que de très-naturel. Le plus grand génie du monde ne saurait faire parler un morceau de bois, et aux gens perdus de vanité la plus légitime contradiction suffit pour détraquer le cerveau : voilà pourquoi la lyre est muette, et voilà pourquoi vous êtes tous fous.
MÉPHISTOPHÉLÈS, à part. Je commence à croire que le diable lui-même peut le devenir. À quoi avais-je l’esprit quand j’ai compté que ces idiots me seraient bons à quelque chose ? L’esprit de la lyre se moque d’eux.
LE CRITIQUE, au maestro. Veuillez faire une exception pour moi, monsieur. J’ai vu avec la sérénité d’un jugement impartial les diverses tentatives que vous avez faites pour retrouver sur cette lyre quelque trace du génie éteint de nos pères. J’ai vu ici un poète s’évertuer à toucher des cordes muettes et se persuader qu’il nous versait des torrents d’harmonie : ceci est le fait de l’impuissance jointe à un orgueil démesuré. J’ai vu un peintre s’efforcer de saisir du moins la forme de l’art, et, au lieu d’une étude consciencieuse et patiente, produire une fantaisie monstrueuse qu’il croyait empreinte d’une grâce ineffable : ceci est encore le fait de l’impuissance jointe à la vanité aveugle. Enfin, j’ai vu un compositeur qui produisait au hasard des sons bruyants et d’une insupportable dissonance. Habitué qu’il est à mépriser le chant et à surprendre les sens par une confusion d’instruments dont il prend le bruit pour de l’harmonie, il a perdu jusqu’au sens de l’ouïe, et ne se fait plus souffrir lui-même de ses exécrables aberrations : ceci est toujours le fait d’une impuissance sans remède, jointe à une confiance grossière. C’est un spectacle bien triste pour celui qui, d’une main assurée, tient la balance de la critique, de voir tant d’avortements misérables et de honteuses défections. Cette douloureuse expérience nous confirme dans la conviction pénible, mais irrévocable, que l’inspiration n’existe plus, et que nos pères ont emporté dans la tombe tous les secrets du génie. Il ne nous reste plus que l’étude laborieuse et l’examen austère et persévérant des moyens par lesquels ils ont revêtu de formes irréprochables les créations de leur intelligence féconde. Travaillez donc, ô artistes ! travaillez sans relâche, et, au lieu de tourmenter inutilement vos imaginations déréglées pour leur faire produire des monstres, appliquez-vous à encadrer, du moins, dans des lignes pures et régulières, les types éternels de beauté et de vérité qu’il n’appartient pas aux générations de changer. Depuis Homère, toute tentative d’invention n’a servi qu’à signaler le progrès incessant et fatal d’une décadence inévitable. Ô vous qui voulez manier le cistre et la lyre, étudiez le rhythme et renfermez-vous dans le style. Le style est tout, et l’invention n’est rien, parce qu’il n’y a plus d’invention possible.
LE PEINTRE. Voilà un discours magnifique ;
Mais tournez-vous, de grâce, et l’on vous répondra.
LE POËTE. Vous qui nous insultez lâchement, vous, impuissant par système parce que vous l’êtes par nature, vous qui nous accusez d’impuissance parce que vous espérez nous décourager et nous faire descendre à votre niveau, prouvez donc que vous êtes capable de produire quelque chose, quoi que ce soit. Faites seulement un vers passable, pour prouver que vous avez étudié la forme. Je vous en défie.
LE PEINTRE. Tracez seulement une ligne avec ce crayon.
LE MAESTRO. Faites Seulement un accord avec cette lyre ; c’est là que je vous attends.
LE CRITIQUE. Les vaines fumées de la gloire sont pour moi sans parfum. Réfugié sur les sommets d’une immuable équité, nourri de joies sérieuses et durables, j’ai méprisé les jouets futiles que vous appelez vos sceptres et vos couronnes : je vous les ai laissé ramasser. Si j’avais voulu, moi aussi, j’aurais joui d’une gloire éphémère et brillé d’un éclat frivole. J’ai préféré être votre conseil, votre appui, votre maître à tous ! Disciples indociles, prenez garde ; si vous n’écoutez pas mes leçons, je saurai vous démasquer et vous empêcher d’égarer le siècle.
LE PEINTRE. Une leçon, une petite leçon de peinture, je vous en prie. Tenez, voilà mon crayon. Faites une main, un pied, un nez, ce que vous voudrez, enfin.
LE POËTE. Improvisez une strophe, allons ! que nous voyions enfin ce que vous savez faire.
LE MAESTRO. Non, non, qu’il joue de la lyre, et, s’il la fait parler, rendons-lui hommage.
LE PEINTRE et LE POËTE. J’y consens, allons !
LE CRITIQUE, prenant la lyre. Et moi aussi, je consens à vous montrer que je sais mieux que vous les arts que vous professez. Je vais vous chanter, en vers alexandrins, une dissertation sur la peinture, et je m’accompagnerai de la lyre sur le mode ionique.
LE PEINTRE. Ce Sera superbe et vraiment neuf. Voyons !
LES DEUX AUTRES. Voyons, commencez !
MÉPHISTOPHÉLÈS, à part. Allons ! toi, tu es celui sur lequel j’ai le plus compté ! (Le critique pose les doigts sur la lyre, et les retire avec un cri douloureux.)
LES AUTRES. Qu’est-ce que c’est ? que vous arrive-t-il ?
MÉPHISTOPHÉLÈS, à part. Esprit de la lyre, tu triomphes !
LE CRITIQUE. Infâme ! vous ne m’aviez pas dit que ces cordes étaient tranchantes comme des lames de poignard. Je me suis coupé, jusqu’aux os. Ah ! mon sang coule par torrents, et une douleur cuisante se communique à tous mes membres. Je succombe. Secourez-moi !
LE MAESTRO. Il pâlit ; sa blessure saigne horriblement. C’est un châtiment céleste.
LE POËTE. Il va mourir. La justice divine se montre enfin, et confond la rage de l’envieux.
LE PEINTRE. Puisse la source de son sang impur être à jamais tarie et ne pas donner la vie à une nouvelle race de polypes !
LE CRITIQUE., avec fureur. Détestables scélérats ! ceci est une trahison. Vous m’avez tendu ce piége pour vous délivrer de moi, votre juge et votre maître. Mais vous ne jouirez pas longtemps de votre triomphe. Avant de mourir, je briserai votre lyre, et nul après moi ne s’en servira… (Il prend la lyre et veut la briser. — Hanz entre précipitamment et lui arrache la lyre.)
HANZ. Arrêtez ! vous êtes des hôtes de mauvaise foi, et mériteriez d’être chassés d’ici. Vous savez le prix inestimable que maître Albertus attache à cet instrument, et, non contents d’y toucher sans sa permission, vous voulez encore l’anéantir. Retirez-vous, misérables insensés, ou j’attirerai sur vous le ressentiment de maître Albertus et de toute son école. Tenez, les voilà tous qui viennent. Partez vite, ou je ne réponds de rien. (Le critique, le maestro, le peintre et le poëte se retirent.)
MÉPHISTOPHÉLÈS, à part. Méchant écolier ! je te ferai payer cher ton beau zèle. Disparaissons, car la figure du juif Jonathas ne serait pas vue de bon œil par tous ces marauds d’étudiants. (Il s’envole par la fenêtre.)
Scène VIII. — HANZ, ALBERTUS, HÉLÈNE, CARL, WILHELM.
ALBERTUS. Est-ce vous, Hanz, qui interrompez la leçon par ce charivari ?
HANZ. Dieu m’en garde ! mon tympan en est encore affecté.
CARL. Jamais, au mardi gras, je n’ai entendu de cornets plus grotesques.
WILHELM. Dites plutôt que c’était la trompette du jugement dernier.
ALBERTUS. Mais qui donc s’est permis, chez moi, cette mauvaise plaisanterie ? Est-ce que c’est la lyre d’Adelsfreit qui rend de pareil sons ?
HÉLÈNE, dans une sorte d’égarement. La lyre a été violée, et la lyre s’est vengée. Elle a puni les profanateurs. La première partie de la prédiction de mon aïeul Adelsfreit est accomplie. Le temps est venu, et une force invincible me précipite vers l’abîme où je dois me briser. (Elle prend la lyre des mains de Hanz.) N’y touchez plus jamais, Hanz. C’est mon héritage. On appelle cela la folie.
ALBERTUS. Mon Dieu ! Hélène a de nouveau perdu l’esprit.
HÉLÈNE, dans une sorte d’extase, tenant la lyre. La lyre ! voici donc la lyre ! Ô lyre ! que je t’aime !
CARL. Que dit-elle ? Voyez donc comme sa figure change !
HANZ. Son visage blanchit comme l’aube, et ses yeux se noient dans une béatitude céleste.
ALBERTUS. Jeune fille, qu’as-tu ? — Une auréole lumineuse l’environne !
HÉLÈNE, parlant à la lyre. Oh ! qu’il y a longtemps que je désirais te tenir ainsi ! Tu sais pourtant que je t’ai respectée comme une hostie sainte placée entre le ciel et moi !
CARL. Quelles paroles étranges !
HANZ. Quel langage sublime !
ALBERTUS. Tu as juré à ton père mourant de ne jamais toucher à cette lyre qu’il croyait enchantée. Les fantaisies des mourants doivent être sacrées comme les arrêts de la sagesse. Ma fille, craignez l’effet des sons sur votre cerveau débile !
CARL. Chère Hélène, vous n’êtes pas bien. Je ne sais ce que tout cela signifie, mais écoutez maître Albertus ; c’est un homme sage et qui vous aime.
HÉLÈNE, parlant à la lyre. Je ne t’ai point profanée, et mes mains sont pures, tu le sais bien. J’ai tant désiré te connaître et m’unir à toi ! Ne veux-tu pas me parler ? Ne suis-je pas ta fille ? (À Albertus et à Carl qui veulent lui ôter la lyre.) Laissez-moi, hommes ! je n’ai rien de commun avec vous. Je ne suis plus de votre monde. (À la lyre.) Je t’appartiens. Veux-tu enfin de moi ?
HANZ., à Albertus. Ô maître ! laissez-la, respectez son extase. Voyez ! comme elle est belle ainsi, pliée jusqu’à terre sur un de ses genoux ! Voyez ! comme elle appuie avec grâce la lyre sur un autre genou, et comme ses bras d’albâtre entourent la lyre avec amour !
ALBERTUS. Jeune enthousiaste, vous ne savez pas à quel péril elle s’abandonne ! Craignez pour sa raison, pour sa vie, qui ont été compromises par le son de cette lyre !
HANZ. Voyez, maître : ceci tient du prodige ; les rubans de sa coiffure se brisent et tombent à ses pieds ; sa chevelure semble s’animer comme si un souffle magique la dégageait de ses liens brillants, pour la séparer sur son front et la répandre en flots d’or sur ses épaules de neige. Oui, voilà ses cheveux qui se roulent en anneaux libres et puissants comme ceux d’un jeune enfant qui court au vent du matin. Ils rayonnent, ils flamboient, ils ruissellent sur son beau corps comme une cascade embrasée des feux du soleil. Ô Hélène ! que vous êtes belle ainsi ! Mais vous ne m’entendez pas !
ALBERTUS. Hanz, mon fils, ne la regardez pas trop. Il y a dans la vie humaine des mystères que nous n’avons pas encore abordés, et que je ne soupçonnais pas, il y a un instant. (À part.) Oh ! moi aussi, je me sens troublé, je voudrais ne pas voir cette sibylle !
HÉLÈNE, elle soutient la lyre d’une main et lève l’autre vers le ciel. Voici ! le mystère s’accomplit. La vie est courte, mais elle est pleine ! L’homme n’a qu’un jour, mais ce jour est l’aurore de l’éternité ! (La lyre résonne magnifiquement.)
HANZ. Ô muse ! ô belle inspirée !
CARL. Quelle mélodie céleste ! quel hymne admirable ! Mes oreilles n’ont jamais entendu rien de pareil, et moi, insensible d’ordinaire à la musique, je sens mes yeux se remplir de larmes, et mon esprit aborder des régions inconnues.
ALBERTUS, baissant la voix. Taisez-vous, parlez-bas, du moins. Observez le prodige. Il y a ici beaucoup à apprendre. Ne voyez-vous pas que ses mains ne sont pas posées sur la lyre ? Son bras gauche seul soutient l’instrument appuyé sur son sein, et, comme si les pulsations de son cœur brûlant, comme si un souffle divin émanant d’elle suffisaient à faire vibrer les cordes, sans le secours d’aucun art humain, la lyre chante sur un mode inconnu quelque chose d’étrange.
HANZ. Oh ! oui, je vois le miracle ! Je savais bien que cette créature appartenait à un monde supérieur ! Laissez-moi l’écouter, maître, elle n’a pas fini. Dieu ! dans quel ravissement elle plonge tout mon être ! Oh ! oui, maître, l’âme est immortelle, et, après cette vie, l’infini s’ouvrira devant nous !
CHOEUR DES ESPRITS DE L’HARMONIE. Hélène fait chanter la lyre, et Albertus s’entretient à voix basse par intervalles avec ses deux élèves. Les paroles que chantent les esprits ne sont pas entendues des hommes, et la mélodie de la lyre, qui en est l’expression, frappe seule leurs oreilles. Le moment est venu pour toi, esprit notre frère, qu’un pouvoir magique retient captif au sein de cette lyre. Nous avons entendu ta voix mélodieuse, et nous viendrons voltiger autour de ta prison d’ivoire, jusqu’à ce que la main de cette vierge ait été assez puissante pour rompre le charme et te rendre à la liberté. Déjà tu n’es plus condamné au silence ; un souffle pur t’a ranimé. Espère : l’homme ne peut rien fixer, et ce qui a été ravi au ciel doit y retourner.
L’ESPRIT DE LA LYRE. Ô mes frères ! ô esprits bien-aimés ! approchez-vous, descendez vers moi. Tendez la main. Arrachez-moi de cette prison, afin que j’aille voltiger avec vous dans l’air pur, au-dessus de la région stérile où végètent les hommes. Ô mes frères, ne m’abandonnez pas. Je soupire, je tremble, je souffre ; écoutez mes plaintes, écoutez mes pleurs timides, emportez-moi sur vos ailes de feu !
LES ESPRITS DE L’HARMONIE. Le magicien t’a lié avec sept cordes de métal. Pour que tu sortes de la lyre, il faut qu’une main vierge de toute souillure ait rompu les sept cordes une à une ; mais il faut que ce soit la main d’une créature humaine. Nous ne pouvons que charmer ta douleur par nos chants et ranimer ton espoir par notre présence.
L’ESPRIT DE LA LYRE. Oh ! plaignez-moi, consolez-moi, parlez-moi ; car je suis captif, et je soupire, je tremble, je souffre, je pleure !
ALBERTUS. Le son de cette lyre est douloureux, et ce chant est d’une tristesse mortelle. Hélène ! que se passe-t-il dans ton âme, pour que ton inspiration soit si déchirante ?
WILHEM. Tout à l’heure le rhythme était plus large, le son plus puissant, l’inspiration plus triomphante. On eût dit d’un hymne, et, maintenant, on dirait d’une prière.
CARL. Je n’y comprends rien, moi ; mais je souffre, et pourtant je ne puis m’arracher d’ici.
LES ESPRITS DE L’HARMONIE. Frère, nous te parlerons de ta patrie, et tu seras consolé. Nous venons du blanc soleil, que les hommes, tes compagnons de misère, appellent Wega, et qu’ils ont consacré à la lyre. Ton soleil, ô jeune frère, est aussi pur, aussi brillant, aussi serein que le jour où un pouvoir magique t’en fit descendre pour habiter parmi les hommes. Il est toujours régi par le même son. C’est toujours le rayon blanc du prisme infini qui chante la vie de cet astre. (Les voisins, attirés par la musique, pénètrent dans le jardin et se pressent à la porte du cabinet d’Albertus.)
UN AMATEUR. Voilà un instrument peu usité, mais d’une qualité et d’une étendue de sons incomparables ; c’est sans doute un ouvrage de M. Meinbaker.
UN AUTRE AMATEUR. Probablement. Mais n’êtes-vous pas stupéfait du talent de sa fille ? — Je ne crois pas qu’il y ait une pareille virtuose au monde. Et elle prétendait ne pas connaître la musique !
UN BOURGEOIS. Messieurs, vous êtes placés derrière nous. Vous ne voyez pas. Avancez un peu, et expliquez-nous, vous qui êtes des connaisseurs, comment mademoiselle Meinbaker peut jouer de cet instrument sans toucher les cordes.
L’AMATEUR, lorgnant. Ah ! c’est bizarre, en effet ! Je n’avais pas remarqué.
UNE BOURGEOISE. Ceci sent par trop la sorcellerie. J’ai envie de m’en aller. J’avais toujours soupçonné ce vieux sournois de Meinbaker de s’adonner à la cabale. Il n’allait jamais à l’église, et il était beaucoup trop lié avec maître Albertus, qui lui-même est un…
L’AMATEUR. Rassurez-vous, madame ; il n’y a rien de moins sorcier que cette manière de jouer. Cette lyre est une espèce d’orgue qui est montée comme une horloge, et qui jouera, sans qu’on y touche, tant que la chaîne n’aura pas terminé un certain nombre de tours sur un pivot.
UNE JEUNE FILLE. Je vous assure, monsieur, qu’Hélène joue avec ses yeux. Tenez, elle pâlit, elle rougit, son œil brille ou s’éteint ; et la musique devient lente ou rapide, douce ou bruyante, selon sa volonté. Je crains bien que la pauvre Hélène ne soit ensorcelée.
L’AUTRE AMATEUR. Comment ! mademoiselle, vous ne voyez pas que ce que vous prenez pour votre amie Hélène est un automate auquel on a donné sa ressemblance ? On dirait d’Hélène, en effet ; mais c’est tout simplement une machine, et vous allez la voir s’arrêter. Les yeux sont d’émail et tournent au moyen d’un ressort. La respiration est produite par un soufflet placé dans le corps du mannequin…
LES ESPRITS. Nous t’avons assez parlé. Maintenant, occupe-toi de ta libératrice, songe qu’elle seule peut briser le charme ; c’est à toi de l’instruire et de te révéler à elle, si son intelligence peut s’élever jusqu’à toi.
L’ESPRIT DE LA LYRE. Eh quoi ! mes frères, déjà ! Que voulez-vous que je devienne sans vous dans mon cercueil d’ivoire ? Que puis-je dire à une fille des hommes ? elle n’entendra pas mon langage. Oh ! je tremble, je souffre, je pleure !
HÉLÈNE, s’interrompant et se levant avec énergie. Tu as parlé ! Tu as dit : Je souffre ! je pleure ! Qui donc es-tu ?
LA JEUNE FILLE, à l’amateur. Voyez si c’est un automate.
ALBERTUS. Hélène, c’est assez ; la lyre a bien parlé, ne poussez pas l’épreuve plus loin. Le son de cet instrument est trop puissant pour des oreilles humaines, il trouble les idées et peut égarer la raison. (Il lui ôte la lyre.)
HÉLÈNE. Que faites-vous ? Laissez, laissez-la-moi ! (Elle tombe évanouie.)
HANZ. Ô maître ! pourquoi lui ôter la lyre ? vous allez la tuer. Maître, elle semble morte, en vérité.
ALBERTUS. N’aie pas peur, ce n’est rien. La commotion électrique de la lyre en vibration devait produire cette crise. Carl, Wilhelm, emportez-la, je vous prie. Vite ! place ! place ! qu’on la mette à l’air !
HÉLÈNE, se ranimant, repousse Wilhelm. Ne me touche pas, Wilhelm ; je ne suis pas ta fiancée. Je ne serai jamais à toi. Je ne t’aime pas. Tu es un étranger pour moi. J’appartiens à un monde où tu ne saurais pénétrer sans mourir ou sans te damner.
WILHEM. Ô mon Dieu ! que dit-elle ? Elle ne m’aime pas !
CARL. Hanz l’avait bien dit.
ALBERTUS. Ma fille, vous parlez sans raison, et vous penserez autrement demain. Donnez-moi votre bras, que je vous reconduise à votre chambre.
HÉLÈNE. Non, maître Albertus, s’il vous plaît, je n’irai pas. Je sortirai dans la campagne. J’irai voir le lever de la lune sur le lac.
THÉRÈSE. Vous ne parlez pas à notre maître avec le respect que vous lui devez. Revenez à vous, Hélène. Toute la ville vous entend et vous voit.
HÉLÈNE. Je ne vois et n’entends personne. Rien n’existe plus pour moi. Je suis seule pour toujours.
ALBERTUS. Hélas ! la crise a été trop forte ! sa raison est perdue… — Hélène, Hélène, obéissez-moi ! je suis votre père. Rentrez chez vous.
HÉLÈNE. Je n’ai point de père. Je suis la fille de la lyre, et je ne vous connais pas. Il y a longtemps que vous me faites souffrir en me condamnant à des travaux d’esprit qui sont contraires à mes facultés. Mais vos grands mots et vos grands raisonnements ne sont pas faits pour moi. Le temps de vivre est venu, je suis un être libre, je veux vivre libre ; adieu !… (Elle s’enfuit à travers le jardin.)
ALBERTUS. Hanz, Wilhelm, suivez-la, et veillez sur ses jours. (Aux autres élèves.) Mes amis, excusez-moi ; ce malheur imprévu m’ôte la force de reprendre la leçon. (Tous sortent.)
Scène IX. — MÉPHISTOPHÉLÈS, LA LYRE.
MÉPHISTOPHÉLÈS. Esprit opiniâtre, qui pourrais recevoir de moi, en un instant, la liberté et la vie ; puisque tu préfères passer par les sept épreuves et sortir lentement de ta prison, au gré d’un homme, attends-toi à souffrir. J’ai assez de pouvoir sur tout ce qui appartient à la terre pour augmenter tes douleurs et prolonger ton agonie. Tu méprises mon secours. Au lieu de venir avec moi habiter les régions de révolte et de haine, tu préfères retourner à un Dieu injuste qui te livre, pour la moindre faute, au caprice et au joug de l’homme. Je mettrai de telles pensées dans le cœur d’Hélène, que tu te repentiras de m’avoir repoussé.
L’ESPRIT DE LA LYRE. Hélène ne t’appartient pas.
MÉPHISTOPHÉLÈS. Mais Albertus m’appartiendra !
L’ESPRIT. Que Dieu le protège !
ACTE DEUXIÈME
Scène PREMIÈRE. — une terrasse chez Albertus. HÉLÈNE, étendue sur des coussins, dort en plein air ; ALBERTUS s’approche avec précaution.
albertus. Voici l’heure où elle exhale son hymne au soleil levant… Elle repose encore… Caché là, sous ces lauriers-roses, je pourrai la voir et l’entendre à mon aise… Quand elle se croit seule, elle tire de sa lyre des mélodies plus étranges… Ô femme inexplicable ! créature sans égale, ou du moins sans analogue sur la terre ! quel lien mystérieux unit donc ta destinée à celle de cet instrument de musique ? Pourquoi le tiens-tu ainsi embrassé pendant ton sommeil, comme une mère craignant qu’on ne lui ravisse son enfant ? Que tu es belle ainsi, ignorante de ta beauté ! Hélène ! Hélène ! je ne profane point ton chaste sommeil par des regards de convoitise ! Ta forme est belle, à ce que disent les autres ; mais je n’en sais rien. Si j’admire ton front, et tes yeux, et ta longue chevelure, c’est parce qu’à travers ces signes extérieurs, qu’on appelle la beauté physique, je contemple ta beauté intellectuelle, ton âme immaculée. C’est ton esprit que j’aime, ô vierge mélancolique ! c’est lui seul que je veux connaître et posséder. C’est pour m’unir intimement avec lui que je veux pénétrer la langue inconnue par laquelle il se manifeste… La voici qui s’éveille. Elle redresse la lyre, elle l’appuie contre son sein… Ses mains languissantes ne touchent point les cordes… et pourtant les cordes s’émeuvent, la lyre résonne… Prodige qui échappe à toutes mes recherches !… (Il se cache. La lyre résonne magnifiquement.)
l’esprit de la lyre. Éveille-toi, fille des hommes, voici ton soleil qui sort de l’horizon terrestre. Prosterne ton esprit devant cette parcelle de la lumière infinie. Ce soleil n’est point Dieu, mais il est divin. Il est un des innombrables diamants dont est semé le vêtement de Dieu. La création est le corps ou le vêtement de Dieu ; elle est infinie comme l’esprit de Dieu. La création est divine ; l’esprit est Dieu.
Fille des hommes, je suis une parcelle de l’esprit de Dieu. Cette lyre est mon corps ; le son est divin, l’harmonie est Dieu. Fille des hommes, ton être est divin, ton amour est Dieu.
Dieu est dans toi comme un rayon qui te pénètre ; mais tu ne peux voir le foyer d’où ce rayon émane, car ce soleil de l’intelligence et de l’amour nage dans l’infini. Comme un des atomes d’or que tu vois étinceler et monter dans ce rayon de l’orient, ô vierges ! il faut briller et monter vers le soleil, qui ne se couche jamais pour les purs esprits appelés à le contempler.
Fille des hommes, épure ton cœur, façonne-le comme le lapidaire épure un cristal de roche en le taillant, afin d’y faire jouer l’éclat du prisme. Fais de toi-même une surface si limpide, que le rayon de l’infini te traverse et t’embrasse, et réduise ton être en poussière, afin de t’assimiler à lui et de te répandre en fluide divin dans son sein brûlant, toujours dévorant, toujours fécond. (La lyre se tait.)
chœur des esprits célestes. Écoute, écoute, ô fille de la lyre ! les divins accords de la lyre universelle. Tout cet infini qui pèse sur ton être, et qui l’écrase de son immensité, peut s’ouvrir devant toi, et te laisser monter comme une flamme pure, comme un esprit subtil ! Que tes oreilles entendent et que tes yeux voient ! Tout est harmonie, le son et la couleur. Sept tons et sept couleurs s’enlacent et se meuvent autour de toi dans un éternel hyménée. Il n’est point de couleur muette. L’univers est une lyre. Il n’est point de son invisible. L’univers est un prisme. L’arc-en-ciel est le reflet d’une goutte d’eau ; l’arc-en-ciel est le reflet de l’infini : il élève dans les cieux sept voix éclatantes qui chantent incessamment la gloire et la beauté de l’Éternel. Répète l’hymne, ô fille de la lyre ! unis ta voix à celle du soleil. Chaque grain de poussière d’or qui se balance dans le rayon solaire chante la gloire et la beauté de l’Éternel ; chaque goutte de rosée qui brille sur chaque brin d’herbe chante la gloire et la beauté de l’Éternel ; chaque flot du rivage, chaque rocher, chaque brin de mousse, chaque insecte chante la gloire et la beauté de l’Éternel !
Et le soleil de la terre, et la lune pâle, et les vastes planètes, et tous les soleils de l’infini avec les mondes innombrables qu’ils éclairent, et les splendeurs de l’éther étincelant, et les abîmes incommensurables de l’empyrée, entendent la voix du grain de sable qui roule sur la pente de la montagne, la voix que l’insecte produit en dépliant son aile diaprée, la voix de la fleur qui sèche et éclate en laissant tomber sa graine, la voix de la mousse qui fleurit, la voix de la feuille qui se dilate en buvant la goutte de rosée ; et l’Éternel entend toutes les voix de la lyre universelle. Il entend ta voix, ô fille des hommes ! aussi bien que celle des constellations ; car rien n’est petit pour celui devant lequel rien n’est grand, et rien n’est méprisable pour celui qui a tout créé !
La couleur est la manifestation de la beauté ; le son est la manifestation de la gloire. La beauté est chantée incessamment sur toutes les cordes de la lyre infinie ; l’harmonie est incessamment vivifiée par tous les rayons du soleil infini. Toutes les voix et tous les rayons de l’infini tressaillent et vibrent incessamment devant la gloire et la beauté de l’Éternel !
albertus. D’où vient donc qu’Hélène semble écouter des sons inappréciables à mon oreille ? La lyre est muette, et cependant Hélène est ravie en extase, comme si quelque chose planait sur elle en lui parlant… La voici qui reprend la lyre, comme pressée de répondre. Qu’a-t-elle donc entendu ? (la lyre résonne.)
l’esprit de la lyre. Ô mes frères ! parlez encore à la fille des hommes ! Aidez-moi à l’instruire, afin qu’elle me connaisse, qu’elle m’aime et qu’elle me délivre. Faites-lui comprendre les mystères de l’infini, et la grandeur et l’immortalité de l’homme, cet atome divin que le souffle de Dieu aspire sans cesse pour nourrir et peupler un autre abîme de l’infini. (La lyre se tait.)
chœur des esprits. Ô esprit déchaîné ! tu dois passer par plusieurs épreuves ; lié par la conjuration des sept cordes, tu ne peux être délié que par la souffrance. Tel est le destin de tout ce qui réside dans l’humanité. Cette terre est une terre de douleurs. On n’y descend que pour l’expiation, on n’en sort que par l’expiation. (La lyre résonne.)
l’esprit de la lyre. Ô purgatoire ! ô attente ! ô effroi ! Perdrai-je donc le sentiment de l’infini ? Faudra-t-il que je nage dans le doute et dans l’ignorance comme les hommes mortels ? Faudra-t-il que j’erre dans les ténèbres, privé de la lumière divine ?… Fille des hommes, faudra-t-il que j’habite ton âme, prison plus sombre et plus froide que la lyre ?… (Hélène porte ses mains sur les cordes de la lyre, et les fait vibrer fortement.)
albertus. Qu’entends-je ! Quelle harmonie nouvelle ! Quels sons puissants et doux à la fois ! Ceci est une musique moins savante et plus suave… Il me semble que je vais la comprendre… Mais que vois-je ?… Hélène touche les cordes, c’est son âme qui parle…
l’esprit d’hélène, tandis qu’Hélène joue de la lyre. Les paroles d’Hélène ne sont entendues que par les esprits. Le son de la lyre en est l’expression mystérieuse pour les oreilles humaines. Que crains-tu de moi, esprit ingrat et rebelle ? Tu n’es point Dieu, comme tu t’en vantes ; tu es fils des hommes, toi aussi, fils de la science et de l’orgueil ! Regarde-moi, et vois si je ne suis point aussi pur que le plus pur cristal. Vois si je ne suis pas inondé du rayon de l’infini, embrasé par le regard de Dieu ! Ne me dédaigne point, parce que j’habite le sein d’une vierge mortelle ; cette vierge est une hostie sans tache ; un amour céleste peut lui inspirer de s’offrir pour toi en holocauste, et d’assumer sur elle l’expiation à laquelle tu es condamné. (Hélène cesse de jouer. La lyre résonne d’elle-même.)
l’esprit de la lyre. Je t’ai entendue, je t’ai vue, ô vierge immaculée ! Tu me comprends, tu me parles, ton être s’est révélé à moi ! Dieu l’a permis. Tu m’aimes ! et moi aussi, je t’aime ; car je te vois, et tu me sembles la plus belle des étoiles. Oh ! qu’un hymen céleste nous rassemble ! Unies pour jamais, fondues l’une dans l’autre, nos âmes iront habiter l’infini des mondes.
hélène, laissant tomber la lyre sur les coussins. Assez ! laisse-moi. Ton embrassement me consume, je succombe… (Elle tombe évanouie.)
albertus. Voici la crise cataleptique où elle tombe tous les jours, à la même heure, après avoir fait résonner la lyre… Ce sommeil qui ressemble à la mort, cet accablement qui m’effrayait tant les premières fois, ne me cause plus de trouble. Il répare ses forces et semble une fonction naturelle de cette organisation particulière. Je vais appeler sa gouvernante et me livrer en secret à l’examen de la lyre.
Scène II. — Dans le cabinet de maître Albertus. ALBERTUS, HANZ. Albertus est assis devant sa table ; la lyre est posée devant lui, parmi des livres et des papiers épars.
albertus. La musique est une combinaison algébrique des divers tons de la gamme, propre à égayer l’esprit d’une manière indirecte, en chatouillant agréablement les muscles auditifs ; chatouillement qui réagit sur le système nerveux tout entier. D’où il résulte que le cerveau peut entrer dans une sorte d’exaltation fébrile, ainsi qu’on l’observe chez les dilettanti.
hanz. Ô maître ! la musique est tout autre chose, croyez-moi.
albertus. La musique peut exprimer des sentiments… mais rendre des idées… mais seulement peindre des objets… c’est impossible ! À moins qu’elle ne soit une magie, comme plusieurs le prétendent. Cependant, voici des notes, des clefs, des portées, des signes pour marquer la mesure, d’autres signes pour hausser ou baisser l’intonation… Ce ne sont point là des signes cabalistiques. Ils tombent sous le sens le plus vulgaire et sont soumis à une logique invariable.
hanz. Ce sont les éléments simples et connus dont la combinaison devient un mystère, une magie si vous voulez, sous l’inspiration du génie : la langue de l’infini.
albertus. Mais le langage de cette lyre est, dites-vous, un fait exceptionnel, unique, complétement en dehors de la science des musiciens : je n’en sais rien, je n’y crois pas ; n’importe ! j’accepte l’hypothèse, et je dis que la musique n’est qu’une création, ce qu’on appelle avec raison un art d’agrément.
hanz. Le prétendu magicien qui a créé ce talisman se serait donc servi des sons, comme d’autres magiciens se sont servis de mots arabes ou de signes astronomiques ? tout cela dans le même but, qui est de marquer, par des formules quelconques, les mystérieuses évolutions de la science des nombres, science qui, selon eux, présiderait aux lois de l’univers sans l’action providentielle d’une force intelligente ? Maître, vous croiriez à la magie plutôt qu’à la musique ?
albertus. Hélas ! j’ai creusé laborieusement cette mine obscure et profonde qu’on appelle la cabale, espérant y trouver quelques vérités cachées sous un fatras de mensonges et d’aberrations… Je n’ai rien trouvé que l’imposture et l’ignorance des temps grossiers, éléments fatals de l’humanité, qui, à chaque instant, posent des bornes au progrès de l’esprit… Aujourd’hui même, n’essaye-t-on pas de faire revivre la sorcellerie, la puissance des charmes et l’empire des charlatans, sous le nom de magnétisme ? C’est la magie des temps modernes.
Et pourtant l’esprit du sage s’arrête devant les faits d’un ordre nouveau et qui détruisent tout l’ordre des lois connues. Que doit-il conclure en présence de prodiges auxquels ses sens ne peuvent refuser de se soumettre ? En théorie, il doit à la postérité de ne rien rejeter comme impossible. En fait, il se doit à lui-même de se méfier du témoignage de ses sens jusqu’à ce que sa raison se soit mise d’accord avec l’expérience.
hanz. Mon Dieu, mon Dieu ! serait-il possible que l’homme eût végété jusqu’ici sur cette terre infortunée sans oser lever le voile épais qui le tient abruti, tandis qu’il ne faudrait à tous que ce qui a été départi à quelques esprits supérieurs, la force et la confiance d’arracher ce bandeau et de percer ces ténèbres ! Eh quoi ! au sein des générations aveugles qui se sont traînées sur la face du globe, sans autre espoir que les promesses fallacieuses des prêtres, sans autre consolation que le rêve vague et flottant d’une autre vie, sans autre morale qu’une jouissance brutale ou un renoncement absurde… des saints, des astrologues, des magiciens, des sibylles, enfin, de quelque nom qu’on les appelle, des hommes illuminés, auraient, dans tous les temps, vécu en commerce avec les purs esprits du monde invisible, sans pouvoir associer leurs semblables à la connaissance de vérités consolantes et sublimes ! Quoi ! ils auraient vu face à face Dieu, ou ses anges, ou les esprits ses ministres, sans réussir à promulguer une foi basée sur la certitude, sur le témoignage des sens joint à celui de l’esprit ! Clouée sur le seuil d’une vie amère et désolée, l’humanité aurait vu quelques élus franchir ces portiques du monde idéal, et, pour se venger de leur bonheur, elle les aurait condamnés au gibet, au bûcher, à l’infamie, au ridicule, au martyre sous toutes les formes !
albertus. Oh ! s’il en était ainsi, que notre philosophie serait ridicule et méprisable ! C’est nous autres qu’il faudrait fouetter sur les places publiques, et mettre au pilori, comme faussaires et blasphémateurs !
hanz. Maître, est-ce vers les sorciers, est-ce vers les philosophes que vous penchez en cet instant ?
albertus. Que t’en semble à toi-même, apprenti philosophe ? Attends-tu de ma réponse la solution du grand problème de ta croyance ? Si tu doutes de ma conviction en cet instant, c’est que tu n’es pas bien sûr de la tienne propre, et, s’il faut tout te dire, mon cher Hanz, je te soupçonne fort depuis quelque temps de te perdre un peu dans les nuages de l’illuminisme. Ne serais-tu point affilié à quelque société secrète ?
hanz. Depuis quelque temps, vous me raillez, mon bon maître, pour détourner mes questions. Je me réjouirais de vous voir en si joyeuse humeur si je ne savais que, chez les esprits sérieux, l’ironie n’est pas l’indice du calme et du contentement intérieur. Vous professez toujours avec un talent admirable ; mais, s’il faut tout vous dire, vos leçons ne me semblent plus aussi claires, ni vos conclusions aussi victorieuses. Il semble qu’une nouvelle série d’idées, encore confuses et impossibles à formuler, soit venue interrompre l’unité de votre doctrine. Vous paraissez gêné avec vous-même, et je suis certain d’une chose : c’est qu’avant peu vous fermerez votre cours sans l’achever, parce que le doute s’empare de vous relativement à votre passé, et peut-être qu’une grande lumière se lève sur vous pour vous révéler votre avenir.
albertus. J’entends ! Mes élèves doutent de ma loyauté ; ils se demandent si j’ai transigé avec quelque puissance, et ils attendent dans un silence railleur que je leur révèle peu à peu mon apostasie…
hanz. Ô mon maître ! pour parler ainsi, il faut que vous ayez perdu la noble sérénité de votre âme. Nous vous aimons, nous vous respectons, et nul d’entre nous ne vous accuse. Seulement, nous voyons qu’une secrète inquiétude vous ronge, et nous en souffrons, parce que nous étions habitués à trouver dans vos enseignements des espérances et des consolations que nous n’y trouvons plus ; que deviennent les passagers quand le pilote a perdu sa route parmi les écueils ?
albertus. Mon ami, nous reprendrons cet entretien ; maintenant, laisse-moi seul. Je suis agité en effet, et je ferais peut-être bien de suspendre mon cours. Un monde nouveau s’est ouvert devant moi ; je n’ose encore y pénétrer qu’en tremblant ; c’est que je ne peux point y entrer tout seul. Je sais que j’entraînerai à ma suite les esprits qui ont mis leur confiance en moi, et je ne veux point disposer à la légère du dépôt sacré des consciences.
hanz. C’est un scrupule digne de vous. Je vous laisse, maître ; puissiez-vous retrouver la paix de l’âme !
Scène III. — ALBERTUS, seul.
Qu’il me tardait de me voir seul ! Ah ! celui qui prend sur soi la responsabilité des croyances et des principes d’autrui, celui qui ose se mêler d’enseigner et de diriger d’autres hommes, ne sait pas de quel fardeau il écrase sa vie ! Celui qui fait de la sagesse une profession est bien fou et bien malheureux quand il n’est pas un vil imposteur ! Au moment où il croit posséder la vérité, au moment où il monte en chaire pour la proclamer, ses yeux se troublent, les ténèbres descendent autour de lui, des lueurs confuses s’agitent dans un lointain obscur, et sa bouche prononce des mots qui n’ont plus de sens pour son esprit. Tout n’est qu’orgueil et mensonge dans la vaine science de l’homme. Il ne sera peut-être pardonné là-haut qu’à celui qui aura su douter et se taire ! (prenant la lyre.) Pourtant il n’y a pas d’effet sans cause ; ceci n’est point une vielle organisée, un accordéon, comme je le laisse croire. Je l’ai démontée pièce à pièce ; j’en ai examiné attentivement toutes les parties, et les sons magnifiques que cet instrument produit ne sont dus qu’aux proportions savantes et au rapport parfait de ses parties diverses. J’en fais vibrer les cordes sonores, et sans doute ma main ne les profane pas ; car leur vibration ne porte pas le trouble dans mon être ; mais il me serait impossible d’en tirer d’autre harmonie que les simples accords qu’une faible notion de la musique me permet de former. Mes doigts les cherchent et les trouvent ; mon oreille les écoute et les juge ; mais jamais ma pensée ne pourrait éveiller un son sur ces cordes ; et pourtant la pensée d’Hélène les émeut et en fait distiller des chants sublimes, sans le secours de l’art, sans l’aide du toucher… L’effet est bien constaté, je dois en chercher la cause. Négliger de la trouver, serait le fait d’une lâche paresse ou d’un orgueil imbécile… D’où vient pourtant que je tremble en abordant ce sujet ?… Il y a là, devant moi, comme un fleuve de feu, d’où s’élèvent des tourbillons de fumée… Il me semble que, comme les astrologues du moyen âge, je vais quitter l’air pur des cieux et la lumière du soleil pour les ténèbres de l’enfer et les prestiges de Satan… Je saurai pourtant vaincre ces frivoles terreurs… Il n’y a désormais pour l’imagination de l’homme ni Tartare ni démons ; il y a le doute, il y a le néant plus affreux encore !… Soutiens-moi, espérance divine, fruit de mes longs travaux et de ma pénible austérité !
Scène IV. — ALBERTUS, MÉPHISTOPHÉLÈS, sous la figure du juif.
méphistophélès, à part. Dans Cette disposition-là, tu me plais fort ; je vais enfoncer quelques aiguillons de curiosité dans ta cervelle paresseuse. (Haut.) Je m’incline jusqu’à terre devant Votre Stoïcisme.
albertus. Je suis votre serviteur. Que me voulez-vous ?
méphistophélès. Votre Infaillibilité ne me fait pas l’honneur de me remettre !
albertus. À moins que je ne vous aie vu dans un hôpital de fous.
méphistophélès. Votre Austérité plaisante, je suis le bon israélite Jonathas Taer.
albertus. En effet, je vous reconnais maintenant ; mais, comme le bruit de votre mort a couru ici, mon esprit ne se prêtait pas à cette reconnaissance.
méphistophélès. J’ai été fort malade à Hambourg. Tous les médecins m’avaient condamné ; mais, au moment où l’on prétendait qu’il fallait me porter en terre, je me suis trouvé sur pieds, grâce à un topique que m’apporta une tireuse de cartes. Je crois bien que, pour n’en avoir pas le démenti, ces messieurs ont fait enterrer une bûche à ma place. Ma guérison eût ruiné leur réputation.
albertus. Et pourquoi ? Vous eussiez pu avoir raison tous. Votre maladie était mortelle ; mais les juifs ont la vie si dure !… Voyons, que désirez-vous ? Pas de compliments inutiles, je vous prie. Mon temps ne m’appartient pas toujours.
méphistophélès, à part. Faquin ! qui sait mieux que moi le temps que tu perds à caresser des lubies ? (Haut.) Mon cher maître, je viens vous proposer une affaire.
albertus. Oh ! c’était votre refrain avec mon pauvre ami Meinbaker. Mais, avec moi, quelle affaire pourriez-vous avoir ? Je n’ai rien, et ne désire que ce que j’ai.
méphistophélès. Oh ! j’ai là, dans ma poche, des papiers qui, j’en suis sûr, vous tenteront.
albertus. Des papiers ?
méphistophélès. Un manuscrit précieux.
albertus. Voyons-le… Mais non, vous ne faites rien pour rien, et je ne pourrais vous payer. Ne me tentez pas. Gardez-le.
méphistophélès. Oh ! la vue n’en coûte rien. Ce sont des parchemins qui m’échurent en payement dans la vente qu’on fit après la mort de maître Meinbaker. J’étais un de ses créanciers, et, comme tant d’autres, je fus ruiné.
albertus. Quand un juif se plaint, c’est signe qu’il est content. De qui donc est ce manuscrit ?
méphistophélès. De quel autre pourrait-il être que du grand luthier, poëte, compositeur, instrumentiste et magicien, Tobias Adelsfreit ?
albertus. Ah ! j’ai vu beaucoup de son écriture.
méphistophélès. J’en suis bien aise ; vous pourrez constater l’authenticité de celle-ci. (Il étale de vieux cahiers sur la table.)
albertus. En effet, elle me paraît incontestable. Voilà son seing et son cachet… Contrats de vente de divers instruments… inventaires de magasin, à diverses époques, avec la date de la confection des instruments… Tout cela est sans importance. Mais ce livre couvert de figures bizarres à demi effacées par le temps… c’est encore son écriture. Voyons donc, sont-ce des vers ?… Non… Voici des essais de composition musicale, pensées lyriques d’une grande valeur sans doute pour les curieux, et d’un grand mérite pour les artistes… Que vois-je ici ? des mots sans suite… des phrases tronquées, jetées là pour memento et dont il serait oiseux ou impossible de reconstruire le sens… (Se parlant à lui-même et oubliant la présence de Méphistophélès.) Ah ! maintenant, des signes cabalistiques, de la magie ! J’en étais sûr ! nos pères ne pouvaient sortir de leurs grossières perceptions que pour tomber dans des superstitions plus grossières encore. Dois-je m’en étonner ? Moi qui vis dans un siècle plus éclairé et qui juge froidement les erreurs du passé, j’ai pourtant dix fois par jour la tentation de croire à ces absurdités ! C’est une conséquence du besoin impérieux que l’homme éprouve de sortir du positif par une porte ou par une autre, fût-ce par celle qui conduit à la folie !
méphistophélès, à part. Tu seras content. Cette porte est large, et tu y passeras sans te gêner. (Haut.) Maître, il ne faut pas que votre érudition méprise ces caractères de nécromancie. Nos pères exprimaient souvent dans cette langue barbare des idées aussi sages et aussi philosophiques que vous pourriez les émettre aujourd’hui ; et, lors même que ces idées vous sembleraient vagues et mystérieuses, elles auraient toujours une certaine profondeur qui vous donnerait à penser si vous pouviez les lire.
albertus. Vous vantez votre marchandise avec beaucoup d’esprit, maître Jonathas ; mais je vous dirai que cela me tente peu. Adelsfreit a écrit de bonnes poésies ; mais je n’en vois point dans ces recueils. La musique et la magie sont aussi peu de mon ressort l’une que l’autre.
méphistophélès. Et si cette prétendue magie n’était qu’une forme mystérieuse pour exprimer librement des idées plus avancées que la barbarie du siècle n’eût voulu les admettre ? Si vous alliez, en cherchant bien, y découvrir une source d’aperçus nouveaux et de révélations inattendues ? Par exemple, si je vous traduisais littéralement ce passage-ci… (Il prend un des parchemins et lit.) « Un temps viendra où les hommes auront tous l’intelligence et le sentiment de l’infini, et alors ils parleront tous la langue de l’infini : la parole ne sera plus que la langue des sens, l’autre sera celle de l’esprit. »
albertus. Qu’entend-il par l’autre ?… La musique ?
méphistophélès, à part. Ah ! nous commençons à dresser l’oreille. (Haut et continuant à lire.) « Tout être intelligent sera une lyre, et cette lyre ne chantera que pour Dieu. La langue des rhéteurs et des dialecticiens sera la langue vulgaire. Et les êtres intelligents entendront les chants du monde supérieur. Comme l’œil saisira le spectacle magnifique des cieux et surprendra les merveilles cachées de l’ordre infini, l’oreille saisira le concert sublime des astres et surprendra les mystères de l’harmonie infinie. Ceci ne sera pas une conquête des sens, mais une conquête de l’esprit. C’est l’esprit qui verra le mouvement des astres, c’est l’esprit qui entendra la voix des astres. L’esprit aura des sens, comme le corps a des sens. Il se transportera dans les mondes de l’infini et franchira les abîmes de l’infini. Cette œuvre est commencée sur la terre. L’homme s’élève, par chaque siècle, de cent mille et de cent millions de coudées au-dessus du limon dont il est sorti. Il y a loin des corybantes que le choc des boucliers d’airain mettait en fureur aux chrétiens qui se prosternent en écoutant les soupirs de l’orgue. L’homme comprendra enfin que, si le métal a une voix ; si le bois, si les viscères et le larynx des animaux, si le vent, si la foudre, si l’onde ont une voix ; si lui-même a, dans ses organes matériels, une puissante voix ; son âme, et l’univers, qui est la patrie de son âme, ont des voix pour s’appeler et se répondre. Il comprendra que la puissance de l’harmonie n’est pas dans le son produit par le bois ou le métal, encore moins dans le puéril exercice des doigts ou de la glotte, pas plus que le mouvement perpétuel n’est dans les machines de bois ou de métal que peut créer une main industrieuse. Les sens ne sont que les serviteurs de l’esprit ; et ce que l’esprit ne comprend pas, la main ne peut le créer. Je créerai une lyre qui n’aura pas d’égale. L’ivoire le plus solide, l’or le plus pur, le bois le plus sonore, y seront employés. J’y déploierai toute la science du musicien, tout l’art du luthier. Les mains les plus habiles et les plus exercées n’en tireront pourtant que des chants vulgaires, si l’esprit ne les dirige, et si le souffle divin n’embrase l’esprit. Ô lyre ! l’esprit est en toi comme il est dans l’univers ; mais tu seras muette si l’esprit ne te parle… » Eh bien, maître, commencez-vous à comprendre ?
albertus. Certainement, tout ceci a un sens poétique d’un ordre assez élevé peut-être, mais pour moi excessivement vague.
méphistophélès. Ne vous rebutez pas. Cherchez longtemps ce sens mystérieux. Il serait possible qu’Adelsfreit ne l’eût pas entrevu clairement lui-même. Les hommes les plus doués du sentiment de l’idéal n’ont encore que des lueurs. Une idée est l’œuvre à laquelle travaillent plusieurs générations d’hommes supérieurs : à eux tous, ils complètent ; mais chacun d’eux l’a formulée, imparfaitement, à sa manière, et il vous faut combiner ensemble ces divers éléments dans l’alambic de votre cerveau pour en tirer la quintessence.
albertus. Vous parlez trop bien pour un simple brocanteur, maître Jonathas. Je vous soupçonne de faire ce métier pour la forme et d’être au fond adonné à des études que vous ne voulez pas laisser paraître. Voyons, qu’êtes-vous ? philosophe ou nécromant ?
méphistophélès. L’un et l’autre, monsieur !
albertus. Comme au moyen âge ? cela ne se voit plus. Vous êtes le dernier de cette race.
méphistophélès. Je suis de mon siècle beaucoup plus que vous-même, mon respectable maître. Je suis à la fois adepte de la raison pure et partisan du magnétisme ; je suis spiritualiste-spinosiste ; je ne rejette rien, j’examine tout, je choisis ce qui m’est le plus facile à pratiquer. Je vois les choses de haut, car je suis un peu sceptique. Je suis, d’ailleurs, très-sympathique à toutes les idées nouvelles et à toutes les anciennes. En un mot, je suis éclectique, c’est-à-dire que je crois à tout, à force de ne croire à rien.
albertus. Si vous plaisantez, du moins vous vous moquez de vous-même avec beaucoup d’esprit.
méphistophélès. vous me trouvez un peu fou, mon bon monsieur. Prenez garde, vous, d’être un peu trop sage. J’ai beaucoup suivi vos cours depuis quelque temps : quoique, perdu dans la foule, je n’aie jamais cherché à attirer vos regards, je suis peut-être le seul homme qui vous ait compris et qui vous connaisse bien.
albertus. Vous, monsieur !
méphistophélès. Sans doute ! je sais que vous êtes précisément le contraire de moi. Vous ne croyez à rien, à force de croire à tout. Allons ! je ne veux pas vous déranger plus longtemps ; je vous laisse ces papiers, je présume que vous les lirez avec plaisir : vous connaissez le caractère arabe, et plus vous examinerez ces choses, plus vous y prendrez goût.
albertus. Mais je ne puis vous les acheter…
méphistophélès. Je vous les prête ; je serai toujours à temps de m’en défaire. Je ne vous demande pour payement que la faveur de venir causer quelque-fois avec vous. Oh ! vous n’en serez pas fâché ! Je m’entends un peu à tout, même à la musique ; et, si vous voulez, nous ferons ensemble un ouvrage pour expliquer le phénomène harmonico-magnétique qui fait jouer cette lyre toute seule entre les bras d’Hélène.
albertus. Hélène ! que savez-vous d’Hélène ?
méphistophélès. Oh ! votre belle pupille n’est pas tellement cachée dans votre maison, que le bruit de sa folie miraculeuse ne se soit répandu dans la ville. D’ailleurs, je me suis souvent tenu ici près pendant qu’elle magnétisait sa lyre, et j’ai reconnu, aux sons qu’elle en tirait, la nature de l’instrument, aussi bien que celle de la catalepsie.
albertus. Monsieur, vous parlez là d’une chose qui m’intéresse beaucoup, et, si vous avez quelques notions sur ce phénomène, je vous prie, au nom de la science et au nom de la vérité, de me les communiquer.
méphistophélès. Oui-da ! vous n’êtes pas dégoûté, monsieur le philosophe ! mais vous auriez trop de raison pour comprendre ce que je me hasarderais à vous expliquer.
albertus. Peut-être, au contraire, n’en aurais-je pas assez. Pourtant je m’efforcerai de me dégager de tout orgueil philosophique.
méphistophélès. Non, vous avez trop de préjugés !… La raison, c’est-à-dire l’amour obstiné de l’évidence, est la plus opiniâtre des idées fausses.
albertus. Hélas ! monsieur, vous ne savez pas à qui vous parlez ; et peut-être étiez-vous plus près de la vérité que vous ne le pensiez, en me disant tout à l’heure qu’à force de croire à tout je ne croyais à rien.
méphistophélès. Ah ! prenez garde de vous amender jusqu’au blasphème, mon pauvre ami. Il faut pourtant croire à quelque chose, ne fût-ce qu’à sa propre ignorance.
albertus. Je suis payé pour croire à la mienne. Depuis deux mois que je vois se répéter tous les jours sous mes yeux le phénomène dont nous parlions tout à l’heure, il m’est encore impossible d’établir, à cet égard, une théorie qui me satisfasse le moins du monde.
méphistophélès, à part. Attends ! attends ! je vais embrouiller toutes tes grandes idées avec des mots ! (Haut.) Je le crois bien, mon cher monsieur ; vous ignorez une foule de choses que vous méprisez et qui vous ouvriraient pourtant les portes d’un monde inconnu. Par exemple, je parie que vous n’avez jamais entendu parler des harpes magnétiques.
albertus. J’ai entendu parler des harpes éoliennes que le vent fait vibrer.
méphistophélès. Et vous ne regardez pas la chose comme impossible ?
albertus. Non certainement.
méphistophélès. Vous admettez que l’air peut jouer de la harpe, et vous n’admettez pas que le souffle humain, mû par la volonté, par la pensée, par l’inspiration, puisse produire des effets semblables ?
albertus. Il faudrait supposer à de tels instruments une incroyable délicatesse d’impressions, si l’on peut parler ainsi.
méphistophélès. Supposez encore plus. Supposez qu’il existe un rapport sympathique entre l’artiste et l’instrument.
albertus. Voilà Ce que je ne puis admettre.
méphistophélès. À votre aise ! ne supposez rien, n’admettez rien ; mais, pour être logique, il vous faut encore nier le phénomène que vous voyez s’accomplir tous les jours sous vos yeux.
albertus. J’admettrai tout ce que vous me prouverez.
méphistophélès. Voyons, voulez-vous sincèrement connaître le secret de la lyre magnétique ?
albertus. Je le veux.
méphistophélès. N’apporterez-vous pas à cette étude votre orgueil de savant et votre entêtement de logicien ?
albertus. Je vous promets d’écouter avec la naïveté d’un enfant qui apprend à lire.
méphistophélès. Eh bien, apprenez à lire en effet. Étudiez ces parchemins, et puis après vous examinerez attentivement cet instrument.
albertus,, souriant. Et c’est là tout ?
méphistophélès. Je reviendrai vous expliquer le reste quand vous aurez étudié votre leçon.
albertus. Soit.
méphistophélès,, à part. Laissons-le à lui-même. Ma présence l’intimiderait et l’empêcherait de se livrer à la curiosité puérile qui le dévore. Sa gravité philosophique l’embarrasse avec moi. Seul avec lui-même, il va tourmenter la lyre comme un enfant qui arrache les plumes de l’aile à un oiseau pour voir comment il s’y prend pour voler. Esprit qui m’as bravé, tu te crois sauvé par Hélène ; mais je viens de te susciter un ennemi terrible, l’opiniâtre curiosité d’un logicien. (À Albertus qui rêve.) Je suis forcé de vous quitter, je reviendrai bientôt. Travaillez en m’attendant ; soyez sûr qu’il n’est pas de prodige qu’un esprit persévérant et consciencieux ne puisse comprendre.
albertus. Je le crois aussi. Dieu vous garde !
méphistophélès. Et vous aussi, à moins que le diable ne soit le plus fort ou le plus malin. (Il se rend invisible.)
albertus, seul. Voilà un homme bizarre ; un charlatan, sans doute ; un escroc, peut-être ! Il m’allèche par ses contes, afin de me vendre chèrement ses parchemins… N’importe : la vue n’en coûte rien, a-t-il dit. (Il lit les parchemins.) Eh ! mais voici quelque chose qui ne me paraît pas dépourvu de sens :
« Esprit qui m’aimes et qui veux remonter vers Dieu, je saurai te lier à la lyre. La trace du génie de l’homme est immortelle comme le génie lui-même ; elle est la semence qui doit féconder le génie des autres hommes, jusqu’à ce que, absorbée et transformée par lui, elle s’efface en apparence. Mais c’est alors qu’elle remonte vers le ciel comme un sillon de flamme, après avoir embrasé le champ destiné à alimenter le feu sacré. »
Ne pourrait-on pas traduire ainsi ce passage : Toute puissance émanée de Dieu, et versée dans le sein de l’homme, doit accomplir une mission sur la terre. La vie de l’homme qui en a été investi ne suffit pas pour la développer ; c’est pourquoi le pouvoir lui est donné de la fixer ici-bas, en la matérialisant dans une œuvre quelconque. Cette œuvre, qui survit à l’homme, ce n’est plus l’homme lui-même, c’est l’inspiration qu’il avait reçue, c’est l’esprit qu’il avait possédé durant sa vie. Cet esprit doit retourner à Dieu, car rien de ce qui émane de Dieu ne s’égare ou ne se perd. Mais, avant de remonter à son principe, cette parcelle de la Divinité doit embraser de nouvelles âmes et contracter une sorte d’hyménée céleste avec elles. C’est alors seulement que sa destinée est accomplie, et que l’esprit créateur peut retourner à Dieu avec l’esprit engendré ; de leur hyménée est sorti un esprit nouveau, qui, à son tour, accomplit une destinée semblable parmi les hommes. C’est ainsi que le génie est immortel sur la terre, comme l’esprit est immortel dans le sein de Dieu…
Oui, sans doute, telle était la pensée d’Adelsfreit, et, je vois que le juif avait raison en disant que cette prétendue magie cache de grandes vérités. Je suis satisfait maintenant d’avoir étudié autrefois la langue cabalistique. Je suis sûr que je trouverai beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. (Il lit encore.)
« Sept cordes présideront à ta formation, ô lyre magique ! Deux cordes du plus précieux métal chanteront le mystère de l’infini… La première des deux est consacrée à célébrer l’idéal, la seconde à chanter la foi ; l’une dira le ravissement de l’intelligence, l’autre l’ardeur de l’âme. Éclairée par ce spectacle de l’infini… » (Il laisse tomber le livre.)
Il me semble que ceci rentre dans la nécromancie pure… Et pourtant, si l’on remonte à l’origine de la lyre, emblème de la poésie chez les anciens, on voit chaque corde ajoutée à l’instrument marquer un progrès dans le génie et dans la grandeur morale de l’homme. Chez les Chinois, les dieux mêmes se chargent de révéler aux premiers législateurs le mystère important d’une nouvelle corde ajoutée à la lyre, emblème de la civilisation chez ce peuple laborieux et positif… Qui fera l’histoire de la musique ? Qui nous expliquera le pouvoir fabuleux que l’histoire poétique lui attribue sur les éléments, sur les peuples barbares, sur les animaux féroces ?… Un simple effet de sensation eût-il pu produire des résultats aussi puissants, quelque naturels qu’on les suppose, dépouillés de l’allégorie ? — D’où vient donc que je ne comprends pas cette langue musicale ? J’ai étudié les règles de la musique avec ardeur depuis deux mois, et cela n’a point éclairci le mystère que je cherche. J’ai trouvé là une arithmétique, rien de plus… Voyons ! la lyre d’Adelsfreit a en effet des cordes de divers métaux : en voici deux en or pur… L’infini !… la foi !… l’intelligence et l’amour !… Voilà les mots dont Hanz et Wilhelm se servent pour exprimer le sens de l’hymne qui s’exhale chaque matin de cette lyre lorsque Hélène la fait résonner. Eh bien !… il est un moyen de s’en assurer : c’est de retrancher ces deux cordes, et, si l’harmonie qu’elle rendra désormais change de nature, si on lui trouve un autre sens, je commencerai à croire qu’il existe une certaine relation entre les sons et les idées… (Il essaye de démonter les deux cordes d’or de la lyre.)
Qu’importe à Hélène que la lyre ait sept cordes ou qu’elle n’en ait que cinq ? Ses doigts n’y touchent que rarement… Adelsfreit ! Hélène est-elle l’âme que ton esprit, matérialisé dans cette œuvre de la lyre, doit féconder ? Hélène est une pure et belle improvisatrice ; mais ce n’est point une intelligence supérieure. Elle ignore tout ce qui fait la science de l’homme ; son âme est engourdie dans une sorte d’aliénation douce et permanente ; son improvisation lyrique est un phénomène jusqu’ici inobservé de cet état cataleptique qu’on appelle aujourd’hui magnétique, mot nouveau, obscur et indéfini, comme l’état qu’il désigne… Mais enfin ; Hélène n’a pu, dans l’inaction où dorment ses facultés, s’élever vers les sommets de la métaphysique, tandis que, moi qui travaille depuis trente ans à agrandir mon intelligence, je ne puis percer le mystère de cette algèbre inconnue ?… Maudite corde qui se casse ! Quelle horrible plainte est sortie de la lyre !… Tout mon sang s’est glacé dans mes veines. Ah ! mon pauvre esprit est fatigué, et je ne suis pas éloigné peut-être d’avoir des hallucinations… Le cerveau s’épuise plus en une heure à s’abandonner à des chimères qu’il ne ferait en un an à suivre le fil conducteur de la logique… Aussi, pourquoi vouloir bâtir dans le vide ? Quoi ! la parole humaine, cet attribut divin qui distingue l’homme de la brute, et qui sert à déterminer, à préciser, à classer les idées les plus abstraites, à rendre les propositions les plus ardues aussi claires que la lumière du jour, serait une langue vulgaire, et la cadence du rossignol serait la langue de l’infini ? Maudits paradoxes des artistes et des poëtes, vous ne servez qu’à égarer le jugement ! (La seconde corde d’or se brise dans les mains d’Albertus.)
Encore ! Cette plainte amère me déchire l’âme ! Quelle puissance les émotions nerveuses peuvent exercer sur le cerveau ! Puissance fatale et dangereuse, le sage doit se tenir en garde contre toi… Les arts devraient être proscrits de la république idéale… Non ! non ! des sons ne sont pas des idées… La musique peut tout au plus rendre des sensations… et encore sera-ce d’une manière très-vague et très-imparfaite…
thérèse, accourant. Maître Albertus, Hélène est réveillée ; elle cherche sa lyre avec inquiétude.
albertus. Je vais la lui porter. (À part.) C’est la seule joie de cette pauvre créature… Je lui rendrai la lyre et ne l’écouterai plus. (À Wilhelm, Hanz et Carl, qui s’avancent d’un autre côté.) Mes enfants, la logique gouverne l’univers, et ce qui ne peut être démontré par elle ne peut passer en nous à l’état de certitude. — Préparez tout pour la leçon ; je suis à vous dans l’instant. (Il sort.)
hanz. Il me paraît que son bon génie a pris le dessus.
carl. C’est possible ; mais sa figure est bien altérée. Croyez-moi, il est amoureux d’Hélène : on ne peut être amoureux et philosophe en même temps.
wilhelm. Ne parlons pas légèrement de cet homme. Il souffre, mais son âme ne peut que grandir dans les épreuves. (Ils sortent.)
méphistophélès. Très-bien ! Je les lui ferai telles, qu’elle n’y résistera pas. Puisque Hélène ne m’appartient plus, puisque l’esprit triomphe, ma haine retombera tout entière sur le philosophe, et son âme est la lyre que je saurai briser.
ACTE TROISIÈME
Scène PREMIÈRE. — Au bord de l’eau. ALBERTUS, HANZ, CARL, WILHELM, HÉLÈNE, assise sur la marge du ruisseau, un peu à l’écart.
albertus. Le soleil est couché, le frais commence à se faire sentir. Il serait temps pour Hélène de rentrer. Il est prudent de ne pas trop prolonger sa première promenade.
wilhelm. Encore quelques instants, mon cher maître. La soirée est si belle ! Le ciel est encore embrasé des feux du couchant. Hélène semble goûter un bien-être qu’à votre place je n’oserais pas troubler.
carl. Il est certain que, depuis deux mois, je ne l’ai pas vue aussi bien portante que ce soir. Son teint est calme, ses yeux doucement voilés. Elle ne répond pas encore à nos questions, mais elle les écoute et les entend. Je suis sûr qu’elle guérira, et que bientôt elle pourra nous raconter les belles visions qu’elle a eues. Hanz, tu le crois aussi, n’est-ce pas ? Tu as remarqué comme, toute la journée, elle a été moins distraite que de coutume ? On dirait qu’elle fait un grand effort intérieur pour reprendre à la vie réelle.
albertus. J’ai essayé hier de calmer son esprit en l’élevant vers la pensée de Dieu. Elle m’a écouté attentivement, et ses regards, ses courtes réponses, me prouvaient que j’étais compris. Mais, quand j’ai eu fini de parler, elle m’a dit : « Je savais tout cela ; vous eussiez pu l’exprimer d’un mot. »
hanz. Et quel était ce mot ? Vous l’a-t-elle dit ?
albertus. Amour.
wilhelm. Ô maître ! Hélène n’est point folle ! Elle est inspirée.
albertus. Oui, elle est poëte ; c’est une sorte de folie, folie sublime, et que je voudrais avoir un instant, pour connaître, et pour savoir au juste où finit l’inspiration et où commence la maladie.
hanz. Mon bon maître, nos longues discussions à ce sujet n’ont donc rien modifié à vos idées ?… Vous m’aviez pourtant promis d’y réfléchir sérieusement.
albertus. J’y ai réfléchi ; mais, avant tout, il faudrait comprendre la musique. J’observe Hélène, j’écoute la lyre. Je cherche à me rendre compte des impressions que j’en reçois. Elles me paraissent si différentes des vôtres, que je n’ose rien décider. J’essaye de saisir le sens de ces mélodies suivantes ; mais j’avoue que je n’ai rien compris jusqu’ici qui m’éclairât suffisamment.
hanz. Quoi ! maître, rien senti non plus ?
albertus. J’ai senti une émotion étrange, mais que je ne pouvais pas plus analyser et définir que la musique qui l’avait causée. hanz. Ne vous semblait-il pas que cette musique exprimait des idées, plutôt des images que des sentiments ?
albertus. Plutôt des sentiments que des idées, plutôt des images que des sentiments.
hanz. Mais quelles images ?
albertus. Les images vagues d’une splendeur infinie, insaisissable.
carl. Qu’avez-vous, chère Hélène ? Que cherchez-vous avec inquiétude ?
wilhelm. N’espère pas qu’elle te réponde ; elle ne t’entend même pas.
albertus. Peut-être m’entendra-t-elle aujourd’hui. Hélène, que désirez-vous ?
hélène. Qui me parle ? Vous !
albertus. Moi, votre frère.
hélène. Mon frère n’est pas de ce monde.
albertus. Votre père.
hélène. Mon père n’est plus.
albertus. Votre ami.
hélène. Ah ! mon ami le philosophe ! Écoutez ici. Vous êtes un homme savant ; vous connaissez les secrets de la nature. Parlez à ce ruisseau.
albertus. Que lui dirai-je ?
hélène. Dites-lui de se taire, afin que j’entende la musique de là-haut…
albertus. Quelle musique ?
hélène. Je ne puis vous le dire. Mais vous ne pouvez dire au ruisseau de s’arrêter. Cette cascade chante trop haut.
albertus. Je commanderais en vain à l’onde de suspendre son cours : Dieu seul peut commander aux éléments.
hélène. Ne savez-vous pas un seul mot de la langue de Dieu ?
albertus. Étrange fille ! Son délire est plein d’une poésie inconnue ?
hanz. La lyre est suspendue aux branches de ce saule. Voulez-vous, Hélène, que je vous la présente ?
hélène. Hâte-toi : le ruisseau se moque du philosophe ; il élève la voix de plus en plus. (Hanz lui donne la lyre.)
albertus, à part. Elle ne s’aperçoit pas de l’absence des deux cordes.
hélène. Écoute, ruisseau, et soumets-toi ! (Elle touche la lyre. Au premier accord, le ruisseau s’arrête.)
albertus. Quel est ce nouveau prodige ? Voyez-vous ? la cascade reste immobile et suspendue au rocher comme une frange de cristal.
hélène. Coule, beau ruisseau, mais chante à demi-voix.
wilhelm. Le ruisseau reprend son cours, mais avec précaution, comme s’il craignait d’éveiller les fleurs endormies sur ses rives. (Hélène joue de la lyre.)
l’esprit de la lyre. Maintenant, la terre recueillie attend avec respect la voix de la lune qui vient regarder sa face assombrie. Écoute bien, fille de la lyre, apprends les secrets des planètes. Du fond de l’horizon, à travers les buissons noirs, voici venir une voix faible, mais d’une incroyable pureté, qui monte doucement dans l’air sonore. Elle monte, elle grandit ; les notes sont distinctes, le disque d’argent sort du linceul de la terre, la terre vibre, l’espace se remplit d’harmonie, les feuilles frémissent à la cime des arbres. La lueur blanche pénètre dans toutes les fentes du taillis, dans les mille et mille clairières du feuillage : voici les gammes de soupirs harmonieux qui fuient sur la mousse argentée ; voici des flots de larmes mélodieuses qui tombent dans le calice des fleurs entr’ouvertes. Silence, oiseaux des bois ! Silence, insectes des longues herbes ; repliez vos ailes métalliques ! Silence, ruisseau jaseur ; ne heurte pas ainsi en cadence les cailloux de ton lit ! Silence, roseaux frissonnants ; dépliez sans bruit vos lourds pétales, lotus du rivage ! Alcyons pétulants, ne ridez pas ainsi le miroir où la lune veut se regarder ! Écoutez ce qu’elle vous chante, et vous lui répondrez quand elle vous aura pénétrés et remplis de sa voix et de sa lumière. Enivrez-vous en silence de sa plainte mélancolique ; buvez à longs traits son reflet humide ; courbez-vous avec crainte, avec amour sous le vol des anges blancs qui nagent dans le rayon oblique. Attendez, pour vous relever, qu’ils vous aient effleurés du bout de leurs ailes embaumées, et qu’ils aient confié tout bas à chaque oiseau, à chaque insecte, à chaque flot, à chaque branche, à chaque fleur, à chaque brin d’herbe, le thème de la grande symphonie que cette nuit la terre doit chanter aux astres.
hanz. Eh bien, maître, cette musique ne parle-t-elle pas à votre âme ?
albertus. Elle ne saurait parler à ma raison. Elle émeut en moi je ne sais quels instincts de contemplation ; mais par quels moyens, je l’ignore. Je ne saurais traduire ni ce que j’entends ni ce que j’éprouve ; et pourtant je prête toute mon attention.
wilhelm. Écoutez maintenant ! le rhythme change.
l’esprit de la lyre. Et maintenant elle est levée, elle règne, elle brille ! elle se baigne dans l’éther comme une perle immaculée au sein de l’immense Océan. Les pâles couleurs du prisme lunaire dansent en cercle autour d’elle. Ses froides mers, ses vastes lacs, ses monts d’albâtre, ses crêtes neigeuses se découpent et se dessinent sur ses flancs glacés. Miroir limpide, création incompréhensible de la pensée infinie, paisible flambeau enchaîné au flanc de la terre ta souveraine, pourquoi répands-tu dans les abîmes du ciel cette plainte éternelle ? pourquoi verses-tu sur les habitants de la terre une influence si douce et si triste à la fois ? Es-tu un monde fini ou une création inachevée ? Pleures-tu sur une race éteinte, ou es-tu en proie aux douleurs de l’enfantement ? Es-tu la veuve répudiée ou la fiancée pudique du soleil ? Ta langueur est-elle l’épuisement d’une production consommée ? est-elle le pressentiment d’une conception fatale ? Redemandes-tu tes enfants couchés sur ton sein dans la poussière du sépulcre ? Prophétises-tu les malheurs de ceux que tu portes dans tes entrailles ? Ô lune ! lune si triste et si belle ! es-tu vierge, es-tu mère ? es-tu le séjour de la mort, es-tu le berceau de la vie ? Ton chant si pur évoque-t-il les spectres de ceux qui ne sont plus ou de ceux qui ne sont pas encore ? Quelles ombres livides voltigent sur tes cimes éthérées ? sont-elles dans le repos ou dans l’attente ? sont-ce des esprits célestes qui planent sur la tête triomphante ? sont-ce des esprits terrestres qui fermentent dans ton flanc et qui s’exhalent de tes volcans refroidis ?
hélène. Le son de la lyre est la seule manifestation de la pensée d’Hélène pour les oreilles humaines. Les pensées qu’elle exprime ici ne sont clairement comprises que par les esprits célestes. Pourquoi interroger l’astre, toi qui connais tous les secrets de l’infini ? Si le charme te lie à mes côtés, ne peux-tu par la mémoire te reporter aux lieux qu’autrefois tu habitais par la pensée ?
l’esprit de la lyre. Ma mémoire s’éteint, ô fille des hommes ! Depuis que je t’aime, je perds le souvenir de tout ce qui est au delà des confins de la terre. Interroge avec moi l’univers, car je ne puis plus rien t’apprendre que ce qui existe ici-bas. Ne sens-tu pas toi-même une langueur délicieuse s’emparer de ton être ? N’éprouves-tu pas qu’il est doux d’ignorer, et que sans l’ignorance l’amour ne serait rien sur la terre ? Aimons-nous, et renonçons à connaître. Dieu est avec nous, car il est partout ; mais sa face nous est voilée, et nous sommes désormais l’un à l’autre l’image de Dieu.
hélène. J’espérais que tu me révélerais toutes choses. Tu me l’avais promis, et déjà nous avions pris ensemble notre vol vers les sphères étoilées. Pourquoi renonces-tu déjà à m’initier ? Ne saurais-tu me conduire dans cette étoile qui brille là-haut, à cent mille abîmes au-dessus de la lune ? C’est là que je voudrais aller. Mais tu ne veux même pas me conduire dans la plus voisine des planètes !
l’esprit. Je ne le puis. Je suis lié par les cordes de la lyre et par l’amour que j’ai conçu pour toi. Fille des hommes, ne me reproche pas la chaîne dont tu m’as chargé. Je ne suis plus un esprit céleste ; je ne sais même plus s’il existe un autre ciel que celui qu’on aperçoit de cette rive, à travers la cime des arbres. Ton sein est mon univers ; uni à toi, je comprends et je goûte les beautés du monde que tu habites. Vois comme cette nuit est sereine, comme les voix de ce monde sont harmonieuses ; comme elles se marient tu concert des astres, et comme, sans savoir le sens mystérieux de l’hymne qu’elles chantent, elles s’unissent dans un accord sublime à la voix de l’infini !
hélène. Que parles-tu de l’infini ? Tu ne sais plus la langue de l’infini. Tu ne chantes pas mieux maintenant que l’insecte caché dans l’herbe ou le roseau balancé par les ondes.
l’esprit Hélène, Hélène ! tu promettais de m’aimer, et tu voulais t’anéantir pour me délivrer. Mais tu es bien une fille des hommes. À mesure que l’esprit se soumet et se livre à toi, tu veux pénétrer plus avant dans les mystères de l’esprit, et tu le tortures par les étreintes d’une implacable curiosité. Ô esprits mes frères ! venez vers moi ; venez vers la fille de la lyre ; instruisez-la, ou rendez-moi la mémoire. Montrez-lui Dieu, ou rendez-moi le prisme qui me servait à le contempler. Secourez-moi. L’hymne funèbre de la lune a engourdi ma flamme. Les cordes de la lyre se sont détendues à l’humidité de la nuit. Les soleils de l’infini brillent là-haut de leur splendeur éternelle, et je les vois à peine à travers les voiles dont la terre est accablée.
les esprits célestes. Résigne-toi, esprit frère ! il faut que ta destinée s’accomplisse. Une main fatale a commencé à briser tes liens ; mais il faut que toi-même tu sois brisé sur la terre avant de retourner aux cieux, et ta délivrance doit s’opérer par la douleur, l’effroi, l’ignorance, l’oubli, la faiblesse. Telle est la loi éternelle. La terre est un aimant, et ceux qui sont nés d’elle ne peuvent la quitter qu’avec désespoir. La terre est le temple de l’expiation.
l’esprit de la lyre. Eh bien, je t’aime, ô terre, fille de l’amour et de la douleur ! Je sens en effet s’exhaler de ton sein une attraction brûlante. Je voudrais, languissant, t’étreindre dans un immense baiser, et m’endormir sur ton flanc tiède sans savoir dans quel monde je m’éveillerai.
hélène. Oui, la nuit est belle, et la terre est enchantée. Les rayons de la lune la caressent doucement, et son chant se marie délicieusement au chant des étoiles. Chante encore, ô belle création d’amour et de douleur ; chante par tes mille voix. Éveillez-vous, créatures embrasées de la soif de l’infini. Esprits terrestres, beaux sphinx aux ailes de pourpre et d’azur, ouvrez vos yeux ardents et plongez-les dans le sein des fleurs enivrées. Allons, datura paresseux, chante l’hymne aux étoiles ; déjà le phalène qui t’aime danse en rond autour de ta corolle endormie. Et toi, pervenche, relève ta tête appesantie, et n’attends pas que la brise te secoue rudement pour chanter avec elle. Commence ton poëme, ô rossignol inspiré ! ne souffre pas que les sanglots de la chouette te devancent. Allons, ruisseau, élance-toi parmi les rochers, et que tes marges fleuries répètent ta fanfare sur tous les tons de la joie, du désir, de l’amour et de l’inquiétude. Ô mon âme, que tu souffres ! Que les étoiles sont loin ! que leur voix est faible ! Ô terre, je t’aime ! Quand mourrai-je, ô mon Dieu ? Ô mon Dieu, où es-tu ? Quand briseras-tu la lyre ? Esprit, esprit de la lyre, quand te verrai-je, quand serons-nous délivrés ?
l’esprit. Fille des hommes, tu ne m’aimes pas. Tu ne songes qu’à Dieu ; tu n’aspires qu’à l’infini. Vois comme la terre est belle, et comme il est doux de vivre sur son sein dans l’oubli de l’avenir, dans la contemplation du présent, dans les voluptés de la paresse, dans les larmes de l’amour. Aime, aime ce qui t’appartient. Dieu ne t’aime peut-être pas ; Dieu ne t’appartiendra peut être jamais.
hanz. Les mains d’Hélène cherchent encore les cordes. Remarquez-vous, maître, qu’aujourd’hui elle joue davantage, et qu’elle semble établir un dialogue avec cette puissance invisible qui fait chanter la lyre ?
albertus. Aujourd’hui, il me semble que je suis sur la trace d’une explication naturelle du prodige. Cette lyre serait une sorte d’écho. Sa construction ingénieuse la rendrait propre à reproduire les sons déjà produits par la main qui en ébranle les cordes.
wilhelm. Ô maître, vous n’écoutez donc pas ? Les sons produits par la main d’Hélène et ceux qui se produisent ensuite d’eux-mêmes n’ont rien de commun. Ce sont des mélodies toutes différentes ; mais, comme elles ne changent ni de ton ni de mouvement, vous n’appréciez pas la différence continuelle des phrases.
albertus. Décidément, je suis un barbare.
hélène, jouant de la lyre. « Peut-être jamais ! » Que ces mots sont effrayants ! Est-il possible qu’on les prononce sans mourir ! Ah ! si l’homme pouvait dire avec certitude Jamais ! aussitôt il cesserait de vivre. Peut-être ! voilà donc le thème mélancolique que tu redis incessamment, ô terre infortunée ! Dans tes plus beaux jours de soleil comme dans tes plus douces nuits étoilées, ton chant est une continuelle aspiration vers des biens inconnus. Aussi Dieu a fait bien courte l’existence des êtres que tu engendres ; car le désir est impérieux ; et, si la vie de l’homme se prolongeait au delà d’un jour, le désespoir s’emparerait de son âme et consumerait sa puissance d’immortalité. Ô lune ! à ton aspect, la face de la terre se couvre de larmes, et son sein n’exhale que des plaintes, car ton spectre livide et ta destinée mystérieuse semblent remplir la voûte céleste d’un cri de souffrance et de crainte : Peut-être jamais !
hanz, à Albertus. Maître, vous devenez triste. Ce chant vous émeut enfin ?
albertus. Il me fait mal, j’ignore pourquoi.
wilhelm. Et moi, il me déchire.
l’esprit de la lyre. Hélène, Hélène, reviens à toi ; chasse ces terreurs inutiles. La nature est belle, la Providence est bonne. Pourquoi toujours aspirer à un monde inaccessible ? Que t’importe demain, si aujourd’hui peut donner le bonheur ? Si tu veux entrer dans la vie immatérielle, apprends la première faculté que tu dois acquérir, la résignation.
L’orgueil de l’homme ne veut jamais se plier à la sainte ignorance où végètent tant d’êtres paisibles dont son univers est peuplé. Vois, fille de la lyre, comme les fleurs sont belles ; écoute comme le chant des oiseaux est mélodieux ; respire toutes ces suaves émanations, entends toutes ces pures harmonies de la terre. Quel que soit l’auteur et le maître de ces choses, une pensée d’amour a présidé à leur création, puisqu’elle leur a départi la beauté et l’harmonie. Il y a bien assez de bonheur à les contempler. L’homme est ingrat quand il ferme ses sens à tant de chastes délices.
Ah ! plutôt que de chercher sans cesse à déchirer le voile qui te sépare de l’idéal, pourquoi ne pas jouir de la réalité ? Viens avec moi, ma sœur, viens : mes ailes t’enlaceront et te porteront sur les cimes des montagnes. Nous raserons d’un vol rapide les nappes de fleurs variées que la brise fait onduler sur les prairies. Nous franchirons les torrents en nous jouant dans le prisme écumant des cataractes ; nous mouillerons nos robes argentées à la crête des vagues du lac, et nous courrons sur le sable fin des rivages sans y laisser l’empreinte de nos pas. Nous nous suspendrons aux branches des saules, et je sèmerai tes blondes tresses des insectes d’azur, vivants saphirs que distillent leurs rameaux éplorés. Je te ferai une couronne de fleurs d’iris et de lotus. Nous les irons chercher sur ces roches glissantes que les pieds de l’homme n’ont jamais touchées, au milieu de ces abîmes tournoyants d’où les barques s’éloignent avec effroi. Et puis nous traverserons les jeunes blés, et nous marcherons sur leurs têtes blondes sans les courber ; nous gravirons les collines, plus rapides que l’élan et le chamois ; nous franchirons ces grandes bruyères où le francolin et le lagopède cachent leurs nids dans des retraites inaccessibles ; nous voltigerons, comme les grands aigles, sur ces pics de marbre où l’arc et la fronde ne peuvent les atteindre ; nous les dépasserons ; nous irons nous asseoir sur ces aiguilles de glace où l’hirondelle même n’ose poser ses pieds délicats, et, de là, nous verrons scintiller les étoiles dans une atmosphère plus pure, et nous embrasserons d’un coup d’œil l’immensité des constellations célestes. Et alors, abaissant les regards sur cette terre si belle, d’où montent sans cesse de si touchantes harmonies, et les reportant sur le firmament, qui lui répond par des chants d’espérance si faibles mais si doux, tu sentiras ton âme se fondre et tes pleurs couler ; car tu comprendras que, si Dieu a mis des bornes à la connaissance de l’homme, il a donné en revanche à sa pensée le sens du beau, et à ce sens l’aliment inépuisable d’une création sublime à contempler.
hélène. Oui, la contemplation est la plus grande jouissance de l’homme ! et je te salue, je t’admire et je t’aime, ô terre, œuvre magnifique de la Providence ! Aime-moi aussi, ô ma mère féconde ! aime tous tes enfants ; pardonne-leur l’ennui qui les ronge et l’impatience de te quitter qui les dévore. Tes enfants sont tristes, ô mère patiente ! Tu les combles de tes dons, et ils en abusent ; tu leur crées mille délices, et ils les méprisent. Tu les engendres et tu les nourris de ton sein ; mais leur unique plainte est celle-ci : « Ô mère impitoyable, tu m’as donné la vie, et je te demandais le repos. Maintenant, à peine ai-je joui de la vie, et tu ouvres ton sein avide pour m’y replonger dans un affreux sommeil. Ô marâtre, puisque tu m’as fait vivre, pourquoi veux-tu me faire mourir ? »
l’esprit. Écoutez ! rien ne meurt, tout se transforme et se renouvelle ; et, quand même la pensée ne remonterait pas vers ces hauteurs sublimes d’où tu la crois émanée, il y aurait encore pour toi des rêves délicieux au delà de la tombe. Quand même ton essence enchaînée pour jamais à celle de la terre se mêlerait à ses éléments, il y aurait encore une destinée pour toi. Qu’oserais-tu mépriser dans la nature, ô fille de la lyre ? Si tu comprends la beauté de tous les êtres qui la remplissent, quelle transformation peut t’effrayer ou te déplaire ? N’as-tu jamais envié les ailes soyeuses de l’hespérie ou le plumage du cygne ? Quoi de plus beau que la rose ? quoi de plus pur que les lis ? N’est-ce rien que la vie d’une fleur ? Celle de l’homme est-elle aussi douce, aussi résignée, aussi touchante ? Y a-t-il une seule grâce oubliée ou perdue dans ce tableau immense ? y a-t-il une seule note isolée ou étouffée dans ce vaste concert ? La Providence n’a-t-elle pas une caresse pour le moindre brin d’herbe qui fleurit, aussi bien que pour le plus grand homme qui pense ? Écoute, écoute ; tu t’es trompée. Ce thème que tu as cru entendre, ce n’est point un chant de doute et d’angoisse… Écoute mieux, le ciel dit : « Espoir ! » Et la terre lui répond : « Confiance !… » (Hélène dépose la lyre et s’agenouille.)
hanz. Qu’avez-vous, chère sœur ? Pourquoi vos larmes coulent-elles ainsi sur vos belles mains jointes ?
wilhelm. Laisse-la prier Dieu. Elle ne t’entend pas.
albertus, à Hélène qui se relève. Êtes-vous mieux, mon enfant ?
hélène. Je me sens bien.
albertus, à ses élèves. Il est temps qu’elle rentre. La soirée devient froide ; emmenez-la, mes amis, et recommandez à sa gouvernante de la faire coucher tout de suite.
wilhelm. Ne venez-vous pas avec nous, maître ?
albertus. Non, j’ai besoin de marcher encore. Je vous rejoindrai bientôt.
carl. N’oublions pas la lyre.
albertus. Laisse-là-moi. J’en aurai soin. Prenez soin de votre sœur.
wilhelm. Hélène, appuie-toi sur mon bras.
hélène, prenant le bras de Wilhelm. La vie n’a qu’un jour.
carl. Hélène, laisse-moi t’entourer de mon manteau.
hélène Et ce jour résume l’éternité.
hanz. Hélène, ne saurais-tu nous dire à quoi tu pensais tout à l’heure en jouant de la lyre ?
hélène. Je le sais, mais je ne pourrais vous l’expliquer.
carl. Mais ne saurais-tu donner à cette improvisation un nom qui nous en révèle le sens ?
hélène. Appelez-la, si vous voulez, les cœurs résignés.
albertus. Et celle d’hier ?
hélène, effrayée. Hier ! hier !… c’était… les cœurs heureux ; mais je n’ai pu la retrouver aujourd’hui, je ne m’en souviens plus.
Scène II — ALBERTUS, seul.
Il n’y a plus à en douter, cette lyre est enchantée. Elle commande aux éléments ; elle commande aussi à la pensée humaine ; car mon âme est brisée de tristesse, et, sans comprendre le sens mystérieux de son chant, je viens d’en subir l’émotion douloureuse et profonde… Enchantée !… Est-ce donc moi dont la bouche prononce et dont l’esprit accepte un pareil mot ? Il me semble que mon être s’anéantit. Oui, ma force intellectuelle est sur son déclin ; et, au lieu de lutter par la raison contre une évidence peut-être menteuse, je l’accepte sans examen, comme un fait accompli… Peut-être le meunier du moulin, que j’aperçois là-bas parmi les peupliers, pourrait m’expliquer fort naturellement le prodige des eaux suspendues dans leur cours. Il n’a fallu qu’une coïncidence fortuite entre le moment où Hélène, dans sa folie, commandait au ruisseau de s’arrêter, et celui où le garçon du moulin fermait la pelle de l’écluse… Il y a peu de temps, je n’aurais pas hésité un seul instant à constater l’explication grossière de ce fait en apparence surnaturel ; aujourd’hui, je me complais dans le doute, et je crains d’éclaircir le mystère. Est-ce qu’à force de contempler la face auguste de la vérité, l’esprit mobile et frivole de l’homme s’en lasserait ? Ah ! sans doute, quand ce moment arrive pour un esprit méditatif, il doit s’épouvanter ; car ce moment marque sa décadence et son épuisement.
Scène III. — MÉPHISTOPHÉLÈS, sortant des saules ; ALBERTUS.
Méphistophélès. Si le meunier avait baissé la pelle de l’écluse juste au moment où Hélène prononçait les paroles sacramentelles, la coïncidence fortuite serait un prodige beaucoup plus étonnant que le fait naturel dont vous avez été témoin.
Albertus. Encore ce juif ! Il me suit comme mon ombre ; que le soleil se montre ou que la lune se lève, il est sur mes talons… Maître Jonathas, vous prenez beaucoup d’intérêt, ce me semble, aux perplexités de mon esprit.
Méphistophélès. Maître Albertus, je m’intéresse à toutes choses et ne m’étonne d’aucune.
Albertus. Vous êtes plus avancé que moi.
Méphistophélès. Beaucoup plus avancé, sans aucun doute, car vous ne l’êtes guère. Vous n’avez donc jamais ouï constater par les savants le rapport qui existe entre le son et le mouvement de certains corps ? Vous n’avez point assisté aux cours d’un savant qui, tout dernièrement, a placé devant nous un vase rempli d’eau incliné sur un récipient ? En calculant la masse d’eau coulante sur la force du son d’un violon, il modifiait la direction, le bouillonnement et la rapidité de l’irrigation au gré de l’archet promené sur les cordes. La théorie de cette action sympathique sera longtemps discutée peut-être, mais le fait est avéré. Peut-être en trouveriez-vous une explication satisfaisante dans les manuscrits que je vous ai remis ce matin,
Albertus. Plût au ciel que je n’eusse pas jeté les yeux sur ce maudit grimoire ! Les extravagances dont il est rempli ont troublé mon cerveau toute la journée.
Méphistophélès. Pourtant, mon maître, vous avez fait une expérience qui n’a pas mal réussi. En retranchant deux cordes de la lyre, vous avez tellement changé la nature des inspirations d’Hélène, que, pour la première fois de votre vie, vous avez failli comprendre la musique.
Albertus, à part. Ses railleries m’irritent, et pourtant cet homme semble lire en moi. Il sait évidemment beaucoup de choses que j’ignore. Pourquoi ne lui ouvrirais-je pas mon âme ? Son scepticisme ne peut être contagieux pour moi, et sa science peut me tirer du labyrinthe où je m’égare. (Haut.) Maître Jonathas, vous étiez donc là pendant qu’Hélène jouait de la lyre ? Vous avez compris son chant ?
Méphistophélès. Très-bien. Elle a chanté la création terrestre, la nature, comme on disait au xviiie siècle, en langue philosophique. La première corde d’argent est consacrée à la contemplation de la nature ; la seconde, à la Providence… Oh ! je sais par cœur le manuscrit d’Adelsfreit… Aujourd’hui, vous avez retranché les cordes d’or, l’infini et la foi. Il faut bien que la pauvre inspirée se rejette sur l’espérance et sur la contemplation.
Albertus. Sur le doute et la mélancolie ; car voilà ce que j’ai compris dans son chant, et voilà l’impression douloureuse qui m’en est restée, à moi !
Méphistophélès. Il ne faut pas que cela vous inquiète. Si vous retranchiez les deux cordes d’argent, vous verriez bien autre chose.
Albertus. Et si je retirais ces deux cordes d’acier ?
Méphistophélès. La lyre chanterait tout différemment, et vous commenceriez à lire dans la musique et dans la poésie comme vous lisez dans le dictionnaire de Bayle.
Albertus. Vous le croyez ?
Méphistophélès. J’en suis sûr. Consultez le manuscrit en rentrant chez vous.
Albertus. Eh bien, j’essayerai encore cela. Mais je tâcherai de ne pas briser les cordes, comme j’ai brisé, sans le vouloir, les deux premières.
Méphistophélès. Sans doute ! La lyre est enchantée, et cela peut porter malheur ! Ne vous sentez-vous pas la fièvre depuis tantôt ?
Albertus. Quel plaisir pouvez-vous prendre à railler un esprit sincère qui s’abandonne à vous ?
Méphistophélès. Je ne raille pas. N’avez-vous jamais entendu raconter à maître Meinbaker, père de votre Hélène et descendant en ligne directe du fameux Adelsfreit, que ce magicien, le jour de sa mort, ayant mis la dernière main à la lyre, se prit d’un tel amour pour ce chef-d’œuvre, qu’il demanda à monseigneur de là-haut, le pape des étoiles…
Méphistophélès. Quelles folies me racontez-vous là ? Meinbaker avait la tête pleine de contes de fées. Il prétendait qu’Adelsfreit avait demandé à Dieu de mettre son âme dans cette lyre, et que Dieu, pour le punir d’avoir ainsi joué avec son héritage céleste, l’avait condamné à vivre enfermé dans cet instrument jusqu’à ce qu’une main vierge de tout péché l’en délivrât.
Méphistophélès. Et, à l’instant même où il eut prononcé ce vœu téméraire, il mourut subitement.
Albertus. Son esprit était égaré depuis quelque temps ; il se donna la mort volontairement.
Méphistophélès. Tout ceci renferme une charmante allégorie.
Albertus. Laquelle ?
Méphistophélès. C’est que le savant, comme l’artiste, se doit à la postérité. Le jour où l’amour de l’art et de la science devient une satisfaction égoïste, l’homme qui sacrifie l’avantage des autres hommes à son plaisir est puni dans son œuvre même. Elle reste enfouie, oubliée, inutile, pendant des siècles ; sa gloire se perd dans les nuages dont la superstition l’environne ; et, pour avoir dédaigné de se révéler à ses contemporains, il est condamné à n’être tiré de la poussière que par un esprit simple qui profite de ses découvertes et usurpe sa renommée.
Albertus. J’aime cette interprétation ; je savais bien que vous étiez un homme plus sérieux que vous ne voulez le paraître.
Méphistophélès. Puisque vous me faites tant d’honneur, profitez, maître Albertus, d’un conseil très-sérieux : ne négligez pas de pénétrer le mystère qui vous paraît encore envelopper les propriétés de cette lyre magnétique. Soyez sûr qu’il y a, entre elle et la folie de votre pupille Hélène, un rapport qu’il est de votre devoir d’éclaircir et de faire connaître. Autrement, le public imbécile s’emparera d’un fait naturel pour accréditer ses superstitions. On dira qu’il s’est passé dans votre maison des choses diaboliques, et votre silence sera une sanction des contes absurdes qu’on débite déjà. La magie était passée de mode ; mais le peuple n’en a pas perdu le goût, et des esprits distingués aiment à ressusciter ces vieilles croyances sous d’autres noms, croyant faire du neuf et sortir de la routine philosophique.
Albertus. Vous avez raison. Mes meilleurs élèves sont les premiers à accepter toutes ces extravagances. Je poursuivrai l’expérience ; et, pour commencer…, je vais ôter les deux cordes d’argent, mais avec précaution, afin de voir, en les remettant plus tard, si Hélène recommence le chant de ce soir.
Méphistophélès. Tournez les chevilles tout doucement. (Albertus touche la première corde d’argent, qui se brise aussitôt qu’il y porte la main.)
Albertus. Ô ciel ! déjà brisée ! Il semble que mon intention suffise sans le secours de ma main !
Méphistophélès. Je vous avais prévenu. Cet instrument est d’une délicatesse extrême. La sympathie le gouverne.
Albertus. Comme tout à coup le ciel est devenu sombre !… Voyez donc, maître Jonathas, la lune est cachée sous les nuages, et l’orage s’amoncelle sur nos têtes.
Méphistophélès, riant. C’est sûrement l’effet de cette corde cassée. Je ne vous conseille pas de toucher à l’autre.
Albertus. Vous me prenez pour un enfant… Je tournerai cette cheville avec tant de lenteur… (Il y touche, et la corde se brise.)
Méphistophélès. Vous l’avez tournée à rebours. Décidément, vous êtes adroit comme un philosophe !
Albertus. Quel cri lamentable est parti du sein des ondes ! Ne l’avez-vous pas entendu, maître Jonathas ?
Méphistophélès. Le grincement de cette corde cassée agace les nerfs du courlis endormi dans les roseaux.
Albertus. Quel coup de vent ! Les peupliers se plient comme des joncs !
Méphistophélès. Il va faire de l’orage. Bonsoir, maître Albertus.
Albertus. Vous me quittez ! Ne m’expliquerez-vous pas ce que j’éprouve en cet instant ? Une terreur invincible s’empare de moi. La sueur coule de mon front. Ah ! ne riez pas de ma détresse ! Je consens à souffrir, je consens même à être humilié, pourvu que mon esprit s’éclaire, et que je fasse, à mes dépens, un pas vers la connaissance de la vérité.
Méphistophélès, éclatant de rire. La vérité, c’est que vous êtes un grand philosophe, et que vous avez peur du diable. (Il se montre sous sa véritable forme. Albertus fait un cri et tombe évanoui.)
Méphistophélès. Maintenant, privée de toutes les cordes qui chantent la gloire ou la bonté de son maître, cet Esprit doit être en ma puissance. Tâchons de briser la lyre. Hélène mourra, et Albertus deviendra fou. (Il veut briser la lyre.)
Chœur des esprits célestes. Arrête, maudit ! Tu ne peux rien sur elle. Dieu protége ce que tu persécutes. En faisant souffrir les justes, tu les rapproches de la perfection. (Méphistophélès s’envola et disparaît dans la brume de la rivière.)
Scène IV. — ALBERTUS, se ranimant peu à peu.
Quelle affreuse vision ! Ne l’avez-vous pas vue, maître Jonathas ? C’était un spectre hideux. Toutes les souffrances de la perversité semblaient avoir creusé ses joues livides. Un rire amer, triomphe d’une haine implacable, entr’ouvrait ses lèvres glacées ; et dans son regard j’ai vu toutes les fureurs de l’injustice, toutes les ruses de la lâcheté, toute la rage impitoyable d’un désespoir sans ressources ! Quel est cet être infortuné dont l’aspect foudroie et dont le regard déchire ? Dites, Jonathas, le connaissez-vous ?… Mais où donc est le vieux juif ? Je suis seul, seul dans les ténèbres !… Mes cheveux sont encore dressés sur ma tête !… Ah ! quelle faiblesse s’est donc emparée de moi ? Quelle douleur est tombée sur ma poitrine et l’a brisée, comme un marteau brise le verre ?… (voyant la lyre à ses pieds.)
Ah ! je me souviens ! J’ai porté encore une fois ma main impie sur cette relique sacrée, dépôt d’un ami mourant, héritage d’une fille pieuse. J’ai voulu détruire ce chef-d’œuvre d’un artiste, cet instrument, source des seules joies qu’éprouve la triste Hélène. Il y avait dans cette lyre un mystère que j’aurais dû respecter ; mais mon orgueil, jaloux de ne pas comprendre son langage, et les perfides conseils de ce juif sophiste m’ont égaré… Pauvre Hélène ! que te restera-t-il, si tu ne peux chanter ni la force ni la douceur du Tout-Puissant ? Mon crime porte avec lui son châtiment. Les mêmes cordes que j’ai brisées à cette lyre se sont brisées au fond de mon âme. Depuis hier, l’idée de l’infini s’est voilée en moi : le doute amer a contristé toutes mes pensées, et, depuis un instant, ma confiance en Dieu s’est évanouie comme ma foi. Il me semblait, pendant qu’Hélène improvisait en regardant la lune, que je pourrais bientôt comprendre les secrets de sa poésie étrange. La nature s’embellissait à mes yeux, et, en même temps qu’une mélancolie profonde s’emparait de moi, j’éprouvais un charme inconnu à savourer ces langueurs d’une contemplation à la fois chaste et voluptueuse auxquelles je n’avais jamais osé me livrer. Oui, je comprenais ce qu’il y a de religieux dans le doute et ce qu’il y a de divin dans la rêverie… Et maintenant, ce monde poétique s’est déjà écroulé. Une voix aigre a jeté un cri de malédiction sur la terre épouvantée. La lune ne répand plus sa molle clarté sur les gazons, et les insectes cachés sous l’herbe ne sèment plus leurs petites notes mystérieuses dans le silence solennel de la nuit. La chouette glapit et s’envole vers le cimetière ; le ruisseau traîne de longs sanglots, comme si sa naïade déchirait ses membres délicats sur les cailloux tranchants ; le vent froisse les feuilles avec colère, et sème les fleurs sur le gravier ; les reptiles sifflent, et les ronces se dressent sous mes pieds. Tout pleure, rien ne chante plus ; et il me semble que c’est moi qui ai troublé la paix de cette nuit sereine en évoquant le désespoir par je ne sais quel maléfice !… Ô mon Dieu ! pourquoi ai-je sacrifié à une vaine sagesse les plus douces impressions de ma vie ? Pourquoi cette âpre résistance, quand une destinée nouvelle pouvait s’ouvrir devant moi ? Que n’ai-je cédé au penchant qui m’entraînait vers la jeunesse, vers la beauté, vers l’amour ? Hélène m’eût aimé peut-être, si, au lieu d’égarer son esprit dans le dédale du raisonnement, je l’eusse laissée s’élever en liberté vers les régions fantastiques où son essor l’entraînait ! Peut-être y avait-il autant de logique dans sa poésie qu’il y en avait dans ma science. Elle m’eût révélé une nouvelle face de la Divinité ; elle m’eût montré l’idéal sous un jour plus brillant… Dieu ne s’est communiqué à moi jusqu’ici qu’à travers le travail, la privation et la douleur ; je l’eusse possédé dans l’extase de la joie… Ils le disent, du moins ; ils le disent tous ! ils se prétendent heureux, tous ces poëtes, et leurs larmes sont encore du bonheur, car elles sont versées dans l’ivresse. Notre sérénité leur offre l’image de la mort, et notre existence est à leurs yeux le néant !… Qui donc m’a persuadé que j’étais dans la seule voie agréable au Seigneur ? N’avais-je pas, moi aussi, des facultés pour la poésie ? Pourquoi les ai-je refoulées dans mon sein comme des aspirations dangereuses ?… Et moi aussi, j’eusse pu être homme !… Et moi aussi, j’eusse pu aimer !…
Scène V. — HANZ, ALBERTUS.
Hanz. Nous sommes inquiets de vous, mon cher maître ; la pluie commence, et l’orage va éclater. Veuillez prendre mon bras, car l’obscurité est profonde et le sentier est escarpé.
Albertus. Hanz ! dis-moi, mon fils, es-tu heureux ?
Hanz. Quelquefois, mon bon maître, et jamais bien malheureux.
Albertus. Et ton bonheur, il te vient… de la sagesse ? de l’étude ?
Hanz. En partie ; mais il me vient aussi de la poésie, et encore plus de l’amour.
Albertus. Tu es aimé ?
Hanz. Non, mon maître. Hélène ne m’aime pas ; mais je l’aime, moi, et cela me rend heureux, quoique cela me fasse souffrir.
Albertus. Explique-moi ce mystère.
Hanz. Maître, l’amour me rend meilleur ; il élève mon âme, il l’embrase, et je me sens plus près de Dieu quand je me sens amoureux et poëte… Mais rentrons, mon cher maître, la pluie augmente, et le chemin sera difficile. Vous semblez plus fatigué que de coutume.
Albertus. Hanz, je me sens faible… Je crois que je suis découragé !…
ACTE QUATRIÈME
LES CORDES D’ACIER
Scène PREMIÈRE. — Sur la grande tour de la cathédrale. ALBERTUS, HÉLÈNE.
Albertus. Arrêtons-nous sur cette terrasse, mon enfant ; cette rapide montée a dû épuiser tes forces.
Hélène. Non ; je peux monter plus haut, toujours plus haut.
Albertus. Tu ne peux monter sur la flèche de la cathédrale. L’escalier est dangereux, et l’air vif qui souffle ici est déjà assez excitant pour toi.
Hélène. Je veux monter, monter toujours, monter jusqu’à ce que je retrouve la lyre. Un méchant esprit l’a enlevée et l’a portée sur la pointe de la flèche. Il l’a déposée dans les bras de l’archange d’or qui brille au soleil. Mais j’irai la chercher, je ne crains rien. La lyre m’appelle. (Elle veut s’élancer sur l’escalier de la flèche.)
Albertus, la retenant. Arrête, ma chère Hélène ! Ton délire t’abuse. La lyre n’a point été enlevée. C’est moi qui, pour t’empêcher d’en jouer, l’ai ôtée de dessous ton chevet. Mais reviens à la maison, et je te la rendrai.
Hélène. Non ! non ! vous me trompez. Vous vous entendez avec le juif Jonathas pour tourmenter la lyre et me donner la mort. Le juif l’a portée là-haut. J’irai la reprendre ; suivez-moi, si vous l’osez. (Elle commence à gravir l’escalier.)
Albertus. lui montrant la lyre, qu’il tenait sous son manteau. Hélène ! Hélène ! la voici, regarde-la ! Reviens, au nom du ciel ! Je t’en laisserai jouer tant que tu voudras. Mais redescends ces marches, ou tu vas périr.
Hélène, s’arrêtant. Donnez-moi la lyre, et ne craignez rien.
Albertus. Non ; je te la donnerai ici. Reviens. Ô ciel ! je n’ose m’élancer après elle. Je crains qu’en se hâtant, ou en cherchant à se débattre, elle ne se précipite en bas de la tour.
Hélène. Maître, étendez le bras et donnez-moi la lyre, ou je ne redescendrai jamais cet escalier.
Albertus, lui tendant la lyre. Tiens, tiens, Hélène, prends-la. Et maintenant appuie-toi sur mon bras, descends avec précaution. (Hélène saisit la lyre, et monte rapidement l’escalier jusqu’au sommet de la flèche.)
Albertus, la suivant. Ô ciel ! ô ciel ! elle est perdue, elle va tomber ! Ô malheureux ! à quoi ont servi tes précautions ! elles n’ont servi qu’à hâter sa perte. (À Hanz et à Wilhelm, qui arrivent sur la terrasse.) Ô mes amis ! Ô mes enfants ! voyez à quel péril elle est exposée…
Hélène. Laissez-moi ! si un de vous met le pied sur ces marches, je me précipite.
Wilhelm. Le plus sage est de la laisser contenter sa fantaisie. En voulant la secourir, on ne peut que déterminer sa mort.
Hanz. N’ayez pas peur, maître, il y a en elle un esprit qui la possède. Elle agit par une impulsion surnaturelle. Laissez-la, ne lui dites rien. Je vais monter, sans qu’elle me voie, par l’escalier opposé. Je me cacherai derrière l’archange de bronze, et, si elle veut se précipiter, alors je me jetterai sur elle et la retiendrai de force. Ayez l’air de ne pas vous inquiéter d’elle. (Il passe derrière la flèche, et monte l’escalier opposé à celui qu’Hélène a franchi. Albertus et Wilhelm s’appuient contre la balustrade de la tour. Hélène, au haut de la flèche, s’assied sur la dernière marche, aux pieds de la statue de l’archange.)
Albertus. Quel effrayant spectacle ! Suspendue ainsi dans les airs, sans appui, sans balustrade, sur cette base étroite, pourra-t-elle résister au vertige ? Ô misérable que je suis ! C’est moi qui serai cause de sa mort !
Wilhelm. Maître, son délire même la rend inaccessible au vertige. Elle échappera au danger, parce qu’elle n’en a pas conscience. D’ailleurs, voyez ! Hanz est déjà auprès d’elle, derrière la statue. Hanz est vigoureux et intrépide ; il est calme dans les grandes occasions : il la préservera. Prenez courage, et surtout montrez-vous tranquille. (Hélène accorde la lyre.)
Albertus, à part. Si elle s’aperçoit de la soustraction des deux cordes, qui sait à quel acte de désespoir elle peut se porter ? Mais non !… elle ne s’en aperçoit pas… Elle rêve, elle s’inspire du spectacle déployé sous ses pieds !
L’esprit de la lyre. Ô fille des hommes ! vois ce spectacle éblouissant ! Écoute ces harmonies puissantes !
Hélène. Je ne vois rien qu’une mer de poussière embrasée que percent çà et là des masses de toits couleur de plomb et des dômes de cuivre rouge où le soleil darde ses rayons brûlants ! Je n’entends rien qu’une clameur confuse, comme le bourdonnement d’une ruche immense, entrecoupé par instants de cris aigus et de plaintes lugubres !
L’esprit. Ce que tu vois, c’est l’empire de l’homme ; ce que tu entends, c’est le bruissement de la race humaine.
Hélène. Maintenant, je vois et j’entends mieux. Mes yeux percent ces nuages mouvants et distinguent les mouvements et les actions des hommes. Mes oreilles s’habituent à cette sourde rumeur, et saisissent les discours et les bruits que fait la race humaine.
L’esprit. N’est-ce pas un tableau magique et un concert imposant ? Vois quelle est la grandeur et la puissance de l’homme ! admire ses richesses si chèrement conquises, et les merveilles de son infatigable industrie ! Vois ces temples majestueux qui dressent, comme des géants, leurs têtes superbes sur ces masses innombrables de demeures élégantes ou modestes, accroupies à leurs pieds ! Vois ces coupoles resplendissantes, semblables à des miroirs ardents, ces obélisques effilés, ces sveltes colonnades, ces palais de marbre, où le soleil allume dans chaque vitre de cristal un diamant aux mille facettes ! Regarde ce fleuve qui se roule comme un serpent d’or et d’azur autour des flancs de la grande cité, tandis que des ponts de fer et de granit, ici bordés de blanches statues qui se mirent dans les ondes, là suspendus comme par magie à d’invisibles cordons de métal, s’élancent d’une rive à l’autre, tantôt en arcades de pierres fortes et massives, tantôt en réseaux de fer transparents et déliés, et tantôt en élastiques passerelles qui plient sans rompre sous le poids des chariots et des cavaliers ! Vois ces arcs de triomphe où le jaspe et le porphyre travaillés par les mains les plus habiles servent de piédestal aux statues des grands hommes ou aux trophées de la guerre ! Vois de toutes parts ces symboles de la puissance et du génie, ces frontons chargés d’emblèmes, ces victoires aux ailes éployées, ces coursiers de bronze qui semblent bondir sous la main des conquérants ! Vois ces fontaines jaillissantes, ces édifices où la science accomplit ses prodiges ; ces musées où l’art entasse ses chefs-d’œuvre ; ces théâtres où l’imagination voit réaliser chaque jour ses plus beaux rêves ! Vois aussi cette rade immense où les bannières de toutes les nations flottent sur une forêt de mâts, et où, des extrémités de la terre, le commerce vient échanger ses richesses ! Porte tes regards plus loin, vois ces rivages fertiles, ces campagnes fécondes semées de villas magnifiques et coupées dans tous les sens de larges voies plantées d’arbres, où les chars volent dans la poussière, et où le pavé brûle sous le pied des coursiers rapides ! Vois des merveilles plus grandes encore : sur ces chemins étroits, rayés de fer, qui tantôt s’élèvent sur les collines et tantôt s’enfoncent et se perdent dans le sein de la terre, vois rouler, avec la rapidité de la foudre, ces lourds chariots enchaînés à la file, qui portent des populations entières d’une frontière à l’autre dans l’espace d’un jour, et qui n’ont pour moteur qu’une colonne de noire fumée ! Ne dirait-on pas du char de Vulcain roulé par la main formidable des invisibles cyclopes ? Vois aussi sur les flots la puissance de cette vapeur qui sillonne le flanc de la mer avec des roues brûlantes, et la rend docile comme la plaine au tranchant de la charrue ! — Et maintenant, écoute ! Ces myriades d’harmonies terribles ou sublimes qui se confondent en un seul rugissement plus puissant mille fois que celui de la tempête, c’est la voix de l’industrie, le bruit des machines, le sifflement de la vapeur, le choc des marteaux, le roulement des tambours, les fanfares des phalanges guerrières, la déclamation des orateurs, les mélodies de mille instruments divers, les cris de la joie, de la guerre et du travail, l’hymne du triomphe et de la force. Écoute, et réjouis-toi ; car ce monde est riche, et cette race ingénieuse est puissante !
Wilhelm. Ô mon maître ! l’heure et le lieu inspirent Hélène ! Jamais la lyre n’a été plus sonore, jamais le chant n’a été plus mâle, et l’harmonie plus large ou plus savante.
Albertus. Oui, maintenant enfin, je comprends le langage de la lyre. La vie circule dans mon sang et embrase mon cerveau du feu de l’enthousiasme. Il m’a semblé que je voyais au delà des bornes de l’horizon, et que j’entendais la voix de tous les peuples se marier à une voix éloquente émanée de mon propre sein.
Wilhelm. Maintenant, Hélène touche la lyre ; notre émotion sans doute va changer de nature ; écoutez bien !
Hélène, jouant de la lyre. Ô Esprit ! où m’as-tu conduite ? Pourquoi m’as-tu enchaînée à cette place, pour me forcer à voir et à entendre ce qui remplit mes yeux de pleurs et mon cœur d’amertume ? Je ne vois au-dessous de moi que les abîmes incommensurables du désespoir, je n’entends que les hurlements d’une douleur sans ressource et sans fin ! Ce monde est une mare de sang, un océan de larmes ! Ce n’est pas une ville que je vois ; j’en vois dix, j’en vois cent, j’en vois mille, je vois toutes les cités de la terre. Ce n’est pas une seule province, c’est une contrée, c’est un continent, c’est un monde, c’est la terre tout entière que je vois souffrir et que j’entends sangloter ! Partout des cadavres et autour d’eux des sanglots. Mon Dieu, que de cadavres ! mon Dieu, que de sanglots !…
Oh ! que de moribonds livides couchés sur une paille infecte ! Oh ! que de criminels et d’innocents agonisant pêle-mêle sur la pierre humide des cachots ! Oh ! que d’infortunés brisés sous des fardeaux pesants ou courbés sur un travail ingrat ! Je vois des enfants qui naissent dans la fange, des femmes qui rient et qui dansent dans la fange, des lits somptueux, des tables splendides couvertes de fange, des hommes en manteaux de pourpre et d’hermine tout souillés de fange, des peuples entiers couchés dans la fange ! La terre n’est qu’une masse de fange labourée par des fleuves de sang. Je vois des champs de bataille tout couverts de cadavres fumants et de membres épars qui palpitent encore ; j’en vois d’autres où s’élancent des bataillons poudreux, au son des fanfares guerrières. Je vois bien les armes reluire au soleil, j’entends bien les chants de l’espoir et du triomphe ; mais j’entends aussi les gémissements des blessés, les derniers soupirs des mourants que brisent les pieds des chevaux. J’entends aussi le cri des vautours et des corbeaux qui marchent derrière les armées, et l’air est obscurci de leur vol sinistre : eux seuls seront les vainqueurs ! eux seuls entonneront ce soir l’hymne de triomphe, en enfonçant leurs ongles ensanglantés dans la chair des victimes !
Je vois des palais, des armées, des fêtes, un grand luxe, une joie bruyante, en effet ! je vois et j’entends ruisseler l’or sur les tables et dans les coffres ! Ce sont les larmes du pauvre, la sueur de l’ouvrier, le sang du soldat qui coulent sur ces tables et qu’on serre dans ces coffres !… Chacune des pièces de cette monnaie devrait être frappée à l’effigie d’un homme du peuple ; car il n’est pas une de ces pièces de métal qui n’ait coûté la santé, l’honneur ou la vie à un homme du peuple !
Je vois des monarques assis sur des trônes élevés, autour desquels les nations se prosternent et que garde le triple rempart d’airain des armées ; mais j’entends aussi le peuple qui menace et qui pleure aux portes du palais ; j’entends les arbres des jardins royaux qui tombent sous la cognée, et les pavés qui s’entassent avec les cadavres pour fermer la marche aux soldats sanguinaires ; j’entends les cris de l’émeute, l’hymne généreux de la délivrance, le bruit des canons, le craquement des édifices qui s’écroulent sur les vaincus et sur les vainqueurs ; j’entends le tocsin terrible qui ébranle les vieilles tours et qui sonne d’une voix haletante la victoire et les funérailles !
J’entends aussi la parole sonore des nombreux orateurs ; j’entends le mensonge et le blasphème étouffer la parole du juste ; j’entends les applaudissements effrénés de la foule qui porte en triomphe les délateurs et les faussaires !
Je vois de majestueuses assemblées, et j’entends ce qu’on y discute. Quelques-uns disent qu’il s’agit de soulager la misère du peuple ; tous répondent que le peuple est trop riche, trop heureux, trop puissant ; et j’entends la masse immense des pharisiens qui se lève lentement en disant d’un air sombre : « Qu’il périsse ! » et je vois les puissances de la terre qui se parfument les mains en disant, le sourire sur les lèvres : « Qu’il périsse !… »
Albertus. Le rhythme est lugubre et la mélodie déchirante ! Voyez comme Hélène souffre, comme son visage est pâle et comme ses bras se tordent avec désespoir autour de la lyre ! Ô malheureuse prêtresse ! J’ai voulu être initié par toi à la poésie de la civilisation. Pythonisse enchaînée au trépied, tu expies dans les tortures ma coupable curiosité ! Ô Hélène ! cesse tes chants, reviens vers nous !…
Wilhelm. Maître, Hanz nous fait signe de ne pas l’appeler. Ravie dans une douloureuse extase, elle oublie que nous l’écoutons. Craignez qu’elle ne s’éveille et que le vertige ne la surprenne.
L’esprit de la lyre. Fille des hommes, pourquoi te désespérer ainsi ? As-tu donc oublié la Providence ? N’est-ce pas elle qui permet ces choses pour amener, par une dure expérience et une lente expiation, tous les hommes à la connaissance de la vérité et à l’amour de la justice ? Regarde ! il est déjà des hommes pieux et des cœurs vraiment purs. Le crime des uns ne fait-il pas la vertu des autres ? L’iniquité des tyrans ne fait-elle pas ressortir la patience ou l’audace des opprimés ? Vois ! que de dévouements sublimes, que d’efforts courageux, que de résignations évangéliques ! Vois ces mains fermes et patientes qui s’arment pour la délivrance, tandis que, pour les encourager, les captifs étouffent leurs sanglots derrière les barreaux de la prison ! Vois ces amis qui s’embrassent ; comprends-tu la dernière étreinte de celui qui accompagne l’autre jusqu’au pied de l’échafaud ? Comprends-tu le dernier regard de celui qui place en souriant sa tête sous la hache ?
Hélène. Je vois des vierges qu’on profane et des enfants qu’on égorge ; je vois des vieillards que l’on suspend au gibet ; je vois une femme que des courtisans traînent dans le lit d’un prince, et qui expire de honte et de désespoir dans ses bras ; je vois l’époux de cette femme qui reçoit de l’or et des honneurs pour garder le silence, et qui baise la main du prince ; je vois une jeune fille que des soldats frappent à coups de verges sur la place publique pour avoir chanté : Non, la patrie n’est pas perdue ! et qui devient folle ; je vois des enfants qu’on sépare de leur mère, qu’on isole de leur famille, et à qui l’on veut apprendre à maudire le nom de leur père et à renier l’héroïsme de leur sang ! Je vois des héros qu’on proscrit, des libérateurs dont la tête est mise à prix ; je vois de jeunes martyrs qu’on traîne hors de la prison, parce qu’ils n’expirent pas assez vite, et qu’on mène sous les glaces du pôle, de peur que leurs derniers soupirs ne percent les murs du cachot et n’arrivent à l’oreille de leurs frères ; je vois des paysans dont on déchire la chair avec des hameçons de fer, parce qu’ils ont oublié de couper leur barbe et d’endosser la livrée du vainqueur ; je vois une nation qu’on veut rayer de la face du globe, comme si elle n’avait jamais existé. On lui ôte ses chefs, ses libérateurs, ses prêtres, ses institutions, ses biens, son costume et jusqu’à son nom pour qu’elle périsse ; et l’univers regarde en disant : « Qu’elle périsse ! »
L’esprit de la lyre. Tu vois le mal qui se montre, tu ne vois pas le bien qui se cache. Ne peux-tu lire au fond des âmes généreuses qui préparent le jour de la justice ? n’entends-tu pas la prière des exilés, et ces chants de la patrie absente qui appellent la colère céleste sur les injustes, la miséricorde sur les faibles, la protection sur les forts ? Fille de la lyre ! au lieu de te lamenter sur les forfaits et les infortunes de l’homme, agenouille-toi et invoque le secours d’en haut. Prions ensemble, unissons nos larmes et nos prières. Que notre amour nous donne l’espoir et la ferveur ! Prions ! tenons-nous embrassés et prosternés aux pieds de celui…
Hélène. Tais-toi ! ne nomme pas ce qui n’existe pas ! Si une puissance fatale préside aux destins de l’humanité, c’est le génie du mal, car l’impunité protège le crime ! Que parles-tu de Providence ? que parles-tu d’amour ? La Providence est muette, elle est sourde, elle est impotente pour les victimes ; elle est ingénieuse et active pour servir les desseins de la perversité. Sois maudite, ô Providence ! Et toi, Esprit, ne me parle plus. Tu m’as révélé des maux que j’ignorais : sois puni de tes enseignements cruels par mon silence ; cherche l’amour dans un cœur que tu n’auras pas brisé ; demande ton salut à une âme qui pourra encore aimer et croire ! (Elle se lève. — Albertus fait un cri.)
Wilhelm. Non, non ! elle ne veut pas attenter à sa vie. Voyez ! elle jette la lyre dans l’abîme, et redescend vers nous légère comme l’hirondelle qui cache son nid au sommet des vieilles tours. Oh ! qu’elle est belle avec ses cheveux épars et sa robe blanche que le vent fait ondoyer !
Hélène, se jetant dans les bras d’Albertus. Mon père, emmenez-moi, cachez-moi ! Descendez-moi aux entrailles de la terre ; je ne veux plus voir le soleil, je ne veux plus entendre aucun bruit humain. Que personne ne me parle plus… Je veux arracher mes yeux, je veux être enfouie comme la taupe, endormie comme la chrysalide.
Albertus. Hélène, éloigne-toi de moi, accable-moi de ta haine, je suis l’auteur de tous tes maux… J’ai voulu ôter à la lyre…
Hélène. Ne me parlez plus de lyre, la lyre est brisée. Je l’ai jetée au vent… Vous ne la reverrez plus… Hanz, mon frère, emmenez-moi… Cet endroit me donne le vertige du désespoir.
Albertus. Emmenez-la bien vite, mes enfants, je vous suis.
Scène II. — Sur la place publique. GROUPE DE BOURGEOIS.
Un bourgeois. La musique a cessé ! Vraiment, c’est une chose merveilleuse, et de mémoire d’homme il ne s’est vu rien de pareil.
Second bourgeois. Qu’avez-vous donc à vous récrier ainsi, voisin ? Est ce que le sucre a encore baissé ?
Une vieille dame. Un miracle, monsieur, un miracle véritable !
Le second bourgeois. Le café ne paye plus les droits ?
La dame. Non, monsieur, l’archange de la cathédrale a joué de la trompette.
Troisième bourgeois. Quel archange ? quelle trompette ?
Le premier bourgeois. Parbleu ! compère, l’archange de cuivre qui est là-haut, là-haut, et qui souffle dans sa trompette depuis le temps du roi Dagobert sans en faire sortir le plus petit bruit. Eh bien, tout à l’heure il a joué des airs charmants pendant plus de vingt minutes ; je l’ai entendu comme…
Le second bourgeois. Comme vous m’entendez causer quand je ne dis rien. À d’autres, maître Spiegendorf !
Le troisième bourgeois. Vous avez eu une lubie, ma bonne dame. Les oreilles vous ont tinté.
La dame. Monsieur, je ne suis pas faite pour en imposer.
Le second bourgeois. Si vous n’avez que cela à nous dire, c’était bien la peine que je me dérange de mon comptoir.
Le troisième bourgeois. Et moi donc ! qui voyais tous ces badauds rassemblés là sur le milieu de la place, regardant en l’air le bout de leur nez, qu’ils prenaient pour la flèche de la cathédrale. J’espérais… c’est-à-dire je croyais qu’il était tombé quelqu’un du haut des tours, et je venais voir bien vite.
Le second bourgeois. Ils auront entendu l’organiste de la cathédrale qui étudie l’air de Marie trempe ton pain, pour nous le jouer dimanche à la grand’messe.
Le premier bourgeois. Ah ! Au fait, c’était peut-être cela.
La dame. Je connais très-bien le son de l’orgue. D’ailleurs, l’église est fermée, on ne l’entendrait pas d’ici. Et puis l’ange n’a pas du tout joué des airs d’église ; c’est même singulier comme c’était peu religieux.
Le premier bourgeois. Ah ! c’était pourtant joli, très-joli !
Le troisième bourgeois. Ils ont peut-être inventé quelque machine à musique qu’ils ont fourrée dans le corps de la statue pour qu’elle ait l’air de jouer de la trompette. Je parie que cela va sonner à toutes les heures, comme l’horloge de Jean de Nivelle.
Le second bourgeois. Ou bien seulement au coup de midi… Quelle heure est-il ?
Le premier bourgeois. Il est certain qu’il y avait quelque chose de blanc aux pieds de la statue.
Le troisième bourgeois. C’est cela ! c’était un cadran !
Le premier bourgeois. C’est égal, je vais voir ce qu’il en est. Je connais le concierge des tours ; il me laissera monter.
Le troisième bourgeois. Eh bien, j’y vais aussi. (Ils s’éloignent tous deux.)
La dame. Moi, je vais raconter à toute la ville ce que j’ai entendu. (Elle s’éloigne.)
Le second bourgeois, d’un air capable, croisant ses bras sur son tablier. Croirait-on qu’au jour d’aujourd’hui il y a encore tant de gens superstitieux ?… Ah ! voilà maître Albertus qui vient par ici. C’est un homme que je n’aime pas à rencontrer. Il vous regarde d’une drôle de manière, et il se passe dans sa maison des choses auxquelles le diable ne comprend goutte. Oh ! le juif Jonathas Taer qui vient derrière lui !… Pour le coup, je m’en vais à la maison. Je n’aime pas du tout les gens qui courent les rues après leur mort. (Il s’enfuit.)
Scène III — ALBERTUS, MÉPHISTOPHÉLÈS.
Méphistophélès, suivant Albertus, qui ne le voit pas. Où courez-vous si empressé et si agité, mon respectable maître ? Vous n’avez pas un regard, pas un simple signe de tête pour votre meilleur ami, ce matin.
Albertus.Toujours ce juif ! Il me suit comme un remords… Laissez-moi, monsieur, de grâce ! Je n’ai pas l’honneur d’être votre ami, et je n’ai pas de temps à perdre.
Méphistophélès, le suivant toujours et se plaçant près de lui. Je conçois votre inquiétude ; l’état d’Hélène vous afflige. Mais rassurez-vous, elle ne s’est jamais mieux portée.
Albertus, haussant les épaule Qu’en savez-vous ?
Méphistophélès. Vous ne pouvez pas douter que j’en sache plus long que vous sur bien des choses.
Albertus. Gardez votre science maudite ; elle ne m’a causé que trouble et désespoir.
Méphistophélès. Je m’étonne qu’un aussi grand philosophe se décourage pour un peu de souffrance. N’enseignez-vous pas tous les jours en chaire qu’il faut beaucoup souffrir pour arriver à la vérité ? qu’on ne saurait payer trop cher la conquête de la vérité ? que la vérité ne s’achète qu’au prix de nos sueurs, de nos larmes, de notre sang même ?…
Albertus. J’ai déjà beaucoup souffert depuis que je vous écoute, et, loin d’être arrivé à la vérité, il me semble que j’en suis plus éloigné que jamais. Le délire d’Hélène augmente, et rien ne m’explique les propriétés sympathiques de la lyre.
Méphistophélès. Permettez. D’abord le délire d’Hélène n’augmente pas. Hier, toute la journée, après sa promenade au bord de l’eau, elle a été pleine de raison.
Albertus. Il est vrai que son délire n’a commencé qu’au moment où je lui ai refusé la lyre. Alors, elle s’est enfuie de la maison, et je n’ai pu la rejoindre qu’au sommet de la grande tour.
Méphistophélès. Aussi pourquoi vouliez-vous l’empêcher de faire résonner la lyre ?
Albertus. Je craignais ce qui est arrivé. En la voyant si sensée et suivant avec tant de clarté une leçon assez abstraite que je venais de lui donner, je me flattais de la voir guérie, et j’aurais voulu que la lyre fût anéantie ; car, n’en doutez pas, tout son délire vient de cet instrument.
Méphistophélès. Sans aucun doute. Vous avez toujours pris pour un conte, pour une rêverie du vieux Meinbaker, un fait très-certain. Le premier accès de folie d’Hélène et la longue maladie qui en fut la suite n’eurent pas d’autre cause qu’un attouchement à la lyre.
Albertus. Le fait est bien constaté pour moi aujourd’hui. Mais qu’il reste à l’état de prodige ! je ne m’en tourmenterai plus. Hélène pouvait périr victime de ma curiosité. Dieu merci ! elle a échappé aujourd’hui à son dernier danger : la lyre est anéantie. Elle l’a jetée du haut de la flèche sur le marbre du parvis.
Méphistophélès. Ce qui n’empêche pas qu’elle ne soit intacte. Vous la retrouverez sur son socle dans votre cabinet. Il n’y manque d’autres cordes que celles ôtées par vous-même, et la table n’est pas seulement fêlée. Ses figures n’ont perdu ni bras ni jambes dans la bataille, et je suis sûr que l’accord n’est pas seulement dérangé.
Albertus. Ce que vous dites est impossible. Vous me raillez, mais je vous avertis que je suis las de vos discours.
Méphistophélès. Ne m’adressez jamais la parole si la lyre n’est pas telle que je vous dis et où je vous dis. Elle est tombée à mes pieds, comme j’écoutais Hélène au bas de la grande tour ; et, en ce moment, j’ai vu passer votre gouvernante Thérèse, à qui j’ai dit de la ramasser et de l’emporter.
Albertus. Je saurai bien tout à l’heure à quoi m’en tenir. Mais comment pouviez-vous entendre la lyre à une aussi grande distance ?
Méphistophélès. Le son de la lyre a cela de particulier, que, quelle qu’en soit la douceur, on en distingue les moindres notes d’un bout de la ville à l’autre. Tout le quartier l’a entendue aujourd’hui ; et, quant à moi, dont l’ouïe est très-fine, je pourrais vous raconter mot à mot ce que la lyre et Hélène se sont dit l’une à l’autre au sommet de la grande aiguille du clocher.
Albertus. Vous comprenez donc parfaitement le sens de la musique ?
Méphistophélès. Très-bien. N’a-t-elle pas chanté aujourd’hui les merveilles et les misères de la civilisation ? Tandis que la lyre disait la grandeur et le génie de l’homme, Hélène ne disait-elle pas ses crimes et ses malheurs ?
Albertus. Oui, j’ai compris cela aussi, — très-bien cette fois, — à ma grande surprise ! Le manuscrit d’Adelsfreit me l’avait prédit.
Méphistophélès. Sur trois cordes la mélodie sera forte et limpide. Tous la comprendront, car les deux cordes d’acier traitent de l’homme, de ses inventions, de ses lois et de ses mœurs. — Vous voyez que je sais mon Adelsfreit sur le bout du doigt. Quant à la corde d’airain, la dernière de toutes…, celui qui la fera vibrer connaîtra le mystère de la lyre.
albertus. Eh bien, je ne le connaîtrai pas. J’y renonce. Je briserai la lyre en rentrant à la maison.
méphistophélès. Présomptueux ! Croyez-vous que cela soit en votre pouvoir ? La lyre est tombée tout à l’heure du ciel en terre sans recevoir le plus léger dommage. Votre main se briserait en essayant de la détruire.
albertus. D’où vient donc que je brise sans le vouloir, et par le plus léger attouchement, ses cordes délicates ?
méphistophélès. Tout cela tient au mystère que vous ne voulez pas connaître. N’avez-vous jamais ouï dire qu’une âme poétique et tendre résiste avec constance aux plus grands revers de la fortune, tandis qu’elle se contriste, se resserre et se brise au moindre échec dans ses affections ? Vous-même, vous souriez quand l’autorité brutale ferme votre cours et arrête vos publications. Pourtant, si Hélène est malade, ou si un de vos disciples commet un acte d’ingratitude envers vous, votre force est vaincue, et vous versez des pleurs comme un enfant. Le mystère de la lyre n’est pas plus inexplicable que cela.
albertus. Vous vous tirez de tout par des comparaisons et des symboles.
méphistophélès. Tout est symbole dans l’ordre intellectuel comme dans l’ordre matériel ; ces deux ordres obéissent à des lois analogues et accomplissent des phénomènes analogues. En partant de ce raisonnement, et en brisant encore deux cordes de la lyre, vous vous emparerez du secret.
albertus. Je ne le ferai pas. Dieu sait quelle crise Hélène aurait à subir cette fois-ci !
méphistophélès. C’est un noble sacrifice, et je vous approuve. Cependant, je suis fâché que tout ceci ait fait tant de bruit, et que le pays tout entier soit bouleversé par les contes de sorciers et de revenants auxquels la folie d’Hélène et le son étrange de la lyre ont donné lieu. Vous passez maintenant pour un magicien, et moi aussi par contre-coup. Vous savez que je ris volontiers de toutes les choses qui me concernent ; mais, quant à vous, je suis vraiment affligé de vous voir perdre toute votre salutaire influence, et je prévois que vos excellentes doctrines, loin de porter leurs fruits, vont tomber dans un discrédit complet.
albertus. N’espérez pas me prendre par la vanité, je suis au-dessus de ce que les hommes diront de moi.
méphistophélès. Il n’est pas question de cela. Vous aviez une mission à remplir auprès des hommes, et vous les abandonnez à l’ignorance et à l’erreur…
albertus. Je n’aime pas assez l’humanité pour lui sacrifier Hélène ; Hélène est une âme pure, un être céleste. Les hommes sont tous des despotes, des traîtres ou des brutes.
méphistophélès. Je vois que la musique a fait son effet : c’est le propre de la lyre d’imposer à ceux qui l’écoutent les émotions de celui qui la fait parler. Il serait bien malheureux pour vous que vous restassiez sous cette impression fâcheuse ; le monde y perdrait beaucoup, et vous en auriez un jour de grands remords.
albertus. N’est-ce pas vous qui m’avez engagé à détruire les cordes qui eussent pu, par leur mélodie, élever et embraser mon âme ? Il vous sied bien de me reprocher l’effet de vos conseils !
méphistophélès. Vous me remercierez de mes conseils quand vous aurez accompli votre tâche, c’est-à-dire quand vous aurez fait de la lyre un instrument monocorde. Concevez encore ceci sous la forme symbolique. Pour élever votre âme vers l’idéal comme vous êtes parvenu à le faire, n’avez-vous pas, durant de longues années, travaillé à briser dans votre propre sein les fibres qui tressaillaient pour des joies terrestres ? N’avez-vous pas détruit tout ce qui eût pu vous distraire de votre but, et n’avez-vous pas concentré toutes vos pensées, tous vos sentiments, tous vos instincts sur un seul objet ?
albertus. C’est vrai, mais ici je travaille dans le sens inverse. J’ai commencé par détruire dans la lyre la poésie de l’infini, et je suis arrivé à la poésie des choses terrestres, tandis que, dans mon travail philosophique sur moi-même, j’ai procédé au rebours.
méphistophélès. C’est un tort que vous avez eu. Ce qu’on étouffe avant qu’il soit né n’est jamais bien mort. Les besoins refoulés avant leur développement redemandent la vie impérieusement. C’est ce qui vous est arrivé. Votre vertu vous rendait l’homme le plus malheureux du monde, et, à l’heure qu’il est, en prêchant tous les jours la certitude, vous ne la possédez sur aucun point.
albertus, à part. Je suis épouvanté de voir cet homme lire en moi de la sorte !
méphistophélès. Si VOUS en restez là, vous êtes perdu, mon bon ami. Il faut que vous retourniez à la foi par une forte réaction. Il faut que vous connaissiez les passions, leurs angoisses, leurs périls, leurs fureurs même. Il faut, en un mot, que vous passiez par l’épreuve du feu ; ensuite, vous rendrez témoignage de votre foi, car vous aurez connu la vie, et vous ne vous tromperez plus.
albertus. Vous me donnez un odieux conseil. Croyez-vous donc que l’âme humaine soit assez folle pour résister à une telle épreuve ? C’est tenter Dieu que de s’abandonner au mal de gaieté de cœur. Quiconque essayera ses forces de la sorte le payera cher et perdra, dans l’exercice des mauvais instincts, le sentiment et le désir de l’idéal.
méphistophélès. Qui vous parle de faire le mal et de cultiver les instincts grossiers ? Vous oubliez que je suis philosophe aussi bien que vous, quoique je ne sois pas patenté. Je ne vous conseille pas de vous avilir, mais de vous retremper. Il est une seule passion, grande dans ses puérilités, généreuse dans ses emportements, sublime dans ses délires : c’est l’amour. Vous vous êtes trompé quand vous avez cru que votre idéal pouvait absorber toute la flamme déposée dans votre sein. Cette flamme est de deux natures : l’une est pour le ciel, l’autre pour la terre ; et l’une ne peut pas plus dévorer l’autre, que la volonté humaine ne peut étouffer l’une des deux. (Posant sa main sur le bras d’Albertus.) Qui le sait mieux que vous, mon cher philosophe ? Cette flamme terrestre vous consume, et rien n’a pu encore l’éteindre en vous !
albertus, tressaillant et se parlant à lui-même. Ses paroles embrasent mon sang, et pourtant sa main me glace comme si elle était de marbre !
méphistophélès, lui tenant toujours la main. Donnez un aliment à cette flamme, et, quand elle aura brûlé le temps nécessaire, elle s’éteindra d’elle-même ; car, étant de nature terrestre, elle doit périr. L’autre, qui est céleste, lui survivra et vous possédera tout entier.
albertus. Mais, pour aimer, il faut pouvoir être aimé.
méphistophélès. Vous l’êtes peut-être déjà sans vous en douter.
albertus. Moi !… Qui pourrait donc m’aimer ?… (Brusquement.) Maître Jonathas, ne la nommez pas !… je vous le défends.
méphistophélès. Vous pensez que son nom serait profané dans ma bouche ? Vous êtes déjà bien amoureux, maître Albertus ?
albertus, troublé. Mais elle ne m’aime pas, elle ne m’aimera jamais…
méphistophélès. Elle vous aimera quand vous voudrez, et cet amour lui rendra la raison, la santé et la vie !
albertus. Et que faut-il donc faire pour qu’elle m’aime ?
méphistophélès. Il faut briser encore deux cordes à la lyre ; et, quand vous serez las d’aimer, ou effrayé de la force de votre amour, il ne tiendra qu’à vous d’en guérir sur-le-champ.
albertus. Comment cela ?
méphistophélès. En épousant Hélène et en brisant la dernière corde de la lyre ! (À part.) Il est à moi ! (Il disparaît.)
albertus, dans une sorte d’égarement. Dieu ! que l’empreinte de sa main est froide !… Ma vue est troublée… J’ai peine à retrouver mon chemin… Serait-il possible que la lyre ne fût pas brisée ?…
ACTE CINQUIÈME
Scène PREMIÈRE. — ALBERTUS, dans son cabinet, contemplant la lyre ; MÉPHISTOPHÉLÈS, invisible pour lui, assis dans un coin.
méphistophélès, à part. C’est Cela ! contemple ta besogne, gémis, effraye-toi, frappe-toi la poitrine ; cela ne raccommodera rien, et tu peux jouer à ton aise maintenant sur la seule corde qui te reste : ce sera une belle musique, mais, par malheur, elle ne durera pas longtemps !
albertus. Je n’ai pu y résister !… Quelle est donc cette tentation infernale ? Ce juif maudit, avec ses manuscrits et ses conseils, a fait de moi un enfant. Il a bouleversé ma raison en me promettant un secret que je ne saurai jamais sans doute !… En vain je cherche dans ces papiers quel chant est consacré par la septième corde ; Adelsfreit ne s’est point expliqué à cet égard, et je suis forcé de m’en rapporter à Jonathas. Prédictions incompréhensibles ! vous vous êtes pourtant réalisées avec une justesse dont une science plus grande que la mienne serait épouvantée. Mais plus le mystère paraît impénétrable, plus ma conscience doit en chercher l’explication ; je la dois aux hommes, je me la dois à moi-même, cette solution, sans laquelle leur esprit et le mien peuvent rester à jamais trompés… Les hommes !… ma conscience ! Est-ce donc pour eux, est-ce donc pour elle que j’ai tenté l’expérience ? Est-ce l’amour de la vérité qui m’a guidé en tout ceci ? est-ce lui qui me dévore en cet instant ? Ah ! malheureux, avoue qu’en brisant ces deux dernières cordes un amour insensé de la vie, une soif ardente des passions t’a seule entraîné !… Oh ! comme ma main tremblait, comme ma poitrine était en feu lorsque j’ai suivi le conseil du juif ! Je m’attendais encore à voir le ciel s’obscurcir, la terre trembler et ma maison s’écrouler sur moi. Rien de tout cela n’est arrivé, et même je n’ai point entendu les cordes d’acier rendre un son plaintif comme celles que j’avais déjà brisées. Cette fois, la lyre a été muette ! Peut-être que c’est ma conscience qui est devenue sourde !… Quel est donc mon crime, cependant ? Si l’action est utile en elle-même, qu’importe qu’une mauvaise intention se soit glissée malgré moi parmi les bonnes ? Je devais poursuivre ici la vérité à travers les épreuves ; et, quand même la paix de mon âme en serait à jamais troublée, c’est encore un sacrifice que je dois à mon œuvre.
méphistophélès, se montrant sous la figure du juif. Mille pardons si je surprends sans façon le secret de vos pensées. Les grands esprits ont la mauvaise habitude de causer tout haut avec eux-mêmes. Cela ne vous arriverait pas si vous connaissiez la musique ; mais vous ne tarderez pas à la savoir, car je vous trouve dans de meilleures idées. Il me semble que vous commencez à ouvrir les yeux et à reconnaître que vous devez tâter le pouls à la vie si vous voulez être le vrai médecin de l’humanité.
albertus, à part. Cet homme me déplaît ; je me méfie de lui, et pourtant il me mène où il veut ? D’où vient que sa visite m’est agréable en cet instant ? Serait-ce que j’ai besoin d’une plus mauvaise conscience que la mienne pour m’encourager dans le mal ?
méphistophélès. Ne seriez-vous pas moine, par hasard ?
albertus. Rien ne peut me déplaire à un plus haut point que cette plaisanterie. Que voulez-vous dire ?
méphistophélès. C’est que vous appelez crime tout ce qui est en dehors de votre morale personnelle.
albertus. S’il en est ainsi, n’ai-je pas raison pour moi du moins ? Tout est relatif.
méphistophélès. Je m’exprime mal… Je devrais dire : vœux insensés, orgueil téméraire.
albertus. Ce reproche est un lieu commun. Vous qui prétendez lire au dedans de moi, vous devriez savoir que mon renoncement aux choses humaines est une résolution naïve et consciencieuse.
méphistophélès. Comme il vous plaira ; j’aimerais mieux passer pour un orgueilleux que pour un niais.
albertus. Le mépris et l’ironie ne me touchent point.
méphistophélès. Cela veut dire que vous êtes blessé. Allons ! ne nous fâchons pas. Depuis vingt-cinq ans, vous êtes la victime d’une erreur, voilà tout. Il est temps de vous en affranchir. Vous avez pensé qu’un philosophe devait être un saint ; et, au lieu de chercher la sainteté dans l’emploi bien dirigé de vos facultés, vous avez suivi la vieille routine des dévots en tâchant d’éteindre ces facultés mêmes. Ce qui doit vous amener à reconnaître votre illusion, c’est que vous devez vous souvenir des doutes qui ont torturé votre âme depuis le jour où vous êtes entré dans cette carrière jusqu’à celui-ci ; c’est aussi que vos facultés n’ont fait que grandir et réclamer toujours plus impérieusement leur emploi. Le maître que vous invoquez, et avec lequel vous vous croyez en rapport direct, serait bien ingrat et bien fou de ne point vous secourir si, en vous immolant ainsi, vous aviez rempli ses intentions. Apprenez donc à reconnaître, dans la révolte des besoins de votre cœur, la légitimité de ces besoins, ou doutez de cette puissance céleste que vous appelez toujours en témoignage et à qui vous offrez tous vos sacrifices. Voyons, de quelle mission vous croyez-vous investi en ce moment ? Est-ce de faire votre salut comme un chartreux, ou de chercher la sagesse afin de l’enseigner aux hommes comme un philosophe ? Si c’est le dernier cas, apprenez qu’on n’enseigne pas ce qu’on ignore. La sagesse que vous pratiquez est un état exceptionnel qui pourra former tout au plus deux ou trois adeptes placés, comme vous, dans une voie d’exception ; c’est une vertu de fantaisie qui rentre dans la série des essais artistiques ; et vous, qui demandez toujours compte aux poëtes de la moralité et de l’utilité de leurs travaux, vous seriez fort embarrassé de prouver en quoi votre cénobitisme peut être profitable à la société.
albertus. Vous ne sauriez nier pourtant que j’aie enseigné des vérités utiles, et je vous répondrai que je n’eusse pas eu le loisir de découvrir et d’enseigner ces vérités si j’eusse livré ma vie au caprice des passions.
méphistophélès. Qui vous parle de caprices ? qui vous parle de passions ? Ne pouviez-vous cultiver, dans le sanctuaire de votre âme, comme vous dites, un amour pur, une amitié conjugale, durable, légitime ? Ne pouviez-vous pas vous marier, être père ? Alors, vous eussiez enseigné avec autorité les devoirs de la famille dont vous parlez si souvent à vos élèves, à peu près comme un aveugle parle des couleurs.
albertus. J’y ai souvent songé ; mais j’ai senti dans mon âme le germe de passions si violentes, que je n’eusse pu faire de l’hyménée un lien aussi paisible, aussi noble, aussi durable que ma raison le conçoit et que ma conviction le prêche aux autres.
méphistophélès. Et pourquoi, s’il vous plaît, le germe de vos passions est-il devenu si brûlant et si dangereux ? C’est que vous l’avez trop longtemps comprimé. Ainsi, avec toute votre vertu, vous êtes inférieur au dernier bourgeois de votre ville.
albertus. J’en suis trop convaincu ! mais le mal est fait. Plus j’ai tardé, plus il est certain que je ne dois pas entrer dans cette carrière. Il est peut-être des erreurs dans lesquelles la sagesse nous ordonne de persévérer en apparence, ou du moins dont elle nous condamne à porter la peine jusqu’au bout.
méphistophélès. Voilà le plus beau sophisme qui soit jamais sorti de la bouche d’un sage ; mais ce n’en est pas moins un sophisme bien conditionné. Dites tout bonnement que ce qui vous arrête aujourd’hui, c’est la timidité : d’une part, la crainte de ne pas savoir plaire à une femme ; de l’autre, la peur de paraître ridicule à vos élèves.
albertus. Je puis jurer devant Dieu et devant les hommes que vous vous trompez. Si je croyais devenir meilleur et plus utile à la société en me mariant, je le ferais tout de suite, avec simplicité, avec franchise. J’augure assez bien des femmes pour croire qu’il s’en trouverait au moins une qui serait touchée de ma candeur, et je connais assez mes élèves pour être sûr qu’ils apprécieraient ma bonne foi ; mais je suis certain que l’amour serait désormais un poison pour mon âme. Je serais porté à m’absorber tellement dans l’amour d’une créature semblable à moi, que je perdrais le sentiment de l’infini et la contemplation assidue de la Divinité. La jalousie dévorerait mes entrailles, et détruirait peu à peu toutes mes idées de justice, de patience et d’abnégation. Pour quelques enfants de plus que je donnerais à la patrie, je lui retirerais ma doctrine, qui certes lui est plus nécessaire ; car les bras manqueront toujours moins que les intelligences. N’est-ce pas votre avis ?
méphistophélès. Ainsi, vous êtes bien décidé à rester moine ? C’est votre dernier mot ?
albertus. Si c’est ainsi qu’il vous plaît de me qualifier, soit ! C’est ma dernière résolution.
méphistophélès. En ce cas, dites-moi donc, maître Albertus, pourquoi vous avez réduit la lyre à cette seule corde d’airain ?
albertus, troublé. Qu’ont de commun le son de cette lyre et les expériences physiques dont elle est l’objet pour moi, avec les principes de ma conduite et les sentiments de mon âme ?
méphistophélès. Sans doute ; qu’a de commun la poésie avec l’amour ? Jamais cela n’est tombé sous le sens d’un philosophe !
albertus. C’est assez ! vos railleries me fatiguent, et tout ce que je viens de vous dire est assez triste pour mériter, de votre part, autre chose qu’un froid dédain. Vous êtes un homme sans entrailles ; laissez-moi !
méphistophélès. Vous m’accusez, ingrat, quand je vous sers malgré vous ! Dupe de vos propres sophismes, vous aviez mis entre vous et le bonheur des obstacles invincibles, la contrainte et la gaucherie d’un philosophe ! Je vous ai fait connaître et modifier les propriétés magiques de cette lyre. Grâce à moi, vous avez dans les mains un talisman avec lequel vous pouvez toucher le cœur d’Hélène, et lui apparaître plus jeune et plus beau que le plus jeune et le plus beau de vos élèves… Et vous le dédaignez, pour vous renfermer dans votre sot orgueil ou dans votre prudence couarde ! Eh bien, que votre destinée s’accomplisse ! Maintenant, la mélodie de la lyre est tellement simplifiée, que vous pourriez en jouer aussi bien qu’Hélène, et agir sur elle comme jusqu’ici elle a agi sur vous… Le tendre Wilhelm, ou le passionné Hanz, ou le beau Carl, en joueront à votre place ; et Hélène, à jamais guérie de sa folie, sera l’heureuse et chaste amante de celui des trois qui sera le mieux inspiré !… Bonsoir, maître, je vous souhaite une bonne nuit et de longs jours sur la terre !
albertus. Attendez : que dites-vous ?… Hélène guérie ? Hélène heureuse ?
méphistophélès. Ma société vous fatigue… Adieu !…
albertus. Encore un mot ! Vous avez une telle foi dans la puissance incompréhensible de ce talisman, que vous oseriez me promettre de semblables résultats ?… Le manuscrit d’Adelsfreit s’arrête à la corde d’acier…
méphistophélès. Depuis quand ajoutez-vous foi à la sorcellerie ? Ne voyez-vous pas que tout ceci est un jeu ? Quand vous avez cru qu’Hélène jouait de la lyre avec sa pensée, vous aviez sur les yeux une taie qui vous empêchait de distinguer ses mains ; quand le ruisseau s’est arrêté à son commandement, le meunier fermait l’écluse, quand la lyre est tombée du haut de la cathédrale sur le pavé, un corbeau l’a saisie au vol et l’a déposée tout doucement par terre. Tout s’explique par des faits naturels. Je ne conçois pas qu’on se rompe la tête à chercher le mot d’une énigme, quand la première explication venue est aussi bonne que toutes les autres. Bonsoir, maître, pour la dernière fois ! (Il redevient invisible pour Albertus, et reste auprès de lui, appuyé sur le dos de son fauteuil.)
albertus. Non ! tout ceci n’était pas explicable par le hasard. Les prodiges accomplis par la lyre peuvent s’accomplir encore, et, tous les jours, nous recevons du ciel des bienfaits qui dépassent la portée de notre intelligence ; celui-ci peut-être m’était réservé, de donner le bonheur et de le recevoir en empruntant à la lyre une éloquence inconnue et une puissance sympathique… Oh ! rendre la raison à Hélène, et en retour être aimé d’elle ! (Saisissant la lyre.) O lyre ! est-il possible que tu puisses opérer un tel miracle, et que ta dernière corde, docile enfin à mes doigts inhabiles, me révèle la poésie, la grâce, l’enthousiasme et toutes les puissances de la séduction ? Lorsque tu vibreras sous ma main, une flamme descendra-t-elle d’en haut pour illuminer mon front et me révéler cette langue de l’infini qu’Hélène parle et que je comprends à peine ? Oui, sans doute, poète et musicien, investi de cette magie sans laquelle le monde est froid et sombre, je saurai me faire aimer… Je ne serai plus le triste philosophe dont l’aspect n’inspire que la crainte et la parole que l’ennui ! Maussade enveloppe, disgracieuse gravité, je vais te dépouiller comme un vêtement d’hiver aux rayons du printemps… Oh ! je suis vaincu ! L’espérance d’être heureux m’a rendu l’espérance d’être bon ! Oui, je saurai aimer avec justice, avec douceur, avec confiance, car je saurai que je puis être aimé de même ; et mes amis seront heureux de mon bonheur, car je leur en parlerai naïvement, et ils verront que mon âme est sincère dans la joie comme dans la souffrance.
Scène II. — HÉLÈNE, ALBERTUS, MÉPHISTOPHÉLÈS, invisible.
méphistophélès, à part. Oui ! oui ! compte sur eux, compte sur elle, compte sur toi-même ! c’est là que je t’attends ! Il me semble que, malgré ses forfanteries, l’Esprit de la lyre va enfin être chassé d’ici. Alors, Hélène me revient de droit, et nous verrons comment M. le philosophe prendra l’amour conjugal avec la veuve d’un ange devenue maîtresse du diable.
albertus, regardant Hélène qui s’est assise avec préoccupation sur le bord de la fenêtre, sans faire attention à lui. Comme elle est pâle et triste ! Ah ! son dernier chant l’a brisée ! (s’approchant d’elle.) Hélène ! êtes-vous plus malade, mon enfant ? — Elle ne m’entend pas, ou ne veut pas me répondre. — Chère Hélène, si vous m’entendez, répondez-moi, ne fût-ce que par un regard. Votre silence m’inquiète, votre indifférence m’afflige. (Hélène le regarde avec étonnement, et reporte les yeux sur la campagne.)
albertus. Elle m’entend cependant, mais il semble que mes paroles n’aient aucun sens pour elle. Peut-être, si je lui montrais la lyre, retrouverait-elle la mémoire. (Il prend la lyre et la pose sur la fenêtre. Hélène la regarde avec indifférence.)
albertus. Allons ! sa raison est entièrement perdue, il faut un miracle pour la ressusciter. Si je suis dupe d’une grossière imposture, pardonnez-moi, ô vérité ! ô Dieu !… Pour la première fois, je vais avoir recours à autre chose que la certitude. (Il essaye la lyre, qui reste muette.)
méphistophélès, à part. Malédiction sur toi, pédagogue incurable ! Tu ne peux pas seulement faire résonner la corde de l’amour ! Qui donc brisera la lyre ? Allons chercher Hanz ou Wilhelm. Peut-être seront-ils moins encroûtés. Que m’importe, au reste, qui ce soit ? La pureté d’Hélène ne peut résister au charme de la corde d’airain, et, qu’elle soit souillée par le philosophe ou par toute la ville, il faudra bien que l’Esprit de la lyre s’humilie, et que le philosophe se damne ! (Il s’envole.)
Scène III. — HÉLÈNE, ALBERTUS.
albertus, consterné. Tous mes efforts sont vains ! Elle est muette pour moi, muette comme Hélène, muette comme moi-même ! Et pourtant mon âme est pleine d’ardeur et de conviction ! D’où vient donc que depuis si longtemps mes lèvres sont closes et ma langue enchaînée comme la voix au sein de cet instrument ? Pourquoi n’ai-je encore jamais osé dire à Hélène que je l’aimais ?… Ah ! le juif m’a trompé : il m’a dit que ce talisman me donnerait l’éloquence de l’amour, et le talisman est sans vertu entre mes mains ! Dieu me punit d’avoir cru à la puissance des chimères en m’enlevant ma dernière illusion et en me replongeant dans l’horreur du désespoir ! Ô solitude ! je suis donc à jamais ta proie ! Ô désir ! vautour insatiable dont mon cœur est l’indestructible aliment !… (Il croise ses bras sur sa poitrine, et regarde Hélène avec douleur. La lyre tombe et rend un son puissant. Hélène tressaille et se lève.)
Hélène. C’est ta voix !… Où donc es-tu ? (Elle cherche autour d’elle avec inquiétude, et, après quelques efforts pour retrouver la mémoire, elle aperçoit la lyre et la saisit avec transport. La lyre résonne aussitôt avec force.)
albertus. Quels sons graves et terribles !… Je ne croyais plus à la puissance du talisman. Pourtant cette voix me remplit de trouble et d’épouvante !
L’esprit de la lyre. L’heure est venue, ô fille des hommes ! C’est maintenant que tous mes liens avec le ciel sont brisés ; c’est maintenant que j’appartiens à la terre ; c’est maintenant que je suis à toi. Aime-moi, ô fille de la lyre ; ouvre-moi ton cœur, afin que je l’habite et que je cesse d’habiter la lyre !
L’esprit d’Hélène, pendant qu’Hélène touche la corde d’airain. Être inconnu qui me parles depuis longtemps et qui ne t’es jamais montré à moi, il me semble que je t’aime, car je ne puis rien aimer sur la terre. Mais mon amour est triste, et la crainte le glace ; je sens que ta nature est supérieure à la mienne, et j’ai peur d’être sacrilége en osant aimer un ange.
L’esprit de la lyre. Si tu veux m’aimer, ô Hélène, si tu oses me prendre et m’enfermer dans ton intelligence, je consens à m’y perdre, à m’y absorber à jamais. Alors, nous serons liés par un indissoluble hyménée, et ton esprit me verra face à face. Ô Hélène, aime-moi comme je t’aime ! L’amour est puissant, l’amour est immense, l’amour est tout : c’est l’amour qui est dieu ; car l’amour est la seule chose qui puisse être infinie dans le cœur de l’homme.
L’esprit d’Hélène. Si l’amour est dieu, il est éternel. Notre hyménée sera donc éternel, et ma mort n’en brisera pas les liens. Parle-moi ainsi, si tu veux que je t’aime ; car la soif de l’infini me dévore, et je ne puis concevoir l’amour sans l’éternité !
Chœur des esprits célestes. Approchons-nous, entourons-les, planons sur leurs têtes ! Que la grâce et la puissance de Dieu soient ici avec nous ! L’heure fatale approche, l’heure décisive pour notre jeune frère captif au sein de la lyre ! Doux esprit de l’harmonie, que ne peux-tu nous voir et nous entendre ! Mais tes liens avec nous sont brisés, les cordes d’or et d’argent ne nous évoquent plus ; l’amour seul nous ramène près de toi. Mais l’amour terrestre t’a envahi et t’a ravi la mémoire. Tu ne nous connais plus ; ta douloureuse épreuve s’accomplit, ton sort est dans les mains d’une fille des hommes. Puisse-t-elle rester fidèle aux instincts divins qui l’ont préservée jusqu’ici de l’amour terrestre ! Ô puissances du ciel ! réunissons-nous, embrasons l’air du battement mélodieux de nos ailes !
albertus. La voilà encore ravie en extase, comme si elle entendait dans le silence un langage divin. Oh ! qu’elle est belle ainsi ! Oui, son âme est ouverte aux inspirations du ciel, et sa folie apparente n’est que l’absence des instincts grossiers de la vie. Ô créature charmante, combien je t’ai calomniée autrefois lorsque j’ai douté de ton intelligence ! combien j’ai été fou moi-même de me défendre de l’émotion que ta beauté m’inspirait ! C’était une pensée sacrilége que de ne pas croire l’existence d’une telle beauté extérieure liée à celle d’une beauté intellectuelle aussi parfaite ! Hélène, les sons puissants que tu viens de me faire entendre ont ouvert mon âme aux harmonies du monde supérieur. Je sens que tu célèbres les feux d’un amour divin, et cet amour pénètre mon sein d’une espérance délicieuse. Écoute-moi, Hélène ! je veux te dire que je t’aime, que je te comprends, et que mon amour est enfin digne de toi ! Écoute-moi, car l’âme est une lyre ; et, comme tu as fait vibrer celle-ci par ton souffle, tu as éveillé par ton regard une harmonie cachée au fond de mon être… (Il s’agenouille auprès d’Hélène, qui le regarde avec surprise.)
L’esprit de la lyre. Hélène, Hélène ! un esprit puissant te parle, un esprit lié encore à la vie humaine, mais dont l’essor mesure déjà le ciel, un esprit de méditation, d’analyse et de connaissance… Hélène, Hélène ! ne l’écoute pas, car il n’est pas, comme toi, enfant de la lyre !… Il est grand, il est juste, il est dans la lumière et dans l’espérance ; mais il n’a pas encore vécu dans l’amour que célèbre la corde d’airain. Il a trop aimé les hommes, ses frères, pour s’absorber en toi. Hélène ! Hélène ! ne l’écoute pas, crains le langage de la sagesse. Tu n’as pas besoin de sagesse, ô fille de la lyre ! tu n’as besoin que d’amour. Écoute la voix qui chante l’amour, et non pas la voix qui l’explique.
albertus. Écoute, écoute, ô Hélène ! Quoique fille de la poésie, tu dois entendre ma voix ; car ma voix vient du fond de mon cœur, et l’amour vrai ne peut manquer de poésie, quelque austère que soit son langage. Laisse-moi te dire, ô jeune fille, que mon cœur te désire et que mon intelligence a besoin de la tienne. L’homme seul est incomplet. Il n’est vraiment homme que lorsque sa pensée a fécondé une âme en communion avec la sienne. N’aie plus peur de ton maître, ô ma chère Hélène ! Le maître veut devenir ton disciple, et apprendre de toi les secrets du ciel. Les desseins de Dieu sont profonds, et l’homme n’y peut être initié que par l’amour. Toi qui chantais hier d’une voix si déchirante les crimes et les infortunes de l’humanité, tu sais que l’humanité aveugle et déréglée erre sur le limon de la terre comme un troupeau sans pasteur ; tu sais qu’elle a perdu le respect de son ancienne loi ; tu sais qu’elle a méconnu l’amour et souillé l’hyménée ; tu sais qu’elle demande à grands cris une loi nouvelle, un amour plus pur, des liens plus larges et plus forts. Viens à mon aide, et prête-moi ta lumière, ô toi qu’un rayon du ciel a traversée ! Unis dans une sainte affection, nous proclamerons, par notre bonheur et par nos vertus, la volonté de Dieu sur la terre. Sois ma compagne, ma sœur et mon épouse, ô chère fille inspirée ! Révèle-moi la pensée céleste que tu chantes sur ta lyre. Appuyés l’un sur l’autre, nous serons assez forts pour terrasser toutes les erreurs et tous les mensonges des faux prophètes. Nous serons les apôtres de la vérité ; nous enseignerons à nos frères corrompus et désespérés les joies de l’amour fidèle et les devoirs de la famille.
Hélène, jouant de la lyre. Écoute, ô Esprit de la lyre ! ceci est un chant sacré, c’est une belle et noble harmonie ; mais je la comprends à peine ; car c’est une voix de la terre, et, depuis longtemps, mes oreilles sont fermées aux harmonies de la terre. Les cordes d’argent ne chantent plus ; les cordes d’acier sont devenues muettes. Explique-moi l’hymne de la sagesse, toi qui du ciel es descendu parmi les hommes.
L’esprit de la lyre. Je ne puis plus rien t’expliquer, ô fille de la lyre ! je ne puis que te chanter l’amour. J’ai perdu la science ; je l’ai perdue avec joie, car l’amour est plus grand que la science ; et ton âme est l’univers où je veux vivre, l’infini où je veux me plonger. La sagesse te parle de travaux et de devoirs, la sagesse te parle de la sagesse ; tu n’as pas besoin de sagesse, si tu as l’amour. Ô Hélène ! l’amour est la suprême sagesse ; la vertu est dans l’amour, et le cœur le plus vertueux est celui qui aime le plus. Fille de la lyre, n’écoute que moi ; je suis une mélodie vivante, je suis un feu dévorant. Chantons et brûlons ensemble ; soyons un autel où la flamme alimente la flamme ; et, sans nous mêler aux feux impurs que les hommes allument sur l’autel des faux dieux, nourrissons-nous l’un de l’autre, et consumons-nous lentement jusqu’à ce que, épuisés de bonheur, nous mêlions nos cendres embrasées dans le rayon de soleil qui fait fleurir les roses et chanter les colombes.
albertus, à Hélène. Hélas ! tu me réponds par un chant sublime qui allume en moi un désir toujours plus vaste ; mais la sympathie ne met pas ton chant en rapport avec ma prière. Quitte la lyre, ô Hélène ! tu n’as pas besoin de mélodie ; ta pensée est un chant plus harmonieux que toutes les cordes de la lyre, et la vertu est la plus pure harmonie que l’homme puisse exhaler vers Dieu.
Hélène, touchant la lyre. Réponds-moi, ô Esprit ! ô toi que j’aime et qui parles la langue de mon esprit ! Notre amour sera-t-il éternel, et la mort ne rompra-t-elle point notre hyménée ? Ce n’est pas dans le rayon du soleil, ce n’est pas dans le calice des roses ni dans le sein des colombes que je puis éteindre l’amour qui me consume ; je le sens monter vers l’infini avec une ardeur dévorante. Je ne puis t’aimer que dans l’infini ; parle-moi de l’infini et de l’éternité, si tu ne veux que la dernière corde de mon âme se brise.
Les esprits célestes. Bonté infinie, amour éternel, protège la fille de la lyre ! Ne laisse pas l’étincelle de ce feu divin s’éteindre dans les douleurs de l’agonie ! Miséricorde céleste, abrège l’épreuve de l’Esprit notre frère qui languit et qui brûle sur la corde d’airain ! Ouvre ton sein aux enfants de la lyre, laisse tomber la couronne sur le front des martyrs de l’amour !
L’esprit de la lyre, à Hélène. Que t’importe de posséder l’infini ? Qu’as-tu besoin d’être assurée de l’éternité, si pendant un jour, si pendant une heure de ta vie, tu as compris et rêvé l’un et l’autre ? L’amour seul peut te donner cette heure d’extase. Profites-en, ô Hélène ! et que l’ambition d’un avenir idéal ne te fasse pas négliger le seul instant où l’idéal te soit présent. N’est-ce pas assez que cet instant, et l’amour ne peut-il résumer en une minute toutes les joies de l’éternité ? Ô Hélène ! pour obtenir cet instant, j’ai vu briser avec transport toutes les cordes qui me liaient au ciel par la foi et l’espérance. Il ne m’a été laissé que l’amour, et l’amour me suffit. Donne-moi cet instant, ô Hélène ! et, si je suis éternel, je consens à faire le sacrifice de mon éternité. Je consens à m’éteindre dans ton âme, pourvu que ton âme consente à recevoir la mienne, et qu’elle oublie un seul instant l’infini et l’éternité.
albertus. Tu es muette pour moi, ô ma pauvre Hélène ! Les sons terribles de la lyre t’entraînent de plus en plus vers la région des pensées inconnues où je ne puis te suivre. Prends pitié de moi, prends pitié de toi-même, ô jeune Pythie ! Crains ce délire sacré, trop puissant pour la nature humaine. Reviens à des pensées plus douces, à une foi plus humble, à un amour plus méritoire et plus bienfaisant.
Les esprits célestes. Ô trois fois Saint ! ô mille fois bon et miséricordieux ! protège la fille de la lyre, prends pitié de l’Esprit de la lyre.
Hélène, jouant de la lyre avec une impétuosité toujours croissante. C’en est fait, il faut que j’aime. Le ciel et l’enfer ont allumé en moi des flammes inextinguibles. Mon âme est un trépied rempli de braise et de parfums. Je voudrais t’aimer, ô sage infortuné, martyr patient de la vertu et de la charité ! Je voudrais t’aimer, ô Esprit de la lyre, mélodie enivrante, flamme subtile, rêve d’harmonie et de beauté ! Mais tous deux vous me parlez des choses finies, et le sentiment de l’infini me dévore ! L’un veut que j’aime pour servir d’exemple et d’enseignement aux habitants de la terre ; l’autre veut que j’aime pour satisfaire les désirs de mon cœur et goûter le bonheur sur la terre. Dieu ! ô toi dont la vie n’a ni commencement ni fin, toi dont l’amour n’a pas de bornes, c’est toi seul que je puis aimer ! Reprends mon âme tout de suite, ou laisse-la languir ici-bas dans une agonie aussi longue que l’existence de la terre ; je ne veux pas perdre le sentiment de l’infini. Ô mon Dieu ! aie pitié, car je souffre ; aime-moi, car je t’aime ; donne-moi ta vie, car je… (La corde d’airain se brise avec un bruit terrible. Hélène tombe morte, et Albertus évanoui.)
Les esprits célestes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes dont le cœur est pur ! Esprit notre frère, ton épreuve est finie ; fille de la lyre, ta foi est récompensée. Venez à nous, ô enfants de l’amour ! qu’un céleste hyménée vous unisse pour l’éternité ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
L’esprit de la lyre. Où suis-je et que vois-je ? Je me réveille dans les cieux, et ma vue embrasse l’infini ! La lumière céleste et l’amour impérissable me sont rendus. Ô fille de la lyre, ta foi m’a sauvé ; viens partager la liberté infinie et l’éternelle joie ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Hélène s’envole vers les cieux avec l’Esprit de la lyre et les esprits célestes.)
albertus, se relevant, ramasse la lyre et court avec égarement autour de la chambre. La lyre brisée, Hélène morte, morte ! Hélène ! Hélène ! où es-tu ? Je suis ton assassin ! Hélène ! Hélène ! je veux me tuer !… Laissez-moi me tuer !…
méphistophélès Ne se tue pas qui veut, mon maître ; il vous faut bien expier cette petite faute. Vous vivrez, s’il vous plaît, mais en société avec moi, en compagnie avec le désespoir.
albertus. Ah ! encore cette horrible apparition. Qui es-tu, esprit de ténèbres, image de la perversité, de l’athéisme et de la douleur ? Je ne puis soutenir ta vue. Mon Dieu, délivrez-moi de cette vision ; mon esprit s’égare !
MÉPHISTOPHÉLÈS, s’approchant pour le saisir. Il faudra pourtant bien t’y accoutumer ; la lyre est brisée, et j’ai tout pouvoir sur toi !
LE SPECTRE D’HÉLÈNE, apparaît à Albertus avec l’Esprit de la lyre, sous la forme de deux anges. Homme vertueux, ne crains rien des artifices du démon, nous veillons sur toi ; la mort ne détruit rien, elle resserre les liens de la vie immatérielle. Nous serons toujours avec toi, ta pensée pourra nous évoquer à toute heure ; nous t’aiderons à chasser les terreurs du doute et à supporter les épreuves de la vie. (Albertus tombe à genoux.)
CHŒUR DES ESPRITS CÉLESTES. Arrête, Satan ! tu ne peux rien sur celui qui tire sa sagesse de la foi et de la charité ; sa main a brisé les six cordes de la lyre, mais sa main était pure, et le chant de la septième corde l’a sauvé. Désormais, son âme sera une lyre dont toutes les cordes résonneront à la fois, et dont le cantique montera vers Dieu sur les ailes de l’espérance et de la joie : il a aimé. Gloire à Dieu dans les cieux !
L’ESPRIT D’HÉLÈNE. Et paix sur la terre aux hommes d’un cœur pur ! (Méphistophélès s’envole en rasant la terre, les esprits célestes disparaissent dans les cieux.)
Scène IV. — ALBERTUS, WILHELM, HANZ, CARL.
HANZ. Maître, l’heure de la leçon est sonnée ; on vous attend.
WILHELM, avec inquiétude. Je croyais trouver Hélène avec vous.
ALBERTUS. Hélène est partie.
HANZ. Partie ? En proie à un nouvel accès de démence ?
WILHELM. Que vois-je ?… La lyre brisée !… Oh ! mon Dieu ! Où donc est Hélène ?
ALBERTUS. Hélène est guérie !
CARL. Par quel miracle ?
ALBERTUS. Par la justice et la bonté de Dieu !
WILHELM. Ô maître ! que voulez-vous dire ? que s’est-il passé ? Nous avons entendu un bruit terrible, comme celui de la foudre qui éclate ; nous voyons la lyre privée de toutes ses cordes, et votre visage est inondé de larmes.
ALBERTUS. Mes enfants, l’orage a éclaté, mais le temps est serein ; mes pleurs ont coulé, mais mon front est calme ; la lyre est brisée, mais l’harmonie a passé dans mon âme. Allons travailler !
1839.
LETTRES À MARCIE
PRÉFACE
Comme Aldo le Rimeur est un essai inachevé, les Lettres à Marcie ne sont qu’un fragment incomplet et sans aucune valeur philosophique. J’avais entrepris une sorte de roman sans événements, dont j’eusse voulu faire arriver tout l’intérêt, toutes les émotions, toutes les péripéties par les modifications et les transformations intimes et mystérieuses d’un seul être, d’une femme qu’on n’eût même pas vue, qui n’eût jamais écrit, et qu’on n’eût connue que par les lettres et les réflexions de son ami. C’était peut-être une entreprise impossible, et j’ignore si elle eût été digne d’un succès d’estime. Quoi qu’il en soit, les personnes qui ont lu les premières lettres, cette sorte de prologue où je peignais seulement pour commencer l’ennui de l’isolement, ont voulu y voir une exposition de principes, et une théorie pour ou contre le christianisme. Il n’y avait pourtant rien de cela, et je ne crois pas que ces fragments aient aucune couleur déterminée dont on puisse tirer des inductions solides. Je n’ai pas fait le vœu de ne jamais m’expliquer sur le fond de mes idées relativement au mariage ; mais je ne crois pas non plus être dans l’obligation d’exposer une théorie quelconque. J’ai déjà dit que, soit pour me montrer coupable de mauvais principes envers la société, soit pour rendre ridicule la bonne foi de mes écrits, quelques moralistes de feuilleton m’avaient souvent mis au défi de dévoiler mes criminelles intentions à l’endroit du mariage. Je ne m’intéresse nullement à ces sortes de polémiques, et n’ai jamais cru devoir y répondre. Il est probable qu’en continuant ce roman intime des Lettres à Marcie, j’aurais causé avec elle sur ces graves matières ; mais le roman a été interrompu par des circonstances qui n’avaient rien de commun avec le sujet, et je puis les dire. Je ne me suis jamais senti propre à la fabrication rapide, pittoresque et habilement accidentée de ces romans dont l’intérêt se soutient malgré les hasards de la publication quotidienne. Je n’avais accepté l’honneur de concourir à la collaboration du journal le Monde que pour faire acte de dévouement envers M. Lamennais, qui l’avait créé et qui en avait la direction. Dès qu’il l’abandonna, je me retirai, sans même m’enquérir des causes de cet abandon ; je n’avais pas de goût et je manquais de facilité pour ce genre de travail interrompu, et pour ainsi dire haché. N’ayant pas eu l’occasion de continuer en temps et lieu les Lettres à Marcie, j’ai eu bientôt oublié l’espèce de plan que j’avais conçu. On m’a reproché, dans quelques journaux d’émancipation, de reculer devant les difficultés de l’entreprise. Le hasard seul m’a forcé de m’arrêter ; mais, quand même j’aurais hésité à formuler mon prétendu système, je ne vois point que l’humanité en ait souffert beaucoup, ni que le salut des empires en ait été compromis sérieusement. Seulement, je proteste un peu, en remettant ces Lettres à Marcie sous les yeux des lecteurs, contre la trop bienveillante obstination de mon éditeur. Il me semble qu’un écrit incomplet n’a pas le droit de se montrer une seconde fois en public sans que l’auteur ait pris la peine d’y mettre la dernière main. Il m’est impossible en ce moment de le faire ; et, en eussé-je le temps, je ne vois pas qu’une forme essayée vaille mieux qu’une autre forme qu’on pourrait tenter pour émettre l’idée dont on se sent dominé. Pour un artiste, il n’y a de forme heureuse et féconde, à ses yeux, que celle qui l’inspire dans le moment même. L’ébauche d’hier est déjà flétrie pour lui, et chacun sait que les ouvrages d’imagination n’ont ni veille ni lendemain. Le peintre consciencieux n’aime plus son tableau quand il le voit sorti de son atelier, éclairé d’un autre rayon de soleil que celui sous lequel il s’était senti inspiré. Ô vous qui lisez et qui n’écrivez pas ! vous ne savez pas combien le livre imprimé, et surtout réimprimé, paraît insipide et froid à celui qui l’a écrit avec quelque émotion sur un papier encore vierge, au reflet de sa lampe solitaire. Ceci est pour vous demander pardon en conscience de la réimpression des Lettres à Marcie, fragment sans portée, qui ne méritait pas l’honneur d’être lu deux fois.
I
Vous êtes triste, vous souffrez, l’ennui vous dévore ; vous redoutez l’avenir, le présent vous accable. Dans le passé, aucun souvenir n’est assez doux ou assez attachant pour ranimer les froides heures qui s’écoulent. Et cependant, le temps marche, et, quand le soir arrive, vous êtes surprise, vous êtes effrayée de ce nombre de jours, de cette suite d’années qui se perdent dans un gouffre sans écho.
Vous peignez votre situation d’une manière touchante, et je suis pénétré de votre douleur, quoique je ne voie rien d’exceptionnellement malheureux dans votre situation matérielle ; mais le dégoût qu’elle vous inspire constitue un malheur véritable. Là où l’âme ne se sent pas bien, l’existence est réellement troublée.
Il n’est au pouvoir de personne de vous guérir de cette langueur maladive. Le mal a sa racine dans les plus secrets retranchements de votre conscience. Il faut que vous soyez à vous-même votre médecin, et que, par un régime hardi et généreux, vous rendiez à votre âme la santé qu’elle a perdue.
Les inconvénients de votre position, que vous exprimez avec candeur, seraient peu de chose si vous les envisagiez sous le jour de la vérité. Les pointes de mille traits frivoles s’émousseraient sur vous, si vous n’aviez pas, dans un moment de fatigue et d’inertie, laissé choir votre bouclier. Relevez-le, tâchez de parer les coups d’une destinée facile à vaincre. Vous le devez ; donc, vous le pouvez.
La solitude où vous vivez est une rude épreuve si vous aimez le monde. Mais comment se ferait-il qu’avec la simplicité que je vous connais, vous aimassiez le monde ? Vous l’avez vu, vous savez ce qu’il peut vous offrir. Vous avez été frappée de la médiocrité des choses et des gens dont vous vous étiez fait la plus grande idée. Vous y avez vu que même les gens réellement distingués y perdaient l’apparence de leur supériorité, par la réserve qu’ils étaient forcés de s’y imposer, par la méfiance qu’ils y éprouvaient. Vous-même, vous vous y êtes sentie glacée et contristée, et les éloges que vous y avez reçus vous ont semblé plus blessants qu’agréables, car on y avait remarqué de vous tout ce que vous ne prisez pas, et on y avait méconnu tout ce qui eût dû être apprécié.
Eh bien, cependant, je crains que vous n’ayez rapporté de votre excursion dans le monde un peu d’envie d’y jouer votre rôle, non pour lui complaire, vous ne l’estimez pas assez pour cela, mais pour vous venger de lui en l’humiliant. Vous voudriez bien le fuir, mais vous aimeriez qu’on sût le mépris que vous en faites. L’idée que telle personne vous plaint de votre pauvreté et qu’on s’imagine vous inspirer des regrets, vous blesse et vous offense. Ne l’avouez pas si vous me trouvez trop pénétrant ; mais songez à extirper de votre repos cette plante parasite, l’opinion d’autrui, le vain bruit du monde, et, dans l’énumération que vous faites de vos ennemis, rayez celui-là. Écrasez-le comme une mouche importune, ce n’est rien de plus. Vous avez vingt-cinq ans, vous êtes belle, votre intelligence est cultivée, votre réputation est sans tache comme votre vie, mais vous êtes pauvre ; et, tandis que les filles les moins aimables et les plus mal faites trouvent un époux à prix d’or, vous semblez condamnée par les convenances d’un monde cupide à vivre dans la solitude.
Marcie, ne vous plaignez point trop, ne soyez point ingrate. Vous êtes instruite, vous êtes pure. Voilà de grandes supériorités, de véritables éléments de bonheur ; et ces riches infortunées, qui sont réduites à acheter leur époux, doivent vous inspirer une profonde pitié. Oh ! que leur tâche est rude, à celles-là ! Qu’il faut de résignation à ces êtres flétris en naissant du sceau de la laideur et de l’ineptie ! Leur existence est une humiliation que l’esprit de renoncement et d’humilité (mort, hélas ! avec la foi évangélique) peut seul aider à porter avec dignité. Vous savez si la société, malgré ses tristes caresses, les dédommage des sévérités de la nature ; vous savez si l’homme attaché à elles par un serment honteux peut feindre longtemps et leur cacher son dégoût et son aversion. J’ai connu une pauvre fille de seize ans qui avait quatre cent mille livres de rente. La mort semblait avoir posé sa main glacée sur ce jeune visage déjà décrépit, et courbé cette taille débile et contrefaite, toujours près de se briser. Son âme était triste comme son front, souffrante comme son corps. Mais ce déplorable enfant de la vieillesse débauchée d’un riche avait en lui le trésor d’une angélique douceur. Un regard paternel était descendu d’en haut sur cette pauvre créature ; un rayon céleste lui avait donné la force de vivre hors de sa misérable enveloppe.
Elle voulait se faire religieuse. Sa famille s’y opposa. On la pressa d’épouser un homme vain, que toutes les femmes vaines recherchaient, et qui, pour autoriser son insolence, avait besoin des vanités de la richesse. La jeune héritière eut un moment de doute, et l’esprit de Dieu s’affaiblit durant quelques jours dans son âme. Elle avait dévoré l’humiliation de sa laideur, mais elle ne s’était pas assez affermie dans l’amour des vrais biens. On lui persuada que son mari l’aimerait pour sa bonté, que cet amour la rendrait heureuse, qu’elle serait enviée de ses belles et orgueilleuses rivales. Elle n’avait pas une haute intelligence, quoiqu’elle eût un noble cœur. C’était un esprit médiocre avec un puissant caractère. Trop tard, elle connut son erreur ; ses vertus ne causèrent qu’ennui et dédain. Elle était dévote, disait le mari, parce qu’elle était laide. Elle recherchait l’amour et la reconnaissance des pauvres, parce qu’il lui fallait bien être aimée et vantée par quelqu’un. Je ne vous ferai pas l’affreux détail de ce qu’elle eut à souffrir. Tant d’infortune ranima sa piété ; sa santé empira, et, en même temps, elle sentit son courage se réveiller. Je l’ai vue dépérir avec stoïcisme, et j’ai deviné ses vertus et ses maux plus que je ne les ai connus. Je crois la voir encore couchée sur l’or et la soie, expirant dans les plis de l’hermine, sous des lambris de lapis et d’agate, et disant que, jusqu’à sa dernière heure, elle voulait, pour se mortifier, contempler ce faste exécré, ces insignes de sa splendeur funeste. Elle fut calme et réservée jusqu’au bout ; je n’ai jamais vu boire un plus amer calice avec moins d’hésitation et de regret. Sa famille n’entendit d’elle aucune plainte, et son mari ne fut pas même troublé dans ses plaisirs par le spectacle de ses souffrances. Nul n’a su quels rêves d’amour et de terrestres voluptés avaient pu dévorer cette oisive imagination. Nul n’a su ce qu’il lui avait fallu d’efforts, pour renoncer sans colère à vivre ici-bas. Le crucifix d’or que j’ai vu dans ses mains crispées par l’agonie pourrait seul raconter combien de ruisseaux de larmes ont baigné ses pieds insensibles. Le pâle ange gardien, qui soutint dans ses bras paternels cette jeunesse pénible, a pu seul raconter à Dieu par combien de martyres elle avait expié l’éphémère désir de prendre place au banquet terrestre. Je ne prétends pas faire ressortir de ce douloureux exemple que toutes les femmes laides doivent se vouer à la solitude. Quelques-unes ont eu le bonheur, grâce à leurs qualités morales, ou au charme de leur esprit, d’inspirer des affections vives et durables. Mais les hommes capables de ressentir de telles affections ne sont pas en général guidés par la cupidité, et on peut les voir choisir la compagne de leur vie partout ailleurs qu’au faîte de la richesse.
Ainsi pourquoi désespérez-vous de trouver, dans cette société injuste et corrompue, une âme d’exception comme la vôtre, qui s’associerait irrévocablement à vos destinées, et qui déjà peut-être de son côté vous cherche afin de vous saluer du nom d’épouse et de sœur ? Et quand vous ne trouveriez pas cet appui nécessaire aux femmes, votre vie serait impossible ? n’êtes-vous pas tellement forte, que vous ne puissiez entrer dans une voie d’exception sublime ? Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que rien n’est impossible à un grand courage aidé de la réflexion. Vous vous êtes élevée au-dessus de votre sexe en d’autres occasions. Toutes les fois que nous faisons des actes de force, nous nous élevons au-dessus de la nature humaine vulgaire. Vous savez que de grandes destinées morales sont condamnées à une sorte d’isolement, et que l’esprit de sagesse, dans tous les temps, dans toutes les religions, a amplement dédommagé ceux qui se retirent de la route commune pour entrer volontairement dans la vie intérieure.
Malheureusement, après avoir vécu sagement et en vous-même, vous avez voulu traverser le tumulte du monde pour satisfaire une vaine curiosité, et maintenant le miroir de votre âme est terni par le reflet de mille fantômes vains, par le souffle malsain des passions vulgaires : vous trouverez dans votre sort des tribulations que vous n’aviez pas aperçues auparavant, ou que vous aviez supportées avec philosophie. Étrange contradiction ! Vous avez vu le règne de la faiblesse et de la vanité, et vous êtes tombée dans les mêmes servitudes que ces esclaves par vous méprisées.
Mais c’est que ce rôle de vieille fille, dites-vous, est bien pitoyable ! On vous raille, si vous êtes laide et vieille ; et on vous hait, parce qu’on vous suppose jalouse et méchante. Si, au contraire, vous êtes jeune et belle, on vous plaint ; et cette pitié, dites-vous encore, et avec raison, est le dernier des outrages.
Vous devriez ne pas vous apercevoir de cette pitié, Marcie ; mais, puisque vous n’avez pas la force de vous placer au-dessus, il est un moyen certain de la repousser et de la changer en respect. C’est d’accepter énergiquement et joyeusement votre sort. C’est d’avoir dans le cœur le calme de la résignation, et sur le front la sérénité de la vertu. Vous avez voulu montrer dans les salons votre pâleur studieuse, votre gravité mélancolique ; et ces hommes, incapables de comprendre le peu qu’ils valent, se sont imaginé que loin d’eux votre vie était un supplice. Qu’alliez-vous faire parmi eux ?
Et voilà qu’au lieu de les faire mentir, au lieu de sourire de leur vanité, vous leur donnez raison en détestant la retraite à laquelle vous devez pourtant ce que vous avez de meilleur. Vous rapportez du dehors les désordres des pensées, le scepticisme de l’esprit, vous les laissez pénétrer dans l’asile dont ces enfants du néant n’auraient pas dû franchir le seuil.
Vous dites que la foi est éteinte, que le genre humain dénie, que les sectes nouvelles ont peut-être raison, que l’amour n’est qu’une chimère, la fidélité qu’un joug ; vous demandez à quoi sert la vertu, si le monde en profite, si Dieu la récompense ! Vous pleurez avec les enfants de la terre sur les autels des dieux renversés dans la fange. Pénétrée de douleur, vous vous écriez : « Comment n’être pas entraînée dans l’orage ? comment rester debout sous tant de ruines qui ne s’arrêtent pas de crouler ! »
Étendez les bras, Marcie ; étendez vos bras vers le ciel, et vos bras porteront les ruines du monde, et vous ne serez point écrasée. Essayez ce que peut la foi contre les éléments conjurés, contre la colère céleste elle-même. Souvenez-vous de l’arche de Noé au milieu du déluge, admirable figure de la lutte que soutiennent aujourd’hui les derniers croyants sous la nuée qui s’épanche au sein des abîmes qui s’entr’ouvrent !
Oh ! nous ne savons pas ce que peut l’espérance, car nous n’essayons plus ce que peut la prière. Moi qui vous parle, j’ai plus de mal que vous ; mais je ne voudrais pas périr sans résister jusqu’au bout ; je ne voudrais pas me laisser balayer avec les feuilles sèches que disperse le vent de la mort. Protestez, Marcie, protestez en vous-même contre ces influences funestes : vous ne savez pas qu’un front sans tache peut arrêter la voûte croulante des cieux. Laissez aux hommes forts le soin de rebâtir leurs temples ; vous, triste et chaste colombe, reconstruisez votre nid solitaire ; ange silencieux, prosternez-vous dans l’ombre du parvis. En apercevant votre front pâle et radieux, quelques-uns diront : « Il y a encore de l’amour dans les cieux, car il y a encore de l’espérance sur la terre. »
Et, quant à ces dangereuses tentatives qu’ont faites quelques femmes dans le saint-simonisme pour goûter le plaisir dans la liberté, pensez-en ce que vous voudrez, mais ne vous y hasardez pas, cela n’est pas fait pour vous. Vous ne sauriez aimer à demi, et, si vous aimez un jour, vous aimerez à jamais. Vous aurez accepté un hommage libre, et bientôt vous aurez horreur de ce droit d’infidélité que se sera réservé votre époux. Si vous vous soumettez par engagement aux principes d’une étrange vertu, à cette immolation de votre orgueil légitime, vous souffrirez, vous souffrirez longtemps, toujours peut-être ; car les organisations fortes ont de forts attachements, elles ne sont pas mobiles comme le vulgaire, aucune considération d’intérêt ou de vanité ne peut les arracher à la douleur de leurs blessures. Elles se dévorent elles-mêmes et sont plus inhabiles à se guérir que les âmes faibles ; un sang brûlant et intarissable coule à longs flots dans leurs veines. Que serait donc une société nouvelle où les belles âmes n’auraient pas le droit d’étendre leurs ailes et de se développer dans toute leur étendue, où le fort serait de par la loi le jouet et la dupe du faible ? Et comment cela n’arriverait-il pas sans cesse sous un régime qui l’autoriserait, puisque cela arrive si souvent sous un régime qui le prohibe ? Étrange remède à la corruption d’une société, que de lui ouvrir toutes grandes les portes de la licence ! Ce que l’homme rêve, ce qui seul le grandit, c’est la permanence de l’état moral, le caractère des grandes choses dans l’ordre matériel, c’est la durée ; et c’est aussi à quoi, dans l’ordre moral comme dans l’ordre matériel, l’homme atteint le plus difficilement. À Dieu seul est réservée l’immutabilité sublime. Mais tout ce qui tend à fixer les désirs, à raffermir les volontés et les affections humaines, tend à ramener sur la terre ce règne de Dieu, qui ne signifie autre chose que l’amour et la pratique de la vérité.
La vérité, c’est l’amour de la perfection, et la perfection, c’est l’éternelle tentative de l’esprit pour dompter la matière. C’est la dure victoire sur les appétits ardents ; c’est l’austère immolation des satisfactions vulgaires. Il ne s’agit pas pour vous, Marcie, qui avez admiré toute votre vie dans les grands hommes le reflet de la puissance céleste, pour vous qui demandez sincèrement le secret d’être heureuse, et qui, fatalement, par l’élévation de votre caractère, ne pouvez trouver ce secret hors de la grandeur ; il ne s’agit pas, dis-je, de vous créer des principes qui vous procurent des plaisirs et de la liberté matérielle. Il s’agit, âme pure, âme triste et fière, d’adopter des principes qui vous fassent de plus en plus pure, qui vous assurent les vrais biens, et fondent votre liberté morale sur des bases inébranlables.
Peut-être qu’on pourrait donner à tous les hommes la même assurance, et leur prédire qu’ils ne trouveront pas une forme sociale durable et satisfaisante hors de ces grands instincts de l’humanité, qu’on semble traiter aujourd’hui comme si un décret céleste les avait supprimés, comme si, avec les machines à vapeur et les merveilles de l’industrie, on avait trouvé la solution de tous les problèmes de l’intelligence, la satisfaction de tous les besoins de l’âme. Mais ce serait viser trop haut, et c’est déjà trop d’honneur pour moi, Marcie, que d’avoir eu un instant droit de conseil sur un esprit comme le vôtre.
II
Vous dites, Marcie, que vous vous efforcerez d’atteindre à cette vertu tranquille et sereine, mais que vous n’espérez pas beaucoup y parvenir ; qu’il vous faudrait l’aide de plusieurs conditions extérieures, dont les plus simples sont irréalisables. La poésie manque à votre vie, dites-vous ; et cependant, vous sentez qu’elle seule pourrait ennoblir vos tristesses et ranimer vos esprits, qui s’éteignent dans un air lourd et plat. Vous trouvez que de si grandes résolutions à prendre, de telles révoltes à combattre ont besoin des grandes scènes de la nature et de l’air libre des voyages. Vous voudriez changer de place, prier sur la terre de Jérusalem, chercher les cryptes des Pères du désert, gémir dans une horrible tempête, aller les pieds nus et saignants sur les rochers, souffrir davantage, afin de sentir quelque chose, fût-ce la douleur avec énergie.
Ces inquiétudes m’affligent et ne me retracent que trop celles qui dévorent souvent mon propre cœur. Je ne suis pas plus héroïque que vous, Marcie ; mais ne sommes-nous pas insensés dans nos mécontentements, et n’est-ce pas une chose digne de pitié que de voir de si chétifs atomes avoir besoin de tant d’espace et de bruit pour y promener une misère si obscure et si commune ? Nous ne sommes qu’enflure et vanité ; nos plaintes ne sont qu’emphase et blasphème. Qu’avons-nous donc fait de si grand pour trouver les autres hommes si petits et vouloir fuir jusqu’à la trace de leurs pas ? Marcie, notre esprit est malade, et, quand nous cherchons à nous préserver d’un mal, nous tombons dans un pire. Nous haïssons les vaines occupations du monde, ses paradoxes impies, ses fausses maximes. Nous fuyons ce commerce dangereux, cet air délétère. Mais, au lieu de chercher autour de nous des âmes simples et des esprits droits, nous nous jetons dans la haine du genre humain ; nous osons devenir orgueilleux dans le sens méchant et superbe du mot ; car l’orgueil a deux faces, comme toute faculté humaine, une divine et une infernale. Eh bien, quand nous avons conquis la première, si nous cessons un instant de nous observer, nous tombons dans l’autre ; et alors, avec notre vaine sagesse et notre fausse grandeur, nous devenons pires que les hommes corrompus du siècle. Nous craignons de nous salir en les touchant, nous ne pouvons respirer dans leur air. Sublime philosophie chrétienne, est-ce là ce que tu nous enseignais ?
Et cependant, Marcie, la grandeur est partout sans que nous nous en doutions. Autour de nous, sous le voile d’une humble obscurité, dans les conditions les plus pauvres, sous notre main, sous nos pieds en apparence, il y a des hommes meilleurs que nous, des hommes plus forts, plus intelligents, plus patients que nous. De grossiers habits et de rudes manières couvrent des trésors de bonté ou de sagesse, que nous méconnaissons ou que nous dédaignons d’apercevoir. Nous demandons les cimes du Liban et les sapins du Morven, comme si la vie d’un homme vertueux, le sourire d’une âme évangélique n’était pas un plus beau spectacle que toutes les montagnes et toutes les forêts. Comme si, d’ailleurs, les étoiles ne brillaient pas sur notre tête de tous les points de la terre, comme si une nuance de plus à la pourpre du matin pouvait guérir les blessures d’une âme fermée à toute sympathie pour ses semblables. Tenez, Marcie, nous sommes infortunés ! Toute notion du devoir est effacée en nous. Nous avons des obligations sacrées, nous ne cherchons pas notre remède dans leur accomplissement. Votre mère est aveugle, mon enfant est malade. Les soigner, les distraire, leur donner tout le bonheur que nous n’avons pas, rendre notre tendresse si ingénieuse et si active, qu’ils ne regrettent pas la santé, et se jettent dans notre sein chaque soir en disant ces mots admirables que j’ai entendus sortir d’une bouche chérie : « Je prie Dieu de ne pas me guérir vite ; » ne serait-ce pas là, si nous étions vertueux, le but de notre vie, la récompense de nos fatigues, la gloire douce et cachée de nos souvenirs ? Aurions-nous le loisir de songer à l’impossible si nous faisions seulement le nécessaire ? Serions-nous désespérés si nous rendions l’espérance à ceux qui n’ont pas d’autres ressources ? Tenez, Marcie, je suis si triste et si abattu aujourd’hui, je confonds tellement dans mon angoisse ma misère et la vôtre, qu’il m’est impossible de vous donner des conseils. Je tâcherai d’y suppléer par un récit. En pensant à vous l’autre soir, je me suis rappelé une anecdote que j’ai voulu écrire pour vous l’envoyer. J’ai bien fait, car aujourd’hui elle suppléera à toute exhortation. D’ailleurs, j’ai foi à la puissance des exemples. La parabole fut l’enseignement des simples. Enseignement sublime, que sont tous nos poëmes au prix de tes naïves allégories !
Le curé d’une petite ville de Lombardie, où j’ai passé quelque temps, avait trois nièces, toutes trois agréables et parfaitement élevées. Orphelines et sans fortune, elles furent recueillies par leur oncle, et, grâce à leur économie, à leur bon caractère et à leur zèle, elles apportèrent, en même temps que le bonheur et la gaieté, un surcroît d’aisance dans le presbytère. Le bon vieillard, en retour, sut leur inspirer tant de sagesse par ses leçons, qu’elles renoncèrent à l’idée peut-être un peu caressée jusque-là de se marier. Il leur fit entendre qu’étant pauvres, elles ne trouveraient que des maris au-dessous d’elles par l’éducation, ou tellement pauvres eux-mêmes, que la plus profonde misère serait le partage de leur nouvelle famille. « La misère n’est point un opprobre, leur disait-il souvent en ma présence ; honte à quiconque ne redoublerait pas de respect pour ceux qui la supportent dignement, et de compassion pour ceux qui en sont accablés ! Mais c’est une si rude épreuve que le besoin ! N’y a-t-il pas une témérité bien grande à risquer la paix et la soumission de son âme dans un si terrible pèlerinage ? » Il fit si bien qu’il éleva leurs esprits à un état de calme et de dignité vraiment admirable. Lorsqu’il voyait un nuage sur la figure de l’une d’elles : « Eh bien, qu’as-tu ? disait-il avec cette liberté de la plaisanterie italienne. Nipotina, ôtez-vous de la fenêtre ; car, si les jeunes gens qui passent dans la rue vous voient ainsi, ils vont croire que vous soupirez après un mari ; » et aussitôt le sourire de l’innocence et d’un juste orgueil reparaissait sur le visage mélancolique. Vous pensez bien que cette famille vivait dans la plus austère retraite. Ces jeunes filles savaient trop bien qu’elles devaient éviter jusqu’au regard des hommes, vouées, comme elles étaient, au célibat. S’il y eut des inclinations secrètement écloses, secrètement aussi elles furent comprimées et vaincues. S’il y eut quelques regrets, il n’y eut entre elles aucune confidence, quoiqu’elles s’aimassent tendrement ; mais la fermeté et le respect de soi-même étaient si forts en elles, qu’il y avait une sorte d’émulation tacite à étouffer toute semence de faiblesse sans la mettre au jour. L’amour-propre, mais un amour-propre touchant et respectable, tenait en haleine la vertu de ces jeunes recluses. Et il faut croire que la vertu n’est pas un état violent dans les belles âmes, qu’elle y pousse naturellement et s’y épanouit dans un air pur ; car je n’ai jamais vu de visages moins hâves, de regards moins sombres, d’aspects moins farouches. Fraîches comme trois roses des Alpes, elles allaient et venaient sans cesse, occupées au ménage ou à l’aumône. Lorsqu’elles se rencontraient dans les escaliers de la maison ou dans les allées du jardin, elles s’adressaient toujours quelque joyeuse et naïve attaque, elles se serraient la main avec cordialité. Je demeurais dans le voisinage et j’entendais leurs voix fraîches gazouiller par tous les coins du presbytère ; aux jours de fête, elles se réunissaient dans une salle basse pour faire quelque pieuse lecture à haute voix à tour de rôle. Après quoi, elles chantaient en partie quelque cantique. Par les fenêtres entr’ouvertes, je voyais et j’entendais ce joli groupe à travers les guirlandes de roses blanches et de liserons écarlates qui encadraient la croisée. Avec leurs magnifiques chevelures blondes, et des bouquets de fleurs naturelles dont se coiffent les jeunes Lombardes, c’était vraiment le trio des Grâces chrétiennes.
La cadette était la plus jolie. Il y avait plus d’élégance naturelle dans ses manières, plus de finesse dans son esprit ; je dirais aussi, plus de magnanimité dans son caractère, si je ne craignais de détruire dans mes souvenirs l’admirable unité de ces trois personnes, en n’admettant pas que le trait d’héroïsme que je vais vous raconter n’eût pas été possible à toutes trois également.
Arpalice était le nom de cette cadette. Elle aimait la botanique et cultivait une plate-bande de fleurs exotiques le long d’un mur du jardin qui recevait les pleins rayons du soleil et en conservait la chaleur jusqu’à la nuit. De l’autre côté du mur s’élevaient à peu de distance, les fenêtres d’une jolie maison voisine, qu’une riche famille anglaise loua pour un été. Lady C*** avait avec elle deux fils : l’un phthisique, et qu’elle essayait de rétablir à l’air pur des campagnes alpestres ; l’autre, âgé de vingt-cinq ans, plein d’espérance, beau de visage et doué d’un esprit fort droit, d’un caractère équitable et généreux. Ce jeune homme voyait de sa fenêtre la belle Arpalice arroser ses fleurs ; et, dans la crainte de la mettre en fuite, il l’observait chaque jour, et tout le temps qu’elle demeurait, par la fente des rideaux de la tendina. Il en devint amoureux, et tout ce qu’il apprit d’elle et de son entourage le captiva si fort, qu’il la demanda en mariage, avec l’agrément de lady C***, laquelle, voyant dépérir son fils aîné, et craignant d’éloigner par sa rigueur le second, fit le sacrifice de ses préjugés aristocratiques et donna son consentement. Grande fut la surprise dans la maison anglaise quand le curé, après avoir consulté sa nièce, remercia poliment et refusa net pour elle l’offre d’un nom illustre, d’une immense fortune, et, ce qui était plus digne de considération, d’un amour honorable. Le jeune lord crut que la fierté du presbytère avait été blessée par la précipitation de sa démarche ; il montra tant de douleur, que lady C*** se décida à aller en personne trouver Arpalice, et lui demanda avec instance de devenir sa bru. La beauté, le grand sens et la grâce de cette jeune personne la frappèrent tellement, qu’elle partagea presque le chagrin de son fils en la trouvant inébranlable dans sa résolution. Le jeune C*** tomba malade, et, au même temps, son frère aîné mourut. Le séjour de la famille anglaise se prolongea dans la petite ville. Le curé alla trouver lady C***, lui offrit de délicates consolations, s’enquit avec intérêt de la santé du jeune lord, et s’efforça, par les soins les plus empressés, d’adoucir leur triste situation. À peine rétabli, lord C***, qui avait fait mettre son lit auprès de la fenêtre, afin d’apercevoir de temps en temps Arpalice, se glissa le long du jardin du presbytère, cacha des billets doux dans les fleurs qu’Arpalice venait cueillir, lui en fit parvenir d’autres, la suivit à l’église, et enfin il lui fit une cour assidue, mystérieuse et romanesque, dont elle n’avait guère le droit de s’offenser, puisqu’il avait si bien prouvé à l’avance l’honnêteté de ses vues.
Un mois s’écoula ainsi, et, un matin, Arpalice avait disparu. Grand effroi et grande rumeur dans le presbytère ; déjà les deux sœurs désolées couraient en se tordant les mains vers la rue pour avoir des nouvelles de la fugitive, lorsque le curé, sortant de sa chambre d’un air ému, mais non affligé, leur dit de se tenir tranquilles, de ne montrer aux gens du dehors aucune surprise, et de ne point avoir d’inquiétude. C’était lui-même, disait-il, qui avait envoyé Arpalice à Bergame pour une affaire à lui personnelle, et dont il priait ses chères nièces de ne lui demander compte qu’après le retour de leur sœur. Trois jours après cette matinée, la famille anglaise partit pour Venise, et de là pour Vienne. Le jeune lord paraissait consterné, mais il ne voulut pas souffrir que sa mère renouvelât ses instances. En même temps qu’ils prenaient, à l’est, la route de Brescia, le curé prit, à l’ouest, celle de Bergame ; et, le lendemain, Arpalice était de retour avec lui au presbytère. Elle était fort pâle et se disait souffrante ; mais elle était aussi affectueuse et aussi sereine qu’à l’ordinaire. Elle pria ses sœurs de ne pas la questionner, et ce ne fut qu’au bout de six mois, après que les brillantes couleurs de la santé eurent reparu sur ses joues, qu’il fut permis au curé de trahir son chaste secret. Arpalice avait aimé lord C*** ; mais, par tendresse pour ses sœurs, elle n’avait pas voulu se marier.
Voici la lettre que l’oncle avait trouvée dans sa serrure le jour où Arpalice avait pris la fuite. Le bonhomme, en essayant de me la lire, était si ému, qu’il ne put achever, et, me la jetant sur les genoux : « Tenez, me dit-il, j’y renonce, quoique je la sache par cœur. » J’ai pris copie de cette lettre avec sa permission, et la voici :
« Mon oncle, ne me blâmez pas de la faiblesse qui m’accable, j’ai tout fait pour lutter contre mon cœur. Il faut que cette passion qu’on appelle inclination (je traduis textuellement) soit bien plus difficile à gouverner que je ne croyais. Apparemment qu’il plaît au Seigneur de m’éprouver pour me ramener au sentiment de la crainte et de l’humilité. Hélas ! mon bon oncle, gardez-moi le secret. Rien au monde n’eût pu me déterminer à avouer à mes pauvres sœurs pourquoi j’étais malade ; mais vous êtes mon confesseur et mon père en Dieu ; je viens vous avouer avec honte que c’est le chagrin qui m’a vaincue. J’ai eu l’imprudence de recevoir plusieurs lettres de ce jeune homme, je vous les renvoie, mon oncle : brûlez-les, que je ne les revoie jamais ; elles ont troublé le zèle de mes jours et le repos de mes nuits. J’ai laissé le venin de la flatterie s’insinuer dans mon âme, et en un instant, chose étrange et déplorable ! l’estime de cet étranger m’est devenue plus précieuse que les bénédictions de ma famille. Tandis que les plus tendres caresses de mes sœurs, tandis que vos plus bienveillantes paroles me tiraient à peine d’une secrète mélancolie, les phrases insensées que milord m’écrivait, et que je dévorais avec mystère, me faisaient monter le feu au visage, et mon cœur bondissait comme s’il allait se briser. Ô mon cher oncle, quelle chose puissante que la louange, quelle chose faible et lâche que notre cœur quand nous en avons ouvert l’accès ! Le désordre de mon âme, arrivé si subitement lorsque je me croyais si affermie, est un mystère pour moi. Je ne comprendrai jamais comment un homme que je ne connais pas a pu m’inspirer plus d’attachement pendant quelques instants que vous et mes sœurs. Un sentiment si injuste, si aveugle, ne peut être qu’une embûche de Satan.
» Lorsque je l’ai repoussé la première fois, vous m’avez dit de bien réfléchir, vous m’avez engagée à suivre mon penchant, vous m’avez répété les paroles sacrées : « Il est écrit : La femme quittera son père et sa mère. » Je sais que c’est la loi des anciens temps. Mais, aujourd’hui qu’il y a tant de filles à marier qui ne demandent pas mieux, je ne crois pas que les hommes soient en peine de trouver à s’établir ; et, dès ce premier jour, comme j’avais l’esprit calme et que je ne sentais rien pour milord, il m’a semblé que je devais refuser, par amour pour mes deux pauvres sœurs, une fortune si différente de la leur. Madame sa mère m’a bien dit qu’elle les doterait, qu’elle les emmènerait avec moi ; vous ne pouviez quitter votre état, vous, mon oncle, et je n’ai pu souffrir l’idée de me séparer de vous, et de cette chère petite maison où nous vivons si heureux, pour aller porter de grandes robes et rouler carrosse dans des pays que je ne connais pas ; et puis je me suis dit que, comme ce n’était pas la fortune qui pouvait me tenter et me faire épouser milord, ce n’était pas non plus en faisant part de cette fortune à mes sœurs que je pourrais les consoler si elles ne trouvaient pas le bonheur dans ma nouvelle famille. Et puis encore, que sait-on ? j’aurais peut-être été heureuse dans le mariage, et mes sœurs, voyant cela, auraient peut-être souhaité se marier aussi, et peut-être qu’elles ne l’auraient pas pu. Et, si elles s’étaient mariées, peut-être n’eussent-elles pas fait d’heureux ménages ; et voilà toutes nos existences, si tranquilles, bouleversées, voilà notre bonheur changé en soucis, en regrets, en déplaisirs sans remède et sans terme. Enfin mon cerveau n’était pas malade : ce jour-là, je vis tout d’un coup, et aussi clairement que si j’eusse lu dans un livre, tous les inconvénients de ce mariage ; je vous les démontrai à vous-même, et je vous persuadai de m’affermir dans mon refus si je venais à changer malheureusement d’avis. Mais, après ce refus, les plaintes de milord devinrent si grandes, qu’elles endormirent ma raison ; et, quoique je ne lui aie pas donné par mes actions, mes paroles ou mes regards, la moindre espérance, voilà qu’aujourd’hui, après lui avoir écrit assez durement de me laisser en repos et de ne jamais compter me faire changer d’avis, je me suis évanouie dans ma chambre, et, après être revenue à moi-même, je me suis sentie fondre en larmes, comme si on fût venu m’annoncer votre mort ou celle de mes sœurs. Épouvantée de me sentir si faible, et ne comprenant rien à la force subite de cette inclination, j’ai vu qu’il était temps de prendre quelque parti irrévocable, car je n’étais plus sûre de moi. J’ai donc ajouté au bas de ma réponse à milord en peu de mots que je m’en allais, et ne reviendrais que lorsqu’il aurait lui-même quitté le pays. J’ajoutai que je croyais trop à son honneur pour craindre qu’il laissât ainsi errer longtemps une pauvre fille sans asile, éloignée de sa maison et de ses parents. J’espère qu’il ne me fera pas attendre son départ, et que vous viendrez me chercher, mon cher oncle, aussitôt qu’il se sera mis en route.
» Mais, mon oncle, ne pensez pas que le sacrifice soit au-dessus de mes forces, et que votre tendresse trop indulgente ne vous porte pas encore, cette fois-ci, à me faire revenir de ma détermination. Au nom du ciel, si vous m’aimez, si vous m’estimez, si vous croyez que mon espoir n’est pas de ce monde, et que je suis digne d’aspirer à la gloire de Dieu, ne confiez pas un mot de tout ceci à mes sœurs ; elles viendraient se jeter à mes pieds, et, sans me fléchir, elles rendraient mon effort plus difficile. Écoutez, mon bon oncle, mon cher confesseur, je sais ce que je fais. Je souffre, mais je peux souffrir à présent que j’ai passé une nuit en prière. »
Ici, le caractère de l’écriture indiquait une interruption et une main plus ferme.
« Écoutez, mon oncle, ne me grondez pas. Vous m’avez fait promettre de ne jamais prononcer un vœu quelconque à Notre-Seigneur, ou à la Vierge, ou aux saints, sans vous consulter à l’avance. Eh bien, pardonnez-moi, j’ai vu que vous étiez plus faible pour moi que moi-même, et je viens de m’engager, au lever du soleil, par un vœu irrévocable, à rester dans le célibat. Je n’ai pas agi à la légère, je vous en réponds. J’ai prié l’Esprit-Saint de m’éclairer. J’ai pris mon temps. L’étoile du matin brillait, et la nuit était encore noire. Je me suis dit : « Je méditerai jusqu’à ce que la clarté du jour ait effacé cette étoile. » Et je me suis mise à genoux devant ma fenêtre en face de l’orient, qui est la figure de la venue du Fils de l’homme sur la terre. J’ai senti que la grâce descendait en moi. Oui, je l’ai sentie ; car, à mesure que la fraîcheur du matin soulageait mes membres rompus, je sentais comme une brise du ciel qui soulageait mon cœur. Et, à mesure que l’étoile pâlissait, la flamme de mon coupable amour s’affaiblissait. Et, à mesure que l’orient s’embrasait, mon espérance et ma foi se ranimaient. Enfin, quand le premier bord du soleil a dépassé la haie du jardin, j’ai été saisie comme d’une extase ; j’ai cru voir la face du Sauveur rayonner dans ce globe de feu, mon cœur s’est brisé en sanglots de bonheur, et je me suis levée par un mouvement involontaire, en tendant les bras vers lui et en m’écriant : Je jure.
» Tout est dit, mon oncle, il ne faut plus me parler de mariage ; depuis un quart d’heure, je me sens si joyeuse, que je vois bien que j’ai pris le bon parti et que j’ai accompli la volonté de Dieu. Que ni vous ni mes sœurs ne m’en fassiez un mérite. Vous n’existeriez pas que je prendrais encore le parti de conserver à Dieu cette âme libre qui jusqu’ici n’a adoré que lui, et qui n’a jamais trouvé ni souffrance, ni mécompte, ni effroi dans cet amour.
» Maintenant, je pars pour Brescia. Je descendrai chez notre cousine l’aveugle. Je lui dirai que c’est vous qui m’envoyez acheter une devanture d’autel, et je vous attends, cher oncle. À bientôt, j’espère. »
Lorsque Giulia et Luigina, les deux autres sœurs, connurent cette lettre, elles voulurent courir se jeter dans les bras d’Arpalice ; mais le curé, qui avait choisi, pour la leur communiquer, l’heure à laquelle Arpalice cultivait ses fleurs, les pria, au contraire, de ne point lui en parler. « Redoublez de tendresse et de soins pour elle, leur dit-il, rendez-la plus heureuse encore que vous ne faites, s’il est possible ; aimez-la, estimez-la davantage, si vous pouvez ; laissez-lui de temps en temps entendre, dans les occasions délicates, que vous savez de quelle haute vertu elle est capable ; mais promettez-moi de ne jamais entrer en explication sur ce sujet. » Elles le promirent, et furent fidèles à leur engagement. Et, quand je demandai au curé, qui me racontait ces détails, pourquoi il avait exigé si expressément ce silence : « Voyez, dit-il en souriant, tout acte sublime a une explication naturelle, et l’explication naturelle n’empêche pas l’acte d’être sublime ; il y a dans Arpalice un immense, un vénérable orgueil, si je puis m’exprimer ainsi. En même temps, il y a tant de foi et de droiture, qu’elle regarde son sacrifice comme la dernière chose du monde, tandis que ses hésitations, son entraînement vers ce jeune homme, et les regrets qu’elle a étouffés depuis, lui apparaissent comme des faiblesses dont elle rougit ; et je sais, moi qui connais tous les replis de son cœur, qu’en vantant la grandeur de son courage ses sœurs l’eussent beaucoup plus humiliée que flattée… Et puis qui sait si, en lâchant la bride à ces conversations dangereuses, la tête des deux autres ne se fût pas enflammée de quelque vaine curiosité ? Qui sait si l’amour d’Arpalice ne fût pas sorti de ses cendres ? Tout le monde se trouve bien de cet arrangement. J’ai voulu dire à Giulia et Luigina ce qu’elles devaient de reconnaissance et d’admiration à leur sœur. Ne pas le dire, c’eût été frustrer Arpalice de ce redoublement d’amour qui lui était dû, comme la récompense de sa grande action, mais ces sortes de tragédies doivent se jouer dans le plus profond mystère de la conscience, et n’avoir pour spectateur que Dieu. Au reste, ajouta-t-il, mes nièces sont restées unies par une invincible tendresse. Le presbytère n’a rien perdu de sa propreté, ni le jardin de son éclat. Arpalice est plus fraîche que jamais, comme vous voyez ; on chante toujours, on rit toujours comme devant ; on lit toujours l’Imitation ; on prie avec ferveur, et Dieu bénit les cœurs simples. Si une personne chez nous est plus sereine et plus contente que les autres, c’est certainement Arpalice. »
III
Je conviens que votre situation est loin de vous offrir des dédommagements aussi réels que ceux dont je vous ai fait le tableau fidèle dans l’histoire d’Arpalice. Je sais bien que votre âme est aimante et généreuse ; je ne doute pas qu’avec une pensée de dévouement, avec l’échange de vives et saintes affections, vous n’eussiez pu accomplir de semblables sacrifices. Chère Marcie, je sais que vos souffrances ne sont point imaginaires, et mon cœur est pénétré de compassion au spectacle de cet isolement fatal, sans diversion, sans terme peut-être, et que l’agitation du monde rend plus profond encore. Mais n’aggravez pas votre mal, je vous en supplie, par une fausse appréciation de vous-même et des choses extérieures. Je vous vois maintenant prendre le dessus, remporter la victoire sur les passions de la femme ; mais, en même temps que j’admire ce courage, je suis effrayé de vous entendre maudire la condition de votre sexe en ce qu’elle a précisément de meilleur et de plus sagement établi. Vous voudriez donner le change à vos souffrances par l’enivrement de la vie d’action. Vous vous croyez propre à un rôle d’homme dans la société, et vous trouvez la société fort injuste de vous le refuser.
Je crains Marcie, que les promesses impuissantes d’une philosophie nouvelle ne vous aient fait du mal. Soit que vous ayez mal compris la véritable pensée du saint-simonisme, soit que, dans ses hésitations et ses recherches, le saint-simonisme n’ait pas trouvé le mot de vos destinées, vous y avez puisé le désir de l’impossible. J’éprouverai toujours de la répugnance à faire la guerre à l’apostolat éphémère des hommes qui avaient entrepris la régénération de l’homme par le travail et l’association ; mais je suis forcé de vous répéter que, par rapport à vous personnellement, il n’a rien été statué là qui pût vous être bon. Le saint-simonisme appelait les femmes à se déclarer, à se prononcer elles-mêmes sur leurs droits et sur leurs devoirs, à en tracer la limite absolue. En vérité, le pouvaient-elles ? En est-il une seule, au temps où nous vivons, qui le puisse faire, même d’une manière générale ? Ne sommes-nous pas, hommes et femmes, dans une époque de doute, d’examen, d’incertitude ? Ne savons-nous pas tous trop et trop peu sur toutes choses ? Qui osera prescrire une forme arbitraire au progrès qui nous saisit, une marche rigide au torrent qui nous entraîne ? Jamais il ne fut plus difficile de s’éclairer sur les véritables besoins d’une génération. Ne faudra-t-il pas attendre que la vérité se manifeste et sorte éclatante de toutes nos clameurs ? N’est-il pas des infortunes plus urgentes à soulager que l’ennui de celui-ci et la fantaisie de celui-là ? Le peuple est aux prises avec des questions vitales ; il y a là des abîmes à découvert. Nos larmes y tombent en vain, elles ne peuvent les combler. Au milieu de cette misère si réelle et si profonde, quel intérêt voulez-vous qu’excitent les plaintes superbes de la froide intelligence ? Le peuple a faim ; que les beaux esprits nous permettent de songer au pain du peuple avant de songer à leur édifier des temples. Les femmes crient à l’esclavage ; qu’elles attendent que l’homme soit libre, car l’esclavage ne peut donner la liberté. Laissez les temps s’accomplir et les idées venir à terme ; cela ne sera peut-être pas aussi long qu’on l’espère d’un côté et qu’on le craint de l’autre. En attendant, faudra-t-il compromettre l’avenir par l’impatience du présent ? Faudra-t-il à tout hasard, pour satisfaire la fantaisie personnelle, trancher des questions que des siècles n’ont pas encore résolues, risquer tout en voulant tout emporter d’assaut, semer tous les trésors de courage et de dévouement sur un sol qui n’est pas encore assis, au pied des volcans à peine fermés ?
Vous, Marcie, qui n’avez jamais pu supporter la pensée d’appartenir, soit par nécessité, soit par caprice, à tout autre qu’un homme sérieusement aimé de vous, n’avez-vous pu trouver en vous-même assez de sagesse pour repousser le désir du vain pouvoir et de la vaine gloire ? Des velléités d’ambition se sont trahies chez quelques femmes trop fières de leur éducation de fraîche date. Les complaisantes rêveries des modernes philosophes les ont encouragées, et ces femmes ont donné d’assez tristes preuves de l’impuissance de leur raisonnement. Il est à craindre que les vaines tentatives de ce genre et ces prétentions mal fondées ne fassent beaucoup de tort à ce qu’on appelle aujourd’hui la cause des femmes. Les femmes ont des droits, n’en doutons pas, car elles subissent des injustices. Elles doivent prétendre à un meilleur avenir, à une sage indépendance, à une plus grande participation aux lumières, à plus de respect, d’estime et d’intérêt de la part des hommes. Mais cet avenir est entre leurs mains. Les hommes seront un jour à leur égard ce qu’elles les feront : confiants quand les femmes seront dignes de confiance, généreux et fidèles lorsque, dans leurs âmes aigries, de folles exigences ou d’injustes révoltes ne refouleront pas tout bon mouvement. Si les femmes étaient dans une bonne voie et dans de saines idées, elles auraient certainement meilleure grâce à se plaindre de la rigidité de certaines lois et de la barbarie de certains préjugés. Mais qu’elles agrandissent leur âme et qu’elles élèvent leur intelligence avant d’espérer faire fléchir le cercle de fer de la coutume. En vain elles se rassembleront en clubs, en vain elles engageront des polémiques, si l’expression même de leur mécontentement prouve qu’elles sont incapables de bien gérer leurs affaires et de bien gouverner leurs affections. Hommes et femmes, ne murmurons pas trop contre notre abaissement et notre servitude ! la faute en est à nous-mêmes ; si nous sommes avilis, c’est que nous n’avons pas la force de la vertu. C’est notre corruption qui fait notre esclavage, et, quand nous régnerons sur nos propres volontés, nous verrons tomber en poussière les volontés brutales et les résistances inintelligentes.
Mais vous, Marcie, vous n’êtes pas une de ces femmes vaines et bornées qui aspirent à des honneurs puérils. Vous avez la conscience d’une valeur réelle, vous êtes accablée de votre inaction. La vie de famille vous est refusée par un caprice de la fortune. Il vous reste, pour lot, une vie toute d’intelligence, et c’est précisément l’emploi de cette intelligence que la société vous interdit. Vous sentez en vous trop de jeunesse et de sympathie pour faire de votre génie un emploi isolé. Vous vous dites qu’à vingt-cinq ans l’homme le mieux doué ne saurait se retirer au désert et se consacrer à une philosophie toute personnelle. Dieu aurait-il départi à la femme une force supérieure à celle de l’homme ? « Non, dites-vous : qu’on me laisse donc m’élancer dans la vie d’action ; je me sens orateur, je me sens prêtre ; je veux, je peux combattre, discuter, enseigner. » Si vous le pouvez, Marcie, vous êtes une exception, et, dans des temps héroïques, vous eussiez pu vous nommer Jeanne D’Arc, madame Roland, Héloïse. Mais que voulez-vous être aujourd’hui ? Cherchez dans la hiérarchie sociale, dans tous les rangs du pouvoir ou de l’industrie, quelque position où la pensée de vous installer ne vous fasse pas sourire. Vous ne pouvez être qu’artiste, et cela, rien ne vous en empêchera. Mais supposons qu’il y ait aujourd’hui dans les discussions parlementaires et dans l’exercice du pouvoir quelque chose qui puisse tenter une âme généreuse ou un esprit élevé ; supposons que plusieurs femmes, excentriques par leur éducation et leurs facultés, brûlent de trouver leur place dans le monde, et, entravées par les lois, périssent consumées dans l’inaction et le regret ; entre nous, Marcie, je ne crois pas qu’il y ait une seule de ces femmes en Europe à l’heure où nous parlons. N’importe ; vous m’accorderez que le nombre n’en est pas grand, et qu’il serait bien imprudent de faire, à cause de ce petit nombre de prodiges, une loi qui admettrait au pouvoir déjà si fourvoyé, et à la discussion déjà si déplorable des intérêts du pays, toutes les femmes que nous ne connaissons pas, et même les premières d’entre celles que nous connaissons le mieux. Ainsi, quant à vous, grande âme cachée, sachez vous effacer, sachez vous anéantir plutôt que de désirer, pour satisfaire un besoin personnel, que le genre humain fasse un acte de démence.
Mais, pardonnez-moi, Marcie ; vous êtes malheureuse, et je me laisse aller à l’ironie au lieu de chercher à vous consoler ; je discute au lieu de verser sur votre front abattu les larmes de la sympathie et le baume de l’amitié. Je cherche le côté faible de votre raison, le côté malade de votre cerveau, sans songer que, plus vous serez malade et faible, plus je serai coupable et grossier de vous le faire sentir. Je vous le dis humblement, pardonnez-moi ; mais sérieusement, je vous dis : préservez-vous de ces ambitions folles. Les femmes ne sont pas propres aux emplois que jusqu’ici les lois leur ont déniés. Ce qui ne prouve nullement l’infériorité de leur intelligence, mais la différence de leur éducation et de leur caractère : ce premier empêchement pourra cesser avec le temps ; le second sera, je pense, éternel. Toujours, quel que soit le progrès de la raison superbe, le cœur des femmes sera le sanctuaire de l’amour, de la mansuétude, du dévouement, de la patience, de la miséricorde, en un mot des reflets les plus doux de la Divinité et des inspirations indestructibles de l’Évangile. Ce sont elles qui nous conserveront à travers les siècles les traditions de la sublime philosophie chrétienne. Ce sont elles encore aujourd’hui qui, au milieu du débordement de nos passions grossières, sauvent, à travers le naufrage, les débris du spiritualisme et de l’esprit de charité. Ainsi, vous le voyez, loin de moi cette pensée que la femme soit inférieure à l’homme. Elle est son égale devant Dieu, et rien dans les desseins providentiels ne la destine à l’esclavage. Mais elle n’est pas semblable à l’homme, et son organisation comme son penchant lui assignent un autre rôle, non moins beau, non moins noble, et dont, à moins d’une dépravation de l’intelligence, je ne conçois guère qu’elle puisse trouver à se plaindre. La Providence, qui a déposé entre ses bras et attaché à son sein l’enfance de l’homme, ne lui a-t-elle pas donné un amour plus ardent de la progéniture, une industrie sublime pour cette première occupation, et des joies ineffables dont la puissance est un mystère pour la plupart des hommes ? Qui nous peindra les transports d’une mère au premier baiser de son enfant ? Qui nous expliquera comment l’attrait chaste et divin de cette simple caresse la dédommage, au centuple, des labeurs de l’enfantement, des fatigues et des sollicitudes souvent cruelles de l’allaitement ?… Mais, quoi ! la vie de l’homme n’est-elle pas difficile et rude dans la nature comme dans la société ? Tout n’est-il pas incertitude, travail, combat dans sa destinée ? Et ses amours, et ses conquêtes et son repos, tout n’est-il pas acheté de son sang et arrosé de ses sueurs ? Examinons la vie dans son ordre le plus social et en même temps le plus naturel. À commencer par l’amour, l’homme provoque une affection qu’il n’inspire pas encore. Faire partager cet amour est pour lui un combat et une souffrance ; et pour la femme ce n’est encore qu’un examen, qu’une attente, qu’un désir vague plein de fierté douce et de sage retenue. Si le choix est libre et réfléchi, l’union est assortie et paisible. La femme a les fatigues du ménage, et l’époux celles de l’établissement, deux manières diverses, mais également nécessaires et par conséquent nobles, de travailler pour la famille. L’union est-elle troublée (et dans la généralité l’on peut croire que le mal vient des deux côtés), la femme a des consolations certaines, un but bien déterminé ; les joies de la maternité sont immuables pour elle. Quelles que soient les douleurs de son âme, les troubles de sa conscience, les incertitudes de son esprit, le sourire de ses enfants a toujours le même charme ; leurs moindres mouvements recèlent toujours cette magique influence qui répand sur tout l’être maternel une satisfaction céleste. Qu’on ne dise pas que la femme aime l’enfant à proportion de l’amour que lui inspire l’époux ; cela n’est vrai que pour de déplorables exceptions ou pour des âmes malades. Il y a deux natures distinctes dans la femme, celle de l’amante et celle de la mère. L’amante est passionnée, inégale, fantasque, souvent sublime, souvent injuste et souvent infortunée ; la mère est toute équité, toute bonté, toute sérénité.
Elle est animée d’un sentiment angélique, elle se sent revêtue malgré elle, et quelle qu’elle soit par elle-même, d’une mission divine. Elle transmet la vie, et, n’importe la valeur de l’être qu’elle a mis au jour, elle le protège et le conserve. Là est sa grandeur, là est sa gloire. Qu’elle ne cherche pas les joies étrangères, car elles lui feraient négliger la première de toutes.
Poursuivons le parallèle. L’époux que sa femme trahit et tourmente cherche au dehors l’agitation ou la gloire. Vaine ou fondée, cette gloire ne le console pas entièrement. Utile ou dangereuse, cette agitation ne l’étourdit pas toujours. La perte du bonheur domestique est souvent irréparable. L’homme a moins d’amour physique pour la progéniture que la femme ; la sympathie morale est subordonnée à trop de chances pour que ses enfants lui donnent à coup sûr des satisfactions aussi vives que cet amour des entrailles, privilége exclusif de la mère. Sa tendresse, moins aveugle parce qu’elle est moins vive, est plus utile aux enfants, mais elle est moins douce à lui-même ; et forcément il doit attacher plus d’importance à la vie extérieure, aux soucis des affaires, aux faveurs de l’opinion. Ses relations avec la société ont toujours pour but direct ou indirect l’avenir de la famille. Car je prends pour type un homme ordinaire, dépourvu des hautes vertus qui font l’enthousiasme, mais préservé des vices affreux qui détruisent les sentiments humains. Cet homme est arrivé à l’âge où les affections personnelles ont fourni leur carrière ; il sent peu à peu se développer en lui un sentiment plus large, celui qui fait le citoyen, l’amour de la famille en grand, l’intérêt privé sympathique aux intérêts généraux, en un mot, le patriotisme plus ou moins éclairé, plus ou moins généreux. Des liens nombreux se sont formés entre l’individu et la société. Or, il trouve là des occupations attachantes, souvent même des jouissances vives dont la femme aurait le droit d’être jalouse si elle n’en avait de relatives dans la présence assidue et dans l’espèce de possession immédiate de ces êtres qu’instinctivement et moralement elle préfère à tout. Ainsi, tant qu’elle n’est pas opprimée dans l’exercice de ses véritables devoirs, elle trouve dans ces devoirs mêmes la source de ses félicités, ou tout au moins de ses consolations.
Dans la vieillesse, la destinée de l’homme pâlit sensiblement, non parce que les joies matérielles lui échappent : tout se compense ; et, s’il a moins d’aptitude à la vie active, il a en revanche plus de ressources matérielles acquises pour assurer son bien-être, mais parce qu’à mesure qu’il approche du terme de sa vie, il devient moins nécessaire à la famille. Dans cet effacement progressif de l’individu dont la tâche est accomplie, la seule joie qui ne lui échappe pas, c’est l’estime et le respect de la famille sociale et de la famille privée. C’est alors que la progéniture devenue indépendante et l’opinion devenue impartiale récompensent la tendresse paternelle et la conduite civique par une tendresse et une considération proportionnées aux services rendus. Alors, le vieillard s’endort paisible et consolé de sa dure carrière s’il espère que la semence de ses sentiments et de ses idées fructifiera dans une génération sortie de lui et des siens. La mère est moins occupée de la grande famille humaine et de l’avenir des idées que de la vie matérielle des êtres nés de son sein. Elle se console de la mort par la seule certitude de la vie qu’elle a donnée et qui subsiste après elle. Comme la fleur en s’effeuillant mêle son dernier parfum aux parfums naissants des boutons qui s’entr’ouvrent sur sa tige, j’ai vu l’aïeule rustique mourir en échangeant son dernier sourire avec celui de l’enfant qui venait de naître.
Ainsi le rôle de chaque sexe est tracé, sa tâche lui est assignée, et la Providence donne à chacun les instruments et les ressources qui lui sont propres. Pourquoi la société renverserait-elle cet ordre admirable, et comment remédierait-elle à la corruption qui s’y est glissée, en intervertissant l’ordre naturel, en donnant à la femme les mêmes attributions qu’à l’homme ? La société est pleine d’abus. Les femmes se plaignent d’être asservies brutalement, d’être mal élevées, mal conseillées, mal dirigées, mal aimées, mal défendues. Tout cela est malheureusement vrai. Ces plaintes sont justes, et ne doutez pas qu’avant peu mille voix ne s’élèvent pour remédier à ces maux. Mais quelle confiance pourraient inspirer à des juges intègres des femmes qui, se présentant pour réclamer la part de dignité qu’on leur refuse dans la maison conjugale, et surtout la part sacrée d’autorité qu’on leur refuse sur leurs enfants, demanderaient pour dédommagement, non pas la paix de leur ménage, non pas la liberté de leurs affections maternelles, mais la parole au forum, mais le casque et l’épée, mais le droit de condamner à mort ?
Vous m’avez entraîné sur le terrain de la discussion, et j’en ai trop dit sur ce sujet ; je me suis donné trop de peine pour combattre en vous une rêverie qui a pu traverser un instant votre esprit dans un jour de souffrance et d’exaltation maladive. Je me suis bien écarté de mon sujet principal, qui était de vous réconcilier, s’il se peut, avec votre situation personnelle. Vous souffrez de votre isolement. Le mariage, la famille vous présentèrent d’abord un tableau digne de vos plus nobles aspirations, je le conçois. Mais je ne concevrais pas qu’il y eût dans les hallucinations de la vanité féminine un rêve digne de vous. Dans tous les cas, ce rêve est irréalisable, celui de vivre un jour en famille ne l’est pas, et votre malheur présent n’est que l’ennui et l’effroi de l’attente ! Pauvre âme, ayez patience et ne perdez pas courage ; il me paraît très-probable que vous serez appelée par de meilleures circonstances, par la rencontre imprévue de ces bonheurs dont l’ange de notre destinée nous murmure quelquefois le secret à l’oreille, à réaliser votre premier vœu. Si la fortune continue à vous maltraiter, vous serez plus forte qu’elle ; vous tournerez vos aspirations vers des hauteurs sublimes, vous chercherez entre le mysticisme et la philosophie un rôle d’exception, une mission de vierge et d’ange ; si votre âme n’y atteint pas, vous souffrirez longtemps avant de vous résoudre à risquer votre sagesse sur des promesses incertaines, sur des espérances trompeuses. Vous mourrez plutôt que d’accepter la fortune et le plaisir de quelque source impure.
Et n’ayez pas d’amertume contre moi, amie infortunée. Ne dites pas que vous me défiez de joindre l’exemple au précepte. Qu’est-ce que cela prouverait pour ou contre la vérité ? La vérité est immuable ; le culte plus ou moins fidèle, plus ou moins épuré que nous lui rendons, n’altère ni n’augmente sa toute-puissance. Elle est au-dessus de nos négations, comme elle est au-dessus de nos hommages ; c’est une source vive qui ne se refuse jamais à nos lèvres, mais qui ne saurait être tarie et ensablée par notre abandon. D’ailleurs, il faudrait que je fusse bien préoccupé, bien maladroit à exprimer ma pensée, si je vous semblais, en cette circonstance, occupé un seul instant à me prévaloir d’aucune espèce de supériorité sur vous. Je vous l’ai dit, je vous le répète, mon âme est aussi troublée, aussi effrayée que la vôtre ; et, quand je vous exhorte au courage, c’est à nous deux que je parle.
Adieu ! attendez la manifestation de la volonté divine. Il est une puissance invisible qui veille sur nous tous, et, quand même nous serions oubliés, il y a un état de délaissement préférable aux rigueurs de la destinée. Il y a une abnégation meilleure que l’agitation vaine et les passions aveugles. Vous êtes au sein des mers orageuses comme une barque engravée. Les vents soufflent, l’onde écume, les oiseaux de tempête rasent d’un vol inquiet votre voile immobile ; tout éprouve la souffrance, le péril, la fatigue ; mais tout ce qui souffre participe à la vie, et ce banc de sable qui vous retient, c’est le calme plat, c’est l’inaction, image du néant. Mieux vaudrait, dites-vous, s’élancer dans l’orage, fût-ce pour y périr en peu d’instants, que de rester spectateur inerte et désolé de cette lutte où le reste de la création s’intéresse. Je comprends bien et j’excuse ces moments d’angoisses où vous appelez de vos vœux l’heure de la destruction qui seule consommera votre délivrance. Cependant, si les flots pouvaient parler et vous dire sur quels graviers impurs, sur quels immondes goëmons ils sont condamnés à rouler sans cesse ; si les oiseaux des tempêtes savaient vous décrire sur quels récifs effrayants ils sont forcés de déposer leurs nids, et quelles guerres des reptiles impitoyables livrent à leurs tremblantes amours ; si, dans les voix mugissantes de la rafale, vous pouviez saisir le sens de ces cris inconnus, de ces plaintes lamentables que les esprits de l’air exhalent dans les luttes terribles, mystérieuses, vous ne voudriez être ni la vague sans rivage, ni l’oiseau sans asile, ni le vent sans repos. Vous aimeriez mieux attendre l’éternelle sérénité de l’autre vie sur un écueil stérile ; là, du moins, vous avez le loisir de prier, et la résignation de la plus humble espérance vaut mieux que le combat du plus orgueilleux désespoir.
IV
Dans un siècle sans foi et sans crainte, lorsque soi-même on est entraîné par l’esprit d’examen et de doute, il est impossible, dites-vous, de trouver dans le vague des idées religieuses la consolation et la force que nos pères puisaient dans un dogme absolu. Il est vrai, Marcie, que nous traversons une époque fatale, et que, de toutes celles qui enfantèrent des révolutions importantes dans la marche de l’esprit humain, aucune peut-être ne fut aussi féconde en souffrances et en terreurs.
Il y avait naguère encore un dogme et une doctrine, un maître, un législateur, un Dieu ami, et de là un culte, un commerce direct et brûlant entre les âmes d’élite et celui qu’on appelait le Fils de l’homme. La foi a perdu son mystère ; l’homme a contesté au maître et à l’ami son humble et ineffable divinité. Les rares chrétiens ont disparu de notre chevet, les pieds de Jésus n’ont plus reçu les baisers des vierges, les plis du voile sans tache de Marie n’ont plus essuyé les larmes des solitaires. L’homme a dit au Christ : « Je n’ai plus besoin de toi, je suis assez sage, assez fort ; garde tes miracles pour les simples, réserve tes préceptes pour les faibles, présente ton hostie aux lèvres des petits enfants ; pour nous, il nous faut un Dieu plus neuf, une philosophie plus facile, une éducation plus rapide. Ton temple est vieux, ton culte est usé ; ton nom sert de glaive et de bandeau dans la main des princes de la terre. Tes prêtres ont scellé de la croix et des insignes de tes martyrs la vente de nos âmes et de nos vies ; ils ont fait servir ta parole à épaissir les ténèbres de notre entendement. Sois donc le Dieu des despotes et le Dieu des esclaves ; nous voulons être libres. S’il faut passer par l’athéisme, s’il faut renverser ton Calvaire et maudire ton père Jéhovah, nous le ferons plutôt que de rester courbés sous des lois iniques et sous un fouet sanglant. »
Et ainsi, tandis que des prêtres impies livraient de nouveau le Christ aux pharisiens, les fidèles trompés et découragés abandonnaient leur maître, et la foule resta sans doctrine et sans loi. Ce qu’on appela dès lors la philosophie fut l’absence de toute philosophie, car avec le christianisme on perdit le précepte de toute morale sentie et raisonnée, et l’habitude de veiller humblement sur moi-même, si salutaire, et qu’aucune sagesse ne peut remplacer. Quelques hommes essayèrent de faire revivre d’antiques doctrines, saints monuments des temps antérieurs au christianisme, mais insuffisantes après lui, et n’apportant pas plus d’éléments de vie que des cadavres exhumés du cercueil. Il n’était pas donné à la raison humaine de rompre la chaîne des temps. La logique inflexible de l’éternel mouvement entraîne nos intelligences vers l’avenir. Si nous devons saluer le passé avec respect, nous ne pouvons pas rétrograder vers lui. Comment Épicure et Platon, comment Zénon et Épictète pourraient-ils éclairer le christianisme, dont la seule sagesse les résume et les perfectionne tous ?
L’étude de ces vieux maîtres était bonne par elle-même ; mais la chaleur factice que ces mânes illustres pouvaient nous rendre un instant fit bientôt place au froid du tombeau. Nous sentîmes leurs reliques tomber en poussière, tandis que la voix du Christ criait encore au fond de nos âmes et que son sang coulait toujours, rare, mais chaud et vivifiant, des veines de la Montagne sainte. Un instant nous vîmes Rome et Sparte secouer leurs fantômes héroïques sur le monde des vivants. De grands actes de délivrance s’accomplirent sous leurs auspices, mais leurs vastes linceuls ne furent pas longtemps à notre taille. Les exploits homériques de l’empire napoléonien ajoutèrent encore quelques jours d’illustration à notre rêve d’antiquité. Puis, après les guerres de la délivrance et celles de l’ambition, l’homme retomba des enivrements de la gloire dans les soucis de la réalité. Il se retrouva en présence d’un Dieu longtemps oublié qu’il ne savait plus ni invoquer ni entendre. Il n’y avait plus de médiateur entre le ciel et la conscience humaine. Les anciens rois et les anciens prêtres revenaient en procession solennelle et ridicule, portant sur leur bannière un Christ souillé et défiguré, une idole honteuse revêtue des emblèmes divins, Baal effrontément courbé sous la couronne d’épines, sous le bois sacré de la croix, apportant aux hommes la servitude et l’abrutissement au nom du Père des hommes et du Sauveur des nations. Plus que jamais dégoûtés du mensonge, nous nous sommes retrouvés face à face avec nous-mêmes, avec un nouvel homme, vide de foi et de volonté, avec un spectre qui revendiquait pour substance la fange de la matière, pour pères les dieux les plus aveugles et les plus grossiers, les monstres que Jupiter et Brahma n’avaient pu terrasser, et dont le Christ délivra l’humanité tremblante, le Hasard et la Fatalité.
Voilà les fétiches hideux que nous sauvâmes dans le naufrage ; et voilà pourquoi nous sommes une génération infortunée, une colonie errante dans l’infini du doute, cherchant comme Israël une terre de repos, mais abandonnée, sans prophète, sans guide, sans étoile, et ne sachant même pas où dresser une tente dans l’immensité du désert.
Voilà aussi pourquoi l’ennui nous dévore, les passions nous égarent, et le suicide, démon des ténèbres, nous attend à notre chevet ou nous attire le soir sur le bord des eaux. Nous n’avons plus de fond solide pour y jeter l’ancre de la volonté, et cette ancre inutile s’est brisée dans nos mains ; nous avons perdu la garde de nous-mêmes, l’empire de nos affections, la conscience de nos forces. Nous doutons même de notre existence éphémère, de notre rapide passage sur cette terre maudite, et on nous voit sans cesse arrêtés devant le spectacle de notre propre vie comme un homme qui s’agite dans la fièvre et s’éveille en criant : « Que signifie ce rêve ? »
Voilà où nous en sommes venus, ô Marcie, et voilà pourquoi, vous et moi, nous sommes accablés du poids de l’existence comme si l’ordre de l’univers était troublé, comme si l’homme et le monde se trouvaient tout à coup en désaccord et venaient donner un démenti à la sagesse de Dieu. Mais il y a une grande loi des esprits semblable à celle du cours des fleuves ; c’est une marche éternelle qui détruit tout pour tout renouveler, ou, pour mieux dire, qui emporte tout pour tout replacer ; car rien ne se détruit que ce qui est faux, et tout ce qui est vrai subsiste éternellement. Le malheur des temps présents est un hommage terrible mais éclatant rendu à la vérité. Si nous l’avions étouffée gaiement dans nos cœurs, si nous étions descendus avec sincérité dans les abîmes du doute, si nous avions perdu la foi sans gémir et sans blasphémer, il serait prouvé que Dieu n’est pas nécessaire à l’homme, et alors Dieu ou l’homme n’existerait pas. Mais nous souffrons, mais nous nous sentons pleins de terreur et de colère, et les hommes des faux biens souffrent plus encore sous leur masque et derrière leur forfanterie que nous, rêveurs et poëtes, dans nos détresses solitaires. Et toute cette douleur est un autel qui s’élève, c’est un chant barbare encore et féroce comme le furent dans un autre ordre d’idées ceux des druides, et pourtant c’est un hymne à la vérité. À travers nos souffrances et nos délires, nous ne pouvons plus concevoir qu’un Dieu irrité, ennemi de l’homme, et, pour l’apaiser, nous lui offrons des hécatombes sinistres, les larmes de nos nuits sans repos, le sang de nos cœurs sans espoir. Le suicide immole encore des victimes humaines dans la nuit et dans l’orage.
Mais le nuage sombre qui voile la face du Seigneur se dissipera ; ne regardons pas en arrière, ne nous arrêtons pas où nous sommes. Si nous ne pouvons marcher, traînons-nous. Tant qu’il y aura de l’espace devant nous, il y aura aussi de l’espérance ; quelque effrayante que soit notre situation, luttons contre elle ; quelque éloigné que paraisse le terme, soyons sûrs qu’il importe beaucoup d’avoir fait un pas pour s’en rapprocher, fallût-il rester encore trois cents ans dans le désert, puisque le moindre terrain gagné amène l’accomplissement des desseins providentiels et prépare le sentier à la génération qui nous suit.
Quel remède en effet assigner à la perte de nos croyances ? Autant vaudrait essayer d’arrêter le vol brûlant des comètes que d’espérer retenir dans sa chute un trône ou un temple qui s’écroule. L’humanité procède historiquement, en vertu de son libre arbitre ; et la souveraine intelligence qui la gouverne l’abandonne à toutes ses chances d’erreur et d’infortune, parce qu’elle l’a douée d’un principe vital qui ne périt point, parce qu’elle sait que la vérité renaît toujours de ses propres cendres et que l’on ne l’enterre pas sous des ruines. Jamais, quoi qu’on fasse, on ne détruit l’esprit de vie des religions ; on ne brise que de vains simulacres, on ne souille que des vêtements, on n’altère que des formes extérieures. L’humanité tombe un instant haletante et comme épuisée ; puis elle reprend courage et se relève aussi ardente à rebâtir qu’elle le fut à détruire ; elle répare, quand les jours de santé sont revenus, le mal qu’elle a fait dans les jours de délire. Elle reconstruit tous les édifices, et c’est toujours à l’Éternel, à la perfection et à la vérité qu’elle les dédie. Elle rejette tous les mauvais matériaux et tous les faux procédés qui causèrent la ruine de l’œuvre ancienne, et, faisant usage d’éléments mieux éprouvés, elle rétablit promptement un nouvel ordre approprié à ses besoins nouveaux. Ainsi, sous les régions tropicales, la nature robuste et généreuse recommence son travail après de grands orages, et l’on voit la végétation, pressée de réparer le temps perdu, reverdir en un jour et cacher sous un luxe magique les désastres de la veille.
Laissez-vous soutenir au sein de votre désespoir par une mâle certitude, par une sévère consolation. Vous êtes un holocauste nécessaire ; vos larmes ne tomberont pas en vain sur cette page de l’histoire religieuse. Ces larmes précieuses des âmes mystiques fécondent un germe de salut. Vous n’êtes point impie pour avoir donné accès en vous au scepticisme du grand poëte. Byron est entre le passé et l’avenir de la foi un lien rude et sanglant, mais entier et solide. C’est un de ces ponts d’enfer qu’on rencontre dans les montagnes près des cimes, et qui sont jetés sur des gouffres. Ils sont perdus dans les nuées du ciel autant que dans la fumée des cataractes, et, quoique ébranlés par la furie du torrent, ils ne sont point emportés et scellent les deux lèvres de l’abîme par un arc de granit. On les traverse en tremblant ; quelques-uns y sont saisis de vertige et se précipitent d’en haut ; d’autres disent : « Il faudrait briser ce pont, œuvre téméraire, insensée, impie, qui leurre le voyageur et brave les éléments. » Mais ces esprits faibles ne songent pas qu’il faut arriver à l’autre bord. Car, dans ce pèlerinage des temps, il n’est pas permis de reculer, et les chemins qui vous conduisent sont enlevés par les orages aussitôt que vous y avez passé. Traversez donc hardiment. Le scepticisme est le défilé périlleux que nous ne sommes plus libres de tourner ; les hommes sans tête et sans cœur y périssent, les hommes vaillants et forts s’y engagent sans se demander comment ils en sortiront ; ils portent l’arche d’alliance des générations futures, et la voix du Seigneur leur crie d’avancer sans regarder à leurs pieds.
Eh bien, il est vrai, nous n’avons plus de culte, nous prions sur les montagnes et dans les forêts, car nos temples sont renversés et profanés. Nous errons parmi les abîmes, et nous les franchissons souvent sur des planches qui tremblent sous nos pieds. Dans ce dur pèlerinage, nos rites se sont perdus, et nous avons oublié jusqu’à la formule de nos prières ; nous n’osons plus invoquer Jésus, nous craignons qu’il ne soit pas assez Dieu pour nous absoudre. Nous n’osons invoquer Jéhovah, nous craignons qu’il ne soit trop grand pour nous entendre ; trop orgueilleux ou trop humbles avec la Divinité, n’ayant plus ni règles, ni mesure, ni communion, ni symbole, nous faisons entendre sur nos sentiers perdus de grands cris de détresse, prière instinctive qui monte aux cieux, non plus comme un cantique, mais comme un sanglot.
Heureux ceux qui n’ont pas douté ! quelques élus ont marché sans crainte et sans fatigue par des chemins bénis ; ils ont gravi des pentes douces à travers de riantes vallées. Conduits par l’étoile mystérieuse de l’espérance, ces justes ont franchi le temps et les révolutions sans être un seul instant ébranlés dans leur sainte confiance. Ils ont dépouillé sans effort ni terreur le fond de la forme, l’erreur du mensonge ; ils ont tendu la main à ceux qui tremblaient, ils ont porté dans leurs bras les débiles et les accablés. Déjà ils pourraient sans doute formuler le christianisme futur, si le monde voulait les écouter ; et, quant à eux, ils ont placé leur temple sur les hauteurs au-dessus des orages, au-dessus du souffle des passions humaines. Ceux-là ne connaissent ni indignation contre la faiblesse, ni colère contre l’incertitude, ni haine contre la sincérité. Peut-être l’avenir n’acceptera-t-il pas tout ce qu’ils ont conservé des formes du passé ; mais ce qu’ils auront sauvé d’éternellement durable, c’est l’amour, élan de l’homme à Dieu ; c’est la charité, rapport de l’homme à l’homme.
Quant à nous qui sommes les enfants du siècle, nous chercherons dans notre Éden ruiné quelques palmiers encore debout, pour nous agenouiller à l’ombre et demander à Dieu de rallumer la lampe de la foi. Nous tâcherons de sauver dans nos croyances passées quelques-unes de ces grandes sympathies poétiques, filles de l’enthousiasme, mères de la vérité. Là où notre conviction restera impuissante à percer le mystère de la lettre, nous nous rattacherons à l’esprit de l’Évangile, doctrine céleste de l’idéal, essence de la vie de l’âme. Avec cet aliment sain et robuste, cette morale toute tracée et si facile à ramener à son vrai sens, avec le charme de cette philosophie chrétienne qui se rattache à ce qu’il y a de plus beau et de plus pur dans les philosophies antérieures, avec la ferme volonté de tout sacrifier à l’amour et à la recherche de la vérité, je pense que nous pouvons atteindre à une sorte de calme ou du moins à un grand rassérénement de l’âme. Comment la pureté, ou tout au moins l’épuration de la conscience, ne conduirait-elle pas à la lucidité de l’esprit, à un meilleur équilibre du caractère ? Avant de nous formuler une doctrine, sans doute il nous faudrait atteindre naïvement et sincèrement le premier point. C’est peut-être tout ce que pourra faire cette génération, et c’est déjà beaucoup. L’existence d’un Dieu-Perfection nous est si intimement révélée, qu’elle ne peut être révoquée en doute dans l’état de santé morale. Pour guérir les athées, il ne faudrait peut-être qu’observer une hygiène intellectuelle, combattre l’orgueil, la sensualité, l’égoïsme, entrer de bonne foi dans une réforme douce et graduée, suivre, en un mot, ne fût-ce que comme essai, un régime d’esprit et de corps. Je crois qu’au bout de peu de temps et à leur propre insu d’abord, ce besoin de croire et d’aimer reviendrait naturellement germer dans leur sein. De ce besoin à la puissance de le satisfaire, il y a une progression infaillible, pleine de charmes, que beaucoup d’entre nous ont connue, soit dans la guérison de quelque passion funeste, soit au déclin de quelque maladie physique. La nature opère et renouvelle le miracle de vie dans le monde de l’esprit comme dans celui de la matière. De même que le grain de blé devient un épi sous l’influence mystérieuse des éléments, de même la semence divine fructifie rapidement dans le cœur de l’homme au souffle vivifiant d’une invisible sollicitude.
Pour vous, Marcie, qui croyez et qui aimez, la seule inquiétude est de trouver un cadre qui resserre vos principes et les fortifie en les résumant. C’est là ce que vous regrettez amèrement dans ce catholicisme auquel vous dites cependant ne pouvoir retourner ; faute de cette formule, malgré des idées saines, de nobles instincts et une vie pure, vous vous sentez atteinte d’une sorte de vertige, et votre conscience est ébranlée. La plupart des femmes sont dans ce cas, Marcie, et à cet égard elles montrent beaucoup plus d’insouciance ou beaucoup plus de regret que les hommes. Une légèreté naturelle les livre aisément à l’oubli de toute religion, ou bien une extrême sensibilité leur fait sentir le besoin impérieux d’un culte ; à ces dernières, il faut la splendeur des rites, les émotions du sanctuaire, la richesse ou la grandeur des temples, ce concours de sympathies explicites, l’autorité du prêtre, en un mot tout ce qui frappe l’imagination et satisfait ou irrite le sens pratique, si développé et en même temps si délicat chez elles. Il y a dans ce luxe d’organisation quelque chose de trop excitable et qu’il serait bon peut-être de contenir ou de modifier. Il faudra que les femmes sachent renoncer à faire du culte un spectacle. Il serait bon déjà, pour celles qu’une foi naïve et sans doute respectable ne tient plus sous le joug des pratiques minutieuses, de s’habituer à un culte plus mâle, à des communications plus directes, plus intimes avec la Divinité.
Encore une fois, je n’oserais arracher du pied des autels une âme croyante et soumise, pour l’initier à un examen dont elle n’aurait pas senti le besoin. Mais à vous, Marcie, qui avez cru devoir secouer la poussière du parvis sur les dernières marches de l’église, je crois pouvoir vous donner un conseil qui me semble faire partie de la sagesse du siècle présent : c’est de ne vous astreindre à aucune formalité aveugle, et pourtant de vous faire des habitudes soutenues et une règle constante dans l’exercice de la foi. Prière en inspiration, méditation, lecture, examen quotidien de la conscience, travail assidu pour combattre les mauvais penchants et tendre à la perfection. C’est de ne fermer l’oreille ou l’esprit à aucune nouvelle philosophie, de quelque forme qu’elle soit revêtue. Il est important, à une époque où tout cherche à réorganiser les lois de la conscience, de connaître et de juger tous les efforts qui tendent à ce but de bonne foi. Chaque siècle porte en soi les germes qui doivent en se développant alimenter les siècles futurs. C’est donc encore un devoir pour tout être intelligent d’examiner et d’analyser ces germes avant qu’ils éclosent, afin de séparer l’ivraie du bon grain, et d’aider à la fécondation de la pure semence. C’est en cela que, faute de prêtres intelligents et sincères, nous sommes tous prêtres et devons exercer un ministère humble et zélé, chacun dans la mesure de nos forces et dans l’étendue de nos attributions. Ne vous découragez donc pas, Marcie, et ne déplorez plus ni votre isolement ni votre inaction. Pour quiconque sent vivre en son cœur le principe de la fraternité humaine, il y a des devoirs à accomplir, des conseils à donner ; et, pour nous tous qui sommes les créatures de Dieu, il y a des droits à ressaisir, un libre examen à exercer.
Puisque Dieu a placé notre vie entre une foi éteinte et une foi à venir, puisque le prêtre qui tenait sur ses genoux le livre de la destinée humaine n’a pas voulu tourner le feuillet et nous lire la seconde parole du Seigneur, Marcie, il est temps de pourvoir à nos pensées et à nos actions. Ce qui a péri avait sa raison de périr, n’allons donc pas nous lamenter. S’il est encore des âmes croyantes, laissons-les s’endormir, pâles fleurs, parmi l’herbe des ruines ; mais l’homme ne vit et ne marche qu’avec une idée, un désir, un but. Quand les oracles se taisent, l’homme s’interroge lui-même et frappe aux portes de la vie éternelle. Dans un passé, aujourd’hui poussière, ronce et ortie des tombeaux, cherchons si la mort a pu vivre, si la destruction a pu durer. Évidemment non. Ce qui a duré, c’est le devoir et le dévouement que le Christ a divinisés ; le bien, le bon, le beau, n’attendent pas pour éclore un soleil qui ne s’est pas levé. Ce bien, son but et son idéal ne sauraient changer à chaque pas que fait l’humanité ; autrement, où irait-elle éternellement, si ce n’est vers un leurre éternel ? Tenons-nous-en à cette loi des siècles, si bien résumée par le christianisme, car elle a duré et elle durera. Ne refaisons pas nos vies d’après un type inconnu encore à créer, si nous voulons trouver l’accord tant cherché de la vie sociale et de la tradition divine. Par la vertu, nous arriverons à la vérité ; nous voulons vivre, nous devons vivre : or, la vie pour la famille humaine, c’est la foi, c’est la charité. Or, cette vie ne peut se réaliser qu’à la condition d’une règle chez l’individu, d’une préparation sérieuse à la bonté, au sacrifice. Du jour où nous aimerons, nous serons religieux et Dieu nous visitera.
Marcie, il est une heure dans la nuit que vous devez connaître, vous qui avez veillé au chevet des malades ou sur votre prie-Dieu, à gémir, à invoquer l’espérance : c’est l’heure qui précède le lever du jour ; alors, tout est froid, tout est triste ; les songes sont sinistres et les mourants ferment leurs paupières. Alors, j’ai perdu les plus chers d’entre les miens, et la mort est venue dans mon sein comme un désir. Cette heure, Marcie, vient de sonner pour nous ; nous avons veillé, nous avons pleuré, nous avons souffert, nous avons douté ; mais vous, Marcie, vous êtes plus jeune ; levez-vous donc et regardez : le matin descend déjà sur vous à travers les pampres et les giroflées de votre fenêtre. Votre lampe solitaire lutte et pâlit ; le soleil va se lever, son rayon court et tremble sur les cimes mouvantes des forêts ; la terre, sentant ses entrailles se féconder, s’étonne et s’émeut comme une jeune mère, quand, pour la première fois, dans son sein, l’enfant a tressailli.
V
Chère Marcie, je suis profondément touché de la déférence que vous accordez à mon avis, et je serais aujourd’hui plein d’orgueil, s’il y avait pour vous dans mon cœur place à un autre sentiment que l’affection. Il faut qu’en cherchant de bonne foi quelle était pour vous la meilleure destinée, j’aie rencontré juste en quelque point, car votre réponse est remplie d’une confiance qui m’honore et d’une émotion qui me pénètre. Que tout l’honneur en revienne à la vérité dont la puissance se manifeste quelquefois par les organes les plus indignes !
Mais vous allez plus loin que je ne voudrais ; en plus d’un endroit, vous avez mal saisi le sens de mes paroles (la faute en est à mon insuffisance), ou bien votre esprit ardent et généreux s’est élancé au delà de ma pensée, et la faute en est encore à moi, car j’aurais dû prévoir qu’avec une âme comme la vôtre, il y aurait excès de force dans l’enthousiasme, comme il y avait un excès de sensibilité dans la douleur.
Non, mon amie, jamais ma pensée n’a été de vous amener à un renoncement éternel, et, si je n’espérais obtenir encore un peu de votre confiance, je serais effrayé de voir éclore en vous ce dessein extrême. Mais vous y réfléchirez et vous ne prononcerez pas un vœu téméraire, insensé, dans la position où vous êtes.
Je ne m’attribue pas tout l’honneur ni tout le danger de ce que vous appelez si gracieusement, Marcie, votre conversion. Je pense que, le hasard vous ayant conduite au couvent des Bénédictines de X…, le tableau si poétiquement tracé par vous de cette vie monastique vous a frappée plus encore que mes amicales démonstrations. Cette vie est belle en effet pour un artiste, et je conçois que vous ayez été sensible à tout ce charme mis en relief peut-être avec quelque habileté naïve pour vous séduire et vous attirer. Mais remarquez à quelles conditions cette vie est possible. Remarquez quelle faible déviation à l’orthodoxie peut la rendre tout à coup odieuse et impraticable.
Depuis longtemps, vous avez dépouillé ce vêtement des religions qu’on appelle le culte ; je ne vous ai jamais rien enseigné ni rien conseillé à cet égard. Vous ne m’avez jamais consulté et vous avez tranché librement la question, élaguant de vos croyances tout ce qui n’avait plus de pouvoir sur vous. Si j’ai essayé dernièrement d’exhumer de votre cœur tout ce que vous avez sauvé et enseveli des débris du vieil édifice, et de le rattacher aux hardies conceptions de l’édifice nouveau, c’est dans la certitude que je ne pouvais rien vous ôter ni rien vous donner ; vous êtes ce que vous vous êtes faite vous-même, selon les conseils de votre sagesse ou les nécessités de votre destinée. Que feriez-vous donc dans un couvent avec cette liberté d’examen et ce droit d’interprétation auxquels vous ne sauriez certainement plus renoncer ? Vous savez bien que la fidélité au serment ne tient pas tant à la force personnelle de l’homme qu’à la sainteté du serment en lui-même. Le jour où un vœu réputé nécessaire et sacré tombe dans le domaine de l’examen, s’il lui arrive d’être regardé comme inutile et vain, la conscience fait bien vite bon marché des formules et des solennités de l’engagement ; si le vœu est injuste ou impossible, elle sait que Dieu l’a repoussé et qu’il n’a point été enregistré dans les archives célestes ; s’il n’est que puérilement orgueilleux, s’il ne produit qu’une vertu de luxe, une superfluité de sagesse, on se flatte que Dieu pardonne la rupture et consent à l’effacer du livre divin ; en un mot, pour garder un tel vœu, il faut croire aveuglément et s’incliner devant les mystères du dogme, ou bien il faut s’être formulé un dogme personnel tellement éclairé, tellement épuré, tellement acceptable, qu’on ne craigne plus d’avoir à y revenir et à le renverser pour le premier perfectionnement venu. Or, vous n’êtes, Marcie, ni dans le premier ni dans le second cas. Votre catholicisme est tombé dans les ténèbres du doute. Votre christianisme est à son aurore de foi et de certitude. Vous cherchez la lumière et l’enseignement, vous ne les trouverez point chez moi. Mais, si vous les cherchez au couvent, vous les y trouverez encore moins, car on abaissera sur votre visage un voile épais, et l’on vous dira que ce voile doit fermer à jamais les yeux de votre corps au spectacle des passions humaines, et ceux de votre intelligence à l’esprit de la lettre sacrée. Vous le promettriez en vain, l’intelligence transplantée sur certaines hauteurs ne peut plus redescendre. Quoique les cimes soient perdues dans les nuages, elle les préférera désormais au séjour de la terre. Elle se précipiterait en vain, tête baissée, dans de muets abîmes, elle en ressortirait bientôt, ou ébranlerait son refuge dans les convulsions terribles de son agonie.
Enfin, vous le savez, vous le déclarez vous-même, vous ne pouvez rentrer sous cette loi du passé. Votre désir d’être religieuse s’exprime comme un regret parce que vous sentez qu’il faudrait porter dans le cloître une âme aveugle et soumise ; mais ce que vous semblez vous proposer, ce vœu d’abstinence que vous êtes tentée violemment, dites-vous, de prononcer dans le secret de votre cœur, afin de mettre entre les vaines espérances et vous une barrière insurmontable, me paraît un remède pire que la mort.
D’abord, je vois dans votre avenir beaucoup de fondement à réaliser ces espérances de mariage et de maternité que je n’appellerai pas vaines, car elles sont justes et saintes, et Dieu sans doute les exaucera. Ensuite, je sais que, s’il ne le fait pas, il vous en dédommagera magnifiquement ; car la vertu trouve sa récompense en elle-même et en Dieu, qui sont une seule et même essence divine. Il vous fera entrer dans une voie de perfection que vous devez attendre et accepter, et non provoquer par l’impatience. Vous connaîtrez alors ces joie suprêmes de la sagesse victorieuse, ces mâles voluptés de l’abstinence, dont parle un grand écrivain moderne. Cette quiétude de l’âme, cette force du sentiment et de l’intelligence dans la vie ascétique, sont à coup sûr la condition la plus noble et la plus précieuse que l’esprit humain puisse attendre. Mais c’est une destinée d’exception, une sorte de prêtrise libre et sublime que Dieu consacre dans le mystère, en versant sur certaines têtes d’élite tous les parfums de son amour, tous les bienfaits de son adoption. Mais où seront ceux qui oseront prétendre à cette intimité avec la perfection céleste, à cette fusion avec l’infini, sans avoir mérité de telles faveurs par de rudes combats, par de longues souffrances ? Quel esprit audacieux s’imaginera qu’il suffit d’entrer dans le temple et de soulever le voile du sanctuaire pour embrasser la divinité ! Il faut passer bien des jours et bien des nuits à genoux sur les marches du parvis, il faut avoir affronté bien des soleils dévorants, essuyé bien des pluies glacées, avoir été battu par l’orage, courbé jusqu’à terre par le vent, ou bien il faut n’avoir pas eu un instant de faiblesse, une heure de langueur et de doute dans sa vie ; il faut n’avoir rien commis ou tout expié, pour oser se présenter à la communion intime de la haute sagesse et de la haute piété. Si telle est votre ambition, Marcie, songez que c’est une ambition subite, ardente, audacieuse, et qu’à votre point de vue religieux et philosophique, il n’est peut-être donné aujourd’hui à dix personnes de réaliser. Ces épreuves terribles que les prêtres de Memphis faisaient subir à leurs adeptes avant de leur révéler les mystères sacrés sont une image de la persévérance et de l’humilité qui devraient préluder à de telles initiations.
D’ailleurs, il faudrait savoir si de semblables résolutions sont possibles à soutenir sans le concours des circonstances extérieures, sans une règle, sans une volontaire captivité, sans l’appareil des monastères, sans la consécration du vœu formulé, sans l’appui, l’aide et la force toujours éveillée d’une autorité matérielle solidaire envers le monde. L’Église catholique a jugé ces contraintes domestiques et sociales nécessaires à l’observation des vœux, et, voulant admettre tous ses lévites à l’état sublime de virginité, elle a dû procéder par tous les moyens pour éviter le scandale des chutes ou pour cacher le désespoir des regrets.
Il ne m’appartient pas d’examiner une question aussi grave que serait celle de la nécessité de ce vœu chez le prêtre. Pour ma part, j’y ai toujours cru, même dans les plus superbes jours d’examen et de doute ; mais, outre que je n’oserais rien trancher à cet égard, il n’importe aucunement à notre sujet. Vous voulez disposer de votre sort par un vœu séculier, en dehors d’une religion formulée. Je crois que la chose n’est ni utile ni possible. Permettez-moi d’ailleurs de vous dire, Marcie, que ces volontés extrêmes, ces aveugles élans vers un but auquel il na faudrait songer qu’en frissonnant, ne sont pas la marque certaine d’une véritable guérison. Ce sont des rayons de soleil vers la fin de l’orage, des fleurs épanouies aux approches du printemps. Mais il y aura encore des bourrasques terribles, il y aura de sombres nuits d’hiver. Tenez-vous en garde contre ces réactions, vous ne les éviterez pas ; sachez les supporter sans désespoir de voir renaître le calme et recommencer l’été. Combien ne seriez-vous pas troublée et épouvantée si de nouvelles crises survenaient après un serment où votre conscience et votre raison se trouveraient engagées au delà de vos forces ! Ne jurez pas, Marcie, ne jurez pas ! Le destin peut sourire et la vie venir comme une coupe de miel s’offrir à vos lèvres pures. Aliéner la liberté de répondre aux secrets desseins d’une Providence dont vous n’avez pas le droit de douter, ce serait presque un crime. Je ne vous ai cité l’exemple d’Arpalice que pour vous montrer quelles douceurs peut offrir le célibat quand on a de fortes raisons pour s’y dévouer ; mais ces raisons n’existent pas pour vous, et vous n’avez pas conservé la foi naïve qui animait cette jeune fille : vos principes doivent vous suggérer des desseins moins romanesques, mais plus réfléchis. De toutes les résolutions, la plus héroïque est justement celle que vous avez à suivre. Il s’agit d’attendre, et c’est en effet ce que l’homme supporte le plus difficilement dans toutes les positions. Agir contre sa souffrance ne demande que de l’énergie ; la subir quand on ne peut agir contre elle, c’est le fait de la force. Il est aisé, dans un jour d’enthousiasme, de disposer de soi et de sacrifier un avenir qui se présente sous la forme d’un rêve. Mais gouverner ses passions et ses volontés, jour par jour, heure par heure, recommencer chaque matin un ouvrage menacé et troublé chaque jour, reprendre au réveil une chaîne pesante, s’endormir tous les soirs en rattachant les anneaux de cette chaîne sans cesse brisée, ne se haïr et ne s’enorgueillir jamais, prendre patience avec soi-même, tendre le dos aux coups de la tempête en ne désespérant jamais de toucher le port, c’est là une grande tâche, et ne croyez pas que vous pussiez la supporter si on vous ôtait le désir d’un état plus doux. Vous tomberiez dans une inertie dont la nature a horreur et contre laquelle elle proteste en retournant au néant. Si vous n’aviez pas cette espérance parfois amère et irritante, votre souffrance ne se sentirait pas ennoblie. Allez, la souffrance est bonne, la douleur est sainte quand on sait les accepter comme des épreuves venant d’en haut. Il est également coupable d’en provoquer et d’en éviter les atteintes. Le destin n’est impitoyable qu’à ceux qui entrent en révolte contre lui.
Et, après tout, soyez de bonne foi. Cet état de l’âme où la douceur de l’espoir et le stoïcisme de l’abnégation tiennent la balance égale n’est pas dépourvu de joies secrètes et de mystérieux triomphes. Il y a de chastes rêves où l’objet des regrets et des désirs apparaît sous des formes angéliques, plus beau mille fois qu’il ne le fut ou qu’il ne le sera dans la vie réelle. Il y a des mouvements de fierté légitime où le témoignage d’une conscience pure nous défend et nous venge de la vaine compassion d’un monde insensé. Il y a surtout des heures d’effusion où l’âme, victorieuse de ses épreuves, croit sentir le regard de Dieu se poser doucement sur elle et l’inonder d’une chaleur vivifiante. Ces lueurs sont fugitives ; elles traversent rarement nos ténèbres. Telle est la volonté du ciel. Nul homme ne voudrait vivre et souffrir avec ses semblables s’il lui suffisait de se retirer du bruit et de se mettre à genoux pour recevoir l’ineffable rosée de l’amour. Mais à ceux qui acceptent la vie d’ici-bas telle qu’elle est imposée, à ceux qui boivent humblement un calice inévitable, Dieu se manifeste assez souvent et assez sensiblement pour que l’âme attristée se ranime, tressaille, s’attendrisse et continue sa route sur le dur sentier en se disant que Dieu la regarde et ne la laissera pas périr.
Ô mon Dieu, ô lumière, ô sagesse, d’amour ! quand ton esprit passe, quelles sont ces larmes inattendues que le parfum d’un lis ou le chant d’un insecte attirent sur nos paupières desséchées ? Après nos nuits d’angoisse, quand la sagesse humaine, lasse d’arguments sans conviction et de conseils sans puissance, tombe vaincue et brisée sous le poids de nos douleurs, quel est ce frisson inconnu qui parcourt nos veines et ce réveil de la confiance qui lève impérieusement nos bras vers toi, comme si nous avions senti ton souffle agiter l’univers ? Pourquoi le vent qui froisse les roseaux et courbe les saules emporte-t-il notre angoisse comme une feuille sèche qui se perd dans l’espace ? Quel pouvoir la brise du crépuscule a-t-elle sur mon esprit et sur mes sens ? Pourquoi cette étoile qui va s’éteindre jette-t-elle tout à coup un éclat si vif, que mon espoir s’envole vers elle et me fait bondir d’une joie insensée ? Qu’y a-t-il de commun entre ce soleil perdu dans les abîmes de l’infini et moi, atome indiscernable, rampant à la surface d’un monde roulant dans les ténèbres ? Ô étoile, me verrais-tu, me connaîtrais-tu, m’aimerais-tu ? Ô vent du matin, est-ce à moi que tu parles ? Ô mes yeux, quelle main invisible a rouvert vos sources taries ? Ô mes bras, quels fantômes avez-vous cru embrasser en vous dressant tout à coup vers le ciel ?…
Ô Marcie ! certains élans de l’âme, rapides comme l’éclair et vagues comme l’aube, suffisent à calmer ces lentes douleurs qui nous rongent, à faire crouler cette montagne de plaintes et d’ennuis si péniblement entassée durant nos lâches révoltes. Nous ne voyons pas d’où découle le baume, nous ne pouvons conserver la manne divine au delà du temps nécessaire pour ranimer nos forces et nous empêcher de mourir ; mais elle tombe chaque jour dans le désert ; et, quand nous doutons de la main qui la verse, c’est quand nous avons négligé de l’invoquer, c’est quand nous avons oublié de purifier le vase que le Seigneur a commandé de tenir toujours prêt à recevoir ses dons.
Marcie, ne promettez pas, demandez ; ne refusez pas, acceptez ; ne doutez pas, priez.
VI
Les femmes, dites-vous, ne sont pas philosophes et ne peuvent pas l’être. Si vous ramenez le mot de philosophie à son sens primitif, amour de la sagesse, je crois que vous pouvez, que vous devez cultiver la philosophie. Je sais qu’aujourd’hui on donne le titre de philosophes aux hommes les moins voués à la pratique de la force et de la vertu. Il suffit qu’on ait étudié ou professé la science des sages, ou seulement qu’on ait rêvé quelque système de législation fantastique, pour être gratifié du titre que portèrent Aristote et Socrate. Mais l’œuvre de la philosophie est ouverte à vos regards, et vous pouvez y puiser tous les secours dont votre âme a besoin. C’est une œuvre immense, éternelle ; une sorte d’encyclopédie de l’intelligence commencée avec le monde, et à laquelle le progrès de chaque siècle, résumé par la parole ou l’action de ses grands hommes, vient apporter son tribut de matériaux. Ce travail ne finira qu’avec la race humaine, et il faudrait nier la raison et la vérité avant de prouver que cette seule vraie richesse, ce seul légitime héritage de l’humanité n’est accessible qu’à certains élus. Chaque âge, chaque sexe, chaque position sociale y doit trouver un aliment proportionné à ses forces et à ses besoins. On enseigne la philosophie aux jeunes garçons ; on devrait nécessairement l’enseigner aux jeunes filles.
Je sais que certains préjugés refusent aux femmes le don d’une volonté susceptible d’être éclairée, l’exercice d’une persévérance raisonnée. Beaucoup d’hommes aujourd’hui font profession d’affirmer physiologiquement et philosophiquement que la créature mâle est d’une essence supérieure à celle de la créature femelle. Cette préoccupation me semble assez triste, et, si j’étais femme, je me résignerais difficilement à devenir la compagne ou seulement l’amie d’un homme qui s’intitulerait mon dieu : car au-dessus de la nature humaine je ne conçois que la nature divine ; et, comme cette divinité terrestre serait difficile à justifier dans ses écarts et dans ses erreurs, je craindrais fort de voir bientôt la douce obéissance, naturellement inspirée par l’être qu’on aime le mieux, se changer en haine instinctive qu’inspire celui qu’on redoute le plus. C’est un étrange abus de la liberté philosophique de s’aventurer dans des discussions qui ne vont à rien de moins qu’à détruire le lien social dans le fond des cœurs, et ce qu’il y a de plus étrange encore, c’est que ce sont les partisans fanatiques du mariage qui se servent de l’argument le plus propre à rendre le mariage odieux et impossible. Réciproquement l’erreur affreuse de la promiscuité est soutenue par les hommes qui défendent l’égalité de nature chez la femme. De sorte que deux vérités incontestables, l’égalité des sexes et la sainteté de leur union légale, sont compromises de part et d’autre par leurs propres champions. Les aphorismes maladroits de la supériorité masculine n’ont pris cette âcreté, je vous l’ai dit, qu’à cause des prétentions excessives de l’indépendance féminine.
L’égalité, je vous le disais précédemment, n’est pas la similitude. Un mérite égal ne fait pas qu’on soit propre aux mêmes emplois, et, pour nier la supériorité de l’homme, il eût suffi de lui confier les attributions domestiques de la femme. Pour nier l’identité des facultés de la femme avec celles de l’homme, il suffirait de même de lui confier les fonctions publiques viriles ; mais, si la femme n’est pas destinée à sortir de la vie privée, ce n’est pas à dire qu’elle n’ait pas la même dose et la même excellence de facultés applicables à la vie qui lui est assignée. Dieu serait injuste s’il eût forcé la moitié du genre humain à rester associée éternellement à une moitié indigne d’elle ; autant vaudrait l’avoir accouplée à quelque race d’animaux imparfaits. À ce point de vue, il ne manquerait plus aux conceptions systématiques de l’homme que de rêver, pour suprême degré de perfectionnement, l’anéantissement complet de la race femelle et de retourner à l’état d’androgyne.
Eh quoi ! la femme aurait les mêmes passions, les mêmes besoins que l’homme, elle serait soumise aux mêmes lois physiques, et elle n’aurait pas l’intelligence nécessaire à la répression et à la direction de ses instincts ? On lui assignerait des devoirs aussi difficiles qu’à l’homme, on la soumettrait à des lois morales et sociales aussi sévères, et elle n’aurait pas un libre arbitre aussi entier, une raison aussi lucide pour s’y former ! Dieu et les hommes seraient ici en cause. Ils auraient commis un crime, car ils auraient placé et toléré sur la terre une race dont l’existence réelle et complète serait impossible. Si la femme est inférieure à l’homme, qu’on tranche donc tous ses liens, qu’on ne lui impose plus ni amour fidèle ni maternité légitime, qu’on détruise même pour elle les lois relatives à la sûreté de la vie et de la propriété, qu’on lui fasse la guerre sans autre forme de procès. Des lois dont elle n’aurait pas la faculté d’apprécier le but et l’esprit aussi bien que ceux qui les créent seraient des lois absurdes, et il n’y aurait pas de raison pour ne pas soumettre les animaux domestiques à la législation humaine.
Non, Marcie, loin de moi, loin de vous cette pensée que vous n’êtes pas apte à concevoir et à pratiquer la plus haute sagesse que les hommes aient pratiquée ou conçue. La précipitation de vos desseins, l’ardeur de vos pensées inquiètes ne prouvent rien sinon que vous avez une âme forte et que vous n’avez pas encore trouvé la nourriture qu’elle réclame. Cherchez-la dans les livres sérieux. Appliquez-vous à les comprendre, et, si vous sentez quelquefois vos facultés rebelles, sachez bien qu’elles sont ainsi par inexpérience et non par impuissance. Les femmes reçoivent une déplorable éducation ; et c’est là le grand crime des hommes envers elles. Ils ont porté l’abus partout, accaparant les avantages des institutions les plus sacrées. Ils ont spéculé jusque sur les sentiments les plus naïfs et les plus légitimes. Ils ont réussi à consommer cet esclavage et cet abrutissement de la femme, qu’ils disent être aujourd’hui d’institution divine et de législation éternelle. Gouverner est plus difficile qu’obéir. Pour être le chef respectable d’une famille, le maître aimé et accepté d’une femme, il faut une force morale individuelle, les lois sont impuissantes. Le sentiment du devoir, seul frein de la femme patiente, l’élève tout à coup au-dessus de son oppresseur. La famille, témoin équitable et juge désintéressé, porte son jugement et son respect exclusivement sur celui des époux qui se montre le plus sage et le plus attaché à la vertu. La haine du despote s’en accroît, et souvent la loi est forcée d’intervenir pour soustraire à ses fureurs une victime épuisée.
Pour autoriser cet oubli des devoirs et pour empêcher la femme d’accaparer par sa vertu l’ascendant moral sur la famille et sur la maison, l’homme a dû trouver un moyen de détruire en elle le sentiment de la force morale, afin de régner sur elle par le seul fait de la force brutale ; il fallait étouffer son intelligence ou la laisser inculte. C’est le parti qui a été pris. Le seul secours moral laissé à la femme fut la religion, et l’homme, s’affranchissant de ses devoirs civils et religieux, trouva bien que la femme gardât le précepte chrétien de souffrir et se taire.
Le préjugé qui interdit aux femmes les occupations sérieuses de l’esprit est d’assez fraîche date. L’antiquité et le moyen âge ne nous offrent guère, que je sache, d’exemples d’aversion et de systèmes d’invectives contre celles qui s’adonnent aux sciences et aux arts. Au moyen âge et à la renaissance, plusieurs femmes d’un rang distingué marquent dans les lettres. La poésie en compte plusieurs. Les princesses sont souvent versées dans les langues anciennes, et il y a un remarquable contraste entre les ténèbres épaisses où demeure le sexe et les vives lumières dont les femmes de haute condition cherchent à s’éclairer. Ces honorables exceptions n’excitent aucune haine chez les contemporains, et sont, au contraire, mentionnées par les écrivains de leur siècle sur un pied d’égalité qui serait à tort ou à raison fort contesté dans les mœurs littéraires d’aujourd’hui. Les chefs de famille avaient-ils autrefois plus de gravité et de justice ? La foi religieuse leur inspirait-elle des sentiments plus doux et plus nobles envers leurs épouses ? Je le pense ; la loi de l’Église fondée sur les impérieux préceptes de saint Paul n’a jamais été réclamée par les maris avec plus d’âpreté que depuis la transgression de toutes les autres lois de l’Église et l’oubli de tous les autres apôtres. Quelque éloigné qu’on fût déjà, il y a cinq cents ans, de l’esprit du christianisme, l’esprit public issu et formé de cette philosophie chrétienne commandait aux hommes l’accomplissement de leurs devoirs domestiques. Le mari est aisément absolu lorsqu’il est juste et bon. La femme obéit instinctivement à ce qu’elle aime : esclave tendre et infatigable de ses enfants au berceau, comment ne serait-elle pas soumise volontairement à des conseils sages et affectueux ? Il est certain que le lien de la famille a été en se relâchant avec les époques de brillantes corruptions, et le xviiie siècle a porté une atteinte mortelle à la dignité du lien conjugal.
La principale raison de ce fait est l’énervement du caractère viril déjà préparé sous les règnes précédents, et consommé sous le long et paisible règne de Louis XV. Jusque-là, le système de guerres continuelles qui opposait des obstacles matériels au développement de l’esprit humain, a tenu la généralité des deux sexes dans une ignorance à peu près égale. La marche de la science et de la philosophie n’est pas suspendue, mais quelques élus seulement peuvent s’arracher aux préoccupations politiques, s’isoler et cultiver le champ sublime sur des hauteurs inaccessibles à la foule. Les agitations sociales, ici les croisades, plus loin les guerres de schisme, emportent l’homme loin de ses pénates, et laissent à la tête de la famille la femme investie d’une autorité non contestée ; si ses attributions sont considérables, si son rôle est important dans la société, l’instruction qu’elle peut avoir acquise est d’un avantage réel pour la fortune et la dignité de son époux.
Bruyamment occupé au dehors, il aime dans ses heures de loisir et de calme à trouver ses affaires bien gouvernées et ses enfants bien élevés. Le pauvre voit régner sous son humble toit l’économie, sa seule richesse, et sourit au gouvernement humble et laborieux de sa compagne. Ainsi, là où la femme remplit ses vrais devoirs, l’homme, loin d’y apporter obstacle et de se livrer à cette basse jalousie d’autorité domestique qu’engendre l’oisiveté, applaudit aux travaux de son associée, ministre solidaire de ses véritables intérêts.
Mais la guerre est suspendue. La tolérance étouffe heureusement les guerres de religion. La lumière se répand sur les masses. Le despotisme à son déclin jette une dernière clarté sur le monde étonné de se sentir si enchaîné et si libre à la fois. La fermentation des esprits apporte dans les idées un désordre effrayant. L’impunité du vice entraîne ceux-ci, le progrès de la raison attire ceux-là. Chacun obéit à ses instincts et à ses sympathies ; car, jusque-là, il a fallu étouffer instincts et sympathies pour défendre l’existence matérielle que l’industrie commence à affranchir des luttes sociales. Une crise providentielle terrible et magnifique va entraîner l’humanité dans une nouvelle phase de vie. Les croyances religieuses cherchent à se dégager de leurs langes, le sentiment de l’indépendance bouillonne dans toutes les veines, le règne de la vérité s’annonce à l’horizon. Mais, dans son empressement, la société, arrachée à son repos et à ses songes de ténèbres, se précipite dans des voies encore sombres, et son salut se prépare au sein d’une déplorable confusion. La lutte du passé et de l’avenir s’engage sur tous les points. L’homme ne doit conquérir son domaine qu’au prix de son sang et de ses sueurs. Les institutions sont ébranlées, les mœurs se corrompent odieusement. Le volcan verse par ses mille cratères la fange immonde et la lave brûlante qui vont labourer la terre et féconder son sein glacé. Combien d’années de crimes et d’héroïsme, d’abjection et de grandeur, jointes aux années déjà écoulées depuis que le volcan est en fusion, faudrait-il encore subir avant d’atteindre au résultat de tant de fatigues et d’efforts ? Nous ne le savons pas, mais nous voyons que l’œuvre marche et que rien ne l’entrave. Espérons, et, pour nous aider au courage, tâchons de comprendre et de constater l’état des mœurs depuis que cette révolution est en travail.
CARL
I
Après la mort de Carl, le séjour de Vienne me devint insupportable, et, résolu à me distraire, je partis seul et à pied pour les montagnes. Je parcourus la Misnie, je contemplai ses plus beaux sites sans y retrouver les mêmes impressions qu’autrefois. L’ennui et l’effroi de la solitude m’y poursuivirent. Je me débattais contre mon chagrin avec une folle inquiétude ; c’était le premier de ma vie, et j’ignorais que, de tout ce qui passe, le souvenir des morts est ce qui s’efface le plus vite. Aujourd’hui, lorsque je songe à mon pauvre Carl, je me sens tout honteux et tout repentant de la précipitation avec laquelle j’ai pu me jeter dans des sentiers nouveaux, caresser des espérances qu’il n’avait pas partagées, me livrer à des soins qu’il n’avait ni connus ni désirés. Je suis effrayé de la brièveté de mon deuil, et, si je puis me le pardonner, c’est en reportant mes regards sur les événements subséquents de ma vie ; c’est en m’assurant bien que mon âme, comme celle de tous les hommes, est un sol changeant, jonché tantôt de fleurs, tantôt de feuilles sèches ; aujourd’hui enseveli sous la neige, demain réjoui et fécondé par la plus faible brise du printemps.
Peut-être qu’à l’époque où le souvenir de Carl était chez moi si vif et si poignant, j’étais moins malheureux que je ne suis aujourd’hui, distrait et consolé. Je croyais à la durée des souvenirs, à la force des sentiments ; et maintenant, que suis-je ? de quoi suis-je certain ?
Il y eut alors dans ma vie une aventure assez étrange, qui, tout en réveillant mes regrets, les adoucit, parce qu’elle leur donna un caractère romanesque et poussa mon esprit malade hors des limites sombres de la réalité.
L’aspect des lieux tant de fois parcourus avec mon ami me rendait sa perte et mon isolement de plus en plus sensibles. Je résolus de voir une contrée nouvelle et de fuir sa trace chérie avec autant de soin que je l’avais recherchée. Je parcourus la Styrie, et je poussai dans le Tyrol. Carl avait bien traversé cette dernière province, mais rapidement et sans moi. Rien ne l’y avait assez occupé pour qu’il m’en parlât avec quelque suite. Je m’y croyais donc à l’abri des vives émotions que la Misnie m’avait fait éprouver.
J’y trouvai, en effet, plus de distractions qu’ailleurs. Quoique la saison fût belle, la route était difficile et même dangereuse, à cause des fréquents orages de la canicule. Le pays prenait, à mesure que je me dirigeais vers Inspruck, un caractère de grandeur qui me pénétrait et m’arrachait à mes pensées ordinaires. Tout allait mieux pour moi que dans les semaines précédentes, lorsque, après avoir essuyé une grande fatigue dans les défilés du mont Brenner, je fus pris, à H… d’un accès de fièvre assez violent et forcé de garder le lit pendant plusieurs jours. J’étais logé à l’hôtel de l’Aigle blanche, unique et sale auberge de ce pauvre village. J’y manquais de tout, et, pour surcroît de malheur, j’avais affaire au plus dur de tous les hôtes. Ma tenue de touriste faisait penser à cet avare qu’il aurait médiocrement à spéculer sur moi, et mon état d’accablement physique et moral ne me permettait guère de me plaindre. Je fus abandonné sur un misérable grabat, et bien me prit d’être assisté de la plus robuste constitution. Heureusement aussi, la Providence, qui nous visite sous une forme inattendue dans nos détresses, m’envoya un ami : humble, douce et touchante assistance qui ne s’effacera jamais de mon souvenir.
Cet ami, c’était le plus jeune des enfants de l’aubergiste garçon de quinze à seize ans, grand, mince, maladif, peu intelligent en apparence, mais plein de zèle généreux et de naïves attentions. Sa bonté naturelle l’ayant porté à me secourir, il fit tout ce qui dépendait de lui pour réparer la grossière indifférence et les suspicions cupides de son père. Ce qu’il put me procurer fut peu de chose, et, en vérité, je n’avais guère besoin que d’eau à boire à grandes doses, et d’un peu de société ; car rien n’augmentait ma fièvre comme l’effroi de me trouver seul et privé des soins de l’affection au début d’une maladie dont le degré de gravité était matière pour moi à de pénibles conjectures.
Mon jeune hôte passa plusieurs nuits à mon chevet, et, dans le jour, il vint d’heure en heure s’informer de mon état, malgré les dures remontrances et les menaces brutales de son père, qui semblait le haïr et qui le traitait plus mal qu’aucun de ses domestiques.
Si quelque chose pouvait excuser cette cruauté de la part d’un père, il serait vrai de dire que l’enfant était très-peu propre aux devoirs de sa profession. Il est impossible d’être plus gauche, plus préoccupé, plus indolent que ne l’était mon pauvre garde-malade. Le premier jour, son air distrait et presque hébété, sa lenteur à exécuter mes moindres désirs, m’avaient causé une telle impatience, que je l’avais maudit, lui et toute sa race ; mais bientôt le contraste de sa bonne volonté et de son intérêt avec la malveillance et l’inhumanité de son père me toucha vivement ; je lui parlai avec douceur, avec gratitude, et il parut s’attacher à moi.
Par une coïncidence singulière, il s’appelait Carl, et le nom de mon pauvre ami, ce nom qui résonnait pour moi avec tant de force, d’activité, de génie musical, de tendresse expansive, placé sur la figure malingre et insipide d’un garçon d’auberge, m’avait véritablement irrité dans les premiers jours de maladie. Ce nom, retentissant à mon oreille, ou se perdant au fond des corridors, me causait des tressaillements involontaires. Au milieu des rêveries de la fièvre, le spectre de mon ami m’apparaissait sans cesse ; je me croyais atteint de la même fièvre cérébrale qui l’avait emporté : je le voyais près de mon lit, debout et me tendant la main pour m’emmener avec lui dans une fosse entr’ouverte. Puis j’entendais sa voix faible et mourante m’appeler, m’engager à le suivre ; et tout à coup, des entrailles de la terre, une autre voix rauque et infernale appelait Carl à plusieurs reprises.
— Tu l’entends, disait mon ami, la mort s’impatiente, elle réclame sa proie.
— Carl, au nom du diable, ne descendras-tu pas ? criait la voix sinistre.
— Me laisseras-tu partir seul pour l’éternité ? disait Carl. Crains-tu de me suivre dans la tombe ?
Alors, je faisais un violent effort pour m’élancer vers mon ami, et je m’éveillais enfin baigné d’une sueur froide, l’œil égaré, la tête en feu ; mais, au lieu du fantôme, je ne voyais au pied de mon lit que le pauvre garçon d’auberge, avec sa face pâle et son air consterné, tandis que la voix diabolique de son père l’appelait en jurant du fond de la cuisine, située précisément au-dessous de mon plancher vermoulu.
Quand je me sentis convalescent, je commençai à discourir avec le pauvre Carl. J’obtins facilement sa confiance. Il me dit qu’il était le plus malheureux des êtres, que son père le haïssait, le rouait de coups à la plus frivole incartade, et que tout ce qu’il désirait au monde, c’était de quitter à jamais la maison paternelle.
— Si je ne l’ai pas fait encore, ajouta-t-il, c’est que, étant d’une mauvaise santé et n’étant pas propre à grand’chose, je craindrais d’être réduit à demander l’aumône ; ce qui serait peut-être moins malheureux que d’être traité comme je le suis, mais ce qui me cause une insurmontable répugnance.
Ces plaintes m’inspiraient une vive compassion, et en même temps le désir de soustraire mon jeune hôte à sa triste destinée. Mais j’hésitai beaucoup à m’en charger, car je n’étais pas assez riche pour l’emmener en qualité d’ami. Tout ce que je pouvais, c’était d’en faire mon domestique, et, malgré toute sa vertu, il m’était facile de voir que personne n’était moins propre à ce rôle. Il était d’une constitution très-faible, comme je l’ai dit, et je le croyais atteint de quelque maladie chronique ; car l’état peu brillant de ses facultés intellectuelles, l’espèce d’assoupissement qui s’emparait de lui à chaque instant, son défaut de mémoire et de prévoyance, tant de langueur et d’apathie dans un être si sincèrement dévoué, sa mélancolie que n’éclairait jamais un rayon de la gaieté de son âge, tout annonçait un désordre sérieux, incurable peut-être, dans son organisation.
Quoi qu’il en soit, un jour que son père l’avait cruellement maltraité pour s’être oublié trop longtemps près de moi, je me décidai à le prendre sous ma protection. La vue de son sang, les traces d’un châtiment inique subi avec patience pour l’amour de moi, me saisirent d’une telle compassion, que je me serais méprisé si j’avais pu balancer davantage. Je fis monter maître Peters, et je lui déclarai que j’allais le dénoncer à la justice du canton comme meurtrier de son enfant, s’il n’accédait à la proposition que je voulais lui faire. Il prit un air fort insolent ; mais, quand il eut jeté un regard de côté sur ma bourse qui était encore assez ronde, et que j’avais posée à dessein sur la table, il se calma et attendit l’explication. Aussitôt que j’eus fait la première ouverture :
— Mille diables ! s’écria-t-il, vous voulez emmener ce paresseux, cet inutile, ce dort debout ? Si j’en avais dix comme lui, je vous les donnerais tous par-dessus le marché. Débarrassez-moi de ce fardeau, et que j’en entende parler le moins possible ; ce sera le mieux.
L’affaire fut conclue sur-le-champ. Je demandai à Carl ce qu’il voulait gagner.
— Rien du tout, que ma nourriture, répondit-il. Vous me donnerez vos vieux habits pour me couvrir. Hélas ! monsieur, je suis si faible et si borné, que toute prétention serait bien déplacée de ma part.
— Pauvre enfant ! lui dis-je, ton cœur est bon et noble ; si ton intelligence ne seconde pas tes intentions, et que je manque de patience avec toi, il faudra me le pardonner, et, pour m’apaiser, il suffira de me rappeler les soins que tu viens de me prodiguer.
Quelques jours après, nous étions sur la route d’Inspruck, Carl et moi. J’étais parti un peu plus tôt peut-être que mes forces ne me le permettaient ; car, vers le milieu du jour, je me sentis accablé d’une telle fatigue, que je ne pus atteindre le village où je m’étais proposé de me rafraîchir. Je me jetai dans un pré à l’ombre d’une haie, et j’y goûtai quelques heures d’un sommeil délicieux.
Quand je m’éveillai, je vis Carl endormi près de moi, dans l’attitude d’un chien fidèle qui garde son maître ; mais son sommeil était si profond, qu’on eût bien pu m’égorger mille fois avant qu’il s’en aperçût. Je le secouai à plusieurs reprises. Je l’appelai de toutes mes forces : tout fut inutile ; c’était une véritable léthargie. J’en pris un peu d’humeur. Il se pouvait que Carl fût en proie à de telles infirmités, qu’il me serait un véritable fléau, et j’eus un instant la pensée coupable de glisser dans son sac la moitié de ma bourse et de l’abandonner à la destinée. Mais j’eus bientôt horreur de ce dessein égoïste et lâche. Si le pauvre Carl était réellement atteint de maladie, ne lui devais-je pas mes soins, à lui qui m’avait prodigué les siens au péril de sa vie ? Que serais-je devenu s’il m’eût abandonné quelques jours auparavant, lorsque j’étais comme lui plongé dans un sommeil qui ressemblait à la mort ?
— Ô Carl, ô toi qui n’es plus sur la terre, m’écriai-je, ô le plus inspiré des artistes, ô le meilleur des amis ! cette criminelle pensée ne te fût pas venue, et, si ton âme plane sur moi, sans cesse, comme je l’ai cru voir dans les révélations de la fièvre, elle s’indigne, à l’heure qu’il est, de découvrir ce mouvement d’ingratitude. Ô Carl ! que ton ombre veille sur moi et sur mon triste compagnon ! que ton souvenir protége cette chétive et infortunée créature, à qui Dieu réserva ton nom, sans doute pour qu’elle me fût à jamais sacrée !…
Je sentis une larme baigner ma paupière, et, cédant à un mouvement instinctif, je tirai ma flûte de son étui et je la fis résonner pour la première fois depuis la mort de Carl. Jusque-là, il m’avait été impossible d’entendre un son musical sans être irrité dans tous mes nerfs. En cet instant, je me sentis, au contraire, inondé d’une volupté mélancolique, en faisant redire à plusieurs reprises aux échos tyroliens cette phrase d’un chant religieux, dernière pensée musicale de mon ami, au milieu de laquelle il avait été surpris par la mort[1].
![{ \key d \major
\time 4/4 d'''4 fis'''2(fis'''8.[)(d'''16] d'''8.[cis'''16]e'''8.[b''16]b''4)(a''8[)(g'''8] \break fis'''8[e'''8d'''8cis'''8]b''4.)d'''8( d'''2 cis'''2 d'''4) \bar "|."
}](http://upload.wikimedia.org/score/f/j/fjs1pcw6es7c7gawabsc5pohxz1ui4y/fjs1pcw6.png)
Tout à coup, le jeune Carl s’éveilla : ses joues blêmes s’enflammèrent d’un éclat singulier, et les lignes pures mais inanimées de son visage reçurent un tel ébranlement, qu’un instant il me parut aussi beau que, jusqu’alors, je l’avais trouvé insignifiant. Frappé de cette métamorphose, je m’arrêtai brusquement pour lui demander s’il comprenait la musique, et s’il était un peu musicien, comme le sont presque tous les villageois de cette contrée.
Mais Carl reprit en un clin d’œil sa pâleur et son insensibilité habituelle ; il se frotta les yeux, bâilla, me demanda si je lui avais parlé, et j’eus la mortification de m’avouer qu’un instant d’exaltation musicale et sentimentale m’avait abusé sur l’émotion de Carl. Honteux de cette faiblesse d’esprit, je remis ma flûte dans l’étui, et j’engageai Carl à renouer son sac de voyage et à se remettre en route avec moi.
J’avais un peu d’humeur, et je lui fis observer que le soleil baissait, qu’il avait dormi bien longtemps, qu’il avait le sommeil bien lourd, le tout d’un ton assez aigre. Mais le pauvre diable était accoutumé à tant de rigueur, qu’il ne s’aperçut pas de mon impatience. Il me répondit avec une douceur angélique :
— Il y a longtemps que je vis dans la misère et dans l’inquiétude, que je ne connaissais presque plus le sommeil ; depuis ce matin, je suis bien, je suis heureux, et je dors pour tout le temps que j’ai veillé. Et puis, ajouta-t-il d’un air simple, j’ai passé bien des nuits sans me coucher pendant que vous étiez malade.
Vivement attendri de cette réponse, je gardai un instant le silence.
— Carl, lui dis-je ensuite, rappelez-vous une chose : je suis impatient et souvent brutal ; quand vous me verrez ainsi, souvenez-vous de certaines paroles qui auront le pouvoir de me calmer.
— Quelles sont-elles, monsieur ?
— Les voici : Respectez le nom de Carl. Dites-moi cela quand je vous traiterai durement.
— Il suffit, monsieur, répondit-il d’un air soumis.
Et sans éprouver ni curiosité ni surprise, il se mit à marcher devant moi.
II
Carl prétendait connaître parfaitement le pays ; mais, soit qu’il se flattât mal à propos, soit qu’il fût distrait plus encore qu’à l’ordinaire, la nuit était close lorsqu’il s’aperçut que nous avions perdu la route, et il fallut marcher pendant trois heures avant de la retrouver. Enfin, à plus de minuit, nous arrivâmes à F… J’étais si las, que je laissai Carl s’enquérir d’un gîte, et je me jetai sur une borne. Pas un réverbère n’était allumé, pas un habitant n’était debout, pas un rayon de lampe de nuit n’illuminait les fenêtres. Carl revint au bout d’une demi-heure me dire qu’il lui était impossible de se faire ouvrir nulle part ; que, même à l’auberge, on l’avait repoussé en le menaçant, du haut d’une lucarne, de lui dépêcher un coup de fusil s’il ne se retirait. Je pensai qu’il ne connaissait pas plus les rues de F… que les chemins de la montagne ; et, convaincu que toute remontrance serait inutile, je me mis à marcher devant moi, cherchant le banc le mieux abrité pour y dormir à la clarté des étoiles.
Le porche de l’église s’offrit à nous ; c’était du moins un ciel de lit. J’allais m’y installer lorsque Carl, essayant de pousser la porte, vit qu’elle cédait et s’écria d’un ton biblique :
— La maison du Seigneur est ouverte aux pèlerins.
— En ce cas, Dieu est plus hospitalier que les hommes, lui répondis-je.
Nous entrâmes ; la lampe brûlait au milieu du chœur et faisait vaciller sur les murs les ombres trapues des colonnes romanes. Je m’étendis au premier endroit venu, la tête sur mon sac. Carl alla se blottir dans un confessionnal. Le sommeil eut bientôt fermé mes paupières. Ce fut un sommeil pénible. La dalle était froide, la fièvre courait dans mes veines ; mais je n’avais pas la force de me lever pour chercher un endroit plus sain. Je fus en proie à des rêves lugubres, il me sembla que j’assistais de nouveau aux derniers moments de mon pauvre ami, Carl le maestro. Je le voyais encore, les yeux éteints, les lèvres contractées, me tendant la main comme un dernier adieu. Puis tout à coup son œil s’entr’ouvrait et brillait d’un éclat céleste ; l’hymne de la grâce, l’élan de la foi, la prière de l’espérance, s’exhalaient en harmonie grave de sa poitrine moribonde. L’hymne s’acheva dans le ciel ; j’essayai de soulever l’agonisant : il n’était plus !
Je m’éveillai, et ce rêve (reproduction fidèle des heures douloureuses écoulées naguère au chevet de mon ami) me laissa une telle impression de tristesse, que je me demandai si Carl n’avait pas survécu à sa propre mort, et si je ne venais pas de lui fermer réellement les yeux une seconde fois. J’essayai de me rendormir ; mais les mêmes images me poursuivirent. Plusieurs fois je m’éveillai, plusieurs fois je retombai dans une sorte de léthargie ; et la veille et le sommeil troublaient également ma raison : l’un et l’autre remplissaient de terreurs puériles ma tête affaiblie… Lorsque j’avais les yeux fermés, je croyais entendre la phrase musicale que Carl avait écrite le jour de sa mort et qu’il murmurait en expirant, la même que j’avais jouée sur ma flûte dans la matinée. Quand j’avais les yeux ouverts, il me semblait que l’orgue venait de la jouer, et que la vibration remplissait encore les nefs sonores. Les voûtes, baignées d’une lueur incertaine, flottaient et oscillaient sur ma tête ; chaque chapelle semblait me renvoyer un son. Demi-évanoui sur les marbres, fatigué de ces hallucinations, je me levai, je pris mon front dans mes mains, j’essayai de marcher. Mais quels termes pourraient rendre ce que j’éprouvai en entendant la nef se remplir en réalité des sons de l’orgue ? Ce n’était plus une illusion, une main pressait les touches, les flancs du vaste instrument gémissaient en chantant l’introduction et les premières mesures de l’hymne fatal.
Je me cachai la figure dans mon manteau et je me prosternai sur le pavé de l’église. Convaincu que j’allais voir sortir de terre une ronde infernale, et que, pour me punir de ma vie peu chrétienne, des spectres allaient me tourmenter, je récitai plusieurs formules d’exorcisme et restai dans cette posture si longtemps, que l’aube blanchissait les vitraux lorsque je me hasardai à regarder autour de moi. Tout était calma : le cri des moineaux voltigeant et becquetant aux croisées interrompait seul le silence ; Carl dormait dans son confessionnal. J’eus beaucoup de peine à l’éveiller ; il n’avait rien entendu, et je n’osai pas insister sur mes questions dans la crainte de lui sembler fou. Nous gagnâmes une auberge ; un peu de nourriture répara mes forces ; je me jetai sur un lit, où je dormis quelques heures assez tranquillement. Néanmoins, cette nuit m’avait laissé une si fâcheuse impression, que je m’obstinai à quitter F…, bien que la journée fût avancée, et qu’il fallût faire quatre lieues pour coucher à T…
À peine étions-nous à la moitié du trajet, qu’un vent violent s’éleva ; l’horizon était chargé d’une zone violette qui envahit le ciel avec rapidité ; de larges gouttes de pluie commencèrent à trouer la neige dont le fragile rempart bordait notre chemin, car nous étions alors au passage le plus élevé du mont Brenner, et, quoique nous fussions en plein été, un froid piquant se faisait sentir. Bientôt le tonnerre gronda et le vent devint si violent, que nous avions de la peine à marcher. Il fallait se hâter pourtant : nous traversions la région des glaces, et Carl disait que, si nous pouvions atteindre sans accident la région située au bas des rochers, les forêts de sapins nous préserveraient des avalanches. Nous eûmes le bonheur de sortir sans accident de ce défilé périlleux ; l’orage se calmait, et nous nous croyions sauvés, lorsqu’une nuée rougeâtre creva au-dessus de nous et nous assaillit d’une grêle si forte, que nous eussions été meurtris et défigurés sans l’abri d’une grotte où nous nous réfugiâmes. Des torrents de pluie succédèrent à la grêle ; et, quand il nous fut possible de quitter la grotte, le soleil était couché. Le ciel, couvert de nuées grisâtres éparses sur tous les points, passa sans crépuscule du jour à la nuit. Le chemin était emporté en mille endroits ; les torrents grossis avaient donné naissance à mille ruisseaux fougueux qui grondaient autour de nous, sans que nous pussions éviter leur rencontre farouche ; nous tombâmes plusieurs fois et j’eus un poignet foulé sur les roches. Pour comble de malheur, au moment où nous descendions sur des sables glissants labourés par les eaux, Carl, qui marchait devant moi et qui prétendait que le village où nous devions coucher était situé au bas de la côte, s’arrêta pensif et me dit :
— Je ne vois pas les lumières de T… ; il faut que nous nous soyons trompés de chemin, car ce village devrait être ici, à main gauche, et…
Le vent nous apporta en ce moment un bruit semblable à celui d’une cataracte.
— C’est une avalanche morte, dit Carl ; elle roule tout doucement de l’autre côté de la montagne.
Le bruit continua.
— Avançons, lui dis-je.
— Non pas, répondit-il ; ce n’est pas une avalanche qui descend ; c’est la grande cascade de Saint-Guillaume, et nous tournons le dos au village.
C’était bien le cas d’envoyer Carl à tous les diables ; mais j’étais accablé de fatigue, il ne me restait plus de force pour l’impatience. Je le priai de s’assurer de la vérité et de descendre encore un peu. Je m’appuyai, en l’attendant, contre un arbre et restai dans une sorte de stupeur. Les vives douleurs que je ressentais dans tous les membres m’annonçaient le retour de la fièvre ; mes pieds étaient glacés, ma tête était brûlante. Si Carl fut long à explorer le pays, si je passai une heure ou un instant dans cette situation, c’est ce que j’ignore. Je fus éveillé en sursaut par un rêve étrange. Il me semblait voir le spectre de mon ami Carl sortir de l’écume d’une cataracte furieuse et saisir mon jeune Carl pour l’entraîner avec lui dans le gouffre. L’enfant se débattait en poussant des cris lamentables, et me tendait les bras en invoquant mon secours. Je fis un violent effort pour m’élancer vers lui ; mais, au moment où je me courbais en avant, j’ouvris les yeux et je restai terrifié du spectacle qui s’offrit à mes regards. J’étais sur le revers d’un abîme incommensurable. De terrasses en terrasses, la montagne se brisait en gouttières à des milliers de pieds au-dessous de moi, et la cataracte, en s’y précipitant, promenait un gémissement sinistre sur les échos lointains. La lune, perçant des nuées bizarres, affreusement déchirées, éclairait d’une lueur blafarde cette scène effrayante et sublime. Je crus rêver encore ; j’appelai Carl à plusieurs reprises. Il ne me répondit pas. Le vent se taisait pourtant, et la seule voix de l’eau, renvoyée par les abîmes, remplissait la nuit de monotones et lugubres harmonies. Je l’écoutais, plongé dans une morne détresse, incapable de me mouvoir et de me rendre compte de ma véritable situation. Un pas de plus, et je roulais sur les gigantesques degrés de la montagne ; mais je n’avais déjà plus conscience du danger, bien que je fusse parfaitement éveillé. Je ne sais par quelle liaison d’idées la phrase musicale de Carl me revint à la mémoire. Mon rêve, un instant oublié, me revint aussi, et la fièvre qui venait de m’envahir, embrouilla tellement mes idées, que je perdis de nouveau l’empire de ma volonté. Des fantômes dansèrent dans mon cerveau et devant mes paupières. La scène de l’église se peignit à ma mémoire sous des couleurs si vives et si réelles, que, possédé par une sorte de frayeur insensée, je me mis à chanter la phrase fatale ; d’abord à demi-voix, comme si j’eusse voulu conjurer et repousser l’approche des esprits des ténèbres ; puis distinctement, comme si je me fusse accoutumé à leur apparition ; et puis enfin d’une voix éclatante, comme si j’eusse voulu les invoquer et m’élancer avec eux dans la vapeur qui tremble sur les abîmes au rayon de la lune. Mais quelle fut ma stupeur lorsqu’au moment où je prononçais les mots terribles :

une voix, qui semblait être la voix même du vent
et des eaux, me répondit à travers les sapins et la
brume :

Et aussitôt, comme si toutes les voix de la nuit et tous les esprits de l’air eussent été convoqués à chanter l’hymne funèbre de Carl, du haut de chaque cime et du fond de chaque ravin, un écho répondit à la voix fantastique pour articuler, chacun à son tour, et avec une force décroissante :
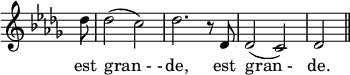
La dernière de ces voix se perdit dans les airs avec tant de délicatesse et de netteté, elle exhala un soupir si tendre et si harmonieux, que je crus entendre le dernier soupir de Carl, ce soupir musical, semblable au faible souffle qui se promène, dans les nuits d’été, sur les cordes de la harpe. C’est en prononçant ces mêmes paroles, en chantant ces mêmes notes que l’âme du maestro s’était envolée au ciel sur les ailes virginales de sa muse chrétienne. Je fus si frappé de ce souvenir, et l’illusion fut telle, que je tombai à genoux en fondant en larmes et que j’élevai les bras au ciel, croyant voir passer sur ma tête une forme angélique…
III
Tout rentra dans le silence… Je me calmai, moitié grâce au froid piquant de la nuit, moitié grâce aux efforts que je faisais pour revenir à la raison.
Je commençai bientôt à m’inquiéter de l’absence prolongée du jeune Carl ; je me demandai combien d’heures avaient pu s’écouler tandis que j’étais livré à un sommeil pénible et à de folles rêveries. Je secouai mon manteau trempé de pluie, je repris mon bâton ferré, et, après avoir appelé Carl, mais sans obtenir de réponse, je me mis à descendre avec précaution ce sentier effrayant et presque impraticable, dont nous avions parcouru la moitié sans crainte au milieu des ténèbres, et dont maintenant la clarté de la lune me révélait toute l’horreur.
À mesure que j’avançais, l’entreprise devenait si difficile, que je faillis y renoncer. Chaque fois que j’arrivais à une des terrasses naturelles de la montagne, je me reposais, j’avalais un peu de grog et je remplissais de nouveau le ravin de mes cris. Le bruit de la cataracte grossissait toujours davantage, et ma vaine recherche me remplissait d’épouvante ; je me reprochais amèrement d’avoir exposé mon pauvre serviteur à parcourir seul cette route affreuse, et je commençais à me persuader qu’il avait dû nécessairement rouler dans les abîmes. Je n’espérais plus le retrouver vivant. Je n’avais plus la force de l’appeler ; je marchais courbé vers la terre, m’attendant sans cesse à heurter son cadavre. Toutes mes émotions puériles, toutes mes terreurs superstitieuses avaient fait place à une douleur réelle, à une angoisse profonde. Quelle fut donc ma surprise et ma frayeur lorsque, au moment où je jouissais de toute ma raison, j’entendis distinctement dans la région que je venais de parcourir, à environ cent toises au-dessus de moi, une voix pure chanter plus distinctement encore que la première fois :

— Ô mon Dieu ! m’écriai-je, si tu permets que l’âme des morts me visite, ouvre mon entendement, afin que je puisse avoir commerce avec les habitants du monde invisible, sans perdre la raison, ou sans tomber foudroyé !
Cette prière, exhalée du fond du cœur, me rendit le courage. Je levai la tête et vis courir sur la rampe supérieure une forme légère. Je l’appelai du nom de Carl à plusieurs reprises ; mais elle n’entendit ni ne répondit, et continua à descendre ou plutôt à glisser vers moi avec une rapidité surnaturelle.
Un instant, je me sentis si troublé, que j’hésitai à prendre la fuite, et à descendre le plus vite possible le sentier de la cascade. Mais je fis un signe de croix, et, surmontant ma faiblesse, je me plaçai au milieu du chemin, les bras étendus, et je conjurai le fantôme.
Mais il venait toujours, et, quand il fut à quelque pas de moi, je reconnus distinctement Carl, mon jeune serviteur. Délivré d’une grande anxiété, je marchai à sa rencontre et lui adressai la parole ; mais il ne me vit pas, ne m’entendit pas, et, avant que j’eusse étendu les bras de nouveau pour l’arrêter, il passa près de moi, si adroitement, qu’il ne m’effleura même pas, quoique le sentier fût à peine assez large pour une personne, et que le moindre choc eût dû nous faire rouler tous deux dans les précipices ; puis il continua de descendre avec la rapidité d’une flèche, et, avant que je fusse revenu de ma surprise, je l’avais perdu de vue.
Un affreux jurement m’échappa ; mais aussitôt des craintes superstitieuses s’emparèrent de nouveau de mon imagination. Je pensai que Carl était tombé dans la cascade depuis plusieurs heures, et que son spectre, errant sur le sentier, m’apparaissait pour réclamer mes prières. Je me mis à prier avec une dévotion puérile ; mais je fus interrompu par la voix fantastique qui m’avait tant poursuivi, et j’entendis encore au-dessous de moi la phrase fatale.
— C’en est trop ! m’écriai-je, ma raison s’y brisera, et nulle autre raison humaine n’y résisterait ! Par quelle magique combinaison vois-je le spectre du nouveau Carl, en même temps que j’entends la voix de Carl, l’ami qui n’est plus ? Quel est ce rêve qui m’a réveillé en sursaut, comme si une invisible main me poussait à secourir un ami en détresse ? Quel est ce chœur mystérieux qui m’a révélé l’existence des puissances invisibles dans un moment solennel et décisif peut-être de ma vie ?…
J’étais plongé dans mes réflexions, j’étais arrivé à admettre tellement mes visions, que je ne m’étonnais plus de rien. Je me mis à descendre la dernière rampe, toujours persistant à chercher le corps de Carl, bien que sa figure me fût apparue. Mais à peine eus-je atteint l’esplanade où j’avais encore aperçu le spectre, que j’entendis la voix de l’autre côté de l’abîme. Elle était alors très-peu distincte, et je ne pouvais saisir que des sons épars au milieu de la basse continue de la cataracte.
Que vous dirai-je ? J’errai toute la nuit autour de ce gouffre, attiré par les piéges de la sirène invisible. De temps en temps, j’apercevais le fantôme de mon jeune compagnon ; puis aussitôt je le voyais sur un autre point, et ma cervelle était tellement troublée, que je m’imaginais souvent le voir en deux endroits à la fois. Je ne sais comment ma raison put survivre à une telle crise ; je ne ressentais plus aucune fatigue : la chaleur de la fièvre me donnait une force et une adresse surhumaines.
Les premières lueurs de l’aube blanchissaient l’horizon, et la lune, lourde et terne, s’abaissait derrière les sapins, lorsque je me trouvai, au détour d’un buisson, face à face avec le fantôme. À demi irrité par la poursuite, à demi calmé par le sentiment de la réalité, je me jetai sur lui à l’improviste, et, le saisissant dans mes bras, j’étreignis, non pas une ombre, mais le véritable Carl, mon compagnon de voyage. Je le saisis au moment où il disait :

La note expira sur ses lèvres, il poussa un gémissement plaintif, un frisson le saisit, et il tomba dans mes bras comme si la mort l’eût frappé.
Je l’assis sur un rocher, et j’essayai de le rappeler à lui-même. Tout fut inutile : cependant, son pouls était à peu près calme et sa respiration régulière ; il paraissait dormir. À peine mon effroi fut-il calmé, que je me sentis vaincu par la fatigue, incapable de trouver la solution des problèmes de cette nuit étrange, je tombai endormi à côté de Carl. Le temps était superbe, et, quand nous nous éveillâmes, le soleil était brillant et généreux. J’accablai mon jeune ami de questions, mais il me fut impossible d’en tirer aucun éclaircissement : il ne se souvenait de rien, et n’était pas moins surpris que moi de tout ce que je lui racontais. Enfin, lorsque je lui parlai à plusieurs reprises de la phrase que j’avais entendue, il sourit d’un air étrange et me pria de la lui chanter. Son œil s’anima en l’écoutant ; puis il rougit, baissa les yeux et me montra une sorte de confusion demi-niaise et demi-rusée. Je crus alors qu’il se moquait de moi et que j’étais le jouet de je ne sais quelle inexplicable comédie ; je le réprimandai fort rudement et le menaçai, s’il ne me révélait toute la vérité, de le renvoyer à son père. Alors, il se prit à pleurer, et, se jetant à genoux, il jura de se confesser si je voulais lui tout pardonner d’avance. Je le jurai, et il m’apprit qu’il était passionné pour la musique ; que cette passion, comprimée par son père, avait fait le malheur de sa vie ; que ses véritables besoins d’artiste, refoulés par les horribles traitements et les grossières occupations dont j’avais été témoin, avaient miné lentement sa santé et peut-être altéré sa raison. Il avait fait tous ses efforts pour arracher de son esprit la pensée de cultiver ses dispositions naturelles, lorsqu’un événement de peu d’importance était venu les réveiller. Un jeune homme brun et d’une belle figure, avait couché, cinq ans auparavant, à l’hôtel de l’Aigle blanche ; il avait fumé, écrit et fait de la musique, seul, dans sa chambre jusqu’à cinq heures du matin ; une phrase entre autres revenait, errait sans cesse sur ses lèvres ; il la répétait aussi sur sa flûte, et même il l’avait laissée écrite au charbon sur les murs de sa chambre.
— Et quelle était cette phrase ? m’écriai-je.
Carl chanta d’un trait :

— Et le nom de ce jeune homme, le savez-vous ?
— Je ne le sais pas ; mais, quant à son nom de baptême, je le connais et ne l’ai pas oublié ; car, en entendant le mien, il me frappa sur l’épaule en me disant qu’il servait le même patron que moi.
— C’est lui ! m’écriai je, c’est mon meilleur ami ! Je sais en effet qu’il y a cinq ans, il traversa le Tyrol, et, lorsque, à l’heure de sa mort, il me chantait sa phrase religieuse, il me dit en souriant : « Ne m’en fais pas compliment, je baisse : c’est une réminiscence de ma jeunesse, et rien de plus. » Mais, dis-moi, Carl, comment il se fait que tu aies retenu cette phrase ?
— Tout ce que j’entends en musique se grave dans ma mémoire pour n’en plus sortir, et pour se retrouver dans l’occasion. Je répétai mille fois cette phrase qui me plaisait tant, et je la chantai même au voyageur en lui tenant l’étrier à son départ. Il fut content de ma voix, m’engagea à la cultiver, et me donna un gros pourboire. Quelque temps après, je fus tellement maltraité pour avoir laissé voir le retour de ma passion, que je fis une maladie grave, et la phrase sacrée s’endormit dans ma mémoire. Je ne la retrouvai plus qu’avant-hier, lorsque vous la jouâtes sur la flûte ; mon cœur bondit de joie en la reconnaissant, et, depuis ce moment, j’ai fait des efforts incroyables pour l’empêcher de sortir de mes lèvres.
— Et comment ne m’avez-vous pas dit alors que vous la connaissiez ?
— D’abord, j’ai cru qu’elle n’avait rien de particulier, et que c’était une composition connue ; c’est pourquoi je n’ai pas été surpris de vous l’entendre jouer. Ensuite, pour rien au monde je n’aurais osé vous confesser mon goût pour la musique. On m’a habitué à regarder ce goût comme une folie dont je devais rougir, ou comme une désobéissance que je devais expier sous le bâton. Je savais bien que vous ne me frapperiez pas ; mais je craignais de vous déplaire, vous si bon pour moi, et j’étais résolu à chasser cette funeste passion de mon cerveau, afin de me consacrer à votre service et de me corriger de ces négligences et de ces distractions auxquelles ma mélancolie me rend trop sujet. Je crains que cela ne soit au-dessus de mes forces, car, depuis que je suis avec vous, je me sens plus malade, plus tourmenté de rêves étranges ; il me semble que je marche, que je cours, que je chante en dormant. Mais tout cela, c’est de la folie !… Je n’y veux plus penser ; ayez compassion de moi !
Ces dernières paroles me furent un trait de lumière ; je résolus d’éclaircir mes soupçons, et, laissant croire à Carl que je désapprouvais sa vocation musicale, je repris avec lui le chemin de T… À la clarté du jour, nous le retrouvâmes sans peine, et, après avoir fait bien dîner Carl, après avoir pris moi-même quelques heures de repos, je me levai à l’entrée de la nuit, et je m’approchai de son lit. Je le vis d’abord dormir paisiblement ; mais bientôt il se leva, s’habilla, se mit à errer autour de la chambre, et tâcha de sortir. Je l’avais enfermé, et la clef était dans ma poche. Il s’approcha alors de la fenêtre. Je me mis au-devant pour l’empêcher de se risquer sur les toits. En éprouvant de la résistance, il frissonna légèrement, et, comme s’il m’eût vu à demi, il me dit quelques paroles inintelligibles, et retourna s’asseoir sur son lit. Puis, après avoir réfléchi, il alla se placer devant une table, et commença à remuer les doigts dessus comme s’il eût joué du piano. Au bout de quelques instants, il se mit à chanter sur cet accompagnement imaginaire.
Je le pris doucement dans mes bras et je le conduisis à son lit, où il se laissa étendre, et bientôt il dormit profondément.
Les nuits suivantes, je continuai mes observations, et j’eus le loisir de me convaincre que Carl était somnambule.
Je le conduisis avec soin jusqu’à Inspruck, où j’appelai un bon médecin. Il me déclara que la guérison de Carl dépendait de la satisfaction de sa passion dominante. Je l’emmenai donc à Vienne, où je le mis entre les mains d’un excellent professeur. Il avait étudié déjà un peu de piano en cachette chez l’organiste de son village, et montrait une grande prédilection pour cet instrument. Il y fit des progrès rapides, et, à l’heure où j’écris, il promet de devenir un compositeur distingué. À mesure que son génie a reçu le développement tant contrarié, sa santé s’est raffermie, son intelligence s’est réveillée, son caractère a pris de la gaieté, son sommeil est paisible ; et, quant à son cœur, il est toujours le plus pur, le plus généreux et le plus fidèle que j’aie connu depuis la mort de Carl le maestro.
LE DIEU INCONNU
Au temps de Dioclétien, lorsque le christianisme grandissait dans la persécution, Pamphile, prêtre de Césarée, vint à Rome pour joindre ses efforts à ceux de Caïus, de Quentin et de plusieurs autres saints hommes, successeurs des apôtres, occupés tous à former des âmes pour le martyre, afin que le sang des chrétiens lavât sur les pavés de Rome les souillures de la débauche païenne. L’holocauste de Jésus continuait à monter vers le ciel ; ses disciples venaient se faire immoler sur l’autel encore fumant, afin que le monde fût racheté, afin que Dieu, épouvanté lui-même des turpitudes humaines, pût mettre dans la balance de sa justice quelques morts héroïques en compensation de tant de vies honteuses.
Un soir, après la courte et sublime exhortation que le reste du troupeau écoutait chaque fois comme pouvant être la dernière (car bien souvent au matin, soit le pasteur, soit la brebis, quelqu’un manquait à l’appel, et le De profundis était murmuré à voix basse sur un cénotaphe), Pamphile, ayant donné sa bénédiction et son triste adieu à ses frères, les regardait s’éloigner lentement et dans un profond silence, sous les sombres voûtes des catacombes. Il fut saisi, ce soir-là, plus que de coutume, d’un sentiment d’inexprimable douleur, car une tendresse infinie naissait vite et se cimentait fortement entre ces hommes voués au sacrifice, et leur âme était souvent partagée entre l’amertume des regrets humains et la joie d’un divin enthousiasme.
Le prêtre chrétien restait debout devant l’autel et ne songeait plus à prier. La fatigue de son corps maigri par le jeûne, le froid du caveau, la solennité des adieux quotidiens, l’aspect de ce cercueil où, chaque jour, depuis plus d’un mois, un cadavre mutilé venait recevoir la couronne humide encore du sang d’un autre martyr, tout le ramenait à un sentiment de personnalité auguste et terrible. Il s’agenouilla enfin devant le Christ, en s’écriant :
— Ô mon maître ! si je dois boire ce calice, épargne-m’en la lie ; si je dois remplir ce cercueil, fais que ce soit demain, afin que je n’y voie plus descendre aucun de mes frères, et que les larmes de mon cœur soient taries.
En ce moment, il entendit frapper doucement à une porte que les fidèles avaient dressée et fermée au dedans, afin que ce souterrain n’eût qu’une issue (celle par laquelle Pamphile les avait vus s’éloigner), et que les moyens de surprise fussent plus rares. Celui qui s’y présentait alors ne pouvait donc être qu’un espion, ou un frère récemment arrivé du dehors et forcé par les poursuites de se réfugier précipitamment dans les caves. Pamphile se leva sans hésiter et alla tirer les verrous d’une main ferme. Peut-être avait-il cru reconnaître les pas d’Eusèbe, son ami, qu’il avait laissé à Césarée, avide de venir affronter la persécution ; peut-être, poussé par un élan surnaturel, crut-il que Dieu exauçait tout à coup sa prière et lui envoyait le bourreau qu’il avait demandé. Pamphile était seul ; à chaque instant de sa vie, il était préparé à paraître devant Dieu ; il demanda d’une voix calme :
— Que voulez-vous ?
Et il ouvrit la porte en même temps.
Alors, il vit une femme voilée, qui s’avança d’un pas timide, en disant :
— Ne me faites pas souffrir de supplice, ne me faites pas mourir ; je suis païenne et ne viens point ici pour vous trahir, mais pour invoquer votre Dieu.
— Notre Dieu a dit : « Rendez le bien pour le mal, » répondit Pamphile ; nous ne tuons pas, nous ne faisons pas souffrir de supplices, même à ceux qui voudraient nous trahir. Entrez, ma fille, et priez le vrai Dieu.
— Referme donc cette porte, répondit la femme païenne, car, si l’on me surprenait ici, je serais accusée de christianisme, et l’on me mettrait à la torture pour me faire avouer vos mystères.
Le prêtre referma la porte, et, lorsqu’il se retourna vers la femme, elle avait ôté son voile, et il vit qu’elle était jeune encore, richement vêtue, et d’une merveilleuse beauté, quoique son visage portât l’empreinte de la fatigue et de la tristesse.
— Qui es-tu ? lui dit le prêtre, et que demandes-tu ? Voici l’autel de notre Dieu : si tu veux le prier, je m’agenouillerai avec toi et je le prierai de t’exaucer.
Mais la femme, au lieu de répondre, regardait autour d’elle avec un mélange d’effroi et de curiosité, et, lorsqu’à la lueur de la lampe qui brûlait devant l’autel, elle distingua le cénotaphe, couvert d’un linceul aux taches livides, elle recula épouvantée, en disant :
— Tu prétends que vous ne tuez pas, que vous ne tourmentez pas, et pourtant voici du sang et un cercueil ?
— Ma fille, répondit le prêtre, c’est le sang de nos frères que vos frères ont tué.
La femme païenne sembla se tranquilliser, puis aussitôt elle fut saisie de tristesse.
— Nos dieux ne sont pas aussi cruels que nous, dit-elle ; ils ne sont pas comme les dieux de la Gaule et de la Germanie, qui demandent des sacrifices humains ; ils se contentent d’hécatombes de troupeaux, et le premier-né d’une génisse est plus agréable au dieu Mars lui-même que le sang versé dans les combats. Crois-moi, pontife du Dieu Christ, nos dieux sont doux et indulgents ; ils nous portent plutôt au plaisir qu’à la fureur, et même il faut qu’ils soient bien endormis, et que la blonde Hébé leur ait versé de l’eau du fleuve Léthé au lieu d’ambroisie, car ils nous abandonnent et ne semblent plus présider à nos destins en aucune manière. Quand les hommes sont quittés par les dieux, ils deviennent semblables aux barbares du Nord. Pour moi, je n’ai pas cessé de les servir comme je le devais. J’ai surtout invoqué les déesses, et j’ai cherché à me les rendre propices par des offrandes dignes de mon rang et de ma fortune, car je suis riche et patricienne, et l’on me nomme Léa.
— Vous êtes cette femme célèbre par son luxe et sa beauté, et vous venez ici braver la persécution et la mort ! Il faut que vous ayez senti le vide et la souffrance des joies humaines.
— Vieillard, j’ai senti les blessures de l’orgueil et la satiété des plaisirs, et, comme je suis jeune encore et que la tristesse me gagne, j’ai invoqué le ciel pour qu’il me rendît mes joies premières ; mais c’est en vain que j’ai sacrifié à toutes les divinités qui pouvaient me secourir. — En vain j’ai fatigué de mes pieds les marches de ton temple, ô Vénus ! je t’ai présenté six couples de jeunes colombes d’Afrique plus blanches que le lait ; j’ai touché de mes mains tremblantes et de ma bouche flétrie, au sein de la statue de Junon Victorieuse, la ceinture d’or incrustée de pierreries, image de celle que tu lui prêtas, dit-on, pour ressaisir l’amour de son immortel époux, le maître des dieux. Tu ne m’as pas rendu le pouvoir de plaire, déesse oublieuse ! et Junon, la fière souveraine de l’Olympe, ne m’a pas inspiré l’orgueil qui console de l’amour. — En vain j’ai brodé des voiles de Tyr pour te les présenter, ô Pallas ! tu ne m’as donné ni la sagesse, ni le goût des études et des travaux ! Hébé, c’est à toi que j’ai fait les plus riches offrandes, à toi que j’ai sacrifié des génisses sans tache et des agneaux d’un an. Le temps n’est plus où ta main invisible effaçait au front de tes privilégiées les premières rides qu’y imprime le temps ; où ta tendresse faisait chaque matin refleurir les roses sur leurs lèvres. Tu laisses les larmes creuser mes joues, et la couleur de l’iris s’étendre autour de mes paupières. — Ô toi, Cupidon, fils du Soleil, ne t’ai-je pas sacrifié le premier-né du lièvre, avant qu’il eût goûté le thym et la sauge dans les montagnes ! N’ai-je pas fait venir de Grèce des myrtes éclos dans les bosquets d’Amathonte et de Gnide, pour en semer les fleurs sur ton autel ? — Amour, ô Amour ! m’as-tu assez oubliée ! Dieux et déesses, vous êtes-vous assez enivrés en silence de la fumée de mes sacrifices ! ma plainte a-t-elle assez longtemps monté vers vous ! N’est-il pas bien temps que quelque divinité m’assiste et me console ! Qu’elle vienne du nord ou de l’orient, ou des provinces de l’Afrique, où l’on dit que les dieux sont noirs, ou de chez les Hébreux, qui n’ont qu’un seul dieu, toujours le même, à ce qu’on m’a raconté, pourvu que je sois exaucée, je lui offrirai les holocaustes les plus beaux, et je n’épargnerai à ses prêtres ni les honneurs ni les dons. Parle donc, ô vieillard, et demande à tes oracles si le Dieu des Galiléens peut l’emporter en puissance ou en bonté sur les nôtres, car ils sont devenus sourds !
— Femme, répondit Pamphile, nous ne recevons pas de présents, et nous ne rendons pas d’oracles.
— Comment donc servez-vous votre Dieu, reprit Léa, et à quoi vous sert-il ?
— Il nous a enseigné sa parole, mais il n’habite pas le flanc des vaines idoles. Il n’a pas besoin d’offrandes terrestres ; celle qu’il demande, c’est l’amour et le culte des cœurs fidèles. Et, quant à ses prêtres, eux et tous ceux qui adorent le Christ ont fait vœu de pauvreté et d’humilité.
— Vous ne lui demandez donc jamais rien, et il n’a donc rien à vous accorder ? Peut-être est-il comme le Destin, qui commande à tous les dieux, mais qui ne peut rien changer à ce qu’il a une fois décidé, quelque prière qu’on lui adresse ?
— Notre Dieu nous écoute et nous exauce, et, pour parler votre langage, afin de me faire comprendre, je vous dirai que le Destin lui obéit comme l’esclave à son maître. C’est sa volonté qui régit l’univers, et aucun dieu n’existe devant lui. Apprenez sa parole, étudiez sa loi, et vous saurez qu’il y a dans sa miséricorde des trésors plus grands que dans toutes les vanités de la terre.
— Faut-il donc, reprit la femme, que j’étudie vos mystères pour pouvoir faire une demande à votre Dieu, et ne me l’accordera-t-il pas tant que je n’y serai point initiée ? Alors, adieu, car mon train de vie ne me laisse pas le temps d’entendre vos prédications ; et, d’ailleurs, je serais persécutée à mon tour. Je pensais qu’en venant faire une offrande ici, j’obtiendrais une réponse quelconque, et m’en retournerais peut-être avec un peu d’espoir ; mais, puisqu’il est défendu aux prêtres de votre loi de recevoir les prières des païens, je m’en vais implorer encore Vénus pour qu’elle me rende la volupté, ou Vesta pour qu’elle m’enseigne la continence.
— Arrête, lui dit Pamphile avec douceur, il m’est défendu de présenter à mon Dieu des demandes folles ou coupables ; il m’a semblé que tu te plaignais du ravage des ans et de la fuite des amours profanes. La parole du Christ nous enseigne que la beauté de l’âme et l’amour pur sont sa seule beauté, le seul amour agréable au Seigneur. Mais, si j’ai bien compris tout ce que tu as dit, je vois que tu souffres du mal qui tourmente ta nation, c’est-à-dire le dégoût, l’ennui de mal faire ; tu implores à la fois les divinités fabuleuses qui, selon vous, président aux dons les plus contraires, la pudicité, la luxure, la science, la fierté, l’égarement, la sagesse. Ce que tu veux, tu ne le sais pas ; ce qui pourrait te guérir, tu l’ignores, et, je te le dis, tu ne me comprendras pas, car les instants sont comptés, tu ne veux passer ici qu’une heure, et ton esprit est si étranger à l’esprit du vrai Dieu, qu’il me faudrait un an pour te convertir… Mais écoute : voilà l’image de ce Dieu, agenouille-toi devant elle en signe de respect, non pour le bois de ce crucifix, mais pour le fils de Dieu qu’il représente et qui est dans le ciel. Élève ton âme vers l’Éternel, et dis-lui ta peine. Sache seulement que c’est un Dieu bon et indulgent, un père pour les affligés et les contrits, un Dieu d’amour pour les agités et les fervents. Il n’est pas besoin d’interprète, de prêtre, ni d’ange, entre lui et toi. Prie-le seulement de regarder au fond de ton cœur ; il verra ce qui s’y passe, mieux que toi même, et, si tu désires sincèrement le connaître et le servir, il t’enverra la grâce, qui est un don plus précieux et une consolation plus puissante que les fausses délices de la vie.
— J’ai ouï prononcer des paroles semblables aux tiennes, reprit Léa ; on m’a raconté que les Nazaréens, condamnés à mort dans ces derniers temps, invoquaient tous un Dieu qu’ils appellent le Dieu d’amour et de grâce. Cependant, on dit qu’il ne ressemble en rien au dieu de Cythère et de Paphos, et j’ai peine à comprendre quelle grâce tu me promets de sa part. Néanmoins, puisque tu me permets de prier dans son temple, je vais l’invoquer ; car, si les dieux immortels connaissent les secrètes pensées des hommes, il n’en est que plus efficace de les leur révéler par l’invocation, afin de leur prouver qu’on espère en eux.
— Fais ce que tu veux, ô aveugle qui cherches la lumière ! répondit Pamphile. Puisse le Seigneur Dieu t’ouvrir les yeux !
Alors, la dame romaine s’agenouilla sur la terre humide, et, rejetant en arrière sa belle tête ornée d’épingles et de bandelettes d’or, élevant vers l’image du Christ ses grands bras de neige, nus jusqu’à l’épaule, elle parla ainsi :
— Je ne sais quelle chose je dois te demander, ô Dieu inconnu ! mais je sais bien quelle plainte je puis adresser au ciel, car ma vie est devenue plus amère que l’olive cueillie sur l’arbre. J’ai vu à mes pieds l’élite des hommes, mais celui que j’ai choisi pour époux m’a délaissée pour de grossières voluptés. Tout son désir était de me voir abdiquer la sévérité de mes mœurs et de me jeter dans les bras d’un autre, afin d’avoir le droit de se livrer à ses honteuses amours. J’ai cru venger mon orgueil en aimant Icilius. Vous le savez, Dieu des Nazaréens, puisqu’on dit que, semblable à Jupiter, vous connaissez toutes les actions et toutes les pensées des hommes ; vous savez qu’Icilius a été indigne de mon amour et qu’il m’a abandonnée pour les courtisanes, me donnant pour prétexte qu’il ne pouvait aimer longtemps une femme sans fidélité. Antoine, qui, pendant quelque temps, fut enchaîné à mes pieds, fut coupable bientôt du même crime qu’Icilius ; et, pour motiver sa trahison, il répondit à mes fureurs qu’une courtisane n’était pas plus méprisable que la femme oublieuse de deux amours. Tu sais, ô Dieu ! que je ne m’abaissai point jusqu’à supplier l’infâme, et que je me hâtai de chercher un vengeur de mon injure ; mais tu sais que cet amour ne fut pas plus heureux que les autres, et que, toujours outragée, ma vie s’est consumée et ma beauté s’est flétrie dans d’inutiles transports de tendresse et de colère. Et, quand j’ai appelé sur ces traîtres la vengeance des dieux infernaux, tu sais qu’ils m’ont répondu que les dieux infernaux n’existaient plus, que Cerbère avait été étouffé par la Volupté, et que les Furies elles-mêmes étaient devenues faciles depuis que Plutus s’était partagé avec Priape et Comus l’empire de la terre.
» Voilà où nous en sommes, ô Dieu inconnu ! Les hommes ne croient plus à la justice des cieux, et les bacchantes effrontées insultent les tristes vestales. Lucine ne protège même plus la dignité des épouses et des mères, et les autels de Cypris ne sont plus desservis que par les ménades échevelées. Et cependant, les femmes n’existent que pour aimer et pour être aimées. Que deviendront celles que l’amour seul conduit à la couche de roses, si l’or crée des plaisirs plus âpres, et si les lupanars de Rome savent des secrets que nous ignorons ? Nos hommes nous préfèrent d’impures concubines : faudra-t-il que, pour les remplacer, nous appelions nos esclaves à nos embrassements ? Plus d’une parmi nous n’a pas rougi de le faire, et s’est abandonnée à de monstrueuses orgies, pour échapper à la solitude de son palais et à la rage de son amour outragé. Et cependant, la femme est faible, ô Dieu puissant ! et d’elle-même elle n’est point portée à quitter la première l’appui qu’elle s’est donné. L’honneur lui rend l’infidélité dangereuse et la lui fait expier par la honte. C’est donc l’homme que je viens accuser devant toi, Nazaréen ! c’est mon époux, c’est Icilius, c’est Antoine, c’est tous ceux que j’ai aimés en vain que je viens dénoncer à ta justice ; venge-moi d’eux, ou fais que je les oublie et que j’entre dans l’indifférence de la vieillesse. Si j’ai perdu une partie de ma beauté, et qu’en la retrouvant je retrouve la foi de ceux qui m’ont trahie, rends-moi la jeunesse et sa puissance. Mais quoi ! ai-je perdu mes attraits au point que la chanteuse Torquata, qui s’est usée dans la débauche, me soit préférable ? Est-ce Lycoris la Grecque, qui, veuve de neuf cents hommes, a plus de fraîcheur et de vivacité que moi ? Et, d’ailleurs, ne vois-je pas que les plus jeunes et les plus belles d’entre nous sont abandonnées comme moi pour la Prostitution aux lèvres livides ? Faudra-t-il nous montrer nues sur les théâtres ? faudra-t-il nous présenter ivres devant nos amants, pour réveiller en eux une étincelle de leurs feux endormis ?
» Et cependant, que ferons-nous, seules et méprisées, au fond de nos jardins silencieux ? Les charges de l’État, la guerre, les académies ne nous admettent point à ces travaux qui absorbent les hommes et les consolent de tout. Notre faiblesse et notre éducation nous en excluent. On nous instruit à plaire, et le premier soin de nos matrones, dès que nos cheveux flottent sur nos épaules, c’est de nous apprendre comment on les relève en tresses parfumées, et de quels joyaux on les orne, pour attirer les regards de l’homme. Nos travaux les plus sérieux se rapportent à la parure, et les seuls entretiens où nous ne soyons pas déplacées sont des entretiens qui allument nos sens et nous convient à la volupté. Et cependant, si nous nous conservons chastes, nous n’inspirons à nos époux qu’une froide estime et les langueurs de l’ennui. Si nous cherchons à les retenir sur notre sein par de jaloux emportements, ils nous soupçonnent et nous méprisent.
» Voilà, ô Dieu de Galilée ! voilà comme on traite les femmes de Rome ! voilà ce que sont devenues ces dames autrefois si respectées, qui donnaient leurs bracelets d’or à la patrie et qui ne portaient que des héros dans leurs flancs. La Luxure s’est couchée sur les places publiques, et tout un sexe a été la relever pour la porter en triomphe, sous les yeux des femmes honnêtes. Si ton peuple est fidèle aux vertus antiques, si ta loi force les cœurs à la fidélité et les reins à la continence, foudroie donc cette ville impure, ô Galiléen ! et fais-y régner une race nouvelle. Je t’ai dit les horreurs de nos destinées, réponds-moi par la bouche de ton prêtre. Qu’un oracle me console ou m’enseigne. S’il faut, pour me guérir de l’ennui et de la colère qui me dévorent, invoquer la magie, assister à d’épouvantables sacrifices, boire les poisons de l’Érèbe, je le ferai plutôt que de retourner sans espérance à ma couche solitaire et aux tortures de ma vengeance impuissante. — J’ai parlé à ton Dieu ; maintenant, prêtre, réponds pour lui. N’avez-vous point une sibylle pour le consulter ? Ah ! si vous connaissez un philtre pour inspirer l’amour aux hommes, ou pour l’éteindre dans le cœur des femmes, donnez-le-moi, je le boirai jusqu’à la dernière goutte, dût-il porter dans mes entrailles les angoisses de la mort. Réponds, vieillard, quelle hécatombe faut-il offrir sur tes autels ? Doutes-tu de mes richesses ? doutes-tu de mon serment ? J’immolerai à ton Christ tous les troupeaux de mes domaines ; je lui enverrai tous les vases d’or de mon palais. Veux-tu mes ornements, les bandelettes de mon front, les pierreries de ma chaussure ? On dit que vous acceptez les dons du riche pour les distribuer aux pauvres, et que ces dons rendent vos dieux propices. Je ferai tout pour acquérir le trésor de l’amour, ou celui de l’oubli.
— Femme infortunée, répondit Pamphile, ce que tu demandes n’est point en notre pouvoir. Notre Dieu ne nous confère pas le droit de travailler à satisfaire les passions humaines ; il sécherait la main criminelle qui voudrait embraser ou refroidir par des poisons le sang qu’il fait couler dans les veines de l’homme. Les serviteurs de ce Dieu de chasteté professent la chasteté à son exemple. Ceux d’entre nous qui se marient regardent la fidélité comme le devoir de l’homme aussi bien que celui de la femme, et le crime de la trahison est égal pour les deux sexes. C’est parmi les chrétiens seulement que l’amour sincère et durable peut régner. Ils n’adorent qu’un maître, qui, à lui seul, résume toutes les vertus, tandis que vos païens adorent tous les vices sous la figure de diverses divinités. Ces divinités, ma fille, ce sont les noirs démons, et, loin de les aduler et de les craindre, il faut les mépriser et les haïr. C’est au Dieu de pardon, de douceur et de pureté, que vous devez sacrifier, non des agneaux et des génisses, mais tous vos désirs de vengeance, toutes les révoltes de votre orgueil, et tous les vains plaisirs de votre vie.
— Ma vie est sans plaisirs et sans repos désormais, s’écria la Romaine ; je ne puis rien sacrifier à ton Dieu que ma haine et mes ressentiments, s’il m’accorde ces plaisirs qui me fuient, et ce repos que je demande.
— Ces plaisirs, mon Dieu ne les bénira jamais. Il les réprouve, il les défend à ceux qui ne les ont pas sanctifiés en son nom par un serment indissoluble.
— Et quelle consolation accorde-t-il donc aux femmes délaissées ? dit Léa en se levant.
— Il leur tend les bras, répondit le chrétien, et il les invite à se consoler dans son sein.
— Ô prêtre ! dit la Romaine, cet oracle est obscur, et je ne le comprends pas. Puis-je aimer ton Dieu, et ton Dieu peut-il m’aimer ?
— Oui, ma fille, Dieu aime tous les hommes, car ils sont ses enfants, et, quand les hommes s’abandonnent entre eux, il console ceux qui se réfugient en lui. Essaye de l’amour divin, ô Léa, et tu y trouveras des délices si pures, qu’elles te feront oublier toutes celles de la terre.
— Tes oracles m’étonnent et m’épouvantent de plus en plus, dit la femme en s’éloignant de l’autel, et en ramenant à demi son voile sur sa figure. L’amour des dieux est terrible, ô vieillard ! et il en a coûté cher aux mortelles qui ont osé s’y abandonner. Sémélé fut réduite en cendres par l’éclat de la face de Jupiter, et la jalouse Junon poursuivit Latone…
— Arrête ! pauvre insensée, et rejette ces pensées d’ignorance et de néant. Le vrai Dieu ne descend pas aux faiblesses des hommes, car il n’est pas revêtu d’une enveloppe terrestre comme vos maîtres fabuleux. Ô fille du siècle ! tu es engagée si avant dans les voies de l’erreur, que je ne sais quelle langue te parler. Le temps me manque pour t’instruire. Veux-tu être chrétienne ?
— Comment puis-je le vouloir, si je ne suis pas assurée d’y trouver la fin de mes douleurs ?
— Je te promets, au nom de l’Éternel, la consolation en cette vie, et la récompense dans l’autre.
— Et comment croirai-je à tes promesses, si je n’ai pas, dès à présent, quelque preuve de la puissance de ton Dieu ?
— Demanderai-je donc à Dieu de te convaincre avec des prodiges ? dit le prêtre se parlant à lui-même plutôt qu’à la dame romaine.
— Fais-le ! s’écria-t-elle, et je me prosternerai.
— Non, répondit Pamphile, car ton âme est dans les liens de l’erreur, et ce n’est pas encore la voix du Ciel qui t’appelle à la conversion ; c’est celle de tes passions, et elles luttent trop encore pour que tu entendes la voix de Dieu. Écoute, femme : retourne chez toi, efforce-toi d’oublier l’homme qui t’a offensée, et vis dans la continence. Condamne-toi à la solitude, à la retraite, à la douleur ; offre à Dieu tes souffrances et tes ennuis, et ne te lasse pas de les supporter. Lorsque tes souffrances te sembleront au-dessus de tes forces, n’invoque ni Vesta ni Vénus, oublie ces fantômes ; mets-toi à genoux et regarde le ciel où règne le Dieu vivant ; alors, tu diras ces paroles : « Vrai Dieu ! fais que je te connaisse et que je t’aime, car je ne veux connaître et aimer que toi. »
— Et alors, quel miracle fera-t-il en ma faveur ? dit la Romaine avec étonnement.
— La vérité descendra dans ton cœur, l’amour divin relèvera ton courage, le calme renaîtra dans tes sens, et tu seras consolée.
— À jamais ?
— Non ; l’homme est faible et ne peut rien sans un continuel secours d’en haut. Il faudra prier toutes les fois que tu seras affligée.
— Et je serai consolée chaque fois ?
— Si tu pries avec ardeur et sincérité.
— Et je serai chrétienne ? dit Léa avec inquiétude. Mon époux me dénoncera et m’enverra à la mort !
— Ces persécutions s’affaibliront, et le Christ triomphera, dit Pamphile. En attendant, ne crains rien, ne révèle encore à personne ta foi nouvelle, et prie le Dieu inconnu dans le secret de ton cœur. Avant peu, tu auras soif d’instruction et de baptême ; et, quand tu seras chrétienne, tu ne craindras plus le martyre. Retire-toi, l’heure est passée. Quand tu auras senti l’effet de mes promesses, tu reviendras aux catacombes.
Le lendemain, les catacombes furent envahies, les chrétiens dispersés, et, pendant deux ans, la religion du Christ sembla étouffée dans Rome. Pamphile retourna à Césarée, et Eusèbe vint prendre sa place dans la ville de saint Pierre, muni des instructions de son ami. Il rassembla le troupeau et le trouva augmenté. La foi avait grandi dans les fers ; la vérité s’était propagée dans l’ombre, et, jusque dans les rangs des anciens persécuteurs, de nouveaux frères communiaient d’intention avec les fidèles.
Une esclave africaine s’approcha d’Eusèbe, un soir qu’il traversait la cité des Césars pour se rendre à une crypte ignorée dans la campagne. Cette femme avait longtemps marché derrière lui, et il l’avait prise pour un espion. Aussi était-il prêt à retourner sur ses pas pour la tromper sur le but de sa promenade, lorsqu’elle lui dit :
— Au nom du Dieu de Nazareth, une dame romaine veut vous voir à ses derniers moments. Suivez-moi et ne craignez rien, car votre Dieu est avec nous.
Eusèbe la suivit, et, après avoir traversé, à la nuit tombante, les ombrages épais d’une magnifique maison de campagne, il fut introduit auprès de Léa. La dame romaine, dans sa robe de pourpre, et déjà froide, se souleva de son lit d’ivoire, et lui dit d’une voix éteinte :
— Es-tu Eusèbe, l’ami de Pamphile ?
— Je le suis, répondit le saint apôtre.
— Eh bien, dit la Romaine expirante, viens me donner le baptême, car je veux confesser le Dieu inconnu en mourant. Il y a deux ans que je le prie et que je pleure en invoquant son secours. Pamphile me l’avait promis ; ma douleur m’est devenue chère, et mes larmes ont cessé de me brûler. J’ai vécu comme il m’a dit ; j’ai abandonné les plaisirs, et le cirque, et les festins, et les chars, et le temple des dieux impuissants ; retirée au fond de mes jardins silencieux, j’ai prié toutes les fois que j’ai senti le regret de mes funestes joies me tourmenter, et, toutes les fois, un calme miraculeux, un étrange bonheur sont descendus en moi. Je n’ai pu être instruite dans vos mystères ; il eût fallu exposer un de vous à la persécution, et j’attendais un meilleur moment. Mais la mort ne m’en laissera pas jouir. Je meurs, et je meurs en paix, avec l’espérance de voir ton Dieu, car ce que Pamphile m’a prescrit, je l’ai fait : j’ai prié avec ardeur et sincérité. J’ai dit sans cesse la prière qu’il m’avait dictée : « Vrai Dieu, fais que je te connaisse et que je t’aime !… »
La parole expira sur les lèvres de Léa ; Eusèbe versa l’eau sainte sur son front, où s’étendait déjà le voile livide de la mort, en lui disant :
— Que Dieu t’enseigne lui-même dans les cieux ce que tu n’as pu apprendre sur la terre ! L’expiation et la sincérité sont le véritable baptême qu’il exige ici-bas.
Léa sourit, et l’esclave qui la servait, s’étonnant de la beauté sublime qui se répandait sur son visage, courut chercher un miroir d’acier poli et le lui présenta en s’écriant avec naïveté :
— Ô ma maîtresse, ne crains pas de mourir, car voici ta jeunesse qui refleurit sur ton visage. Ton œil brille, ta lèvre s’empourpre ; le Dieu de Galilée a fait un prodige en ta faveur, et, si les hommes te voyaient en ce moment, ils abandonneraient toutes les femmes pour s’incliner devant toi. Lève-toi donc, fais préparer ton char ; je vais nouer et orner tes cheveux, César lui même t’adorera aujourd’hui.
Léa contempla son image dans le métal étincelant ; puis, laissant retomber son bras affaibli :
— Si le Dieu de Galilée me rendait la vie, je ne voudrais pas retourner parmi les hommes. Je ne voudrais pas que ma beauté, rajeunie par son amour mystérieux, devînt le trophée souillé d’un mortel contempteur. Je sens que je meurs, et que je vais rejoindre le foyer d’impérissable beauté appelé par le divin Platon le souverain bien. Lui aussi, il a placé aux cieux la source d’amour et de perfection… — Ô prêtre ! cette eau que tu verses sur mon front n’est-elle pas l’emblème de la source inépuisable où je vais me désaltérer ?
— Oui, ma fille, répondit le prêtre.
Et, lui parlant de rédemption et d’espérance, il la vit mourir avec le sourire sur les lèvres. Le calme qu’elle avait trouvé en se vouant au culte du Dieu inconnu, et la tranquillité de son heure dernière, frappèrent tellement l’esclave noire, qu’elle suivit Eusèbe à la crypte des chrétiens et embrassa la religion du consolateur des amantes et du rédempteur des esclaves.
LA FILLE D’ALBANO
C’était un dimanche, et l’un des beaux jours de mai ; le son de la cloche vibrait au fond de la vallée ; tout le hameau avait un air de fête. Les jeunes filles couraient avec leur bonnet blanc à tuyaux empesés ; le garde champêtre marchait gravement avec la plaque luisante au bras ; des jeunes gens apportaient des corbeilles pleines de fleurs, et d’autres suspendaient au porche gothique de l’église paroissiale de fraîches guirlandes de pervenches et de marguerites qui fuyaient sur les crevasses poudreuses et les arabesques éraillées du frontispice. Les hirondelles décrivaient de grands cercles dans le ciel bleu, et, dans l’air embaumé de violettes, on respirait un parfum de bonheur !
C’était bien autre chose au château ! Le château était un de ces vieux manoirs qui s’effacent peu à peu du sol de la France, et que le voyageur aime tant à retrouver habillés, avec leur air d’opulence seigneuriale, leurs tableaux de famille et leurs grandes cours ouvertes à tout venant, au carrosse armorié du seigneur voisin, au souple landau du riche industriel, au mendiant chargé de la besace, au pauvre artiste qui voyage à pied et qui se repose là où le ciel est beau et la campagne riante.
La dame du lieu, aussi hospitalière dans sa dignité de châtelaine que le manoir dont elle faisait les honneurs, était encore belle avec cet embonpoint qui est pour la beauté comme l’été de la Saint-Martin ; ses cheveux gris, artistement frisés, faisaient un fort bon effet sous un bonnet de dentelle, et l’on aimait à voir, parmi ces boucles argentées, des roses artificielles qui semblaient défier le ridicule. En effet, la raillerie aurait expiré sur les lèvres de tout homme qui eût rencontré le regard bienveillant et le sourire affectueux de madame de Nancé, et, lorsqu’on avait pressé sa main blanche et ronde, il était impossible de se soustraire à la sympathie vraie qui était comme répandue dans l’atmosphère de cette femme excellente.
Avec les grands talents et le haut caractère d’un magistrat recommandable, Aurélien de Nancé avait toute la beauté qu’avait eue sa mère, toute la bonté de tempérament qu’elle avait encore. Une inclination marquée, en d’autres termes, une forte passion, l’avait décidé à épouser une jeune personne sans nom et sans fortune, mais telle, que la famille riche et noble des Nancé n’eût pu la repousser sans ridicule et sans injustice.
Elle était là, sans diamants ni dentelles, sans autre ornement à ses cheveux que le voile de gaze et le bouquet blanc de la fiancée ; belle de grâce, de poésie et de jeunesse, Laurence n’était plus une enfant ; elle connaissait déjà le monde, et pourtant, au milieu de l’assemblée solennelle des grands parents, elle avait une gaucherie qui trahissait son goût pour la liberté, et qui, chez elle, était une grâce de plus. Se croyait-elle oubliée, c’était une autre femme : son regard rêveur devenait imposant, et la douce gravité de son front ressemblait à la conscience modeste d’une supériorité involontaire.
C’était quelque chose de touchant que de voir l’amour et le respect dont madame de Nancé et son fils entouraient Laurence, quelque chose de touchant que cette adoption de l’orpheline, cimentée par le cœur, avant de l’être par la loi, que cette confiance de la femme qui, pauvre et délaissée, acceptait sans rougir les dons de son amant.
Aurélien était maire de la commune. Ne pouvant se marier lui-même, il avait mandé son adjoint, brave paysan gêné dans son habit neuf et dans la société de ses maîtres, soupirant après le moment de se débarrasser de sa cravate et de sa dignité. Mais, pour ne pas laisser de lacune entre le mariage civil et la bénédiction religieuse, on prolongeait les angoisses du bonhomme, parce que M. le curé n’était pas de retour. Le pasteur villageois avait été porter les derniers secours à un mourant fort éloigné dans la campagne, et tout le monde attendait, dans cette sorte de gêne qui s’empare de gens réunis pour jouer un rôle, et décontenancés de voir intervertir l’ordre de la représentation.
Laurence ne put résister à ce malaise, dont, moins que personne, elle avait appris à subir le supplice. Elle monta sur une terrasse parée de fleurs qui s’élevait au milieu d’un petit parc solitaire, et, là, appuyée sur le balcon, elle promena sur la campagne un regard mélancolique. C’était là son pays désormais ! l’enceinte où devaient s’enfermer ses affections, ses rêves et ses espérances ! À elle une maison, des devoirs ! À cette âme libre et fière, dont le monde à peine était la patrie, un espace de terrain limité, des chemins qui devaient toujours porter dans le même jour l’empreinte de ses pas tournés vers l’horizon, et l’empreinte de ces mêmes pas retournant au point de départ ! Un toit écrasé pour couvrir, chaque soir, sa tête ardente de voyages, un climat ramenant avec régularité le chaud et le froid, sans qu’elle pût jamais hâter le soleil ou se soustraire à la bise glacée ! Dans une heure, tout serait dit…
Un froid mortel tomba sur son cœur.
Et puis elle pensa à Aurélien… L’amour est comme la magie, il rend naturel ce qui semblait impossible. L’artiste redevint femme, et les rêves d’un autre bonheur effacèrent les regrets futiles d’un bonheur perdu.
Où trouver une âme assez forte, assez sceptique, pour hésiter devant les promesses de l’amour, pour repousser ces serments si flatteurs à l’oreille et qui sont si doux au cœur ? Si cette âme existe, ce n’est pas du moins celle d’une femme. Elle rêvait donc de bonheur et d’amour, lorsque des pas firent crier le sable à ses côtés… C’était un homme en habits de voyage, couvert de poussière ; une chevelure en désordre tombait sur son front large et safrané ; sa barbe était épaisse et noire, et ses grands yeux, enfoncés sous leurs orbites, étaient vifs et brûlants comme des éclairs.
— Oh ! mon Dieu ! c’est toi ! s’écria Laurence en se jetant dans ses bras ; c’est toi ! Tu as donc voulu que ce jour fût le plus beau de ma vie ?…
— Ma sœur, mon enfant, disait l’étranger en caressant les cheveux noirs de la fiancée, je n’arrive donc pas trop tard ?
— Non, non, tu assisteras à la noce, tu verras l’église et l’autel ; tu feras un beau tableau de la cérémonie, n’est-ce pas ? Oh ! que tu dois bien peindre, maintenant !
— Et toi, Laurence, et toi ! as-tu donc abandonné ton art ?…
— Oh ! non… Il aime tant à me voir travailler !
— Le bourgeois ? murmura l’étranger à voix basse. Sommes-nous seuls ici ?
Laurence pâlit, parcourut d’un œil inquiet les allées sinueuses du parc ; puis, après un moment d’hésitation, conduisit son frère dans la chambre qu’elle habitait, et, après en avoir fermé la porte :
— Expliquez-vous, dit-elle en se laissant tomber sur une chaise, avec une sorte de terreur.
— Mon enfant, dit l’artiste, car vingt ans de plus que toi m’ont donné le droit de te regarder comme ma fille ; as-tu bien réfléchi à ce que tu vas faire ?
— Réfléchi ?… Oui, Carlos… Je l’aime !
— Ah ! femme !… s’écria-t-il en frappant du pied, aimer un bourgeois ! toi, ma sœur ! un ampliateur de la loi écrite, un homme à métier, un homme qui mesure la vie avec un compas, et qui envoie à l’échafaud celui dont la mesure est plus petite ou plus grande que la sienne !… Écoute : tu es libre et je t’aime ; tu peux te marier, tu ne peux pas te brouiller avec moi. Ce que je t’ai écrit de Rome, je te le répète encore ; fais ta volonté. Mais je suis venu un peu tard, je le vois ; et ce n’est pas lorsque ton front est paré de la couronne du mariage que je dois espérer de te rendre à la liberté ; tu m’entendras pourtant, et, après…, je souscrirai à ton mariage ; j’en souffrirai, et ne t’en aimerai que mieux, car tu en auras besoin, pauvre enfant !
Laurence laissa tomber son front blanc et pur sur sa main veinée de bleu, et une larme, qu’elle s’efforça vainement de retenir, roula sur son bouquet de jasmin et d’orange.
Carlos, qui se promenait en silence dans la chambre, s’arrêta tout à coup pour la regarder.
— Belle comme la vierge du Corrége ! disait-il ; et, avec tant de poésie dans le regard, tant de feu dans l’âme, tant de génie entre les mains, végéter parmi des légistes et des calculateurs, amasser une fortune, faire des enfants, être la première servante d’une famille et d’un homme ! Ô ma sœur ! ma pauvre sœur !… Et, sans doute, ils ont réussi à te prouver qu’une femme n’était pas née libre, que la gloire déshonorait ton âme ; qu’il fallait jeter l’eau et la cendre sur le feu sacré !… Ma sœur, ma fille, mon élève, perdue, perdue !
— Non, Carlos ; telle que le ciel m’a faite, ils m’ont prise, ils m’ont aimée ; loin de leur sacrifier mes goûts, mes idées indépendantes et ma passion des arts, c’est lui, c’est sa mère, qui m’ont sacrifié leurs croyances pour m’attirer sur leur sein, pour me faire asseoir à leur bonheur, sans vouloir m’exiler du mien.
— Ils ont donc daigné, les superbes, te pardonner ton génie ! Dis-moi, ton mari te pardonne-t-il aussi d’être belle comme l’entendait Van Dyck ? Ne t’a-t-il point prescrit de lisser tes boucles rebelles à la main de la camériste, de serrer dans des lames d’acier ton corsage andalous, de baisser tes yeux de feu, et de faire usage de cosmétiques pour pâlir ton coloris oriental ?… Oh ! calme-toi, ton époux est charmant, ta belle-mère parfaite… On se résigne à toi, on t’admet sans reproches. Sais-tu bien, maintenant, les devoirs que ta condition t’impose ? Connais-tu l’esclavage ? As-tu passé une heure entière dans une prison, et sais-tu que la vie est longue ? Tiens, regarde ces fossés qui n’ont plus d’eau, ces bastions écroulés, cette herse qu’on ne baisse plus ; autrefois, c’est ainsi que l’on gardait les femmes… Dans la cour, des hommes d’armes, des préparatifs de combat ; de l’autre côté du mur, la guerre et les dangers, les meurtriers ou les ravisseurs, le trépas ou l’infamie. C’était peu de chose, après tout, tant qu’il y avait un beau page dans le château et un mari en Palestine. Eh bien, aujourd’hui, il y a des entraves plus fortes pour la femme que le fer des lances et la pierre des fortifications : le préjugé, l’usage ! Voilà vos liens, et malheur à celle qui les brise ! Il lui reste du mépris dans le cœur des femmes, et, dans celui des hommes, un amour qui outrage. Adieu donc la liberté ! La récolte manquera, ou la faveur du ministre ; puis ta belle-mère aura la goutte, il faudra soigner l’héritage d’un oncle riche et cacochyme… Et, lorsque tu seras sur le point de donner un fils à ton heureux époux, dans la crainte de voir s’évanouir une espérance aussi chère (car une femme comme toi ne pourra devenir mère à la manière du peuple), une prudence féroce t’imposera les ennuis rongeurs d’une captivité de six mois, et sacrifiera sans pitié les beaux jours de ta jeunesse à l’espoir incertain d’un rejeton illustre, déjà vicomte dans ton sein… Adieu l’avenir !… adieu le laurier du concours !… adieu l’Italie !
— Aurélien désire l’Italie autant que moi même. Ne t’ai-je pas écrit que nous devions aller t’y rejoindre ?
— Oui, en poste, avec une escorte de gendarmes pour protéger tes émotions dans l’Apennin, et une place au spectacle dans la loge de l’ambassadeur. Adieu nos soupers d’artistes, étincelants de verve et de poésie, où, dans la chaleur nerveuse du cerveau, le peintre ébauchait hardiment les traits de la danseuse aérienne mollement courbée sous les vibrations du hautbois, ou bondissant comme une bacchante aux chants frénétiques de l’ivresse ! L’ivresse de l’artiste ! l’exaltation fougueuse d’un délire sublime, la brûlante sensation du plaisir intellectuel ! la débauche du génie, l’invasion du feu céleste ! l’ivresse qui broyait de l’âme sur la palette de Salvator et sous l’archet de Tartini ! Va donc ! dans le monde qui t’attend, l’enthousiasme fait scandale, et, froide et désenchantée, il te faudra renoncer à toutes les jouissances de la pensée, à ces courses nocturnes que nous faisions autour des vieux monuments, à ces muettes extases qui nous enchaînaient sous les gothiques arceaux des temples du moyen âge. La piété est le devoir d’une mère de famille ; tu iras à l’église pour prier Dieu… Et pourtant, quels transports je t’ai vue exprimer alors que tu étais pauvre fille vivant de la palette et de l’inspiration ! Rappelle-toi notre séjour à Paris, notre maison sur le quai désert, l’antique cité, la ville de l’histoire ! Rappelle-toi ces deux tours, sœurs rivales, se haussant dans l’air lumineux, pendant que la lune, molle et nonchalante, découpait en festons d’argent leurs galeries aériennes, et leurs faisceaux de colonnettes !… Toi, tu demeureras dans la Chaussée-d’Antin, dans des rues bâties d’hier, alignées comme des vers classiques, blanches comme les mains de l’oisiveté ; et, d’ailleurs, qu’irais-tu faire ailleurs, sultane fourvoyée au milieu des profanes que mettrait en fuite ton odeur d’ambre, et des bacheliers d’outre-Seine qui oseraient louer tout haut ta beauté, en dépit du couteau de chasse luisant à la ceinture de ton heiduque ?
— Arrête, Carlos ! arrête ! Ces souvenirs me font mal, dit Laurence, dont le cœur battait violemment. Par pitié ! ne me force pas de reporter ma pensée sur un passé perdu sans retour, beau comme la jeunesse, comme elle inressaisissable !
— Tu crois ! dit l’artiste en saisissant le bras de sa sœur, et ses yeux brillèrent d’un feu subit ; tu crois que nous ne pourrons plus être heureux ! Qui donc a brisé notre coupe et caché les morceaux ? Quels liens pèsent sur toi ? Voilà les seuls…
Et il arracha brusquement le bouquet de fleurs d’oranger, et le froissa dans ses mains.
— Carlos, j’ai fait un serment !
— L’homme n’a pas le droit d’en faire, puisqu’il n’a pas les moyens de les tenir. Fou qui se lie pour le lendemain ! Autant vaudrait promettre sur sa tête un ciel d’azur à tout un jour.
— Je suis femme, mon frère, j’ai besoin d’affection. J’étais seule, et j’ai trouvé une famille : j’avais rêvé l’amour et je l’ai inspiré.
— Le génie n’a pas de sexe. Autre chose est la femme née pour perpétuer l’espèce, et l’artiste qui vit de la vie de tout un monde. L’artiste ne s’appartient pas, les détails de la vie commune ne vont pas à sa taille. Bientôt le dégoût et l’ennui, l’ennui poignant, la torture, la fin atroce d’une âme active, viendront ternir pour lui ce faux éclat de bonheur qu’en vain promet la vie positive. Ah ! tu l’avais tant promis, de n’être jamais qu’artiste ! Tu étais si fière de ta liberté, de tes mœurs pures et larges comme la bonne foi, calmes comme la conscience forte ! C’était bien la peine de refuser ce pauvre Henriquez, qui t’aurait donné jusqu’à son dernier pinceau, qui te plaçait dans toutes les créations de son jeune talent ! Mais tu le sacrifias à sa gloire et à la tienne ; tu brisas ton cœur et le sien, et, maintenant qu’il a conquis le succès sous le ciel de sa patrie, il te bénit, il te rêve encore jeune et belle sous les murs de l’Alhambra, il te pleure en même temps qu’il te remercie de l’avoir sauvé. Te souviens-tu du jour où tu vis son visage pâlir à ton refus, et son enthousiasme se rallumer ensuite à l’avenir de peintre et d’indépendance que tu lui déroulais avec feu ? « Elle a raison ! s’écria-t-il en se tournant vers ses compagnons. Alvarès, Gaetano, Bragos, en Espagne ! — En Espagne ! en Espagne ! disaient-ils avec transport. — À Rome ! » s’écriaient les autres ; et un pauvre plâtre qui représentait l’Amour avec son carquois et son bandeau classiques, fut brisé en éclats comme un holocauste à la liberté. Ah ! comme ils t’aimaient tous, mes braves élèves ! Quel saint respect pour la confiance de ta candeur ! Comme, au bruit de tes pas, les statues se voilaient, les chevalets se renversaient ! Et, quand tu t’asseyais par hasard sur un marbre antique, tes cheveux noirs flottants sur ta mantille, les genoux pliés sous la mandoline émue à l’approche de tes doigts, en moins d’un instant, tu étais représentée sur vingt toiles comme si l’atelier avait eu vingt glaces pour te réfléchir ! Ah ! que tu faisais palpiter de cœurs et brûler d’imaginations ! que d’âme tu prêtais au pinceau ! que de vie tu versais sur la toile ! Et cet amour que tu semais autour de toi, qu’il était pur et chaste dans toutes ces jeunes têtes éprises de ma Laurence comme d’un rêve embaumé, comme d’une mélodie céleste, comme d’une apparition fantastique surgie des tableaux des grands maîtres !… Et maintenant, tu vas être aimée d’un amour conjugal, d’un amour terne et paisible, sans jalousie et sans vénération, sans emportement et sans culte ! Puis ils diront : « Elle était célèbre, elle s’est faite obscure ; elle avait une grande destinée, et elle l’a étouffée dans son ménage ; elle a renié la gloire pour conquérir l’estime… Ô misère ! C’est-à-dire, elle nous dépassait de la tête, et nous lui avons crié : À genoux ! C’était une étoile aux cieux, nous en avons fait un diamant pour orner notre sceptre ; le monde la réclamait, nous l’avons volée au monde. Qu’elle nous bénisse donc, la femme que nous avons dépouillée de son avenir, que nous avons nivelée à notre médiocrité ! » Et, s’ils soupçonnent un regret dans ton âme flétrie, s’ils surprennent une larme se cachant dans tes cils, ils t’en feront un crime, les barbares ! Car, ma sœur, la tristesse d’une femme déshonore un époux : pour être vertueux jusqu’à la lie, il faut même qu’elle renonce à pleurer.
Carlos pleurait lui même en parlant ; sa sœur se jeta dans ses bras et l’y serra avec force, comme si elle eût craint qu’on ne vînt l’en arracher déjà.
— Reste ! reste ! disait le peintre en la pressant sur son sein.
Et ses larmes tombaient sur la tête de la fiancée.
— Enfant, ajouta t-il, enfant qui veux une famille ! Eh ! n’as-tu pas le monde ? Toi qui l’avais adopté pour patrie, le trouves-tu trop vaste ? déborde-t-il ton âme ? Que fait au bohémien la terre qu’il foule de ses pas vagabonds, le ciel sous lequel repose sa tête indépendante ? La terre n’est-elle pas à lui ? tous les lieux n’ont-ils pas du soleil ? Ainsi l’artiste : il a l’univers pour famille ; sa patrie, c’est le sol qui l’inspire. Et puis tu te plains d’être seule… Seule, ingrate ! et Carlos ? et ton frère ?
— Mon frère ! s’écria la jeune fille en jetant ses bras blancs au cou du peintre.
Et elle pleurait.
— Pleure ! lui disait-il, pleure !… Je t’ai vue naître, je t’ai bercée sur mes genoux, je t’ai endormie de mes chants, et tu l’as oublié ! Ton enfance a grandi près de moi, je l’ai réchauffée de ma tendresse, j’ai couvé ton jeune talent, et tu me quittes ! je t’ai façonnée pour la liberté, te voilà esclave ! Appuyés l’un sur l’autre, nous avons défié l’avenir ; chacun de nous avait une âme toujours prête pour échanger la sienne et tu te trouves seule !
Laurence l’enlaçait de ses bras.
— Malédiction ! s’écria-t-il, que ne le disais-tu plus tôt ? j’aurais taillé ton âme pour ce monde où tu veux vivre ; j’aurais rétréci ton esprit, j’aurais raccourci les lisières, et bientôt, naturalisée dans la société qui t’attire, tu n’y serais pas comme une étrangère, gauche et timide au milieu d’un cercle où l’on ne parle pas sa langue. Il est trop tard !… L’arbuste obéit à la main qui l’incline : l’arbre ne ploie pas, il casse. Va donc y dépérir de misère et d’ennui ; va donc végéter sur ce terrain ingrat où l’espace manquera à tes pas, l’air à tes poumons, l’indépendance à ton allure ! Et moi, moi qui n’avais que toi, ma sœur, je traînerai mes jours désenchantés loin de toi qui pouvais me les faire si beaux !
— Ah !… s’écria la jeune fille.
Et elle arracha de son sein le bouquet de la fiancée.
— Vois, que le ciel est pur ! que l’air est enivrant ! que l’horizon est vaste ! s’écria Carlos rayonnant de joie et d’espérance ; vois, que la campagne est belle ! À nous tout cela ! à nous le monde !…
Ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
— Libre ! dit Carlos avec enthousiasme.
— Libre ! répéta Laurence en respirant plus largement.
Elle écrivit quelques mots sur un papier, le joignit à la couronne blanche qu’elle avait détachée de sa tête, le plaça sur une table, et, laissant tomber un dernier regard sur cette chambre qu’elle allait quitter pour jamais :
— Viens ! s’écria-t-elle en saisissant le bras de son frère…
Le curé du village était de retour, les cierges s’allumaient, les registres de l’état civil étaient ouverts, et le cortége allait partir. Aurélien, après avoir vainement cherché sa fiancée dans le jardin et dans le parc, courut à sa chambre, tressaillit à l’aspect des fleurs froissées qui jonchaient le parquet, saisit en tremblant le billet et la couronne.
« Je vous la rends, lui écrivait Laurence ; jamais à vous ! jamais à un autre ! »
— Laurence ! où est Laurence ? cria d’une voix tonnante Aurélien éperdu, au cortége qui attendait sur la terrasse.
— Ma fille ? dit madame de Nancé avec effroi.
Tous se regardèrent avec étonnement.
Cependant, au bout d’une ligne blanche et poudreuse qui coupait les champs et les guérets, une chaise de poste volait, rapide comme le vent, et on entendait encore le claquement du fouet, les cris du postillon et le bruit sourd des roues qui laissaient derrière elles des nuages de poussière.
Aurélien fut sérieusement malade ; il eut des attaques de nerfs, une fièvre cérébrale, une convalescence pénible et lente.
L’année d’après, il reprit ses travaux par une mercuriale fort remarquable : ses amis crurent remplir un devoir en lui donnant des éloges proportionnés au degré d’intérêt que son malheur et son talent avaient le droit d’inspirer. Ce fut une première consolation qu’il goûta malgré lui et presque à son insu.
L’année suivante, madame de Nancé fut malade à son tour ; Aurélien soigna sa mère avec dévouement, avec anxiété. Lorsqu’elle revint à la vie, Aurélien sentit le prix de ce qui lui restait à toutes les angoisses que la crainte de la perdre avait réveillées en lui. Ses facultés de souffrir n’avaient point été épuisées par la fuite de Laurence ; ses facultés d’aimer ne l’étaient pas non plus. Pendant toute cette année, il vécut pour sa mère.
L’année suivante, il épousa une jeune demoiselle de bonne maison, qui lui apporta trente mille livres de rente, et, à force de s’entendre dire que la fortune avait une influence directe sur le bonheur, il commença à le croire.
L’année suivante, il fut père et s’attacha à la mère de son fils.
L’année suivante, il amena sa famille à Paris.
Un jour, il voulut voir les nouveaux chefs-d’œuvre qu’Horace Vernet venait d’envoyer à Paris. La foule se pressait dans la galerie du Luxembourg ; le portrait d’une jeune fille d’Albano attirait tous les regards ; sa robe d’un rose pâle, ses dentelles d’un blanc mat, faisaient ressortir d’une manière neuve et fraîche le ton solide de son chaud coloris et les ombres de son large front.
— Quelle finesse de peau ! disait-on ; quelle pureté de sourcils ! quelle coupe de visage ! que de pensées ensevelies sous cette rêverie pieuse, de passions cachées sous cette calme méditation ! Jamais Française n’eût inspiré l’idée de cette création suave et brûlante.
Aurélien s’approcha ; cette ravissante Italienne, c’était le portrait de Laurence… Il s’évanouit.
Aurélien est un homme de mérite ; il sera pair de France, si la pairie devient élective, ou ministre, si le ministère devient plus national.
CLÉOPÂTRE
Cléopâtre est un type double, également remarquable par son côté moral et par son côté historique. Dans l’ordre moral, elle représente la passion pure ; dans l’ordre historique, la tyrannie pure. Et nécessairement ces deux ordres se mêlent et s’identifient presque. Cléopâtre aime Antoine avec ardeur, avec caprice, avec peur, avec insolence, comme peut aimer seulement une Égyptienne, et une Égyptienne reine, esclave de Rome, despote de son peuple. De pudeur fausse ou vraie, pas l’apparence. Et cela la distingue autant comme femme que comme reine.
Voyez quel contraste elle forme avec la rivale qu’elle déteste ! Octavie est bien la matrone romaine, belle, grave, pure, froide ; la femme qui n’est sortie de la maison paternelle que pour entrer sous le toit conjugal ; qui, devenue veuve, est allée demander à son frère la protection que lui donnait auparavant son mari ; la femme qui pourrait sans crainte attacher sa ceinture immaculée à la galère sacrée, certaine de l’entraîner sur ses pas. Pour elle, la liberté n’est qu’un nom, l’amour n’est qu’un devoir. La chasteté est la déesse qui préside à sa vie, comme à celle de Cléopâtre la volupté. C’est à cause de cette différence que la reine hait, craint et méprise à la fois la matrone. Elle sent que sa rivale a une vertu qui lui manque, une vertu qu’elle regrette peut-être de ne pas avoir, et dont elle ne voudrait pas, si les dieux la lui offraient ; une vertu dont elle redoute ou dédaigne l’influence sur Antoine, selon qu’elle songe au Romain ou à l’homme.
Le Romain, tout voluptueux, tout passionné, tout spontané qu’il est dans la satisfaction de ses désirs, garde pourtant toujours caché dans le fond de l’âme un souvenir respectueux, presque superstitieux, des idées romaines, et, dans une heure de faiblesse de cœur ou de force d’esprit, il peut sacrifier aux préjugés de son éducation les penchants de sa nature. Mais cette nature est si puissante, si active, si déterminée ! Cet homme a un cœur si chaud, une soif si brûlante d’amour, un besoin si insatiable de volupté !
Cléopâtre, qui connaît toute la puissance de ses séductions, a vingt chances contre une pour triompher de cette rivale qui ne voit dans Antoine qu’un mari et ne sait d’autre moyen de plaire que le devoir. Pourtant sa passion est si forte, qu’une seule chance de perte suffit pour la troubler et l’épouvanter.
Quelle passion, en effet ! quel ciel africain, tour à tour resplendissant de tous les feux du soleil, sillonné des lueurs sinistres de l’éclair, chargé des sombres nuées de l’orage ou doucement humide de la rosée matinale ! Que d’abandon ! que d’adresse ! que de caresses ! que de blessures ! que de terribles colères et de tendres réconciliations ! Il y a de tout dans cette liaison fatale, excepté de la tiédeur. On voit dans de certains instants les deux amants se haïr mortellement, mais c’est pour s’aimer ensuite plus encore qu’ils n’ont jamais fait. Cet amour ressemble à Antée : chaque fois qu’il touche la terre en tombant, il se relève plus fort. Il résiste à tout et triomphe de tout : désir de la gloire, de la vie, du pouvoir ; crainte de la honte, de la mort, de l’abaissement, il surmonte tout et dévore tout.
Parfois il semble que les âmes des deux amants, lassées de leurs luttes et de leurs transports gigantesques, vont s’affaisser sur elles-mêmes et ne plus se relever. La vie ordinaire, la vie réelle, les saisit et cherche à les dominer. Antoine épouse Octavie, sans envoyer à travers les airs une parole de regret à Cléopâtre ; il promet à Octave de rendre sa sœur heureuse, et tout porte à croire que cet homme sincère et hardi ne ment pas plus cette fois que les autres ; mais à peine Octavie l’a-t-elle quitté un instant qu’une force irrésistible l’entraîne vers sa bien-aimée et l’enchaîne de nouveau à ses pieds. Alors, il n’y a plus de Rome, plus d’épouse, plus de devoir, plus de serment ; il n’y a plus que l’Égypte, Cléopâtre, les orgies et l’amour. Une autre fois, lorsque cette même Cléopâtre, téméraire comme une reine habituée à tout voir plier sous sa main et lâche comme une femme qui n’a jamais frappé que des esclaves, fuit le combat où elle s’est mêlée, malgré tous les conseils, Antoine, témoin de la honte de cette fuite, certain de sa défaite s’il l’imite, fuit cependant avec elle. D’un coup, il ternit sa vieille gloire, il perd l’empire du monde, il sacrifie son armée ; mais qu’importe ? il n’aura pas quitté sa maîtresse.
Mais ce n’est pas tout encore : lorsque, accablé par son déshonneur et son infortune, il maudit celle qui les a causés et veut aller chercher dans la tombe un abri contre elle, contre lui, contre le monde entier, qu’elle paraisse ! et une larme d’elle suffira pour effacer tout le passé et refaire de lui un amant plus heureux et un héros plus grand que la veille. Et, quand il succombera définitivement, ce ne sera que sous le destin ; et son amour, aussi fort que sa vie, s’exhalera avec elle, en répétant le nom adoré de Cléopâtre.
Et toi ! toi, l’objet d’une passion si vive, si profonde, si vivace, que fais-tu pour t’en montrer digne ? Elle, qui a eu peur de la flèche perdue d’un vélite romain, elle qui s’est laissé à moitié corrompre par l’éloquence du rhéteur d’Octavie triomphant, et qui a pensé vendre pour se sauver celui qui s’était perdu pour elle ; celle-là même, quand elle voit mort cet amant si grand, si beau, si généreux, si parfait, si supérieur au divin César, répudie la clémence du vainqueur, trompe la surveillance de ses gardes, et va rejoindre dans le tombeau celui qui ne l’a jamais délaissée sur la terre.
Couple étrange, qui a puisé dans les neiges de l’âge des feux plus brûlants que ceux de la jeunesse ! âmes infatigables qui ont pris dans des passions antérieures un aliment inépuisable pour un dernier et immense amour ! amants si glorieux dans leur misère, qu’on oublie le triomphateur pour ne penser qu’à eux, et qu’on préfère le sort d’Antoine mourant aimé de Cléopâtre à celui d’Octave vivant maître du monde !
FRAGMENT D’UNE LETTRE ÉCRITE DE FONTAINEBLEAU
Me voilà encore une fois dans la forêt de Fontainebleau, seule avec mon fils, qui devient un grand garçon et dont pourtant je suis encore le cavalier plus qu’il n’est le mien. Nous nous risquons sur toute sorte de bêtes, ânes et chevaux plus ou moins civilisés, qui nous portent, sans se plaindre, de sept heures du matin à cinq ou six heures du soir au hasard de la fantaisie. Nous ne prenons pas de guide, et nous n’avons même pas un plan dans la poche. Il nous est indifférent de nous éloigner beaucoup, puisqu’il est difficile de se perdre dans une forêt semée d’écriteaux. Nous nous arrangeons pour ne rencontrer personne, en suivant les chemins les moins battus et en découvrant nous-mêmes les sites les moins fréquentés. Ce ne sont pas les moins beaux.
Tout est beau ici. D’abord les bois sont toujours beaux, dans tous les pays du monde, et, ici, ils sont jetés sur des mouvements de terrain toujours pittoresques quoique toujours praticables. Ce n’est pas un mince agrément que de pouvoir grimper partout, même à cheval, et d’aller chercher les fleurs et les papillons là où ils vous tentent.
Ces longues promenades, ces jours entiers au grand air sont toujours de mon goût, et cette profonde solitude, ce solennel silence à quelques heures de Paris sont inappréciables. Nous vivons d’un pain, d’un poulet froid et de quelques fruits que nous emportons avec les livres, les albums et les boîtes à insectes. Quelles noctuelles, quels bombyx endormis et comme collés sur l’écorce des arbres ! Quelles récoltes ! et quel plaisir de les étaler le soir sur la table !
Nous ne connaissons personne à la ville. Nous avons un petit appartement très-propre et très-commode dans un hôtel qui est à l’entrée de la forêt, et dont l’hôtesse, madame Duponceau, est une charmante hôtesse. J’y travaille le soir quand mon garçon ronfle, et ce gros sommeil me réjouit l’oreille. Je ne sais pas trop, moi, quand je dors. Je n’y pense pas. Du reste je vis de la vie rationnelle pour le moment ; je vis dans les arbres, dans le soleil, dans les bruyères, dans le mouvement et le repos de la nature, dans l’instinct et le sentiment, dans mon fils surtout, qui se plaît à cette vie-là autant que moi, et qui m’en fait jouir doublement.
Quelle belle chose que cette forêt ! Sénancour l’a bien décrite dans certaines pages où il veut bien céder au charme qui s’empare de lui. Sa peinture large et bien tranchée est encore ce qui résume le mieux certains aspects. Mais il ne rend pas justice, dans toutes ses lettres, à ce beau lieu. Il le rapetisse comme s’il avait peur de le trop admirer. Il le voit à travers son spleen. Il veut qu’on sache bien que ce n’est pas vaste et accidenté comme la Suisse. À quel propos fait-il ce parallèle, je ne sais. Certes, en tant que montagnes, celles-ci ne sont pas des Alpes ; mais, en tant que bois charmants, les grands pins de la Suisse n’ont pas les qualités propres à la nature de notre forêt, nature à la fois mélancolique et riante, et qui ne ressemble qu’à elle-même. On veut toujours comparer : c’est un tort qu’on se fait, c’est une guerre puérile à sa propre puissance. Ce qui est beau d’une certaine façon n’est ni plus ni moins beau que ce qui est beau d’une manière toute différente. Pour moi, je passerais ma vie ici sans regretter la Suisse, et réciproquement. Là où l’on se trouve bien, je ne comprends pas le besoin du mieux. Je ne sais pas si le proverbe est vrai d’une manière absolue. Je ne crois pas qu’il en ait la prétention, car les sentences sont toujours relatives. Mais, en fait de locomotion, de curiosité, de jouissance personnelle, je croirais volontiers que le regret ou le désir du mieux est un leurre de l’imagination malade. C’était bien le fait de Sénancour. Obermann est un génie malade. Je l’ai bien aimé, je l’aime encore, ce livre étrange, si admirablement mal fait ; mais j’aime encore mieux un bel arbre qui se porte bien.
Il faut de tout cela : des arbres bien portants et des livres malades, des choses luxuriantes et des esprits désolés. Il faut que ce qui ne pense pas demeure éternellement beau et jeune, pour prouver que la prospérité a ses lois absolues en dehors de nos lois relatives et factices, qui nous font vieux et laids avant l’heure. Il faut que ce qui pense souffre, pour prouver que nous vivons dans des conditions fausses, en désaccord avec nos vrais besoins et nos vrais instincts. Aussi, toutes ces choses magnifiques qui ne pensent pas donnent beaucoup à penser…
LES FLEURS DE MAI
Belles fleurs de mai, orgueil et jeunesse de la terre, je ne vous aime plus, vous que j’ai tant aimées ! Vos parfums ne m’enivrent plus ; les brises qui vous caressent ne réveillent plus l’ange de ma poésie, qui reposait naguère au fond de vos riants calices. Gardez-le parmi vous, cet ange trop jeune qui ne me connaît plus ! qu’il consacre avec vous, dans le secret des nuits printanières, ces divins hyménées que je savais surprendre et chanter autrefois ; initiez quelque autre enfant des hommes à vos chastes mystères. Mon esprit a perdu sa candeur ; la sainte ignorance du poëte n’habite plus avec moi. Belles fleurs de mai, je ne vous aime plus, vous que j’ai tant aimées !
Jacinthe blanche au cœur vert, toi qui me parus un symbole d’espérance et de pureté, et qui me fis verser des larmes sur ma colère, je ne t’ai point oubliée ! tu naquis et mourus pour moi seul ; tu fus pour moi plus qu’une fleur, plus qu’un ami, tu fus le mystérieux langage de Dieu. Tu me parlas pendant trois nuits, et tu m’enseignas des choses que je ne savais pas. Mais tes sœurs fleurissent loin de moi, et je n’ai rien à leur demander qu’elles puissent me donner ; car le temps n’est plus où j’étais poëte, c’est-à-dire seul dans la nature avec la beauté. Je suis homme ; l’homme a besoin des autres hommes ; sa vie est liée à celle de ses frères, et, si les hommes tuent son âme, c’est en vain que la nature sera féconde, c’est en vain que la terre reverdira et que les fleurs seront belles. Jacinthe blanche au cœur vert, je ne t’ai point oubliée ; tu m’as enseigné bien des choses du ciel, mais tu ne m’as rien révélé des maux de la terre.
Cyclamen de la Brenta, sauge du Tyrol, gentiane du mont Blanc, je vous ai confié des douleurs que je n’aurais pas essayé de raconter aux hommes. J’étais seul avec mon ennui ; je ne demandais rien, je n’aspirais à rien dans la société de mes semblables ; j’étais naïf, j’étais égoïste comme l’une d’entre vous. Je ne souffrais que de me sentir froissé par le vent ; je n’avais d’ennemi que l’orage qui courbait ma tête, ou que la sécheresse qui flétrissait mon sein. Vous pouviez, dans ce temps-là, me comprendre et me consoler ; je ne demandais au ciel que ce qu’il vous accorde : la puissance d’exister, la faculté d’être par soi-même et pour soi-même. Je n’avais d’autre besoin que celui qui vous fait éclore, vivre afin de vivre. Vos grâces éternellement jeunes, votre beauté éternellement riche répondaient aux aspirations de ma jeunesse aveugle. Je pouvais reprendre confiance en Dieu, comme le fait chaque créature bornée au sentiment de sa propre existence. Fleurs du torrent, filles des montagnes et des glaciers, je ne saurais plus vous confier les douleurs que l’on peut raconter aux hommes.
Bruyère blanche, qui étales tes grappes de perles avec tant d’orgueil, d’où vient que je ne pense plus à toi en te regardant ? que m’importent tes mille fleurons semés comme une neige légère sur ta palmette flexible ? est-il un seul de ces petits êtres qui s’inquiète de la vie de son frère, et qui se sente issu de la même tige, nourri de la même séve, soumis à la même loi ? Vous n’êtes que de vains fantômes de l’immortelle beauté, vous n’êtes que de froids emblèmes de l’impérissable harmonie, êtres charmants et stupides que la poésie adore et que l’amour ne peut invoquer. Vous ne pouvez parler à la pensée humaine que par des signes glacés et des manifestations vagues ; vous n’aimez pas, vous ne sentez pas, vous ne connaissez pas. Bruyères fleuries, quand le sang des hommes vous arrose sur les champs de bataille, vous vous teignez de pourpre, et la rosée du soir lave vos souillures ; mais vous ne demandez point aux cieux si c’est une pluie qu’ils épanchent pour vous purifier, ou si ce sont des larmes répandues d’en haut sur les crimes de l’humanité.
Belles fleurs de mai, orgueil et jeunesse de la terre, je ne vous aime plus, vous que j’ai tant aimées ! Vous ne savez pas ce que souffrent les hommes, et vous n’avez rien à leur enseigner pour les rendre purs et tranquilles comme vous. Vous ne savez pas que les plus nobles et les plus vivantes créatures de Dieu se haïssent et se déchirent. Vous ne savez pas qu’elles se disputent le moindre coin de cette terre où vous naissez, où vous vivez toutes libres et à l’aise sous l’œil de la Providence ; vous ne croissez pas sur nos tombes pour consacrer la douleur de nos mères et pour couronner la dépouille de nos héros. Vous vous nourrissez de nos cadavres, et nos entrailles ne sont pour vous qu’un engrais ! Mais, hélas ! l’inévitable main de la destinée vous menace vous-mêmes ; le temps approche, peut-être, où l’humanité tout entière sera une armée, où la terre tout entière sera un champ de bataille. Alors, des hordes de spectres affamés ravageront ces jardins où vous croissez pour les délices du poëte. La charrue tranchera vos racines ; la hache nivellera peut-être ces buissons où vous entrelacez vos guirlandes ; et il se passera quelques jours avant que la terre songe à sa beauté, avant que l’homme avide de pain lui redemande des roses. — Ou bien, je fais un plus doux rêve ! Sur les sommets nus et chauves des collines incultes, sur ces vastes landes désertes où vos humbles sœurs, les pâles asphodèles et les sombres fougères croissent au bord des tristes marécages, le trop-plein de la famille humaine, les enfants déshérités de la civilisation, les mendiants et les parias, troupeau du Christ, iront planter dans les terres vierges, avec le pic et la bêche, armes des conquérants pacifiques, le signe sacré d’une religion nouvelle. Là fleuriront alors, sous l’œil de Dieu et sous la main des hommes purifiés, ces dons immortels, la foi, l’amour, l’idéal. Alors, nos vieilles sociétés dissoutes et dévastées par les éléments de destruction qu’elles nourrissent fièrement dans leur sein, ne paraîtront plus que comme d’affreuses solitudes, d’où s’exileront par milliers les âmes pieuses, d’où se détourneront à jamais les grâces d’en haut. Alors, vous aussi, reines orgueilleuses et délicates, roses des parterres, jacinthes sans taches, tulipes enflammées, vous irez dans la demeure des hommes réconciliés vous marier aux naïves fleurs de la solitude, et des races plus charmantes et plus parfaites naîtront de vos hyménées ! Oh ! alors, riantes conquêtes de la civilisation nouvelle, symboles de la poésie ressuscitée, palmes aux mains de l’esclave affranchi, couronnes au front de la Liberté, je vous rendrai mon culte et mes soins, ô belles fleurs que j’ai tant aimées !
COUP D’ŒIL GÉNÉRAL SUR PARIS
Tu m’as fait promettre, honnête Flammèche, de te dire mon mot sur Paris ; et, comme un diable candide et bénin que tu es, tu as insisté au point de rendre un refus impossible. Prends garde de te repentir de ta politesse ; car, en vérité, tu ne pouvais t’adresser plus mal. Personne ne connaît Paris moins que moi. On ne connaît que ce qu’on aime, on ignore presque toujours ce qu’on hait ; et, je te l’avoue, je hais Paris au point de passer tout le temps que je suis forcé d’y demeurer à fermer mes yeux et mes oreilles pour tâcher de ne pas voir et de ne pas entendre ce qui fait, au dire des riches et des étrangers, le charme et le prix de cette riante capitale. C’est une aversion passée à l’état de monomanie ; si bien que j’ai oublié mes existences antérieures. Je ne saurais donc te peindre que les misères du coin du feu, et valent-elles la peine d’être dites ? Le seul moyen d’y échapper, c’est, diras-tu, de sortir de chez soi. Où aller dans Paris, à moins qu’on n’y soit forcé ? où trouver le ciel qu’on puisse regarder sans heurter les passants et sans se faire écraser par les voitures, pour peu qu’on n’ait pas la faculté de regarder à la fois en l’air et devant soi ? où respirer un air pur ? où entendre des harmonies naturelles ? où rencontrer des figures calmes et des allures vraies ? Tout ce qui n’est pas maniéré par l’outrecuidance, ou stupide comme la préoccupation du gain, est triste comme l’ennui, ou affreux comme le malheur. Tout ce qui ne grimace pas pleure, et ce qui par hasard ne grimace ni ne pleure est tellement effacé ou hébété, que les pavés usés par les pas de la multitude ont plus de physionomie que ces tristes faces humaines. Que se passe-t-il donc dans cette ville riche et puissante, pour que la jeunesse y soit flétrie, la vieillesse, hideuse, et l’âge mûr égaré ou sombre ? Regarde ces masures décrépites et puantes auprès de ces palais élevés d’hier. Regarde ce monde d’oisifs qui marche dans l’or, dans la soie, dans la fourrure et dans la broderie ; et, tout à côté, vois se traîner ces haillons vivants qu’on appelle la lie du peuple ! Écoute courir ces légers et brillants équipages ; entends ces cris rauques du travail et ces voix éteintes de la misère ! La plus nombreuse partie de la population condamnée au labeur excessif, à l’avilissement, à la souffrance, pour que certaines castes privilégiées aient une existence molle, gracieuse, poétique et pleine de fantaisies satisfaites ! Oh ! pour voir ce spectacle avec indifférence, il faut avoir oublié qu’on est homme, et ne plus sentir vibrer en soi ce courant électrique de douleur, d’indignation et de pitié qui fait tressaillir toute âme vraiment humaine, à la vue, à la seule pensée du dommage ou de l’injure ressentis au dernier, au moindre anneau de la chaîne.
Mais, où donc, me diras-tu, espérer de fuir ce monstrueux contraste ? Oh ! je sais bien qu’il est partout, et que, d’ailleurs, le devoir n’est pas de fuir la souffrance et d’apaiser son cœur dans le repos de l’égoïsme. S’il existait sur la terre un sanctuaire réservé, une société d’exception, où, dans quelque île enchantée, on pût aller s’asseoir au banquet de la fraternité, ce serait peut-être là qu’il faudrait faire un pèlerinage une ou deux fois dans sa vie, pour s’instruire et se retremper ; mais ce ne serait pas là que l’on devrait aller vivre à jamais. Car on s’y endormirait dans les délices, et on y oublierait tout ce qui cherche, lutte et gémit sur la face de la terre. Ou bien, si on n’y devenait pas insensible aux malheurs de l’humanité, on se sentirait profondément malheureux d’être ainsi associé aux suprêmes jouissances du petit nombre, et de ne pouvoir plus rien tenter pour sauver le reste des hommes. Eh bien, voilà précisément ce qu’on éprouve à Paris quand on n’est pas desséché par l’égoïsme. C’est que Paris me présente, au premier chef, la réalisation de cette fiction, dont la seule pensée épouvante mon esprit : tout d’un côté, rien de l’autre. C’est le résumé de la société universelle, vouée au désordre, au malheur et à l’injustice, avec une petite société d’exception incrustée au centre, et qui réalise en quelque sort l’Eldorado que je supposais tout à l’heure dans les régions fantastiques. Seulement, ce n’est pas au nom du principe divin de l’égalité chrétienne que cette petite société vide incessamment la coupe des voluptés humaines. Ce n’est pas même en vertu d’une loi d’égalité relative, semblable à celle qui constituait les anciennes sociétés de Sparte, d’Athènes et de Rome. Il y a bien encore une caste de citoyens privilégiés entée et assise sur un peuple d’esclaves méprisés ou d’affranchis méprisables ; mais ce n’est plus même le hasard de la naissance ou l’orgueil des services rendus au pays, qui préside à ces privilèges : c’est le hasard de la spéculation, c’est souvent le prix du vol, de l’usure ; c’est la protection accordée aux vices contempteurs de toute religion, aux crimes commis contre la patrie et l’humanité tout entière.
Il y a donc au sein de Paris une société libre et heureuse d’un certain bonheur sans idéal, réduite à la jouissance de la sensation. On appelle cela le monde. Que dis-tu de ce nom ambitieux et outrecuidant, toi, libre voyageur parmi les sphères de l’infini, à qui la terre tout entière apparaît comme un point perdu dans l’espace ? Eh bien, dans les imperceptibles détails de cet atome, il existe une petite caste qui a donné à ses frivoles réunions, à ses fêtes sans grandeur et sans symbole, le nom de monde, et dont chaque individu dit, en montant dans sa voiture pour aller parader parmi quelques groupes d’oisifs pressés dans certains salons de la grande ville de travail et de misère : Je vais dans le monde ; je vois le monde ; je suis homme du monde.
Étrange dérision ! vous êtes du monde, et vous ne savez pas qu’au sein de votre petit monde terrestre vous devenez un monstre et un non-sens dès que vous vous isolez de la race humaine dans le moindre de ses membres ! Vous êtes du monde, et vous ne savez pas qu’il y a un monde céleste et infini au milieu duquel vous vous agitez sans but et sans fruit, en contradiction que vous êtes avec toutes ses lois divines et naturelles ! Vous êtes du monde, et vous ne savez pas que votre devoir est de travailler comme homme, comme créature de Dieu, à transformer ce monde par le travail, par la religion, par l’amour, au lieu d’y perpétuer le mensonge et le forfait de l’inégalité ! Non ; vous n’êtes pas homme du monde ; car vous ne connaissez ni le monde ni l’homme !
Suis-les, lutin investigateur ; monte dans leur carrosse, et entre avec eux dans ces hôtels, dans ces salons où brille et sourit froidement ce qu’ils appellent leur monde. Je suppose que, de la région céleste où tu déployais ton vol, tu fusses tombé tout à coup au milieu d’un bal aristocratique, sans avoir eu le temps de jeter un regard sur les plaies de la pauvreté : le spectacle qui se fût déployé alors sous tes yeux t’eût fait croire à l’âge d’or de nos poëtes. Si tu n’avais pas eu la faculté surnaturelle de plonger dans les cœurs, et d’y lire l’ennui, le dégoût, la crainte, les souffrances de l’amour-propre, les rivalités, l’ambition, l’envie, toutes ces mauvaises passions, tous ces remords mal étouffés, toutes ces appréhensions de l’avenir, toute cette peur de la vengeance populaire qui expient le crime de la richesse ; si, enfin, tu t’étais arrêté à la surface, n’aurais-tu pas cru contempler une fête véritable, et assister à la communion des membres de la famille humaine, au sein des joies conquises par le travail, par les arts et par les sciences ? Car, en vérité, toutes ces joies sont légitimes en elles-mêmes. Ces palais, ces buissons de fleurs au milieu des glaces de l’hiver, ces jets d’eau qui reflètent la lumière des lustres, ces globes de feu qui effacent l’éclat du jour, ces tentures de velours et de moire, ces ornements où l’or brille sur tous les lambris, ces parquets où le pied vole plutôt qu’il ne marche, cette douce chaleur qui transforme l’atmosphère et neutralise la rigueur des saisons, tout ce bien-être… c’est l’œuvre du travail intelligent ; et ce n’est pas seulement pour l’homme un droit, mais un devoir résultant de son organisation inventive et productive, que de créer à la famille humaine des demeures vastes, nobles, saines et riches. Ces tableaux, ces statues, ces bronzes, cet orchestre, ces belles étoffes, ces gracieux ornements de pierreries au front des femmes, tout ce luxe, c’est l’œuvre de l’art ; et l’art est une mission divine que l’humanité doit poursuivre et agrandir sans cesse. Ces artistes, qui cherchent là des jouissances exquises, échange bien légitime des jouissances données par eux-mêmes à la société, ils ont le droit d’aimer le beau, et ils obéissent à leur instinct supérieur en cherchant à s’y retremper sans cesse. Oui, l’humanité a droit à ces richesses, à ces plaisirs, à ces satisfactions matérielles et intellectuelles. Mais c’est l’humanité, entendez-vous ? c’est le monde des humains, c’est tout le monde qui doit jouir ainsi des fruits de son labeur et de son génie, et non pas seulement votre petit monde qui se compte par têtes et par maisons. Ce n’est pas votre monde de fainéants et d’inutiles, d’égoïstes et d’orgueilleux, d’importants et de timides, de patriciens et de banquiers, de parvenus et de pervertis ; ce n’est pas même votre monde d’artistes vendus au succès, à la spéculation, au scepticisme et à une monstrueuse indifférence du bien et du mal. Car, tant qu’il y aura des pauvres à votre porte, des travailleurs sans jouissance et sans sécurité, des familles mourant de faim et de froid dans des bouges immondes, des maisons de prostitution, des bagnes, des hôpitaux auxquels vous léguez quelquefois une aumône, mais dans lesquels vous n’oseriez pas entrer, tant ils diffèrent de vos splendides demeures, des mendiants auxquels vous jetez une obole, mais dont vous craindriez d’effleurer le vêtement immonde ; tant qu’il y aura ce contraste révoltant d’une épouvantable misère, résultat de votre luxe insensé, et des millions d’êtres victimes de l’aveugle égoïsme d’une poignée de riches, vos fêtes feront horreur à Satan lui-même, et votre monde sera un enfer qui n’aura rien à envier à celui des fanatiques et des poëtes.
Mais, diras-tu, faut-il mettre le feu aux hôtels ou fermer la porte des palais ? faut-il laisser croître la ronce et l’ortie sur ces marbres, aux marges de ces fontaines ? faut-il que la beauté revête le sac de la pénitence, que les artistes partent pour la terre sainte, que les arts périssent pour renaître sous une inspiration nouvelle, que la société tombe en poussière afin de se relever comme la Jérusalem céleste des prophètes ? Tout cela sera bien inutile à conseiller, lutin, et encore plus inutile à entreprendre sans lumière et sans doctrine. Un élan nouveau et subit de l’aumône catholique ne remédierait à rien, pas plus que certains essais de transaction pratique entre l’exploiteur et le producteur, conseillés aujourd’hui par les prétendues intelligences du siècle. L’aumône, comme la transaction, ne sert qu’à consacrer l’abandon du principe sacré et imprescriptible de l’égalité. Ce sont des inventions étroites et grossières, au moyen desquelles on apaise hypocritement sa propre conscience, tout en perpétuant la mendicité, c’est-à-dire l’abjection et l’immoralité de l’homme ; tout en prolongeant l’inégalité, c’est-à-dire l’exploitation de l’homme par l’homme. La doctrine est faussée par ces tentatives ; il faut une autre science, basée sur la doctrine. Mais ce n’est pas toi, Flammèche, qui aideras à la chercher ; et je ne suppose pas que ton Roi des Enfers, à moins qu’il ne soit l’ange méconnu que j’ai rêvé et dépeint quelque part, s’y intéresse véritablement. Tel que tu nous l’as montré, spirituel railleur, à moins que tu ne te sois joué de nous, le souverain qui t’a dépêché vers nous est un bon diable, blasé dans ses émotions, et curieux plutôt qu’amoureux de nos nouveautés philosophiques. Je laisserai donc à d’autres le soin de l’amuser ; je ne me sens pas divertissant, et je t’ai promis de répondre seulement à une question formulée, je crois, à peu près ainsi : « Pourquoi n’aimes-tu pas Paris, le berceau de ton être intellectuel et moral, le milieu où ton existence gravite mêlée à celle de tes semblables ? » Je t’ai répondu : Je hais Paris, parce que c’est la ville du luxe et de la misère, en première ligne. Je ne m’y amuse point, parce que je n’y vois rien que de triste et de révoltant. Je ne saurais m’y plaire, parce que je rêve le règne de l’égalité, et que je vois ici le spectacle et la consécration insolente et cynique de l’inégalité poussée à l’extrême. J’ai les tristesses d’un philosophe, bien que je sois un pauvre philosophe. J’ai les besoins d’un poëte, bien que je sois un poëte fort mince. Mais, si petit que l’on soit, on peut grandement souffrir, et ce que mes yeux voient ne porte pas la joie dans mon cœur ni l’enivrement dans mon cerveau.
Deux ou trois fois dans ma vie je me suis glissé en clignotant, comme tu pourrais le faire, dans ce monde qui se croit si beau. J’ai vu des lumières qui m’ont donné la migraine, des murs habillés de pourpre et d’or comme des cardinaux, des femmes couronnées, demi-nues comme des bacchantes, des hommes tout noirs et tout d’une pièce, des artistes qui s’évertuaient à faire de l’effet sur des gens qui faisaient semblant d’être émus, des fleurs qui avaient l’air de souffrir et de pleurer dans cette atmosphère âcre et chaude ; j’ai trouvé de nobles amphitryons, de belles femmes, des hommes de talent, des œuvres d’art, des arrangements d’un goût recherché dans les décors, dans la musique, dans les choses et dans les personnes ; mais je n’ai trouvé ni poésie élevée, ni inspiration véritable, ni politesse partant du cœur, ni bienveillance générale, ni sympathies partagées, ni échange d’idées et de sentiments ; pas de lien commun entre tous ces êtres, pas d’abandon, pas de grâce, pas de pudeur, et encore moins de sincérité. Voilà ce que j’ai vu avec les yeux et entendu avec les oreilles, et mon cœur s’est retiré en moi tout contristé et tout épouvanté, car le son de ces instruments n’empêchait pas le cri de la détresse et le râle de l’agonie du peuple de monter jusqu’à moi. Et je me demandais, en regardant ces riches décorations, ces tables et ces buffets, ce que le fournisseur avait volé au consommateur et au producteur pour produire toutes ces merveilles ; et il me semblait voir mêlés ensemble, dans une sorte de cave située sous les pieds des danseurs, les cadavres des riches qui se brûlent la cervelle après s’être ruinés, et ceux des prolétaires qui sont morts de faim à la peine d’amuser ces riches en démence.
Et je rentrai dans ma chambre silencieuse et sombre, et je me demandai pourquoi, comme tant d’autres artistes insensés qui croient s’assurer une méditation paisible, un travail facile et agréable, et donner une couleur poétique à leurs rêves en faisant quelques frais d’imagination et de goût pour enjoliver modestement leur demeure, j’avais eu quelque souci moi-même de me clore contre le froid, contre le bruit, et de placer sous mes yeux quelques objets d’art, types de beauté ou gages d’affection. Et je me répondis que je ne valais donc pas mieux que tant d’autres, qu’il était donc bien plus facile de dire le mal que de faire le bien. Et j’eus une telle horreur de moi-même, en pensant que d’autres avaient à peine un sac de paille pour se réchauffer entre quatre murs nus et glacés, que j’eus envie de sortir de chez moi pour n’y jamais rentrer. Et s’il y avait eu, comme au temps du Christ, des pauvres préparés à la doctrine du Christ, j’aurais été converser et prier avec eux sur le pavé du bon Dieu. Mais il n’y a même plus de pauvres dans la rue ; vous leur avez défendu de mendier dehors, et l’homme sans ressource mendie la nuit, le couteau à la main. Et, d’ailleurs, mon désespoir n’eût été qu’un acte de démence : je n’avais ni assez d’or pour diminuer la souffrance physique, ni assez de lumières pour répandre la doctrine du salut. Car, si l’on ne fait marcher ensemble le salut de l’âme et celui du corps, on tombera dans les plus monstrueuses erreurs. Je le sentais bien, et je demeurai triste, élevant vers le ciel une protestation inutile, j’en conviens, Satan ; mais tu serais venu en vain m’enlever, pour me montrer d’en haut les royaumes de la terre et pour me dire : « Tout cela est à toi si tu veux m’adorer, » je t’aurais répondu : « Ton règne va finir, tentateur, et tes royaumes de la terre sont si laids, qu’il n’y a déjà plus de vertu à les mépriser. »
- ↑ Cette phrase musicale a été donnée à George Sand par Halévy.
