Le Petit Lord/Texte entier
LE
ADAPTÉ DE L’ANGLAIS DE FRANCES HODGSON BURNETT

PARIS
LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE
15, rue soufflot, 15
――
Jules Bardoux, Directeur.
I
Cédric ne connaissait rien de son histoire. Quoiqu’il habitât New-York, il savait, parce que sa mère le lui avait dit, que son père était Anglais ; mais quand le capitaine Errol était mort, Cédric était encore si petit qu’il ne se rappelait rien de lui, si ce n’est qu’il était grand, qu’il avait des yeux bleus, de longues moustaches, et qu’il n’y avait pas de plus grand bonheur au monde pour lui, petit garçon de quatre ou cinq ans, que de faire le tour de la chambre sur son épaule. Pendant la maladie de son père, on avait emmené Cédric, et quand il revint, tout était fini. Mme Errol, qui avait été très malade aussi, commençait seulement à s’asseoir, vêtue de noir, dans son fauteuil près de la fenêtre. Elle était pâle, et toutes les fossettes avaient disparu de sa jolie figure. Ses grands yeux bruns se fixaient tristement dans le vide.
« Chérie, dit Cédric, — son père l’avait toujours appelée ainsi, et l’enfant faisait de même, — Chérie, papa va-t-il mieux ? »
Il sentit les bras de sa mère trembler autour de son cou. Alors il tourna vers elle sa tête bouclée, et, la regardant en face, il se sentit prêt à pleurer.
« Chérie, répéta-t-il, comment va papa ? »
Puis, tout à coup, son tendre petit cœur lui dit que ce qu’il avait de mieux à faire, c’était de grimper sur les genoux de sa maman, de lui jeter les bras autour du cou et de la baiser et baiser encore, et d’appuyer sa petite joue contre la sienne. Alors sa mère cacha sa figure dans la chevelure de son petit garçon et pleura amèrement en le tenant serré contre elle. Il semblait qu’elle ne pourrait jamais s’en séparer.
« Il est bien maintenant, sanglota-t-elle enfin ; il est bien, tout à fait bien ; mais nous, nous n’avons plus que nous au monde ; nous sommes tout l’un pour l’autre. »
Alors, tout petit qu’il était, Cédric comprit que son papa, si grand, si beau, si fort, était parti pour toujours, qu’il ne le reverrait plus jamais, qu’il était mort, comme il avait entendu dire que d’autres personnes l’étaient, quoiqu’il ne pût comprendre exactement ce que ce mot voulait dire. Voyant que sa mère pleurait toujours quand il prononçait son nom, il prit secrètement la résolution de ne plus en parler si souvent. Il se dit aussi qu’il valait mieux ne pas la laisser s’asseoir, muette et immobile, devant le feu ou à la fenêtre, et que ce silence et cette immobilité ne lui valaient rien.
Sa mère et lui connaissaient très peu de monde et menaient une vie très retirée : Mme Errol était orpheline et n’avait pas un seul parent quand le capitaine l’avait épousée. Le père de celui-ci, le comte de Dorincourt, était un vieux gentilhomme anglais, très riche et d’un caractère dur, qui détestait l’Amérique et les Américains.
Il avait deux fils plus âgés que le capitaine, et, d’après la loi anglaise, l’aîné seul devait hériter de ses titres et de ses propriétés, qui étaient considérables. Si le fils aîné venait à mourir, le second devait prendre sa place et récolter tout l’héritage, si bien que, quoique membre d’une riche et puissante famille, il y avait peu de chances pour le capitaine Errol de devenir riche et puissant lui-même.
Mais il arriva que la nature, qui ne tient pas compte des distinctions sociales, avait accordé au plus jeune fils des dons qu’elle avait refusés aux autres. Il était grand, beau, brave, intelligent et généreux. Il possédait le meilleur cœur du monde et semblait doué du pouvoir de se faire aimer de tous, tandis que ses frères aînés n’étaient l’un et l’autre ni beaux, ni aimables, ni intelligents. Pendant leur vie d’écoliers et d’étudiants, à Éton ou ailleurs, ils n’avaient su s’attirer ni l’affection de leurs camarades ni l’estime de leurs maîtres. Le comte de Dorincourt était sans cesse humilié à leur sujet. Son héritier, il le voyait avec dépit, ne ferait pas honneur à son noble nom et ne serait autre chose qu’un être égoïste et insignifiant. C’était une pensée très amère pour le vieux lord. Quelquefois il semblait en vouloir à son troisième fils de ce qu’il eût reçu tous les dons et qu’il possédât les qualités s’assortissant si bien à la haute position qui attendait l’aîné. Cependant, dans les profondeurs de son cœur, il ne pouvait, sans le lui témoigner toutefois, s’empêcher de se sentir porté vers ce fils qui flattait son orgueil. C’est dans un accès de colère causé par ces sentiments opposés qu’il l’avait envoyé en Amérique, de manière à n’avoir pas sans cesse sous les yeux le contraste que formait son jeune fils avec ses deux aînés, dont la conduite lui donnait de plus en plus de soucis et de chagrin.
Mais au bout de six mois, commençant à se sentir isolé et désireux en secret de le revoir, il lui ordonna de revenir. Sa lettre se croisa avec celle où le capitaine lui annonçait son désir de se marier. Quand le Comte reçut cette lettre, il entra dans une furieuse colère. Il écrivit de nouveau à son fils, lui défendant de reparaître jamais en sa présence, et même de jamais lui écrire, à lui ou à ses frères. Il ajouta qu’il le regardait désormais comme retranché de la famille et qu’il n’avait rien à attendre de lui.
Le capitaine fut très affligé à la réception de cette lettre. Il aimait l’Angleterre et la vieille maison où il était né, surtout son père, quelque rude qu’il se fût montré à son égard ; la pensée de ne jamais les revoir lui causait un profond chagrin. Cependant il connaissait assez le vieux lord pour savoir que sa résolution était irrévocable. Au bout de quelque temps, il parvint à trouver un emploi, se maria et s’établit dans un quartier tranquille et retiré de la ville. C’est là que Cédric vint au monde. Quoique leur intérieur fût très modeste, Mme Errol était si douce si gaie et si aimable que le jeune homme se sentait heureux en dépit des événements.
Jamais enfant ne fut mieux doué que Cédric. Comme sa mère, il avait de grands yeux bruns, bordés de longs cils, et ses cheveux blonds tombaient en boucles naturelles sur ses épaules. Il avait de plus des manières si gracieuses, une taille si souple et si élégante, il envoyait à tous ceux qui lui parlaient un si doux regard, accompagné d’un si aimable sourire, qu’il était impossible de le voir sans être séduit. Aussi n’y avait-il personne dans le quartier qu’ils habitaient, pas même M. Hobbes, l’épicier du coin de la rue, l’être le plus grincheux du monde, qui ne fût heureux de le voir et de lui parler. Son charme principal venait de son air ouvert et confiant. On sentait que son bon petit cœur sympathisait avec chacun et croyait qu’il en était de même des autres. Peut-être ces aimables dispositions naturelles se trouvaient-elles augmentées par la vie qu’il menait. Il avait toujours été choyé et traité avec tendresse ; jamais il n’avait entendu un mot dur ou même impoli. Son père usait toujours avec sa femme d’appellations affectueuses, et l’enfant l’imitait. Le capitaine veillait sur elle avec une tendre sollicitude, et Cédric s’efforçait de faire de même.
Aussi, quand il comprit que son cher papa ne reviendrait plus et qu’il vit combien sa maman était triste, il se dit, dans sa bonne petite âme, que, puisqu’elle n’avait plus que lui au monde, il devait faire tout ce qu’il pouvait pour la rendre heureuse. Cette pensée était dans son esprit d’enfant le jour où il revint chez sa mère, qu’il grimpa sur ses genoux, qu’il l’embrassa et qu’il mit sa tête bouclée sur sa poitrine ; elle y était quand il apporta ses jouets et ses livres d’images pour les lui montrer, et quand il se pelotonna à côté d’elle, sur le sofa où elle avait coutume de se reposer. Il n’était pas assez grand pour imaginer autre chose ; mais c’était plus pour le confort et la consolation de sa mère qu’il ne pouvait le savoir.
« Oh ! Mary, disait Mme Errol à la vieille bonne qui les servait depuis longtemps, je suis sûre que, tout petit qu’il est, il me comprend, qu’il devine tout ce que je souffre et qu’il veut me soulager. Il a un si brave petit cœur ! si tendre et si courageux ! »
Et en effet, Cédric continua à être le petit compagnon de sa mère, sortant, causant, jouant avec elle. Quand il sut lire, il lui lut tous les livres qui formaient sa bibliothèque enfantine, et de plus des livres sérieux ou les journaux. Peu à peu, les couleurs reparurent sur les joues de Mme Errol, et de temps en temps Mary, de sa cuisine, l’entendit rire des remarques et des raisonnements de Cédric.
« C’est qu’aussi, disait de son côté Mary à M. Hobbes, il a de si drôles de petites manières et il vous tient des discours si sérieux ! N’est-il pas venu dans ma cuisine, le jour où le président fut nommé, pour parler politique avec moi ! Il s’arrêta devant le feu, les mains dans ses petites poches, et, son innocente petite figure aussi grave que celle d’un juge, il me dit : « Mary, je m’intéresse beaucoup à l’élection : je suis un républicain ; Chérie aussi. Et vous, Mary, êtes-vous républicaine ? » Depuis ce moment il n’a jamais été sans me parler des affaires du gouvernement, et toujours de son air de petit homme. »
La vieille bonne était fort attachée à l’enfant dont elle était très fière. Elle était fière de sa gracieuse petite personne, de ses jolies manières, fière surtout des boucles dorées et brillantes qui tombaient autour de son aimable visage.
« Il n’y a pas un enfant dans la Cinquième Avenue, disait-elle (la Cinquième Avenue est le quartier aristocratique de New-York), non, il n’y en a pas un qui soit moitié aussi beau que lui. Tout le monde le regarde quand il a son habit de velours noir, taillé dans la vieille robe de madame. Avec ses cheveux bouclés, il a l’air d’un jeune lord. »
Cédric ne se demandait pas s’il ressemblait à un jeune lord ; d’abord il ne savait pas ce que c’était qu’un lord. Son plus grand ami était l’épicier du coin, le revêche épicier, qui n’était pas du tout revêche pour lui. Cédric le respectait et l’admirait beaucoup ; il le regardait comme un très riche et très puissant personnage. Il s’entassait tant de choses dans sa boutique : des pruneaux, des figues, des oranges, des biscuits ! De plus, il avait un cheval et une voiture pour porter ses marchandises. Cédric aimait bien aussi la laitière et le boulanger, ainsi que la marchande de pommes ; mais M. Hobbes l’emportait sur eux. Cédric et lui étaient dans de tels termes d’intimité que le petit garçon allait voir l’épicier tous les jours et restait longtemps assis dans la boutique, discutant la question du moment. M. Hobbes lisait les journaux avec assiduité et tenait Cédric au « courant des affaires ». Il lui disait si le Président « faisait son devoir ou non ».
C’est peu de temps après une élection qui les avait fort occupés, qu’un événement tout à fait inattendu apporta un changement extraordinaire dans la vie de Cédric, alors âgé d’un peu plus de huit ans.
Une chose à observer encore, c’est que cet événement arriva le jour même où M. Hobbes, parlant de l’Angleterre et de la reine, avait dit des choses très sévères sur l’aristocratie, s’élevant principalement contre les comtes et les marquis.
Il faisait très chaud, et, après avoir joué au soldat avec ses amis, Cédric était entré dans la boutique pour se reposer. Il avait trouvé M. Hobbes examinant d’un air farouche un numéro d’un journal illustré de Londres, contenant un dessin représentant une cérémonie de la cour.
« Ah ! dit-il rudement, voilà comme ils y vont ! On verra ce qui arrivera un de ces jours chez eux ! Tous sauteront, tous : comtes, marquis et le reste ! »
Cédric s’était perché, comme de coutume, sur une grande boîte de conserves et avait ôté son chapeau.
« Avez-vous connu beaucoup de marquis, monsieur Hobbes, demanda-t-il de son grand air sérieux, ou bien des comtes ?
— Non, répliqua M. Hobbes avec indignation ; il n’y a pas de danger ! Je ne me soucie pas d’en voir un dans ma boutique, assis sur mes barils de biscuits. » Et M. Hobbes était tellement satisfait du sentiment qu’il exprimait qu’il promena un regard orgueilleux autour de lui en essuyant son front.
« Peut-être ils ne voudraient pas être comtes s’ils pouvaient être autre chose, dit Cédric, se sentant quelque vague sympathie pour la malheureuse condition de ceux dont on parlait.
— Ils ne voudraient pas ! s’écria M. Hobbes ; ils ne voudraient pas ! Ils s’en glorifient au contraire. Ah ! bien oui, ils ne voudraient pas ! »
Cédric et son ami l’épicier parlèrent encore de cent autres choses. C’est surprenant tout ce que M. Hobbes trouvait à dire sur le Quatre Juillet, par exemple.
Le Quatre Juillet est l’anniversaire de l’Indépendance des États-Unis, c’est-à-dire du jour où les habitants de l’Amérique, jusque-là soumis à l’Angleterre, s’en séparèrent et se déclarèrent nation libre. On le célèbre toujours avec une grande solennité.

Quand l’épicier commençait à parler sur ce sujet, il semblait que cela ne dût pas avoir de fin. M. Hobbes aimait à raconter tout au long l’histoire de cette époque, à rappeler les faits de bravoure accomplis par les héros républicains et les actes de vilenie de ceux qui appartenaient à la mère patrie, comme on appelait alors l’Angleterre. Dans ces occasions, Cédric était si animé que ses yeux brillaient d’émotion, tandis que ses boucles s’agitaient autour de sa tête, et il attendait avec impatience le moment du dîner pour raconter à Chérie tout ce qu’il avait entendu.
Au moment de l’élection dont nous avons parlé plus haut, Cédric fut si vivement impressionné par tout ce qu’il entendit dire à son vieil ami, qu’il demeura persuadé que, si M. Hobbes et même lui, Cédric, ne s’en étaient mêlés, le pays aurait pu faire naufrage. L’épicier le mena, le soir, voir une grande marche aux flambeaux, et plusieurs de ceux qui portaient les lanternes remarquèrent, près d’un bec de gaz, un gros homme sur l’épaule duquel était juché un petit garçon qui criait et gesticulait en agitant son chapeau en l’air.
La conversation sur les comtes, les lords et la politique en général était au point le plus intéressant quand la vieille Mary apparut. Cédric pensa qu’elle venait pour acheter du sucre ou toute autre denrée ; il n’en était rien. Elle semblait éprouver une vive émotion.
« Venez, mon mignon, dit-elle à l’enfant ; votre mère vous demande.
— A-t-elle besoin de moi pour sortir ? » demanda-t-il.
Mais Mary le regarda sans lui répondre, et l’enfant lui trouva un air tout singulier.
« Qu’est-ce qu’il y a, Mary ? demanda-t-il.
— Il arrive d’étranges choses chez nous, dit la vieille bonne.
— Chérie a-t-elle eu froid ? est-elle malade ? interrogea Cédric anxieusement, tout en suivant la vieille femme.
— Non, il n’y a rien de ce genre ; mais c’est singulier, bien singulier ! »
Quand ils atteignirent la maison, un coupé stationnait devant la porte, et Maman causait avec quelqu’un dans le parloir. Mary fit monter l’enfant à sa chambre, et lui mit son costume de flanelle crème, avec son écharpe rouge, car il y avait trois ans qu’il avait perdu son père, et il ne portait plus le deuil. Elle arrangea aussi ses cheveux.
« Seigneur ! disait-elle, tout en se livrant à ces occupations, un grand seigneur ! un lord ! un comte ! qui s’en serait jamais douté ? »
Cédric ne comprit pas ce que signifiaient ces paroles, mais il pensa que sa mère le lui dirait pour sûr ; aussi laissa-t-il Mary pousser ses exclamations sans lui demander d’éclaircissements.
Quand il fut habillé, il descendit en courant au parloir. Un vieux monsieur, grand, maigre, à figure anguleuse, était assis dans un fauteuil en face de sa mère. Mme Errol semblait fort agitée, et l’enfant vit des larmes dans ses yeux.
« Oh ! Cédric, mon chéri, s’écria-t-elle, en courant au-devant de lui et en le serrant avec transport dans ses bras ; oh ! Cédric, mon cher garçon ! »
Le vieux monsieur se leva de son siège ; il regarda attentivement l’enfant en se caressant le menton de sa main osseuse.
« Ainsi, dit-il à la fin, c’est le petit lord Fautleroy ? »
II
Il n’y eut jamais un garçon plus étonné que Cédric pendant la semaine qui suivit. Ce fut une semaine étrange ! D’abord l’histoire que lui dit sa maman était des plus curieuses. Il lui fallut l’entendre deux ou trois fois avant de la pouvoir comprendre, et il se demandait ce que M. Hobbes en penserait. Cette histoire parlait de lords, de comtes ; son grand-papa, qu’il n’avait jamais vu, était un comte, et l’aîné de ses oncles, car il paraît qu’il en avait eu deux, aurait été comte, s’il n’avait pas été tué d’une chute de cheval. Après sa mort, son autre oncle aurait été comte à son tour, si, lui aussi, n’était mort subitement, à Rome, de la fièvre. Et à cause de ces deux événements-là, son papa à lui, Cédric, s’il avait vécu, aurait été comte ; mais tous étant morts, et Cédric seul étant resté, il paraît que c’est lui qui devait être comte après la mort de son grand-père, — comte de Dorincourt. — Pour le présent, il était lord, — lord Fautleroy.
M. Havisam, l’homme de loi du vieux comte, que celui-ci avait envoyé en Amérique, était chargé par lui de lui ramener son petit-fils. M. Havisam était complètement au courant des affaires de la famille. Son patron ne lui avait caché ni les chagrins et les inquiétudes que lui avaient causés ses fils aînés, ni la colère qu’il avait éprouvée en apprenant le mariage du troisième, ni la haine qu’il ressentait pour la jeune veuve, dont il parlait comme d’une femme appartenant à la dernière classe de la société : Une intrigante, disait-il, qui s’était fait épouser par le capitaine, sachant qu’il était fils d’un comte. Le vieil homme de loi partageait cette opinion, de même que les autres idées de son maître sur l’Amérique et les Américains en général. En outre, sa profession lui avait fait voir tant d’égoïsme et de calcul chez tous ceux avec qui il avait été en rapport, qu’il ne pouvait croire au désintéressement de personne, et encore moins à celui de la jeune Mme Errol. Ce n’est donc qu’avec répugnance qu’il accomplissait sa mission ; il lui était désagréable d’avoir à entrer en arrangement avec une femme qu’il jugeait vulgaire et cupide, et qui n’aurait sans doute aucun égard pour la mémoire de son mari ni pour la dignité de son nom. Quand il vit son coupé enfiler une petite rue étroite et s’arrêter devant une modeste petite maison, il se sentit impressionné désagréablement. Est-ce donc dans une semblable bicoque que le futur propriétaire des domaines de Dorincourt, de Wyndham, de Cholworth et de nombre d’autres était né et avait été élevé ? Cet enfant n’allait-il pas faire tache dans la noble famille dont M. Havisam conduisait les affaires depuis si longtemps et pour laquelle il avait un si profond respect ?
Lorsque Mary l’introduisit dans le petit parloir, il regarda autour de lui avec la pensée qu’il allait trouver beaucoup à critiquer. La pièce était simplement meublée ; cependant elle avait un air intime qui plaisait tout d’abord. On n’y voyait pas d’ornements communs ou de mauvais goût, mais seulement quelques petits objets qui ne pouvaient sortir que de la main d’une femme.
« Ce n’est pas déjà si mal ici, se dit-il ; sans doute le goût du capitaine a prévalu. »
Mais quand Mme Errol entra dans la chambre, il commença à penser qu’elle pouvait y être aussi pour quelque chose. S’il n’avait pas été un gentleman si raide et si parfaitement maître de lui, il n’aurait pu se défendre de laisser paraître une certaine émotion en l’apercevant. Dans sa simple robe noire, sans ornement, elle avait plus l’air d’une jeune fille que de la mère d’un garçon de sept ans. Il fut frappé de l’expression triste et douce de ses traits, une expression qui ne l’avait pas quittée depuis la mort de son mari, excepté quand elle causait ou jouait avec son fils. La vieille expérience de l’homme de loi lui avait appris à lire clairement sur les visages, et aussitôt qu’il eut jeté un regard sur celui de la mère de Cédric, il reconnut que le comte s’était complètement trompé en la supposant une femme mercenaire. Il vit tout de suite aussi qu’il n’aurait pas avec elle les difficultés qu’il redoutait, et il commença à se dire qu’après tout le petit lord Fautleroy ne serait peut-être pas une honte pour sa famille, comme il avait été tenté de le croire. Le père avait été un noble jeune homme, la mère était une femme belle et distinguée ; il n’y avait pas de raison pour que l’enfant ne leur ressemblât pas quelque peu.
Quand il annonça à Mme Errol ce qui l’amenait, celle-ci devint pâle.
« Oh ! s’écria-t-elle, va-t-il donc m’être enlevé, le cher petit ? Il m’aime tant ! Et moi… je n’ai pas d’autre bien au monde ! J’ai essayé d’être pour lui une bonne mère… » Et sa voix tremblait tandis que ses larmes coulaient le long de sa figure.
L’homme de loi toussa pour s’éclaircir la voix.
« Je suis obligé de vous dire, répondit-il avec un peu d’hésitation, que le comte de Dorincourt n’est pas… n’est pas très bien disposé pour vous. Il est âgé, vous le savez, et attaché à ses préjugés. Il a toujours particulièrement détesté l’Amérique et les Américains, et a été très mécontent du mariage de son fils. Je sais qu’il est très déterminé à ne pas vous voir. Je regrette infiniment d’être le porteur d’une communication si peu agréable. Son plan est que lord Fautleroy vive avec lui, qu’il soit élevé chez lui et sous sa propre surveillance. Il est attaché à Dorincourt et y passe la plus grande partie de son temps. La goutte le tourmente souvent, et le séjour de Londres lui est tout à fait contraire. Lord Fautleroy habitera donc principalement le château de Dorincourt. Le comte vous offre la Loge, une habitation agréable, située à peu de distance du château, ainsi qu’un revenu suffisant pour y vivre d’une manière honorable. Lord Fautleroy pourra aller vous voir tant que vous le désirerez, mais vous ne pourrez aller le voir vous-même ni franchir les grilles du parc. Vous voyez, madame, que vous ne serez pas réellement séparée de votre fils, et je vous assure que les termes de cet arrangement ne sont pas aussi… hem ! aussi durs qu’ils pourraient l’avoir été. D’ailleurs les avantages que doit en recueillir lord Fautleroy seront très grands pour lui, et… »
Il s’attendait que Mme Errol allait se mettre à pleurer, à gémir et à se lamenter comme plus d’une aurait fait à sa place, et il en était ennuyé et embarrassé d’avance ; mais il n’en fut rien. Elle alla à la fenêtre, resta quelques instants le dos tourné vers la chambre, et M. Havisam s’aperçut qu’elle s’efforçait de commander à ses sentiments.
« Le capitaine Errol avait conservé le meilleur souvenir de Dorincourt, dit-elle enfin, en venant reprendre sa place ; il en était fier, ainsi que de son nom. L’Angleterre et tout ce qui était anglais lui était cher. C’était un grand chagrin pour lui d’avoir quitté son pays ; il aurait été heureux de penser que son fils pût y retourner un jour, et je crois en effet que ce sera un bien pour mon petit garçon qu’il en soit ainsi. J’espère — je suis sûre — que le comte ne sera pas assez cruel pour essayer de détourner de moi le cœur de mon fils, et je suis sûre aussi que, s’il l’essayait, il n’y parviendrait pas. C’est une nature chaude et sincère et un cœur fidèle. Il m’aimerait toujours, même quand on le séparerait complètement de moi, et, tant que nous pourrons nous voir, je ne souffrirai pas trop d’en être séparée, puisque c’est pour le bien de son avenir.
— Elle ne pense pas à elle, se dit le vieil homme de loi ; elle n’est pas égoïste, comme le prétendait le comte. Madame, reprit-il, votre fils vous remerciera plus tard du sacrifice que vous vous imposez aujourd’hui. Je puis vous affirmer que lord Fautleroy sera très soigneusement élevé et que tout sera fait pour assurer son bonheur. Le comte de Dorincourt sera aussi anxieux de son bien-être que vous pourriez l’être vous-même.
— J’espère encore, dit la pauvre petite maman, d’une voix brisée par l’émotion, que son grand-père aimera Cédric. Le cher enfant est d’une nature affectueuse, et il a toujours été aimé. »
M. Havisam toussa de nouveau pour s’éclaircir le gosier. Il ne s’imaginait pas trop le goutteux et irascible vieux comte aimant quelqu’un ; mais il savait qu’il considérerait comme de son intérêt d’être bienveillant, autant du moins que sa nature le comportait, pour l’enfant qui devait être son héritier. Il savait aussi que si Cédric lui faisait honneur, il en serait fier et lui accorderait tout ce qu’il demanderait ; cependant il se contenta de répondre :
« Lord Fautleroy ne manquera de rien, et c’est en vue de son bonheur que le comte désire que vous habitiez assez près de lui pour le voir fréquemment. »
Le vieil homme de loi ne pensa pas qu’il fût nécessaire de rapporter exactement les expressions du comte, qui n’étaient ni aimables ni même polies, et il préféra présenter ses offres dans un langage plus doux et plus courtois.
Il reçut un léger choc lorsque Mme Errol, ayant demandé à Mary où était Cédric et lui ayant donné l’ordre d’aller le chercher, celle-ci répondit :
« Il est sûrement chez M. Hobbes, assis près du comptoir, au milieu des caisses de cassonade et de biscuit de mer, et causant politique avec lui, selon son habitude. »
Ses inquiétudes lui revinrent. Les fils des gentilshommes anglais n’ont pas coutume de se lier d’amitié avec les épiciers. Ce serait terrible si l’enfant allait avoir de mauvaises manières et des dispositions à aimer la basse compagnie. Une des plus amères humiliations du vieux comte avait été ce penchant de ses deux fils aînés à rechercher les gens au-dessous d’eux. Cet enfant allait-il partager ces fâcheuses dispositions au lieu des bonnes qualités de son père ?
Mais à peine la porte de la chambre se fut-elle ouverte pour livrer passage à Cédric que cette crainte s’évanouit. Il reconnut à l’instant que c’était un charmant enfant, et en effet sa beauté était peu commune. Sa démarche était aisée et gracieuse, et il portait la tête droite avec un brave petit air. Il ressemblait à son père d’une manière frappante, quoiqu’il eût les yeux bruns de sa mère. L’expression de ceux-ci n’était ni craintive ni hardie ; ils peignaient la confiance et l’innocence et regardaient les choses et les gens en face, comme un enfant qui n’a à se défier de personne.
« Vraiment, se dit intérieurement M. Havisam en poursuivant son examen, pendant que Cédric se jetait dans les bras de sa mère, c’est certainement le petit garçon le plus beau, le mieux fait et le plus gracieux que j’aie vu de ma vie.
— Ainsi, c’est le petit lord Fautleroy ? » se contenta-t-il de dire tout haut, ainsi que nous l’avons rapporté.
Cédric, qui ne se doutait pas qu’il fût l’objet d’un examen quelconque, agit à sa manière ordinaire. Après avoir embrassé sa mère, il donna une poignée de main à M. Havisam, comme il avait coutume de le faire avec les rares visiteurs qui venaient chez eux, et répondit à ses questions avec la tranquillité et l’aisance qu’il mettait à répondre à celles de M. Hobbes.
Quelques instants après l’arrivée de Cédric, M. Havisam prit congé de Mme Errol.
« Oh ! Chérie, dit l’enfant à sa mère lorsque le vieil homme de loi fut parti, j’aimerais mieux ne pas être comte ni lord. Aucun des autres garçons n’est ni lord ni comte. Est-ce que je ne peux pas ne pas l’être ? »
Mais il paraît que c’était inévitable, d’après une longue conversation que sa mère et lui eurent ce même jour, tandis que Mme Errol était assise dans son fauteuil au coin du feu, et Cédric à ses pieds en compagnie de Pussy, sa chatte. Par moments, il semblait tout au plaisir de jouer avec elle, comme de coutume ; on n’aurait pas dit, à l’expression de sa figure, qu’il était survenu quelque chose d’extraordinaire dans son existence ; mais dans d’autres toutes ses inquiétudes lui revenaient, et il levait vers sa mère sa petite figure anxieuse, et rouge des efforts qu’il faisait pour faire entrer tant de choses nouvelles dans son esprit.
« Ton père aurait accepté avec joie l’offre du comte, dit Mme Errol, et je serais une mère égoïste si je refusais de te laisser partir. Un petit garçon ne peut pas comprendre toutes les raisons qu’il y a à donner pour agir ainsi ; mais plus tard tu reconnaîtras que j’ai bien fait. »
Cédric secoua la tête.
« Je serai très chagrin de quitter M. Hobbes, dit-il. Il me manquera beaucoup, et je crains de lui manquer aussi. Tous me manqueront, d’ailleurs. »
III
Le lendemain, aussitôt le déjeuner, il se rendit à la boutique d’épicerie dans une grande anxiété.
Il trouva M. Hobbes lisant le journal, ce qui était son occupation favorite, et il s’approcha d’un pas grave. Il sentait qu’il allait porter un coup à son vieil ami en lui disant ce qui était arrivé, et tout en faisant le trajet qui séparait la maison de sa mère de celle de l’épicier, il s’était demandé comment il lui apprendrait toutes ces choses.
« Bonjour ! fit M. Hobbes, de la manière brève qui lui était habituelle.
— Bonjour, monsieur Hobbes, » dit Cédric.
Il ne grimpa pas sur un des barils ou sur un des ballots qui se trouvaient là, comme cela lui arrivait quelquefois ; mais il s’assit humblement sur une caisse de biscuit, et, prenant son genou à deux mains (c’était sa posture favorite), il demeura quelques instants silencieux. Cette manière de faire était si différente de celle qui lui était habituelle qu’elle étonna l’épicier.
« Qu’est-ce qu’il y a ? » dit-il en regardant par-dessus le journal étendu devant lui.
Cédric rassembla tout son courage.
« Monsieur Hobbes, dit-il, vous rappelez-vous ce dont nous avons parlé hier matin ?
— Il me semble, répliqua l’épicier, qu’il était question de l’Angleterre.
— C’est cela, dit Cédric. Mais juste au moment où Mary vint me chercher, vous rappelez-vous ? »
M. Hobbes frotta rudement de sa main droite le derrière de sa tête.
« Est-ce que nous n’en étions pas sur l’aristocratie ?
— Oui, dit Cédric avec un peu d’hésitation, sur l’aristocratie et… sur les comtes.
— Les comtes, c’est vrai ; je me souviens, nous en avons dit quelque chose en effet. »
Cédric se sentit rougir jusqu’à la racine des cheveux. Jamais rien d’aussi embarrassant ne lui était arrivé, et il craignait que ce ne le devînt aussi pour son vieil ami.
« Vous avez dit, reprit-il en faisant effort, que vous ne voudriez pas en avoir un, assis dans votre boutique, sur une de vos caisses de biscuit.
— L’ai-je dit ? répliqua M. Hobbes. Eh bien ! je le dis encore. Qu’il y vienne, et nous verrons !
— Monsieur Hobbes, dit Cédric humblement, il y en a un maintenant, là, sur cette caisse. »
L’épicier bondit sur sa chaise.
« Comment cela ? dit-il.
— Oui, dit Cédric modestement, je suis un comte ou j’en serai un ; je ne veux pas vous tromper. »
M. Hobbes parut très agité. Il se leva vivement.
« L’enfant est fou, se dit-il ; que lui est-il arrivé ? »
Il lui prit la main, et lui tâtant le pouls :
« Comment vous trouvez-vous, mon ami ? dit-il. Avez-vous du mal quelque part ? Y a-t-il longtemps que vous vous sentez ainsi ? »
Il posa sa grosse main sur les cheveux bouclés du petit garçon.
« Je vous remercie, dit Cédric un peu étonné ; je vais très bien. Je n’ai pas de mal à la tête ni ailleurs ; seulement j’ai beaucoup de chagrin de ce que je viens de vous dire là. C’est pour cela que Mary est venue me chercher hier. M. Havisam, qui est un homme de loi, causait avec maman et lui expliquait tout cela quand je suis arrivé. »
M. Hobbes se rassit tout tremblant, et, tirant, de sa poche un ample mouchoir à carreaux, il s’en frotta énergiquement le front.
« Un de nous a eu un coup de soleil, dit-il, en revenant à son idée ; ce n’est pas possible !
— Je vous dis que si, monsieur Hobbes, et nous ferons mieux d’en prendre notre parti. M. Havisam a fait tout le chemin d’Angleterre ici pour nous le dire. C’est mon grand-papa qui l’a envoyé.
— Qui est votre grand-papa ? » demanda l’épicier.
Cédric porta la main à sa poche et en retira un papier, qu’il déplia soigneusement et sur lequel étaient tracées quelques lignes de sa grosse et irrégulière écriture.
« Je n’aurais pas pu me rappeler tous ses noms si je ne les avais pas écrits, » dit-il.
Il lut alors tout haut et lentement :
« John-Arthur Molyneux Errol, comte de Dorincourt. Il demeure dans un château, et même, je crois, dans deux ou trois. Papa était son plus jeune fils, et je n’aurais sans doute pas été un lord et un comte si papa avait vécu, et papa n’aurait pas été un comte non plus si ses deux frères avaient vécu. Mais ils sont tous morts, et alors c’est moi qui dois être lord et comte, et c’est pourquoi mon grand-père m’a envoyé chercher pour demeurer avec lui en Angleterre. »
M. Hobbes semblait avoir de plus en plus chaud, car il soufflait de plus en plus et il épongeait son front de plus en plus énergiquement. Il commençait à comprendre qu’en effet il s’était passé quelque chose d’extraordinaire ; mais en regardant l’enfant assis sur la caisse de biscuit, avec l’innocente et anxieuse expression empreinte dans ses jolis yeux bruns, il vit bien qu’il n’y avait rien de changé en lui, mais qu’il était toujours le même, aimable, beau, brave petit garçon, avec son simple habillement de drap noir et sa cravate ponceau. Alors toutes ses idées sur la noblesse furent bouleversées, surtout à cause de la simplicité ingénue avec laquelle Cédric lui avait donné toutes ces nouvelles, sans se douter de l’importance prodigieuse qu’elles pouvaient avoir.
« Et… et… quel nom m’avez-vous dit qu’était le vôtre ? demanda-t-il.
— C’est Cédric Errol, lord Fautleroy ; c’est ainsi que M. Havisam m’a appelé. Il a dit, quand je suis entré dans la chambre : « Ainsi, c’est le petit lord Fautleroy ? »
— Prodigieux ! » fit l’épicier. C’est l’exclamation qu’il employait quand il était étonné ou échauffé. « Prodigieux ! » Il ne pouvait trouver autre chose à dire pour l’instant.
Cédric parut trouver que c’était tout à fait le mot de la situation. Son respect et son affection pour M. Hobbes étaient si grands qu’il admirait et approuvait toutes ses remarques. Il ne connaissait pas assez le monde pour faire des comparaisons entre l’épicier et d’autres personnes. Les manières de son vieil ami étaient très différentes de celles de sa maman, il s’en était bien aperçu ; mais sa maman était une dame, et il avait quelque idée que les dames ne ressemblaient pas aux messieurs sous ce rapport.
Il regarda l’épicier d’un air pensif.
« L’Angleterre est très loin ? demanda-t-il.
— De l’autre côté de l’océan Atlantique, répondit M. Hobbes.
— C’est ce qui me fait de la peine : peut-être serai-je longtemps sans vous voir ; je n’aime pas à penser à cela.
— Les meilleurs amis doivent se séparer.
— Il y a longtemps que nous le sommes, amis, dit Cédric.
— Presque depuis votre naissance. Vous aviez environ six semaines quand vous fîtes votre première promenade dans les bras de votre nourrice.
— Ah ! remarqua Cédric avec un soupir, je ne pensais guère, à ce moment-là, que je deviendrais un comte !
— Il n’y a donc pas moyen de l’empêcher ? demanda M. Hobbes.
— Je crains que non. Maman dit que papa aurait été bien aise que je le fusse. Mais s’il faut absolument que je sois comte, il y a une chose que je peux essayer de faire ; je peux essayer d’en être un bon, de ne pas devenir un tyran, et si jamais il y a une autre guerre entre l’Angleterre et l’Amérique, j’essayerai de l’arrêter. »
Cette conversation fut longue et sérieuse. Une fois le premier choc reçu, M. Hobbes ne se montra pas aussi farouche qu’on aurait pu s’y attendre. Il essaya de se soumettre aux événements, et avant que l’entrevue eût pris fin il s’y était résigné. Il fit à Cédric de nombreuses questions au sujet de sa nouvelle situation, et comme l’enfant ne pouvait le plus souvent y répondre, il essayait d’y répondre lui-même. Lancé sur le sujet des marquis et des comtes, il expliqua les choses d’une manière qui probablement aurait fort étonné M. Havisam si le digne homme avait été à portée de l’entendre.
IV
Quelques jours après, M. Havisam eut une conversation avec Cédric : une conversation qui amena de temps en temps un sourire sur les lèvres ridées de l’homme de loi et qui lui fit frotter, à plusieurs reprises, son maigre menton avec ses doigts osseux.
Mme Errol ayant été appelée hors du parloir, l’homme de loi et Cédric restèrent ensemble. D’abord M. Havisam se demanda ce qu’il pourrait bien dire à un si petit personnage. Il avait dans l’idée qu’il ferait peut-être bien de le préparer à son entrevue avec son grand-père et au grand changement qui allait avoir lieu dans son existence : car Cédric n’avait pas la moindre idée du sort qui l’attendait en arrivant en Angleterre ; il ne savait même pas encore que sa mère ne devait pas vivre avec lui. On avait pensé qu’il valait mieux lui laisser recevoir le premier choc avant de le lui apprendre.
M. Havisam était assis dans un large fauteuil, d’un côté de la table ; de l’autre était un fauteuil encore plus large. Cédric s’y installa bien au fond, les mains dans ses poches et ses boucles dorées se répandant sur le dossier, imitant de son mieux la pose de M. Hobbes. Tant que sa mère était restée dans la chambre, il avait examiné M. Havisam très attentivement et sans rien dire. Quand Mme Errol fut sortie, il demeura encore quelques instants en silence, comme s’il continuait à étudier le vieil homme de loi, qui, lui, de son côté, étudiait certainement Cédric, toujours se demandant ce qu’il pourrait bien dire à un petit garçon dont les jambes étaient à peine assez longues pour dépasser le coussin du fauteuil.
Ce fut Cédric qui entama la conversation.
« Savez-vous une chose, monsieur ? dit-il ; je ne me doute pas du tout de ce que c’est qu’un comte.
— Vraiment ! dit M. Havisam.
— Non ; et je pense que quand on doit en être un, il faut savoir ce que c’est. Ne trouvez-vous pas ?
— Vous avez raison, répliqua l’homme de loi.
— Voudriez-vous bien, reprit l’enfant respectueusement, prendre la peine de me l’expliquer. — Qui est-ce qui fait les comtes ?
— Un roi ou une reine. Généralement on fait comte un homme qui a rendu quelque grand service à l’État.
— C’est comme le président des États-Unis, alors ? dit Cédric.
— Vos présidents sont élus, je crois ? dit M. Havisam.
— Oui, répondit Cédric avec animation. Quand un homme est très bon, qu’il a accompli de grandes actions, il est nommé président. Alors il y a une procession avec des bannières, des torches, des lanternes, des marches aux flambeaux ; on fait des discours… Je me suis dit quelquefois que je pourrais devenir président, mais je ne m’étais jamais imaginé que je pourrais être comte, — ajouta l’enfant d’un air pensif. — C’est sans doute parce que je n’en avais jamais beaucoup entendu parler, reprit-il avec empressement, de peur de paraître impoli à M. Havisam en ayant l’air de ne pas se soucier de cette dignité ; si je savais ce que c’est, sans doute j’aimerais à l’être.

— C’est tout autre chose qu’un président, dit l’homme de loi.
— Ah ! dit Cédric, alors il n’y a pas de marches aux flambeaux ? »
Havisam croisa sa jambe gauche sur sa jambe droite, rapprocha le bout de ses doigts l’un de l’autre ; c’était sa pose favorite quand il avait à parler affaires : il se disait que le moment était venu de fournir quelques explications à l’enfant.
« Un comte, commença-t-il, est un personnage très important.
— Un président aussi, reprit Cédric. La marche aux flambeaux a cinq milles de long, on tire des fusées et on fait de la musique… M. Hobbes m’a emmené voir cela ; c’était très beau.
— Un comte, reprit l’homme de loi, est généralement de très ancien lignage.
— Qu’est-ce que cela veut dire ?
— De très vieille famille, extrêmement vieille.
— Je crois que je comprends, dit Cédric, enfonçant ses mains plus profondément encore dans ses poches. La marchande qui vend des pommes à l’entrée du parc doit être de très ancien… comment dites-vous ?… lignage. Elle est si vieille que c’est tout au plus si elle peut marcher. Elle a bien cent ans ; et cependant elle reste là quand il pleut. Cela me fait de la peine, et aux autres garçons aussi. Un dimanche on avait donné à Billy, mon camarade de classe, un dollar ; je le priai d’acheter tous les jours à la vieille femme pour deux ou trois sous de pommes, jusqu’à ce qu’il n’eût plus d’argent. Il ne demanda pas mieux, car c’est un très bon garçon ; seulement le jeudi il en avait assez. — Vous comprenez, manger tous les jours des pommes, c’est ennuyeux, si on ne les aime pas beaucoup. — Par bonheur, ce même jour, une dame qui vient quelquefois voir maman m’en donna un, de dollar, et je pus acheter tous les jours des pommes à la marchande, pendant très longtemps, à la place de Billy. La pauvre femme ! cela vous ferait peine de la voir ! Elle dit qu’elle a mal dans ses os, surtout quand il pleut ; elle a un si ancien lig… lignage ! »
M. Havisam demeura quelque peu embarrassé.
« Je crains que vous ne m’ayez pas tout à fait compris, reprit-il. Quand je parle d’ancien lignage, je ne veux pas parler d’âge avancé ; je veux dire que le nom de la famille est connu depuis longtemps ; que depuis des centaines d’années peut-être ce nom a été porté par des personnes qui se sont illustrées dans l’histoire de leur pays.

— Comme George Washington ! dit Cédric, j’ai entendu parler de lui depuis que je suis né, et il était connu bien longtemps encore avant. M. Hobbes dit que son nom ne sera jamais oublié ; c’est à cause de la Déclaration de l’Indépendance et du Quatre Juillet… vous savez, il était très brave.
— Le premier comte de Dorincourt fut créé comte il y a quatre cents ans, dit M. Havisam d’un ton solennel.
— Vraiment ! dit Cédric ; cela fait beaucoup de temps ! Avez-vous dit cela à Chérie ? Cela l’intéresserait beaucoup ! Nous le lui dirons quand elle reviendra : elle aime toujours à entendre des choses curieuses. — Et quelle autre chose a-t-il faite encore pour être comte ?
— Plusieurs des comtes de Dorincourt ont aidé à gouverner l’Angleterre, continua M. Havisam ; d’autres ont été remarquables par leur bravoure et se sont distingués autrefois dans les batailles.
— J’aimerais à faire comme eux, s’écria Cédric : papa était soldat et très brave — brave comme George Washington. — Peut-être est-ce à cause de cela qu’il aurait été comte, s’il n’était pas mort. Je suis heureux de savoir que les comtes sont braves ; c’est très beau d’être brave. Autrefois, quand j’étais petit, j’avais peur si je me trouvais tout seul, le soir, sans lumière ; mais quand j’entendis parler de George Washington et de sa bravoure, et de celle des soldats de la Révolution, cela me guérit.
— Il y a un grand avantage à être comte, dit M. Havisam lentement, et en observant l’effet que ses paroles allaient produire sur l’enfant ; généralement les comtes sont très riches.
— C’est une bonne chose, dit innocemment Cédric. J’aimerais bien à être riche.
— Ah ! Et pourquoi ? demanda M. Havisam.

— C’est que, répliqua l’enfant, il y a tant de choses qu’on peut faire avec de l’argent ! Ainsi, par exemple, la marchande de pommes : eh bien ! si j’étais très riche, je pourrais lui acheter une petite tente, avec un petit poêle pour s’installer l’hiver, et, chaque fois qu’il pleuvrait, je lui donnerais un dollar, de manière à ce qu’elle ne soit pas obligée de sortir et qu’elle puisse rester chez elle à se chauffer. Je lui donnerais aussi un châle pour que ses os ne lui fassent plus tant mal. Ce doit être très pénible quand vos os vous font souffrir ; si elle avait toutes ces choses, je suis sûr que les siens ne lui feraient plus de mal du tout.
— Hum ! fit l’homme de loi, et que feriez-vous encore si vous étiez riche ?
— Naturellement, d’abord, j’achèterais à Chérie toutes sortes de belles choses : des nécessaires, des éventails, des dés d’or et des bagues, et une voiture pour qu’elle ne soit plus obligée d’attendre les tramways quand elle sort. Si elle aimait les robes de soie roses ou bleues, je pourrais lui en acheter aussi ; seulement elle n’aime que les noires… Mais au fait, ce serait bien plus simple, je la conduirais dans les plus grandes boutiques et je lui dirais de choisir. — Il y a aussi Dick…
— Qui est Dick ? demanda M. Havisam vivement intrigué.
— C’est un garçon qui cire les bottes des passants, et il y est très habile. Il est installé là-bas, au coin de la place. Je le connais depuis des années et des années. Une fois, étant tout petit, je me promenais avec Chérie. Elle m’avait acheté une belle balle qui rebondissait ; voilà qu’en traversant la rue ma balle tombe et se met à sauter et à rebondir au milieu des voitures. Moi je commence à pleurer, — j’étais tout petit dans ce temps-là. — Dick était occupé à faire reluire les souliers d’un monsieur ; il s’écrie : « Attendez ! » Il s’élance entre les chevaux et les voitures, il rattrape la balle, l’essuie avec sa jaquette et me la tend en disant : « Tenez, jeune homme ! » Maman l’admira beaucoup et moi aussi, et depuis ce jour, quand nous allons de ce côté-là, nous lui parlons toujours ; nous lui demandons comment vont les affaires ; la dernière fois, il nous a dit qu’elles étaient mauvaises.
— Et que voudriez-vous faire pour lui ? demanda M. Havisam en souriant et en frottant son menton.
— Je voudrais lui acheter une petite boutique, c’est-à-dire une estrade, avec une chaise dessus, pour asseoir ses pratiques, comme le cireur de bottes qui est là-bas à la porte du parc, et qui est si bien installé, lui. Il y a un parapluie au-dessus de la chaise, et c’est très commode quand il pleut ou quand il fait grand soleil. Je lui achèterais aussi des brosses neuves, et puis des habits, et comme cela il serait très heureux. Il me disait l’autre jour : « Tout ce que je désirerais, ce serait de trouver quelqu’un qui pût me prêter quelques dollars. »
Et Cédric continua à parler encore de Dick, persuadé, dans son innocence et sa simplicité, que le vieux monsieur prenait autant d’intérêt à son ami qu’il en prenait lui-même. En vérité, M. Havisam commençait à se sentir captivé, quoique ce ne fût pas précisément par ce qui regardait le petit décrotteur et la marchande de pommes, mais simplement par le petit garçon, dont la tête bouclée s’appuyait sur le dossier du fauteuil placé en face de lui, toute pleine de projets pour les autres et s’oubliant complètement lui-même.
« Mais pour vous, que désireriez-vous si vous étiez riche ? lui dit-il.
— Oh ! beaucoup de choses ! D’abord je donnerais à Mary un peu d’argent pour Brigitte : c’est sa sœur ; elle a douze enfants et un mari qui n’a pas d’ouvrage. Quand elle vient ici, elle pleure. Chérie lui donne à emporter des habits, des provisions, et elle est bien contente, ce qui n’empêche pas qu’elle pleure encore plus fort. Je pense aussi que M. Hobbes serait bien aise d’avoir une montre avec une chaîne d’or, et puis une pipe en écume de mer. »
En ce moment la porte s’ouvrit et Mme Errol rentra.
« Je suis fâchée d’avoir été obligée de vous laisser si longtemps seul, dit-elle à M. Havisam ; mais une pauvre femme qui est dans le chagrin est venue me voir…
— Lord Fautleroy m’a tenu compagnie ; il m’a entretenu de quelques-uns de ses amis et de ce qu’il voudrait faire pour eux s’il était riche et maître de son argent.
— Brigitte est l’une de ces personnes, et c’est à elle que je viens de parler dans la cuisine. Son mari a une fièvre rhumatismale, et elle se trouve dans la misère. »
Cédric glissa vivement en bas du fauteuil.
« Je vais aller la voir, dit-il, et lui parler de Michel. Il est très complaisant quand il n’est pas malade, ajouta-t-il en s’adressant à M. Havisam, et très habile. Une fois, il m’a fait une épée de bois ; il a beaucoup de talent, oh ! oui, beaucoup. »
Et il quitta la chambre en courant.
« Dans la dernière entrevue que j’ai eue avec le comte, dit M. Havisam après quelques instants d’hésitation, Sa Seigneurie m’a donné des instructions… Afin que son petit-fils envisage avec un certain plaisir la perspective de sa vie future en Angleterre, et aussi afin de le bien disposer pour son grand-père, le comte m’a ordonné de satisfaire tous ses désirs et de lui faire savoir que c’était lui, le comte de Dorincourt, qui m’en fournissait les moyens. Sûrement Sa Seigneurie n’a pas prévu quels seraient les souhaits que formerait son petit-fils ; n’importe ! il m’a ordonné de m’y conformer, et puisque lord Fautleroy veut secourir cette pauvre femme… »
Dans cette occasion, pas plus que dans d’autres, il ne répétait exactement les paroles du comte, qui auraient laissé beaucoup à désirer sous le rapport de l’amabilité et de la courtoisie.
« Faites comprendre à mon petit-fils, avait dit celui-ci, que je peux lui donner tout ce qu’il désire. Qu’il voie ce que c’est que d’être le petit-fils du comte de Dorincourt. Achetez-lui tous les objets qui lui feront envie. Qu’il ait toujours de l’argent dans ses poches et qu’il sache bien que c’est son grand-père qui le lui donne. »
Les motifs du comte étaient loin d’être élevés ; mais la mère de Cédric avait une nature trop droite et trop affectueuse pour les soupçonner. Sans s’apercevoir du profond égoïsme qui se cachait sous ces apparences généreuses, elle se dit qu’il était naturel qu’un homme âgé, seul, malheureux, qui avait perdu tous ses enfants, cherchât, par de bons procédés, à gagner l’affection et la confiance de l’unique rejeton qui lui restât. De plus, elle était heureuse de penser que le premier effet de la fortune étrange et soudaine qui venait de tomber sur son petit garçon, serait de venir en aide à une pauvre femme à laquelle elle s’intéressait et qui avait tant besoin de secours.
« Oh ! s’écria-t-elle, toute rougissante de joie, c’est très bon de la part du comte ! Cédric va être si heureux ! Il a toujours beaucoup aimé Brigitte et Michel, qui sont tout à fait méritants. J’ai souvent souhaité pouvoir les aider un peu plus que je ne le faisais. Michel est un excellent ouvrier, quand il est en bonne santé ; mais il a été longtemps malade ; il lui a fallu des médicaments, une bonne nourriture, des vêtements chauds, ce qui a épuisé leurs ressources. Lui et Brigitte sauront ménager ce qu’on leur donnera. »
M. Havisam mit sa main osseuse dans sa poche et en tira un large portefeuille. Un sourire bizarre se jouait sur sa figure. La vérité est qu’il se demandait ce que penserait le riche, orgueilleux et égoïste lord quand il apprendrait quel avait été le premier désir de son petit-fils, et quand son envoyé lui dirait comment avait été dépensé le premier argent qui lui aurait été donné en son nom.
« Madame, dit-il tout haut, vous savez que le comte est extrêmement riche. Si vous voulez bien rappeler votre fils, je lui donnerai, avec votre permission, ces cinq livres (environ cent vingt-cinq francs) pour ces pauvres gens.
— Cinq livres ! s’écria Mme Errol ; ce sera la richesse pour eux. C’est à peine si je peux croire à pareil bonheur.
— Il est pourtant très réel, » reprit M. Havisam avec son sourire compassé ; et il ajouta d’un ton important : « Un changement considérable vient d’avoir lieu dans l’existence de votre fils, et un grand pouvoir reposera dans ses mains.
— Un grand pouvoir ! répéta la mère, et il est si petit ! Comment lui apprendrai-je à en bien user ? Cette pensée m’effraye. Mon cher petit Cédric… ! »
L’homme de loi toussa de nouveau légèrement ; son vieux cœur endurci était ému par le regard anxieux et timide de la jeune femme.
« Je crois, madame, dit-il, autant que j’en peux juger par mon entrevue de ce matin avec Sa Seigneurie, que le futur comte de Dorincourt pensera aux autres encore plus qu’à lui-même. Il n’est encore qu’un enfant, mais il me semble qu’on peut se fier à lui. »
Cédric rentrait en ce moment dans le salon.
« Ce sont des douleurs rhum… rhumatismales, à ce que raconte Brigitte, dit-il, et il paraît que ce sont des douleurs terribles. Et Michel voit bien qu’ils ne vont pas pouvoir payer le loyer, et cela rend les douleurs encore plus fortes. Au moins si Patty avait une robe propre, comme dit Brigitte, elle pourrait aller en journée et gagner quelque chose pendant que son père est malade ; mais elle n’a que des loques à se mettre. »
La figure de l’enfant était très anxieuse en parlant ainsi.
« Chérie dit que vous me demandez, monsieur, ajouta Cédric à qui sa mère venait de dire quelques mots.
— Le comte de Dorincourt… » commença l’homme d’affaires ; mais il s’arrêta, un peu embarrassé, de ce qu’il avait à dire, ou du moins de la manière de le dire, et jeta un coup d’œil involontaire à Mme Errol.
Celle-ci s’agenouilla vivement sur le tapis, comme pour se mettre mieux à la portée de son fils, et jetant tendrement ses bras autour de lui :
« Cédric, lui dit-elle, le comte est ton grand-papa, le propre papa de ton père. Il est très, très bon, il t’aime et il désire que tu l’aimes, en remplacement de tous ses enfants qui sont morts. Son plus grand désir est de te rendre heureux et de rendre tout le monde heureux autour de lui. Il est très riche, il peut te donner tout ce que tu désires. Il l’a dit à M. Havisam, à qui il a remis beaucoup d’argent pour toi. Tu peux donner un peu de cet argent à Brigitte, afin qu’elle puisse payer son loyer et acheter à Michel ce dont il a besoin. N’en es-tu pas bien content, hein ? » ajouta-t-elle en déposant un tendre baiser sur les joues rondes de l’enfant, où la joie causée par l’annonce de ces richesses inattendues et arrivées si à propos avait fait monter des couleurs plus éclatantes que de coutume.
Cédric regarda successivement sa mère et l’homme de loi.
« Puis-je avoir cet argent maintenant ? s’écria-t-il ; puis-je le donner tout de suite à Brigitte ?… Elle va partir. »
M. Havisam lui tendit les cinq pièces d’or.
Cédric s’élança hors de la chambre.
« Brigitte, l’entendit-on s’écrier en se précipitant dans la cuisine, Brigitte, attends un instant : voici de l’argent ; tu pourras payer ton loyer ; mon grand-papa me l’a envoyé. C’est pour toi et pour Michel.
— Oh ! monsieur Cédric, s’écria la pauvre femme, à demi suffoquée par la surprise et par la joie ; cinq livres ! cinq livres ! Savez-vous que cela fait vingt-cinq dollars ! Je ne peux pas accepter tout cela sans la permission de votre maman.
— Je vous demande pardon, il faut que j’y aille, » dit en souriant Mme Errol ; et elle quitta le salon, laissant M. Havisam seul.
« Elle a pleuré ! s’écria Cédric en rentrant impétueusement dans la chambre quelques instants après, elle a pleuré ; mais elle a dit que c’était de joie. Je n’avais jamais vu personne pleurer de joie. Mon grand-papa est très bon. C’est bien plus agréable d’être comte que je ne le croyais, beaucoup plus agréable. Je suis content de l’être ! »
V
Le lendemain de ce jour, M. Havisam put reconnaître que, quoique Cédric prêtât à certains sujets plus d’attention sérieuse que n’en donnent habituellement les enfants, il ne cédait pas sa part aux autres quand il était question de jeu.
Comme son coupé tournait le coin de la rue, il aperçut un groupe de petits garçons fort excités. Deux d’entre eux s’étaient défiés à la course, et l’un des compétiteurs était précisément Sa Seigneurie, le petit lord Fautleroy. Cédric faisait à lui tout seul, par ses clameurs, plus de bruit que tous ses compagnons. Son camarade et lui, rangés sur la même ligne ; une jambe en avant, attendaient le signal du départ.
« Un ! glapit celui qui devait le donner ; deux ! trois ! En avant ! »
M. Havisam fit arrêter sa voiture et se pencha à la portière avec un singulier sentiment d’intérêt et de curiosité. Il ne se rappela pas avoir jamais vu de petites jambes chaussées de bas rouges s’agiter avec autant de vélocité que les petites jambes de Sa Seigneurie, pendant que, les poings fermés et les cheveux au vent, elles couraient sur la piste.
« Hourra ! hourra ! Errol ! criaient les autres garçons en dansant et en poussant des acclamations ; hourra ! Billy ! » car Billy, celui dont Cédric avait parlé à M. Havisam, au sujet de la marchande de pommes, était son rival dans cette occasion.
« Je crois vraiment qu’il va gagner la course, se dit l’homme de loi. » La manière dont les jambes rouges battaient le pavé, les cris des enfants, les efforts de Billy, dont les jambes brunes n’étaient pourtant pas à mépriser, avaient produit en lui un certain excitement.
« Je ne peux pas m’empêcher d’espérer qu’il va gagner, » ajouta-t-il.
À ce moment, les cris et les clameurs redoublèrent, ainsi que les danses et les sauts. D’un dernier élan, le futur comte de Dorincourt venait d’atteindre le candélabre de becs de gaz qui servait de but, juste deux secondes avant que Billy lui-même le touchât.
« Trois hourras pour Cédric ! s’écria la troupe bruyante ; trois hourras pour Cédric Errol ! »
M. Havisam sortit sa tête entièrement de la fenêtre du coupé, et avec un de ces sourires secs avec lesquels il tâchait d’éclaircir sa physionomie :
« Bravo ! lord Fautleroy ! » s’écria-t-il.
Et M. Havisam donna l’ordre au cocher de repartir.
Comme la voiture s’arrêtait devant la maison de Mme Errol, l’homme de loi vit venir, bras dessus, bras dessous, le vainqueur et le vaincu, suivis par la bande bruyante. Le teint de Cédric était très animé ; ses yeux brillaient encore plus que de coutume, et les boucles de ses cheveux se collaient sur son front humide.
« Je suis sûr que j’ai gagné parce que mes jambes sont un peu plus longues que les tiennes, disait-il à Billy, afin de lui rendre sa défaite moins amère ; oui, ce doit être à cause de cela, car tu cours aussi bien que moi. Je suis plus vieux que toi d’abord : j’ai trois jours de plus ; cela me donne un avantage. C’est quelque chose, trois jours ! »

Cédric avait une manière à lui, et qui lui était inspirée par son cœur, de mettre les gens à leur aise. Même dans la première joie du triomphe, il se disait que le battu pouvait n’être pas aussi satisfait que lui et aimerait à penser qu’il pourrait être gagnant à son tour. Il réussit si bien à consoler Billy de sa défaite, qu’un sourire se montra bientôt sur la figure de celui-ci, qui d’abord avait paru très vexé d’avoir été vaincu, et qu’il ne tarda pas à recommencer ses fanfaronnades, comme c’était assez son habitude, et comme si c’était lui qui venait de remporter la victoire.
VI
Plus M. Havisam voyait le petit lord et plus il se sentait subjugué par lui. Il pensait au vieux comte de Dorincourt assis dans la grande, sombre et splendide chambre de son château appelée la bibliothèque, malade, souffrant de la goutte et seul : entouré par le luxe et la grandeur, servi par un grand nombre de domestiques, mais n’ayant personne, près de lui pour l’aimer, parce que, dans tout le cours de sa longue vie, il n’avait réellement aimé personne que lui-même ; qu’il s’était toujours livré à ses goûts, à ses plaisirs et à ses penchants, sans jamais se soucier des goûts, des plaisirs, des penchants ou même des besoins de personne. Ses immenses richesses et le pouvoir que lui donnaient son nom et son rang élevé dans l’État lui avaient toujours semblé des avantages qui lui étaient départis pour le simple agrément du « Comte de Dorincourt », et pour qu’il en usât selon son bon plaisir. Maintenant qu’il était vieux, il ne lui restait, de sa vie passée que la maladie, une irritabilité extrême et un grand mépris pour le monde, qui le lui rendait bien. Il pouvait, il est vrai, remplir son château avec des hôtes de choix ; il pouvait donner de grands dîners et de splendides parties de chasse ; mais il savait que ceux mêmes qui se rendaient à ses invitations ne trouvaient aucune satisfaction à se trouver en face de son visage renfrogné et qu’ils redoutaient ses sarcasmes : car il avait toujours eu une langue piquante et il aimait à railler les gens, à les intimider et à leur faire sentir son pouvoir.
En regard du hautain gentilhomme, formant un contraste parfait avec lui, M. Havisam se représentait l’aimable, gai, ouvert petit garçon qui, quelques jours auparavant, était assis au fond du grand fauteuil, en face de lui, lui racontant à sa généreuse et innocente manière l’histoire de ses amis, Dick, Brigitte, la marchande de pommes. Il pensait aux immenses revenus, aux magnifiques propriétés et au pouvoir pour le bien et pour le mal qui, avec le temps, devaient tomber dans ses petites mains, et il disait :
« Cela fera une fameuse différence ! une fameuse différence ! »
Le sentiment qu’eut Cédric des avantages qu’il y avait à être comte augmenta encore la semaine suivante. Il lui était pour ainsi dire impossible de concevoir un désir qu’il ne pût réaliser, et il s’empressa de le faire avec une satisfaction et une simplicité qui amusèrent beaucoup le vieil homme de loi. Pendant la semaine qui précéda leur départ pour l’Angleterre, ils firent des choses assez singulières et auxquelles l’envoyé du comte n’était certes pas préparé. Ce digne gentleman se rappela longtemps le matin où il accompagna Sa petite Seigneurie. dans une visite à Dick, et l’après-midi où Cédric étonna si fort la marchande de pommes — d’ancien lignage — en s’arrêtant devant son éventaire et en lui apprenant qu’elle allait avoir un châle, une tente, un poêle, et de plus une somme d’argent qui sembla à la bonne femme tout à fait considérable.
« Car je vais aller en Angleterre pour être un lord, dit l’enfant avec simplicité, et je n’aimerais pas à penser que vos os vous font mal, chaque fois qu’il pleut. Mes propres os ne me font pas de mal, et je ne m’imagine peut-être pas très bien ce qu’on éprouve dans ce cas-là ; mais cela ne m’empêche pas de sympathiser avec vous de tout mon cœur, et j’espère que vous serez mieux maintenant.
« C’est une très bonne femme, dit-il à M. Havisam en quittant la propriétaire du futur établissement, à peine revenue de sa surprise et ne pouvant croire à cette fortune inespérée ; c’est une très bonne femme. Une fois que je tombai et que je me fis mal au genou, elle me donna une pomme pour rien. Je me le suis toujours rappelé. On se rappelle toujours quand quelqu’un a été bon pour vous. »
Il n’était jamais entré dans son excellent, simple et honnête petit esprit qu’on pût être ingrat.
L’entrevue avec Dick fut tout à fait émouvante. Les affaires du petit décrotteur étaient dans le plus triste état ; ses brosses étaient usées, et il n’avait pas le moyen de les remplacer. Quand Cédric lui annonça, de son petit ton doux et tranquille, et sans prendre le moins du monde un air important, qu’il allait lui fournir de quoi s’établir d’une manière tout à fait confortable, la surprise rendit le pauvre garçon presque muet. En apprenant que son jeune ami était lord et menaçait de devenir comte, il demeura saisi de stupeur et resta quelques instants la bouche et les yeux ouverts, pendant que sa casquette roulait par terre sans qu’il s’en aperçût. En la ramassant, il poussa une exclamation dont le sens échappa à M. Havisam, mais que Cédric comprit mieux.
« Non, répondit-il, je ne suis pas fou ; M. Hobbes a cru comme vous ; il s’est imaginé que j’avais perdu la tête, mais rien n’est plus vrai que ce que je vous dis. D’abord j’étais un peu fâché de penser que j’étais lord et que je serais comte ; mais depuis que j’en ai usé, je trouve que c’est très agréable. C’est mon grand-père qui est comte maintenant, et il a dit qu’il voulait faire tout ce qui me ferait plaisir. Il est très bon, quoique comte, et il m’a envoyé beaucoup d’argent par M. Havisam. »
La fin de l’histoire fut que Cédric remit à Dick la somme nécessaire pour acheter les objets qu’il ambitionnait, à savoir : l’estrade, la chaise, le parapluie, les brosses, et une demi-douzaine de pots de cirage. Cédric y joignit des habits et une casquette pour remplacer la sienne, qui avait subi bien des orages, sans compter son dernier plongeon dans le ruisseau. Le pauvre garçon ne pouvait pas plus croire à son bonheur que la marchande de pommes — d’ancien lignage — ne pouvait croire au sien. Ses jambes flageolaient, il regardait son petit bienfaiteur d’un air tout effaré. Pourtant, quand Cédric eut glissé un billet entre ses doigts, il comprit qu’il n’avait pas rêvé, comme il avait été un instant tenté de le croire.
« Adieu, dit le petit lord en lui donnant une poignée de main, adieu ! et, quoiqu’il fît tous ses efforts pour parler fermement, il y avait un petit tremblement dans sa voix, de même qu’il y avait quelque chose qui troublait ses grands yeux bruns ; j’espère que le commerce ira bien. Je suis fâché d’être obligé de partir et de vous quitter, mais peut-être reviendrai-je pour vous voir quand je serai comte. Écrivez-moi, je vous en prie, car nous serons toujours bons amis. Si vous le faites, voici l’adresse qu’il vous faudra mettre sur la lettre : Lord Fautleroy, car mon nom n’est plus Cédric Errol tout court. Adieu, Dick ! »
Dick cligna aussi ses paupières, qui étaient humides comme celles de Cédric. Le pauvre garçon aurait été bien embarrassé d’exprimer ce qu’il sentait, s’il l’avait essayé. Peut-être est-ce à cause de cela qu’il ne l’essaya pas et qu’il se contenta d’agiter ses paupières et d’avaler une espèce de grosse boule qu’il avait à la gorge et qui l’étouffait.
« Je suis bien fâché, moi aussi, que vous partiez, dit-il enfin d’une voix étranglée, — et il cligna des yeux de nouveau pour faire disparaître ce qui lui obscurcissait la vue, — bien fâché ! »
Puis il regarda M. Havisam, et touchant sa casquette :
« C’est un petit garçon bien… bien extraordinaire, ajouta-t-il ; merci, monsieur, de l’avoir amené ici, et aussi de ce que vous avez fait. Oui, c’est un petit garçon bien extraordinaire… »
Et quand M. Havisam et le petit lord prirent congé de lui, Dick, la grosse boule dans sa gorge, toujours prête à l’étouffer, et ses yeux toujours brouillés par la petite larme qui s’était attachée à ses paupières et qu’il s’obstinait à ne pas essuyer, comme s’il ne s’apercevait pas de sa présence, Dick les suivit du regard jusqu’à ce que la mince silhouette de Cédric eût disparu, ainsi que celle du grave personnage qui l’accompagnait.
Jusqu’au jour du départ, Sa Seigneurie passa la plus grande partie de son temps dans la boutique de M. Hobbes. Une amére tristesse avait envahi l’épicier ; il était très abattu. Quand son jeune ami lui apporta en triomphe la montre et la chaîné d’or qu’il voulait lui offrir comme souvenir, M. Hobbes ne sut pas comment remercier. Il posa la petite boîte sur son large genou et se moucha plusieurs fois bruyamment.
« Il y a quelque chose d’écrit à l’intérieur, dit Cédric ; j’ai dit moi-même ce qu’il fallait mettre : « Lord Fautleroy à son plus vieil ami, M. Hobbes. » Quand vous lirez ces mots, vous penserez à moi. J’aurais du chagrin si vous m’oubliiez. »
M. Hobbes se moucha de nouveau et encore plus énergiquement.
« Il n’y a pas de danger que je vous oublie, dit-il d’une voix un peu saccadée, comme Dick l’avait fait. J’espère que vous ne m’oublierez pas non plus, quand vous serez là-bas, avec vos lords et vos seigneuries.
— Je ne vous oublierai pas, n’importe avec qui je me trouverai, dit le petit lord ; j’ai passé avec vous mes meilleures journées, du moins quelques-unes des meilleures. J’espère qu’un jour vous viendrez me voir. Je suis sûr que mon grand-papa sera très heureux de vous connaître. Peut-être il vous écrira pour vous en prier, quand je lui aurai parlé de vous. Vous ne lui en voudrez pas trop d’être un comte ; je veux dire vous ne refuseriez pas de venir, s’il vous y invitait, à cause de cela ?
— J’irais pour vous, » répliqua M. Hobbes gracieusement.
Ainsi il sembla arrêté entre eux que, si l’épicier recevait une pressante invitation du comte pour venir passer quelques mois à Dorincourt, il mettrait de côté ce qu’il appelait ses sentiments républicains et s’empresserait de faire sa valise.
VII
Enfin tous les préparatifs de départ prirent fin, et l’heure arriva où la voiture qui devait mener les voyageurs au bateau s’arrêta devant la porte. Alors un singulier sentiment d’isolement enveloppa le petit garçon. Sa maman s’était enfermée quelques instants dans sa chambre. Quand elle en sortit, ses yeux étaient brillants et humides, et sa bouche tremblait. Cédric alla à elle ; elle se pencha vers lui : il lui jeta les bras autour du cou, et ils échangèrent des baisers. Il savait bien que quelque chose les rendait tristes tous les deux, quoiqu’il ne pût pas dire ce que c’était ; mais il murmura tendrement à l’oreille de sa mère :
« Nous aimions bien tous deux cette petite maison, Chérie, nous l’aimions bien ; nous l’aimerons toujours, n’est-ce pas ?
— Oui, oui, mon amour, répondit-elle en embrassant Cédric ; oui, mon amour. »
Ils montèrent alors dans la voiture. Le petit lord s’assit tout près de sa mère, jeta un dernier regard sur la maison, puis il s’enfonça au fond de la banquette et demeura silencieux.
Quelques instants après, ils étaient sur le pont du steamer, au milieu du bruit et de la confusion. Des omnibus, des voitures de toutes sortes, amenaient des passagers, qui faisaient décharger leurs bagages. Les commissionnaires s’empressaient de les enlever et de les porter sur le bateau ; d’autres voyageurs se hâtaient d’accourir, pressés par l’heure et agités de la crainte d’arriver trop tard ; les marins déroulaient des cordages ; les officiers donnaient des ordres ; des messieurs et des dames, des enfants avec leur bonne, qui étaient venus dire adieu à des amis en partance, allaient et venaient sur le pont ; quelques-uns riaient et babillaient gaiement ; d’autres, et c’était le plus grand nombre, tristes et silencieux, essuyaient leurs yeux avec leur mouchoir. Cédric trouvait tout cela intéressant. Il regardait les piles de cordes enroulées, les voiles repliées, les mâts qui touchaient presque le ciel bleu, et il commençait à faire des plans pour causer avec les marins quand on serait en mer, et pour les interroger au sujet des pirates.
Tout en formant ce projet, il suivait des yeux les derniers préparatifs du départ, penché sur le parapet du pont. Il s’amusait beaucoup de ce tumulte inaccoutumé, des cris des marins et des commissionnaires, lorsqu’il remarqua qu’un léger mouvement se produisait dans un groupe à quelques pas. Quelqu’un cherchait à se frayer passage pour arriver jusqu’à lui. C’était un garçon de quatorze ou quinze ans, qui tenait à la main quelque chose de rouge. Cédric eut bientôt reconnu Dick. Celui-ci s’élança presque hors d’haleine vers le petit lord, aussitôt qu’il l’eut aperçu.

« J’ai couru tout le temps, dit-il, pour vous voir encore une fois. Je voulais vous donner ceci, que j’ai acheté avec ce que j’ai gagné hier, continua-t-il en montrant l’objet qu’il avait à la main. Vous le porterez quand vous serez là-bas, sur la mer. J’ai perdu le papier qui l’enveloppait pendant que je m’efforçais de passer entre ces gens là-bas. Qu’est-ce qu’ils avaient besoin de m’empêcher d’avancer ? C’est un mouchoir. »

Dick débita ce discours tout d’une haleine. Une cloche sonna ; il fit un saut en arrière et disparut parmi la foule des passagers avant que Cédric eût eu le temps de placer un mot.
Un instant après, l’enfant l’aperçut au milieu du flot des visiteurs qui étaient venus dire un dernier adieu à leurs amis, et qui se dirigeaient vers la passerelle réunissant le bâtiment au quai, car la cloche venait de donner le signal du départ :
« Adieu ! s’écria encore Dick tout haletant, adieu ! Portez-le quand vous serez sur la mer ! »
En parlant ainsi, il s’élança sur la passerelle, et sauta sur le quai en agitant son chapeau.
Cédric avait déplié le mouchoir, qu’il regardait avec admiration. Il était de soie rouge, et orné de fers à cheval imprimés en couleur plus foncée.
Le tumulte et la confusion étaient à leur comble ; ceux qui étaient sur les quais criaient au revoir à leurs amis qui allaient partir, et ceux-ci leur répondaient non moins bruyamment.
« Au revoir ! au revoir ! entendait-on de tous côtés. Ne nous oubliez pas ; écrivez-nous à Liverpool. Adieu, adieu ! »
Le petit lord se pencha sur le garde-fou, et faisant flotter le mouchoir de soie rouge :
« Au revoir, Dick, cria-t-il, au revoir ! Je vous remercie, Dick ! je vous remercie ! »
Le gros steamer commence à se mouvoir ; les passagers et leurs amis continuent à pousser des acclamations, et la mère de Cédric tire son voile sur ses yeux. Cela lui fait de la peine de quitter sa patrie pour aller habiter un pays qu’elle ne connaît pas. Tous les passagers se penchent sur la balustrade pour envoyer un dernier adieu à leurs amis. Pour Dick, il ne voit que la gentille petite figure de Cédric et ses cheveux dorés et brillants soulevés par la brise. Il n’entend rien que la douce et affectueuse voix d’enfant qui répète : « Au revoir, Dick ! » tandis que le petit lord Fautleroy quitte lentement le lieu de sa naissance pour se diriger vers la terre inconnue de ses ancêtres, que son père a quittée presque en banni.
VIII
Ce fut pendant le voyage que la mère de Cédric lui apprit qu’ils ne devaient pas vivre tous deux dans la même maison. L’enfant eut d’abord quelque peine à le comprendre ; mais quand il en fut bien convaincu, son chagrin fut si grand que M. Havisam reconnut combien le comte avait été bien inspiré en faisant des arrangements pour que Mme Errol pût vivre près de son fils et le voir souvent. Il était visible qu’il n’eût pas supporté une séparation plus complète ; mais sa mère s’y prit avec tant de tendresse et de douceur qu’au bout de quelque temps l’impression de profonde tristesse qu’il avait reçue d’abord se dissipa.
« La maison que je dois habiter est tout près du château, ne cessait-elle de répéter, chaque fois que le sujet revenait sur le tapis ; à une très petite distance de celle que tu habiteras toi-même ; tu pourras venir me voir tous les jours, et nous serons si heureux pendant ces moments-là ! Tu auras tant de choses à me raconter ! Le château de Dorincourt est très beau ; ton papa m’en a parlé bien souvent. Il l’aimait beaucoup, et tu l’aimeras de même.
— Je l’aimerais encore bien mieux si vous étiez avec moi, » dit Sa petite Seigneurie, pendant qu’un soupir s’échappait de son pauvre cœur oppressé.
Il ne pouvait que se sentir fort troublé par un si bizarre état de choses qui mettait sa « Chérie » dans une maison et lui dans une autre.
Le fait est que Mme Errol n’avait pas jugé à propos de lui dire pourquoi ces arrangements avaient été pris.
« J’aimerais mieux qu’il n’en sût rien, dit-elle à M. Havisam, il ne le comprendrait pas ; il en serait seulement choqué et peiné, et je suis sûr que ses sentiments pour son grand-père seront plus affectueux s’il ne sait pas que le comte me déteste si profondément. Il n’a jamais connu la haine ou même la dureté, ni par lui-même ni par les autres, et ce serait un coup bien rude pour lui d’apprendre que quelqu’un peut me haïr. Il a un petit cœur si tendre et il m’aime tant ! Il vaut mieux pour le comte qu’on ne lui parle pas de cela avant qu’il soit plus âgé. Quoique Cédric ne soit qu’un enfant, la connaissance des sentiments que me porte son grand-père mettrait une barrière entre son petit-fils et lui. »
Ainsi l’enfant sut seulement que quelques mystérieuses raisons nécessitaient cette séparation ; qu’il était encore trop jeune pour les comprendre et qu’on les lui expliquerait un peu plus tard. Mais ce n’étaient pas les raisons de cette détermination qui le touchaient ; c’était la détermination elle-même ; néanmoins, après beaucoup de causeries avec sa mère, où celle-ci s’efforça de le conforter en plaçant devant lui le côté agréable de la perspective, l’autre s’affaiblit peu à peu. Cependant M. Havisam le surprit plus d’une fois, assis dans une attitude pensive, regardant gravement la mer, et plus d’une fois aussi il entendit un profond soupir s’échapper de ses lèvres enfantines.
« Je n’aime pas cet arrangement, dit-il au messager du comte, un jour qu’il causait sérieusement avec lui sur le sujet qui lui tenait si fort au cœur ; oh ! non, je ne l’aime pas du tout ; mais il y a comme cela beaucoup d’ennuis et de chagrins dans ce monde qu’il faut savoir supporter. Mary le disait ; M. Hobbes aussi, et Chérie désire que j’aille vivre avec mon grand-papa, parce que, voyez-vous, tous ses enfants sont morts et qu’il est très triste. Cela rend un homme bien malheureux quand il a perdu tous ses enfants ; aussi j’irai avec lui. »
Une des choses qui charmaient toujours les gens qui étaient en relation avec Sa petite Seigneurie, c’est le sage petit air qu’elle prenait quand elle se livrait à la conversation. Combiné avec des remarques au-dessus de son âge et avec l’expression d’innocence peinte sur sa ronde petite figure, cet air était irrésistible. Quand le beau petit garçon au teint rosé et aux boucles ondoyantes s’asseyait gravement, et, frottant ses mains potelées, se mettait à converser sérieusement, c’était une joie pour ceux qui l’écoutaient. Peu à peu, M. Havisam lui-même en était arrivé à prendre beaucoup de plaisir et d’amusement dans sa société.
« Et alors, vous allez tâcher d’aimer le comte ? dit-il, en réponse au propos que nous avons rapporté.
— Bien sûr, dit Sa Seigneurie. C’est mon grand-père, et naturellement on doit aimer son grand-père. De plus, il a été très bon pour moi. Quand une personne fait tant de choses pour vous, et vous donne tout ce que vous désirez, vous ne pouvez pas faire autrement que de l’aimer, même quand elle ne vous est pas parente ; mais quand elle agit avec tant de bonté, et que de plus elle vous est parente, vous l’aimez encore davantage.
— Croyez-vous que lui-même vous aimera ? demanda M. Havisam.
— Sans doute, puisque je suis son petit-fils. Un grand-père aime toujours ses petits-enfants ; et, d’ailleurs, s’il ne m’aimait pas, il ne vous aurait pas dit de me donner tout ce que je désire de sa part, et surtout il ne vous aurait pas envoyé me chercher pour vivre avec lui. »
Quand les passagers, qui avaient d’abord été malades du mal de mer et obligés de garder leur cabine, commencèrent à venir s’établir sur le pont pour passer la journée, ils s’intéressèrent vivement au petit lord, dont l’histoire romanesque n’avait pas tardé à être connue. Chacun le suivait des yeux, soit qu’il courût sur le pont avec les autres enfants, soit qu’il se promenât tranquillement avec sa mère ou M. Havisam, soit qu’il écoutât les histoires des matelots. Il s’était fait des amis partout. Quand les messieurs parcouraient le pont d’un bout à l’autre en causant et qu’ils l’invitaient à se joindre à eux, Cédric, allongeant son petit pas, frappait le plancher du pied d’un air crâne, et répondait gaiement aux remarques et aux plaisanteries qu’on lui adressait. Les dames l’appelaient souvent, et on entendait toujours des éclats de rire s’échapper des groupes dont il était le centre. Les enfants ne s’amusaient jamais autant que quand il était de leurs parties. Mais c’était parmi les marins qu’il avait les plus chauds amis.

Ils lui contaient leurs miraculeuses histoires de pirates, de naufrages, d’îles désertes ; lui taillaient de petits bateaux dans du bois, lui apprenaient les termes nautiques, si bien qu’à leur exemple, Cédric émaillait ses discours de « bâbords », de « tribords », de « grelin », de « misaine », etc.
Un vieux matelot nommé Jerry était son préféré. À en juger d’après ses récits, Jerry avait fait deux ou trois mille voyages et avait invariablement fait naufrage chaque fois, dans une île peuplée de cannibales « altérés de sang » ; il avait même été rôti et mangé, en partie du moins, à plusieurs reprises, et scalpé une douzaine de fois.
Scalper quelqu’un, c’est lui enlever la peau du crâne avec la chevelure. C’est ainsi que les sauvages en usent avec leurs prisonniers, et vous devez penser que peu de personnes résistent à une pareille opération.
« C’est sans doute pour cela qu’il est chauve, disait Cédric, en racontant à sa mère les catastrophes dont son ami le marin avait été victime. Quand on a été scalpé plusieurs fois, les cheveux ne peuvent plus repousser. Ceux de Jerry ne sont jamais revenus depuis le jour où le Serpent de feu, le roi des Ac… Accomanches, lui enleva sa chevelure, à l’aide du couteau fait avec le crâne du Loup féroce, un autre chef de ce pays-là. Il dit que ce sont les moments les plus durs qu’il ait jamais eu à passer, et je le crois. Il eut si peur quand le roi brandit son grand sabre, que ses cheveux se dressèrent tout droit sur sa tête, absolument comme les crins d’une brosse. C’est étonnant toutes les aventures que Jerry a eues ! J’aimerais pouvoir en parler avec M. Hobbes ; elles l’intéresseraient beaucoup. Pour ma part, j’ai tort bien sûr, mais si ce n’était pas Jerry qui me raconte toutes ces choses, j’aurais envie quelquefois de croire qu’elles ne sont pas tout à fait vraies ; mais, puisque c’est à Jerry qu’elles sont arrivées, à lui-même !… Pourtant, il doit se faire quelquefois qu’il se trompe ou qu’il oublie quelque chose ; ce qui n’est pas étonnant : car il a été scalpé bien souvent, et être scalpé souvent peut faire perdre un peu la mémoire. »
IX
Onze jours après avoir dit adieu à son ami Dick, Cédric atteignit Liverpool, et, dans la soirée suivante, le carrosse dans lequel il avait pris place avec sa mère et M. Havisam, en quittant la station du chemin de fer, s’arrêta à la porte de la Loge. On ne pouvait pas voir grand’chose de la maison dans l’obscurité. Cédric reconnut seulement que la voiture tournait sous de grands arbres ; et quand elle eut roulé pendant quelques minutes, il aperçut une porte ouverte, d’où s’échappait un torrent de lumière.
Il sauta à terre et vit deux ou trois domestiques qui attendaient dans le grand vestibule. Parmi eux était Mary, qui accompagnait ses maîtres en Angleterre et qui les avait devancés de quelques heures à la Loge.
Lord Fautleroy lui sauta gaiement au cou.
« Vous voilà, Mary ! s’écria-t-il. Chérie, voilà Mary ! et il embrassa la vieille servante sur les deux joues.
— Je suis heureuse de vous voir, Mary ! dit Mme Errol à demi-voix ; cela me fait du bien. Au moins c’est quelqu’un qui ne m’est pas étranger ! »
Et elle tendit sa petite main à la fidèle créature, qui la pressa doucement et d’une manière encourageante. Elle comprenait combien tout ce qui l’entourait devait sembler « étranger » à la pauvre jeune femme, qui venait de quitter le pays où elle était née et que son enfant lui-même allait quitter.
Les servantes regardèrent avec curiosité le petit garçon et sa mère. Tous deux avaient été le sujet des conversations depuis qu’il était question de leur arrivée. On savait quelle affreuse colère le mariage du fils cadet du comte avait autrefois excitée chez son père ; on savait les déboires que lui avaient causés ses autres fils, aussi bien que la raison pour laquelle Mme Errol devait vivre à la Loge et le petit lord au château. On connaissait aussi la dureté de son grand-père, dont la goutte augmentait encore l’humeur acariâtre.
« Il n’aura guère de bon temps, le pauvre petit ! » disaient les domestiques entre elles.
Il retira lui-même son pardessus, comme un petit garçon qui n’est pas habitué à se faire servir, et se mit à regarder autour de lui et à examiner le large vestibule, ainsi que les peintures et les bois de cerf qui l’ornaient. Ces choses lui semblaient d’autant plus curieuses que, jusque-là, il n’en avait vu que dans les musées et les établissements publics.
« Chérie, dit-il enfin, cette maison est très jolie, et je suis heureux de penser que vous allez y vivre ; elle est très jolie, très grande. »
Elle était très grande en effet, surtout comparée à celle que Cédric avait habitée jusque-là. Mary les conduisit à une belle chambre à coucher, tendue de perse, dans la cheminée de

laquelle brillait un bon feu. Devant le foyer, un bel angora
blanc dormait, pelotonné sur le tapis, et semblait le frère
jumeau de celui que Cédric, à son grand regret, avait été forcé
de laisser à New-York.
« C’est la femme de charge du château, une excellente dame, expliqua Mary, qui a fait tous les préparatifs pour recevoir madame et qui a apporté cette belle chatte, pensant qu’elle amuserait Sa Seigneurie quand elle viendrait vous voir. Elle a connu le capitaine, et, pendant les quelques minutes seulement que je suis restée avec elle, j’ai vu combien elle l’aimait. Oui, elle a connu le capitaine quand il était enfant. C’était un très beau garçon, dit-elle, et plus tard un beau jeune homme, qui avait toujours un mot aimable pour chacun, grand ou petit. Alors je lui ai dit à mon tour : « Il a laissé un petit garçon qui lui ressemble ; je n’ai jamais vu un petit garçon plus beau et plus aimable. »
Quand Mme Errol et Cédric eurent enlevé leurs habits de voyage, ils descendirent au salon, vaste pièce voûtée, garnie de meubles sculptés du plus grand style. Une peau de tigre s’étendait devant le foyer. Le chat, qui avait suivi Cédric, comme s’il reconnaissait déjà qu’il avait trouvé un ami, s’y installa, et le petit lord s’étendit à côté pour faire plus ample connaissance avec lui, sans prêter attention à ce que disaient sa mère et M. Havisam.
Du reste, ils parlaient à demi-voix. Mme Errol était pâle et agitée.
« Il n’a pas besoin d’y aller ce soir, disait-elle. Ne sera-t-il pas temps demain ? Ne peut-il encore rester avec moi cette nuit ?
— Oui, il le peut, répliqua M. Havisam du même ton. J’irai moi-même au château sitôt après dîner, et j’informerai le comte de notre arrivée. »
Mme Errol contempla Cédric.
Il reposait dans une gracieuse attitude sur la peau rayée de noir et de jaune. Le feu jetait ses lueurs sur son teint éclatant, sur ses yeux brillants et sur les boucles d’or de sa chevelure. L’angora ronronnait de satisfaction en sentant la douce main de l’enfant passer sur sa fourrure soyeuse.
Mme Errol sourit faiblement.
« Le comte ne sait guère ce qu’il m’enlève, » dit-elle d’une voix douce et triste.
Puis s’adressant directement à l’homme d’affaires :
« Voudrez-vous dire à Sa Seigneurie, reprit-elle après un instant d’hésitation, que je préfère ne pas toucher d’argent ?
— Quel argent ? dit M. Havisam. Vous ne voulez pas parler de la rente que le comte se propose de vous payer ?
— Si, répondit-elle simplement. Je désire qu’il n’en fasse rien. Je suis obligée d’accepter la maison, puisque autrement il me serait impossible de vivre près de mon enfant, et je le remercie de me l’offrir ; mais je ne veux pas accepter autre chose. Mes revenus sont suffisants pour me faire vivre selon mes goûts, qui ont toujours été simples, et je n’ai pas besoin d’autre chose. Il me semble qu’en recevant l’argent qu’il m’a proposé, ce serait lui vendre mon fils. Si je le lui donne, c’est que je l’aime, ce cher enfant, au point de m’oublier pour lui et parce que je crois que son père aurait souhaité qu’il en fût ainsi. »
M. Havisam frotta son menton :
« C’est très étrange, dit-il. Je crains que cela ne le fâche ; il ne comprendra pas.
— Je pense qu’il le comprendra quand il y aura réfléchi, dit doucement la jeune femme. Je n’ai aucun besoin de cet argent. Comment accepterais-je ce dont je puis me passer de la part d’un homme qui me hait au point de me prendre mon enfant, l’enfant de son fils ! »
M. Havisam demeura pensif pendant quelques instants, le menton dans sa main, comme il faisait quand une question le préoccupait vivement.
« Je délivrerai votre message, dit-il enfin ; seulement j’ai peur, ainsi que je viens de vous le dire, que cette détermination n’offense le comte ; il est si… si absolu dans ce qu’il a décidé ! il souffre si peu la contradiction !
— Il ne peut me contraindre à recevoir une part de ses bienfaits plus grande que celle que je crois de ma dignité d’accepter, dit Mme Errol du même ton doux et tranquille.
— Je délivrerai votre message, » répéta M. Havisam. Et il quitta la mère et le fils de plus en plus captivé par les sentiments qu’ils lui avaient inspirés tous deux, laissant les pauvres créatures jouir du bonheur de passer encore une nuit ensemble.
X
Quand, une heure après, M. Havisam se présenta au château, il trouva le comte assis dans un grand fauteuil, près du feu ; son pied reposait sur un tabouret, car il souffrait d’un accès de goutte. Il envoya à l’homme de loi un coup d’œil perçant de dessous ses sourcils embroussaillés, et celui-ci put voir qu’en dépit de ses efforts pour paraître calme, Sa Seigneurie était vivement agitée.
« Eh bien ! Havisam, dit-il, vous voilà de retour. Quelles nouvelles ?
— Lord Fautleroy et sa mère sont à la Loge, répliqua l’homme d’affaires. Ils ont très bien supporté le voyage et sont en fort bonne santé. »
Le comte poussa une exclamation d’impatience, pendant que sa main s’agitait nerveusement sur le bras de son fauteuil.
« J’en suis charmé ! dit-il brusquement. Mais asseyez-vous, Havisam ; mettez-vous à votre aise et prenez un verre de vin. Et maintenant ?…
— Sa Seigneurie reste avec sa mère ce soir. Demain je l’amènerai au château. »
Le comte posa le coude sur le bras de son fauteuil et mit la main devant ses yeux, comme pour dérober à son interlocuteur l’effet que ses paroles allaient produire sur lui.
« Bien, dit-il ; continuez. Vous savez que je vous ai défendu de me rien écrire sur cette matière ; je ne sais donc rien de cet enfant. Quelle sorte de garçon est-ce ? » ajouta-t-il.
M. Havisam porta à ses lèvres le verre de porto qu’il s’était versé et s’assit le tenant à la main.
« Il est difficile de juger du caractère d’un enfant de huit ans, dit-il enfin.
— Un imbécile ! exclama le comte ; un garçon grossier, mal bâti ! Son sang américain parle.
— Je ne pense pas que le sang américain lui ait nui, mylord, reprit l’homme de loi, du ton tranchant qui lui était habituel. Je ne connais pas grand’chose aux enfants, mais il me fait plutôt l’effet d’être un beau garçon.
— De bonne santé et de bonne venue ? demanda le comte.
— De bonne santé, en apparence du moins, et de très belle venue.
— Droit, bien conformé ? »
Un léger sourire monta aux lèvres de M. Havisam. Il avait laissé à la Loge le beau et gracieux enfant au teint rosé, aux yeux brillants, à demi étendu devant le foyer, ses cheveux d’or répandus sur la peau de tigre.
« C’est plutôt un beau garçon, j’ose dire, reprit-il, quoique je ne sois peut-être pas très bon juge. Je crois seulement que vous le trouverez un peu différent de nos enfants anglais.
— Je n’en fais pas de doute, dit le comte en poussant un grognement, car son pied lui faisait sentir un élancement ; c’est une sorte d’impudent petit misérable, comme tous ces enfants américains.
— « Impudent », n’est pas précisément le terme, reprit M. Havisam de son même ton sec et coupant. C’est un mélange de maturité et d’innocence enfantine, qui a quelque chose de particulier.
— Américaine impudence ! insista le comte. On me l’a toujours dit. Ils appellent cela précocité et liberté. Grossièreté, rudesse, impudence ; voilà ce que c’est ! »
M. Havisam ne crut pas devoir répliquer. Il tenait rarement tête à son noble patron, surtout quand la noble jambe de son noble patron était enflammée par la goutte. Il trempa de nouveau ses lèvres dans le porto.
« J’ai un message à délivrer de la part de Mme Errol, dit-il en replaçant le verre sur la table.
— Je ne me soucie pas de ses messages, grommela Sa Seigneurie ; moins j’entendrai parler d’elle, mieux cela vaudra.
— Il a une certaine importance, reprit l’homme de loi. — Elle préfère ne pas accepter la rente que vous lui offrez, » dit-il après un moment de silence.
Le comte tressaillit.
« Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria-t-il.
— Elle prétend qu’elle n’en a pas besoin et que ses relations avec vous ne sont pas assez affectueuses…
— Pas affectueuses !… répéta le comte avec colère, j’ose le dire, quelles ne sont pas affectueuses. Je la hais ! Une intrigante !… Une mercenaire ! Je désire ne pas la voir.
— Vous auriez tort, mylord, de l’appeler mercenaire ; elle ne demande rien et refuse même d’accepter ce que vous lui offrez.
— C’est une comédie ! riposta le comte. Elle voudrait m’amadouer. Elle s’imagine que j’admirerai son désintéressement : elle se trompe. Je ne veux pas avoir une mendiante vivant à ma porte. Comme mère de son fils, elle a une position à garder, un rang à tenir. Elle aura l’argent, qu’elle le veuille ou non !
— Elle ne le dépensera pas, dit M. Havisam.
— Je ne me soucie pas qu’elle le dépense ou qu’elle ne le dépense pas ! dit brusquement Sa Seigneurie, mais elle le recevra. Elle ne pourra pas dire qu’elle est forcée de vivre chichement parce que je ne fais rien pour elle. Je ne veux pas qu’elle donne à son fils une mauvaise opinion de moi. Je suppose qu’elle a déjà empoisonné l’esprit de l’enfant à mon sujet.
— Non, dit M. Havisam, et j’ai même à vous communiquer un autre message qui vous prouvera qu’il n’en est rien.
— Je ne veux pas l’entendre », rugit le comte, mis hors de lui par la colère et par les élancements que lui donnait son pied malade.
Néanmoins M. Havisam reprit :
« Elle vous prie, de ne rien dire à lord Fautleroy qui pourrait lui faire comprendre que vous l’avez séparée de lui à cause des sentiments que vous avez conçus contre elle. Mme Errol est convaincue que ce serait mettre une barrière entre vous et lui, car il aime passionnément sa mère. Elle a tâché de lui faire accepter cette séparation en lui disant qu’il était trop jeune encore pour en comprendre la raison, et qu’on la lui dirait plus tard. Elle désire qu’il n’y ait aucun nuage sur votre première entrevue. »
Les yeux du comte lancèrent un éclair sous le profond abri de ses sourcils.
« Allons donc ! fit-il, vous ne me ferez pas accroire que la mère ne lui a rien dit.
— Pas un mot, mylord, reprit l’homme de loi froidement, pas un mot. Ceci, je puis vous l’affirmer. L’enfant est préparé à croire que vous êtes le plus aimable et le plus tendre des grands-pères. Rien, absolument rien, n’a été dit pour lui donner le plus léger doute sur vos perfections ; et comme j’ai exécuté vos ordres dans les plus grands détails, il vous regarde comme un miracle de générosité.
— Bah ! dit le comte.
— Je vous donne ma parole d’honneur que l’impression que lord Fautleroy aura de vous dépend entièrement de vous-même. Et si vous voulez me pardonner la liberté que je prends, j’ajouterai que je pense que cette impression sera d’autant plus favorable si vous ne lui parlez pas légèrement de sa mère.
— Bah ! bah ! dit le comte, l’enfant n’a que huit ans, après tout !
— C’est possible, mais il a passé ces huit années avec elle, et elle a toute son affection. »
XI
Il était déjà tard dans l’après-midi, le lendemain, quand le coupé contenant le petit lord et M. Havisam enfila la longue avenue qui conduisait au château. Le comte avait donné l’ordre que son petit-fils arrivât pour dîner avec lui, et, pour quelque raison qu’il ne jugea pas à propos de communiquer à personne, il voulait que l’enfant fût introduit seul dans la chambre où il avait l’intention de le recevoir. Comme la voiture montait l’avenue, lord Fautleroy, appuyé mollement sur les coussins, suivait avec le plus grand intérêt la perspective qui se déroulait à ses regards. Par le fait, rien ne le laissait indifférent : ni le confortable coupé avec les deux superbes chevaux qui y étaient attelés, ni leurs harnais magnifiques, ni le cocher et le valet de pied avec leurs livrées resplendissantes, ni même la couronne peinte sur les panneaux, et il se promettait de se faire expliquer ce qu’elle signifiait.
Quand la voiture atteignit la grande grille du parc, il se pencha à la portière pour mieux voir les deux lions de pierre qui décoraient l’entrée. La grille fut ouverte par une jeune femme fraîche, de bonne mine, qui sortit d’une jolie maisonnette couverte de lierre, située près de l’entrée. Deux enfants l’accompagnaient. La bouche ouverte et les yeux arrondis par la curiosité, ils se mirent à regarder le petit garçon qui était dans la voiture et qui, lui aussi, les regardait. La femme fit une révérence en souriant au petit lord, et sur un signe d’elle les deux enfants l’imitèrent.
« Est-ce qu’elle me connaît ? demanda Cédric. Elle croit me connaître, bien sûr. »
Et retirant son bonnet de velours noir, il la salua à son tour d’un air de joyeuse humeur.
« Comment allez-vous ? lui dit-il. Bonne après-midi ! »
La femme eut l’air charmé. Le sourire s’élargit encore sur sa bonne figure, tandis que ses yeux bleus brillaient de contentement.
« Que Dieu bénisse Votre Seigneurie, dit-elle, que Dieu bénisse votre aimable visage ! Bonne chance et bonheur à vous ! Soyez le bienvenu ! »
Lord Fautleroy agita encore une fois son bonnet en lui faisant un nouveau signe de tête amical.
« Cette femme me plaît, dit-il à M. Havisam, quand il l’eut perdue de vue. Elle a l’air d’aimer les enfants. Je serais bien aise de venir jouer de temps en temps avec les siens ; j’ai peur qu’ils n’aient pas beaucoup de camarades. »
M. Havisam ne jugea pas à propos de lui dire que probablement il ne lui serait pas permis d’aller jouer avec les enfants des gardes du parc. Il pensa qu’il serait temps plus tard de lui donner cette information.

La voiture roulait entre les grands et beaux ormes croissant de chaque côté de l’avenue, et étendant leurs énormes branches qui se recourbaient en arche au-dessus de la tête de Cédric. L’enfant n’avait jamais vu de si gros arbres. Il ne savait pas que le domaine de Dorincourt était un des plus vieux de toute l’Angleterre, que son parc était un des mieux plantés, et que ses avenues étaient presque sans égales ; néanmoins, il voyait bien que tout cela était magnifique. Il prenait plaisir à regarder le soleil couchant envoyer ses flèches d’or entre les branches touffues ; il jouissait de la parfaite tranquillité qui semblait régner sous ces superbes ombrages ; il admirait la manière dont ils étaient disposés, tantôt pressés les uns contre les autres, et laissant à peine le regard glisser entre leurs épais fourrés, tantôt isolés ou groupés sur de vastes pelouses.
De temps en temps la voiture atteignait des espaces couverts de fougères ; dans d’autres, le terrain était tapissé de fleurs sauvages. Plusieurs fois Cédric poussa une exclamation de joie en voyant un lapin sauter du taillis sur la route, puis y rentrer bien vite, son petit bout de queue blanche se dressant derrière lui ; ou bien c’était une compagnie de perdrix qui s’envolait avec un bruissement d’ailes, ce qui faisait battre des mains au petit lord.
« C’est un très bel endroit, dit-il à M. Havisam, je n’en ai jamais vu de si beau. C’est plus beau encore que le Parc Central. (Le Parc Central est un des jardins publics de New-York.)
« Et puis, comme c’est grand ! ajouta-t-il. Combien y a-t-il de la grille d’entrée au château ?
— Environ trois ou quatre milles, répondit l’homme de loi. (Un mille vaut un peu plus d’un kilomètre.)
— Comme c’est grand ! » répéta Cédric.
À chaque instant, l’enfant apercevait de nouveaux sujets d’étonnement et d’admiration. Ce qui l’enchanta le plus, ce fut la vue d’un troupeau de daims, couchés sur le gazon, qui tournèrent vers lui leurs jolies têtes, garnies de bois élégants, quand le coupé passa près d’eux. L’enfant n’avait jamais vu de ces animaux que dans les ménageries.
« Est-ce qu’ils demeurent toujours ici ? demanda-t-il ravi.
— Sans doute, dit M. Havisam ; ils appartiennent à votre grand-père. »
Quelques instants après, on aperçut le château. Il s’élevait vaste et imposant, avec ses murailles grises et ses nombreuses fenêtres que les derniers rayons de soleil faisaient flamboyer. Il était hérissé de tours, de créneaux, de tourelles. Les murs en plusieurs places étaient couverts de lierre. Devant s’élevait un large espace ouvert, disposé en terrasses plantées de fleurs.
« C’est le plus bel endroit que j’aie jamais vu, dit encore Cédric, la figure brillante de joie. Il ressemble à un palais comme ceux qu’il y a dans mon livre de contes de fées. »
Il vit la grande porte d’entrée ouverte et les domestiques rangés sur deux lignes qui le regardaient. Il admira beaucoup leur livrée, en se demandant ce qu’ils faisaient là. Il ne se doutait pas qu’ils honoraient ainsi le petit garçon à qui toutes ces splendeurs devaient appartenir un jour : le beau château qui ressemblait à un palais de contes de fées, le parc magnifique, les grands vieux arbres, les clairières pleines de fougères et de fleurs sauvages, où jouaient les lièvres et les lapins, et les daims aux grands yeux languissants, couchés dans l’épais gazon. Il y avait à peine deux semaines, il était encore à côté de M. Hobbes, grimpé sur un baril de cassonade ou sur une caisse de savon, avec ses jambes dansant le long de ce perchoir, ne se doutant guère des grandeurs qui l’attendaient, et maintenant il marchait entre deux rangées de serviteurs qui le considéraient comme leur maître et leur seigneur futur, et se tenaient tout prêts à exécuter ses moindres volontés.
À leur tête était une vieille dame, en simple robe de soie noire.
« Voici lord Fautleroy, madame Millon, lui dit M. Havisam, qui tenait le petit lord par la main. Lord Fautleroy, voici Mme Millon, la femme de charge du château. »
Cédric lui tendit la main.
« C’est vous, m’a-t-on dit, qui avez envoyé le beau chat à maman pour moi ; je vous remercie beaucoup.
— J’aurais reconnu Sa Seigneurie partout où je l’aurais vue, dit la femme de charge, pendant qu’un sourire de contentement se répandait sur sa figure ; c’est le capitaine trait pour trait. Voici un grand jour, mylord, » ajouta-t-elle.
Cédric se demanda pourquoi c’était un grand jour. Il lui sembla voir briller une larme dans les yeux de la vieille dame ; évidemment, pourtant, elle n’éprouvait pas de chagrin, car elle lui sourit de nouveau :
« La chatte que j’ai envoyée à la Loge a deux beaux petits chatons, dit-elle encore ; on les portera dans l’appartement de Sa Seigneurie. »
XII
Quelques minutes plus tard, le grand et imposant valet de pied qui avait escorté Cédric jusqu’à l’entrée de la bibliothèque, en ouvrit la porte et annonça d’un ton tout à fait majestueux :
« Lord Fautleroy, mylord. »
Il n’était qu’un domestique ; mais il sentait que c’était un jour solennel que celui où le jeune héritier était mis pour la première fois en présence de celui qui devait lui laisser un jour son nom et son titre.
Cédric entra dans la chambre. C’était un bel et grand appartement, meublé avec un luxe sévère, et garni presque tout autour de planchettes couvertes de livres. Les tentures et les draperies étaient si sombres, les croisées garnies de vitraux étaient si profondément encaissées, le jour qui baissait donnait si peu de clarté, que c’est à peine si on voyait le bout de la pièce, et qu’au premier aspect elle produisait un effet lugubre. Pendant quelques instants, Cédric crut qu’il n’y avait personne dans la chambre ; mais il finit par distinguer, près du feu qui brûlait dans une vaste cheminée, un grand fauteuil, et dans ce fauteuil une personne assise.
Sur le plancher, à côté d’elle, était étendu un chien, appartenant à l’espèce des grands dogues. Ses jambes et sa tête étaient presque aussi grosses que celles d’un lion, et il rappelait encore le roi des déserts par la couleur fauve de son pelage. En entendant s’ouvrir la porte, il se leva majestueusement et marcha à pas lents au-devant du nouveau venu, comme pour lui faire les honneurs de l’appartement.
Alors la personne qui était dans le fauteuil, craignant sans doute que l’enfant eût peur, appela :
« Dougal, venez ici, monsieur ! »
Mais il n’y avait pas plus de crainte dans le cœur du petit lord qu’il n’y avait de méchanceté. Il posa sa main sur le collier du gros chien, de la manière la plus simple et la plus naturelle du monde, et tous deux s’avancèrent vers le personnage enfoncé dans le fauteuil, le chien humant l’air fortement, tout en marchant.
Ce personnage alors leva les yeux vers eux. Tout ce que Cédric vit, c’est que c’était un grand vieillard avec des moustaches et des cheveux blancs, des sourcils en broussailles, et un nez semblable à un bec d’aigle entre deux yeux perçants. Ce que le comte vit, c’était une gracieuse et enfantine figure, dans un costume de velours noir, avec un col de dentelle, et des boucles d’or qui flottaient autour d’un beau et mâle petit visage, dont les yeux rencontrèrent les siens avec un regard d’innocente sympathie. Si le château ressemblait, selon ce qu’avait dit Cédric, à un palais de conte de fées, on peut dire

que le petit lord ressemblait lui-même au prince Charmant qui
figure dans ces contes. Une flamme soudaine d’orgueil et de
triomphe brilla dans les yeux du comte quand il vit combien
son petit-fils était grand, beau et fort, et avec quelle tranquille
hardiesse il se tenait devant lui, la main posée sur le cou de
l’énorme chien. Il ne déplaisait pas au farouche gentleman que
son petit-fils parût ne montrer aucune crainte ni du dogue ni
de lui-même.
Cédric le regardait du même air qu’il avait regardé la gardienne de la grille et Mme Millon, la femme de charge.
« Êtes-vous le comte ? dit-il quand il fut arrivé près du fauteuil. Je suis votre petit-fils, lord Fautleroy, que M. Havisam a amené ici. »
Et il tendit la main au comte.
« J’espère que vous allez bien, continua-t-il d’un ton affectueux : je suis très content de vous voir. »
Le comte prit la main qu’on lui tendait. Il était tellement étonné qu’il ne trouvait rien à dire. Il promenait les regards de ses yeux enfoncés des pieds à la tête de la petite apparition.
« Vous êtes content de me voir ? répéta-t-il.
— Oui, répondit lord Fautleroy ; très content. »
Il y avait une chaise près du comte, il s’y assit : la chaise était haute, et les pieds du petit homme se balançaient au-dessus du parquet ; néanmoins Cédric semblait tout à fait à son aise. Il regardait son auguste parent avec attention, quoique modestement.
« J’ai toujours cherché à me figurer comment vous étiez, dit-il. J’y pensais dans mon hamac, sur le vaisseau, et je me demandais si vous ressembliez à mon père.
— Eh bien ? demanda le comte.
— Eh bien ! répliqua Cédric, j’étais très jeune quand il mourut, aussi je ne me le rappelle pas très bien ; mais je ne crois pas que vous lui ressembliez.
— Vous êtes désappointé, alors ?
— Oh ! non, répondit poliment le petit lord. Naturellement cela fait plaisir de voir quelqu’un qui ressemble à votre père ; mais cela n’empêche pas que votre grand-papa vous plaise, quand même il est tout différent de votre père. On aime toujours ses parents, et on les trouve toujours très bien. »
Le comte parut un peu déconcerté. Il ne pouvait pas dire, lui, qu’il eût jamais aimé ses parents.
Il avait au contraire été un tyran pour tous les membres de sa famille, et il s’en était fait haïr cordialement.
« Quel est l’enfant qui n’aime pas son grand-père, surtout un grand-père qui a été si bon que vous l’avez été pour moi ? reprit Cédric.
— Ah ! dit le comte avec un singulier éclair dans les yeux, j’ai été bon pour vous ?
— Sans doute, répondit vivement le petit lord, et je vous suis bien reconnaissant pour Dick, pour Brigitte et pour la marchande de pommes.
— Dick ! exclama le comte ; Brigitte ! la marchande de pommes !
— Oui, expliqua Cédric, ce sont ceux pour qui vous m’avez donné de l’argent : cet argent que vous aviez dit à M. Havisam de me remettre si j’en avais besoin.
— Ah ! je sais ! Eh bien ! qu’avez-vous acheté avec cet argent ? j’aimerais à le savoir. »
Il fronça de nouveau les sourcils et regarda Cédric fixement. Il était curieux de savoir de quelle manière l’enfant avait usé de ses dons.
« Vous ne connaissez pas Dick, commença l’enfant, ni la marchande de pommes, ni Brigitte ; ce n’est pas étonnant, car ils demeurent très loin d’ici. Ils sont de mes amis. Et d’abord, il faut que je vous dise que Michel était malade.
— Qui est Michel ? demanda le comte.
— Le mari de Brigitte. Ils étaient tous les deux dans un grand embarras. Quand un homme est malade, qu’il ne peut pas travailler et qu’il a douze enfants, vous pensez si c’est triste ! Michel a toujours été un bon ouvrier. Le soir que M. Havisam était à la maison, Brigitte est venue pleurer dans la cuisine, en disant qu’il n’y avait plus rien à manger chez elle, que ses enfants allaient mourir de faim et qu’elle ne pouvait pas non plus payer son loyer. Enfin elle était bien malheureuse. J’étais allé à la cuisine pour tâcher de la consoler ; M. Havisam m’a envoyé chercher, et il m’a dit que vous lui aviez donné de l’argent pour moi. Alors j’ai couru aussi vite que j’ai pu à la cuisine et j’ai donné à Brigitte l’argent que M. Havisam venait de me remettre. Elle pouvait à peine en croire ses yeux. Voilà pourquoi je vous ai beaucoup de reconnaissance.
— Bien, dit le comte ; et ensuite ? »
Dougal pendant ce temps était resté assis près de la chaise de Cédric. Plusieurs fois il avait tourné la tête du côté de l’enfant, pendant qu’il parlait, comme s’il prenait grand intérêt à la conversation. Le vieux lord, qui le connaissait bien, l’avait examiné avec beaucoup d’attention. Ce n’était pas un chien à donner légèrement son affection, et le comte avait été frappé de la manière dont il avait paru reconnaître le pouvoir de l’enfant. Juste à ce moment, le dogue donna une preuve de plus de la confiance que lui inspirait le petit lord, en posant sa tête de lion sur ses genoux.
En passant doucement la main sur le fauve pelage de son nouvel ami, Cédric continua :
« Ensuite ? Ensuite ce fut Dick.
— Dick ? Qui est ce Dick ? demanda encore le comte.
— C’est un garçon dont le métier est de faire reluire les bottes des messieurs. Il est très honnête et il fait son état de son mieux. C’est un de mes amis : pas tout à fait aussi vieux que M. Hobbes, mais grand tout de même. Je crois qu’il a seize à dix-sept ans. Il m’a fait un cadeau quand je suis parti. »
Il mit la main à sa poche et en tira un objet plié avec soin, et le secoua d’un air de satisfaction affectueuse. C’était le mouchoir de soie rouge semé de fers à cheval.
« Il m’a donné ce mouchoir, et je le garderai toujours, dit Sa petite Seigneurie. On peut le mettre autour de son cou ou le laisser dans sa poche, comme on veut. Il l’a acheté avec le premier argent qu’il gagna quand je lui eus donné ses brosses et tout ce dont il avait besoin. C’est un souvenir. Quand je le verrai, je me rappellerai toujours Dick. »
Les sentiments du très honorable comte de Dorincourt seraient difficilement décrits. Il n’était pas homme à se troubler facilement, car il avait vu beaucoup le monde ; mais il y avait quelque chose de si nouveau, de si inattendu dans ce qu’il avait sous les yeux, qu’il en éprouvait plus d’émotion qu’il ne se serait cru capable d’en ressentir. Il n’avait jamais fait grande attention aux enfants ; il avait toujours été si occupé de son plaisir qu’il ne lui restait pas assez de temps pour y penser. Ses propres fils même ne l’avaient jamais beaucoup intéressé quand ils étaient enfants, quoiqu’il se rappelât s’être dit quelquefois que le troisième était un beau garçon. Il n’avait jamais su combien tendres et affectionnées, simples et généreuses sont les impulsions de cet âge. Un enfant lui avait toujours semblé un petit être gourmand, bruyant, insupportable, qu’on devait tenir sous une sévère contrainte. Ses deux fils aînés n’avaient donné à leurs précepteurs que des ennuis, et il se figurait que s’il n’avait pas reçu les mêmes plaintes du troisième, c’est que son rang de cadet lui enlevait toute importance et qu’on ne croyait pas devoir lui en parler. Il ne lui était jamais venu à la pensée qu’il pût aimer son petit-fils. Il l’avait envoyé chercher, ne voulant pas, autant que possible, que son nom et son titre appartinssent un jour à un rustre. Il était convaincu qu’il en serait ainsi s’il était élevé en Amérique. Quand le domestique avait annoncé lord Fautleroy, il avait été quelques instants avant d’oser le regarder, tant il craignait de voir un enfant mal fait ou commun de manières, et c’était la raison pour laquelle il avait tenu à être seul avec lui à la première entrevue. Il ne pouvait supporter la pensée de laisser voir à personne son désappointement, s’il avait sujet d’en éprouver. Mais son vieux et orgueilleux cœur avait tressailli quand le jeune garçon s’était avancé vers lui avec sa tranquillité et son aisance habituelles, sa main posée sur le cou du dogue. Il m’avait jamais espéré que son petit-fils, l’enfant de cette Américaine qu’il détestait, pût être un si charmant garçon. Le sang-froid du comte fut tout à fait troublé par cette découverte.
Quand ils commencèrent à causer, il fut encore plus curieusement intéressé et de plus en plus agité. En premier lieu, il était tellement habitué à voir les gens embarrassés et même effrayés en sa présence, qu’il s’était attendu à ce que son petit-fils se montrât gauche ou timide. Mais Cédric n’avait pas plus peur du comte qu’il n’avait eu peur de Dougal. Il n’était pas hardi, mais seulement innocemment affectueux. Il était visible qu’il prenait le comte pour un ami, qu’il n’avait pas le moindre doute à ce sujet, et il était visible aussi qu’il faisait tout son possible pour lui plaire. Quelque dur et égoïste que fût le comte, il ne pouvait s’empêcher d’éprouver un certain plaisir de cette confiance. Après tout, ce n’était pas désagréable de savoir qu’il y avait quelqu’un qui ne se défiait pas de lui, qui ne le fuyait pas, qui ne semblait pas soupçonner le mauvais côté de sa nature ; quelqu’un qui le regardait en face, d’un regard ouvert et bienveillant.
Aussi il laissa causer l’enfant sur lui-même et sur ses amis, l’observant attentivement pendant qu’il parlait, Lord Fautleroy ne demandait pas mieux que de répondre à ses questions et babillait, selon sa manière habituelle, avec beaucoup de tranquillité. Après s’être étendu longuement sur Dick, sur la marchande de pommes, sur M. Hobbes, il décrivit la fête dont il avait été témoin à propos de l’élection du président des États-Unis, parla des bannières, des illuminations, des marches aux flambeaux. Il en était sur le Quatre Juillet et allait se laisser emporter par l’enthousiasme lorsque tout à coup il s’arrêta.
« Qu’y a-t-il ? demanda son grand-père. Pourquoi ne continuez-vous pas ? »
Le petit lord s’agita sur sa chaise d’un air un peu gêné. Il était évident qu’il était troublé par une idée qui venait de se présenter à son esprit.
« Je pensais, dit-il avec un peu d’hésitation, que vous pouviez ne pas aimer à entendre parler du Quatre Juillet et de la… de la guerre de l’Indépendance. Peut-être des personnes de votre famille étaient-elles en Amérique à ce moment-là et ont-elles été tuées ou blessées. J’oubliais que vous êtes Anglais.
— Et vous oubliez que vous l’êtes vous-même, dit le comte.
— Oh non ! dit vivement Cédric ; je suis Américain.
— Vous êtes Anglais, dit sèchement le comte : votre père l’était. »
Cela l’amusait de pousser l’enfant pour voir ce qu’il répondrait ; mais cela n’amusait pas Cédric. Il n’avait jamais pensé qu’il pût perdre son titre d’Américain, et il se sentait chaud jusqu’à la racine des cheveux.
« Je suis né en Amérique. On est un Américain quand on est né en Amérique. Je vous demande pardon de vous contrarier, mais M. Hobbes me l’a dit ; s’il y avait une autre guerre entre les Anglais et les Américains, je serais avec les Américains. »
Le comte laissa échapper un sourire amer :
« Vous seriez, vous seriez… » dit-il.
Il haïssait l’Amérique, mais il lui était agréable de voir quel bon petit patriote était son petit-fils. Il pensait qu’un si excellent petit Américain ferait sûrement un bon Anglais plus tard.
Du reste, ils n’eurent pas le loisir de pousser plus avant sur le sujet de la Révolution, — et en vérité lord Fautleroy n’y tenait pas beaucoup, — car le dîner fut annoncé.
XIII
Cédric sauta de sa chaise ; il alla à son grand-père et, regardant le pied du comte posé sur son coussin :
« Voulez-vous me permettre de vous aider ? dit-il gentiment. Vous pouvez vous appuyer sur moi, vous savez. Une fois, M. Hobbes s’étant blessé en faisant rouler un baril de pommes de terre sur son pied, il s’appuya sur moi pour marcher. »
Le grand et imposant valet de pied faillit mettre sa situation en péril, car il se laissa presque aller à sourire. C’était un valet de pied aristocratique, qui avait toujours vécu dans les plus nobles familles, et jamais jusque-là il n’avait souri. En vérité il se serait regardé comme un laquais de bas étage s’il s’était jamais laissé aller à commettre une action aussi indiscrète qu’un sourire. Mais il avait un moyen sûr d’échapper au danger qui le menaçait. C’était de détourner ses yeux de la gentille petite figure de Cédric pour les porter sur les traits rudes et renfrognés du comte. Ceux-ci ne provoquaient jamais le moindre sourire, et leur vue suffit pour rendre au valet toute sa gravité.
Le vieux lord regarda l’enfant de la tête aux pieds.
« Croyez-vous que vous puissiez m’aider à marcher ? dit-il d’un ton bourru, en réponse à l’offre amicale de Cédric.
— Je le crois, dit celui-ci. Je suis fort ; j’ai huit ans, vous savez. Vous n’avez qu’à vous appuyer sur votre canne d’un côté et sur mon épaule de l’autre. Dick dit que j’ai des muscles étonnants pour un garçon de huit ans. »
Il ferma le poing et le leva jusqu’à l’épaule, comme s’il faisait des haltères, afin que le comte pût juger de la puissance des muscles qui avaient eu l’approbation de Dick. Sa figure était si sérieuse et si animée, en se livrant à cet exercice, que le valet de pied fut encore forcé de regarder le comte pour n’avoir pas envie de se dérider.
« Eh bien ! dit le vieux lord, essayez. »
Cédric lui donna sa canne et commença par l’aider à se lever. Ordinairement c’était le domestique qui remplissait cet office, et le comte ne se faisait pas faute de jurer après lui, surtout quand il en résultait, comme cela arrivait fréquemment, un redoublement de son mal ; mais ce soir-là il ne jura pas, quoique son pied le fît particulièrement souffrir. Il se leva péniblement et posa sa main sur la petite épaule qui se présentait à lui avec tant de courage. Le petit lord fit un pas en avant, avec précaution, les yeux fixés sur le pied malade.
« N’ayez pas peur de vous appuyer, dit-il d’une manière encourageante ; je peux très bien vous soutenir. »
Si le comte avait été aidé par le domestique, il se serait appuyé moins sur le bâton et plus sur l’épaule de son assistant ; mais en cette circonstance il fit le contraire ; cependant c’était une partie de son expérience de laisser sentir son poids à son petit-fils, et c’est un poids qui pouvait compter que le sien !

Au bout de quelques pas, le visage de Sa petite Seigneurie était
tout rouge, et son pauvre petit cœur battait bien vite ; mais il se raidissait et tendait ses muscles, ces muscles que Dick jugeait
si solides.
« Ne craignez pas de me faire du mal, continuait-il à dire bravement, quoique sa voix altérée témoignât des efforts qu’il faisait ; je peux très bien, quand il n’y a pas loin… »
Il n’y avait réellement pas bien loin de la bibliothèque à la salle à manger ; néanmoins le chemin sembla interminable à Cédric avant qu’il atteignît le haut bout de la table. La main posée sur son épaule lui semblait de plus en plus lourde à chaque pas, et, à chaque pas aussi, sa respiration devenait de plus en plus courte ; mais il ne songeait pas pour cela à abandonner son entreprise. Il continuait à raidir ses muscles d’enfant, tenant sa tête droite et encourageant le comte tout en marchant.
« Votre pied vous fait beaucoup de mal, n’est-ce pas, quand vous vous tenez debout ? N’avez-vous jamais essayé de l’eau chaude et de la moutarde ? M. Hobbes se servait toujours d’eau chaude et de moutarde. L’arnica est aussi une très bonne chose, à ce qu’on dit. »
Le gros dogue s’avançait majestueusement derrière eux, et le grand domestique suivait.
À plusieurs reprises encore quelque chose ressemblant à un sourire qu’il ne pouvait retenir entièrement, détendait un peu ses lèvres, tandis qu’il regardait le petit personnage qui marchait devant lui et qui faisait appel à toute sa force pour supporter vaillamment le fardeau qui pesait sur son épaule. Le visage du comte avait aussi une singulière expression, tandis qu’il jetait un regard de côté sur son petit-fils.
La salle à manger était une pièce vaste et d’aspect imposant. Derrière le fauteuil du comte se tenait un domestique, qui regarda avec étonnement, mais sans oser se permettre la moindre réflexion, le spectacle singulier que formaient cet homme grand et fort soutenu par un enfant. Ils atteignirent enfin le bout de la chambre, et l’épaule de Cédric se trouva dégagée.
L’enfant tira de sa poche le mouchoir de Dick et en frotta énergiquement son front ruisselant.
« Vous avez fait une rude besogne, dit le comte.
— Oh ! non, répliqua Cédric, ce n’était pas rude positivement ; seulement, j’ai chaud. En été, vous savez, il fait chaud. »
Et il frotta de nouveau son front humide. Sa propre chaise était placée de l’autre côté de la table, en face du comte. C’était un siège à haut dossier avec de larges bras. Il n’avait jamais été destiné au petit personnage qui l’occupait et qui peut-être n’avait jamais semblé si petit qu’en ce moment, au fond de ce grand fauteuil, dans cette vaste salle au plafond élevé, et devant cette table large et massive ; mais cela était indifférent au petit lord.
En dépit de sa vie solitaire, le comte menait grand train. Il aimait à bien dîner, et les repas étaient servis chez lui avec beaucoup d’apparat. Cédric n’apercevait son grand-père qu’à travers un surtout de table en cristal et en argent, garni de fleurs, qui l’éblouissait. Si le dîner était une chose sérieuse pour le comte, elle était une chose non moins sérieuse pour le cuisinier, qui avait toujours à craindre ou que Sa Seigneurie n’eût pas faim, ou qu’elle ne trouvât pas le dîner à son goût. Le jour dont nous parlons, le comte paraissait avoir un peu plus d’appétit que de coutume ; peut-être est-ce parce qu’il avait à penser à autre chose qu’à la saveur des mets et à la perfection des sauces. Il regardait son petit-fils au travers de la table. Il ne parlait pas beaucoup lui-même, mais il faisait causer le jeune garçon. Il ne s’était jamais imaginé jusque-là qu’il pût s’entretenir avec un enfant, mais la conversation de Cédric l’amusait et l’intéressait. Il se rappelait, en outre, combien il avait fait sentir la pesanteur de son corps à l’épaule de son petit-fils, rien que pour éprouver jusqu’où pouvaient aller son courage et sa faculté de résistance, et il se plaisait à penser que l’enfant qu’il avait sous les yeux, et qui à lui seul représentait sa noble race, n’avait pas faibli ni songé un instant à abandonner la tâche qu’il avait entreprise.
« Vous ne portez pas toujours votre couronne ? dit tout à coup lord Fautleroy.
— Non, répliqua le comte avec son espèce de sourire ; cela ne me convient pas.
— M. Hobbes croyait que vous l’aviez toujours ; pourtant, après y avoir réfléchi, il pensait que vous deviez l’ôter quelquefois pour mettre votre chapeau.
— En effet, dit le comte de même ; je la retire de temps en temps. »
Pour le coup, la gravité abandonna un des domestiques, qui se retourna vivement et porta la main à sa bouche pour étouffer un éclat de rire, qui se traduisit par un léger accès de toux.
Quand Cédric eut fini de manger, il s’appuya sur le dossier de sa chaise pour regarder la pièce où il se trouvait.
« Vous devez être fier de votre maison, dit-il au comte : elle est très belle. Je n’en ai jamais vu de si belle ; mais je n’ai que huit ans et, naturellement, je n’ai pas encore vu beaucoup de choses.
— Et vous pensez que je dois en être fier ?
— Tout le monde le serait. Je le serais certainement si elle était à moi. Tout y est très beau. Et le parc donc ! Comme les arbres y sont gros et comme ils bruissent au vent ! »
Il resta silencieux un instant, puis jetant un regard pensif autour de la pièce :
« C’est une bien grande maison, dit-il, pour deux personnes seulement.
— Elle est assez grande en effet. Trouvez-vous qu’elle le soit trop ? »
Sa petite Seigneurie hésita un instant.
« Je me disais, fit-il, que si deux personnes vivant ici ne s’accordaient pas bien ensemble, il pourrait leur arriver quelquefois de se trouver bien seuls.
« Pensez-vous que nous nous accorderons bien ? demanda le comte.
— Je le crois. M. Hobbes et moi nous nous accordions très bien. C’était le meilleur ami que j’eusse après Chérie. »
Le comte fronça ses sourcils en broussailles.
« Qui est Chérie ? demanda-t-il.
— C’est maman, dit le petit lord de sa douce et tranquille voix. Je l’appelle ainsi parce que je l’aime du plus profond de mon cœur ; elle a toujours été ma meilleure amie. »
Oui, elle avait toujours été sa meilleure, sa plus tendre amie, et il ne pouvait pas s’empêcher, à mesure surtout que la nuit approchait, d’éprouver un amer sentiment de solitude en pensant que cette nuit il ne dormirait pas près d’elle, sous les yeux qu’il chérissait. Plus il y pensait, plus son pauvre petit cœur se gonflait, si bien que, peu à peu, il devint silencieux. Cependant il se dit qu’il ne devait pas s’abandonner à son chagrin. Au moment où le comte quitta la table pour retourner à la bibliothèque, il s’élança au devant de lui, pour lui prêter encore l’aide de sa petite épaule, et le comte s’y appuya de nouveau, quoique moins lourdement que la première fois.
Quand le valet de pied les eut laissés seuls, Cédric s’assit sur le tapis du foyer près de Dougal. Pendant quelques instants il caressa les oreilles du chien en silence, en regardant le feu.
Le comte l’examinait. Les yeux de l’enfant avaient une expression pensive, et une fois ou deux il soupira légèrement.
« Fautleroy, demanda le vieux lord, à quoi pensez-vous ? »
Cédric fit un effort pour sourire et, regardant son grand-père :
« Je pensais à Chérie, » dit-il.
Alors il se leva et se mit à arpenter la chambre de long en large. Ses yeux brillaient, il serrait ses lèvres l’une contre l’autre, mais il tenait sa tête droite et marchait d’un pas résolu.

Dougal se leva paresseusement et le regarda faire pendant
quelques instants ; puis il se décida à marcher derrière lui,
allant et venant comme lui et suivant tous ses mouvements.
Le petit lord posa sa main sur la tête du chien :
« C’est un très bon chien, dit-il ; il m’aime déjà, et il devine ce que je sens.
— Et que sentez-vous ? » dit le comte.
Cela le contrariait de voir quelle place les premières affections de son petit-fils tenaient dans son cœur ; mais d’un autre côté il lui était agréable de constater qu’il les contenait bravement. Ce courage enfantin lui plaisait.
« Venez ici, » dit-il.
L’enfant obéit.
« Je n’ai jamais quitté notre maison avant aujourd’hui, dit-il, avec un regard troublé dans ses yeux bruns ; cela fait une singulière impression de penser qu’on va passer la nuit dans une autre maison que la sienne ; mais Chérie n’est pas loin ; elle m’a recommandé de me le rappeler. D’abord j’ai huit ans ! À huit ans on n’est plus un petit garçon, on doit être raisonnable ; et puis je peux regarder son portrait. »
Il mit la main à sa poche et en tira un petit écrin de velours violet.
« Tenez, dit-il, vous n’avez qu’à presser ce ressort, la boîte s’ouvre… et, la voilà ! »
Il était venu près du siège du comte, et, comme il levait le couvercle, il se pencha sur son bras, avec autant de confiance que si ce bras était celui d’un grand-père tendre et affectueux.
« La voilà, » répéta-t-il, et il plaça l’écrin sous les yeux du vieux lord.
Celui-ci fronça les sourcils ; il ne se souciait pas de voir le portrait, mais il le vit en dépit de lui-même. Il présentait un doux, jeune et aimable visage, un visage si semblable à celui qui se penchait vers lui qu’il ne put s’empêcher de tressaillir.
« Et… vous l’aimez beaucoup ? dit-il en hésitant.
— Oui, répondit doucement et simplement Cédric. M. Hobbes est mon ami ; Dick, Brigitte, Mary, Michel, sont mes amis ; mais Chérie c’est bien autre chose encore ! Nous pensons et nous sentons toujours de même. Je lui dis tout ce que j’ai dans l’esprit. Mon père me l’a laissée pour que j’en aie soin, et quand je serai un homme, je travaillerai afin de gagner de l’argent pour elle.
— Et que comptez-vous faire ? »
Sa petite Seigneurie s’assit de nouveau sur le tapis du foyer, tenant toujours le portrait entre ses mains. Il semblait réfléchir sérieusement.
« Peut-être pourrais-je m’associer avec M. Hobbes, dit-il… J’aimerais aussi à être président.
— Nous vous enverrons en place à la Chambre des lords, dit le comte. (La Chambre des lords en Angleterre répond à peu près au Sénat chez nous.)
— Eh bien ! si je ne peux pas être président, et si on fait de bonnes affaires en cet endroit dont vous parlez, je ne dis pas non, répliqua Cédric. L’épicerie est ennuyeuse quelquefois. »
Sans doute il pesait les choses dans son esprit, car il fixa les yeux sur le foyer sans rien dire et parut réfléchir profondément.
Le comte aussi demeura silencieux. Il appuya son dos à son fauteuil, en regardant l’enfant. Beaucoup de nouvelles et étranges pensées se pressaient dans l’esprit du noble comte. Dougal s’était étendu sur le tapis et s’était endormi, la tête reposant sur ses larges pattes.
Il y eut un long silence.
Une demi-heure après environ, M. Havisam fut introduit. Tout était tranquille dans la chambre. Le comte était toujours dans la même position sur son siège. Quand l’homme de loi parut, le vieux lord lui fit un geste pour lui recommander de ne pas faire de bruit. Dougal dormait toujours paisiblement, et tout près de lui, sa tête bouclée reposant sur le cou du chien, dormait aussi profondément le petit lord Fautleroy.
XIV
Lorsque lord Fautleroy se réveilla le lendemain (il n’avait rien senti quand on l’avait porté dans sa chambre et déshabillé la veille au soir), lorsqu’il se réveilla, les premiers sons qui frappèrent ses oreilles, avant qu’il ouvrît les yeux, furent le pétillement d’un bon feu et le murmure de deux voix.
« Vous aurez soin, Gertrude, de ne pas lui parler de cela, entendit-il quelqu’un dire. Il ne sait pas pourquoi elle n’est pas ici avec lui et la raison pour laquelle ils ont été séparés.
— Si ce sont les ordres de Sa Seigneurie, répliqua une autre voix, il faudra bien les exécuter ; mais si vous le permettez, madame Millon, je vous dirai que je trouve que c’est une chose cruelle. Oui, c’est cruel d’arracher à cette pauvre jeune veuve un enfant si beau, sa propre chair et son propre sang ! James et Thomas, l’autre nuit, dans la salle des domestiques, après le souper, disaient qu’ils n’avaient jamais vu une créature plus aimable que ce petit garçon, plus intéressante, de manières plus polies, plus gracieuses. Pendant qu’il était assis au milieu de la table, en face de mylord, il avait l’air d’être en tête à tête avec son meilleur ami. Lorsque j’entrai dans la bibliothèque, avec James, le comte nous ayant sonné, je trouvai lord Fautleroy endormi sur le tapis du foyer. Mylord nous ordonna de le monter ici : James le prit dans ses bras, et vous n’avez jamais rien vu de si gentil que sa ronde et rose petite figure, et que sa jolie petite tête s’appuyant sur l’épaule de James avec les boucles de ses cheveux pendant de tous côtés. Je crois bien que mylord n’était pas aveugle et qu’il a été touché aussi, car il l’a regardé d’un air que je ne lui ai jamais vu, et il a dit à James : « Prenez garde de l’éveiller. »
Cédric se retourna sur son oreiller, ouvrit les yeux et regarda avec étonnement. Il y avait deux femmes dans la chambre.
La pièce était gaie et tendue d’étoffe perse ; un bon feu brillait dans la cheminée, et le soleil envoyait ses rayons roses par les fenêtres encadrées de lierre. Les deux femmes, voyant Cédric éveillé, s’avancèrent vers le lit, et l’enfant reconnut dans l’une d’elles Mme Millon, la femme de charge. L’autre était une avenante personne d’âge moyen, dont le visage souriant annonçait la bonté et la bonne humeur.
« Bonjour, mylord, dit Mme Millon ; avez-vous bien dormi ? »
Cédric frotta ses yeux et sourit.
« Bonjour, répliqua-t-il. Je ne savais pas que j’étais ici.
— On vous a monté pendant que vous étiez endormi. Cette pièce est votre chambre à coucher, et voici Gertrude qui prendra soin de vous. »
Lord Fautleroy s’assit sur son lit et tendit sa main à Gertrude, comme il l’avait tendue la veille au comte.
« Je vous suis bien obligé, madame, dit-il, de vouloir bien vous occuper de moi.

— Vous pouvez l’appeler Gertrude, mylord, dit la femme de charge : elle y est accoutumée.
— Madame ou mademoiselle Gertrude ? demanda Sa Seigneurie.
— Ni l’un ni l’autre : Gertrude tout court, dit Gertrude elle-même. Ni madame ni mademoiselle. Que Dieu bénisse Votre petite Seigneurie ! Voulez-vous maintenant vous lever et laisser Gertrude vous habiller ? puis vous déjeunerez dans la nursery.
— Je sais m’habiller moi-même depuis plusieurs années, dit le petit lord. Chérie me l’a appris. Chérie est maman, ajouta-t-il. Nous avions seulement Mary pour les gros ouvrages : laver, faire la cuisine et tout, et ainsi elle n’avait pas le temps de s’occuper de moi. Je peux aussi me débarbouiller tout seul, si vous avez seulement la bonté de regarder dans les petits coins quand j’aurai fini. »
Gertrude et la femme de charge échangèrent un coup d’œil.
« Gertrude fera tout ce que vous lui ordonnerez, dit Mme Millon.
— Bien sûr, dit Gertrude avec bonne humeur. Sa Seigneurie s’habillera elle-même, si elle le désire, et je resterai près d’elle, afin de l’aider si elle a besoin de moi.
— Je vous remercie, répondit lord Fautleroy. Les boutons sont quelquefois un peu durs à mettre, vous savez, et je suis obligé d’avoir recours à quelqu’un. »
Quand la toilette de Cédric fut terminée, Gertrude et lui étaient tout à fait amis. L’enfant avait découvert une foule de particularités sur son compte. D’abord que son mari avait été militaire et qu’il avait été tué dans une bataille ; puis que son fils était marin, qu’il était parti pour une longue croisière, qu’il avait vu des pirates et des cannibales, des Chinois et des Turcs. Il avait apporté à Gertrude des coquillages et des coraux, que la bonne femme lui promit de lui montrer. Tout cela était très intéressant. Il découvrit encore qu’elle s’était occupée de petits enfants toute sa vie et qu’elle venait justement d’une grande maison, dans une autre partie de l’Angleterre, où elle avait soin d’une belle petite fille dont le nom était lady Isabelle Vaughan.
« Elle est un peu parente de Votre Seigneurie, ajouta-t-elle, et un jour peut-être la verrez-vous.
— Vraiment ? dit Fautleroy. Oh ! j’en serais bien content ! Je n’ai jamais connu de petites filles, mais j’ai toujours aimé à les regarder ; j’aimerais bien voir celle-là. »
Il se rendit dans la pièce voisine pour déjeuner. C’était aussi une grande chambre. Elle était suivie d’une autre pièce non moins vaste. Quand Gertrude lui dit que ces trois pièces étaient à lui, le sentiment de l’opposition que formait l’étendue de ses appartements avec sa petite personne se présenta de nouveau à son esprit, comme il s’y était présenté la veille, quand il s’était vu dans la grande salle à manger, en face de son aïeul et au fond du grand fauteuil.
Il s’assit devant la table de la nursery, sur laquelle s’étalaient son couvert et le joli service du déjeuner.
« Je suis un bien petit garçon, n’est-ce pas ? dit-il à Gertrude d’un ton pensif, pour vivre dans un si grand château et pour avoir de si belles chambres à moi. N’est-ce pas votre avis ?
— Oh ! cela vous semble un peu étrange maintenant, dit la servante, mais vous vous y ferez bien vite, et alors vous vous plairez beaucoup ici. C’est un si bel endroit !
— Très beau, en effet, dit le petit lord avec un soupir ; mais je m’y plairais mieux si Chérie y était avec moi. J’ai toujours déjeuné avec elle tous les matins ; c’est moi qui lui mettais son sucre et sa crème dans son thé et qui lui préparais sa rôtie. J’aimais tant cela !
— Vous savez, répondit Gertrude d’un ton de bonne humeur, que vous pourrez la voir tous les jours, et vous aurez bien des choses à lui dire. Il y a tant à examiner dans le château. Il y a un cheval surtout qui vous plaira.
— Vraiment ! exclama Cédric. j’aimais beaucoup Jim, le cheval de M. Hobbes. Il s’en servait pour son commerce. Il n’était pas vilain du tout.
— Eh bien ! vous verrez ceux qui sont dans les écuries ; mais, Dieu me pardonne, vous n’avez pas encore regardé ce qu’il y a dans l’autre chambre.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda vivement Cédric.
— Finissez d’abord de déjeuner et vous le verrez. »
Cette réponse et l’air de mystère avec lequel elle lui fut faite excitèrent la curiosité de Cédric, qui se hâta de terminer son déjeuner.
« Voilà qui est fait, dit-il quelques minutes après, en sautant de son siège. Puis-je aller regarder par là ? »
Gertrude fit un signe affirmatif, et, prenant un air encore plus important et plus mystérieux, elle marcha et ouvrit la porte. Cédric s’arrêta sur le seuil et regarda émerveillé autour de lui. Il demeura silencieux, les mains dans ses poches, tandis que sa surprise et son contentement se trahissaient par la rougeur qui lui montait au visage.
Il y avait bien là en effet de quoi causer l’admiration d’un enfant. La pièce était grande, gaie, tendue d’étoffe claire représentant des fleurs et des oiseaux. Autour des murs s’étendaient des tablettes chargées de livres, et sur les tables s’étalaient nombre de jouets, ainsi qu’une infinité de choses intéressantes ou instructives : boîtes de physique ou de couleurs, stéréoscopes, papeteries, albums, comme il en avait admiré avec délices au travers des glaces, dans les boutiques de New-York.
« On dirait la chambre d’un petit garçon, fit-il. À qui appartient tout ce que je vois là ?
— À vous.
— À moi ?
— Oui ; vous pouvez toucher, regarder toutes ces choses et vous amuser avec les jouets.
— À moi ! répéta Cédric. Pourquoi tout cela m’appartient-il ? Qui me l’a donné ? »
Et faisant un bond joyeux au milieu de la chambre :
« Je devine, je devine ! s’écria-t-il, les yeux aussi brillants que les étoiles : c’est encore mon grand-papa !
— Oui, c’est Sa Seigneurie, dit Gertrude ; et si vous voulez être un petit monsieur bien gentil, ne pas vous chagriner, et vous amuser, et être heureux, il vous donnera tout ce que vous lui demanderez. »
Ce fut une matinée extraordinaire. Il y avait tant d’objets à examiner, tant d’expériences à essayer ! Chaque nouveauté était si absorbante, que Cédric avait toutes les peines du monde à la quitter pour passer à une autre. C’était si singulier en outre de se dire que toutes ces choses avaient été préparées exprès pour lui ! que, même avant qu’il eût quitté New-York, des gens étaient venus de Londres pour les apporter, pour arranger la chambre qu’il occuperait, pour réunir les livres qui devaient l’intéresser et les jouets qui devaient le plus l’amuser.
« Connaissez-vous quelqu’un, Gertrude, s’écria-t-il, qui ait un si bon grand-père ? »
La figure de Gertrude peignit l’indécision. Elle n’avait pas une très haute opinion des sentiments du comte. Quoiqu’elle ne fût dans la maison que depuis quelques jours, cela lui avait suffi pour entendre les domestiques s’exprimer librement, mais non d’une manière flatteuse sur leur maître.
« De tous les maîtres violents, sauvages, brutaux, dont j’eus le malheur de porter la livrée, disait l’un d’eux appelé Thomas, c’est le plus violent, le plus sauvage et le plus brutal. »
XV
Thomas, qui était le valet de chambre particulier du comte, avait répété à ses compagnons d’antichambre une partie de la conversation du vieux lord avec Havisam, quand il discutait avec lui les préparatifs de l’arrivée de Cédric.
« Remplissez sa chambre de joujoux, avait-il dit ; donnez-lui tout ce qui peut le divertir, et il aura bientôt fait d’oublier sa mère. Quand son esprit sera plein d’amusements, nous n’aurons plus rien à craindre. C’est dans la nature des enfants. »
Peut-être, s’étant attendu à trouver un enfant insouciant et oublieux, ne lui était-il pas agréable de voir que son petit-fils ne répondait pas exactement au programme qu’il s’était tracé. Aussi avait-il passé une mauvaise nuit. Il resta toute la matinée dans sa chambre ; mais après midi, après avoir déjeuné légèrement, selon son habitude, il envoya chercher Cédric.
L’enfant s’empressa de descendre. Il franchit l’escalier en quelques bonds, et le comte l’entendit traverser en courant la pièce qui précédait la bibliothèque.
« J’étais impatient que vous m’envoyiez chercher, dit-il en entrant, le teint animé et les yeux étincelants. Je voulais vous remercier de tout ce que vous m’avez donné ; vous remercier de tout mon cœur. Je n’ai jamais été si content de ma vie. Je me suis bien amusé toute la matinée.
— Ainsi, dit le comte, tout ce que vous avez trouvé là-haut vous plaît ?
— Je le crois bien ! Plus que je ne saurais le dire, s’écria Cédric, sa figure rayonnant de délices. Il y a un jeu surtout… il ressemble un peu au jeu de paume, si ce n’est qu’on le joue sur une planche avec des pions blancs et noirs et que vous comptez vos points avec des jetons enfilés sur un fil de fer. J’ai essayé d’y jouer avec Gertrude, mais elle n’en a pas très bien compris la marche. Elle n’a jamais joué à la paume, naturellement, étant une dame, et j’ai peur de ne pas lui avoir expliqué très bien. Mais vous devez le connaître.
— Je crains que non. C’est un jeu américain, il me semble ; quelque chose comme le cricket.
— Je ne connais pas le cricket, mais M. Hobbes m’a mené plusieurs fois voir jouer à la paume. C’est un jeu superbe ! tout le monde est si animé ! — Voulez-vous que j’aille chercher mon jeu et que je vous le montre ? Peut-être que cela vous amusera et vous fera oublier votre mal. Souffrez-vous beaucoup ce matin ?
— Plus que je ne le voudrais.
— Alors j’ai peur que de jouer vous ennuie, dit le petit garçon anxieusement. Qu’en pensez-vous ? cela vous distraira-t-il ou cela vous fatiguera-t-il ?
— Allez chercher la boîte, » dit le comte.
C’était certainement une occupation tout à fait nouvelle pour le vieux lord que de se faire le compagnon d’un enfant qui offrait de lui montrer ses jeux ; mais c’est cette nouveauté qui l’amusait. Quelque chose qui ressemblait à un sourire parut au coin de ses lèvres quand Cédric, l’expression de l’intérêt le plus vif peinte sur ses traits, revint avec la boîte contenant le jeu annoncé.
« Puis-je tirer cette petite table près de votre fauteuil ? demanda-t-il.
— Sonnez Thomas, dit le comte, il la placera pour vous.
— Oh ! je peux la porter moi-même ; elle n’est pas lourde. »
Le faible sourire s’accentua sur la bouche du comte, tandis qu’il regardait l’enfant faire ses préparatifs. Ils l’absorbaient complètement. La petite table fut amenée par lui à côté du siège de son grand-père, le jeu tiré de la boîte et mis en place.
« C’est très intéressant quand la partie est une fois engagée, dit Fautleroy. Les pions noirs peuvent être les vôtres, et les blancs les miens. Ils représentent des hommes, vous savez, et il s’agit de les faire arriver d’abord ici et ensuite là. »
En parlant ainsi, il désignait les différentes parties de la tablette qu’il avait étendue sur la table et qui portait plusieurs divisions ; puis il entra dans les détails du jeu avec la plus grande animation. Prenant tour à tour les attitudes de joueurs de paume lançant et attrapant la balle, il commença par mimer le véritable jeu de paume, tel qu’il l’avait vu pratiquer à New-York, en compagnie de M. Hobbes. Ses gestes gracieux, ses mouvements vifs et aisés, étaient amusants à observer, tandis qu’il donnait ainsi à son grand-père une sorte de représentation dramatique.
Mais les explications prirent fin, et la partie commença tout de bon entre le vieux lord et son petit-fils. Cédric était profondément absorbé ; il mettait dans son occupation toute son attention et tout son cœur. Sa joie quand il était parvenu à franchir un pas difficile, sa satisfaction non moins vive quand c’était son partner qui avait obtenu un avantage, auraient suffi à donner de l’attrait au jeu.
XVI
Si, une semaine auparavant, quelqu’un avait dit au comte de Dorincourt qu’un certain matin qui n’était pas éloigné, il oublierait sa goutte et sa mauvaise humeur en jouant avec un petit bonhomme de huit ans, ce quelqu’un-là eût été très mal reçu. Cependant il était occupé de cette manière quand la porte s’ouvrit et que Thomas annonça un visiteur.
Ce visiteur était un grave personnage, habillé de noir, et qui n’était rien moins que le recteur de la paroisse. Il fut frappé d’une telle surprise à la vue du spectacle qu’il avait sous les yeux, qu’il manqua de faire un faux pas et faillit se heurter avec Thomas.
Parmi tous les devoirs qui incombaient au révérend M. Mordaunt, il n’y en avait pas qui lui semblât plus déplaisant que la nécessité où il était de se rendre chez le comte pour lui présenter quelque requête ou pour solliciter sa charité au nom de ceux de ses paroissiens qui se trouvaient dans le besoin. Le noble lord s’efforçait de lui rendre ces visites aussi désagréables que possible. Il n’avait pas le moindre penchant à la générosité, et entrait en fureur quand un de ses tenanciers tombait malade et avait besoin d’assistance. Si son accès de goutte était violent, il ne se gênait pas pour dire qu’il avait assez de ses maux sans avoir encore à subir le récit de leurs ennuyeuses et misérables infortunes. Quand il souffrait moins ou qu’il était dans une moins mauvaise disposition d’esprit, il lui arrivait bien parfois, souvent même, de donner un peu d’argent au recteur ; mais ce n’était qu’après l’avoir injurié, après avoir traité ceux qui avaient recours à lui de paresseux, de mendiants, et après avoir déblatéré contre la mollesse et l’imbécillité de la paroisse, qui ne savait pas administrer ses affaires. Il entremêlait ses discours de sarcasmes et de réflexions blessantes à l’adresse de M. Mordaunt, si bien qu’il rendait très difficile au pauvre révérend la tâche de faire des vœux chrétiens en sa faveur. Depuis nombre d’années que le recteur gouvernait la paroisse de Dorincourt, il ne se rappelait pas avoir vu le comte, de sa propre volonté, faire aucun acte de bonté, ni dans aucune circonstance montré qu’il pensât à un autre qu’à lui-même.
Ce jour-là, il se rendait près de Sa Seigneurie pour lui parler d’un cas pressant, et deux raisons lui faisaient redouter encore plus que de coutume son entrevue avec le comte. D’abord il savait que, depuis plusieurs jours, les accès de goutte de Sa Seigneurie avaient redoublé, et le bruit de sa méchante humeur était venu jusqu’au village, apporté par une des servantes, dont la sœur, miss Diblet, tenait une petite boutique de mercerie et en même temps de commérages. Ce que miss Diblet ne savait pas sur le château et sur son propriétaire, sur les fermiers du voisinage et sur leurs femmes, sur le village et sur ses habitants, ne valait pas la peine d’être dit. Les confidences de Jane à sa sœur passaient de la boutique de mercerie dans les maisons de ses pratiques : car, quoiqu’on détestât le vieux lord, ses faits et gestes n’en étaient pas moins le sujet de toutes les conversations.
La seconde raison pour laquelle le recteur appréhendait plus encore que de coutume de s’adresser au comte n’avait pas moins d’importance. Il se rappelait la fureur du vieux seigneur quand il avait appris que son fils le capitaine avait épousé une Américaine ; comment il avait traité ce fils, qu’il préférait pourtant intérieurement aux autres, et comment le charmant jeune homme, le seul de cette grande et puissante famille que chacun aimât, était mort sur une terre étrangère, pauvre et abandonné. Il savait, de même que tout le monde, combien le comte haïssait la pauvre jeune veuve qui avait été la femme de son fils, et comment, jusqu’à ce que ses deux aînés mourussent, il avait repoussé la pensée de reconnaître l’enfant de cette étrangère. Il savait enfin avec quelle répugnance il avait fait venir cet enfant, que d’avance il avait déclaré un petit Américain vulgaire, grossier, et plus capable de faire honte à son nom que de lui faire honneur.
Le vieux et orgueilleux seigneur pensait avoir gardé toutes ces pensées en lui-même. Il ne se doutait guère que personne eût osé les deviner, et encore moins en parler ; mais ses domestiques l’observaient et lisaient sur sa figure tout ce qui se passait dans son esprit ; ils le commentaient entre eux. Et pendant qu’il se vantait intérieurement de n’avoir rien de commun avec le vil troupeau qui l’entourait, Thomas, parlant à Jane la chambrière, au sommelier, au cuisinier et aux autres servantes et domestiques, s’exprimait ainsi :
« Le vieux, là-haut, rumine sur le fils du capitaine, et a grand’peur que ce garçon amené d’Amérique ne soit qu’un pauvre représentant de sa noble famille ; aussi nous n’avons qu’à marcher droit et à ne pas nous faire prendre en faute, car il est pour l’instant d’une humeur de dogue. »
Aussi, tout en montant l’avenue de grands arbres qui conduisait au château, M. Mordaunt se rappelait que le petit garçon en question était précisément arrivé au château la veille, qu’il y avait neuf chances sur dix pour que les appréhensions du comte fussent justifiées, et par conséquent vingt chances pour une, s’il en était ainsi, pour que, le comte étant fort mal disposé, sa colère tombât sur le premier qui se présenterait. Il y avait toutes chances en outre pour que cette première personne fût le révérend lui-même.
On juge donc de son étonnement lorsque, Thomas ayant ouvert la porte de la bibliothèque, un éclat de rire argentin, poussé par un enfant, arriva jusqu’à lui.
« Cela vous en fait deux de pris ! disait une petite voix claire et gaie ; voyez, cela vous en fait deux de pris ! »
Le comte était assis dans son fauteuil, à sa place ordinaire, son pied malade posé sur son tabouret ; à côté de lui se penchait sur son bras un petit garçon, à la figure animée, aux yeux brillants. « Cela vous en fait deux de pris ! répétait-il ; vous n’avez pas eu de bonheur, cette fois ; vous serez plus heureux une autre. »
Le comte leva les yeux en entendant ouvrir la porte ; il fronça les sourcils selon son habitude ; mais M. Mordaunt, à son grand étonnement, reconnut qu’il avait l’air moins bourru que de coutume. Par le fait, il semblait avoir oublié pour l’instant combien il savait être déplaisant et désagréable quand il le voulait.
« Ah ! c’est vous, dit-il, toujours de son ton rude, mais en tendant la main au recteur presque gracieusement. Bonjour, Mordaunt ; vous le voyez, j’ai trouvé un emploi. »
Il posa son autre main sur l’épaule de Cédric, et il eut une étincelle de plaisir dans ses yeux, causé sans doute par la satisfaction de pouvoir présenter un tel héritier, tandis qu’il continuait :
« Voici le nouveau lord Fautleroy. Fautleroy, voici M. Mordaunt, le recteur de la paroisse. »
Le petit lord leva les yeux sur celui qu’on lui présentait, jeta un regard sur ses vêtements ecclésiastiques, et lui tendant la main :
« Je suis très heureux de faire votre connaissance, Monsieur, » dit-il, se rappelant la phrase dont il avait entendu M. Hobbes user dans certaines occasions solennelles, quand, par exemple, il avait à saluer une nouvelle pratique d’importance : car Cédric se disait qu’il devait être tout particulièrement poli avec un ministre.
M. Mordaunt tint la petite main dans la sienne pendant quelques instants, tandis qu’il regardait l’aimable petite figure de l’enfant. Dès ce moment il se sentit attiré vers lui, et par le fait il en était ainsi de tous ceux qui l’approchaient. Ce n’était pourtant ni sa beauté ni sa grâce qui séduisait le recteur ; c’était la simple et naturelle amabilité du petit garçon ; cette amabilité qui faisait que, quelles que fussent les paroles qu’il prononçait, on sentait qu’elles étaient dictées par un sentiment affectueux et sincère.
« Je suis heureux, moi aussi, de vous connaître, lord Fautleroy, dit le recteur. Vous avez fait un bien long et bien pénible voyage pour venir à nous. J’aime à penser qu’il s’est bien accompli.
— C’était un long voyage, en effet, dit le petit lord ; mais il n’a pas été pénible, je n’étais pas seul ; Chérie était avec moi. Naturellement on n’est pas malheureux quand on a sa mère avec soi. Et puis le vaisseau était très beau.
— Prenez un siège, monsieur Mordaunt, » dit le comte.
Le recteur s’assit, et promenant ses yeux de l’enfant à son grand-père :
« Je félicite Votre Seigneurie, » dit-il au vieux lord.
Mais le comte ne se souciait pas de dévoiler ses sentiments sur ce sujet.
« Il ressemble à son père, dit-il d’un ton bourru. Espérons qu’il se conduira mieux. » Puis il ajouta :
« Qu’est-ce qui vous amène ce matin, Mordaunt ? Qu’y a-t-il encore ? »
L’accueil n’était pas aussi mauvais que le recteur s’y était attendu ; néanmoins, il hésita une seconde avant de répondre.
« C’est au sujet de Hugues, dit-il, de Hugues, de la ferme des Haies. Il a été malade l’automne dernier ; ses enfants viennent d’avoir la fièvre scarlatine, et sa femme, qui a été prise à son tour, est encore au lit. Je ne peux pas dire que ce soit un fermier très entendu ; mais il a eu du malheur, de sorte qu’il n’est pas en état d’acquitter son terme de loyer, et Newick, votre homme d’affaires, lui a signifié que s’il ne payait pas il devait quitter la place. Ce serait une terrible affaire pour lui. Il est venu chez moi, hier, me prier de vous voir et de vous demander du temps. Il pense que si vous vouliez lui accorder quelques mois, il pourrait se libérer.
— Ils disent tous la même chose, » grommela le comte.
Cédric fit un pas en avant. Il s’était tenu jusque-là entre son grand-père et le visiteur, écoutant de toutes ses oreilles, se sentant déjà vivement intéressé au sort de Hugues. Il se demandait combien d’enfants il avait et, si la fièvre scarlatine faisait beaucoup souffrir. Ses yeux restèrent fixés sur le recteur tout le temps qu’il parla.
« Hugues est un homme de bonne volonté, dit M. Mordaunt en tâchant de renforcer son plaidoyer.
— C’est un assez mauvais fermier. Il est toujours en retard, à ce que me dit Newick.
— Il est dans un grand embarras pour l’instant ; il aime beaucoup sa femme et ses enfants et, si la ferme lui est enlevée, ils seront tous réduits à mourir de faim. Ses enfants ont besoin de soins et de ménagements : deux d’entre eux ont été laissés très bas après leur maladie, et le docteur a ordonné pour eux du vin et des réconfortants. »
Lord Fautleroy fit un nouveau pas en avant.
« C’est comme pour Michel, » dit-il.
Le comte tressaillit légèrement.
« J’oubliais que vous étiez là, dit-il. J’oubliais que nous avions ici un philanthrope. Qui est ce Michel ? Un de vos amis sans doute ? »
Et l’espèce de sourire qu’à plusieurs reprises nous avons déjà vu dans les yeux du comte, s’y montra de nouveau.
« C’était le mari de Brigitte, dit Cédric. Il avait aussi la fièvre, et il ne pouvait payer ni son loyer, ni le vin, ni les autres choses qu’il lui fallait, et vous m’avez donné de quoi l’aider. »
Le comte grimaça d’un sourire.
« Je ne sais pas quelle sorte de propriétaire il fera plus tard, dit-il, en s’adressant au recteur, mais pour l’instant… J’avais recommandé à Havisam de lui donner tout ce dont il avait envie ou besoin, et tout ce dont il a eu envie, c’était d’argent, pour donner à des mendiants.
— Oh ! mais ce n’étaient pas des mendiants, dit le petit lord avec vivacité. Michel est un excellent maçon ; tous étaient de bons ouvriers.
— Eh bien ! fit le comte, mettons que ce n’étaient pas des mendiants, mais d’excellents maçons, ou de remarquables décrotteurs, ou de respectables marchandes de pommes. N’est-ce pas cela ? »
Il regarda l’enfant quelques instants en silence. Le fait est qu’une nouvelle pensée venait de surgir dans son esprit, et, quoiqu’elle ne lui eût peut-être pas été inspirée par le sentiment le plus noble, ce n’était pas une mauvaise pensée.
« Venez ici, Fautleroy, » dit-il.
L’enfant obéit et se plaça devant son grand-père, en ayant soin de ne pas heurter son pied malade.
« Que feriez-vous dans le cas dont vient de parler M. Mordaunt, si vous étiez à ma place ? »
Il faut convenir que le révérend éprouva en ce moment une curieuse sensation. Il y avait longtemps qu’il était recteur de la paroisse : il connaissait tous ceux qui l’habitaient, riches et pauvres, probes et malhonnêtes, fainéants et industrieux, et il réfléchissait au pouvoir que le petit garçon qui se tenait tranquille devant le comte aurait un jour pour le bien et pour le mal de tout ce monde. Le caprice d’un lord orgueilleux et fantasque pouvait lui accorder ce pouvoir dès à présent, et le ministre se disait que, si la nature de l’enfant n’était pas droite et généreuse, ce caprice pouvait avoir les conséquences les plus fâcheuses, aussi bien pour le futur maître du domaine que pour les tenanciers.
« Que feriez-vous à ma place ? » répéta le comte.
Le petit lord fit un nouveau pas en avant, et, posant une main sur le genou de son grand-père avec la confiance d’un enfant aimé :
« Si, au lieu d’être un petit garçon, j’étais à votre place, je voudrais qu’on laissât Hugues tranquille, qu’on lui accordât du temps pour payer. Je lui donnerais de plus ce dont il a besoin pour ses enfants. Seulement… seulement je ne suis qu’un petit garçon, et alors… » — Puis, après une pause pendant laquelle une légère rougeur monta à son visage : « Mais vous, dit-il, vous êtes riche ; vous pouvez lui accorder ce qu’il demande.
— Hum ! comme vous y allez ! fit le comte, d’un ton qui prouvait qu’il n’était pas mécontent.
— Ne le pouvez-vous pas ? répéta Cédric. Qui est Newick ? ajouta-t-il.
— C’est mon homme d’affaires. Il est chargé de toucher les loyers des fermages, et plusieurs de mes fermiers ne l’aiment pas.
— Si vous vouliez lui écrire, insista le petit lord ; je vous apporterais une plume et de l’encre et j’ôterais le jeu de cette table. »
Il ne lui était pas venu un instant à la pensée que son grand-père pût permettre à Newick d’agir à sa guise en cette circonstance et de traiter durement de pauvres gens.
Le comte demeura sans répondre.
« Savez-vous écrire ? dit-il enfin.
— Oui, mais pas très bien, répliqua Cédric.
— Retirez les objets de cette table, reprit le comte ; apportez la plume et l’encre et prenez une feuille de papier dans mon pupitre. »
L’intérêt de M. Mordaunt augmentait. Il suivit des yeux l’enfant, tandis qu’il obéissait vivement à l’ordre de son grand-père. En un instant la feuille de papier, la plume et le lourd encrier furent prêts.
« Là ! dit l’enfant gaiement, maintenant vous pouvez écrire.
— C’est vous qui allez le faire, dit le comte.
— Moi ! s’écria Cédric, tandis qu’une rougeur soudaine montait à son front. M. Newick ne voudra pas faire ce que je lui écrirai. Et puis, et puis… je ne mets pas bien l’orthographe ; je fais beaucoup de fautes quand personne ne me dicte les lettres qu’il faut mettre.

— N’importe, répliqua le comte. D’ailleurs, Hugues ne se plaindra pas de la manière dont la missive sera tournée. Asseyez-vous et trempez votre plume dans l’encrier.
— Qu’est-ce qu’il faut que je dise ?
— Vous pouvez dire : « Hugues ne doit pas être poursuivi pour l’instant, » et vous signerez : « Fautleroy. »
L’enfant s’installa devant la table et commença à écrire. C’était une grosse affaire pour lui ; il allait lentement, mais il y mettait toute son âme. Au bout de quelques instants, il tendit le papier à son grand-père, avec un sourire où se mêlait un peu d’anxiété.
Le comte lut, et les coins de sa bouche se détendirent légèrement.
« Hugues trouvera ces lignes tout à fait satisfaisantes, dit-il en tendant à son tour la feuille à M. Mordaunt. Celui-ci y lut :
« Chère M. Newick ne poursuivez pas M. Hugues s’il vous plêt vous oblijerez
— Est-ce bien la manière d’écrire « obligerez » et « respectueux » ? dit l’enfant.
— Ce n’est pas tout à fait celle du dictionnaire, répliqua le comte.
— C’est justement ce que je craignais ! J’aurais dû vous le demander. Y a-t-il encore d’autres fautes ?
— Quelques-unes, » dit le vieux lord. — Et, prenant un crayon, il corrigea le billet : « Maintenant recopiez cela, » dit-il.
L’enfant se mit de nouveau à l’ouvrage, et quelques instants après, la lettre, très correcte, tant d’écriture que d’orthographe cette fois, était remise à M. Mordaunt.
En la recevant des mains de l’enfant et en quittant le château, le recteur emporta encore autre chose que cette feuille de papier ; il emporta un affectueux sentiment pour l’enfant dont l’arrivée avait été marquée par un acte de charité, et l’espoir que de meilleurs jours allaient luire pour les tenanciers du comte.
XVII
Quand il fut parti, Cédric, qui l’avait accompagné jusqu’à la porte, revint vers le comte.
« Puis-je aller voir Chérie ? dit-il ; je pense qu’elle doit m’attendre. »
Le comte demeura quelques instants silencieux.
« Il y a quelque chose dans l’écurie qu’il faut que vous voyiez d’abord, fit-il. Sonnez.
— Je vous remercie beaucoup, dit le petit lord, en rougissant légèrement ; mais je vous en prie : elle m’attend depuis ce matin. J’irai bien voir ce qui est à l’écurie demain.
— Très bien, répliqua sèchement lord Dorincourt. — Demandez la voiture. — C’était un poney, ajouta-t-il.
— Un poney ! exclama Cédric ; quel poney ?
— Le vôtre.
— Le mien ! s’écria le petit garçon. Un poney à moi ! à moi ! comme les jouets de là-haut ?
— Oui, répliqua son grand-père. Aimeriez-vous à le voir ? Voulez-vous que je donne l’ordre de l’amener ? »
Les joues de Cédric devinrent de plus en plus rouges.
« Un poney à moi ! répéta-t-il. Je n’avais jamais pensé avoir un poney ! Comme Chérie va être contente !
— Désirez-vous le voir ? » demanda de nouveau le comte.
L’enfant poussa un long soupir.
« Bien sûr que je le désire ; je suis même impatient de le voir, mais je n’en ai pas le temps.
— Faut-il donc absolument que vous alliez chez votre mère aujourd’hui ? Ne pouvez-vous attendre à demain ?
— Oh ! non, dit Cédric. Elle a pensé à moi toute la matinée, et moi-même j’ai tant pensé à elle !
— Vraiment ! » dit le comte du même ton sec, et il ajouta : « Sonnez ! »
Quelques instants après, le grand-père et le petit-fils descendaient en voiture la grande avenue.
Le vieux lord était silencieux, mais l’enfant ne l’était pas. Il parlait du poney. Était-il grand ? Quelle était sa couleur ? Comment le nommait-on ? Que mangeait-il de préférence ? Quel était son âge ? À quelle heure pourrait-il le voir le lendemain ?
« Chérie sera si contente ! ajoutait-il ; elle vous sera si reconnaissante d’être bon pour moi ! Elle sait que j’ai toujours beaucoup aimé les poneys ; mais elle n’avait jamais pensé, pas plus que moi, que je pourrais en avoir un. Il y avait un petit garçon à New-York, dans la Cinquième Avenue, qui en montait un tous les matins, et nous avions coutume de passer devant sa maison pour le voir. »
Il s’adossa au coussin, et, regardant pendant quelques minutes avec un sérieux intérêt le comte, qui était assis en face de lui :
« Je pense que vous êtes le meilleur homme qui existe, dit-il à la fin. Vous êtes sans cesse occupé à faire le bien et à penser aux autres. Chérie dit toujours : Ne pensez pas à vous, mais pensez aux autres. C’est justement ce que vous faites, n’est-ce pas ? »
Sa Seigneurie fut tellement abasourdie en se voyant présentée sous de si agréables couleurs, qu’elle ne sut que répondre. Elle avait besoin de réfléchir. Voir chacun de ses motifs bas et égoïstes changés en intentions charitables et désintéressées par la généreuse simplicité d’un enfant, c’était une épreuve assez singulière.
Le petit lord continuait à regarder son grand-père de ses grands yeux clairs et innocents, où se peignait l’admiration.
« Vous avez rendu heureux tant de gens ! reprit-il : Michel, Brigitte et leurs enfants ; la marchande de pommes, Dick et même M. Hobbes : car la montre que je lui ai donnée a été achetée avec l’argent dont vous m’aviez fait cadeau. Maintenant c’est M. Hugues, et Mme Hugues, et leurs enfants ; et M. Mordaunt, par la même occasion ; et puis Chérie, et puis moi, à qui vous voulez donner un poney et à qui vous avez déjà donné tant d’autres belles choses. Tenez, j’ai compté sur mes doigts : cela fait vingt-sept personnes à ma connaissance que vous avez rendues heureuses. C’est beaucoup vingt-sept !
— Et c’est moi qui ai fait tout ce bien ? demanda le comte.
— Bien sûr, dit l’enfant. Savez-vous ? ajouta-t-il avec un peu d’hésitation, il y a des gens qui sont quelquefois trompés sur les comtes. M. Hobbes était de ces gens-là. Mais je vais bien vite lui écrire pour le détromper.
— Et quelle était l’opinion le M. Hobbes sur les comtes ? demanda le vieux lord.
— Il pensait… mais il n’en avait jamais vu et ne les connaissait que par les livres… Il pensait… Il ne faut pas que cela vous chagrine, au moins… Il disait que c’étaient des tyrans, et qu’il voudrait les voir tous pendus autour de sa boutique. Seulement il ne vous connaissait pas ; s’il vous avait connu, c’eût été tout différent. Je lui parlerai de vous, et alors il changera d’opinion.
— Que lui direz-vous ?
— Je lui dirai, s’écria Cédric, le teint animé par l’enthousiasme, que vous êtes l’homme le meilleur, le plus généreux que je connaisse ; que vous pensez toujours aux autres ; que vous ne cherchez qu’à les rendre heureux, et que, quand je serai grand, je ferai mon possible pour vous ressembler.
« Pour me ressembler ! » répéta le comte fixant ses yeux sur l’aimable petite figure qu’il avait devant lui. — Une sorte de rougeur monta à ses joues flétries ; il détourna ses regards et les laissa errer sur les grands hêtres dont le soleil faisait reluire les feuilles lisses et brillantes.
« Oui, pour vous ressembler, dit de nouveau Cédric ;… si je peux, ajouta-t-il modestement. Peut-être n’y réussirai-je pas ; mais j’essayerai toujours.
La voiture continua à rouler sous les grands et beaux arbres qui étendaient leurs énormes branches sur le chemin. Cédric vit de nouveau les larges places couvertes de fougères, et celles où les clochettes bleues s’agitaient à la brise. Il traversa des espaces plongés dans une ombre profonde et d’autres inondés de soleil. De nouveau les daims et les chevreuils levèrent leurs têtes fines pour regarder passer la voiture, et les lapins disparurent dans le fourré. Il entendit l’appel des perdrix, les chansons des oiseaux, et tout lui parut plus beau encore que la première fois. L’aspect de toutes ces magnificences remplissait son cœur de joie et d’amour. Mais le vieux comte voyait des choses très différentes, quoique ses yeux contemplassent les mêmes objets. Il voyait une longue vie qui ne contenait ni actions généreuses ni bonnes pensées. Il voyait une suite d’années pendant lesquelles un homme jeune, fort, riche et puissant n’avait employé sa jeunesse, sa force, sa richesse et sa puissance que pour sa propre satisfaction. Il vit cet homme, quand l’âge fut venu, rester seul, sans ami, au milieu de toutes ses richesses ; il vit des gens qui le craignaient et le détestaient ; d’autres qui le flattaient et rampaient devant lui ; mais pas une seule personne qui se souciât qu’il vécût ou qu’il mourût, à moins qu’ils eussent à gagner ou à perdre quelque chose par sa mort. Il contemplait son immense propriété : car il savait, lui, ce que le petit lord ne savait pas, c’est-à-dire jusqu’où elle s’étendait ; il songeait aux richesses qu’elle représentait, aux nombreuses familles qui vivaient sur ses terres, et il se disait — autre chose dont Cédric ne se doutait pas — qu’il n’était pas un seul habitant de ces demeures, humbles ou aisées, qui eût jamais eu la pensée d’appliquer au propriétaire de tous ces biens l’épithète de « bon », et que pas un n’eût voulu lui ressembler, comme le souhaitait en ce moment son petit-fils, avec son âme candide.
Ces réflexions n’étaient pas précisément agréables, même pour un vieillard égoïste, qui pendant soixante-dix ans n’avait jamais eu une pensée qui ne fût pour lui, et qui n’avait jamais daigné se soucier de l’opinion que le monde pouvait avoir de lui, tant que cette opinion ne nuisait ni à sa satisfaction ni à ses intérêts. Par le fait, jusque-là, il ne s’était jamais donné la peine d’y réfléchir, et, chose étonnante, s’il y avait été amené en ce moment, c’est parce qu’un enfant l’avait cru meilleur qu’il n’était, qu’il avait exprimé le désir de marcher sur ses « glorieux » pas et de suivre son exemple. Ce désir avait conduit le vieux comte à se demander s’il était réellement la personne que son petit-fils dût prendre pour modèle.
Cédric pensa que le pied du comte devait le faire souffrir, car il fronçait les sourcils tandis qu’il regardait au dehors, par la fenêtre de la voiture. Dans cette pensée, le petit garçon cessa de parler, de peur de lui irriter les nerfs, et se contenta de jouir en silence de la vue du parc et des beaux arbres. Mais la calèche, après avoir passé la grille et traversé rapidement de vertes prairies, s’arrêta enfin. On avait atteint la Loge. Cédric fut à terre presque avant que le valet de pied eût ouvert la portière de la voiture.
Le comte sortit de sa rêverie.
« Qu’y a-t-il ? dit-il, avec un léger tressaillement ; sommes-nous arrivés ?
— Oui, dit Cédric. Voici votre canne ; appuyez-vous sur moi pour descendre.
— Je ne descends pas, répliqua le comte brusquement.
— Comment ! vous n’allez pas voir Chérie ? dit l’enfant avec surprise.
— Chérie m’excusera, dit le comte sèchement. Allez, et dites-lui que rien n’a pu vous empêcher de venir la voir aujourd’hui, pas même le désir de faire connaissance avec votre poney.
— Elle sera bien fâchée ! Elle aurait été si contente de vous voir !
— Je crains que non, murmura le comte. La voiture viendra vous chercher pour retourner au château, » ajouta-t-il.
Sur un signe de son maître, Thomas ferma la portière de la calèche. Après un moment d’étonnement et d’embarras, Cédric prit sa course vers la maison. Le comte eut alors l’occasion, comme M. Havisam l’avait eue déjà, de voir une paire de belles et fortes petites jambes fuir avec une étonnante rapidité. Évidemment leur propriétaire ne voulait pas perdre de temps, et pas une fois il ne se retourna.
Le carrosse s’éloignait lentement. À travers un espace vide entre les arbres, le comte put apercevoir la porte de la maison. Elle était toute grande ouverte. Le petit coureur franchit d’un saut les marches du perron. Une autre figure, mince et vêtue de noir, s’élança au-devant de lui : on aurait dit qu’ils volaient l’un à l’autre. Cédric sauta dans les bras de sa mère, se pendit à son cou et couvrit son doux visage de baisers.
XVIII
Jamais l’église de Dorincourt n’avait été aussi remplie qu’elle
le fut le dimanche suivant. Ce jour-là, M. Mordaunt vit apparaître
une foule de personnes qui ne lui faisaient que très rarement
l’honneur de venir écouter ses sermons. On voyait même
parmi elles des paroissiens des villages voisins, attirés par la
curiosité. C’étaient de robustes paysans, au teint brûlé par le
soleil, avec leurs femmes débordant de santé et dont les joues
étaient rouges comme des pommes. Elles avaient mis pour cette
occasion leurs plus belles robes et arboré leurs bonnets à rubans
ainsi que leurs châles multicolores. Leurs nombreux enfants,
dans leurs habits neufs, les entouraient. Le médecin du
village était dans son banc avec sa femme et ses quatre filles.
De même, le droguiste, l’épicier, la couturière et son amie la
modiste, avec leur famille, occupaient le leur ; enfin le village
entier était réuni, et M. Mordaunt ne se rappelait pas avoir
jamais vu une assemblée aussi nombreuse.
Dans le cours de la semaine précédente, une foule d’histoires étonnantes avaient circulé sur le compte du petit lord Fautleroy. La boutique de miss Diblet n’avait pas désempli. On venait acheter pour deux sous de ruban ou pour un sou d’aiguilles, afin d’entendre ce qu’en sa qualité de sœur d’une des chambrières du château, elle pouvait avoir appris sur Sa petite Seigneurie.
Miss Diblet savait tant de choses ! Elle savait au juste comment étaient meublées les chambres qui composaient l’appartement du petit lord ; quels jouets avaient été achetés pour lui ; comment un joli poney brun attendait son arrivée dans l’écurie, ainsi qu’une petite charrette anglaise avec des harnais montés en argent, Elle avait vu le groom qui devait accompagner le petit lord dans ses promenades. Elle pouvait raconter en outre les réflexions de tous les domestiques quand ils avaient aperçu l’enfant, le jour de son arrivée ; les exclamations de toutes les femmes de service, qui s’étaient écriées que c’était une cruauté de séparer le pauvre petit de sa mère, et qui toutes avaient déclaré que les larmes leur étaient venues aux yeux quand lord Fautleroy était entré seul dans la bibliothèque pour paraître devant son terrible grand-père : car, disaient-elles, comment va-t-il le traiter quand il se trouvera seul avec lui ?
« Mais voyez-vous, continuait miss Diblet quand elle était parvenue à ce point de son récit, cet enfant ne connaît pas la crainte ; c’est Thomas lui-même qui le dit. Il entra dans la biblithèque en souriant et parla à Sa Seigneurie comme s’ils avaient été les meilleurs amis du monde, et cela dès le premier moment. Et le comte fut tellement stupéfait des manières de son petit-fils qu’il ne put faire autre chose que l’écouter et le regarder par-dessous ses gros sourcils. C’est l’opinion de Thomas que, tout méchant qu’est le vieux lord, il était content aussi bien qu’orgueilleux de voir quel bel enfant était lord Fautleroy : car, pour un plus beau garçon, de meilleures manières, M. Thomas dit qu’il est impossible d’en trouver un et que le vieux lord a lieu d’être satisfait. »
On en vint à l’histoire du fermier Hugues. M. Mordaunt l’avait racontée chez lui à table ; la servante, qui l’avait entendue, n’avait pas manqué de la répéter à la cuisine, et de là elle s’était répandue comme une traînée de poudre.
Le jour du marché, quand Hugues parut sur la place, il fut interrogé de tous côtés, ainsi que Newick. À toutes les questions ils répondirent en montrant le billet signé « Fautleroy ».
Ainsi les ménagères du village et les fermières des environs eurent de quoi causer toute la semaine, et, quand vint le dimanche, elles s’empressèrent de se rendre à l’église, dans l’espoir de voir le héros de tous ces événements. Elles y entraînèrent leurs maris, qui avaient, eux aussi, leur part de curiosité, n’étant pas fâchés de connaître l’enfant qui devait un jour être leur propriétaire et seigneur.
Le comte n’avait pas l’habitude d’aller très régulièrement à l’office, mais il décida pourtant qu’il s’y rendrait ce même dimanche. C’était sa fantaisie de se montrer à ses tenanciers dans le banc seigneurial, ayant lord Fautleroy à côté de lui.
Tous les fidèles n’étaient pas entrés dans le temple. Une grande partie se tenaient sous le porche, dans le cimetière qui entourait l’église ou dans la prairie qui s’étendait devant. Les discussions étaient fort animées au sujet de savoir si le comte viendrait ou ne viendrait pas. Pendant qu’elles étaient au plus haut degré de vivacité, une bonne femme fit entendre une exclamation.
« Ce doit être la mère ! dit-elle. Pauvre dame ! qu’elle est jolie et comme elle a l’air doux ! »
Toutes les têtes se tournèrent, et on aperçut une jeune femme vêtue de noir, qui montait le sentier conduisant au porche. Son voile était rejeté en arrière, laissant voir son aimable visage, ainsi que les boucles dorées des cheveux, soyeux comme ceux d’un enfant, qui s’échappaient de son petit chapeau de veuve.
Elle ne pensait pas à tous ceux qui l’entouraient ; elle pensait seulement à Cédric, à ses visites et à la joie que lui avait donnée le poney, sur lequel il était allé voir sa mère la veille. Il s’y tenait si bien et il avait l’air si content et si heureux ! Mais bientôt elle ne put s’empêcher de remarquer qu’elle était le centre de tous les regards et que son arrivée causait de la sensation.
Elle s’en aperçut d’abord parce qu’une vieille femme en manteau rouge lui fit une révérence. Une autre l’imita en disant : « Dieu vous garde, mylady ! » — Tous les hommes alors, les uns après les autres, retirèrent leur chapeau comme elle passait. D’abord elle ne comprit pas la raison des honneurs qu’on lui rendait ; puis elle se dit qu’ils s’adressaient à la mère de lord Fautleroy. Alors elle rougit légèrement, tandis qu’elle répondait d’une voix douce et en souriant à la vieille femme qui lui avait souhaité la bienvenue : « Je vous remercie. »
Pour une personne qui avait toujours vécu dans une ville américaine, affairée et populeuse, cette simple marque de déférence était toute nouvelle et même d’abord un peu embarrassante ; néanmoins Mme Errol ne put s’empêcher d’être touchée des sentiments qu’on lui montrait.
Elle venait de franchir le porche de pierre et d’entrer dans l’église, quand le grand événement, attendu avec tant d’impatience, se produisit. La calèche du comte, attelée de ses magnifiques chevaux, avec ses domestiques en grande et brillante livrée, se montra au coin de la route.
L’exclamation « Les voici ! les voici ! » courut de l’un à l’autre groupe.
Le carrosse vint se ranger devant l’entrée du cimetière. Thomas sauta à terre, ouvrit la portière, et un petit garçon habillé de velours noir s’élança dehors.
Tous les regards se fixèrent sur lui avec curiosité.
« C’est le capitaine ! s’écrièrent ceux des assistants qui se rappelaient le père ; c’est le capitaine trait pour trait ! »
Cédric s’était arrêté en attendant le comte, que Thomas aidait à descendre de voiture, et le regardait avec l’intérêt filial le plus vif. Dès qu’il pensa pouvoir lui être de quelque utilité, il lui tendit la main, et lui offrit son épaule pour l’aider à marcher, avec autant de confiance que s’il avait eu sept pieds de haut. Il était visible que, quels que fussent les sentiments que le comte inspirait aux autres, son petit-fils du moins n’était pas frappé de terreur.
« Appuyez-vous sur moi, lui disait-il. Comme tous ces gens sont heureux de vous voir et de quel air affectueux ils vous saluent !
— Découvrez-vous, Fautleroy, dit le comte ; c’est vous qu’ils saluent.
— Moi ! » s’écria Cédric en obéissant et en enlevant vivement son chapeau.
Il montra alors sa jolie tête, entourée de son auréole brillante, tandis que, le visage animé par la joie et la surprise, il souriait à droite et à gauche.
« Dieu bénisse Votre Seigneurie ! dit avec une révérence la vieille femme au manteau rouge qui avait parlé à sa mère ; qu’il vous accorde une longue vie !
— Je vous remercie, madame ! » dit Cédric.
Alors, suivant son grand-père, il entra dans l’église. Tous les regards les accompagnèrent pendant qu’ils gagnaient la tribune garnie de tentures et de coussins qui leur était réservée. Quand Cédric y fut parvenu, il fit une découverte qui lui fut très agréable. En face de lui, de l’autre côté de l’église, sa mère lui souriait. Cédric lui rendit son sourire, heureux de voir qu’elle était placée de manière à ce que leurs regards pussent facilement se rencontrer.
Cédric aimait beaucoup la musique. Souvent sa mère et lui chantaient ensemble. Quand les psaumes commencèrent, il joignit aux voix des assistants sa voix pure et douce, qui s’élevait aussi claire que celle d’un oiseau. Il se laissait aller entièrement au plaisir qu’il éprouvait. Le comte s’oubliait aussi un peu lui-même et, enfoncé dans les coussins du banc, il observait l’enfant. Le petit lord, le psautier ouvert dans sa main, chantait de toutes ses forces ; la joie se peignait sur son visage, légèrement levé vers le ciel, et qu’un rayon de soleil, perçant, au travers des vitraux de couleur, venait baigner d’or, de pourpre et d’azur. Sa mère, tandis qu’elle le regardait de l’autre côté de l’église, sentit son cœur tressaillir de bonheur, et une prière s’éleva pour lui dans son cœur. Elle demandait à Dieu que son cher enfant conservât son âme pure et candide, et que l’étrange et grande fortune qui venait de tomber sur lui n’amenât pas de mal avec elle.
« Oh ! Cédric, avait-elle dit à son petit garçon la veille au soir, au moment où il allait la quitter, oh ! Cédric, je voudrais être très vieille, très habile, et posséder beaucoup d’expérience, afin de pouvoir te donner de bons conseils. Mais je te dirai seulement, mon cher enfant : sois bon, sois affectueux, sois sincère ; sois courageux aussi. Alors, non seulement tu ne feras jamais de mal à personne, mais tu pourras empêcher beaucoup de mal, et le monde, le vaste monde, deviendra un peu meilleur, parce que mon petit garçon aura vécu. Et c’est tout ce qu’on peut désirer, que le monde devienne un peu meilleur, même si peu que ce soit, mon chéri ! »
De retour au château, l’enfant avait reporté ces paroles à son grand-père.
« Quand elle eut fini, ajouta Cédric, je lui dis que c’est ainsi, bien sûr, que vous aviez été, et que c’est la raison qui fait que le monde est un peu meilleur qu’autrefois ; aussi je lui ai bien promis de faire tout mon possible pour vous imiter.
« Et qu’a-t-elle répondu ? demanda le comte, légèrement embarrassé.
— Elle a dit que j’avais raison ; que nous devions toujours prendre pour modèle les gens qui sont bons et tâcher de faire comme eux. »
Peut-être était-ce le souvenir de cette conversation qui revenait à l’esprit du vieux lord, tandis qu’à moitié caché derrière les draperies de sa tribune, il regardait de loin, par une ouverture entre les rideaux, celle qui avait été la femme de son fils et qui, avec ses yeux bruns et doux, ressemblait si fort à l’enfant qu’il avait à côté de lui. Mais si ses pensées étaient agréables ou amères, c’est ce qu’il eût été difficile de découvrir.
Quand le grand-père et le petit-fils sortirent de l’église, plusieurs de ceux qui avaient assisté au service et qui étaient sortis avant eux se pressèrent pour les voir passer. Comme ils approchaient de la porte fermant le petit enclos qui entourait l’église, l’un d’eux fit un pas en avant avec hésitation. C’était un homme d’une quarantaine d’années, avec un visage maigre et fatigué.
« Eh bien, Hugues ? » demanda le comte.
Cédric se retourna vivement en entendant ce nom.
« Ah ! c’est M. Hugues ! s’écria-t-il.
— Oui, répondit le comte sèchement, et je suppose qu’il vient jeter un regard sur son futur propriétaire.
— Oui, mylord, dit l’homme, dont la face brune se couvrit de rougeur. M. Newick m’a dit que Sa jeune Seigneurie a été assez bonne pour parler en ma faveur, et, avec votre permission, je voulais lui dire un remerciement. »
Peut-être éprouva-t-il un peu d’étonnement en voyant que c’était un si petit garçon qui, sans le savoir peut-être, lui avait fait tant de bien, et que cet enfant restait à le regarder, comme un de ses propres enfants aurait pu le faire, sans avoir l’air de se douter le moins du monde de son importance.
« Je suis bien reconnaissant à Votre Seigneurie, dit Hugues ; je vous remercie beaucoup, je…
— Oh ! dit le petit lord, je n’ai fait qu’écrire la lettre ; c’est mon grand-père qui l’a dictée. Il est toujours prêt à faire du bien, vous savez. Comment va Mme Hugues ? »

Hugues eut l’air un peu embarrassé. C’était la première fois qu’il entendait son noble seigneur présenté sous la figure d’un personnage bienveillant, rempli d’aimables qualités.
« Je… balbutia-t-il. Elle va mieux, mylord, depuis qu’elle n’a plus d’inquiétudes. C’est surtout ce qui l’avait abattue.
— Je suis heureux d’apprendre cela, dit Cédric. Mon grand-père et moi nous avons été bien fâchés aussi de savoir que vos enfants avaient la scarlatine. Il a eu des enfants lui-même, et, ajouta-t-il plus bas, il s’y intéresse particulièrement. Je suis le petit garçon de son fils, vous savez. »
Hugues était sur les épines. Il sentit que ce qu’il avait de mieux à faire, c’était d’éviter de regarder le comte : car il savait comme tout le monde que l’affection paternelle du noble lord était telle qu’il s’était toujours contenté de voir ses fils deux fois par an, et qu’un jour qu’ils étaient tombés malades, il s’était hâté de partir pour Londres, ne se souciant pas d’être ennuyé par les gardes et les médecins. C’était une singulière épreuve pour les nerfs de Sa Seigneurie, dont les yeux brillaient sous ses sourcils rapprochés, d’entendre dire qu’elle avait été émue en apprenant que les enfants d’un de ses fermiers avaient la fièvre scarlatine.
« Vous voyez, Hugues, dit-il en grimaçant un sourire, que vous et bien d’autres avez toujours été trompés à mon sujet. Lord Fautleroy me comprend, lui. Quand vous aurez besoin d’informations sur mon compte, adressez-vous à mon petit-fils.
— Montez, Fautleroy. »
XIX
Cédric sauta dans la voiture, qui traversa de nouveau la verte prairie ; et quand elle fut arrivée au tournant de la route, le comte avait encore l’espèce de même sourire sur le visage.
Ce sourire eut l’occasion de revenir plusieurs fois sur les lèvres de lord Dorincourt pendant les jours qui suivirent. À mesure qu’il faisait plus ample connaissance avec son petit-fils, il s’y montrait de plus en plus souvent ; il y avait même des instants où il semblait perdre son amertume. Il est sûr qu’au moment où le petit lord fit son apparition, le vieux comte commençait à être très fatigué de sa solitude, de sa goutte et de ses soixante-dix ans. Après une longue vie passée dans le plaisir, il n’est pas amusant de se trouver seul dans un appartement, si splendide qu’il soit, avec un pied sur un tabouret de goutteux, et sans autre divertissement que de se mettre en colère contre un valet qui vous déteste : car le vieux lord était beaucoup trop fin pour ne pas savoir quels sentiments ses domestiques avaient pour lui. Il savait que quand on venait le voir ce n’était pas par affection, mais peut-être parce qu’on trouvait un certain plaisir dans sa conversation méchante et sarcastique, qui n’épargnait personne. Tant que sa santé le lui avait permis, il avait parcouru le monde, allant sans cesse d’un lieu à un autre, cherchant à s’amuser, mais n’y parvenant pas toujours. Quand les ans et la maladie furent venus, il s’enferma à Dorincourt, en compagnie de ses journaux et de sa goutte ; mais il ne pouvait pas lire toujours, sans désemparer, et il devint de plus en plus « excédé de la vie », comme il disait. Les nuits étaient pour lui aussi fatigantes que les jours. Son caractère s’aigrit de plus en plus. Quand Cédric apparut, par bonheur pour lui, l’orgueil de son grand-père se trouva flatté par les grâces de son extérieur ; s’il en eût été autrement, l’enfant n’aurait peut-être pas eu l’occasion de montrer les qualités de son cœur ou de son esprit : car le vieux comte eût commencé par le prendre en aversion et l’eût tenu dans l’éloignement de sa personne. Mais il lui plut de croire que la beauté dont son petit-fils était doué, aussi bien que le charme de ses manières et la raison précoce qui apparaissait dans ses discours, en dépit de son ignorance de tout ce qui concernait sa nouvelle position, provenaient du noble sang qui coulait dans ses veines, si bien que, sans s’en douter, il commença à aimer cet enfant. Cela l’avait amusé de remettre en son pouvoir le sort de Hugues. Il ne se souciait pas le moins du monde de son fermier ; mais il lui plaisait de penser que son petit-fils pouvait devenir populaire parmi ses tenanciers, et c’était la raison pour laquelle il s’était rendu à l’église ce jour-là. Il voulait voir quel effet produirait son arrivée. Il savait qu’on s’extasierait sur la beauté de ses traits, sur l’élégance et sur la force de ses membres bien découplés, sur l’éclat de ses boucles chatoyantes, sur la grâce de toute sa petite personne, et qu’ainsi qu’il avait entendu autrefois une vieille femme le dire du père, ils s’écrieraient tous : « C’est un lord des pieds à la tête ! » Lord Dorincourt était orgueilleux et arrogant, surtout dans tout ce qui touchait à son rang et à son nom ; et il n’était pas fâché de faire savoir à ceux qui avaient vu si longtemps l’espoir de sa maison représenté par des fils qu’il jugeait indignes de lui, que son nouvel héritier était à la hauteur de sa position.
Quelques jours auparavant, le poney avait été essayé, et le comte fut si satisfait des dispositions montrées par Cédric qu’il en oublia sa goutte. D’après ses ordres, Wilkins, le groom, avait amené le petit animal, qui secouait sa crinière brillante en arrondissant sa nuque, devant les fenêtres de la bibliothèque, pour que lord Dorincourt pût assister à la première leçon d’équitation. Le grand-père se demandait quelle allait être la conduite de Cédric en cette circonstance ; il avait souvent vu les enfants donner des signes de frayeur en se sentant tout à coup, et pour la première fois, hissés sur un cheval, et il craignait que son petit-fils ne se laissât aller à pareille faiblesse.
Il eut bientôt sujet d’être rassuré.
Cédric s’approcha résolument du poney, qui n’était pas pourtant des plus petits, lui fit quelques caresses ; puis, avec l’aide de Wilkins, il sauta gaiement sur son dos. Alors le groom, prenant le cheval par la bride, le fit marcher de long en large devant la fenêtre.
« C’est un fameux luron, disait Wilkins quelques heures après à Thomas ; je n’ai pas eu de mal à le mettre en selle, et un autre plus vieux ne s’y serait pas tenu comme lui. « Suis-je bien droit, Wilkins ? qu’il me disait. Au cirque, j’ai vu que les écuyers se tenaient bien droit ; suis-je bien droit ? » Et je lui répondais : « Droit comme une flèche, mylord ; droit comme un I. » Et alors il s’est mis à rire : « Droit comme un I ! C’est bien cela ! Si je ne me tiens pas bien droit, Wilkins, vous me le direz. »
Mais marcher au pas, d’abord de droite à gauche, et ensuite de gauche à droite, ne faisait pas complètement l’affaire de Cédric.
« Est-ce que je ne pourrais pas aller tout seul, maintenant ? dit-il, en levant les yeux vers son grand-père, qui continuait à le regarder par la fenêtre. Est-ce que je ne pourrais pas aller tout seul et un peu plus vite ? Le garçon de la Cinquième Avenue, à New-York, faisait trotter et même galoper son cheval.
— Pensez-vous pouvoir trotter et galoper ? dit le grand-père.
— Je voudrais essayer. »
Sa Seigneurie fit un signe à Wilkins, qui, sautant sur son propre cheval, vint se placer à la gauche de Cédric.
Sur un autre signe du comte, les deux chevaux partirent au trot.
Cédric s’aperçut alors que de trotter n’était pas aussi aisé que de marcher.
« Oh… oh… oh !… dit-il, com-com-comme il m-m-me

s-s-se-c-c-coue ! Es-es-est-ce qu-qu-qu’il v-v-vous s-s-secoue
c-c-comme ce-ce-cela, W-W-Wilkins ?
— Non, mylord, répondit le domestique, et il ne vous secouera pas toujours autant. Levez-vous sur vos étriers.
— Je… je… je… m-m-me lève ; m-m-mais ce-ce-cela n’-n’-n’y f-f-fait rien ! »
Il rebondissait bien sur sa selle en effet, mais par secousses et par sauts inégaux, qui lui procuraient une sensation très peu agréable. Ses joues étaient empourprées, sa respiration haletante ; cependant il se tenait toujours droit sur sa selle et continuait à se laisser bravement secouer par le trot du poney sans demander grâce. Le comte le suivait toujours des yeux. Les deux cavaliers disparurent bientôt entre les bouquets d’arbres qui entouraient la pelouse, et on fut quelque temps sans les apercevoir. Quand ils se montrèrent de nouveau, Cédric était en tête ; ses joues étaient rouges comme des coquelicots ; il tenait ses lèvres serrées ; mais il trottait toujours à côté de Wilkins.
« Arrêtez un instant, dit le grand-père ; où est votre chapeau ? »
Wilkins toucha le sien.
« Il est tombé, mylord, dit-il ; Sa Seigneurie n’a pas voulu que je m’arrête pour le ramasser.
— Lord Fautleroy a-t-il eu peur ? demanda le comte.
— Peur ! lui ! Oh ! non, il n’a pas eu peur ! Je jurerais qu’il ne sait pas ce que c’est que d’avoir peur ! J’ai appris à monter à bien des jeunes messieurs avant aujourd’hui, mais je n’en ai jamais vu d’aussi résolus que Sa Seigneurie.
— Êtes-vous fatigué ? demanda le comte à Cédric. Voulez-vous vous arrêter ?
— Cela vous secoue plus que je ne croyais, dit l’enfant, et cela vous fatigue un peu ; mais j’aime mieux ne pas m’arrêter encore et continuer la leçon. Aussitôt que j’aurai recouvré ma respiration, j’irai chercher mon chapeau. »
La personne la plus habile du monde, si elle avait donné des conseils à Cédric sur la meilleure manière de plaire à son grand-père, n’aurait pu l’engager à s’y prendre autrement que ne le faisait le petit lord dans la simplicité de son cœur et rien qu’en obéissant à sa nature. Tandis que le poney, portant son petit cavalier, trottait vers le lieu où Cédric avait laissé tomber son chapeau, une faible rougeur colora les joues flétries du comte, et un sentiment de satisfaction tel qu’il ne pensait plus devoir jamais en éprouver vint allumer un éclair dans ses yeux. Il resta plongé dans son fauteuil, les regards fixés sur l’endroit où l’enfant avait disparu, attendant avec impatience qu’il se montrât de nouveau. Au bout de quelque temps, le son des fers des chevaux l’avertit du retour des cavaliers. Ils arrivaient, en effet, Wilkins portant le chapeau de Cédric, qui était toujours nu-tête, ses cheveux flottant au vent et lui formant une auréole ; ses joues étaient plus rouges, ses yeux plus brillants que jamais. Il avait fait prendre le galop à son cheval.
« Là ! s’écria-t-il tout essoufflé en arrivant devant la fenêtre, j’ai galopé. Pas aussi bien que le petit garçon de la Cinquième Avenue, mais je l’ai fait et je recommencerai ! »
De ce moment, lui, Wilkins et le poney furent grands amis. À peine un jour se passait-il sans qu’on les vît galoper, tous trois de compagnie, sur les routes du voisinage ou à travers les vertes prairies. Les enfants sortaient des maisons pour venir voir le joli petit cheval, qui semblait tout fier du gentil cavalier qui se tenait si droit sur sa selle, et le petit lord leur jetait un joyeux bonjour, en faisant flotter son chapeau d’une manière fort peu digne peut-être, mais très amicale.
XX
Chaque jour augmentait l’intimité du grand-père et du petit-fils et en même temps, accroissait la confiance de celui-ci dans les bons sentiments de son aïeul. Il ne mettait pas en doute que son grand-père fût l’homme le meilleur et le plus généreux de la terre. Ce qu’il y a de sûr, c’est que tous les souhaits du petit lord étaient exaucés presque avant qu’ils fussent formés, et les cadeaux, les plaisirs, lui arrivaient avec une telle prodigalité qu’il en était quelquefois embarrassé. Cette méthode eût présenté des dangers, appliquée à d’autres enfants du même âge ; mais avec Cédric elle ne produisait que de bons effets. Peut-être, en dépit de son excellente nature, en eût-il été autrement si sa mère n’avait veillé si tendrement et si attentivement sur lui. Mais il allait toujours passer avec elle quelques heures chaque jour ; ils causaient longuement ensemble, et jamais elle ne le laissait partir, pour retourner au château, sans avoir déposé sur son front un baiser et dans son cœur quelques paroles qui devaient porter leurs fruits.
Il y avait une chose, malgré tout, qui embarrassait beaucoup le petit garçon, et à laquelle il pensait plus souvent que ne le croyait sa mère elle-même. Avec sa vivacité d’esprit et d’observation, il n’avait pas tardé à remarquer que le comte et sa mère ne se rencontraient jamais. Quand la voiture de son grand-père le conduisait à la Loge, jamais le comte ne descendait, et, dans les rares occasions où le comte allait à l’église, il laissait son petit-fils parler à sa mère sous le porche ou même la suivre chez elle, mais sans jamais s’en approcher. Cependant chaque jour des fruits et des fleurs, provenant des jardins ou des serres du château, étaient envoyés à la Loge. Là ne se bornaient pas les munificences du comte à l’égard de sa belle-fille : il avait donné des ordres pour qu’elle ne manquât de rien, sans doute d’après le principe émis devant M. Havisam, qu’il ne voulait pas qu’on pût lui reprocher de ne pas fournir à la mère de lord Fautleroy de quoi tenir convenablement son rang.
Ainsi, quelques semaines après son arrivée, Cédric, se disposant un jour à aller voir sa mère, trouva au bas du perron, au lieu de la grande calèche qui l’y conduisait ordinairement, un joli coupé attelé d’un beau cheval bai brun.
« C’est un présent de vous à votre mère, dit le comte brusquement. Elle ne peut pas aller à pied ; il lui fallait une voiture. Will, l’homme qui vous conduit, en aura soin, et sera à ses ordres ; mais souvenez-vous que c’est vous qui lui donnez cette voiture. »
La joie de Fautleroy put à peine s’exprimer, et ce fut par des paroles entrecoupées qu’il remercia son grand-père. Ce présent mettait le comble à toutes les attentions qu’il avait pour lui et pour sa mère. Pourquoi donc semblait-il ne pas consentir à voir Chérie, quand il s’occupait sans cesse à lui être agréable ?
Il eut grand’peine à contenir ses sentiments jusqu’à ce qu’il fût arrivé à la Loge. Sa mère cueillait des roses dans le jardin au moment où la voiture s’arrêta devant la porte. Il s’élança du marchepied, et courant à elle :
« Chérie ! cria-t-il, pourrez-vous le croire ! Ce coupé est pour vous. Il a dit que c’était moi qui vous en faisais cadeau. Il est à vous, pour vous promener partout où vous voudrez. »
Il était si heureux qu’il ne savait ce qu’il disait. Mme Errol ne pouvait gâter le plaisir de son fils en refusant ce don, quoiqu’il lui vînt d’une personne qui la regardait comme son ennemie. Elle fut obligée de monter dans la voiture, avec les roses qu’elle portait dans sa jupe, et de consentir à faire une promenade. Pendant que la voiture roulait, l’enfant l’entretenait de la bonté, de la générosité de son grand-père. Ces récits dénotaient une âme à la fois si innocente, si pure et si tendre, une si sainte ignorance de tout ce qui était intérêt ou calcul, que, par moments, Mme Errol ne pouvait s’empêcher de sourire. En même temps elle attirait son petit garçon plus près d’elle encore, le baisait, heureuse de penser qu’il ne savait voir que du bien autour de lui, même chez le vieillard au cœur dur qui n’avait pas su se faire un ami.
XXI
Un jour Cédric voulut absolument descendre de son cheval, près de l’école du village, pour y faire monter un pauvre garçon boiteux, John Hartle, et le reconduire chez lui.
« Il n’a jamais consenti à entendre raison, dit Wilkins, racontant cet incident à ses camarades. Je lui proposai de donner mon cheval à Hartle, puisque Sa Seigneurie ne voulait pas absolument qu’il allât à pied ; mais il me répondit que mon cheval était trop grand, que John ne saurait pas s’y tenir, que le sien conviendrait beaucoup mieux. Et mylord descendit, et il se mit à marcher d’un pas délibéré à côté du cheval où j’avais fait monter l’infirme, ses mains dans ses poches, son béret en arrière, ses cheveux au vent. Tout en marchant, il sifflait ou causait avec Hartle.
« Quand nous arrivâmes à la maisonnette de sa mère, celle-ci sortit avec toutes sortes de révérences, ne sachant ce qui arrivait. Il lui fit un grand salut, comme il aurait fait à une lady, et il lui dit : « Bonjour, madame ; je vous ai ramené votre fils, parce que sa jambe lui faisait du mal ; je pense qu’un bâton n’est pas suffisant pour l’aider à marcher, et je vais demander à mon grand-père de lui faire faire une paire de béquilles. » Vous pensez si la bonne femme était surprise. Les bras lui en sont tombés. »
Quand le comte entendit ce rapport de la bouche de Wilkins, il ne montra pas de colère, comme le domestique l’avait craint d’abord : il se mit à rire au contraire, et, appelant Cédric, il lui fit faire le récit de l’aventure, ce qui provoqua de nouveau son hilarité.
Quelques jours après, la voiture du comte s’arrêtait devant la demeure de la veuve Hartle. Fautleroy s’élançait dehors et s’avançait vers l’entrée, portant sur l’épaule, à la manière d’un fusil, une paire de béquilles à la fois fortes et légères.
« Mon grand-père vous envoie ses compliments, madame Hartle, dit-il à la mère du jeune infirme ; ces béquilles sont pour votre fils ; mon grand-père et moi nous espérons qu’il s’en trouvera bien.
« J’ai fait vos compliments, dit-il en revenant vers la voiture, où le comte l’attendait : vous ne me l’aviez pas dit, mais j’ai pensé que vous aviez pu l’oublier. Ai-je bien fait ? »
Sa Seigneurie répondit en riant de nouveau.
C’est peu de jours après cette promenade que Cédric écrivit à M. Hobbes. Il fit d’abord un brouillon, qu’il porta à son grand-père en le priant de l’examiner.
« Je dois avoir fait beaucoup de fautes d’orthographe, dit-il, et si vous vouliez bien me les corriger, je recopierais ma lettre ensuite. »
Cette lettre contenait, en effet, bon nombre d’accrocs à la

grammaire, que le comte fit disparaître. Nous ferons de
même. Elle était ainsi conçue :
« Il faut que je vous parle de mon grand-père : c’est le meilleur comte que vous ayez jamais vu. Je vous assure que vous vous étiez trompé en vous imaginant que les comtes étaient des tyrans ; ce n’est pas un tyran du tout. Je voudrais que vous le connussiez : vous seriez tout de suite bons amis, j’en suis sûr. Il a la goutte au pied et il souffre beaucoup ; mais il est si patient ! Je l’aime tous les jours davantage, et personne ne pourrait s’empêcher d’aimer un homme comme lui, qui est bon pour tout le monde et qui s’oublie toujours pour les autres. Je serais content si vous pouviez causer avec lui : il sait tout, et on peut lui demander tout ce qu’on veut. Il m’a donné un poney, et à ma maman une belle voiture. J’ai trois chambres, pleines de livres et de joujoux. Le château est très grand ; vous vous y perdriez. Wilkins m’a dit (Wilkins est mon groom) qu’il y a des cachots dans les caves. Le parc vous semblerait bien beau. Il y a de très gros arbres, et puis des chevreuils, des lapins, toutes sortes de bêtes. Mon grand-père est très riche, mais il n’est ni dur ni orgueilleux, comme vous croyiez qu’étaient les comtes. J’aime à me promener avec lui ; les gens d’ici sont si polis ; ils vous tirent toujours leur chapeau, les femmes vous font la révérence et quelquefois elles disent : Dieu vous bénisse ! Je sais monter à cheval maintenant, mais d’abord cela me secouait beaucoup quand je trottais. Mon grand-père a un fermier qui ne pouvait pas le payer ; mais il l’a laissé dans sa ferme, et Mme Millon, c’est la femme de charge, va lui porter du vin et des médicaments pour ses enfants malades. Je serais bien aise de vous voir. J’aimerais bien aussi que Chérie pût vivre au château avec nous, mais il paraît que cela ne se peut pas. Je vous en prie, écrivez-moi.
« P.-S. La prison dont je vous parlais tout à l’heure est vide, et mon grand-père n’y a jamais enfermé personne.
« P.-S. Il est si bon qu’il me rappelle vous tout à fait. Tout le monde l’aime. »
« Votre mère vous manque donc beaucoup ? dit le comte quand il eut terminé cette lecture.
— Oui, dit l’enfant ; j’y pense toujours. »
Il se rapprocha du comte, et posant sa main sur son genou :
« Et vous, dit-il, est-ce qu’elle ne vous manque pas ?
— Je ne la connais pas, répliqua Sa Seigneurie brusquement.
— Je le sais, dit Fautleroy, et c’est ce qui m’étonne. Elle m’a dit de ne pas vous faire de questions… et je ne veux pas en faire ; seulement, quelquefois, je ne peux pas m’empêcher d’y penser, et alors cela me tracasse. Mais je ne veux pas vous faire de questions, maman me l’a défendu. Le soir, avant de me coucher, je vais à la fenêtre de ma chambre. Il y a une place entre les arbres où je vois briller une petite lumière : c’est la sienne. Elle la met là, aussitôt qu’il fait nuit, de manière que je puisse la voir scintiller, et quoiqu’elle soit bien éloignée, j’entends ce qu’elle me dit.
— Que vous dit-elle ? demanda le comte.
— Elle me dit : « Dors bien, mon cher enfant ; que Dieu te garde toute la nuit. » C’est ce qu’elle me disait tous les soirs quand nous étions ensemble. Tous les matins, elle me disait ; « Que Dieu te garde tout le jour. » Aussi, comme vous voyez, je suis toujours en sûreté, et il ne m’arrive jamais rien de fâcheux ; c’est pour cela !
— Ce doit être pour cela, en effet, » dit Sa Seigneurie sèchement.
Il rapprocha ses épais sourcils et regarda lord Fautleroy si fixement et si longuement, que l’enfant se demanda à quoi son grand-père pouvait bien penser.
XXII
Le fait est que le comte de Dorincourt pensait alors à beaucoup de choses qui ne lui étaient jamais entrées dans l’esprit jusque-là, et toutes ses méditations se rapportaient, d’une manière ou d’une autre, à son petit-fils. L’orgueil était son sentiment dominant, et Cédric le satisfaisait de tout point. Cet orgueil lui faisait trouver un nouvel intérêt dans la vie ; il commençait à prendre de plus en plus de plaisir à montrer son petit-fils. Le monde avait connu le désappointement que ses enfants lui avaient fait éprouver, et c’était un triomphe pour lui de pouvoir lui présenter, comme héritier, un enfant tel que le nouveau lord Fautleroy. Il faisait des plans pour l’avenir. Quelquefois, dans le secret de son âme, il se prenait à regretter que sa vie n’eût pas été meilleure, et qu’il n’y eût pas en elle moins de choses blâmables : de ces choses qui auraient blessé le cœur pur et simple de son petit-fils s’il avait connu la vérité. Ce n’était pas agréable pour lui de se demander comment le regarderait cet enfant, si le hasard voulait qu’il apprît un jour que son grand-père, pendant bien des années, avait été appelé « le méchant comte de Dorincourt ». Cette pensée faisait courir en lui un léger tressaillement. Quelquefois, dans ces préoccupations, il oubliait sa goutte, et, au bout d’un certain temps, son docteur fut surpris de trouver que la santé de son noble malade s’améliorait plus qu’il ne s’y serait jamais attendu. Peut-être en était-il ainsi parce que le temps ne se traînait plus si lentement pour lui, et qu’il avait autre chose à penser qu’à ses souffrances et à ses infirmités.
Un beau matin, les gens du village furent étonnés de voir le petit lord chevaucher à côté d’un cavalier qui n’était pas son compagnon habituel. Ce cavalier montait un grand et fort cheval gris, et n’était autre que le comte lui-même. Au moment où Cédric allait enfourcher son poney pour sa promenade de tous les jours, il avait dit à son grand-père :
« Je regrette bien que vous ne puissiez monter à cheval. Quand je pars, je suis peiné de vous laisser seul dans ce grand château. Si vous pouviez venir avec moi ! »
Quelques instants après, cet ordre du comte : « Qu’on selle Selim ! » mettait les écuries en mouvement : car il y avait bien longtemps que lord Dorincourt n’en avait donné de semblable. Depuis, Selim fut sellé presque chaque jour, et on s’accoutuma à voir le grand cheval gris et la silhouette imposante du comte se montrer à côté du petit poney brun que montait le petit lord.
Dans leurs promenades à travers champs ou le long des jolies routes du comté, les deux cavaliers devinrent de plus en plus intimes. Peu à peu le grand-père apprit beaucoup de choses sur « Chérie » et sur la vie qu’elle menait. Tout en trottant à côté du grand cheval gris, Cédric babillait gaiement. Le plus souvent le comte était silencieux, se contentant d’écouter et de regarder le visage animé et joyeux de son petit interlocuteur. Quelquefois il disait à Cédric de prendre le galop. L’enfant s’élançait droit, ferme et hardi sur sa selle, et le comte le suivait d’un regard plein d’orgueil et de satisfaction. Quand l’enfant revenait, agitant son chapeau avec un rire joyeux, c’est en se disant que son grand-père et lui étaient vraiment très bons amis.
C’est dans ces promenades que le comte découvrit un jour que sa belle-fille ne menait pas une vie oisive, comme il l’avait cru jusqu’ici. Les pauvres la connaissaient bien. Quand la maladie, le chagrin ou la misère s’étaient abattus sur une maison, on était sûr de voir bientôt le joli petit coupé s’arrêter devant la porte.
« Chacun s’écrie : Dieu vous bénisse ! dès qu’on l’aperçoit, dit un jour Cédric à son grand-père. Les enfants aussi sont bien heureux. Elle fait venir quelques petites filles à la Loge pour leur apprendre à coudre ; elle dit que, maintenant qu’elle est riche, sa plus grande joie, c’est d’aider les autres. »
Il n’avait pas déplu à lord Dorincourt d’apprendre que la mère de son héritier était une belle jeune femme, qui avait autant l’air d’une dame que si c’était une duchesse ; il ne lui déplaisait pas non plus de savoir qu’elle était populaire parmi les gens de ses terres et aimée des pauvres. Cependant il éprouvait un serrement de cœur, causé par la jalousie, quand il voyait à quel point elle remplissait le cœur de son enfant, et que son enfant, de son côté, était attaché à elle comme à ce qu’il aimait le mieux au monde. Il aurait désiré être le premier dans les affections de son petit-fils, et n’avoir pas de rival.
Un jour que tous deux se promenaient comme de coutume, ils arrivèrent au sommet d’une colline d’où l’on apercevait une vaste étendue de paysage.
« Savez-vous que toutes ces terres m’appartiennent ? dit le comte, en étendant la main et en décrivant avec sa cravache un large demi-cercle.
— Vraiment ! dit l’enfant. Tout cela à une seule personne !
— Savez-vous aussi qu’un jour elles vous appartiendront ? continua le comte ; celles-là et bien d’autres encore ?
— À moi ! s’écria le petit lord, d’un ton qui peignait plutôt la crainte que la satisfaction.
— À vous.
— Et quand cela ?
— Quand je serai mort, répliqua le vieux lord.
— Oh ! alors, je ne tiens pas du tout à les avoir. J’aime bien mieux que vous viviez toujours.
— Bon ! Il y aura toujours un jour où elles vous appartiendront, un jour où vous serez le comte de Dorincourt. »
Cédric demeura quelques instants silencieux. Il contemplait le vaste paysage, les fermes entourées de champs cultivés, les maisonnettes perdues entre les arbres, les vertes prairies, les landes couvertes de bruyère, le village qui avait un air si tranquille et au-dessus duquel s’élevaient les tourelles du château. Il poussa un léger soupir.
« À quoi pensez-vous ? demanda le grand-père à Cédric.
— Je pense à ce que m’a dit Chérie.
— Que vous a-t-elle dit ?
— Elle m’a dit que ce n’était pas facile d’être riche ; que quelquefois les personnes qui possèdent beaucoup d’argent oublient que les autres ne sont pas si bien partagés, mais qu’on doit toujours se le rappeler. Alors je lui ai parlé de vous ; je lui ai dit que vous ne l’oubliiez jamais, vous ; que vous étiez bien trop bon et trop généreux pour cela. Elle pensait tout à fait comme moi ; et, en parlant des autres personnes riches et qui ne faisaient pas de même que vous, elle disait que c’était bien triste, quand on avait tant de fortune et tant de puissance, qu’on pouvait faire tant de bien et empêcher tant de mal, de ne s’inquiéter que de soi et de sa propre satisfaction. Aussi je réfléchissais, tout à l’heure, en regardant ces maisons, sur le bonheur de combien de personnes j’aurai à veiller quand je serai comte. Combien y en a-t-il qui vivent sur vos terres ? »
La question était embarrassante. Tout ce dont Sa Seigneurie se souciait, touchant ses tenanciers, c’était de savoir ceux qui payaient bien : il louait ses fermes à ceux-ci ; quant aux autres, il les mettait dehors.
« C’est Newick qui s’occupe de cela, grommela-t-il, en tirant sa moustache grise et en regardant le petit garçon d’un air embarrassé.
« Retournons maintenant, ajouta-t-il, et quand vous serez comte à votre tour, soyez un meilleur seigneur que moi, si vous pouvez ! »
Il demeura silencieux pendant que tous deux se dirigeaient vers la maison. Il ne pouvait se rendre compte de ce qui faisait que lui, qui, dans tout le cours de sa vie, n’avait aimé personne, se sentait si vivement attiré vers ce petit garçon. Il avait commencé par être orgueilleux de la beauté et de la grâce de Cédric, du courage que ses actions semblaient dénoter ; mais il y avait plus que de l’orgueil dans ce qu’il éprouvait maintenant. Il ne pouvait s’empêcher de rire de lui-même quand il s’apercevait du plaisir qu’il avait à avoir l’enfant près de lui, à entendre le son de sa voix, et combien, dans le secret de son cœur, il désirait que son petit-fils l’aimât et eût bonne opinion de lui.
« Je suis un vieux fou, se disait-il, et on voit bien que je n’ai rien autre chose à penser ! »
Cependant il savait bien que son affection pour cet enfant ne venait pas du désœuvrement, et, s’il avait voulu aller au fond des choses, il aurait peut-être été obligé de s’avouer à lui-même que ce qui l’attirait si fortement vers son petit-fils c’étaient les qualités qu’il n’avait jamais possédées lui-même : la franchise, la sincérité, la chaleur de cœur, l’affectueuse confiance, qui éclataient sans-cesse dans les discours et dans les actions de Cédric.
XXIII
Environ une semaine après cette promenade, l’enfant, revenant un jour d’une visite à sa mère, entra dans la bibliothèque avec une figure toute soucieuse. Il s’assit sur la chaise à haut dossier sur laquelle il s’était assis le jour de son arrivée, et pendant quelques instants, il resta les yeux fixés sur les cendres du foyer, d’un air pensif, sans rien dire. Le comte le regardait en silence, se demandant ce qui était arrivé. Évidemment le petit lord avait quelque chose dans l’esprit. À la fin, il releva la tête.
« Newick sait-il tout ce qui se passe ici ? demanda-t-il.
— C’est son affaire de le savoir, répliqua le comte. S’est-il montré négligent ? »
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, rien n’était plus agréable au vieux lord que l’intérêt porté par son petit-fils à ses tenanciers. Il ne leur en avait jamais porté lui-même ; mais il était bien aise de voir que les pensées sérieuses se mêlaient dans la tête bouclée de Cédric aux pensées de plaisir et d’amusement qui convenaient à son âge.
« Il y a un endroit, dit L’enfant avec une sorte d’horreur peinte dans les yeux, il y a un endroit, Chérie l’a vu, c’est à l’autre bout du village, un endroit où les maisons sont pressées les unes contre les autres, et si délabrées qu’on croirait qu’elles vont tomber. C’est à peine si on y respire, tant elles sont petites, basses et humides. Les gens qui habitent là sont si pauvres qu’ils ne peuvent acheter rien de ce dont ils ont besoin. Beaucoup ont la fièvre, et les enfants meurent. Oh ! c’est affreux à penser ! Cela doit les rendre méchants de vivre si misérablement ! C’est encore pis que Michel et Brigitte. La pluie passe par le toit ! Chérie est allée visiter une pauvre femme qui vit dans une de ces maisons… Oh ! elle pleurait, cette pauvre Chérie, en me racontant tout ce qu’elle avait vu ! »
Des perles humides brillaient dans les yeux du petit lord lui-même, comme il faisait ce récit. Il les essuya vivement, sauta de sa chaise, et, venant s’appuyer sur le fauteuil du comte en posant une main sur son genou :
« Je lui ai dit, continua-t-il en souriant à travers ses larmes, que vous ne saviez rien de tout cela et que je vous en parlerais ; que bien sûr vous feriez comme vous aviez fait à propos de Hugues ; que Newick devait avoir oublié de vous en prévenir. »
Le comte regarda la petite main posée sur son genou. Newick n’avait pas oublié de le prévenir, et plus d’une fois son homme d’affaires l’avait entretenu du misérable état dans lequel se trouvait la partie du village connue sous le nom de l’Impasse. Il savait que les maisons menaçaient ruine ; que les fenêtres, les toits, tenaient à peine ; que l’eau coulait le long des murs ; que la maladie et la pauvreté les habitaient. M. Mordaunt aussi lui avait peint toutes ces choses sous les couleurs les plus fortes qu’il avait pu trouver, et Sa Seigneurie avait repoussé avec violence toute idée d’apporter la moindre atténuation à ces misères. Cependant, en regardant la petite main posée sur son genou, et en remontant de la petite main à l’honnête et anxieuse petite figure qui se penchait vers lui, il se sentit un peu honteux de lui-même et de l’Impasse de Dorincourt.
« Voudriez-vous faire de moi un entrepreneur de chaumières modèles ? dit-il.
— Il faut absolument, Chérie l’a dit, que ces maisons soient jetées par terre, répliqua énergiquement le petit lord ; elles sont tellement délabrées qu’il serait impossible de les réparer : il le faut absolument. Venez les voir, ajouta-t-il, ses yeux brillant comme des étoiles et son visage animé par l’émotion, venez les voir et faites-les démolir tout de suite. Venez ; vos paysans seront si heureux de penser que vous vous intéressez à eux ! Ils vous seront si reconnaissants de les aider ! »
Le comte se leva et posa la main sur l’épaule de son petit-fils.
« Allons faire un tour sur la terrasse, dit-il, avec le rire sarcastique qui lui était habituel ; nous causerons de cela. »
Et quoique ce rire s’échappât encore deux ou trois fois de ses lèvres, pendant qu’il faisait, comme de coutume, sa promenade du soir sur la terrasse, appuyé sur l’épaule de son petit compagnon, il semblait occupé de pensées qui ne lui étaient pas désagréables.
La vérité était que Mme Errol avait fait beaucoup de tristes découvertes dans le cours de ses visites au village, qui paraissait si pittoresque, vu du haut de la colline, — Les choses ne sont pas si pittoresques vues de près que vues à distance. — Elle avait trouvé paresse, pauvreté et ignorance où il y aurait dû avoir confort et industrie, et elle avait été forcée de reconnaître que Dorincourt était le plus misérable village de toute cette partie de la contrée. M. Mordaunt lui avait fait part de toutes les difficultés qu’il avait rencontrées et de ses découragements. Elle avait trouvé elle-même beaucoup d’obstacles au bien qu’elle voulait faire. Les agents qui régissaient les propriétés avaient toujours été choisis pour plaire au comte, et ne s’étaient jamais occupés de la dégradation physique et morale où étaient descendus les malheureux tenanciers de leur maître. Les choses étaient allées ainsi de mal en pis, et arrivées à un point où on ne pouvait plus y remédier que par des mesures tout à fait radicales.
L’Impasse, principalement, avec ses maisons à demi ruinées et ses habitants négligents, insouciants et maladifs, présentait le spectacle le plus lamentable. Quand Mme Errol s’y rendit pour la première fois, elle ne put s’empêcher de frémir. En voyant les enfants déguenillés, presque abandonnés par des parents adonnés au vice et à la paresse, elle les comparait, dans son esprit, à son propre petit garçon, élevé par elle avec tant de soin, et qui vivait maintenant dans un magnifique château, gardé et servi comme un jeune prince, ne pouvant former un désir qui ne fût satisfait et ne connaissant rien que le luxe, la joie et le bonheur ; alors une pensée naquit dans ce cœur généreux. Plusieurs fois elle s’était dit qu’il avait été très heureux pour lui que Cédric plût à son grand-père : elle se disait maintenant qu’il pouvait aussi en résulter du bien pour les autres.
« Le comte ne peut rien lui refuser, dit-elle à M. Mordaunt, en lui développant son plan ; il lui accorde tout ce qu’il lui demande. Pourquoi ce bon vouloir ne serait-il pas employé en faveur de ces pauvres gens ? C’est à moi de faire mon possible pour qu’il en soit ainsi. »
Elle savait qu’elle pouvait se confier au cœur tendre de Cédric. Elle lui raconta tout ce qu’elle avait vu à l’Impasse, sûre qu’il en parlerait à son grand-père, et dans l’espérance qu’à sa prière le comte consentirait à améliorer le sort des malheureux qui étaient dans sa dépendance.
Quelque étrange que cela pût paraître à tout le monde, les choses tournèrent comme elle l’avait arrangé dans sa tête, et, une fois de plus, l’influence de Cédric sur le comte se fit sentir et se manifesta par un heureux résultat. Le secret de cette influence était toujours cette confiance de l’enfant dans son grand-père, qui lui faisait voir en lui un homme juste, humain et généreux. Le comte ne pouvait se décider à laisser soupçonner à son petit-fils qu’il n’avait nulle inclination à la générosité et qu’il se souciait fort peu de savoir s’il avait tort ou raison quand ses intérêts étaient en jeu. C’était une telle nouveauté pour lui d’être regardé avec tendresse et admiration par des yeux d’enfant ; d’être considéré comme un des bienfaiteurs de l’humanité, le type par excellence de la noblesse, qu’il ne trouvait pas la moindre satisfaction à se dire lui-même : « Je ne suis qu’un vieux misérable, méchant et égoïste, qui n’ai jamais eu une idée généreuse dans ma vie, qui me soucie des gens de l’Impasse ou de leurs semblables comme d’une guigne. » Il commençait à penser qu’à part la joie qu’il trouverait à faire plaisir à son petit-fils, il ne lui serait pas désagréable, de temps en temps, de faire une bonne action. Aussi, tout en riant intérieurement de lui-même, il fit venir Newick, et, après une longue entrevue avec lui, il donna des ordres pour que les masures de l’Impasse fussent jetées par terre et que de nouvelles maisons fussent bâties.
« C’est lord Fautleroy qui insiste pour cela, dit-il sèchement ; il pense que ces réparations donneront de la valeur à la propriété. Vous pouvez dire aux tenanciers que c’est son idée. »
Et il jeta un regard sur Sa petite Seigneurie, qui, étendue sur le tapis du foyer, jouait avec Dougal, et qui certes était, tant par son âge que par sa nature, incapable de calculer les avantages qui pouvaient résulter pour lui des améliorations qu’il demandait. Le grand chien était le constant compagnon de l’enfant et le suivait partout, marchant solennellement derrière lui quand Cédric marchait, ou trottant avec majesté à côté du cheval ou de la voiture quand il se promenait dehors.
Naturellement, tant dans la campagne que dans la petite ville voisine, on entendit parler des changements projetés. D’abord beaucoup de personnes ne voulurent pas y croire ; mais quand on vit une armée d’ouvriers arriver à Dorincourt et démolir les misérables et sordides baraques de l’Impasse, on commença à reconnaître que c’était la vérité, et on devina que c’était à la généreuse intervention du petit lord qu’on devait ce nouveau bienfait. Si Cédric avait su comme on parlait de lui dans les chaumières, quelles bénédictions on répandait sur son nom, et quelles prophéties on faisait pour le jour où il serait homme, il eût été bien étonné ; mais il ne s’en doutait pas. Il vivait de sa simple, heureuse et naïve vie d’enfant, s’amusant dans le parc, poursuivant les lapins, s’étendant sur le gazon à l’ombre des grands arbres ou sur le tapis de la bibliothèque avec un livre ; parlant au comte de ses lectures et les racontant de nouveau à sa mère ; écrivant de longues lettres à Dick ou à M. Hobbes, qui répondaient chacun à leur mode ; se promenant, tantôt en voiture, tantôt à cheval, en compagnie soit du comte soit de Wilkins. Quand il traversait la place du marché ou quand il rencontrait un paysan, il s’apercevait bien que tous les chapeaux se soulevaient et que les figures prenaient une expression joyeuse ; mais il pensait que c’était parce que son grand-père était avec lui.
« Ils vous aiment tant ! dit-il une fois, en levant vers le comte son doux visage, illuminé d’un brillant sourire. Avez-vous remarqué comme ils sont heureux de vous voir ? J’espère qu’un jour ils m’aimeront aussi. Ce doit être bon que tout le monde vous aime. »
Et il se sentait tout heureux d’être le petit-fils d’un homme si aimé et si admiré.
Quand on commença à bâtir les maisonnettes, le comte et son petit-fils dirigèrent souvent leur promenade du côté de l’Impasse, pour voir où en étaient les travaux. Cédric les suivait avec le plus vif intérêt. Il descendait de cheval pour aller faire connaissance avec les ouvriers et leur poser des questions au sujet de ce qu’ils faisaient, comparant la manière dont ils s’y prenaient avec ce qu’il avait vu faire en Amérique. Il rendait ensuite compte à son grand-père de ses remarques, tandis qu’il retournait au château.
« j’ai toujours aimé à savoir comment se font les choses, disait-il au comte, car on ne sait jamais ce qu’on deviendra plus tard. »
Quand il était parti, les ouvriers souriaient entre eux de ses observations et de ses discours, mais leurs sourires n’avaient rien de moqueur. Ils l’aimaient ; ils aimaient à le voir arriver, à l’entendre parler, à le regarder se camper devant eux, les mains dans ses poches, son chapeau rejeté en arrière, et suivre tous leurs mouvements avec un sérieux plein d’intérêt. « C’est un garçon comme on n’en voit guère, disaient-ils ; et hardi, et pas fier avec le pauvre monde. Il n’y a rien de la vieille souche en lui. » Rentrés chez eux, ils parlaient du petit lord à leurs femmes, et les femmes en parlaient entre elles, de manière que Cédric était le sujet de toutes les conversations et que chacun avait une anecdote à raconter sur lui. À la fin, tout le monde avait reconnu que le « méchant comte », comme on l’appelait, avait enfin trouvé quelqu’un qui l’intéressait, et que son cœur, vieux, dur et insensible, avait fini par être touché et échauffé.
Mais personne ne pouvait savoir jusqu’à quel point le changement s’était produit, et comment, de jour en jour, l’intérêt du vieillard augmentait pour cet enfant, la seule créature qui se fût jamais confiée à lui. Il aspirait au temps où Cédric serait un jeune homme fort et beau, avec toute la vie ouverte devant lui, ayant conservé son cœur affectueux et le pouvoir de se faire des amis de tous ceux qui l’approchaient. Souvent, tandis qu’il contemplait le petit garçon, allongé sur le tapis et lisant quelque gros livre, avec la lumière tombant sur sa tête blonde, une faible lueur brillait dans ses yeux, et une légère rougeur montait à ses joues.

« Cet enfant peut faire tout ce qu’il voudra, » disait-il.
Il ne s’ouvrait jamais à personne de ses sentiments pour Cédric. Quand il en parlait, c’était toujours avec son sourire sarcastique ; mais il aimait à l’avoir avec lui : près de son fauteuil dans la bibliothèque ; en face de lui à table ; à côté de lui quand il sortait à cheval ou en voiture, ou bien quand il faisait sa promenade du soir sur la terrasse.
« Vous rappelez-vous, lui dit un jour Cédric, en levant les yeux de son livre, ce que je vous ai dit le premier soir que nous nous sommes vus, que nous serions bons camarades ? Je pense que personne ne saurait être meilleurs camarades que nous le sommes.
— Nous sommes très bons camarades en effet, dit le comte. Venez ici. »
Cédric, qui était allongé sur le tapis (c’était sa pose favorite), se dressa sur ses pieds et se tint debout près de son grand-père.
« Y a-t-il quelque chose dont vous ayez besoin ? interrogea le comte, quelque chose qui vous manque, que vous désiriez avoir ? »
Les yeux bruns du petit garçon se fixèrent sur ceux de son grand-père avec un regard plein d’anxiété et de désir.
« Seulement une chose, répondit-il.
— Laquelle ? » demanda le vieux lord.
Fautleroy resta quelques instants silencieux.
« Laquelle ? répéta le comte.
— C’est Chérie, » dit-il.
Le comte fit une légère grimace.
« Vous la voyez presque chaque jour, dit-il ; n’est-ce pas assez ?
— J’étais habitué à la voir toujours, dit le petit lord. Elle avait coutume de m’embrasser tous les soirs, quand j’allais me coucher, et le matin elle m’embrassait encore ; nous pouvions nous dire mutuellement ce que nous voulions, sans avoir besoin d’attendre. »
Les yeux du vieux comte et ceux de son jeune héritier se rencontrèrent, et tous deux demeurèrent quelques instants silencieux. Alors le comte, fronçant ses gros sourcils grisonnants :
« N’oublierez-vous donc jamais votre mère ?
— Jamais ! répliqua l’enfant, jamais ! et elle jamais ne m’oubliera non plus. Je ne vous oublierais jamais vous-même, si je ne demeurais plus avec vous, et au contraire j’y penserais d’autant plus que j’en serais séparé.
— Sur ma parole ! s’écria le comte, après l’avoir regardé quelques instants encore, je crois que vous le feriez ! »
La douleur que la jalousie faisait éprouver au comte toutes les fois que l’enfant parlait de sa mère, semblait plus forte chaque jour, et elle augmentait en effet à mesure que croissait l’affection du vieillard pour l’enfant.
Mais il survint bientôt des événements qui lui firent oublier, pour quelque temps du moins, les mauvais sentiments qu’il avait toujours entretenus contre sa belle-fille, et ils arrivèrent d’un étrange manière.
XXIV
Un soir, peu de temps avant que les travaux de l’Impasse fussent terminés, il y eut un grand dîner à Dorincourt. Il n’y avait pas eu de réception au château depuis longtemps ; mais sir Harry Lorridale et lady Lorridale, sœur unique du comte, étaient venus passer quelques jours chez lui. Cet événement causa une grande émotion dans le village et fit tinter plus que jamais la sonnette du petit magasin de miss Diblet. Il y avait de quoi être étonné en effet, car lady Lorridale n’avait pas mis les pieds au château depuis son mariage, c’est-à-dire depuis trente-cinq ans environ. C’était une dame imposante, avec de beaux cheveux blancs et des joues à fossettes, aussi fraîches que des pêches, en dépit de son âge. Elle était aussi bonne que belle et n’avait jamais approuvé la conduite de son frère. Comme elle avait un caractère résolu, elle lui avait dit plusieurs fois franchement sa manière de penser, si bien qu’après des querelles assez animées avec Sa Seigneurie, voyant qu’elle n’obtiendrait rien, elle avait renoncé à le voir, et ils étaient demeurés étrangers l’un à l’autre depuis de longues années.
Ce que lady Lorridale avait appris sur son frère pendant cette période n’était pas de nature à lui faire désirer un rapprochement. Elle savait combien il avait été dur pour sa femme et indifférent pour ses enfants.
Quoiqu’elle n’eût jamais vu les deux fils aînés, la rumeur publique lui avait appris qu’ils étaient dénués de toute qualité bonne, utile ou aimable ; mais une fois était arrivé au château de Lorridale un beau jeune homme de dix-huit ans, qui lui dit qu’il était son neveu, Cédric Errol, et que, passant près de son habitation, il avait voulu venir voir sa tante Constance, dont il avait souvent entendu parler à sa mère bien-aimée. Le cœur de la bonne lady Lorridale fut remué de fond en comble à la vue de ce beau garçon ; elle le fit rester avec elle une semaine, le gâta, le choya et l’admira. Il avait un caractère si aimable, un cœur si affectueux, un esprit si ouvert, qu’elle conçut pour lui une vive affection, et, en le quittant, elle exprima l’espoir de le revoir bientôt ; mais cet espoir ne se réalisa pas : le comte, fort mécontent que son fils fût allé voir sa tante, lui défendit d’y retourner de nouveau. Mais lady Lorridale s’était toujours souvenue tendrement de lui, et quoiqu’elle craignît qu’il eût fait un mariage dégradant en Amérique, elle était entrée dans une grande colère contre son frère quand elle apprit qu’il avait renié ce fils, et que personne ne savait ni où ni comment il vivait. Peu après vint la rumeur de sa mort ; puis la nouvelle de celle de ses deux frères aînés ; puis enfin elle entendit parler du petit Américain amené au château de Dorincourt, pour porter le titre de lord Fautleroy.
« Probablement pour y être aussi mal élevé que les autres, dit-elle à son mari ; à moins que sa mère ne soit assez capable et n’ait une volonté assez ferme pour contre-balancer l’effet de la mauvaise éducation qu’il va recevoir. »
Mais quand elle entendit dire que la mère de Cédric avait été séparée de lui, elle ne trouva pas de paroles pour peindre son indignation.
« C’est trop fort ! s’écria-t-elle. Avoir la pensée de séparer un enfant de cet âge de sa mère et d’en faire le compagnon d’un homme comme le comte ! Mon frère le traitera avec brutalité, ou bien alors il sera avec lui d’une déplorable faiblesse. Il en fera un monstre. Si je pensais que cela pût être de quelque utilité, je lui écrirais.
— Cela ne servira à rien, dit sir Harry.
— C’est vrai ; je connais trop bien le comte de Dorincourt, mon très honoré frère, pour ne pas savoir que ce que je pourrais dire sera en pure perte ; mais c’est révoltant ! »
Lady Lorridale n’était pas seule à avoir entendu parler du petit lord Fautleroy. Dans les châteaux des environs de Dorincourt, aussi bien que dans les fermes et les maisons du village, il courait beaucoup d’histoires sur lui, sur sa beauté, sur son amabilité, sur l’affection qu’il inspirait à tous ceux qui l’approchaient, sur l’influence croissante qu’il prenait sur son grand-père. Il était devenu le sujet des conversations : les dames plaignaient la pauvre jeune mère séparée de son enfant, et les hommes, qui connaissaient le comte et sa dureté d’âme, riaient de tout leur cœur en entendant parler de la confiance du petit garçon dans les bons sentiments de son grand-père. Sir Thomas, un propriétaire des environs, traversant un jour le village de Dorincourt, avait rencontré le vieux lord et son petit-fils chevauchant ensemble. Il s’était arrêté pour échanger une poignée de main avec le comte et pour le féliciter de l’amélioration de sa santé : la goutte paraissait l’avoir abandonné pour l’instant.
« Il semblait aussi orgueilleux qu’un roi, dit sir Thomas, en parlant de cette rencontre, et, sur ma parole, je ne m’en étonne pas : car je n’ai jamais vu un plus bel enfant que son petit-fils. Droit comme une flèche et se tenant sur son poney comme un vieux cavalier. »
Ces bruits arrivèrent jusqu’à lady Lorridale. Elle entendit aussi parler de Hugues, de l’enfant boiteux, des maisonnettes de l’Impasse, d’une vingtaine d’autres incidents, et commença à désirer vivement de voir le petit garçon. Juste comme elle se demandait comment elle parviendrait à réaliser son désir, elle reçut, à son grand étonnement, une lettre de son frère, l’invitant, ainsi que son mari, à aller passer quelque temps à Dorincourt.
« C’est inimaginable ! s’écria-t-elle. On prétend que cet enfant fait des miracles ; je commence à le croire. Mon frère, dit-on, l’adore ; il peut à peine s’en séparer et il est orgueilleux de lui. Sans doute il éprouve le besoin de nous le montrer. »
Elle accepta l’invitation.
Quand elle arriva à Dorincourt avec sir Harry, il était tard dans l’après-midi, et elle se rendit à l’appartement qui lui était destiné avant d’avoir vu son frère. S’étant habillée pour le dîner, elle descendit au salon. Le comte était debout près du feu. À côté de lui se tenait un petit garçon habillé de velours noir, avec un col de dentelle à la Van Dyck : un petit garçon si beau, et qui tourna vers elle des yeux bruns si doux et si candides, qu’elle ne put retenir une exclamation de surprise et de joie.
« Quoi ! Édouard, dit-elle en échangeant des poignées de main avec le comte, est-ce là l’enfant dont on m’a parlé ?
— Oui, Constance, c’est lui, répliqua le comte. — Lord Fautleroy, continua-t-il, voici votre grand’tante lady Lorridale.
— Comment vous portez-vous, ma tante ? » dit Cédric en avançant sa petite main.
Lady Lorridale posa la sienne sur l’épaule de l’enfant, regarda pendant quelques secondes l’aimable visage qui se levait vers elle, puis elle l’embrassa chaudement.
« Je suis votre tante Constance, dit-elle ; j’ai beaucoup aimé votre cher papa, et vous lui ressemblez tout à fait.
— Cela me rend heureux quand on dit que je lui ressemble, dit Cédric : car tout le monde l’a aimé, je crois, presque autant que Chérie. Oui, j’en suis très heureux… tante Constance. »
Il ajouta les deux derniers mots après un instant d’hésitation.
Lady Lorridale était dans le ravissement.
Elle se pencha vers lui, l’embrassa de nouveau, et, de ce moment, ils furent amis.
« Il n’est pas possible d’être mieux, dit-elle quelques instants après à son frère ; c’est le plus charmant enfant que j’aie jamais vu.
— En effet, répondit sèchement le comte, c’est un assez beau garçon. Nous sommes très bien ensemble, ajouta-t-il. Il croit que je suis le meilleur et le plus tendre des philanthropes, et je vous confesserai, Constance, ce que vous découvririez sans doute vous-même si je ne vous le disais pas, que je suis en train de devenir fou de lui.
— Qu’est-ce que sa mère pense de vous ? demanda lady Lorridale, suivant sa manière habituelle d’aller droit au but.
— Je ne le lui ai pas demandé, répondit le comte brusquement.
— Eh bien ! je serai franche avec vous, Édouard, et je vous dirai tout de suite que je n’approuve pas votre conduite ; que c’est mon intention d’aller faire visite à Mme Errol et de la voir le plus souvent possible. Tout ce que j’ai entendu dire de cette pauvre jeune femme me fait supposer que son enfant lui est redevable de la plupart de ses qualités. Le bruit est venu jusqu’à Lorridale que vos pauvres tenanciers l’adorent.
— C’est lui qu’ils adorent, répliqua le comte, désignant du geste le petit lord. Quant à Mme Errol, vous pouvez la voir si le cœur vous en dit. Vous trouverez une assez jolie femme, et je reconnais lui avoir quelque obligation pour avoir donné un peu de sa beauté à son enfant. Je vous le répète, vous pouvez aller la voir ; tout ce que je désire, c’est qu’elle ne mette pas les pieds ici et que vous ne me demandiez pas d’aller chez elle. »
« Quoiqu’il se soit exprimé sur le compte de sa belle-fille d’un ton bourru, dit lady Lorridale à son mari, en lui rapportant cette conversation, je me suis bien aperçue qu’il ne la haïssait plus autant. Il est certainement changé au moral depuis que je ne l’ai vu, et, tout incroyable que cela puisse paraître à ceux qui l’ont connu autrefois, il est en train de s’humaniser. C’est l’affection qu’il éprouve pour ce petit garçon qui a produit ce miracle. Avez-vous remarqué comme cet enfant l’aime, avec quelle confiance il se penche sur son fauteuil et s’appuie sur son genou ? Ses propres enfants auraient autant aimé s’approcher de lui que d’un tigre. »
Le jour suivant, lady Lorridale alla faire visite à Mme Errol.
« Édouard, dit-elle à son frère en revenant, c’est la plus aimable petite femme que j’aie jamais vue. Elle a une voix qui est une musique, et vous pouvez lui être reconnaissant pour avoir fait cet enfant ce qu’il est. Elle lui a donné plus que sa beauté ; elle lui a donné son cœur et son âme, et vous avez grand tort de ne pas la persuader de venir habiter avec vous. Je l’inviterai certainement à Lorridale.
— Elle ne voudra pas quitter son enfant, dit le comte.
— Eh bien ! j’aurai l’enfant aussi, » dit lady Lorridale en riant.
Mais elle savait bien que son frère ne voudrait pas se séparer de Cédric, et chaque jour elle voyait plus clairement jusqu’à quel point le grand-père et le petit-fils étaient attachés l’un à l’autre : comment toute l’ambition, et l’espoir, et l’affection du vieux lord se concentraient sur l’enfant, et comment la tendre et innocente nature de celui-ci lui retournait cette affection avec confiance et bonne foi.
XXV
Le comte annonça à sa sœur qu’il voulait profiter de sa présence chez lui pour réunir dans un grand dîner toute la noblesse des environs ; mais lady Lorridale ne fut pas dupe des paroles de son frère. Ce n’était pas pour lui faire honneur que lord Dorincourt voulait donner une fête, ou du moins cette considération ne passait qu’en seconde ligne. La première et principale raison, c’était le désir de présenter dans le monde son petit-fils, et de montrer que l’enfant dont la rumeur publique s’était tant occupée depuis quelque temps était encore au-dessus de ce qu’on pouvait dire de lui.
« Ses deux aînés ont été une si amère humiliation pour lui ! disait lady Lorridale à son mari. Chacun l’a su. Son orgueil triomphera en plein, maintenant. »
Le comte lança donc ses invitations. Elles furent acceptées avec empressement. Tout le monde était désireux de connaître le jeune lord Fautleroy ; mais on se demandait si on le verrait, les enfants du grand monde n’étant pas ordinairement admis aux réunions de cérémonie.
« Le jeune garçon a de bonnes manières, dit le comte quand la matière fut agitée entre sa sœur et lui, pour la forme seulement : car sa résolution était prise. Les enfants sont ordinairement idiots ou insupportables, — les miens l’étaient tous les deux ; — mais celui-ci sait répondre quand on lui adresse la parole et rester silencieux quand on ne lui parle pas ; on peut donc le garder au salon. »
Le jour du dîner arrivé, il ne fut pas permis à Cédric d’être longtemps silencieux : chacun voulut lui parler, le faire causer. Les dames le caressaient, le questionnaient, le faisaient rire ; les messieurs plaisantaient avec lui. Fautleroy ne comprenait pas toujours très bien pourquoi ils riaient tant quand il leur répondait ; mais il était accoutumé à voir les gens plaisanter quand il était sérieux, et il ne s’en préoccupait pas autrement. Il trouva la soirée délicieuse. Les magnifiques galeries étaient si brillamment éclairées ! il y avait tant de fleurs de tous côtés ! les messieurs avait l’air si gai ! les dames portaient de si belles toilettes ! de si riches bijoux étincelaient dans leurs cheveux et autour de leur cou ! Il y avait parmi elles une jeune femme dont il ne pouvait détacher les yeux. Elle portait une robe blanche et un collier de perles, et Cédric pensa qu’elle ressemblait tout à fait à une princesse de conte de fées.
« Venez ici, lord Fautleroy, dit cette dame en souriant, et dites-moi pourquoi vous me regardez ainsi.
— Je pensais combien vous êtes belle ! » dit Sa petite Seigneurie.
Les messieurs qui étaient présents se mirent à rire, et de
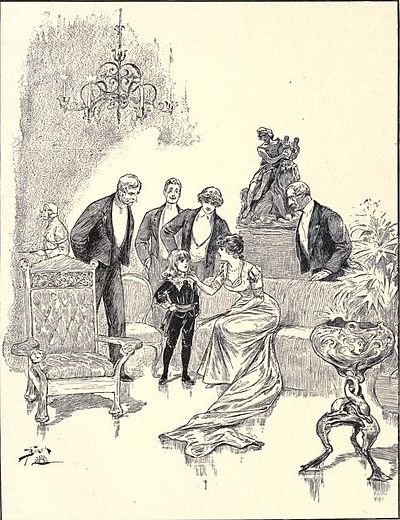
légères couleurs roses montèrent aux joues et au front de la
dame. Attirant l’enfant vers elle, elle l’embrassa.
« Oui, reprit Cédric, je crois que vous êtes la plus jolie dame que j’aie jamais vue, à l’exception de Chérie. Naturellement je ne peux pas penser que quelqu’un soit tout à fait aussi joli que Chérie. Je trouve que c’est la plus jolie personne du monde.
— Je suis sûre qu’elle l’est, » dit la dame, qui s’appelait miss Viviane, en embrassant Cédric de nouveau.
Elle le garda près d’elle une partie de la soirée.
Le groupe qui s’était formé autour d’eux était très gai. Cédric ne sut pas comment cela arriva ; mais au bout de quelques instants c’est lui qui faisait les principaux frais de la conversation. Il parlait de l’Amérique, de la République, de M. Hobbes, de Dick, et il tirait orgueilleusement, pour le montrer, le présent de départ de son ami de New-York, le mouchoir de poche de soie rouge.
« Je l’ai mis dans ma poche ce soir, dit-il, parce que c’était fête ; j’ai pensé que Dick serait content de savoir que j’ai porté son mouchoir dans une soirée. »
Et, tout commun qu’était le mouchoir de soie rouge, c’est d’un air si sérieux et si affectueux que Cédric le déplia, que les rires moqueurs s’arrêtèrent sur les lèvres des assistants, se changeant en sourires de sympathie.
Quoique le petit lord parlât volontiers, ainsi que l’avait remarqué le comte, il n’était jamais importun. Il écoutait avec autant de plaisir qu’il parlait. Un léger sourire se montra sur plus d’un visage quand on le vit, à plusieurs reprises, venir se placer près de son grand-père, le regarder avec affection, en suivant avec le plus vif intérêt chacun des mots qui s’échappaient des lèvres du comte. Une fois même il se pencha tellement vers lui que sa joue toucha l’épaule du vieux lord. Sa Seigneurie, remarquant le sourire des assistants, sourit faiblement elle-même. Cela l’amusait de leur faire observer les sentiments de cordiale amitié qui régnaient entre lui et son petit-fils, si différents des sentiments qu’il excitait généralement ou qu’il éprouvait lui-même.
M. Havisam avait été attendu au château dans l’après-midi ; mais il était tard déjà, et il n’avait pas encore paru. Une pareille chose n’était jamais arrivée depuis ses rapports avec le comte. Ce n’est qu’au moment où on quittait la salle à manger qu’il se présenta. Quoique l’heure fût très avancée, il semblait avoir fait grande hâte, et les traits de sa vieille et sèche figure étaient bouleversés.
« J’ai été retenu, dit-il à voix basse au comte, par un événement… un événement bien… bien inattendu. »
C’était une chose aussi étonnante de voir le vieil homme d’affaires agité que de le voir en retard ; il fallait un événement bien extraordinaire, en effet, pour le troubler ainsi. À plusieurs reprises, il jeta les yeux sur le petit lord avec une expression si bizarre que celui-ci la remarqua et se demanda ce qu’elle signifiait. Lui et M. Havisam étaient dans les meilleurs termes et échangeaient habituellement des sourires ; l’homme de loi semblait avoir complètement oublié ces rapports affectueux.
Par le fait, il avait tout oublié, excepté les étranges et pénibles nouvelles qu’il devait annoncer au comte le soir même ; les étranges nouvelles qui, il le savait, causeraient au vieux lord un coup si terrible, et qui devaient changer de fond en comble la face des choses ! Il promenait ses regards autour de lui, sur les splendides appartements, sur la brillante compagnie qui y était réunie, sur le comte assis dans son fauteuil, sur l’enfant qui souriait à son côté, et il se sentait profondément ému, quoiqu’il ne fût qu’un homme de loi au cœur dur. Quel coup il allait frapper !
Il ne se rendait pas compte bien exactement de ce qui se passait autour de lui ; les choses s’agitaient comme dans un rêve ; plusieurs fois, cependant, il vit le comte l’observer avec surprise, pendant qu’il regardait lord Fautleroy, qui examinait des peintures avec miss Viviane Herbert.
« Je vous suis bien obligé d’avoir été si bonne avec moi, dit Cédric quand il eut fini ; je n’étais jamais allé à un grand dîner ni à une soirée auparavant, et je me suis bien amusé. »
Il s’était fort amusé en effet ; mais c’était la première fois qu’il veillait si tard, et il commençait à s’en apercevoir. Il essaya d’écouter la conversation qui se tenait auprès de lui, entre la belle lady et les jeunes gens qui l’entouraient ; il ne put y parvenir. Ses yeux se fermaient malgré lui. Il fit son possible pour les rouvrir deux ou trois fois ; ses paupières alourdies retombèrent. Sans qu’il en eût conscience, il laissa aller sa tête bouclée sur le coussin qui se trouvait derrière son dos, et, après avoir lutté encore quelque temps contre le sommeil, il fut définitivement vaincu. Il perdit alors complètement la conscience des choses ; il lui sembla seulement sentir un léger baiser sur sa joue et entendre une douce voix qui murmurait : « Bonsoir, petit lord Fautleroy ; bonsoir, dormez bien. »
Il lui sembla même qu’il essayait de répondre : « Bonsoir, bonsoir ; je suis… bien… bien… heureux de vous avoir vue… vous êtes si… si belle ! »
XXVI
Les hôtes de lord Dorincourt n’eurent pas plus tôt quitté le salon que M. Havisam, abandonnant sa place près du feu, s’approcha du sofa. Il regarda quelques instants l’enfant qui y était étendu dans une pose pleine de grâce et de laisser-aller. Une de ses jambes pendait sur le bord, et sa tête reposait sur son bras replié. Les couleurs de la santé, de la quiétude heureuse, brillaient sur le visage du petit garçon, tandis que les ondes brillantes et soyeuses de ses cheveux blonds se répandaient sur les coussins de satin du sofa. Un plus charmant modèle eût été difficilement imaginé par un peintre.
Tout en le considérant, M. Havisam frottait son menton ; l’expression de son visage dénotait l’abattement.
« Eh bien ! Havisam, dit la rude voix du comte derrière lui, qu’y a-t-il ? car il est évident qu’il y a quelque chose. Que se passe-t-il d’extraordinaire, si je peux le savoir ? »
Le vieil homme de loi se retourna, toujours frottant son menton : ce qui était pour lui le signe d’une grande perplexité.
« De mauvaises nouvelles, répliqua-t-il ; de très mauvaises nouvelles, mylord ; des nouvelles tout à fait fâcheuses ! Je regrette bien d’en être le porteur. »
Le comte avait commencé à se sentir fort mal disposé. Il était toujours fort irritable.
« Qu’avez-vous à regarder ce garçon ? dit-il avec colère. Vous l’avez regardé de même toute la soirée… Pourquoi le regardez-vous ainsi ? Vous avez l’air d’un oiseau de mauvais augure ! Qu’ont vos mauvaises nouvelles à faire avec lord Fautleroy ?
— Mylord, dit M. Havisam, je ne perdrai pas de temps en paroles. Mes nouvelles concernent précisément lord Fautleroy, et même, si nous devons y ajouter foi, ce ne serait pas lord Fautleroy qui reposerait sur ce sofa, mais seulement le fils du capitaine Errol. Le véritable lord Fautleroy serait le fils de votre second fils Bévis, le frère aîné du capitaine, et se trouverait pour l’instant, avec sa mère, dans un hôtel à Londres. »
Le comte saisit les deux bras de son fauteuil avec tant de force que les veines de ses mains en saillirent, pendant que celles de son front se gonflaient et qu’une pâleur livide se répandait sur son visage.
« Que voulez-vous dire ? s’écria-t-il. Vous êtes fou ! Qu’est-ce que c’est que ce conte-là ?
— Ce n’est pas un conte, répondit M. Havisam ; c’est, par malheur, la vérité. Une femme est venue à mon cabinet ce matin ; elle m’a dit que votre fils Bévis l’avait épousée, il y a six ans, à Londres, et m’a montré son certificat de mariage. Ils se querellèrent, paraît-il, après une année d’union et se séparèrent. Son fils a sept ans. C’est une Américaine aussi, mais une Américaine appartenant à la dernière classe de la société. Il n’y a que peu de temps, m’a-t-elle dit, qu’elle sait que votre fils aîné est mort, et que, par conséquent, son fils est l’héritier du titre de lord Fautleroy et du domaine de Dorincourt. Elle est allée consulter un homme d’affaires, et elle est disposée à revendiquer les droits de son enfant. »
Il y eut un mouvement sur les coussins où reposait la tête bouclée de Cédric. Un soupir, long et profond, mais qui n’avait rien de pénible, glissa entre ses lèvres entr’ouvertes. Ce n’était pas, semblait-il, celui qui se serait échappé de la poitrine d’un imposteur. Le visage calme, rosé et souriant de l’enfant se retourna légèrement vers le comte, comme pour qu’il pût mieux voir ses traits et l’expression de candeur et de droiture qui les animait comme toujours.
Un sourire amer se répandit sur les lèvres du comte pendant qu’il tenait ses yeux fixés sur son petit-fils.
« Je pourrais me refuser à ajouter foi à ce que vous me rapportez, dit-il, si cette misérable affaire n’était liée au nom de mon fils Bévis. Il a toujours été une honte pour moi ! Cette femme est une personne vulgaire, mal élevée, ignorante, dites-vous ?
— Je suis obligé de convenir que c’est à peine si elle sait signer son nom. Elle est absolument sans éducation et fait tout à fait de cela une affaire d’argent. Elle est assez belle, si l’on veut, mais… »
L’homme de loi s’interrompit avec une sorte de tressaillement.
Les veines du front du comte, gonflées de plus en plus, ressemblaient à des cordes rouges ; on aurait dit qu’elles allaient se briser. Des gouttes de sueur perlaient au-dessous de ses sourcils ; il les essuya avec son mouchoir. L’expression d’amertume peinte sur ses traits avait encore augmenté et était devenue poignante.
« Et j’ai refusé de reconnaître l’autre, la mère de cet enfant ! s’écria-t-il, désignant du geste le petit garçon endormi ; j’ai refusé de la reconnaître pour ma belle-fille ! J’ai refusé de la voir ! Elle sait signer son nom, elle !… C’est mon châtiment ! »
Il se leva de son fauteuil et se mit à marcher de long en large dans la chambre. Des paroles de colère s’échappaient de ses lèvres. Il semblait secoué par ses sentiments intérieurs comme un vieil arbre par la tempête ; il était terrible à voir ; néanmoins M. Havisam remarqua que, quoique la rage semblât chez lui portée à son comble, il contenait les éclats de sa voix de manière à ne pas troubler le sommeil de l’enfant, qui continuait à reposer paisiblement sur le sofa.
Il fit questions sur questions à M. Havisam, au sujet de la femme et des preuves qu’elle pouvait fournir de son mariage avec son fils Bévis, arpentant toujours la chambre et passant tour à tour du blanc au rouge et du rouge au blanc.
Il s’avança lentement vers le sofa, s’arrêta, et regardant de nouveau Cédric :
« Si quelqu’un m’avait dit que je m’attacherais jamais à un enfant, murmura-t-il d’une voix basse et indistincte, je ne l’aurais jamais cru. Je n’ai jamais aimé les enfants, pas plus les miens que ceux des autres ! J’aime celui-là, et il m’aime ! Je ne lui ai jamais fait éprouver de crainte ; il avait confiance en moi ! J’ai toujours été détesté de mes vassaux ; lui avait trouvé le secret de se les attacher ! Il aurait rempli ma place mieux que je ne l’ai remplie moi-même. Il eût été l’honneur du nom !
Il se pencha sur le sofa et resta ainsi une minute ou deux à contempler le doux et gracieux visage de l’enfant endormi. Ses gros sourcils gris étaient rapprochés, mais ses traits avaient perdu leur dureté habituelle. Il écarta doucement les cheveux du front de Cédric comme pour mieux le voir, puis se leva et tira le cordon de la sonnette.
Un laquais parut.
« Prenez lord Fautleroy, dit-il avec une légère altération dans la voix, et portez-le dans sa chambre. »
XXVII
Quand le jeune ami de M. Hobbes quitta New-York pour aller habiter Dorincourt et devenir lord Fautleroy, et que le vieil épicier fut forcé de se dire que l’océan Atlantique s’étendait entre lui et l’enfant qui lui avait fait passer tant d’heures agréables, il se sentit très isolé.
Par le fait, M. Hobbes n’était ni brillant ni spirituel ; il était plutôt lourd d’esprit ; de plus son caractère taciturne ne lui avait jamais donné beaucoup d’amis.
Il ne possédait pas non plus assez de ressources en lui-même pour se désennuyer, et il n’avait jamais eu recours à d’autre divertissement qu’à celui qu’il trouvait dans la lecture des feuilles publiques et dans l’entretien de ses livres de compte.
Il n’était même pas très fort sur le calcul, et tenir ses livres en ordre lui donnait beaucoup de peine. Dans les derniers temps, Cédric, qui commençait à compter très bien, tant sur ses doigts que sur son ardoise, venait à son secours pour faire ses additions. L’enfant, en outre, était un auditeur si patient et si complaisant, il prenait tant d’intérêt à tout ce que disaient les journaux, lui et M. Hobbes avaient eu de si longues conversations sur les événements de la Révolution et sur les élections du dernier président, qu’il n’est pas étonnant que son départ eût laissé un grand vide dans la boutique de l’épicier.
Ce vide ne se fit pas sentir tout de suite ; il ne semblait pas à M. Hobbes que l’enfant fût parti si loin ; il s’imaginait que Cédric allait revenir ; qu’un beau matin, en levant les yeux de dessus son journal, il le verrait dans l’ouverture de la porte, avec son costume blanc et ses bas rouges, son chapeau de paille rejeté en arrière, et qu’il l’entendrait lui crier de sa petite voix joyeuse : « Bonjour, monsieur Hobbes ! Il fait chaud aujourd’hui, n’est-il pas vrai ? »
Mais les jours passaient, et l’apparition ne se montrait pas ; aussi M. Hobbes se sentait de plus en plus triste et isolé. Il ne jouissait même plus autant de ses journaux que par le passé. Il posait la feuille sur son genou, quand il l’avait lue, et fixait les yeux d’un air abattu sur le haut tabouret où Cédric s’asseyait autrefois. Il y avait sur les pieds certaines marques qui rendaient l’épicier tout à fait mélancolique. Elles avaient été laissées par les talons du futur comte de Dorincourt, qui, tout en causant, accentuait ses discours à sa manière, ou plutôt à la manière des enfants, qu’ils soient comtes ou non, en donnant des coups de pied dans son tabouret. Après avoir contemplé ces marques pendant un certain temps, M. Hobbes tirait sa montre, sa belle montre d’or, l’ouvrait et lisait avec un plaisir toujours nouveau l’inscription qu’elle renfermait :
Pensez à moi. »
Quand il l’avait contemplée quelques instants, il refermait la boîte avec bruit, se promenait de long en large dans sa boutique, entre les sacs de pommes de terre et les barils de cassonade, allait jeter un coup d’œil dans la rue, puis venait reprendre son siège. Le soir, quand la boutique était fermée, il allumait sa pipe et suivait le trottoir jusqu’à la maison que Cédric avait habitée. Au-dessus de la porte se voyait un écriteau : « Maison à louer. »
M. Hobbes contemplait la maison et l’écriteau pendant quelques minutes, branlait la tête, tirait une demi-douzaine de bouffées de sa pipe, regardait de nouveau la maison, puis, d’un air profondément mélancolique, il revenait lentement sur ses pas.
Les choses se passèrent ainsi pendant un certain temps après le départ de Cédric, sans qu’une nouvelle idée se présentât à l’esprit du vieil épicier. Lent et lourd comme il l’était, une nouvelle idée avait peine à germer en son cerveau. Par principe, il n’aimait pas les nouvelles idées ; il préférait les anciennes, celles qui avaient fait leurs preuves et qui surtout ne donnaient pas le moindre travail à sa pensée.
Cependant, après deux ou trois semaines durant lesquelles les choses, au lieu de s’améliorer, étaient devenues pires, il conçut un projet. C’était d’aller voir Dick ; il ne le connaissait pas personnellement, mais il le connaissait pour en avoir entendu parler par Cédric. Dick était comme lui un ami du jeune Errol : c’était un lien entre eux.
Il irait donc voir Dick. Beaucoup de pipes furent fumées néanmoins avant que ce projet fût complètement mûri dans son esprit ; mais un jour il se décida à l’exécuter.
Sa solitude devenait de plus en plus difficile à supporter ; il se disait que, puisqu’il ne pouvait plus voir Cédric, ce serait du moins une consolation pour lui d’en parler, et que cela l’aiderait à surmonter le chagrin qu’il éprouvait de l’absence de l’enfant.
Donc, un jour que Dick était occupé à s’escrimer sur les chaussures d’une pratique, un court et gros homme, avec une large face rouge et un front chauve, s’arrêta sur le trottoir et regarda pendant deux ou trois minutes l’enseigne du décrotteur, qui portait ces mots :
Fait reluire bottes et souliers pour dames et messieurs :
le tout au plus juste prix.
Il demeura là si longtemps que Dick commença à le remarquer ; de sorte que, quand il eut mis la dernière touche aux bottes de son client, il se tourna vers M. Hobbes.
« Un coup de brosse, monsieur ? » demanda-t-il.
Le gros homme s’avança délibérément ; il lui était tout à coup venu à l’esprit que le moyen était excellent pour arriver à ses fins.
« Oui, » dit-il.
Il s’assit sur le fauteuil ombragé d’un parapluie que Dick, depuis les générosités de Cédric à son égard, tenait à la disposition de ses clients, et posa le pied sur le support destiné à cet usage.
Pendant que le jeune garçon travaillait, les regards de M. Hobbes allaient de l’enseigne à Dick et de Dick à l’enseigne.
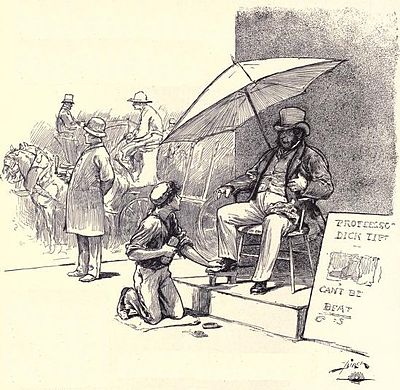
« Comment avez-vous fait pour vous procurer cet établissement ? dit-il enfin.
— C’est avec l’aide d’un de mes amis, répliqua Dick, un petit garçon qui me donna le moyen de l’acheter. C’est le meilleur enfant que j’aie vu de ma vie. Il est en Angleterre maintenant ; on est venu le chercher pour être lord.
— Lord… lord… interrompit M. Hobbes en appuyant sur chaque mot, lord Fautleroy, plus tard comte de Dorincourt. »
Dick laissa presque échapper sa brosse.
« Comment ? Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria-t-il. Le connaîtriez-vous vous-même ?
— Je l’ai connu, dit M. Hobbes en essuyant son front couvert de sueur, depuis sa naissance. Nous étions amis intimes. »
Ce n’est pas sans une profonde émotion qu’il parvint à articuler ces paroles. Il tira de son gousset sa superbe montre d’or, l’ouvrit et en montra l’intérieur à Dick, et lisant l’inscription qu’elle renfermait :
« Lord Fautleroy à son plus vieil ami, M. Hobbes. Pensez à moi. Je ne veux pas que vous m’oubliiez. » — Ce sont ses propres paroles. Cette montre est son souvenir, son cadeau de départ. Il n’y a pas de danger que je l’oublie ! ajouta-t-il en secouant la tête, quand même il ne m’aurait rien donné ; oh ! non ! il n’y a pas de danger ! ne devrais-je plus le voir de ma vie ; c’est un de ces amis qu’on n’oublie jamais !
— C’est bien le plus joli enfant qu’il soit possible de voir, reprit Dick, et, quant à des sentiments, je n’en ai jamais vu davantage à un petit garçon. Un jour j’ai ramassé sa balle qu’il avait laissée tomber en traversant la rue et qui avait roulé sous une voiture : il ne l’a jamais oublié ; et chaque fois qu’il venait de ce côté, avec sa mère ou avec sa bonne, il ne manquait pas de me crier : « Bonjour, Dick, bonjour ! » C’était un aimable petit garçon, et quand il vous parlait on était content ; cela vous faisait du bien.
— C’est-à-dire, fit M. Hobbes, que c’est une pitié d’en avoir fait un comte ! Il aurait brillé dans l’épicerie ou dans les denrées sèches ; oui, il y aurait brillé !… »
Et il secoua sa tête d’un air plus triste que jamais.
Les deux nouveaux amis reconnurent bientôt qu’il n’était pas possible de dire en une seule fois tout ce qu’ils avaient à dire sur le petit lord ; il fut donc convenu que le lendemain soir Dick rendrait à M. Hobbes sa visite.
La proposition agréait fort à Dick. Il avait toujours mené une vie fort décousue, ne possédant ni feu ni lieu, ayant été, dès sa première enfance, privé de ses parents. Il avait vécu pendant quelque temps avec son frère aîné, Ben, qui avait pris soin de lui jusqu’à ce que Dick fût assez grand pour vendre des journaux et faire des commissions ; mais depuis longtemps il était abandonné à lui-même. Ce n’était pas un mauvais garçon, loin de là, et il avait toujours aspiré à une existence plus régulière. Depuis qu’il était maître d’un petit établissement, ses affaires prenaient une meilleure tournure, et il gagnait maintenant assez d’argent pour s’abriter toutes les nuits sous un toit, au lieu de dormir à la belle étoile, comme cela avait été longtemps son lot. Il commençait même à entrevoir la possibilité de louer une chambre, que peu à peu il meublerait de ses deniers ; mais la réalisation d’un pareil rêve était encore loin de son atteinte. En attendant, être invité à aller voir un respectable épicier, qui avait sa boutique au coin d’une rue et qui possédait un cheval et une voiture, était un événement dans son existence.
« Connaissez-vous quelque chose sur les comtes et sur leurs châteaux ? dit M. Hobbes avant de quitter Dick. J’aimerais à apprendre certaines particularités à ce sujet.
— Il y a une histoire où il en est question dans le journal à un sou, dit le décrotteur. Elle est intitulée : Le Crime d’un noble, ou la Vengeance de la comtesse May. J’ai un camarade qui le lit et qui m’a dit que c’était intéressant.
— Eh bien, achetez-le et apportez-le demain : je vous le payerai. Apportez tout ce que vous trouverez sur les comtes, marquis, ducs, quoiqu’il (il signifiait Cédric), quoiqu’il n’ait pas fait mention de ducs ni de marquis. J’ai parlé avec lui aussi autrefois de couronnes, mais je n’en ai jamais vu. Je me doute bien, comme je le lui ai dit, que ces comtes ne doivent pas porter toujours la leur. Ce serait difficile à garder avec un chapeau.
— Et encore plus de dormir avec cette chose-là sur la tête, » ajouta Dick.
XXVIII
Tels furent les commencements des rapports de sérieuse amitié qui s’établirent entre M. Hobbes et Dick. Quand celui-ci, se rendant à l’invitation de l’épicier, arriva à la boutique le lendemain soir, M. Hobbes déploya à son égard la plus large hospitalité. Il l’installa sur une chaise, près d’un tonneau de pommes, et quand son visiteur fut assis, que lui-même eut allumé sa pipe, il frappa sur le tonneau pour inviter son jeune ami à y puiser et à se régaler à son aise, en lui disant :
« Ne vous gênez pas. »
Pendant que Dick, obéissant à cette invitation cordiale, croquait quelques pommes, M. Hobbes parcourut l’histoire que le jeune garçon avait apportée. Cet examen fut suivi d’une discussion sur l’aristocratie anglaise, pendant laquelle M. Hobbes tira force bouffées de sa pipe et secoua la tête un nombre infini de fois. Il la secoua plus encore en désignant les marques laissées par les talons de Cédric sur le haut tabouret.
« Ce sont ses propres pieds qui les ont faites, dit-il. Je les regarde pendant des heures et des heures. Dire qu’il était là, cassant une noix ici, croquant une pomme là, envoyant ses pépins dans la rue, et que maintenant c’est un lord, vivant dans un château ! Ces marques que vous voyez là sont des marques de coups de pied d’un lord ! un jour ce seront les marques de coups de pied d’un comte. Quand je pense à cela !… »
M. Hobbes parut tirer une grande satisfaction et une grande consolation de la visite de Dick. Avant le départ du jeune homme, il lui offrit, dans l’arrière-boutique, un souper dont le fromage, les sardines, les fruits secs et autres marchandises du magasin firent les principaux frais. Puis l’épicier déboucha solennellement une bouteille d’ale, en versa le contenu dans deux verres et proposa ce toast :
« À lui ! et puisse-t-il leur donner une leçon, à ces comtes, ducs et marquis ! »
Depuis cette soirée, l’épicier et Dick se virent très souvent, et chaque visite laissait M. Hobbes un peu moins triste et un peu moins abandonné. Ils lisaient en commun le journal à un sou. Le Crime d’un noble, ou la Vengeance de la comtesse May les initia tous deux aux habitudes de la noblesse anglaise, et leur en donna une idée qui aurait fort étonné les membres de ce corps, s’ils avaient pu lire dans la pensée des deux amis ; mais ce livre ne satisfaisait pas encore le désir qu’avait M. Hobbes de se renseigner au sujet de tout ce qui concernait Cédric, du pays qu’il habitait et des personnes avec lesquelles il devait se trouver en rapport. Un jour il entreprit un pèlerinage à une boutique de librairie, située fort loin de son épicerie, dans l’intention expresse d’augmenter sa bibliothèque. Il s’adressa à un commis, et se penchant sur le comptoir :
« Je voudrais un livre sur les comtes, dit-il.
— Sur les comtes ? Que voulez-vous dire ? demanda le commis.
— Un livre sur les comtes ! répéta l’épicier.
— Je crains, dit le commis avec embarras, que nous n’ayons pas ce que vous demandez.
— Vous n’en avez pas ! répliqua M. Hobbes avec anxiété. Eh bien, alors, un livre sur les marquis ou les ducs ?
— Je ne connais pas de livres sur ce sujet. »
M. Hobbes devint fort perplexe. Il regarda à ses pieds ; puis, levant les yeux :
« Et sur les comtesses ? dit-il.
— Pas davantage ! dit le commis avec un sourire.
— Vraiment ! répliqua l’épicier ; voilà qui est bien étrange ! »
Il allait sortir de la boutique, quand le commis, le rappelant, lui demanda si une Histoire de la noblesse anglaise pourrait lui convenir. M. Hobbes répondit qu’il s’en contenterait, puisqu’il ne pouvait trouver un volume entièrement consacré aux comtes.
Le commis lui remit donc un livre intitulé la Tour de Londres, que l’épicier s’empressa d’emporter chez lui.
Dick étant venu passer la soirée avec M. Hobbes, on en profita pour commencer la lecture du livre. C’était une histoire très émouvante qui se passait au temps de la reine Marie, qu’on a appelée « la Sanglante ». En entendant la relation des actions de ce personnage et des supplices qui lui avaient valu son sinistre surnom, M. Hobbes devint très agité. Il retira sa pipe de sa bouche, sans songer à l’y remettre, occupé à écouter Dick et à suivre la terrible tragédie de ce règne.
À plusieurs reprises, il fut forcé de tirer de sa poche son mouchoir rouge pour essuyer les gouttes de sueur que l’indignation faisait perler sur son front.
« Vous voyez ! s’écria-t-il ; vous voyez ! Il n’est même pas en sûreté ! Si une reine n’a qu’à monter sur son trône et à dire un mot pour que des choses pareilles soient faites, qui peut savoir ce qui lui arrivera ; ce qui lui arrive peut-être en ce moment ? Il n’est pas en sûreté du tout là-bas. Je m’en doutais déjà. Du reste, laissez faire une femme comme celle-là, et personne n’est en sûreté.
— Sans doute, sans doute ; mais vous voyez pourtant, répliqua Dick, quoiqu’il ne fût pas complètement rassuré lui-même, vous voyez que la femme qui était reine en Angleterre dans ce temps-là n’est pas celle qui l’est maintenant. La reine actuelle s’appelle Victoria, et la reine dont il est question dans le livre s’appelle Marie.
— C’est vrai, dit M. Hobbes, épongeant de nouveau son front ; c’est vrai ; et en effet les journaux ne parlent pas de « tortures », de « question », d’« échafauds », comme on en parle dans ce livre ; cependant j’ai idée qu’on ne peut pas être en sûreté avec des gens que… des gens qui… Croiriez-vous qu’ils ne fêtent pas le Quatre Juillet ! »
M. Hobbes fut intérieurement très tourmenté pendant plusieurs jours, et il ne recouvra sa tranquillité d’esprit que quand il eut reçu une lettre de Cédric, qu’il l’eut lue plusieurs fois, et qu’il eut lu de même une lettre que le petit lord avait adressée à son ancien ami Dick, à peu près à la même époque.
On devine avec quel plaisir ces missives furent reçues. Chaque mot fut commenté par les compagnons, qui ne se fatiguaient jamais de ressasser les mêmes réflexions quand il s’agissait de Cédric. Ils employèrent ensuite plusieurs jours à y répondre ; avant de les envoyer, ils se communiquèrent l’un à l’autre leurs réponses et ils les lurent presque autant de fois qu’ils avaient lu les lettres du petit lord.
C’était une grosse affaire pour Dick que la correspondance. Son éducation n’avait pas été très soignée, et toutes ses connaissances en lecture et en écriture se réduisaient à ce qu’il avait pu en recueillir durant quelques mois où il avait fréquenté, avec Ben, une école du soir. Mais comme c’était un garçon intelligent, il avait tiré bon parti de cette instruction sommaire. Il l’avait même perfectionnée, tant bien que mal, sous le rapport de la lecture, en lisant les journaux, et, sous celui de l’écriture, en se servant des murs en guise de papier et d’un morceau de craie ou de charbon en guise de plume. Quoi qu’il en soit, sa lettre à Cédric lui donna grand’peine et lui prit beaucoup de temps.
Le jeune garçon avait promptement mis l’épicier au courant de sa vie passée et lui avait parlé de Ben, son frère aîné :
« Peu de temps après que je commençai à gagner quelques sous en vendant des journaux et en faisant des commissions, lui avait-il dit, il se maria. Il épousa une femme nommée Minna, qui était bien la plus méchante créature que j’aie vue de ma vie ; une tigresse, un chat sauvage. Elle déchirait et brisait tout ce qui était à sa portée quand elle était en colère, et il n’y avait pas d’instant où elle ne le fût. Elle avait un enfant qui lui ressemblait : il ne faisait que crier jour et nuit. Ah ! quelle maison ! Un jour elle me jeta un plat à la tête ; j’esquivai le coup, qui alla frapper son garçon. Le docteur a dit qu’il en garderait la marque au menton toute sa vie. En voilà une mère ! Elle faisait sans cesse des scènes à Ben, disant qu’il ne gagnait pas assez d’argent. Si bien qu’un beau jour, mon frère quitta la maison et s’en alla dans l’Ouest, tout là-bas, pour être valet de ferme. Il n’y avait pas une semaine qu’il était parti qu’étant retourné moi-même à la maison garnie qu’il habitait avec sa femme, j’appris que Minna avait décampé. Une voisine me dit qu’elle était partie comme bonne d’enfant avec une dame qui traversait l’Atlantique ; jamais depuis je n’ai entendu parler d’elle, et Ben non plus. Cette Minna — ma belle-sœur — était une assez belle femme quand elle était requinquée. Elle avait de grands yeux, et des cheveux noirs qui tombaient jusqu’à ses genoux. Elle les tordait en une corde aussi grosse que mon bras et les tournait deux fois autour de sa tête. Oui, c’était une belle femme ; ce qui n’empêche pas que Ben n’a pas fait une belle affaire en l’épousant. »
Depuis que Ben était parti, il avait écrit une fois ou deux à son frère. Il n’avait pas été heureux et s’était vu forcé d’errer de place en place. Mais enfin il avait trouvé un emploi dans une ferme en Californie, et c’est là qu’il était au moment où Dick fit la connaissance de M. Hobbes.
« Aussi pourquoi s’est-il marié ? disait M. Hobbes en manière de conclusion, chaque fois que Dick lui parlait de son frère. Je n’ai jamais su, pour ma part, à quoi une femme était bonne ! »
Un soir, comme de coutume, les deux amis ressassaient leurs sujets habituels de conversation, sur le pas de la boutique. M. Hobbes était occupé à bourrer sa pipe. Il rentra dans le magasin pour l’allumer ; mais à peine eut-il enflammé une allumette qu’il poussa une exclamation. En jetant un coup d’œil sur le comptoir, il venait d’apercevoir une lettre que, sans doute, le facteur y avait déposée sans qu’il s’en aperçût.
Il la prit et l’examina soigneusement.
« Elle est de lui, bien de lui, » dit-il.
L’épicier, oubliant sa pipe, revint à sa chaise dans un état de grande agitation ; il tira son couteau de sa poche et ouvrit l’enveloppe.
« Je me demande ce qu’il peut m’écrire, » dit-il tout en dépliant la lettre.
Elle contenait ce qui suit :
« Je m’empresse de vous écrire, car j’ai à vous dire quelque chose de très singulier, qui vous étonnera beaucoup quand vous le saurez. C’est une erreur, et je ne suis pas lord, et je ne serai pas comte. Il y a une dame qui a été mariée à mon oncle Bévis, mon oncle qui est mort, et cette dame a un petit garçon, et c’est lui qui est lord Fautleroy, parce qu’en Angleterre le petit garçon du fils aîné est comte, quand son père et son grand-père sont morts. Mon grand-père, qui est aussi le sien, n’est pas mort ; mais mon oncle Bévis l’est, et alors son garçon est lord Fautleroy. Moi, je ne le suis pas, parce que mon papa était le plus jeune fils de mon grand-père, de sorte que mon nom est tout simplement Cédric Errol, comme quand j’étais à New-York. Je pensais d’abord que je devrais donner à l’autre garçon mes joujoux, mon poney et ma petite charrette ; mais mon grand-père a dit que je pouvais les garder pour moi. Mon grand-père a beaucoup de chagrin, et je crois bien qu’il n’aime pas la dame, la mère du petit garçon. Peut-être aussi il pense que Chérie et moi nous sommes très fâchés parce que je ne serai pas comte. J’aurais été plus content de l’être maintenant que je ne l’étais auparavant, parce que j’ai changé d’idée là-dessus, comme vous en changeriez vous-même, et que je vois bien qu’on peut être comte et bon tout de même. D’abord j’aime ce beau château et tous les gens d’ici ; et puis, quand on est riche, il y a bien des choses qu’on peut faire. Je ne serai plus riche maintenant, parce que mon papa, étant seulement le plus jeune fils, ne l’aurait pas été, et moi non plus par conséquent. Aussi je vais apprendre à travailler, de manière à ce que Chérie ne manque de rien. J’ai demandé à Wilkins de m’apprendre à soigner les chevaux. Peut-être que je pourrai être groom ou cocher. La dame, la mère de l’autre petit garçon, est venue hier au château avec son fils : grand-père et M. Havisam ont causé avec elle. Je pense qu’elle était en colère, car elle parlait très fort, et grand-père était en colère aussi. Je ne l’avais jamais vu comme cela auparavant ; j’espère que cela ne le rendra pas malade. Je tenais à vous dire ces choses-là tout de suite, à vous et à Dick, parce que je savais qu’elles vous intéresseraient.

M. Hobbes se laissa tomber sur sa chaise, tandis que la lettre tombait sur ses genoux et que son couteau ainsi que l’enveloppe tombaient à terre.
« Pour le coup ! s’écria-t-il, je suis… »
Ce qu’il était, nous ne saurions le dire, le digne épicier ne trouvant pas un mot pour peindre ce qu’il éprouvait.
Aucune expression, en effet, ne pouvait rendre la profonde stupéfaction dans laquelle ces étranges nouvelles le plongeaient ; aussi demeura-t-il au milieu de sa phrase, les yeux fixés à terre, sans penser à ramasser son couteau qui gisait à côté de lui.
« Eh bien ! s’écria Dick, qui avait été saisi d’étonnement, lui aussi, mais qui avait eu plus tôt fait de recouvrer son sang-froid, eh bien ! tant mieux s’il n’est pas comte ! Est-ce que ce n’est pas votre avis, monsieur Hobbes ?
— Tant mieux… tant mieux… balbutia le brave négociant Au fait… oui, tant mieux !… C’est égal… mon opinion est que ces gens-là l’ont dépouillé de ses droits parce que c’était un Américain. Ces Anglais nous en veulent, depuis la Révolution. Oui, ils l’ont dépouillé… dépouillé : j’en suis sûr. Je vous ai dit qu’il n’était pas en sûreté dans ce pays-là, et vous voyez ce qui est arrivé ! Je parierais que tout le gouvernement s’est entendu pour lui dérober la fortune et le rang qui lui appartiennent, au pauvre petit ! »
M. Hobbes était très agité. Il avait eu de la peine à accepter le changement survenu dans l’existence de Cédric ; mais il avait fini par se réconcilier avec l’idée de voir en lui un lord et un futur comte. Même, depuis les lettres antérieures de Cédric, il avait senti quelque chose comme un secret orgueil à la pensée de l’élévation de son jeune ami à ces hautes dignités. Cela n’allait pas jusqu’à changer complètement sa manière de voir sur les comtes et les lords, mais il y avait là quelque chose dont il ne se rendait pas complètement compte ; de plus, il reconnaissait qu’aussi bien en Amérique qu’ailleurs, l’argent pouvait être regardé comme une chose agréable à posséder ; et si la richesse devait s’en aller de compagnie avec le titre, il trouvait qu’il valait mieux les conserver tous les deux.
« Oui, ils veulent le dépouiller, le pauvre petit ! répétait-il ; je le vois bien ; ils veulent lui prendre son argent. Mais, après tout, ceux qui en ont doivent le défendre et ne pas le laisser échapper ; aussi j’espère qu’il le gardera, et le titre de comte par-dessus le marché, si l’un ne peut aller sans l’autre ; mais je ne sais pas trop comment il y parviendra. »
Il garda Dick avec lui jusqu’à une heure très avancée de la soirée, à parler toujours sur le même sujet ; et quand le petit décrotteur le quitta, il le reconduisit jusqu’au coin de la rue. En revenant il s’arrêta en face de la maison inhabitée, lut plusieurs fois l’écriteau « À louer », tira précipitamment plusieurs bouffées de sa pipe et rentra chez lui l’esprit fort troublé.
XXIX
Peu de jours après le grand dîner donné au château de Dorincourt, presque toutes les personnes qui, en Angleterre, lisaient les feuilles publiques, connaissaient l’histoire romanesque de ce qui se passait chez le vieux comte. Cela constituait vraiment un récit très intéressant, quand on donnait tous les détails. Tout le monde parlait du petit Américain qui avait été amené en Angleterre pour être lord Fautleroy. C’était, disait-on, un très bel enfant, qui déjà avait trouvé moyen de rendre chacun fou de lui. On parlait du comte son grand-père, si orgueilleux ; de la jeune veuve sa mère, à qui le vieux lord n’avait jamais voulu pardonner son mariage avec le capitaine Errol ; de l’étrange mariage de Bévis, le dernier lord Fautleroy ; de sa femme, Américaine aussi, que personne ne connaissait, dont personne n’avait soupçonné l’existence jusque-là, et qui apparaissait tout à coup avec son fils, prétendant que cet enfant était le véritable lord Fautleroy et réclamant ses droits. Ces événements étaient le sujet de toutes les conversations et des commentaires de tous les journaux.
Le bruit se répandit aussi que le comte de Dorincourt était fort mécontent de la tournure que prenaient les choses ; qu’il ne voulait pas admettre les prétentions de la veuve de Bévis ; qu’il avait l’intention d’avoir recours aux lois et que les choses ne se dénoueraient que devant les tribunaux.
Il n’y avait jamais eu autant de remue-ménage dans le canton où est situé Dorincourt. Les jours de marché, des groupes animés se formaient sur la place, et on agitait la question relative aux deux prétendants. Les femmes des fermiers s’invitaient à prendre le thé ensemble, afin de se communiquer l’une à l’autre ce qui leur était venu aux oreilles sur ce sujet, de se confier ce qu’elles pensaient, et de se dire ce qu’elles pensaient que les autres pensaient. Elles se racontaient mutuellement les anecdotes qui couraient dans le pays : sur la colère du comte et sur sa détermination de ne pas reconnaître le nouveau lord Fautleroy ; sur la haine qu’il avait conçue contre sa mère ; mais naturellement c’est miss Diblet qui était le plus au courant, ses relations avec le château lui permettant de connaître une foule de circonstances qui restaient étrangères aux autres ; aussi sa boutique ne désemplissait-elle pas, et sa conversation était-elle plus appréciée que jamais.
« Si vous me demandiez ma façon de penser, mesdames, disait-elle aux clientes réunies dans sa boutique, je dirais que c’est bien fait pour le vieux comte ; le bon Dieu le punira de la manière dont il a traité cette aimable jeune dame, la femme du capitaine, qu’il a séparée de son enfant. En dépit de la dureté et de la sécheresse de son vieux cœur, il est devenu si attaché à ce petit et si orgueilleux de lui, que ce qui arrive l’a presque rendu fou. De plus, la mère de ce nouveau lord n’est pas du tout une dame, comme l’est celle du premier. Elle a un air effronté, des yeux noirs, durs et hardis, et M. Thomas dit qu’aucun « gentleman » portant la livrée ne voudra recevoir des ordres d’elle. Son garçon non plus ne peut pas davantage se comparer à l’autre. Dieu sait ce qui va arriver de tout ceci ; et vous auriez pu me renverser d’une chiquenaude quand Jane m’a apporté ces nouvelles, tant j’étais saisie ! »
Si l’agitation était grande dans le village, elle l’était encore davantage au château. Dans la bibliothèque, le comte et M. Havisam tenaient sans cesse des conciliabules, tandis que dans la salle des domestiques, M. Thomas, le sommelier, les autres valets et servantes faisaient des commérages et poussaient des exclamations tout le long du jour. Il en était de même dans les écuries, où Wilkins ainsi que les cochers et palefreniers se livraient à leur ouvrage ordinaire avec une négligence inaccoutumée, s’interrompant sans cesse pour se faire part de leurs réflexions. Wilkins surtout était très abattu ; cependant il continuait à soigner de son mieux le poney de Cédric, quoique bien attristé à la pensée que peut-être lui et l’animal allaient changer de maître.
« Jamais, disait-il au cocher d’un ton lamentable, jamais je n’enseignerai à monter à un jeune gentleman si bien doué ! un jeune gentleman qui se tenait à cheval comme s’il n’avait fait que cela toute sa vie ; et qui avait tant de cœur, par-dessus le marché ! — Rappelez-vous l’histoire de Hartle le boiteux. — C’était un de ces jeunes gens qu’on est fier de suivre à la promenade. »
Au milieu de tous ces troubles, une personne restait parfaitement calme et tranquille : c’était le petit lord Fautleroy, qui n’allait plus être ni lord ni Fautleroy. Quand l’état des choses lui eut été expliqué, il avait commencé, il est vrai, par être un peu anxieux et perplexe ; mais l’ambition déçue n’était pour rien dans ses inquiétudes.
Pendant que le comte lui parlait de ces événements, il était assis près de lui, sur un tabouret, tenant son genou avec ses deux mains, comme il le faisait habituellement quand il prêtait toute son attention à ce qu’on lui disait ou qu’il y trouvait un intérêt particulier. Lorsque l’histoire fut finie, il avait un air très sérieux.
« Cela me semble tout… tout drôle, dit-il, et sa voix tremblait un peu ; cela me semble tout drôle de penser… »
Le comte regarda l’enfant en silence.
Lui aussi, il y avait quelque chose qui lui semblait « tout drôle » ; quelque chose qu’il n’avait jamais éprouvé pendant tout le cours de sa vie ; quelque chose qui lui étreignait le cœur et qui se fit sentir plus vivement encore quand il vit un nuage se répandre sur le petit visage levé vers lui : ce visage sur lequel, jusqu’à présent, ne s’était jamais montré qu’une expression heureuse.
« Cette dame prendra-t-elle à Chérie la maison et la voiture que vous lui avez données ? demanda enfin Cédric d’une voix anxieuse.
— Non, dit le comte avec force et sans hésitation ; soyez tranquille, on ne peut rien lui prendre.
— Ah ! » dit Cédric avec un soulagement évident.

Il leva de nouveau les yeux vers son grand-père ; ils avaient une expression touchante et ils semblaient chargés de larmes.
« Cet autre petit garçon, dit-il d’une voix tremblante, il sera votre petit garçon maintenant comme je l’étais ?
— Non, fit encore le comte, et il accentua ce mot si fermement que Cédric tressaillit sur sa chaise.
— Non ? répéta l’enfant étonné. Je croyais… je pensais… »
Il sauta vivement de son siège, s’approcha du vieillard et lui prenant la main :
« Serai-je encore votre petit garçon, même si je ne suis pas comte ? dit-il ; serai-je votre petit garçon comme je l’étais auparavant ? »
Et son petit visage s’éclaira d’une lueur subite.
Le comte le contempla un instant de la tête aux pieds ; ses gros sourcils se froncèrent et se rapprochèrent complètement, tandis que ses yeux brillaient dessous d’une manière bizarre.
« Si vous serez encore mon petit garçon ? dit-il, — et, si étrange que cela puisse paraître, sa voix était profondément altérée, presque tremblante, faible et saccadée, tout à fait différente de sa voix habituelle, quoique son ton fût aussi décidé et péremptoire que de coutume, — oui, vous serez mon petit garçon ; vous serez mon enfant, aussi longtemps que je vivrai ; et, par saint Georges ! il me semble que vous êtes le seul enfant que j’aie jamais eu ! »
La figure de Cédric devint rose jusqu’à la racine des cheveux et une expression joyeuse se répandit sur ses traits.
Il enfonça ses deux mains dans ses poches (une pose qu’il affectionnait), et regardant en face son noble parent :
« Vraiment ? Et vous m’aimerez encore ? dit-il. Eh bien ! alors, je ne me soucie pas du tout d’être ou de ne pas être comte ! Je pensais que c’était l’autre garçon qui en même temps devait être comte et votre petit-fils, et que moi je ne serais plus ni l’un ni l’autre. C’est ce qui m’avait rendu tout triste ; mais puisque je serai encore votre petit garçon, puisque vous m’aimerez encore, que Chérie garde sa maison et sa voiture, qu’est-ce que cela peut me faire de m’appeler lord Fautleroy ou Cédric Errol ? »
Le comte mit la main sur l’épaule de l’enfant et l’attira près de lui.
« Ils ne vous prendront rien de ce que je pourrai vous conserver, dit-il de la même voix étrange. Je ne veux pas croire qu’ils puissent vous enlever quelque chose. Vous êtes fait pour la place et… et vous la garderez. Quoi qu’il arrive, vous aurez tout ce que je pourrai vous donner… tout ! »
Il ne semblait pas se rappeler qu’il parlait à un enfant, tant il y avait de résolution sur son visage et dans sa voix ; c’était plutôt comme s’il se faisait une promesse à lui-même, et peut-être en effet en était-il ainsi. Il ne s’était jamais douté jusque-là combien était profonde l’affection qu’il avait pour son petit-fils, et combien fort le lien qui l’attachait à lui. Il n’avait pas encore vu la beauté, la grâce, la force de cet enfant, tout ce qui en lui flattait son orgueil, comme il les voyait en ce moment. Il paraissait impossible à sa nature arrogante et obstinée, il lui paraissait plus qu’impossible d’abandonner le petit garçon auquel il avait attaché son cœur, et il était résolu à ne pas s’en séparer sans un combat acharné.
XXX
Peu de jours après celui où elle avait eu une entrevue avec M. Havisam, la femme qui réclamait le nom de lady Fautleroy se présenta pour la seconde fois au château. Comme la première, elle avait son fils avec elle ; mais elle fut éconduite. — Le comte ne voulait pas la recevoir, lui annonça le valet de pied : son homme d’affaires le représentait ; c’est à lui qu’elle devait s’adresser. — C’est Thomas qui délivra ce message, et il ne se gêna pas ensuite pour exprimer son opinion sur la dame, dans la salle des domestiques : « Il espérait, dit-il, avoir porté assez longtemps la livrée dans de nobles familles pour savoir ce que c’était qu’une dame, et il déclarait que la future lady Fautleroy n’en était pas une.
« Celle de la Loge, ajouta Thomas avec dignité, qu’elle soit ou non Américaine, est une dame, une dame de la tête aux pieds ; c’est facile à reconnaître. Je m’en suis aperçu dès le premier moment que je l’aperçus. »
La visiteuse s’était retirée, la colère peinte sur ses traits, assez beaux, mais communs. M. Havisam avait remarqué que, quoiqu’elle parût avoir un caractère emporté et des manières grossières et insolentes, elle n’était ni si habile ni si hardie qu’elle voulait le faire croire. Elle semblait par moments embarrassée et même comme accablée par la position dans laquelle elle s’était placée. On aurait dit qu’elle ne s’était pas attendue à tant de difficultés ; qu’elle avait cru que les choses marcheraient plus aisément, et qu’elle éprouvait comme du regret des démarches qu’elle avait entreprises. En d’autres moments, elle reprenait son assurance et faisait sonner bien haut ses droits et ses titres.
« Évidemment, dit un jour l’homme de loi à Mme Errol, c’est une personne appartenant aux plus basses classes de la société. Elle manque complètement d’éducation et d’instruction, et n’est pas accoutumée à rencontrer des personnes comme vous ou moi sur le pied d’égalité. Elle est furieuse, mais consternée. Le comte ne veut pas la recevoir ; mais je lui ai conseillé de venir avec moi à l’auberge où elle est descendue, « Aux Armes de Dorincourt ». Il a suivi mon conseil, et nous y sommes allés ensemble avant-hier. Quand elle a vu mylord entrer dans la salle, elle est devenue blanche comme un linge, tout en commençant par s’emporter en fureur, en menaces et en récriminations. »
Le fait est que lorsque le comte, sans daigner prononcer un mot, s’était avancé majestueusement dans la chambre, marchant d’un pas imposant, en redressant sa grande taille et en dardant sur l’Américaine un regard hautain, sous ses sourcils rapprochés en broussailles, celle-ci avait complètement perdu contenance. Le vieux lord la toisait comme si elle eût été simplement le but d’une insouciante et dédaigneuse curiosité, qu’il pût satisfaire sans se demander si celle qui en était l’objet la trouvait indiscrète. Il la laissa parler, faire ses réclamations et se répandre en discours jusqu’à ce qu’elle fût fatiguée. Quand elle eut fini :
« Vous prétendez, dit-il, être la femme de mon fils. Si cela est vrai, et si vous pouvez en fournir la preuve, vous avez la loi pour vous. Dans ce cas, votre fils est lord Fautleroy. La matière sera examinée à fond, vous pouvez en être sûre. Si vos prétentions sont reconnues justes, il sera pourvu à votre entretien ; mais rappelez-vous bien que je n’ai besoin de voir ni vous ni votre enfant au château tant que je vivrai. On vous y verra assez malheureusement après ma mort ! »
Et il ajouta :
« Vous êtes exactement la sorte de personne que devait choisir mon fils Bévis. »
Il lui tourna alors le dos, et quitta la pièce du même pas calme et imposant dont il était entré.
Peu de jours après, un visiteur fut annoncé à Mme Errol qui écrivait dans son cabinet de travail. La servante qui apportait le message semblait très émue ; ses yeux étaient arrondis par l’étonnement, et elle regardait sa maîtresse avec un air de commisération et de sympathie.
« C’est le comte en personne, madame, » ajouta-t-elle d’une voix aussi tremblante que si la visite se fût adressée à elle-même.
Quand Mme Errol entra dans le salon, un grand vieillard, d’aspect majestueux, se tenait debout sur la peau de tigre étendue devant le foyer. Il avait de beaux traits, un nez aquilin, une longue moustache blanche et un regard perçant.
« Mme Errol, je pense ? ajouta-t-il.
— Mme Errol, répliqua celle-ci en s’inclinant.
— Je suis le comte de Dorincourt, » ajouta-t-il.
Le comte s’arrêta un moment et, presque inconsciemment, ses regards tombèrent sur les yeux qui se trouvaient en face de lui. Ils ressemblaient tellement à ceux qui s’étaient levés si souvent vers les siens pendant ces derniers mois, à ces beaux yeux si limpides, si affectionnés, qu’ils lui donnèrent une singulière sensation.
« Votre enfant vous ressemble, dit-il brusquement.
— On me l’a dit souvent, mylord, mais j’aime à croire qu’il ressemble aussi à son père. »
Comme lady Lorridale le lui avait dit, la voix de Mme Errol était douce, ses manières simples et dignes. Elle ne semblait pas le moins du monde troublée par l’arrivée de ce visiteur inattendu.
« Oui, répliqua le comte, il ressemble aussi à… à mon fils. »
Il leva la main vers sa grosse moustache blanche et la tira rudement :
« Savez-vous, dit-il, pourquoi je suis venu ici aujourd’hui ?
— J’ai vu M. Havisam, commença Mme Errol, et il m’a parlé de réclamations qui avaient été élevées par la femme…
— Je suis venu pour vous dire, interrompit le comte, que ses droits seront examinés et contestés, s’il y a lieu. Je suis venu pour vous dire que votre fils sera défendu par tous les moyens que la loi met en mon pouvoir ; que ses droits…
— Mylord, interrompit à son tour Mme Errol, je désire que mon fils n’ait rien que ce que lui donnent ses droits. Quand même la loi lui reconnaîtrait certains avantages, si c’est aux dépens de la loyauté…
— Par malheur, la loi ne peut pas grand’chose. Si elle le pouvait, ce serait fait déjà… Mais cette méprisable femme et son enfant…
— Sans doute elle se préoccupe de son fils comme je me préoccupe de Cédric, interrompit de nouveau la jeune veuve. Si elle est en effet la femme de votre fils aîné, son fils est lord Fautleroy, et le mien n’est rien. »
Mme Errol parlait du ton doux et tranquille qui lui était habituel. Elle ne semblait pas plus effrayée ou intimidée par la présence du comte que Cédric ne l’avait été, et elle le regardait juste comme Cédric le regardait. Le vieux lord, qui avait été un tyran toute sa vie, qui avait toujours vu chacun plier devant son autorité, qui pendant si longtemps s’était plu à faire sentir sa domination, à inspirer la terreur, éprouvait une jouissance infinie à voir quelqu’un à qui il ne faisait pas peur et qui le regardait sans trembler. Il était si rare qu’on osât avoir une opinion opposée à la sienne, qu’avoir affaire à une personne qui lui tenait tête était une nouveauté qui lui plaisait.
La jeune femme rougit.
« C’est très beau d’être comte de Dorincourt, mylord, dit-elle ; c’est une magnifique position, et je suis bien loin de la dédaigner pour mon fils ; mais je tiens encore plus à ce qu’il soit ce que son père était : brave, juste et loyal.
— Un contraste frappant avec ce que fut son grand-père, n’est-ce pas ? dit le comte d’un ton sarcastique.
— Je n’ai pas eu, jusqu’à présent, le plaisir de connaître personnellement son grand-père, dit Mme Errol ; mais je sais qu’il a été bon pour mon petit garçon ; je sais aussi que Cédric le croit… »
Elle s’arrêta un moment, regarda le comte en face et ajouta :
« Je sais que Cédric aime son grand-père.
— M’aurait-il aimé, dit le comte sèchement, si vous lui aviez dit pourquoi je ne vous recevais pas au château ?
— Non, répondit Mme Errol : je ne le pense pas ; c’est pourquoi je n’ai pas voulu qu’il le sût.
— Eh bien, répliqua le comte brusquement, il y a peu de femmes qui ne le lui auraient pas dit. »
Il se leva et se mit à marcher dans la chambre, tirant sa grande moustache plus que jamais.
« Oui, il m’aime, dit-il enfin ; il m’aime et je l’aime. Je ne peux pas dire que j’aie jamais aimé quelqu’un ou quelque chose avant lui ; mais lui, je l’aime ; je l’aime autant que je puis aimer et bien plus que je ne m’en croyais capable. Il m’a pris le cœur dès que je l’ai vu. J’étais un vieillard fatigué de la vie, il m’y a rattaché. Il m’a donné une raison de vivre. Je suis orgueilleux de lui, et c’était une satisfaction profonde pour moi de penser qu’il serait un jour à la tête de la famille. »
Il s’arrêta devant Mme Errol.
« Je suis très malheureux ! dit-il, très malheureux ! »
Et il semblait très malheureux, en effet. Tout l’empire qu’il possédait sur lui et même tout son orgueil ne pouvaient empêcher sa voix de trembler et ses mains de s’agiter. Pendant un instant on eût pu croire qu’une larme brillait dans ses yeux sombres.
Il reprit :
« Peut-être est-ce parce que je suis malheureux que je suis venu à vous. Jusqu’ici je vous ai haïe ; j’ai été jaloux de l’affection que votre fils avait pour vous. Les événements qui viennent de se passer ont changé ces malveillantes et injustes dispositions. En voyant la misérable créature qui prétend avoir été la femme de mon fils Bévis, je sens que c’est pour moi une consolation, un soulagement, de me tourner vers vous. J’ai agi comme un vieux fou et je vous ai traitée d’une manière indigne. Il y a entre nous un lien qui nous rapproche l’un de l’autre : vous êtes attachée à Cédric, et Cédric est tout pour moi. Je viens à vous simplement parce qu’il vous aime et parce que je l’aime. Ayez pitié de moi, uniquement par amour pour lui. »
En parlant ainsi, il regardait Mme Errol en face ; sa voix était dure, saccadée, mais elle semblait s’échapper si péniblement de ses lèvres que la jeune femme fut touchée au cœur. Elle se leva, et lui avançant un fauteuil près d’elle :
« Asseyez-vous, dit-elle avec douceur et d’un ton sympathique. Vous avez éprouvé une telle émotion de ces incidents, que vous êtes bouleversé et que vos forces s’en sont trouvées affaiblies. »
Il était aussi nouveau pour le vieux lord de s’entendre parler avec cette sollicitude qu’il l’était de s’entendre contredire. Il fit ce qu’on lui disait et se laissa tomber dans le fauteuil qui lui était offert. Peut-être la déception et le malheur avaient-ils été une bonne discipline pour lui. S’il ne s’était pas senti si abattu par la main du destin, peut-être aurait-il continué à haïr la mère de son petit-fils ; mais dans la triste situation où il se trouvait, les paroles de sympathie de celle-ci firent sur son cœur l’effet d’un baume calmant. D’ailleurs, quelle est la femme qui ne lui aurait pas semblé charmante, comparée à la créature déplaisante qui revendiquait le nom de lady Fautleroy ? Mme Errol avait en outre des traits si gracieux et si aimables ; ses manières, ses gestes et ses paroles étaient empreints d’une dignité si douce, qu’il ne pouvait qu’être entièrement subjugué par la tranquille magie de ces influences. Il commença à se calmer et à se sentir moins malheureux.
« Quoi qu’il arrive, dit-il au bout de quelques instants, votre fils ne sera pas abandonné. J’aurai soin de sa fortune ; je lui assurerai un douaire, pour maintenant et pour l’avenir. »
Puis il se leva, et jetant un regard autour de la chambre :
« Cette maison vous plaît-elle ? demanda-t-il.
— Beaucoup, mylord, répondit Mme Errol.
— Vous en avez fait une agréable demeure, dit-il. Puis-je venir de temps en temps pour causer avec vous des choses dont je viens de vous parler ?
— Aussi souvent que vous le voudrez, mylord. »
Elle reconduisit le visiteur jusqu’à la porte de la Loge. Le comte reprit sa place dans la voiture, tandis que, sur le siège, Thomas et Henry demeuraient muets de surprise, et qu’ils furent pendant quelques instants avant de se communiquer leurs réflexions au sujet du tour inattendu qu’avaient pris les événements, tant ils étaient bouleversés par ce fait de la visite du comte à sa belle-fille et de l’union qui semblait régner entre eux.
XXXI
Ainsi que nous l’avons dit, dès que l’histoire de lord Fautleroy et des difficultés suscitées au comte de Dorincourt par les revendications de la femme qui se présentait comme lady Fautleroy furent connues, elles devinrent l’objet des discussions des feuilles publiques. Naturellement elles passèrent des journaux anglais dans les journaux américains. L’histoire était trop intéressante pour qu’on la traitât légèrement, et, aussi bien en Amérique qu’en Angleterre, elle fut bientôt le sujet de toutes les conversations. On en donnait tant de versions qu’il eût été curieux d’acheter tous les journaux pour les comparer entre eux ; mais on n’en eût pas été plus avancé pour cela. M. Hobbes, pour sa part, en lut tant et tant, qu’il n’y comprit plus rien du tout. Une de ces feuilles parlait de son jeune ami Cédric comme d’un enfant au maillot ; une autre comme d’un étudiant d’Oxford, ayant obtenu tous ses grades et s’étant déjà distingué par des poèmes grecs ; une autre prétendait qu’il était fiancé à une jeune dame d’une grande beauté, fille d’un duc ; une autre encore, qu’il venait de se marier ; mais pas une ne disait que c’était un petit garçon de huit ou neuf ans, avec de bonnes petites jambes agiles, de jolis yeux bruns et des cheveux blonds bouclés. Enfin un de ces journaux disait qu’il n’existait aucun lien de parenté entre ce prétendu lord Fautleroy et le comte de Dorincourt ; que ce garçon était un misérable petit imposteur qui avait vendu des journaux et dormi à la belle étoile dans les rues de New-York, avant que sa mère ne le donnât pour héritier du comte à l’homme d’affaires que celui-ci avait envoyé en Amérique pour aller chercher son petit-fils. Venait alors la description du nouveau lord Fautleroy et de sa mère. Pour les uns c’était une bohémienne, pour les autres une actrice, pour d’autres encore une belle Espagnole ; mais tous étaient d’accord que le comte de Dorincourt haïssait sa belle-fille, qu’il ferait tous ses efforts pour ne pas la reconnaître s’il pouvait l’empêcher ; et comme, paraît-il, il y avait un léger vice de forme dans les papiers qu’elle avait produits, on s’attendait à ce qu’il en résultât un long procès, qui ne pouvait manquer d’être des plus intéressants.
M. Hobbes avait coutume de lire tous ces journaux, jusqu’à ce que tout ce qu’ils contenaient formât dans sa tête un tohu-bohu, un pêle-mêle, un tourbillon. Dans la soirée, il parlait avec Dick de ce qu’il avait appris dans les lectures de la journée, ce qui ne l’empêchait pas de ressasser ce qu’il avait déjà dit les jours précédents, de sorte que les conversations entre les deux nouveaux amis étaient interminables. Ces lectures leur avaient appris une chose : c’est que le comte de Dorincourt était un très important personnage, plus important encore qu’ils ne se l’étaient imaginé ; qu’il possédait un revenu considérable, des propriétés immenses, et que le château qu’il habitait était une magnifique demeure, entourée d’un parc princier. Les lettres de Cédric leur avaient bien dit toutes ces choses, mais elles n’étaient pas parvenues à leur en donner quelques notions justes, et ce n’est qu’à force de les voir répétées dans les journaux qu’ils commençaient à comprendre ce que pouvait être un lord et un comte.
Plus ils parlaient sur ce sujet, plus ils s’animaient à la pensée que tant de biens, d’honneurs, de dignités, avaient été sur le point d’appartenir à leur petit ami et qu’il allait se les voir enlever.
« Il me semble qu’il y aurait quelque chose à faire, bien que je ne sache pas quoi, dit un jour l’épicier. On doit défendre son bien et celui de ses amis, qu’ils soient comtes ou non. »
Mais il n’y avait en réalité, rien à faire ; pour le brave M. Hobbes et pour Dick du moins ; rien qu’à écrire à Cédric et à l’assurer de leur amitié et de leur sympathie. C’est ce qu’ils firent, aussitôt qu’ils eurent connaissance des nouvelles qui concernaient leur jeune ami ; puis, selon leur coutume, ils se communiquèrent leurs missives.
Voici ce que M. Hobbes lut dans celle de Dick :
« Mon cher ami, j’ai reçu votre lettre, et M. Hobbes a reçu la sienne, et nous sommes bien fâchés de ce qui arrive. Nous disons : Tenez bon tant que vous pourrez, et ne vous laissez pas prendre ce qui vous appartient. Ce sont tous voleurs qui feront tout ce qu’ils pourront pour vous dépouiller. La présente est pour vous dire que je n’ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi, et, si vous n’avez pas de meilleure perspective, venez ici : vous serez mon associé. Les affaires vont assez bien, et j’espère que nous réussirons. Aucun autre garçon n’oserait s’établir dans mon voisinage, c’est pourquoi je ne vous en dirai pas plus aujourd’hui. »
La lettre de M. Hobbes était ainsi conçue :
(M. Hobbes, qui commençait à avoir quelque vague notion des distinctions sociales, commençait en même temps à penser qu’il ne pouvait traiter le petit-fils d’un comte, un garçon qui avait failli être lord et comte lui-même, avec la même familiarité que le jeune Cédric Errol.)
« J’ai reçu votre honorée, et je vois que les choses ne vont pas bien. Je crois que toute cette affaire est une duperie et qu’il faut y regarder de très près. J’ai deux choses essentielles à vous dire. C’est d’abord celle-ci : voyez un homme de loi et faites tout ce que vous pourrez pour rentrer dans ce qui vous appartient. Si le pire arrive, c’est-à-dire si vous n’êtes plus ni lord ni comte, revenez en Amérique, et soyez sûr que vous trouverez un bon ami dans l’épicerie, qui vous prendra pour associé aussitôt que vous serez en âge, et qui, en attendant, vous offre sa maison et son amitié.
XXXII
Le lendemain, une des pratiques de Dick eut lieu d’être surprise.
C’était un jeune avocat qui commençait seulement sa carrière. Il possédait une grande énergie de caractère, un grand désir de parvenir, une grande aptitude au travail ; mais pour l’instant il était fort pauvre et avait peu de clients. Son cabinet d’affaires était situé dans le voisinage de l’établissement de Dick, et chaque matin le petit décrotteur faisait la toilette de ses bottes, qui n’étaient pas toujours imperméables, mais qui gardaient bonne apparence, grâce aux coups de brosse savants et répétés de notre jeune ami.
M. Harrisson avait toujours une bonne parole et une plaisanterie à l’adresse de Dick.
Le matin de ce jour, lorsqu’il s’assit sur le fauteuil surmonté d’un parasol et qu’il posa le pied sur l’appui destiné à cet usage, il tenait à la main un journal illustré. Il en avait achevé la lecture ; et quand Dick eut terminé sa besogne, l’avocat lui tendit la feuille en lui disant :
« Tenez, Dick, prenez ce journal ; vous vous amuserez à le lire en déjeunant. Vous y verrez un dessin représentant un des plus beaux châteaux d’Angleterre et le portrait de la belle-fille du comte auquel appartient le susdit château : une superbe femme, quoiqu’elle manque un peu de distinction. Elle a des cheveux magnifiques. Cela vous mettra au courant des choses de la noblesse, ami Dick, à commencer par Sa Grâce le très honorable comte de Dorincourt, et par lady Fautleroy… Eh bien ! qu’est-ce qui vous prend ? »
Les dessins dont M. Harrisson parlait occupaient la première page du journal, et, les yeux de Dick y étant tombés, le jeune garçon avait poussé une exclamation qui venait de provoquer la remarque de son client.
« Qu’est-ce qui vous prend ? » répéta celui-ci, voyant Dick devenir tout pâle, tandis que, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, il continuait à regarder les dessins.
Il montra du doigt le portrait qui illustrait la première page du journal. Au bas était écrit :
« Lady Fautleroy, la mère du prétendant. »
C’était celui d’une assez belle femme, encore jeune, avec de grands yeux noirs et d’épaisses nattes de cheveux, noirs aussi, enroulées autour de sa tête.
« Elle ! s’écria enfin Dick, qui commençait à reprendre son sang-froid. Elle ! mais je la connais mieux encore que je ne vous connais vous-même ! »
Le jeune avocat se mit à rire.
« Où l’avez-vous rencontrée, ami Dick ? À Londres, pendant la « saison » ? ou bien à votre dernier voyage à Paris ? »
Dick ne releva pas la plaisanterie ; mais il commença à réunir ses brosses et ses pots de cirage et à les enfermer dans le coffre où il les rangeait quand il avait fini son ouvrage habituel. Sans doute une affaire plus importante mettait fin, pour l’instant, à sa besogne de tous les jours.
« Si je la connais ! Oh ! oui, je la connais, répétait-il. Nous allons voir ce que M. Hobbes va dire de cela ! »
En moins de cinq minutes tout était en place, et il se dirigeait à toutes jambes vers la boutique de l’épicier, laissant son client, qui n’avait pas pu obtenir la moindre explication, tout ébahi de ce départ précipité. Quelques instants après il atteignit la demeure de son ami. Celui-ci put à peine en croire ses yeux en le voyant se précipiter dans son magasin : Dick n’avait pas coutume de quitter ses affaires à cette heure matinale ; c’était celle au contraire où il était le plus occupé. L’épicier attendit que son jeune ami lui expliquât le motif de sa visite ; mais Dick avait couru avec une telle vitesse qu’il en avait perdu la respiration, si bien que tout ce qu’il put faire, ce fut de jeter le journal sur le comptoir en faisant signe à M. Hobbes de le regarder.
« Qu’est-ce ? demanda l’épicier. — Ah ! s’écria-t-il après y avoir jeté les yeux : lady Fautleroy, la mère du prétendant ! La mère de l’autre, car ce n’est pas celle de Cédric pour sûr. Mme Errol ne ressemblait pas du tout à cette femme-là, qui est une belle femme, c’est possible, mais qui a l’air d’une virago.
— Bien sûr que ce n’est pas la mère de Cédric, dit alors Dick, qui commençait à recouvrer la voix et parlait par mots entrecoupés, bien sûr que ce n’est pas elle ! Regardez-la bien, monsieur Hobbes. Elle une lady ! Ah bien ! oui ! Elle la femme d’un lord !… Un drôle de lord ! C’est Ben alors qui est ce lord : car il ne fait pas jour en plein midi si ce portrait n’est pas celui de Minna : de Minna, la femme de Ben, et par conséquent ma belle-sœur ! »
M. Hobbes se laissa tomber sur son siège.
« Pas possible ! » fit-il.
Il tira son mouchoir à carreaux de sa poche, et, selon son habitude quand il était fortement ému, il commença à le passer et repasser avec énergie sur son crâne.
Cette friction parut lui rendre son sang-froid.
« Quand je vous disais que c’était un complot tramé contre lui, s’écria-t-il. Quand je vous disais !… Et c’est parce qu’il est Américain !
— Oh ! mais nous verrons ! s’écria Dick. Cela ne se passera pas ainsi ! Oh non ! Je connais ses tours ! Elle voudrait bien se donner pour une lady ! Une jolie lady ! Elle porter une couronne ! Ça lui irait comme des plumes de paon à une truie ! Je me rappelle que, dans un des journaux où il était question de la prétendue lady Fautleroy et de son fils, on disait que celui-ci avait une cicatrice au menton. Je sais bien d’où elle vient, cette cicatrice ! Vous rappelez-vous que je vous ai raconté qu’un jour Minna, en colère, m’avait lancé un plat à la tête ; que ce plat avait atteint son garçon au menton, et qu’il en était résulté une blessure dont, au dire du médecin, il devait garder la trace toute sa vie ? Lui, un lord ! je t’en souhaite ! un lord comme moi ! C’est le fils de Minna et de Ben, tout simplement, c’est-à-dire mon neveu, et je n’en suis pas plus fier pour ça ! »
Dick Tipton avait toujours été un garçon fort avisé, et la nécessité où il s’était vu, dès ses premières années, de se tirer d’affaire tout seul l’avait rendu plus avisé encore. Il avait appris à observer et à mettre à profit ses observations. Si le petit lord avait pu jeter un regard dans la boutique de l’épicier ce matin-là, il aurait certainement éprouvé un vif intérêt, même quand il ne se serait pas agi de choses le concernant, en voyant avec quelle animation on discutait les plans qui se présentaient à l’esprit de Dick et de son compagnon.
Après avoir mis en avant une foule de projets, avoir ressassé de nouveau tous les faits concernant leur jeune ami ; après avoir répété à satiété les réflexions que ces étranges événements leur inspiraient, ils se décidèrent à agir. Dick commença par écrire à Ben ; puis, après avoir découpé le portrait de la prétendue lady Fautleroy, il le glissa dans sa lettre. Pendant ce temps, M. Hobbes écrivait au comte et à Cédric. Ils n’avaient pas encore terminé l’un et l’autre cette intéressante opération quand une nouvelle idée surgit dans le cerveau de Dick.
« Le jeune homme qui m’a donné ce journal, dit-il, est un avocat. Il s’appelle Harrisson et il a son cabinet tout près de ma boutique. Si nous le chargions de débrouiller tout cela ? Les avocats connaissent les lois ; il nous dira comment nous y prendre pour empêcher que Cédric soit dépouillé. »
M. Hobbes trouva que la proposition de Dick était un trait de lumière, et déclara que le jeune garçon avait les plus grandes dispositions pour les affaires.
« Vous avez raison, dit-il ; il faut en parler à un avocat. »
Alors, laissant sa boutique aux soins d’un voisin, l’épicier se hâta d’endosser son pardessus et de se diriger vers le cabinet de M. Harrisson, toujours accompagné de Dick.
Si l’avocat n’avait pas été si nouveau dans la carrière, s’il n’avait pas eu beaucoup de temps de disponible et s’il n’eût pas été doué d’un esprit aussi entreprenant, peut-être la romanesque et étrange histoire qu’on lui racontait eût-elle rencontré des oreilles moins complaisantes : car on conviendra qu’elle pouvait passer pour invraisemblable et pour être née dans l’imagination de ceux qui la débitaient ; mais il se trouvait par bonheur que les clients de M. Harrisson étaient rares pour l’instant, ce qui lui laissait beaucoup de loisirs ; ensuite il connaissait Dick ; enfin il arriva que celui-ci lui présenta les faits avec tant d’animation, qu’en dépit de leur couleur fantastique, il trouva moyen d’intéresser et même de convaincre son auditeur.
« Et, ajouta M. Hobbes quand le jeune garçon eut fini, vous me direz ce que votre temps vaut l’heure et combien vous en aurez passé pour éclaircir ce grabuge. C’est moi qui vous payerai : — Silas Hobbes, denrées coloniales, épiceries de premier choix, au coin de Blank street.
— Bon ! répliqua l’avocat. Ce ne sera pas une chose de mince importance pour moi si je débrouille cette affaire ; mon avenir peut en dépendre, aussi bien que celui du véritable lord Fautleroy. Dans tous les cas, il ne peut résulter aucun mal d’essayer de tirer les choses au clair. Je vois qu’on a des doutes au sujet de l’enfant que sa mère présente comme l’héritier du titre. Elle s’est contredite à plusieurs reprises, quant à son âge, ce qui a éveillé les soupçons. Les premières personnes qu’il faut avertir, comme vous l’aviez bien compris du reste, sont le frère de Dick et le comte, ou plutôt son homme d’affaires. »
Donc, avant que le soleil descendît sur l’horizon, deux lettres partaient dans deux directions tout à fait différentes. L’une était emportée par le premier steamer en destination d’Europe, et était adressée à M. Havisam ; l’autre, par un train se dirigeant vers la Californie, portait comme suscription le nom de Benjamin Tipton.
Quoique les événements qui se rapportaient à leur jeune ami, avec tous les incidents qui pouvaient s’y rattacher, eussent fait le sujet de leurs discours pendant toute la journée, l’épicier et son compagnon trouvèrent encore moyen de prolonger la conversation sur le même thème jusqu’à minuit.
XXXIII
Une chose étonnante, c’est combien d’événements extraordinaires peuvent arriver en peu de temps. Il n’avait fallu que quelques instants, à ce qu’il semblait du moins, pour changer tout l’avenir du petit garçon que nous avons vu, au commencement de notre histoire, assis les jambes pendantes sur un baril, dans la boutique d’un épicier de New-York, et pour transformer la vie simple et modeste qu’il menait auprès de sa mère, dans une rue retirée, en une vie luxueuse dans un des plus beaux châteaux d’Angleterre. En quelques instants il était devenu un noble lord, le petit-fils d’un comte, l’héritier de domaines immenses et d’une fortune considérable, le représentant enfin d’une des plus anciennes familles de la Grande-Bretagne. — Quelques autres instants encore avaient fait du petit lord un orphelin, ne possédant pas un penny, n’ayant aucun droit aux splendeurs dont il avait joui, et même, aux yeux de bien de gens, pour un misérable intrigant, qu’on pouvait chasser comme un imposteur. Troisième et dernière métamorphose, qui ne prit pas plus de temps que les autres : la face des choses avait encore changé, et Cédric était une fois de plus rétabli dans les dignités et dans les autres avantages qu’il avait été sur le point de perdre.
Cette dernière transformation prit très peu de temps en effet ; la femme qui s’était donnée pour lady Fautleroy n’était pas, à beaucoup près, aussi habile qu’elle était méchante et intéressée. Quand elle fut serrée de très près par M. Havisam, au sujet de son mariage et de son fils, elle fit plusieurs maladresses qui éveillèrent les soupçons du vieil homme de loi. Dès qu’elle s’en aperçut, la colère lui enleva complètement son sang-froid et sa présence d’esprit. Elle fit alors bévue sur bévue, et s’embrouilla tant et si bien qu’elle ne put plus se retrouver dans les mensonges qu’elle entassait les uns sur les autres. C’était surtout au sujet de son enfant que ces tromperies étaient le plus apparentes. Peut-être, en effet, avait-elle été mariée à Bévis et s’étaient-ils séparés ne pouvant faire bon ménage, ce qui, vu le caractère, l’humeur et l’éducation des deux personnages, n’avait rien que de très plausible ; mais il était difficile à M. Havisam de se faire une opinion à cet égard. Quant à l’enfant, sa mère prétendait tantôt qu’il avait été inscrit à une paroisse, tantôt qu’il l’avait été à une autre, et l’on reconnut bientôt que tous les prétendus renseignements donnés à cet égard étaient de la dernière fausseté.
C’est au milieu des incertitudes causées par ces découvertes qu’arrivèrent la lettre de M. Hobbes et celle de M. Harrisson, le jeune avocat de New-York.
On devine quelle émotion elles causèrent chez ceux à qui elles étaient adressées. Le comte fit immédiatement appeler M. Havisam, et tous deux, enfermés dans la bibliothèque, se concertèrent quant à la conduite à tenir dans cette circonstance.
« Après les trois entrevues que j’eus avec elle, dit l’homme de loi, je commençai, ainsi que j’ai eu l’honneur de le dire à Votre Seigneurie, à la suspecter fortement. Il me sembla tout d’abord que l’enfant était plus âgé qu’elle ne le disait ; puis elle fit un lapsus au sujet de la date de sa naissance et essaya de se rattraper pour pallier sa méprise. L’histoire que ces lettres nous révèlent vient confirmer plusieurs de mes soupçons. Ce qu’il y aurait de mieux à faire, selon moi, ce serait de télégraphier aux deux frères Tipton, Ben et Dick, de venir ici au plus vite, et de ne rien dire, bien entendu, à la prétendue lady Fautleroy des renseignements que nous venons de recevoir.
« Quand son mari et son beau-frère seront arrivés, on la confrontera avec eux sans qu’elle s’y attende. Cette femme est, après tout, un pauvre conspirateur. En se voyant en présence de ces deux hommes, elle sera saisie et se trahira sur-le-champ, rien que par son attitude. »
Ce plan fut approuvé par le comte, et il en résulta ce qu’on en attendait. Afin que la femme ne conçût aucun soupçon, M. Havisam continua à avoir avec elle des entrevues où il lui annonçait qu’il poursuivait ses investigations, essayant de la faire causer, juste assez pour la tenir en haleine, mais peu soucieux de ce qu’elle pourrait dire, maintenant qu’il avait sur ses mensonges des preuves convaincantes. Elle conclut de la conduite de M. Havisam qu’elle était parvenue à détruire tous les soupçons ; alors, se croyant sûre de ne pas être découverte, elle commença à devenir aussi insolente qu’on pouvait s’y attendre.
Mais un matin, comme elle était assise dans une pièce de l’auberge des « Armes de Dorincourt » qu’elle décorait du nom de salon, occupée à édifier les châteaux en Espagne de sa fortune future, M. Havisam fut annoncé. Il était accompagné de trois personnes : le comte, un jeune garçon de treize à quatorze ans à la mine avisée, plus un homme d’une trentaine d’années, aux traits énergiques.
La femme se dressa tout debout, comme mue par un ressort.
Un cri de terreur s’échappa de ses lèvres avant qu’elle pût le retenir.
Quand par hasard elle pensait aux deux personnes qui étaient entrées derrière le comte, ce qui lui était bien rarement arrivé depuis les dernières années, c’était comme à des gens dont elle n’avait pas à s’inquiéter, qui vivaient à des milliers de lieues. Elle ne s’était jamais attendue à les revoir, et voilà, qu’ils se dressaient tout à coup devant elle.
Son agitation n’avait pas échappé à Dick, car notre jeune ami était une de ces deux personnes.
« Hé ! c’est donc vous, Minna ! » fit-il d’un ton gouailleur en l’apercevant.
Son compagnon, qui n’était autre que Ben, demeura quelques instants en contemplation devant la jeune femme.
« La reconnaissez-vous ? dit M. Havisam, dont les regards allaient de l’un à l’autre.
— Oui, dit enfin Ben, je la reconnais, et elle me reconnaît aussi. »
Alors il reporta ses yeux d’un autre côté et poursuivit son chemin jusqu’à l’extrémité de la pièce. Il s’approcha de la fenêtre et regarda au dehors. Il ne semblait pas avoir d’autre idée, et tel était bien son but en effet, que de détourner ses yeux et sa pensée d’un objet qui lui était désagréable. Alors la femme, se voyant démasquée, perdit toute retenue, et se laissa aller à un de ces accès de rage dont les deux frères autrefois avaient souvent été les témoins.
Cette explosion de colère ne fit qu’augmenter les ricanements moqueurs de Dick. Il semblait prendre un grand plaisir à la voir s’y livrer et à l’entendre exhaler ses menaces en les accablant d’injures. Mais Ben ne paraissait pas y trouver la même satisfaction et demeurait le visage obstinément tourné au dehors.
« Je peux jurer devant n’importe quel tribunal, finit-il par dire à M. Havisam, que cette femme est ma femme, et je peux faire venir une douzaine de camarades qui le jureront comme moi. Son père était un honnête homme, quoique ce ne fût qu’un homme du peuple. Il vit encore et il est aussi honteux que moi-même de la conduite de sa fille. Il la reconnaîtrait bien, et il pourrait vous dire s’il n’est pas vrai que je l’ai épousée, pour mon malheur ! »
Il se décida à se retourner.
« Où est mon garçon ? dit-il en s’adressant à sa femme. Où est-il ? Je veux l’emmener ! Il est resté trop longtemps avec vous… Et moi aussi j’y suis resté trop longtemps. »
Comme il prononçait ces paroles, la porte qui conduisait à la chambre à coucher de Minna fut entr’ouverte doucement, et une tête d’enfant, probablement attiré par le bruit des voix, se glissa par l’entre-bâillement. Ce n’était pas précisément celle d’un beau garçon, mais c’était après tout une figure franche et réjouie. Sa ressemblance avec Ben était frappante.
Celui-ci marcha vers le nouveau venu et le prit par la main ; il était facile de voir qu’il était profondément agité.
« Je peux jurer aussi que cet enfant est le mien, dit-il d’une voix où l’on sentait un tremblement. Oui, c’est mon fils et celui de cette mère indigne. — Tom, ajouta-t-il, je suis ton père et je vais t’emmener. »
Une expression de satisfaction bien marquée se répandit sur les traits du petit garçon ; évidemment il lui était plus agréable de suivre cet homme que de rester avec la femme qui prétendait être sa mère.
Depuis plusieurs mois, il s’était produit tant de changements dans son existence, il avait mené une vie si aventureuse, qu’il n’éprouvait aucun étonnement à entendre dire par cet étranger qu’il était son père, pas plus qu’il ne l’avait été, quelques mois auparavant, quand une femme, qu’il ne se rappelait jamais avoir vue, était venue le chercher en l’appelant son enfant. Elle était bien sa mère en effet, quoiqu’il lui eût plu de l’abandonner jusqu’au jour où il lui avait semblé avantageux de le reprendre.
« Oui, c’est son fils, le fils de Ben et de Minna, fit Dick ; je n’en voudrais d’autre preuve que la cicatrice que voici. »
Et il montrait une petite tache blanchâtre, en forme d’étoile, que l’enfant portait au menton.
« Vous rappelez-vous, Minna, d’où lui vient cette cicatrice ? dit-il à sa belle-sœur en ricanant. C’est une des marques de votre tendresse maternelle. Il est vrai de dire que quand vous lui avez jeté le plat à la tête, ce n’est pas à lui que vous le destiniez. »
Et il se mit à rire de nouveau.
« Partons, dit Ben à Tom en le prenant par la main. Où est ton chapeau ? »
L’enfant s’empressa d’aller le chercher ; puis il revint prendre avec confiance la main que son père lui tendait.
« Si vous avez encore besoin de moi, dit Ben à M. Havisam, en se dirigeant vers la porte, vous savez où me trouver. »
Il sortit de la chambre, tenant l’enfant par la main et sans jeter le moindre regard sur Minna, qui, prise de rage, continuait à l’invectiver, pendant que ses yeux noirs lançaient des éclairs de fureur.
Le comte avait placé tranquillement son lorgnon sur son nez aristocratique et la considérait avec le plus grand sang-froid, comme il aurait regardé un tigre ou un chat sauvage.
« Allons, allons, jeune dame, dit M. Havisam quand Ben, accompagné de son frère, eut quitté la pièce ; allons, tout ce que vous dites ne signifie rien. Si vous ne voulez pas être mise en prison, il faut tâcher de vous contenir. »
Il y avait quelque chose de si péremptoire dans le ton de l’homme d’affaires, que probablement Minna sentit que ce qu’elle avait de mieux à faire c’était de suivre ce conseil. Elle se leva, jeta un dernier regard de haine et de colère sur les deux hommes et sortit du salon, en jetant violemment la porte derrière elle.
« Nous en voilà débarrassés, j’espère, dit M. Havisam, et nous n’aurons plus à nous en occuper. »
En effet, cette nuit même elle quitta l’auberge des « Armes de Dorincourt », et on n’entendit plus parler d’elle.
XXXIV
Quand le comte sortit de l’auberge, après cette entrevue :
« À la Loge ! dit-il à Thomas en remontant en voiture.
— À la Loge ! » répéta Thomas au cocher en sautant sur le siège à côté de lui.
Et il ajouta :
« Vous pouvez compter que les choses vont prendre une tournure tout à fait inattendue. »
Quand le coupé s’arrêta devant l’habitation de Mme Errol, Cédric était dans le salon avec sa mère.
Le comte entra sans être annoncé. Il semblait d’un pouce plus grand que de coutume et paraissait rajeuni de plusieurs années ; ses yeux lançaient des flammes.
« Où est lord Fautleroy ? » fit-il en s’arrêtant sur le seuil de la pièce.
Mme Errol s’avança au-devant de lui ; la rougeur de ses joues trahissait son émotion.
« Est-il encore lord Fautleroy ? demanda-t-elle. L’est-il réellement ?
— Oui, répondit le comte, il l’est ; il est mon seul petit-fils et mon seul héritier. »
Puis, posant la main sur l’épaule de Cédric :
« Fautleroy, dit-il de son ton brusque et impératif, demandez à votre mère quand elle viendra habiter avec nous au château. »
Cédric courut à sa mère et l’enveloppant de ses bras :
« Pour vivre avec nous ! s’écria-t-il, pour vivre avec nous toujours ! dites, Chérie, quand viendrez-vous ? »
Mme Errol leva les yeux vers le comte. Il était grave, mais ses traits avaient perdu leur dureté habituelle ; néanmoins on voyait qu’il avait mis dans son esprit que le désir exprimé en ce moment ne souffrirait pas de contradiction ni même de retard. Depuis quelque temps, il commençait à penser que le meilleur moyen de se faire aimer de son petit-fils c’était de se réconcilier avec sa mère, et la conversation qu’il avait eue quelques semaines auparavant avec Mme Errol lui avait fait voir que cette réconciliation ne pouvait qu’être avantageuse pour lui à tous les points de vue. Aussi avait-il résolu de ne pas perdre de temps pour la réaliser.
« Êtes-vous sûr qu’il vous sera agréable que j’aille vivre avec vous ? demanda Mme Errol avec son doux et aimable sourire.
— Tout à fait sûr, répliqua brusquement le comte, et nous espérons que ce sera bientôt. »
Avant que Ben retournât en Amérique, M. Havisam eut une entrevue avec lui. Il lui apprit que le comte voulait reconnaître le service qu’il lui avait rendu en venant démasquer les intrigues de sa femme ; que de plus son intention était de faire quelque chose pour l’enfant qui avait failli devenir lord Fautleroy. Il lui demanda donc comment il pourrait l’obliger. Ben

répondit que si le comte voulait lui avancer quelque argent
pour acheter des bestiaux, il s’établirait fermier à son compte au
lieu d’être au compte des autres, comme il l’avait été jusque-là,
et qu’il pourrait ainsi faire une petite fortune. Le comte doubla la somme que Ben demandait à emprunter et la lui donna en
toute propriété. Le jeune homme partit donc, avec son fils, pour
la Californie. Il trouva une petite ferme à acheter dans de
bonnes conditions, et fit si bien ses affaires, qu’au bout de
quelques années il devint un des plus riches propriétaires des
environs. Tom, qui s’était attaché tendrement à son père et
qui était devenu un beau et brave jeune homme, le seconda
avec tant d’ardeur dans ses entreprises, que Ben avait coutume
de dire que son garçon le dédommageait amplement de tous les
malheurs qu’il avait éprouvés dans le cours de son existence. Dick
ne retourna pas en Amérique en même temps que lui. Il avait
été décidé, dès le principe, que le comte se chargerait de l’avenir
du jeune garçon et lui ferait donner une solide éducation.
M. Hobbes avait accompagné le frère de Ben en Angleterre ; et si nous n’en avons pas encore informé le lecteur, c’est que son intervention n’avait pas été nécessaire pour le dénouement des intrigues ourdies par la fausse lady Fautleroy. Il s’était décidé au voyage, l’occasion lui semblant propice pour revoir son jeune ami. D’ailleurs pouvait-on savoir, s’il y avait procès, comment les choses se termineraient ? Si elles ne s’arrangeaient pas à la satisfaction du vieux lord, si Tom était admis par les tribunaux comme le fils de Bévis et comme l’héritier du comte de Dorincourt, peut-être Cédric et sa mère reviendraient-ils à New-York. M. Hobbes alors les y ramènerait, et le brave homme (si ardent républicain qu’il fût) était tellement combattu par le désir de voir son petit ami porter les titres de lord et de comte et par celui de le voir revenir à New-York qu’il ne savait pas ce qu’il préférait des deux.
XXXV
M. Hobbes était donc parti, laissant sa boutique entre les mains d’un représentant. Les affaires complètement terminées par la disparition de Minna et par le départ de Tom, M. Hobbes aurait pu partir à son tour ; mais il céda aux instances de Cédric, qui voulait absolument que son vieil ami assistât aux fêtes qui devaient être célébrées à l’occasion de son neuvième anniversaire de naissance. Tous les tenanciers avaient été invités ; il devait y avoir festin, danses et jeux dans le parc, sans compter des illuminations et un feu d’artifice le soir.
« Et mon jour de naissance est le Quatre Juillet ! Est-ce heureux, hein ! monsieur Hobbes, que cela tombe précisément ce jour-là ? car alors nous pourrons faire les deux fêtes ensemble ! Comme cela se trouve bien ! »
Nous devons confesser que d’abord le comte et M. Hobbes n’avaient pas été tout à fait aussi intimes que Cédric se l’était imaginé. Jusque-là le comte avait eu très peu de rapports directs avec des épiciers, de même que M. Hobbes en avait eu peu avec les lords. Aussi, dans leurs rares entrevues, la conversation n’était-elle pas très animée. Il faut dire aussi que quand le brave négociant allait au château, il était quelque peu impressionné par les splendeurs qui régnaient autour de lui, et son aplomb naturel de commerçant satisfait, de ses affaires, se changeait en timidité quand Cédric lui faisait les honneurs de l’habitation de son grand-père et lui en détaillait les beautés, comme il pensait que c’était son devoir de le faire. La porte d’entrée, avec les deux lions de pierre qui la décoraient, avait le don de le plonger dans une stupéfaction qui augmentait quand il apercevait le donjon avec ses tours massives, les parterres remplis de fleurs, les terrasses avec des paons faisant la roue sur les balustres de pierre ouvragée, le grand escalier avec les rangées de valets en livrée s’alignant de chaque côté, lorsqu’il passait escorté de Cédric, ou plutôt lorsque Cédric passait en l’accompagnant. Cette satisfaction, on le pense bien, ne diminuait pas quand lord Fautleroy lui faisait visiter les serres remplies de fleurs exotiques, les écuries où chaque cheval avait son appartement séparé et sa généalogie inscrite sur sa stalle, la salle d’armes avec les armures dressées comme autant de chevaliers prêts au combat. Mais c’était surtout la galerie de peinture qui lui causait le plus d’étonnement.
« C’est quelque chose comme un musée, dit-il la première fois que l’enfant l’introduisit dans la vaste pièce, entourée de portraits d’hommes et de femmes habillés à la mode du temps passé, les uns couverts d’armures, d’autres portant la grosse perruque à la Louis XIV ; — oui, quelque chose comme un musée ; j’en ai déjà vu à New-York.
— Non, non, je ne crois pas, dit Cédric avec un peu d’hésitation, car il n’était pas bien sûr de ce qu’il avançait ; non, je ne crois pas que ce soit tout à fait la même chose. Mon grand-père n’appelle pas cela un musée : il dit que ce sont mes ancêtres.

— Vos ancêtres ! répéta M. Hobbes, dont toute la généalogie remontait à son père, sa mère étant morte peu de temps après sa naissance, et qui non seulement n’avait jamais vu ses grands-pères et ses grand’mères, lesquels avaient vécu très loin de New-York, mais qui savait à peine qui ils étaient ; vos ancêtres !…
— Oui, le père et la mère de grand-père ; et puis leur père et leur mère ; et puis le père et la mère de ceux-là ; et ainsi de suite, toujours en remontant, jusqu’à… »
Et il leva le doigt.
« Jusqu’à… continua-t-il, ma foi ! je ne sais plus son nom ; je crois seulement que c’était quelqu’un qui vivait du temps de Guillaume le Conquérant. »
Par le fait, il trouva plus sûr d’avoir recours à l’assistance de Mme Milon, la femme de charge. Elle savait par cœur le nom de tous ceux que représentaient les portraits, ainsi que celui du peintre qui les avait faits. Elle connaissait en outre leur histoire à fond et pouvait même y ajouter des incidents romanesques. Quand M. Hobbes fut arrivé à se débrouiller un peu dans tous les personnages qui formaient le sujet des tableaux, il les trouva si intéressants, et la galerie de peinture exerça sur lui une telle fascination, qu’il ne put plus s’en arracher. La pensée que ces personnages imposants appartenaient tous à la famille de Cédric les lui faisait regarder comme autant de héros.
Souvent il quittait l’auberge des « Armes de Dorincourt », où il s’était installé, et se rendait au château, rien que pour aller passer une heure ou deux en compagnie « des ancêtres de Cédric », contemplant, sans se lasser, les belles dames et les beaux cavaliers qui le suivaient obstinément du regard, tandis qu’il errait dans la somptueuse galerie.
« Et tous comtes ! disait-il ; tous comtes ! Et lui aussi sera comte comme eux ! »
Intérieurement les comtes et leur manière de vivre ne déplaisaient pas autant, à beaucoup près, à M. Hobbes qu’il se l’était imaginé, et on peut même se demander si les sentiments républicains de l’épicier n’étaient pas quelque peu ébranlés par cette intimité avec l’héritier d’un comte et avec ses ancêtres. Dans tous les cas, il fit entendre un jour une très singulière et très remarquable réflexion :
« Il ne m’aurait pas absolument déplu d’être moi-même un comte, » dit-il ; — et, étant connues les dispositions premières du personnage, cette déclaration pouvait passer pour une véritable concession.
XXXVI
Quel beau jour que celui de l’anniversaire de naissance du petit lord, et combien Sa petite Seigneurie parut en jouir ! Le parc était rempli de gens portant leurs habits de fête, dont les couleurs gaies et voyantes brillaient entre les arbres des bosquets, pendant que les drapeaux, les bannières et les banderoles flottaient au-dessus des tours du château et des tentes préparées pour les danses et les rafraîchissements. Parmi les gens valides, personne, hommes, femmes ou enfants, n’avait voulu garder la maison ce jour-là ; chacun était heureux de voir le petit lord Fautleroy, qu’on avait failli perdre, être encore le petit lord Fautleroy, l’héritier du comte et un jour le maître du domaine. Chacun voulait avoir un regard de lui et aussi de son aimable mère, qui avait su se faire tant d’amis parmi les pauvres gens. Le comte bénéficiait des sentiments qu’inspiraient son petit-fils et sa belle-fille. On peut même dire que ses vassaux commençaient à se sentir bien disposés pour lui. Par le fait, on ne demandait pas mieux que de l’aimer, à cause du petit garçon qui l’aimait et qui avait confiance en lui, et de la douce et gracieuse créature qu’il avait si longtemps haïe, et que maintenant il traitait avec le respect qu’il devait à la mère de son héritier. Quelques-uns prétendaient même que le comte ne tarderait pas à aimer sa belle-fille, et on se disait qu’entre le petit lord et sa mère, le vieux seigneur au cœur sec et dur arriverait peut-être, avec le temps, à devenir un seigneur humain et bienveillant ; qu’il changerait alors de conduite envers ses tenanciers et qu’il s’occuperait de faire le bonheur de ceux qui étaient dans sa dépendance, ce dont, jusque-là, il n’avait pas paru se soucier. Cette pensée rendait tout le monde joyeux.
Quelle foule dans les bosquets, sous les grands arbres et sur le gazon !
Tous les voisins du comte s’étaient rendus au château pour assister à la fête, pour adresser au vieux lord leurs félicitations et pour faire connaissance avec Mme Errol. Lady Lorridale avec son mari, ainsi que miss Viviane Herbert, se trouvaient parmi eux.
Quand Cédric avait aperçu miss Viviane, il était accouru vers elle ; la jeune dame l’avait pris dans ses bras et l’avait embrassé comme s’il eût été pour elle un petit frère tendrement préféré.
« Cher petit Fautleroy, disait-elle, cher petit ami ! quand je pense que nous avons été sur le point… ! Que je suis heureuse qu’il n’en ait rien été ! »
Elle parcourut le parc avec lui, car Cédric voulait lui montrer tout ce qui avait été préparé ; puis elle se laissa conduire par lui auprès de M. Hobbes et de Dick.
« Miss Viviane, voici mon vieil ami M. Hobbes, dit l’enfant en lui présentant l’épicier, et mon autre ami Dick. Je leur ai dit combien vous étiez belle, et je leur ai promis qu’ils vous verraient si vous veniez pour mon jour de naissance. »
Miss Viviane donna une poignée de main à M. Hobbes et une autre à Dick, leur parla de leur voyage, de l’Amérique, de ce qu’ils avaient fait ou vu depuis qu’ils étaient en Angleterre. Cédric l’écoutait avec ravissement, heureux de penser que ses deux amis allaient avoir, comme lui, la belle miss en admiration et en adoration.
« C’est bien la plus jolie dame que j’aie jamais vue, déclara Dick à M. Hobbes, quand miss Viviane les eut quittés, en les saluant d’un sourire ; oui, la plus jolie et la plus aimable. » Et il la suivait des yeux tandis que, toujours accompagnée de Cédric, elle parcourait les groupes des paysans, les regardant danser, disant un mot gracieux à l’un et à l’autre.
La gaieté continuait à régner dans le parc ; les jeux attiraient tous les amateurs ; les orchestres étaient toujours entourés de danseurs et de danseuses, et les tables, les buffets garnis de victuailles de toutes sortes, n’étaient pas non plus désertés. Tout le monde semblait parfaitement heureux, à commencer par le petit héros de la fête.
Un autre homme aussi était heureux ; c’était un vieillard qui, quoiqu’il eût toujours été riche et haut placé, n’avait jamais connu le bonheur véritable. Peut-être se sentait-il plus heureux qu’il ne l’avait jamais été, parce qu’il se sentait meilleur. Il n’était pas, en réalité, devenu aussi bon que Cédric s’était toujours imaginé qu’il l’était ; mais du moins il commençait à aimer quelqu’un, et, à plusieurs reprises, il lui était arrivé de trouver une sorte de plaisir à faire les choses bonnes et utiles, qu’un chaud et tendre petit cœur d’enfant lui avait suggérées. C’était un commencement. Chaque jour aussi, depuis celui où Mme Errol était venue s’établir au château, il se plaisait davantage avec sa belle-fille. À son grand étonnement, il sentait même naître en lui une sorte d’attachement pour elle. Il aimait à entendre sa douce voix et à regarder son doux visage. Quand il était enfoncé dans son grand fauteuil, au coin de la fenêtre de la bibliothèque, il aimait à la suivre des yeux et à l’écouter parler à son fils. Il entendait alors des expressions de douceur et de tendresse qui étaient toutes nouvelles pour lui, et il commençait à s’expliquer comment l’enfant qui avait vécu à New-York et s’était lié d’amitié avec un épicier et un petit décrotteur, avait néanmoins d’assez bonnes manières pour n’être pas déplacé dans l’un des plus beaux châteaux et parmi la société la plus aristocratique d’Angleterre, et comment il se faisait qu’il s’était trouvé tout de suite à la hauteur de sa situation, quand le sort en avait fait l’héritier d’un comte.
C’était facile à comprendre en effet : il avait suffi que l’enfant vécût auprès d’un cœur aimant et dévoué, qui lui avait inspiré des pensées d’amour et de dévouement et qui lui avait appris à s’oublier pour les autres, pour qu’il devînt ce qu’il était. Il avait su attirer l’affection, parce qu’il était affectueux lui-même, et les grandeurs ne l’avaient ni gâté ni ébloui, parce qu’il était simple de cœur et qu’il ne voyait dans la puissance et la richesse que le moyen d’être utile à autrui.
Tandis que le comte de Dorincourt le suivait des yeux, ce
signe de tête à ceux qui le saluaient, parlant à ceux qu’il connaissait, montrant à ses deux amis, M. Hobbes et Dick, les choses les plus intéressantes de la fête, ou bien encore se tenant près de sa mère ou des autres dames, les écoutant causer ou causant avec elles, le noble lord se répétait qu’il ne pouvait trouver pour petit-fils un enfant qui satisfît mieux son orgueil et qui représentât plus dignement sa race.
Les plus importants parmi les tenanciers s’étaient réunis près d’une grande tente où devait être servie une grande collation, et ils s’y préparaient en portant des santés, selon la mode anglaise. Ils avaient bu à celle du comte avec plus d’enthousiasme qu’ils ne l’avaient jamais fait jusque-là. On proposa ensuite celle de lord Fautleroy.
Si quelqu’un avait eu des doutes sur la question de savoir si Cédric était aimé ou non de ses futurs vassaux, il aurait été complètement rassuré par la clameur, accompagnée d’applaudissements, qui s’éleva à cette proposition. Même la présence des dames du château, qui assistaient à la fête, n’eut pas le pouvoir de contenir les éclats de joie de tous ces braves gens, et de les empêcher de pousser les hourras les plus énergiques, pendant qu’ils contemplaient, entre le comte et sa mère, le petit lord, dont le contentement se lisait sur la figure radieuse, en se voyant l’objet d’une pareille ovation.
« Que Dieu, le bénisse, le pauvre cher petit ! disaient les bonnes femmes, tandis que Cédric saluait à droite et à gauche ; que Dieu le bénisse !
— C’est parce qu’ils m’aiment, n’est-ce pas, Chérie ? disait le petit lord à sa mère ; c’est parce qu’ils m’aiment qu’ils m’acclament ainsi ? Oh ! que je suis heureux ! »
Le comte posa la main sur l’épaule de l’enfant.
« Fautleroy, dit-il, parlez-leur et dites-leur ce que vous pensez de l’accueil qu’ils vous font.
— Faut-il vraiment que je parle ! » dit Cédric en levant les yeux sur son grand-père et en les reportant sur sa mère, puis sur miss Herbert, comme pour demander un peu d’aide.
Mme Errol sourit, ainsi que miss Viviane, avec un signe de tête encourageant.
Cédric fit alors un pas en avant.
« Je vous suis très obligé, dit-il, pour votre politesse ; et… et… j’espère que vous vous amusez pour mon jour de naissance : car moi je m’amuse beaucoup. Je suis très content de voir que vous m’aimez ; moi aussi je vous aime tous et je désire que tous vous soyez heureux ; mon grand-père le désire comme moi, car il vous aime beaucoup aussi. Il est si bon ! Quand je serai grand et que je serai devenu comte, j’essayerai d’être aussi bon que lui, et de faire votre bonheur à tous comme il a toujours essayé de le faire. »
Et au milieu des hourras et des applaudissements, Cédric reprit en souriant sa place à côté de son grand-père, et mit sa main dans celle du comte en se penchant affectueusement contre lui.
Et c’est la fin de mon histoire. Je n’ai plus que quelques mots à ajouter, touchant M. Hobbes. Le vieil épicier fut tellement fasciné par tout ce qu’il avait vu au château de Dorincourt et il éprouvait tant de répugnance à quitter son jeune ami, qu’il ne put se décider à retourner en Amérique. Il vendit sa boutique d’épicerie de New-York et en ouvrit une autre dans le village de Dorincourt. Son commerce, patronné par le château, réussit parfaitement. Quoique le comte et M. Hobbes, comme on peut le croire, ne vécussent pas sur le pied d’une grande intimité, M. Hobbes ne tarda pas à devenir plus aristocrate que le vieux lord lui-même. Il lisait tous les matins la Gazette de la cour et suivait avec le plus vif intérêt tout ce qui se passait à la Chambre des lords. Quelques années après, quand Dick, qui, par les soins du comte, avait terminé son éducation, lui proposa de retourner en Amérique, où lui-même allait rejoindre son frère :
« Merci, lui dit-il ; je ne veux pas aller vivre là-bas ; j’ai besoin de rester à côté de lui. Certainement l’Amérique est un bon pays, pour quelqu’un qui a sa fortune à faire ; mais il y manque quelque chose : il n’y a ni noblesse, ni lords, ni comtes ! »
Jules Bardoux, Directeur
Comédie du moyen âge arrangée en vers modernes
Par GASSIES DES BRULIES
AVEC 16 PLANCHES EN TAILLE DOUCE PAR BOUTET DE MONVEL
Un magnifique volume in-4o avec reliure spéciale, 10 fr.
Collection de volumes format in-8o jésus. Br., 10 fr. Rel. tr. dorées, 13 fr.
UN DÉSHÉRITÉ Par EUDOXIE DUPUIS Illustrations de SANDOZ
LA MISSION DU CAPITAINE Par Ch. DE CHARLIEU Illustrations de SANDOZ
Les Héritiers de Montmercy, par E. Dupuis, illustr. de Brach et Sandoz. — L’Espion des écoles, par Louis Ulbach, illustrations de Carl Larsonn. — Mont Salvage, par S. Blandy, illustrations de Sandoz. — Le Vœu de Nadia, par Henry Gréville, illustrations d’Adrien Marie.
LE LIVRE DES PETITS
Par JEAN AICARD, Illustrations de SANDOZ
Souvenirs d’un petit Alsacien, par Pierre du Chateau, illustr. de J. Girardet. — La Nouvelle Schéhérazade, par Leïla Hanoun, illustr. de Ferdinandus. — Les Trois Petits Mousquetaires, par Emile Desbeaux, illustr. de Ferdinandus, Scott, etc. — À la recherche d’une ménagerie, par E. Dupuis, illustr. de Birch.
LE ROMAN DE CHRISTIAN Par Pierre Du Chateau Illustrations de SANDOZ
La Succession du Roi Guilleri Par CH. SÉGARD Illustrations de B DE MONVEL.
LA CHASSE AUX LIONS Par Alfred ASSOLLANT Illustrations de J. GIRARDET.
Pharos, par A. Piazzi, illustr. de Sandoz. — La Petite Maison rustique, par Marthe Bertin, illustr. de Clérice. — Vie et Aventures de Trompette, par J. Anceaux, illustr. de B. le Monvel. — Trois Mois sous la neige, par J. Ponchat, illustr. de Ch. Donzel. — Madame Grammaire et ses enfants, par Marthe Bertin, illustr. de Ginos. — La Rose et l’Anneau, par Titmarsh, illustr. de Poirson. — Bébés et Papas, par Ch. Ségard, illustr. de Ferdinandus.
LA CHASSE AU PHÉNIX Par DANIEL BERNARD Illustrations de Clerget, Stop, Vierge, etc.
IMPRESSIONS ET SOUVENIRS DE VOYAGE DANS LES PAYS DU NORD DE L’EUROPE Par LÉOUZON LE DUC Illustrations de Breton, Hubert-Clerget, etc.
Les Entreprises d’Harry, par Eudoxie Dupuis, illustr. de Birch et Sandoz. — Les Disciples d’Eusèbe, par E. Dupuis, illustr. de Courboin. — Histoire d’une ferme, par A. Narjoux, illustr. de l’auteur.
LES COMÉDIENS MALGRÉ EUX
Les Sept Métiers du petit Charles, par Léonce Petit. — Sans Souci, par A Piazzi. — Les Petites Conteuses, par A. Piazzi. — Les Petits Hommes, par Louis Ratisbonne. — Les Petites Femmes, par Louis Ratisbonne. — L’Éducation musicale de mon cousin Jean Garrigou, par Léopold Dauphin. — Les Pupazzi de l’enfance, par Lemercier de Neuville. — La Mésange, par V. Aury. — Les Lettres d’oiseaux, par R de Najac. — Histoire des mois, par Mélanie Talandier. — Les Contes de Saint Nicolas, par Lemercier de Neuville. — De fil en aiguille, par V. Aury. — Le Nid de pinson, par R. de Najac. — Les Épreuves de Jean, par Marthe Bertin.
Br., 5 fr. Rel. toile, tr. dor., 7.50.
La Comédie des animaux, par Méry, illustr. de Eu. Morin, Kirschner, etc. — Voyage scientifique autour de ma chambre, par A. Mangin, illustr. de Lix, A. Marie, etc. — À la recherche de la pierre philosophale, par Ed. Morin, illustr. de Besnier, Max, etc. — La Guerre, par Carlo du Monge, illustr. de V. Poirson.
Par UN ANCIEN SAINT-CYRIEN
52 PLANCHES HORS TEXTE EN PHOTOTYPIE. — DESSINS DE JAZET