Journal (Eugène Delacroix)/Texte entier
DE
EUGÈNE DELACROIX
TOME PREMIER
1823-1850
PRÉCÉDÉ D’UNE ÉTUDE SUR LE MAÎTRE
par PAUL FLAT
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS PAR MM. PAUL FLAT ET RENÉ PIOT
Portraits et fac-similé
PARIS
LIBRAIRIE PLON
PLON-NOURRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIÈRE-6e
Tous droits réservés
DE
EUGÈNE DELACROIX

eau forte de Paul Colin
d’après un dessin original de A. Colin
DE
EUGÈNE DELACROIX
TOME PREMIER
1823-1850
PRÉCÉDÉ D’UNE ÉTUDE SUR LE MAITRE
par PAUL FLAT
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS PAR MM. PAUL FLAT ET RENÉ PIOT
Portraits et fac-similé
PARIS
LIBRAIRIE PLON
PLON-NOURRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIÈRE-6e
Tous droits réservés
Le Journal d’Eugène Delacroix se compose de notes prises au jour le jour, écrites à bâtons rompus, où le grand artiste jetait chaque soir au courant de la plume, sans ordre, sans plan, sans transitions, toutes les idées, les réflexions, les théories, les extases, les découragements qui pouvaient traverser son esprit toujours en travail.
Commencé en 1823 par un jeune homme de vingt-deux ans, dans la fièvre d’une vie ardente et tourmentée, ce Journal a d’abord l’allure rapide et quelque peu décousue ; à mesure que les années s’avancent, le sang s’apaise, l’esprit se mûrit et s’élève, l’expérience naît, l’horizon s’élargit, le style se précise et les aperçus succincts du début font place peu à peu à de véritables morceaux littéraires.
Ces notes qui n’étaient pas destinées à voir le jour et qui embrassent une période de plus de quarante années, se trouvent consignées sur une série de petits cahiers, de calepins et d’agendas portant chacun sa date.
L’existence de ce Journal était connue : des copies en furent prises ; à la mort de Delacroix, elles demeurèrent entre les mains de l’élève le plus fidèle, du véritable disciple du maître, le peintre Pierre Andrieu, à qui nous devons rendre ici un sincère hommage. La vénération d’Andrieu pour Delacroix avait revêtu le caractère d’une véritable religion : dépositaire de la pensée du grand peintre, il résolut de la garder pour lui seul, et, tant qu’il vécut, il se refusa à publier ces pages qu’il relisait sans cesse.
Pierre Andrieu est mort l’an dernier. Sa veuve et sa fille n’ont pas cru devoir priver plus longtemps le public d’un document si précieux pour l’histoire de l’art, et elles nous ont confié la mission de le mettre au jour. La publication actuelle est donc faite d’après les papiers remis à Pierre Andrieu. Mais pour écarter toute critique, éviter toute erreur et assurer à la pensée de l’écrivain toute son exactitude et toute son autorité, les éditeurs ont pensé qu’il était indispensable de contrôler ces notes, page par page, sur les manuscrits originaux. Le petit-neveu du grand peintre, M. de Verninac, sénateur du Lot, avec une bonne grâce et une courtoisie dont nous ne saurions trop le remercier, nous a permis de faire ce travail de vérification sur les originaux eux-mêmes, qu’il a bien voulu nous communiquer.
Si dans ce Journal certaines lacunes sont à constater, notamment pour la période de 1848, par contre nous avons eu la bonne fortune de retrouver certains carnets qu’on croyait égarés. Le fameux voyage au Maroc, dont la trace semblait perdue, appartient aujourd’hui à M. le professeur Charcot, qui nous a permis de reproduire cet épisode capital dans la carrière artistique du maître ; nous sommes heureux de pouvoir lui adresser ici l’expression de notre gratitude.
Nous avons fait également appel au souvenir des anciens amis, des élèves et des admirateurs de Delacroix ; tous se sont empressés de mettre à notre disposition les renseignements et les documents qu’ils pouvaient posséder. En nous accordant leur bienveillant concours, Mme Riesener, M. le marquis de Chennevières, MM. Robaut, Faure, Paul Colin, Maurice Tourneux, Monval, Bornot, le commandant Campagnac, nous ont aidés dans notre tâche, et c’est un devoir pour nous d’inscrire leurs noms en tête de cette publication.
Pour conserver au Journal son véritable caractère, les éditeurs ont scrupuleusement respecté les divisions du manuscrit, qu’ils publient tel qu’il a été conçu. À côté des aperçus philosophiques, des idées critiques les plus élevées, sur l’art, sur la peinture, la musique et la littérature, on trouvera une foule de notes personnelles qui nous font pénétrer dans la vie même de l’artiste ; car Delacroix a consigné dans ces cahiers tous les détails de son existence, jusqu’aux incidents parfois infimes de sa journée, ses visites, ses promenades, voire même ses dépenses, le prix de vente de ses tableaux et les procédés techniques de sa peinture. Tous ces menus faits, dont quelques-uns pris isolément pourraient paraître quelquefois de peu de valeur, constituent, réunis, un document du plus haut intérêt : il en ressort un Delacroix intime, qu’on avait pu soupçonner déjà par la correspondance recueillie par Philippe Burty et par les notes fragmentaires déjà publiées, mais qui apparaît aujourd’hui dans ces pages avec un relief saisissant. À travers ces impressions personnelles, ces sensations, ces confidences, se dégage une âme, une intelligence, un caractère de qualité tout à fait supérieure.
Pendant plus d’un demi-siècle, Delacroix a été mêlé au mouvement intellectuel de son temps. Il a connu tous les hommes illustres de la monarchie de Juillet, de la République de 1848 et du second Empire. Si l’on excepte quelques compagnons de jeunesse et d’atelier, dont l’amitié est restée fidèle à Delacroix jusqu’à la fin, mais dont la notoriété s’est effacée depuis longtemps, on trouvera inscrits dans ce Journal les noms de la plupart de ceux qui, à un titre quelconque, ont marqué leur place dans le monde des arts, de la littérature et de la politique.
À ce point de vue, on peut donc dire que le Journal de Delacroix est en même temps l’histoire d’une époque.
Delacroix écrit au cours de son Journal : « On ne connaît jamais suffisamment un maître pour en parler absolument et définitivement. » Un tel jugement, qui paraît au premier abord la condamnation de l’étude que nous entreprenons, deviendra facilement, si l’on y réfléchit, un argument en sa faveur. On peut objecter, sans doute, que l’historien d’un esprit péchera toujours par quelque lacune, provenant soit d’un défaut de compréhension qui lui est personnel, soit d’un manque de documents qu’on ne saurait lui reprocher ; il n’en reste pas moins qu’en appliquant à la lettre, jusqu’à ses extrêmes conséquences, l’aphorisme du grand artiste, on aboutirait au néant, qu’il vaut mieux être incomplet que de n’être point du tout, enfin que l’autorité des documents sur lesquels il s’appuie contribue singulièrement à soutenir l’écrivain. Or, quels plus précieux documents pourraient exister que ceux qui sont offerts au public sur Eugène Delacroix ? Quarante années de la vie d’un artiste, depuis l’origine de sa production jusqu’à ses derniers moments, non point complètes, il est vrai : — nous verrons plus tard quelles lacunes on y doit regretter ; — mais quarante années durant lesquelles, avec la franchise et la sincérité qu’on ne saurait avoir qu’envers soi-même, l’homme s’explique en découvrant l’intimité de son être, le penseur expose les vues originales que lui ont suggérées les hommes et les choses ; l’artiste enfin nous fait la confidence de ses plus chères théories d’art, de ses préférences et de ses antipathies, jugeant en toute impartialité ses contemporains, comme il a jugé les maîtres d’autrefois. Dire cela, c’est préciser en même temps les limites où nous devons nous tenir. Ce qui importe ici, en effet, ce n’est pas d’étudier son œuvre ; la chose a été faite, et magistralement : il suffit de citer les noms de Théophile Gautier, de Paul de Saint-Victor, de M. Mantz, de Baudelaire surtout, pour rappeler aux lettrés, aux curieux, les beaux et nombreux travaux composés soit du vivant, soit après la mort du peintre, dans lesquels ces écrivains éminents ont analysé le génie d’Eugène Delacroix et marqué sa place dans l’histoire de l’Art. Recommencer sur ce terrain serait s’exposer à des redites, risquer en outre d’ajouter peu de chose à ce qui a été écrit. L’important est de reconstituer l’homme et le penseur, de montrer à l’aide de ces documents l’universalité de son intelligence, de réunir en un faisceau serré les éléments épars de son individualité, de justifier en un mot aux yeux du lecteur l’importance historique de ces notes journalières, comme Delacroix en marquait à son propre point de vue l’intérêt, lorsqu’il écrivait : « Il me semble que je suis encore le maître des jours que j’ai inscrits, quoiqu’ils soient passés ; mais ceux que ce papier ne mentionne point, ils sont comme s’ils n’avaient point été. »
Il est une double manière pour un homme éminent de faire ses confidences à ceux qui viendront après lui : rédiger des Mémoires ou laisser un Journal. Les Mémoires offrent ceci de particulier qu’ils sont composés d’ordinaire vers la fin d’une carrière ou du moins dans la plénitude des forces intellectuelles, lorsque déjà l’écrivain a atteint un âge assez avancé pour pouvoir embrasser une longue période de sa vie passée et pour avoir acquis, ne fût-ce que vis-à-vis de lui-même, l’autorité nécessaire à ce genre de travail. C’est à la fois leur avantage et leur inconvénient : leur avantage d’abord, parce qu’ils présentent un ensemble soutenu, et, comme tout ouvrage subordonné à un plan, se font lire plus facilement, jusqu’au point où la lassitude commence à envahir l’écrivain ; leur inconvénient enfin, parce qu’ayant été rédigés avec une pensée bien arrêtée de publication et n’étant en somme la plupart du temps qu’une biographie de leur auteur préparée par lui-même, il y a tout à parier qu’il n’y est point sincère en ce qui le concerne. Ce sont précisément les avantages et les inconvénients opposés qui caractérisent un Journal : la monotonie inévitable, conséquence de sa forme même, l’absence forcée de composition, le laisser-aller inhérent au genre, d’autant plus sensible que l’écrivain a été plus éloigné de toute arrière-pensée de publication, voilà des objections capitales pour certains esprits qui dans un livre prisent avant toute qualité l’ordre et la méthode. Est-il besoin d’ajouter qu’au regard du biographe, ces défauts, en admettant qu’il les reconnaisse pour tels, sont des motifs de s’intéresser à des pages dans lesquelles il cherchera de préférence, sinon exclusivement, la signification psychologique et l’affirmation d’une intense personnalité ?
Que penser en particulier du Journal d’Eugène Delacroix ? Chaque fois que l’on procède à une publication de cette nature, il convient, tout en conservant pieusement à l’œuvre son caractère d’intégralité, de se substituer dans la mesure du possible à l’artiste lui-même, et, par un effort d’imagination sympathique, de se demander comment il la ferait, vivant encore, ou même s’il la ferait. C’est là d’ailleurs un point de vue de pure curiosité qui, suivant nous, ne saurait avoir d’influence sur la présentation de l’ouvrage, car nous n’admettons pas qu’en cette matière, et d’autant mieux qu’il s’agit d’un très grand homme comme Eugène Delacroix, une main quelconque vienne, sous prétexte d’ordre ou de convenance, arranger et disposer à sa guise. De tels documents doivent être acceptés tels qu’ils sont : il faut les prendre ou les laisser, il n’est pas permis d’y toucher. Mais revenons à notre question : de la lecture de l’ensemble, il nous paraît résulter que Delacroix eût retouché et présenté peut-être de manière différente les premières années du Journal : on y trouve, en effet, des négligences de style qui n’étaient pas dans le génie du maître. Non qu’il fût de parti pris hostile aux écrits dépourvus de plan ; bien au contraire, on lit dans une page de l’année 1850 ce curieux passage : « Pourquoi ne pas faire un petit recueil d’idées détachées qui me viennent de temps en temps toutes moulées et auxquelles il serait difficile d’en coudre d’autres ?… Faut-il absolument faire un livre dans toutes les règles ? Montaigne écrit à bâtons rompus… Ce sont les ouvrages les plus intéressants. » Et plus tard, en 1853 : « F… me conseille d’imprimer comme elles sont mes réflexions, pensées, observations, et je trouve que cela me va mieux que des articles ex professo. » Ces paroles ne suffiraient-elles pas à justifier, s’il en était besoin, le principe même d’une telle publication ? Quant à la seconde partie du Journal, l’élévation constante de pensée, la préoccupation presque exclusive de l’art, enfin le souci de la forme, nous permettent d’avancer qu’il aurait eu bien peu de chose à faire pour la mener à perfection. À ce propos, nous tenons de Mme Riesener, veuve du peintre qui fut parent de Delacroix, un trait marquant à quel point il se souciait de l’effet que pourraient produire ses écrits. Un après-midi, — c’était dans les dernières années de la vie du maître, — Mme Riesener étant allée le voir à son atelier avec son mari, Delacroix leur montra un cahier manuscrit entr’ouvert : « C’est là-dessus, leur dit-il, que je note chaque jour mes impressions sur les hommes et les choses ; j’ai une réelle facilité pour écrire, et d’ailleurs je fais grande attention, car, maintenant qu’on a la manie de garder, pour les publier plus tard, les moindres autographes des hommes en vue, je soigne même ma correspondance. » Il est manifeste qu’il existe une différence de forme entre les premières et les dernières années du Journal. Lorsque les lecteurs auront sous les yeux toutes les pièces du procès, ils pourront le juger et marqueront leur préférence. Pour nous, si nous reconnaissons la supériorité des dernières années au point de vue littéraire, nous ne saurions nous empêcher de professer à l’égard des premières une tendresse toute spéciale de pur psychologue.
Bien que le Journal et les papiers de famille consultés ne nous apprennent rien de nouveau sur l’enfance et la jeunesse d’Eugène Delacroix, nous ne pouvons négliger cette période de sa vie ; à cet égard, d’ailleurs, les renseignements fournis par ses précédents biographes s’accordent complètement et laissent peu de points obscurs. Eugène Delacroix naquit à Charenton Saint-Maurice, près Paris, le 7 floréal an VI (26 avril 1798). Son père, Charles Delacroix, était alors ambassadeur de France en Hollande. La carrière politique et administrative de ce dernier fut assez brillante : il appartenait à cette catégorie d’esprits imbus des principes philosophiques du dix-huitième siècle, et qui rêvaient d’en tenter l’application à la société environnante ; il avait été d’abord avocat au Parlement, puis secrétaire de Turgot : le département de la Marne l’envoya à la Convention nationale ; il paraît n’y avoir joué qu’un rôle assez effacé, bien que l’ancien Moniteur contienne de lui des discours qui, selon M. Mantz, « ne semblent pas inspirés par une vive tendresse pour le clergé et les choses religieuses ». Sa véritable voie était l’administration : il s’acquitta à son honneur de missions dans les Ardennes et dans la Meuse, et plus tard le Directoire lui confia le ministère des Affaires étrangères ; il fut appelé à ce poste le 12 brumaire an IV et le conserva jusqu’en messidor suivant. Lorsqu’il le quitta, ce fut pour céder la place au prince de Talleyrand ; il eut alors comme compensation l’ambassade de Hollande, puis, après l’organisation des préfectures, termina sa carrière en qualité de préfet de Marseille et de Bordeaux, où il mourut en 1805. Le trait saillant de son caractère paraît avoir été l’énergie ; du moins est-ce celui qui ressort le plus clairement des renseignements fort rares que nous possédons sur son compte. Dans une note du Journal, Eugène Delacroix fait allusion à cette énergie en parlant d’une opération cruelle qu’il dut subir, et durant laquelle il montra un courage stoïque. Peut-être le fils hérita-t-il du père cette force morale qui se traduisit chez le peintre par une volonté indomptable pour tout ce qui concernait son art, par cette incroyable persévérance qui sut triompher de tous les obstacles accumulés devant lui. Quant à la mère de Delacroix, Victoire Oëbène, elle faisait partie d’une famille d’artistes, dont le peintre Riesener fut un des plus honorables représentants : elle était, disent ceux qui l’ont connue, d’une grande distinction physique et d’allures tout aristocratiques. Eugène Delacroix semble avoir eu pour elle une tendre vénération, bien qu’il n’ait pu en conserver qu’un souvenir d’enfant, puisqu’elle mourut en 1814, époque où il n’avait encore que seize ans.
Nous ne pouvons passer sous silence l’hypothèse suivant laquelle Eugène Delacroix serait le fils naturel du prince de Talleyrand. On sait comment se forment ces sortes de légendes, comment, avec le temps, elles prennent peu à peu de la consistance, et, nées d’un simple rapprochement ingénieux, finissent par acquérir un véritable crédit : l’esprit humain est ainsi fait qu’il adopte une croyance non point tant à raison de la valeur ou du nombre des arguments qu’on lui présente en sa faveur, qu’à raison de l’ingéniosité, de la séduction plus ou moins grande qu’elle offre par elle-même : il n’est donc pas surprenant que la réunion de ces deux noms : Talleyrand Delacroix ait trouvé un certain crédit. L’éloignement du père de Delacroix, à l’époque de la naissance de l’artiste, les relations qui existaient entre la famille et le prince de Talleyrand, ce fait que Charles Delacroix, aussitôt après avoir quitté le ministère des Affaires étrangères, fut envoyé en Hollande pour y représenter la France, enfin et surtout une prétendue ressemblance entre le peintre et le prince de Talleyrand, autant de causes qui, se surajoutant, se soudant les unes aux autres, amenèrent certains esprits à cette conviction intime qu’Eugène Delacroix était le fils naturel du grand diplomate : c’est ainsi que s’établissent la plupart des légendes, résultats d’ingénieuses hypothèses, qui, envisagées isolément, ne reposent sur aucune base solide, et dont le groupement seul fait la force ; pourtant, à le bien prendre, elles ne peuvent avoir pour un esprit sérieux d’autre valeur que leur valeur individuelle, et c’est en les examinant séparément qu’il convient de les juger. Or il est une chose sûre, c’est que pas un de ces arguments n’offre un caractère de créance suffisant pour qu’on en tire une preuve. Sans aller aussi loin que M. Maxime du Camp, qui repousse avec indignation cette idée d’une filiation illégitime, et, se posant en véritable champion de l’honneur de la famille, présente encore moins d’autorité dans ses négations que les partisans de la descendance naturelle dans leurs ingénieuses allégations, sans dire comme lui « que rien dans ses habitudes d’esprit, dans sa vie parcimonieuse, dans sa sauvagerie, dans ses aspirations qui souvent répondaient mal à ses aptitudes, rien, ni dans l’homme intérieur, ni dans l’homme extérieur, ne rappelait le prince de Talleyrand », nous pensons qu’en dépit même des ressemblances, il n’y a là qu’une simple conjecture à laquelle on ne doit pas attacher plus d’importance qu’à une hypothèse non vérifiée.
Les dispositions artistiques de Delacroix se manifestèrent de très bonne heure ; si l’on en croit ses notes mêmes, il était aussi bien doué pour la musique que pour le dessin. Il raconte qu’à l’époque où son père était préfet de Bordeaux, il avait étonné le professeur de musique de sa sœur par la précocité de ses aptitudes. Tout jeune encore, à neuf ans, il fut mis au lycée Louis-le-Grand. Il ne paraît pas qu’il y ait été un élève remarquable : il appartenait à cette classe d’esprits qui doivent se former seuls, vivent, bien qu’enfants, déjà repliés sur eux-mêmes, chérissent l’isolement, et attendent l’appel intérieur de la vocation. Philarète Chasles, qui fut son camarade de collège, nous a laissé dans ses Mémoires un portrait physique et moral d’Eugène Delacroix : l’étrangeté de sa physionomie, ce quelque chose de bizarre et d’inquiétant qui marque d’un signe certain les destinées supérieures, avait frappé son attention d’observateur, et lui avait permis de le distinguer dans la masse des intelligences vulgaires qui l’entouraient : il avait noté ses aptitudes extraordinaires pour le dessin : « Dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait tous les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects avec une obstination semblable à de la fureur. » On trouvera peut-être surprenant que dans son Journal Delacroix ne se reporte presque jamais à cette époque de sa vie ; sans doute, comme la plupart des natures délicates et originales, il avait conservé un mauvais souvenir de cette misérable existence du lycéen, assez voisine de l’enrégimentement par sa promiscuité, et, différant en cela de la majorité des hommes qui considèrent ces premières années comme les plus heureuses, il ne se les rappelait qu’avec déplaisir. Je ne sais s’il eût souscrit à l’énergique parole de Bossuet : « L’enfance est la vie d’une bête » ; toujours est-il qu’il ne professait pas grand enthousiasme pour cette saison de la vie, et qu’il aboutit à une conclusion assez proche de celle de Bossuet, lorsque, exprimant son opinion sur la méchanceté de l’homme, il nous fait cette confidence : « Je me souviens que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du devoir ne s’acquiert que très lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment, et par l’exercice progressif de la raison, que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle. »
Un de ses biographes s’est demandé avec candeur pourquoi Delacroix se fit peintre, et après avoir examiné successivement les différentes carrières qu’il aurait pu choisir, les emplois publics, l’industrie, le commerce, pour lesquels il lui semblait évidemment mal préparé, en vient à cette conclusion « qu’il ne lui restait plus qu’à s’abandonner à ses instincts d’indépendance ». Sans insister sur le côté légèrement naïf de cette observation, nous ferons remarquer que son auteur touchait du doigt la vérité, et donnait, sans s’en douter, la cause intime et profonde de la vocation du futur artiste, comme de toute grande vocation. Dans un des premiers cahiers du Journal, Delacroix rend grâce au ciel « de ne faire aucun de ces métiers de charlatan qui en imposent au genre humain ». Le secret de sa carrière d’artiste est tout entier dans cette phrase, qui explique en même temps ses aspirations d’indépendance et l’impuissance où demeurèrent toujours les artistes individuels et les écoles sur le développement de sa personnalité. Personne n’ignore que, par une étrange ironie du sort, il fut élève de Guérin. Gros le reçut également dans son atelier. Dirons-nous que ces influences furent vaines ? Cela est trop évident : il obéissait à l’appel intérieur de la destinée et n’écoutait que son génie !
Si nous nous posons sur Delacroix la question que Sainte-Beuve considérait comme indispensable de résoudre dans l’étude biographique et critique d’un homme éminent : « Comment se comportait-il en matière d’amour ? Comment en matière d’amitié ? » le Journal du maître nous éclairera complètement. Les préoccupations amoureuses existent au début de sa carrière. Faut-il ajouter qu’elles sont sans conséquence ? Il n’est jamais indifférent de savoir si un homme, surtout un artiste, a connu le souci d’aimer ; mais ce qui est capital, c’est d’être fixé sur ce point : quelle partie de son être a été atteinte ? La tête, le cœur ou les sens ? Suivant que l’amour de tête, l’amour-sentiment ou l’amour sensuel prédominera, l’être intellectuel se trouvera modelé différemment et la réaction amoureuse influera diversement sur les productions de son esprit. De cette vérité psychologique, Stendhal, pour ne citer qu’un nom, a fourni la plus saisissante démonstration, car il est bien certain que, si l’amour de tête et l’amour-sentiment n’avaient pas tenu dans sa vie la place que nous savons, nous n’aurions ni Julien Sorel, ni Mme de Rénal, ni Mathilde de la Môle, ni Clélia Conti. Or, pour en revenir à Delacroix, il ne paraît pas que l’amour ait jamais gravement atteint la tête ou le cœur : il semble s’être limité exclusivement aux sens et s’être manifesté chez lui de telle manière qu’il ne pouvait ni influer sur son travail, ni contribuer à l’en détourner. En examinant les différents épisodes amoureux dont il confie le secret à son Journal, nous ne saurions les envisager que comme des fantaisies d’un jour. Non qu’il méprisât la femme ou la traitât uniquement comme un instrument de plaisir : sa nature était trop délicate pour s’en tenir à une semblable philosophie ; disons mieux : il était trop homme du monde, dans le sens supérieur du mot, pour méconnaître le rôle discret dévolu à l’élément féminin dans de certaines limites. Mais il demeura toujours à l’abri d’une passion par un double motif, à ce qu’il nous paraît : d’abord la banalité de ses premières liaisons : « Tout cela est peu de chose, écrit-il à propos de cette Lisette qui passe pour ne plus revenir. Son souvenir, qui ne me poursuivra pas comme une passion, sera une fleur agréable sur ma route… » « Ce n’est pas de l’amour, note-t-il à propos d’une autre ; c’est un singulier chatouillement nerveux qui m’agite. Je conserverai le souvenir délicieux de ses lèvres serrées par les miennes. » Et puis, en admettant même qu’il eût rencontré un véritable amour, ou plutôt la possibilité d’un amour, il n’est pas téméraire d’affirmer qu’il aurait eu garde de s’y abandonner. « Malheureux, écrit-il après une rencontre qui sans doute l’avait plus préoccupé qu’à l’ordinaire, et si je prenais pour une femme une véritable passion ! » L’année 1824 contient une confidence bien significative sur l’innocuité de ses fantaisies amoureuses : « Quant aux séductions qui dérangent la plupart des hommes, je n’en ai jamais été bien inquiété, et aujourd’hui moins que jamais. » Ces influences extérieures tendent à disparaître complètement à mesure qu’il avance dans la vie, pour laisser place entière aux voluptés de l’imagination. À ce propos, il écrit une phrase que l’on croirait détachée de la correspondance de G. Flaubert : « Ce qu’il y a de plus réel en moi, ce sont ces illusions que je crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant. »
On a dit que Delacroix avait réservé toute sa puissance d’affection pour le sentiment d’amitié. L’expression nous paraît singulièrement exagérée. Qu’on n’aille pas s’imaginer, d’ailleurs, que nous nous le représentions incapable d’en goûter dans leur plénitude les délicates jouissances. La vérité est que l’amitié ne s’offrit jamais à lui sous une forme et avec un caractère entièrement dignes de lui. On a beaucoup parlé des amis dont le nom revient souvent dans sa correspondance : Guillemardet, Soulier, Pierret, Leblond. Ils ne pouvaient satisfaire qu’une part de sa nature, la part affective ; quant aux besoins intellectuels, ils demeurèrent impuissants à y répondre ; or, chez des intelligences complètes comme celle de Delacroix, il ne peut exister de sentiment d’amitié complet que celui qui correspond à toutes les exigences de l’être. Nous inscrivions tout à l’heure le nom de Flaubert ; Delacroix n’eut pas, précisément comme celui-ci, la rare fortune de rencontrer dans sa première jeunesse un de ces esprits, je ne dis pas égal au sien, mais véritablement frère du sien, tel que Flaubert les trouva en Bouilhet et Lepoittevin. Et ce n’est pas une conjecture que nous faisons ici ; il y a un passage du Journal qui ne laisse aucun doute à cet égard : « J’ai deux, trois, quatre amis ; eh bien, je suis contraint d’être un homme différent avec chacun d’eux, ou plutôt de montrer à chacun la face qu’il comprend. C’est une des plus grandes misères que de ne pouvoir jamais être connu et senti tout entier par un même homme, et quand j’y pense, je crois que c’est la souveraine plaie de la vie. » Là encore, par conséquent, il ne devait pas goûter une satisfaction entière, et c’est dans la supériorité de sa nature qu’il en faut chercher la cause.
C’est que l’Art, et l’Art seul, pouvait satisfaire son esprit, en lui communiquant la plénitude de vie pour laquelle il était fait. Il appartenait à la famille des grands « Intellectuels », chez qui l’idée maîtresse atteint presque à la hantise d’une monomanie et devient à ce point absorbante qu’elle étouffe les tendances voisines. On l’a dit avec raison, précisément à propos d’Eugène Delacroix. : il serait injuste d’appliquer à certains esprits les principes d’existence dont relèvent la plupart des hommes : ce qu’il y a d’anormal dans leur conformation spirituelle explique comme il justifie ce qu’il peut y avoir d’étrange dans leur vie. Suivez-le dans le premier développement de son existence d’artiste : vous trouverez chez lui cette impatience, cette impétuosité du créateur qui provient d’une surabondance de sève et du fourmillement des idées. Son intelligence est mobile parce que le nombre des points de vue la détourne en tous sens et l’empêche de se fixer ; mais ce n’est là qu’une crise transitoire, sans inconvénient pour sa grandeur future, car il la constate lui-même, et, semblable à un malade qui serait son propre médecin, s’administre les remèdes appropriés. Il se tient constamment en garde contre lui ; il se voit agir et penser ; il se compare à ceux qui l’approchent, prend pour modèle ce qu’il trouve bon en eux, et conserve sa lucidité d’analyse au milieu des émotions les plus troublantes de sa carrière d’artiste. C’est là un des traits caractéristiques de son esprit que cette faculté de se replier sur lui-même, de s’observer : en cela il est bien moderne et nous apparaît comme un des nôtres : « Je serais un tout autre homme, écrit-il à vingt-quatre ans, si j’avais dans le travail la tenue de certains que je connais… Fortifie-toi contre ta première impression ; conserve ton sang-froid. » Semblable par là à Stendhal, de qui Baudelaire le rapprochait, il comprend la nécessité d’une méthode, d’un ensemble de principes directeurs de la vie intellectuelle qui lui semblent la sauvegarde de toute existence vouée aux travaux de la pensée. Baudelaire le comparait à Mérimée et à Stendhal, et certes, s’il avait connu les premières années de ce Journal, il eût éprouvé cette jouissance particulière que goûte toujours un esprit inventif à constater la vérification d’une hypothèse : « L’habitude de l’ordre dans les idées est pour toi la seule route au bonheur, et pour y arriver, l’ordre dans tout le reste, même dans les choses les plus indifférentes, est nécessaire. » Cette phrase ne vous paraît-elle pas comme détachée de ces lettres intimes écrites à sa sœur dans lesquelles l’auteur de Rouge et noir faisait à cette amie ses confidences journalières, en lui donnant des conseils pour la poursuite de la vie heureuse ?
Se défiant de lui-même, Delacroix se défiait aussi des autres et prenait à leur égard des résolutions dictées par la plus sage prudence. Il avait reconnu sans doute, en en faisant l’expérience lors des enthousiasmes irréfléchis de la première jeunesse, le danger de s’abandonner à la spontanéité d’une nature trop ardente en présence de tiers qui demeureront toujours impuissants à la comprendre et n’y verront le plus souvent que bizarre excentricité. On a dit qu’une des grandes préoccupations de sa vie avait été de « dissimuler les colères de son cœur et de n’avoir pas l’air d’un homme de génie ». Je le croirais volontiers, surtout quand je lis cette phrase : « Sois prudent dans l’accueil que tu fais toi-même, et surtout point de ces prévenances ridicules, fruit des dispositions du moment. » Il fréquenta beaucoup de monde, trop peut-être pour sa santé ; mais on peut affirmer que le monde n’eut aucune influence sur sa vie spirituelle, sur ses travaux d’artiste, car dès l’abord il en avait senti les dangers, et il lui fut trop constamment supérieur pour ne le point juger comme il mérite de l’être. Chaque fois qu’il en parle, c’est avec cet accent de haute supériorité qui vient de la conscience intime d’une valeur transcendante, par laquelle se manifeste le sentiment d’aristocratie intellectuelle : « Que peut-on faire de grand au milieu de ces accointances éternelles avec tout ce qui est vulgaire ? » dit-il dans les premières pages du Journal ; et plus tard, en 1853, lorsque, arrivé au faîte de sa réputation et pleinement maître de ses effets, il tente de résumer son impression sur la société moderne, son jugement pénètre jusqu’aux causes de son infériorité, ne se contentant pas de la constater : « Il n’est pas étonnant qu’on trouve insipide le monde à présent : la révolution qui s’accomplit dans les mœurs le remplit continuellement de parvenus. Quel agrément pouvez-vous trouver chez des marchands enrichis qui sont à peu près tout ce qui compose aujourd’hui les classes supérieures ? » Quelquefois même il ira jusqu’à l’indignation, et vous sentirez une colère sourde l’envahir. En 1854, sortant d’un bal des Tuileries, il écrit : « La figure de tous ces coquins, de toutes ces coquines, ces âmes de valets sous ces enveloppes brodées, vous lèvent le cœur. » Voilà sans contredit une des notes les plus intéressantes du Journal, parce qu’elle est éminemment significative, parce que nulle autre part que dans des papiers intimes elle ne pouvait figurer, parce qu’enfin elle découvre et met à nu le révolté qui est au fond de tout homme de génie. C’est bien là l’expression d’une de ces « colères de cœur qu’il aimait à dissimuler » ; mais il fallait qu’il se déchargeât, et son Journal lui permit de le faire.
De bonne heure, il comprit que l’homme est seul dans l’existence, d’autant plus seul qu’il est plus différent, car la société en cela nous paraît assez semblable à l’enfant, lequel se détourne avec crainte des figures qui ne lui sont pas familières. Il sentit que l’on ne doit compter que sur ses propres forces, que les sympathies apparentes dont nous sommes entourés ne sont en réalité que duperie, puisqu’elles cachent toujours un principe d’intérêt personnel, plus ou moins habilement dissimulé. Heureux encore l’artiste, lorsque la jalousie, l’envie de ceux qui l’approchent ne tentent pas de le décourager par de perfides insinuations ! Il existe à cet égard une page curieuse : elle est de 1824, époque de ses premières luttes ; il a déjà exposé la Barque du Dante, et l’on sait de quelle manière ce tableau fut accueilli. Il est en train de peindre les Scènes du massacre de Scio, il a esquissé la femme traînée par le cheval qui occupe le centre de cette admirable composition. Il montre son travail à quelques amis, à quelques parents : vous vous figurez comme on le juge ; mais après leur départ, il se soulage et note sur son Journal cette exclamation indignée : « Comment ! il faut que je lutte avec la fortune et la paresse qui m’est naturelle ! il faut qu’avec de l’enthousiasme, je gagne du pain, et des bougres comme ceux-là viendront jusque dans ma tanière, glacer mes inspirations dans leur germe, et me mesurer avec leurs lunettes ! » J’imagine que cette épreuve lui fut une rude leçon et ne contribua pas médiocrement à l’affermir dans ses idées de prudente réserve, d’autant mieux que s’il se défie du monde, il se défie encore plus des artistes ; ce qui lui semble redoutable en eux, c’est cette envie qui lui fait l’effet d’un manteau de glace sur les épaules, et puis il a déjà conscience de l’infériorité des « spécialistes », des « gens de métier », car il écrit : « Le vulgaire naît à chaque instant de leur conversation. »
Voilà, dira-t-on, une conception singulièrement pessimiste de la vie ! Sans doute, mais c’est la conception d’un sage, d’un homme qui entend n’aborder la lutte que bien armé, et prudemment se représente le monde plus médiocre encore et plus vulgaire qu’il n’est, pour éviter ce qu’il redoute par-dessus tout : être dupe ! Nous avons parlé de ces principes directeurs de la vie qui doivent soutenir l’homme de pensée au milieu des perpétuels dangers qui le menacent, et qu’un écrivain comparait à des phares, ou à des barres lumineuses placées de distance en distance, destinés qu’ils sont à le préserver des écueils. Dans le Journal de Delacroix, comme dans les lettres de Stendhal, vous les trouverez en grand nombre, car il conçoit la vie comme un combat : « Il n’y a pas à reculer, écrit-il en 1852. Dimicandum ! C’est une belle devise que j’arbore par force et un peu par tempérament. J’y joins celle-ci : Renovare animos. Mourons, mais après avoir vécu. Beaucoup s’inquiètent s’ils revivront après la mort, et ils ne vivent point dès à présent. »
Sa vie fut tout intérieure, comme celle des « Intellectuels » ; les luttes qu’il eut à soutenir se livrèrent dans le vaste champ du cerveau. Pour le seconder, il eut deux adjuvants puissants : la solitude et le travail. La solitude d’abord : nous avons vu qu’il la constatait autour de lui, même dans le monde, disons : d’autant plus qu’il était dans le monde, au milieu de ses amis ou de ceux qui se prétendaient tels : c’est l’isolement forcé du grand esprit qui ne se voit pas d’égaux ; mais à côté de celui-ci, il en est une autre, l’isolement volontaire, celui de l’homme qui vit dans sa tour d’ivoire. Après l’amour de la solitude, et comme conséquence directe, l’amour du travail. Quand il parle de sa vie intellectuelle, c’est avec l’enthousiasme d’une âme possédée par de hautes idées : « Je me le suis dit et ne puis assez me le dire, pour mon repos et pour mon bonheur, — l’un et l’autre sont une même chose, — que je ne puis et ne dois vivre que par l’esprit. » — Cette pensée reparaît à chaque instant ; lorsqu’il souffre, c’est dans son art qu’il trouve l’oubli de ses souffrances ; lorsqu’il éprouve un déboire, c’est par la production de nouvelles œuvres qu’il se console.
Tout jeune, son génie le torture : il est une cause de tourment, en ce sens que les idées affluent trop nombreuses, que son esprit, malgré les principes de méthode dont il ne se départira jamais, bouillonne trop fortement, que les images picturales s’accumulent dans son cerveau et qu’il n’est pas maître de ses sujets. Mais l’énergie productrice prend vite le dessus ; il ne s’en tient jamais à la période de conception et de rêve, si pleine de délices, si féconde en illusions perfides. Un de nos écrivains qui le connut et s’entretint plusieurs fois avec lui nous a parlé du bouillonnement qui se faisait dans sa tête ; il l’a représenté curieux de tout, s’intéressant à tout, suivant des cours de langues orientales, faisant de la botanique, bref, un des esprits les plus ouverts de ce siècle. La lecture complète du Journal est une vérification éclatante de son assertion. Dès les premières années, Delacroix vit dans une constante surexcitation. En 1822, il écrit : « Que de choses à faire ! Fais de la gravure, si la peinture te manque, et de grands tableaux… Que je voudrais être poète ! » Il s’échauffe à la fréquentation des écrivains, tient constamment présent à sa pensée le souvenir des précurseurs : la vie de Dante, celle de Michel-Ange le hantent et le soutiennent. La noblesse et la pureté de ces existences d’artistes lui sont comme un perpétuel incitamentum qui le pousse à la production et l’arrête sur les pentes dangereuses. Que de bouillonnement dans ce cerveau, mais aussi que de méthode ! Que d’ardeur, mais que de sagesse ! L’impression maîtresse qui demeure est celle d’une existence bien ordonnée, dans laquelle la raison et la volonté dominent toujours la passion et ne cèdent jamais pied !…
Si peu avancés que nous soyons dans l’analyse de cet esprit, nous y découvrons déjà les rudiments d’une philosophie, j’entends une conception d’ensemble de la vie. Le propre des cerveaux à tendances généralisatrices est de ne jamais s’en tenir aux événements et de considérer les phénomènes successifs dont ils sont les témoins comme autant de matériaux pour la construction d’idées. Delacroix est de ce nombre, la seule forme de son Journal suffirait à le démontrer. Il voit un écrivain, un artiste, un homme politique : peut-être bien la conversation n’a-t-elle été que médiocrement intéressante ; une intelligence ordinaire n’eût rien trouvé à en tirer. Il est rare qu’il n’y rencontre pas l’occasion et le prétexte d’une note personnelle, presque toujours suggestive. De même et d’autant mieux s’il s’agit d’art, du sien en particulier : il visite une exposition, il entend une symphonie, il assiste à une représentation ; ou bien, plus simplement, il a travaillé tout le jour à l’une de ses œuvres, tableau de chevalet, esquisse de peinture murale, décoration de la Chambre ou du Louvre ; l’impression subie lui dictera quelque vue d’ensemble touchant aux plus hautes questions d’esthétique. C’est cette faculté généralisatrice, critérium de toutes les supériorités intellectuelles, et croissant avec son génie, qui communique un intérêt progressif à ces pages dans lesquelles il se raconte lui-même. Avec lui, vous ne sauriez vous heurter à l’une de ces étroites conceptions qui caractérisent les hommes de métier exclusif, et bornent fatalement leurs vues. Sans doute il peut se tromper ; il se trompe quelquefois, mais ses erreurs ne trahissent jamais une lacune irrémédiable de l’esprit. Enfin, comme dans tous les développements bien ordonnés, l’évolution de sa pensée obéit à des lois régulières, ne subit pas de temps d’arrêt, et les approches de la vieillesse n’entraînent point avec elles cet affaiblissement des forces cérébrales dont le spectacle est une des plus attristantes réalités d’ici-bas !
Je ne sais plus quel écrivain, arrivé au faîte de la réputation, et jetant un regard en arrière sur sa vie, souhaitait pour ses fils une destinée différente. Si Delacroix avait été contraint à de semblables préoccupations, il eût probablement formulé un vœu analogue. Tout compte fait, nous plaçant non pas tant au point de vue de la qualité que de la somme de bonheur possible, il est évident que l’existence de l’homme ordinaire offre plus de garanties que celle de l’homme supérieur. Delacroix en fut un jour frappé, dans les premiers temps de sa carrière, et ne put s’empêcher de noter l’observation sur son Journal : « Les ignorants et le vulgaire sont bien heureux. Tout est pour eux carrément arrangé dans la nature. Ils comprennent ce qui est, par la raison que cela est. » Plus tard, à vingt-cinq années de distance, il revient sur cette idée et parle des souffrances de l’homme de génie, de cette réflexion et de cette imagination qui lui semblent de funestes présents. Après les luttes qu’il avait dû soutenir, les attaques dont il avait été l’objet, il écrivait : Presque tous les grands hommes ont eu une vie plus traversée, plus misérable que celle des autres hommes. » La cause de leurs souffrances, Delacroix l’avait éprouvé, n’est pas seulement dans la difficulté d’imposer leur talent ; elle est encore et surtout dans ce talent lui-même, dans la nature maladivement sensible qu’il implique, qui fait vibrer leurs nerfs frémissants à des contacts non ressentis par la plupart, et communique à tout leur être une hyperesthésie contre laquelle il n’est pas de remède.
Mais l’homme est aussi impuissant à modifier sa nature morale que son tempérament physique : il lui faut accepter l’existence avec les conditions dans lesquelles elle se présente ; c’est cet asservissement aux lois implacables de la destinée qui amène la révolte en lui, bien qu’il en comprenne la nécessité. Sa raison lui démontre la loi, sa sensibilité s’insurge contre elle, dans une de ces heures où l’esprit, après avoir goûté, grâce aux délices du travail, cette illusion réconfortante qu’il est le maître et domine à son gré, reçoit un de ces vigoureux rappels à l’ordre qui lui remémorent son état d’irrémédiable esclavage : « Ô triste destinée ! Désirer sans cesse mon élargissement, esprit que je suis, logé dans un mesquin vase d’argile. » Les mêmes motifs qui l’ont fait déplorer l’asservissement de l’être humain en apparence le plus détaché des liens de la matière, l’amènent à envisager avec une sorte de tristesse résignée la variabilité, l’incertitude de la production. Il compare entre eux ces enfants doués d’une imagination supérieure à celle des hommes faits, ces artistes qui ne peuvent travailler que sous l’influence de l’opium ou du haschisch ; — il était ami de Boissard, le maître du salon où avaient lieu les séances du club des « Haschischins », si minutieusement décrites par Th. Gautier et rappelées dans la préface des Fleurs du mal, séances au cours desquelles, on s’en souvient, des écrivains et des artistes s’intoxiquaient de ces dangereuses substances, puis observaient sur eux-mêmes et leurs voisins l’effet produit. Pour d’autres, il remarque que la simple inspiration journalière suffit ; peut-être songeait-il à Balzac qui avait toujours refusé de se soumettre à ces expériences, se contentant d’en noter le résultat sur autrui. En ce qui le concerne, Delacroix estime qu’une demi-ivresse lui est assez favorable. Là encore il constate que nous ne sommes que des machines, machines d’un ordre supérieur, munies de rouages plus délicats, plus compliqués que celles que nous inventons, mais dont le fonctionnement demeure un inquiétant et insoluble problème.
Delacroix, nous l’avons vu, était intimement convaincu de cette vérité que l’homme s’avance seul dans l’existence, livré à ses propres forces et muni des armes que la nature lui a départies. Il a des rapports sociaux une idée pessimiste, d’autant plus intéressante comme preuve de l’originalité de son esprit qu’elle va directement et contre les principes du dix-huitième siècle finissant, dans le respect desquels il avait dû être élevé, et contre les doctrines optimistes de l’époque où il atteignit sa maturité, doctrines avec lesquelles sa conception de la vie forme un contraste saisissant. Il eût volontiers, je crois, inscrit en lettres d’or la fameuse maxime de Hobbes : Homo homini lupus, car il estime que « l’homme est un animal sociable qui déteste ses semblables ». Toutes ses réflexions sur la société, et elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses à mesure qu’il avance dans la vie, découlent de cette idée, toujours conséquentes avec elle. Lorsqu’il parle du « progrès », c’est toujours avec l’ironie mordante et détachée de l’observateur, assistant en philosophe convaincu de l’immutabilité des choses aux luttes tragiques et vaines de l’humanité pour améliorer sa condition misérable. Chaque fois qu’il se trouve en présence de ce qu’Edgar Poë appelait le ballon-monstre de la perfectibilité, il émet un doute, réserve son opinion et finalement écrit : « Je crois, d’après les renseignements qui nous crèvent les yeux, qu’on peut affirmer que le progrès doit amener nécessairement, non pas un progrès plus grand encore, mais à la fin négation du progrès, retour au point d’où on est parti. » Notez que cette phrase est de 1849, qu’elle emprunte par conséquent à sa date un caractère particulier d’intérêt, puisqu’elle se réfère à cette époque où tant d’âmes généreuses, mais peu éclairées, s’étaient abandonnées aux rêves illusoires d’un perfectionnement universel, de l’avènement d’une ère de bonheur général. La supériorité de son intelligence lui montre la vanité de tous ces rêves, et sur ce point l’amène à la certitude.
Il semble même, quand il touche à ces questions, qu’il soit un précurseur et qu’il écrive pour notre temps. Il eut sans doute à subir, dans les réunions qu’il fréquentait, dans ses causeries intimes avec George Sand, de longues et fastidieuses dissertations sur le problème social ; nous en trouvons la trace dans ses notes journalières. Le rêve d’égalité qui, avec celui du progrès indéfini, hantait ces cervelles de travers, ne le trouvait pas plus indulgent ; au lieu du progrès, c’est la dégénérescence qu’il constate, comme résultat de ces prétendus perfectionnements. Cette conception si haute et si philosophique de la société le conduit à étudier la question de la « philanthropie ». Profondément convaincu que la véritable charité est celle qui agit individuellement, dans le silence et sans espoir de récompense, d’autant plus noble qu’elle est plus désintéressée, n’obéissant qu’au mobile supérieur de la sympathie humaine, il perce à jour les causes réelles de la philanthropie organisée ; il en pénètre les secrets avec cette infaillible sûreté d’instinct qui sous les dehors trompeurs découvre les mobiles cachés, et quand il parle de ces entrepreneurs de charité, de ces philanthropes de profession, « tous gens gras et bien nourris », il semble prévoir dans toute son extension le charlatanisme dont nous sommes aujourd’hui les témoins.
Ces immortelles duperies sur lesquelles vit la société et qui font le succès de ceux qui savent à point les exploiter, l’amènent à examiner les conditions élémentaires de la vie heureuse. Partant de cette idée que l’homme ne place presque jamais son bonheur dans les biens réels, Delacroix en revient aux principes de sagesse de la philosophie antique, renouvelés par les sages des temps modernes, c’est-à-dire à l’acceptation des conditions de vie telles qu’elles nous sont imposées : d’une part, développement de notre être en conformité avec ses tendances, ce qui n’est autre chose que la doctrine de Gœthe ; de l’autre, résignation aux nécessités inéluctables qui établissent les lois de la vie comme celles de la mort, « condition indispensable de la vie ». Il reconnaissait d’ailleurs qu’une telle philosophie ne pouvait être à la portée du grand nombre, et pensait que le monde continuerait à se mouvoir dans le même cercle, impuissant qu’il demeurera toujours à se transformer dans son essence…
Esprit généralisateur, Delacroix fut également « universel », et par là nous n’entendons pas seulement qu’il fut universel comme peintre ; nous voulons marquer que sa curiosité et sa compréhension d’artiste s’étendirent à toutes les manifestations de la beauté. Sa curiosité d’abord, car aucune de ces manifestations ne lui demeura indifférente : il s’intéressa à toutes ; son intelligence, perpétuellement en éveil, ne manqua jamais une occasion de se développer, d’agrandir le champ de ses connaissances. Sa compréhension enfin le rendit apte, sinon à les juger toutes « absolument et définitivement », du moins, malgré les erreurs de détail qui peuvent entacher quelques-unes de ses appréciations, à en pénétrer l’esprit caché et l’intime signification. Montrer quel retentissement salutaire une pareille universalité peut exercer sur une âme d’artiste, ce serait presque une banalité, car il suffit d’émettre l’idée pour en faire toucher du doigt l’exactitude. Quant à l’influence bienfaisante dont elle favorisa le développement particulier du maître dont nous parlons, la lecture attentive de son Journal le prouverait, si la connaissance de ses innombrables productions n’en demeurait à tout jamais la démonstration la plus évidente. Lui-même, il avait examiné cette question d’universalité et s’est expliqué à cet égard avec une singulière netteté. Dans une page de l’année 1854, il observe « combien les gens de métier sont de pauvres connaisseurs dans l’art qu’ils exercent, s’ils ne joignent à la pratique de cet art une supériorité d’esprit ou une finesse de sentiment que ne peut donner l’habitude de jouer d’un instrument et de se servir d’un pinceau » ; et il ajoute, toujours à propos des spécialistes : « Ils ne connaissent d’un art que l’ornière où ils se sont traînés, et les exemples que les écoles mettent en honneur. Jamais ils ne sont frappés des parties originales ; ils sont, au contraire, bien plus disposés à en médire ; en un mot, la partie intellectuelle leur manque complètement. » On ne pouvait mieux marquer la cause de l’insuffisance de tant d’artistes, de l’étroitesse de leurs vues, de ce qui fait qu’en somme ils ne sont, la plupart, comme on l’a écrit si justement, que « d’illustres ou obscurs rapins ». Lorsque Delacroix parle ainsi, il exprime une opinion qui lui est chère, qui correspond bien à ses convictions intimes, car elle cadre avec toute sa vie. Peu importe qu’à une époque postérieure, dans une de ces boutades fréquentes chez les intelligences d’élite, parce qu’elles résultent d’un don particulier d’envisager les choses sous leurs différents points de vue, peu importe que Delacroix ait écrit « qu’un artiste a bien assez à faire d’être savant dans son art » ; sans doute, en notant cette boutade, il songeait au danger inverse de celui qu’il avait indiqué plus haut, à l’inconvénient qui peut résulter pour un peintre d’une culture trop étendue, quand elle ne s’accompagne pas d’une faculté d’invention en harmonie avec elle. Peut-être même, — et les longs entretiens qu’on lira dans le Journal de 1854 confirmeront cette hypothèse, — pensait-il à Chenavard, dont il appréciait singulièrement l’érudition, mais à qui il reprocha toujours de n’être pas assez peintre. Il n’en reste pas moins certain qu’une culture complète de l’esprit lui paraît la condition indispensable de toute grande carrière d’artiste.
L’éternelle question du « Beau », qui a servi de thème aux discussions stériles de tant d’écrivains, cette question qui sous la plume des purs théoriciens ne peut guère être qu’un prétexte à déclamations creuses, mais qui, traitée par un artiste comme Delacroix, devient aussitôt d’un intérêt vivant et palpitant, devait le préoccuper et le préoccupa en effet. Sous ces deux titres : Questions sur le Beau et Variations du Beau, il l’examina dans ses détails, et dévoila la largeur de ses vues esthétiques. Ennemi des pures abstractions et des principes absolus, il arrive à cette conclusion notée par M. Mantz, « qu’il faut admettre pour le Beau la multiplicité des formes », « que l’art doit être accepté tout entier », et que « le style consiste dans l’expression originale des qualités propres à chaque maître ». L’examen de ces problèmes d’esthétique revient souvent dans son Journal, aussi bien pendant les premières années de jeunesse, alors que ses convictions n’étaient pas encore solidement assises, qu’à l’époque de la pleine maturité et de la vieillesse commençante. En 1847, il écrit : « Je disais à Demay qu’une foule de gens de talent n’avaient rien fait qui vaille à cause de cette foule de partis pris qu’on s’impose ou que le préjugé du moment vous impose. Ainsi, par exemple, de cette fameuse question du Beau, qui est, au dire de tout le monde, le but des arts. Si c’est là l’unique but, que deviennent les gens qui, comme Rubens, Rembrandt, et généralement toutes les natures du Nord, préfèrent d’autres qualités ? »
De telles paroles sont la condamnation même des principes absolus en matière esthétique, de même que cette idée émise plus loin : « Le Beau est la rencontre de toutes les convenances », nous semble la négation de l’idéal romantique. C’est qu’en effet, et nous touchons ici à l’une des faces les plus curieuses de son esprit, à celle peut-être qui se trouvera le plus complètement éclairée par l’œuvre posthume du maître, si l’on s’efforce de dégager à ce point de vue sa signification, on reconnaît combien grande était l’erreur de ceux qui s’obstinaient à le représenter comme un des chefs du romantisme militant. En cela, nous semble-t-il, ils furent les dupes d’une apparence trompeuse ; ils ne virent que l’extrême fougue d’un tempérament excessif, sans vouloir tenir compte des facultés de réflexion, de repliement sur soi-même, de concentration voulue et préméditée, qui constituaient l’essence de son génie. Si Delacroix fut attentif à une chose, ce fut à ne s’affilier à aucune école, et, comme toutes les individualités très tranchées, à marcher seul dans sa carrière d’artiste. Les mêmes raisons qui firent que dans les premières années de son développement il demeura rebelle aux influences environnantes, que ni les écoles organisées, ni les artistes individuels n’eurent de prise sur son talent, l’empêchèrent toujours de se rattacher à aucune secte. Plus loin, quand nous examinerons les jugements qu’il porte sur les artistes d’autrefois, sur ses contemporains, écrivains, musiciens et peintres, nous trouverons la preuve irréfutable de ce que nous avançons ; mais dès maintenant nous en savons assez pour marquer avec certitude combien son génie le différenciait du romantisme impénitent !
S’il ne fut pas toujours tendre au romantisme, il se montra constamment hostile aux doctrines du réalisme. La sévérité avec laquelle il juge Courbet, tout en proclamant ses merveilleuses aptitudes de peintre, prouve à quel point les tendances de cette école étaient opposées aux siennes. À ses yeux, l’imagination est le principal facteur de la production esthétique, et la réalité ambiante ne lui semble digne de devenir matière à œuvre d’art, qu’à la condition d’avoir été épurée, transfigurée en quelque sorte par sa toute-puissante influence. Dans un fragment de l’année 1853, à propos d’esquisses de la Sainte Anne, faites par lui à Nohant, il compare un premier croquis reproduisant servilement la nature, qui, dit-il, lui est insupportable, à une seconde esquisse dans laquelle ses intentions sont plus nettement marquées, et qui pour cette raison commence à lui plaire, tandis qu’il n’attribue guère au premier une importance plus grande qu’à une reproduction photographique. Sans cesse il insiste sur la prépondérance de l’imagination, et par imagination ce n’est jamais l’invention de toutes pièces qu’il entend, mais bien la faculté d’interpréter puissamment, de refléter suivant le tempérament individuel de l’artiste la nature qui pose devant lui. Pour Delacroix, imagination et idéalisation sont des termes égaux et réciproquement convertibles. Dans une page merveilleuse, tant par la beauté de la forme que par la hauteur de l’idée, il rapproche cette idéalisation de l’art de l’idéalisation du souvenir, résultat du travail psychologique dans les phénomènes de la mémoire : « J’admirais ce travail involontaire de l’âme qui écarte et supprime dans le ressouvenir des moments agréables tout ce qui en diminuait le charme, au moment où on les traversait. Je comparais cette espèce d’idéalisation, — car c’en est une, — à l’effet des beaux ouvrages de l’imagination. Le grand artiste concentre l’intérêt en supprimant les détails inutiles ou repoussants ou sots ; sa main puissante dispose et établit, ajoute et supprime, et en use ainsi sur des objets qui sont siens ; il se meut dans son domaine et vous y donne une fête à son gré. » Plus loin, à propos du dictionnaire, auquel il compare la nature, il écrit : « Un dictionnaire n’est pas un livre ; c’est un instrument, un outil pour faire des livres. » Il faut rapprocher cette phrase, — et peut-être même l’exemple lui vint-il pour mieux affirmer son idée, — de la conversation rapportée par Baudelaire, dans laquelle il semble s’être efforcé de résumer sur ce point ses théories artistiques, en laissant percer une arrière-pensée de combattre les théories réalistes : « La nature n’est qu’un dictionnaire », répétait-il fréquemment. Pour bien comprendre l’étendue du sens impliqué dans cette phrase, il faut se figurer les usages ordinaires et nombreux du dictionnaire. « On y cherche des mots, la génération des mots, l’étymologie des mots ; enfin on en extrait tous les éléments qui composent une phrase ou un récit ; mais personne n’a jamais considéré le dictionnaire comme une composition, dans le sens poétique du mot. » Voilà qui nous apparaît net et tranché. Je ne sache pas de meilleur exemple pour rendre l’idée saillante et pour illuminer la pensée du
Delacroix n’aimait pas les Écoles, avons-nous dit, car il les jugeait impuissantes à former de véritables artistes : il ne faisait en cela qu’insister sur une conviction intime et généraliser son cas. Il parlait en homme de génie qui ne conçoit pas d’autre éducateur que lui-même et le développement normal d’une intense personnalité. À toute grande manifestation artistique, quelque degré de raffinement qu’elle atteigne dans son expression, il estimait que la puissance du sentiment et la spontanéité devaient toujours présider ; point d’œuvre d’art digne de ce nom qui ne dérive en dernière analyse de cette double origine. Tout le reste est à ses yeux pur métier, ou, si vous aimez mieux, rhétorique. La rhétorique, il la trouvait partout, non pas seulement dans les livres au elle différencie les gens de lettres et ceux qui écrivent parce qu’ils ont quelque chose à dire, mais encore dans la peinture, où elle remplace l’imagination du dessin et de la couleur par la reproduction servile de la nature ; dans la musique enfin, où elle remplace les idées par des combinaisons d’harmonie plus ou moins habiles. C’est elle qui, d’une façon générale, se substitue à l’imagination chez les artistes dénués d’invention, c’est elle qui conduit à la « manière ». Et ce n’était pas chez lui amour exagéré d’indépendance ; c’était le résultat des exigences d’une personnalité absorbante ; c’était aussi le fruit des observations qu’il avait faites sur les lois qui dirigèrent l’éducation des artistes fameux. Il trouvait la confirmation de ce qu’il avançait dans l’exemple de toutes les intelligences vouées aux travaux de la pensée ; à l’appui de son dire, il aimait à citer Rubens, Titien, Michel-Ange. Ces illustres ancêtres étaient toujours présents à sa mémoire pour soutenir ses défaillances et relever son courage abattu. Tout grand esprit lui paraissait comme une force en mouvement qui brise les obstacles accumulés devant elle et sait se faire jour à travers tous les empêchements. Aussi la hardiesse était-elle la qualité qu’il appréciait le plus : hardiesse au début d’une carrière, parce qu’elle est synonyme de puissance ; hardiesse après les premiers succès, parce qu’elle prouve l’effort constant de l’artiste ; hardiesse encore en plein triomphe, parce qu’elle dénote l’amour désintéressé de l’art, la recherche inassouvie de formes nouvelles incarnant la beauté : « Être hardi, dit-il, quand on a un passé à compromettre, est le plus grand signe de la force. » Notons d’ailleurs que ces principes d’indépendance, qui pourraient sembler outrés, ne l’empêchaient pas de reconnaître et de proclamer le rôle de l’imitation, la nécessité pour l’artiste débutant de s’appuyer sur l’enseignement des maîtres. Lui-même, il avait donné l’exemple de cette discipline de l’esprit par son érudition, par la fidélité scrupuleuse avec laquelle, jusque dans les derniers temps de sa vie, il copia leurs œuvres pour s’assimiler leur génie. Le développement de l’artiste lui paraissait assez semblable à celui de l’enfant qui d’abord reproduit les mouvements imités de ceux qui l’approchent, puis arrive peu à peu à l’indépendance et à la spontanéité. Ainsi en va-t-il dans le domaine intellectuel, et il ne saurait exister de véritable maître en dehors de l’affranchissement. En 1855, il écrit à ce propos : « Il faut absolument qu’à un moment quelconque de leur carrière ils arrivent, non pas à mépriser tout ce qui n’est pas eux, mais à dépouiller complètement ce fanatisme presque aveugle qui nous pousse tous à l’imitation des grands maîtres et à ne jurer que par leurs ouvrages. Il faut se dire : Cela est bon pour Rubens, ceci pour Raphaël, Titien ou Michel-Ange. Ce qu’ils ont fait les regarde ; rien ne m’enchaîne à celui-ci ou à celui-là. Il faut apprendre à se savoir gré de ce qu’on a trouvé ; une poignée d’inspiration personnelle est préférable à tout. »
Jusqu’ici nous n’avons examiné que des principes d’esthétique générale ; nous devons en venir maintenant à l’étude de l’esthétique spéciale de Delacroix en matière de peinture. Il est toujours intéressant d’entendre un artiste parler de son art et faire au public la confidence de ses pensées ; cela est en tout cas singulièrement révélateur de l’esprit dans lequel il le pratique, des tendances qu’il y apporte, de la largeur ou de l’étroitesse de vues qu’il y manifeste. Lorsque cet artiste est un Fromentin, on reconnaît aisément à la façon dont il en parle, au parti pris de composition littéraire et d’ordonnance classique toujours saillant jusqu’en ses moindres analyses, une intelligence fine et distinguée, merveilleusement apte à comprendre certains talents d’ordre moyen comme Van Dyck ou certaines faces d’un talent supérieur comme celui de Rubens, mais mal préparé à pénétrer le génie mystérieux et souverain d’un Rembrandt ; même dans ses appréciations techniques, le littérateur perce toujours chez lui, et l’on est forcé de conclure qu’il est plus écrivain que peintre. Quand cet artiste est un Couture, on peut trouver chez lui des recettes de métier, un souci constant de la technique, de précieux conseils pour les spécialistes ; en revanche, dès qu’il tente de s’élever à des préoccupations plus hautes, dès qu’il aborde ce que Delacroix appelait la partie « intellectuelle » de l’art, on saisit tout de suite le danger que courent certains artistes en pénétrant dans un domaine qui leur demeurera à jamais inaccessible, car leur incompétence n’y a d’égale que leur désinvolture, laquelle, ainsi que l’écrivait M. Mantz à propos de ce même Couture jugeant Delacroix, « dépasse peut-être les limites du comique ordinaire ». Chez l’artiste dont nous tentons d’analyser l’esprit, chez Delacroix, nous rencontrons le genre de mérite propre aux deux précédents sans apercevoir les lacunes ou les insuffisances que nous signalions. Chaque fois qu’il traite une question de métier, c’est avec la compétence d’un peintre de race ; mais comme chez lui l’exécution est toujours subordonnée à l’idée, il reste constamment supérieur à son sujet par l’élévation et la diversité des points de vue ; partout et toujours il demeure peintre, c’est-à-dire qu’en aucune circonstance il ne tente d’introduire dans son art des moyens qui lui soient étrangers ; pourtant jamais en lui le peintre n’étouffe l’artiste, l’homme d’éducation générale et d’inspiration soutenue. Ajoutons que la plupart de ses réflexions sur la peinture ont été écrites après l’année 1850, alors qu’il était dans la pleine maturité du talent, et qu’elles empruntent à ce simple fait une autorité singulière.
Écoutez-le quand il parle de la composition d’un tableau, de l’art de « conduire ce tableau depuis l’ébauche jusqu’au fini ». On sait qu’il n’admettait pas qu’une composition fût faite autrement que par « masses marchant simultanément » : c’était là un des principes d’art qui lui tenaient le plus au cœur, et il lui paraissait aussi hostile à une saine méthode de travail de peindre par fragments isolés qu’il lui eût semblé contraire à une bonne discipline de l’esprit de traiter telle partie d’une composition littéraire sans obéir à un plan nettement délimité, sans avoir préparé par avance les développements avoisinants. Cette règle, qu’il considérait comme fondamentale, lui était apparue avec la lumière de l’évidence en constatant les inconvénients de la méthode contraire dans des tableaux qu’il avait vus en préparation, notamment à l’atelier de Delaroche dont il détestait d’ailleurs la facture ; il comparait ce genre d’ouvrage « à un travail purement manuel qui doit couvrir une certaine quantité d’espace en un temps déterminé, ou à une longue route divisée en un grand nombre d’étapes… Quand une étape est faite, elle n’est plus à faire, et quand toute la route est parcourue, l’artiste est délivré de son tableau. » Dans un fragment de l’année 1854 qui traite la question avec l’ampleur qu’elle comporte, voici ce qu’il écrit : « Le tableau composé successivement de pièces de rapport, achevées avec soin et placées à côté les unes des autres, paraît un chef-d’œuvre et le comble de l’habileté, tant qu’il n’est pas achevé, c’est-à-dire tant que le champ n’est pas couvert ; car finir, pour ces peintres qui finissent chaque détail en le posant sur la toile, c’est avoir couvert cette toile. En présence de ce travail qui marche sans encombre, de ces parties qui paraissent d’autant plus intéressantes que vous n’avez qu’elles à examiner, on est involontairement saisi d’un étonnement peu réfléchi ; mais quand la dernière touche est donnée, quand l’architecte de tout cet entassement de parties séparées a posé le faîte de son édifice bigarré et dit son dernier mot, on ne voit que lacunes ou encombrement, et l’ordonnance nulle part. »
À la suite de cette théorie, comme conséquence immédiate, nous trouvons celle des « sacrifices », cet art de mettre en lumière les parties saillantes et capitales de la composition par l’effacement voulu dans l’exécution des parties secondaires. Delacroix y voyait la suprême habileté du peintre, son plus difficile effort, un art qui ne peut être que le résultat d’une longue expérience. Lorsqu’il parle des « accessoires » en peinture, ce lui est une occasion nouvelle de développer sa théorie des sacrifices, car la manière de les traiter lui semble le critérium de l’habileté de l’artiste. Il y a deux choses qui selon lui caractérisent les mauvais peintres, et les empêchent d’atteindre au Beau : d’abord le défaut de conception d’ensemble, puis l’importance exagérée donnée à ce qui est éminemment relatif et secondaire. Ces idées d’unité dans la composition, de subordination des parties accessoires aux principales, le poursuivent et le hantent ; nous y trouvons une preuve nouvelle de ce besoin d’ordre et de méthode caractérisant une des faces les moins connues de son esprit, qui pourtant ne saurait être omise sous peine de l’ignorer en sa complexité. Même dans l’ébauche, ou la première indication du peintre, on doit voir cette subordination, car « les premiers linéaments par lesquels un maître indique sa pensée contiennent le germe de tout ce que l’ouvrage présentera de saillant ». Cette qualité le frappe surtout chez les artistes de pure imagination, chez ceux qui doivent leur maîtrise au sens intime de la composition, à l’idée qui soutient l’œuvre et la dirige, plutôt qu’aux qualités d’exécution : il cite comme exemples Rembrandt et Poussin. À cet égard, il distingue deux catégories d’artistes nettement différenciées : ceux chez lesquels l’idée prédomine, qui tirent tout d’eux-mêmes et sont le plus redevables à l’invention : Rembrandt par-dessus tous ; ceux, au contraire, qui excellent dans le rendu, et chez qui l’imitation de la nature joue un rôle plus marqué : Titien ou Murillo. » Ils arrivent par une autre voie à l’une des perfections de l’art. »
Delacroix se trouve ainsi conduit à examiner la question de l’« emploi du modèle ». D’après lui, le modèle ne devrait être que le guide de l’artiste, quelque chose comme le dictionnaire auquel il se plaisait à comparer la nature qui pose devant l’œil du peintre : il serait fait uniquement pour soutenir les défaillances de l’exécution et lui permettre d’avancer avec assurance. À ce propos, il s’analyse lui-même et, faisant un retour sur son passé, reconnaît qu’il a commencé à se satisfaire le jour où il a négligé les petits détails pour subordonner ses compositions à l’idée d’ensemble, le jour où il n’a plus été poursuivi uniquement par l’amour de l’exactitude, où il a compris que la vérité résidait dans l’interprétation de la nature. C’est le contraire qu’il observe chez la plupart des peintres, précisément à cause de l’abus qu’ils font du modèle.
Ce qui s’impose toujours à lui, on le voit, c’est le souci de la composition, c’est la prédominance de l’idée sur l’exécution, c’est la prépondérance de la personnalité de l’artiste qui doit s’affirmer dans toutes ses œuvres, même dans celles qui au premier abord paraissent une reproduction fidèle de la nature ; peut-être même serait-il exact de dire qu’elle doit s’affirmer d’autant mieux que le genre traité est plus proche de la nature. Delacroix pensait bien ainsi, et il émet cette idée dans les observations qu’il présente sur le « paysage ». L’idéalisation, qui n’est autre chose que l’interprétation originale du peintre, lui semble d’autant plus indispensable dans le paysage que celui-ci s’y trouve en communication plus directe avec la réalité, que son œuvre en deviendra nécessairement la copie servile, s’il n’y apporte des qualités de vision personnelle et puissante. Il dit quelque part que « le paysage qu’il lui faut, ce n’est pas le paysage absolument vrai ». Nous ne devons pas voir dans cette phrase la simple constatation de ses tendances particulières, qui le poussaient à ne pas envisager séparément ce genre de composition, à le considérer comme le décor mouvant au milieu duquel il plaçait ses inventions dramatiques ; à ce point de vue, il nous semble bien le descendant des grands peintres décorateurs d’autrefois. Mais, abstraction faite des tendances de Delacroix, si nous nous arrêtons avec lui au genre tel que les paysagistes l’ont traité, nous voyons qu’il y affirme une fois de plus la nécessité de l’idéalisation : « Les peintres qui reproduisent simplement leurs études dans leurs tableaux ne donnent jamais au spectateur un vif sentiment de la nature. Le spectateur est ému parce qu’il voit la nature par souvenir, en même temps qu’il voit votre tableau. » Qu’est-ce autre chose, cette remarque, que la constatation du caractère suggestif de l’œuvre d’art, des conditions de son existence et de sa portée, puisqu’en dernière analyse elle n’agit sur notre âme qu’en ressuscitant, par l’intervention miraculeuse de la mémoire et de l’association des idées, les éléments de sensibilité que la vie antérieure y a accumulés ?
Même en dehors de son art, Delacroix aimait à systématiser, à coordonner les pensées maîtresses que l’observation faisait naître en lui : l’esprit est un, en effet, et, semblable à un instrument d’optique complexe et fidèle, reflète avec des propriétés identiques les différents objets qui lui sont présentés. Les motifs qui l’avaient amené à examiner la peinture isolément, le poussent à l’envisager dans ses rapports avec les autres arts ; il l’analyse comme moyen d’expression du sentiment, indépendamment de toute application pratique ; il y était forcément conduit, et par la pente naturelle de son esprit et par sa culture même qui s’étendait, on le sait, à toutes les manifestations du Beau ; également curieux de littérature, de musique, d’art dramatique, il se révèle bien dans son Journal l’intelligence la plus ouverte, la plus avide de jouissances qui ait jamais paru, car on trouverait difficilement, même dans la période de sa vie la plus absorbée par les grands travaux décoratifs, une semaine entière où ne fût point notée quelque réflexion venue à la suite de lectures, de représentations dramatiques ou d’auditions musicales. La poésie, tout d’abord : il y revient sans cesse, comme à la salutaire auxiliatrice de ses travaux, à la source vivifiante où il va puiser ses inspirations ; les lecteurs du Journal verront, dans l’immense quantité de projets qu’il a notés, l’assiduité de ses fréquentations poétiques ; de ces projets, il en exécuta un grand nombre : il eût fallu la vie de dix peintres pour les exécuter tous. À maintes reprises il émet le regret de n’être pas né poète, après avoir comparé dans leur puissance expressive les arts qui se meuvent dans le temps à ceux qui, comme la peinture, produisent une impression d’un bloc et simultanément. Delacroix en profite pour marquer la nécessité de bien comprendre les limites des différents arts : « L’expérience est indispensable pour apprendre tout ce qu’on peut faire avec son instrument, mais surtout pour éviter ce qui ne doit pas être tenté : l’homme sans maturité se jette dans des tentatives insensées ; en voulant faire rendre à l’art plus qu’il ne doit et ne peut, il n’arrive pas même à un certain degré de supériorité dans les limites du possible. » Certains lui ont reproché de n’avoir pas toujours scrupuleusement obéi au principe qu’il pose ainsi et qu’il aimait à répéter ; nous n’avons pas à examiner la question ; mais en admettant que le reproche fût fondé, on ne saurait voir dans une pareille tendance que l’affirmation de son génie. Il aimait passionnément la peinture, et lorsqu’il en parle, il ne trouve pas d’expressions assez enthousiastes pour en décrire les délices. Une seule chose l’affligeait, c’était sa fragilité ; en présence de ces toiles qui ne peuvent résister à l’action du temps, une indicible tristesse l’envahissait. Il reconnaissait la supériorité des conditions matérielles de l’œuvre écrite, qui traverse les siècles à l’abri de la destruction et n’a rien à craindre des injures du temps.
Attentif à toutes les productions de son époque, Delacroix avait assisté au développement de la forme romanesque, sans enthousiasme, il faut le dire. Il reprochait au roman moderne de s’appuyer sur de faux principes d’esthétique, d’abuser des descriptions de lieux, de costumes, de ne pas assez tenir compte de la psychologie des personnages. Ces objections qui se justifiaient pleinement quand il les adressait à des écrivains comme George Sand et Dumas, il eut le tort de les généraliser, et cela le rendit injuste à l’égard de Balzac, dont il ne comprit jamais le puissant génie. À vrai dire, le genre du roman n’était pas fait pour lui plaire : il est superflu d’en déduire les raisons. En revanche, l’art dramatique le prenait tout entier et faisait vibrer ses fibres les plus délicates. Ceux qui ont lu sa correspondance ont pu remarquer que, lors de son voyage à Londres, son admiration se partagea entre les peintures de l’école anglaise, pour laquelle il avait une prédilection particulière, et les représentations de Shakespeare, qu’il suivait assidûment. Le Journal ne nous apprend rien de nouveau en montrant avec quelle ardeur il lisait son théâtre ; mais il éclaire d’une lumière singulièrement révélatrice une des faces de son esprit sur laquelle nous avons insisté déjà à propos du romantisme, en découvrant son admiration pour notre théâtre français du dix-septième siècle, admiration qui le pousse à mettre en parallèle le système dramatique de Racine et celui de Shakespeare. Ici encore il faudra beaucoup rabattre des opinions erronées que les partisans du romantisme avaient contribué à répandre sur lui, car on y verra, non sans surprise, la démonstration de ses tendances classiques.
Delacroix ne s’attachait pas seulement à la forme dramatique elle-même, mais encore à ses interprètes, et l’on conçoit en effet que le peintre de passions si multiples, l’artiste dans l’œuvre duquel le mouvement et le geste devaient tenir une place prépondérante, ait trouvé dans le jeu des grands comédiens, en outre d’une pure jouissance esthétique, un enseignement salutaire et de précieuses indications. Ses lettres de 1825 datées de Londres décrivent l’enthousiasme que suscita en lui le talent de Kean, de Young, les plus fameux interprètes de l’œuvre shakespearienne. En 1835, il écrivait à Nourrit pour le remercier du plaisir qu’il lui avait fait goûter et du talent dont il avait fait preuve en répandant de l’intérêt sur une pièce comme la Juive, « qui en a grand besoin, ajoute-t-il, au milieu de ce ramassis de friperie qui est si étranger à l’art ». Le Journal contient des appréciations longues et détaillées sur les plus célèbres acteurs de l’époque : Rachel, Mlle Mars, la Malibran, Talma, et toujours dans ce qu’il écrit on voit percer le souci des rapports existant entre l’art du comédien et celui du peintre. Il consulte Talma, il interroge Garcia sur la Malibran, et arrive à cette conclusion que chez le peintre « l’exécution doit toujours tenir de l’improvisation, différence capitale avec celle du comédien ».
Mais l’art qui semble l’occuper par-dessus tout, après la peinture, c’est la musique. À cet égard, il faut distinguer entre les jugements qu’il porte sur la pure musique et sur la musique dramatique. Sans doute, lorsqu’il parle de la première, on peut contester certaines de ses appréciations, notamment à propos de Beethoven, qu’il trouve souvent « confus », bien qu’il admire « la divine symphonie en la », à propos de Berlioz, dont il méconnut le talent : — rappelons, toujours dans le sens du préjugé romantique, que les critiques d’alors se plaisaient à associer leurs noms, et appelaient Berlioz le Delacroix de la musique. — Pourtant, si l’on songe à ce qu’était de son temps l’éducation musicale en France, si l’on réfléchit que le grand art allemand n’avait pas encore pénétré dans le public et n’était encore compris que de quelques rares élus, si d’autre part on abandonne le domaine de la pure musique pour aborder celui de la musique dramatique, on reconnaîtra que, loin d’être un retardataire, il fut plutôt un avancé. Ses aversions et ses préférences ne laissent pas d’être significatives : nous avons vu le jugement qu’il portait sur la Juive ; il détestait Meyerbeer, dans les ouvrages duquel il notait une lourdeur et une vulgarité croissantes, ce qui n’est déjà pas si mal pour son temps : « L’affreux Prophète, que son auteur croit sans doute un progrès, est l’anéantissement de l’art. » En revanche, il ne se lassait pas du Don Juan de Mozart, et les œuvres de Glück lui inspiraient une admiration sans réserve. À leur sujet, il expose sur l’union de la déclamation et de la musique, sur la puissance expressive du son combiné avec la parole, des idées éminemment modernes : « Chez Viardot, musique de Glück… Le philosophe Chenavard ne disait plus que la musique est le dernier des arts. Je lui disais que les paroles de ces opéras étaient admirables. Il faut de grandes divisions tranchées ; ces vers arrangés sur ceux de Racine, et par conséquent défigurés, font un effet bien plus puissant avec la musique. Chenavard convenait, sans que je l’en priasse, qu’il n’y a rien à comparer à l’émotion que donne la musique : elle exprime des nuances incomparables. » Enfin, à propos de certains opéras italiens qui alors étaient à la mode, il écrit ces lignes, qui sans doute eussent profondément stupéfié ses contemporains, s’ils les avaient connues : « Cette musique « mince » ne va pas aux temps héroïques. Le dialogue est bien puéril, et cependant, quand on l’interrompt pour intercaler un morceau de cette musique, on est dans la situation d’un voyageur qui fait une route insipide, mais qui voudrait n’arrêter qu’au bout de sa carrière : en un mot, c’est un « genre bâtard », bâtard quant au poème par la niaise imitation de mœurs qui ne nous touchent pas, bâtard par cette musique d’opéra-comique. »
Delacroix voyagea peu, ou du moins ne séjourna guère dans les pays qu’il visita. Si l’on excepte l’excursion au Maroc qui devait avoir une influence considérable sur son talent, il ne paraît pas qu’il soit demeuré longtemps dans les villes d’art qu’il traversa. Ainsi, à son retour du Maroc en 1832, il voit les musées de Séville, mais c’est à peine s’il y reste ; en tout cas, il ne songe pas à s’y arrêter pour copier les maîtres. En 1850, après de longues hésitations, il se décide à partir en Belgique : il visite Bruxelles, Anvers, Malines, Coblentz, Cologne, puis revient à Bruxelles et de là rentre à Paris. Il ne pousse même pas jusqu’en Hollande et paraît impatient de reprendre ses travaux. Un séjour qui semble lui avoir été particulièrement agréable fut celui qu’il fit à Londres en 1825 ; mais il était dans les premières années de sa carrière de peintre, et n’avait pas encore cet impérieux besoin de production ininterrompue qui caractérise l’époque de sa maturité. Le pays qu’il regretta toujours de n’avoir pas vu, c’est l’Italie. À son ami Soulier qui se trouvait à Florence en 1821, il écrivait pour lui dire qu’il enviait son bonheur ; mais comme il avait renoncé à « courir la chance du prix », et que ses modiques ressources ne lui permettaient pas de songer à un aussi long voyage, il se voyait contraint d’en détourner sa pensée ; plus tard, alors qu’il eût pu mettre son projet à exécution, il en fut distrait par ses travaux ; dans les dernières années de sa vie, l’idée d’un voyage à Venise le préoccupa encore : il fit des plans, prit des renseignements, mais finalement y renonça. Faut-il regretter, au point de vue de son œuvre, qu’il n’ait pas visité l’Italie ? Nous ne le pensons pas : sans doute il eût gagné à ce voyage une connaissance approfondie des maîtres qu’il aimait, que l’on ne peut juger « définitivement » qu’en les voyant dans leur pays, dans leur cadre, avec le décor du milieu environnant. L’éducation de son esprit en eût été plus complète ; son opinion sur certains artistes de la Renaissance aurait été modifiée en plusieurs points ; il n’est pas probable que son œuvre en eût subi le contre-coup. La vérité nous paraît être que, semblable à tous les grands inventeurs, Delacroix était attaché au sol natal par l’impérieuse nécessité de la production ; il n’avait pas trop de tout son temps pour exécuter les immenses projets qui fourmillaient dans son cerveau ; il constate quelque part, avec terreur, mais aussi avec une fierté légitime, qu’il faudrait dix existences d’artiste pour les mener à bien ; et de fait, lorsqu’on suit attentivement dans ce Journal la marche de sa pensée, lorsqu’on voit ce besoin incessant d’invention, cet amour absorbant du travail qui a dompté toute autre passion, on est amené à le rapprocher de ces grands maîtres du seizième siècle dont il apparaît, par l’énergie créatrice, le descendant incontestable.
Dans les jugements qu’il porte sur les peintres fameux de la Renaissance, et bien que ces jugements se ressentent souvent de l’incomplète connaissance qu’il en eut, Delacroix est toujours conséquent avec les principes d’esthétique exposés plus haut. On remarquera que pour certains son opinion se modifia avec l’âge, et subit l’influence de son éducation personnelle : la chose est frappante en ce qui concerne Michel-Ange et Titien. Les idées de Delacroix sur ces deux artistes diffèrent complètement à vingt années de distance, suivant que l’on consulte les premiers ou les derniers cahiers du Journal ; cela tient à ce qu’il ne vit de leur œuvre que des exemplaires insuffisants pour les juger « absolument et définitivement » ; cela tient aussi à ce qu’il ne les visita point dans leur patrie ; cela tient enfin à ce que les points de vue se modifient avec l’âge, à ce que des qualités qui semblent prépondérantes au début d’une carrière prennent une importance moindre à l’époque de la maturité, tandis que d’autres occupent la première place : on ne saurait expliquer autrement ses variations à l’égard de ces deux grands hommes. Pourtant il est une chose certaine, c’est que les principes dominateurs de son esthétique demeurent le critérium de ses préférences. Nous avons vu à quel point il prisait la hardiesse d’invention, la prédominance de l’imagination : tel est le secret de son enthousiasme pour Rubens, sur le compte duquel il n’a jamais varié. Quelque partie du Journal que l’on examine, que l’on se réfère aux premières années, alors qu’il l’étudiait au Louvre, et faisait des copies de ses œuvres, à son voyage en Belgique, ou bien à la dernière période de sa vie, c’est toujours la même admiration et le même motif raisonné d’admiration. Il aime en lui la force, la véhémence, l’éclat, l’exubérance, la connaissance approfondie des moyens de l’art. Les dernières pages du Journal exaltent la vie prodigieuse des compositions de Rubens : « Il vous impose ces prétendus défauts qui tiennent à une force qui l’entraîne lui-même et nous subjugue, en dépit des préceptes qui sont bons pour tout le monde excepté pour lui. »
De même pour Rembrandt, dont il devait pénétrer le génie mystérieux mieux qu’aucun peintre de son temps. Il chérissait en lui le sens dramatique des choses, l’intuition profonde des âmes, cette étrange et douloureuse compréhension de la vie, par laquelle le grand artiste nous fait vibrer jusqu’aux profondeurs de notre être. Dans une page de l’année 1851, que Delacroix n’eût sans doute pas, à cette époque, livrée à la publicité, car il en comprenait la portée révolutionnaire, il compare Raphaël et Rembrandt, et confie à son Journal le secret de ses préférences : « Peut-être découvrira-t-on que Rembrandt est un beaucoup plus grand peintre que Raphaël. J’écris ce blasphème propre à faire dresser les cheveux de tous les hommes d’école, sans prendre décidément parti ; seulement je trouve en moi, à mesure que j’avance dans la vie, que la vérité est ce qu’il y a de plus beau et de plus rare. Rembrandt n’a pas, si vous voulez, l’élévation de Raphaël. Peut-être cette élévation que Raphaël a dans les lignes, Rembrandt l’a-t-il dans la mystérieuse conception des sujets, dans la profonde naïveté des expressions et des gestes. Bien qu’on puisse préférer cette emphase majestueuse de Raphaël qui répond peut-être à la grandeur de certains sujets, on pourrait affirmer, sans se faire lapider par les hommes de goût, mais j’entends d’un goût véritable et sincère, que le grand Hollandais était plus nativement peintre que le studieux élève de Pérugin. »
Les maîtres vénitiens furent toujours chers à Delacroix. Ici encore il lui manqua de ne pas les avoir vus chez eux, d’autant mieux qu’il n’existe pas d’école tenant par des racines plus profondes au milieu d’où elle sortit, s’expliquant plus complètement par ce milieu. S’il les avait étudiés à Venise, il est probable que ses opinions à leur égard eussent été modifiées en certains points. Titien est celui sur lequel il insiste le plus volontiers ; de tous les Vénitiens il est d’ailleurs celui qu’on peut le mieux connaître en dehors de Venise. Véronèse eut la plus salutaire et la plus constante influence sur le développement de son talent de coloriste. Delacroix allait l’étudier au Louvre, ne se lassant pas d’interroger ses œuvres dans lesquelles il cherchait à découvrir les secrets de la technique picturale. Le nom de Véronèse revient constamment dans le Journal, quand il parle de son métier, et c’est en s’appuyant sur ses exemples qu’il présente une défense en règle de la couleur ; en réalité, c’est sa propre cause qu’il soutient ; pour en bien comprendre l’importance, il faut se rappeler les attaques qu’il avait eu à supporter, la prépondérance que l’école d’Ingres attribuait au dessin, les reproches que vingt années durant on avait adressés à Delacroix de méconnaître le rôle de la ligne et d’avoir uniquement recours au moyen « matériel » de la couleur. Il s’insurge contre cette prétendue matérialité, et il est au moins curieux de le voir, alors qu’il l’avait surabondamment prouvé par les multiples exemples de ses œuvres personnelles, s’efforçant d’établir par le raisonnement, en 1857, que la couleur est tout aussi idéale que le dessin. Mais il est un autre peintre que Delacroix n’a jamais connu, parce qu’en dehors du Palais-Ducal et des églises de Venise on ne saurait avoir la moindre idée de son génie : c’est Tintoret. J’imagine que si dans les dernières années de sa vie, alors que les magnifiques compositions décoratives de la galerie d’Apollon, de l’Hôtel de ville, du Palais-Bourbon avaient solidement établi sa gloire, et lui avaient prouvé à lui-même ce dont il était capable, j’imagine que s’il avait mis à exécution son projet de voir Venise, il eût ressenti, au Palais-Ducal et à la Scuola de San Rocco, une des plus grandes émotions comme un des plus vifs bonheurs qu’il puisse être donné à un artiste de goûter, en découvrant chez un maître d’autrefois un génie frère du sien, et en retrouvant dans l’œuvre de peinture la plus sublime qui jamais ait été conçue un tempérament et des tendances identiques aux siennes. Devant ce prodigieux poème en peinture qui raconte depuis ses origines jusqu’à son aboutissement final la divine légende de Jésus, en face de cette surabondance de vie et d’invention, Delacroix aurait trouvé la confirmation d’une de ses plus chères idées : la supériorité de l’art décoratif, comme aussi l’exemplaire le plus tranché de la qualité qu’il admirait par-dessus tout : la puissance imaginative.
Nous arrivons au point le plus délicat du Journal, à celui sur lequel la curiosité du lecteur se porte toujours avidement dans des publications de cet ordre : les jugements sur les contemporains. Ils le savent bien et connaissent le parti qu’on en peut tirer, les écrivains qui, se souciant uniquement de bruit et de réclame, exploitent avec opiniâtreté cette tendance. Nous en avons eu des exemples fameux, récemment encore dans la publication d’un journal où il resterait sans doute assez peu de chose, si l’on en retranchait ce qui n’y devrait pas être. Dans l’œuvre qui nous occupe, disons-le bien haut pour la plus grande gloire de son auteur, il ne saurait être question de préoccupations semblables. Ceux qui y chercheraient, sur les hommes célèbres de son temps, des révélations intimes dictées à Delacroix par un parti pris de dénigrement, risqueraient fort d’être déçus. Non que l’artiste ait été dépourvu de cette lucidité d’analyse, de cette pénétration critique qui perce à jour les faiblesses communes à tous les hommes éminents ; non qu’il se soit jamais départi de cette indépendance sans laquelle il n’est pas d’esprit supérieur. Nous l’avons déjà dit, et nous ne pouvons assez le répéter, l’intérêt de ces notes journalières est dans leur sincérité ; on y découvre certaines faces de l’esprit du maître, certaines préférences et certaines antipathies qui sans elles seraient demeurées inconnues ; il s’y trouve donc des jugements sévères, mordants quelquefois, mettant à nu les parties faibles d’un talent ou d’un caractère ; mais la raison comme le bon goût s’y manifestent toujours et viennent atténuer ce que la passion exclusive pourrait avoir de trop ardent.
Presque tous les artistes célèbres de l’époque sont jugés dans le Journal de Delacroix. Nommons, pour n’en citer que quelques-uns, Charlet, Géricault, Gros, Girodet, Ingres, Delaroche, Flandrin, Couture, Corot, Rousseau, Chenavard, Meissonier, Gudin, Courbet, Millet, Decamps. Lorsque Delacroix est en présence d’un tempérament de peintre directement hostile au sien, on s’en aperçoit dès l’abord, car il ne cache pas son impression : Delaroche, par exemple. Il ne pouvait supporter ni sa méthode de composition, ni sa couleur, faite, comme disait Th. Gautier, « avec de l’encre et du cirage ». Il se montre à son égard d’une sévérité extrême et compare ses tableaux « à la patiente récréation d’un amateur qui n’a aucune exécution comme peintre ». De même pour Flandrin, dont il ne pouvait goûter, on le conçoit, la manière sèche et guindée, le parti pris d’affectation, le style froid et voulu. Delacroix aimait trop la vie, la spontanéité, tout cet ensemble de qualités originales dont nous l’avons vu faire l’éloge, pour être indulgent à cet art raide et maniéré. Le nom d’Ingres, est-il besoin de le dire ? revient constamment sous sa plume : il suit ses expositions, note au retour l’impression reçue, tâche de se procurer, par tous les moyens possibles, des esquisses ou des dessins de son rival, les copie ou les calque, car il entend pénétrer ses secrets et ne le juger qu’en connaissance de cause. Néanmoins il semble à son égard d’une rigueur excessive, que certains trouveront assez voisine de l’injustice ; il insiste avec complaisance sur ses défauts, ferme volontairement les yeux sur des qualités incontestables, que lui-même ne pouvait contester ; il s’obstine à ne pas les voir et contre lui seul peut-être laisse percer une animosité manifeste. Cette animosité trouve sa cause, sinon son excuse, dans une parfaite réciprocité, et si l’on réfléchit à la violence, à l’âpreté des critiques qui furent dirigées contre ses œuvres au nom des théories artistiques chères à son illustre adversaire, on comprend qu’il ait été aveuglé sur sa réelle valeur, on comprend surtout qu’il ne faut pas demander à la générosité humaine plus qu’elle ne peut donner ! L’impartialité de Delacroix est entière quand il juge des artistes dont les théories allaient contre les siennes, mais dans l’œuvre desquels il découvre un véritable talent : Courbet entre autres. Nous savons son opinion sur le réalisme, qu’il appelait : « l’antipode de l’art. » En visitant une des expositions de Courbet, il note la vulgarité de ses sujets, mais s’arrête étonné devant la vigueur de sa facture. Il rencontre Couture, constate sans en être surpris « qu’il ne voit et n’analyse comme tous les autres que des qualités d’exécution ». Dans ce domaine restreint, Delacroix reconnaît son talent et fait du même coup le procès de tous les « gens de métier ». Avec Millet, il s’entretient de Michel-Ange et de la Bible, plaisir qu’il goûte assez rarement avec les peintres, si l’on en croit son Journal ; il remarque ses œuvres à une époque où elles étaient méconnues de tous, non sans lui reprocher la prétention affectée, la tournure ambitieuse de ses paysans. Quant à Corot, il salue en lui un véritable artiste. Les observations présentées plus haut sur le paysage, sur la manière dont il le comprenait, sur l’idéalisation qu’il y jugeait indispensable, suffisent pour expliquer son admiration à l’endroit de ce maître unique.
Pour en revenir au romantisme, il est au moins piquant de connaître son jugement sur les chefs incontestés d’un mouvement artistique auquel l’opinion publique le rattachait obstinément, car ce jugement est singulièrement significatif, s’il n’est pas équitable. Mais en fait, peut-on parler ici de justice ou d’injustice, quand il ne doit s’agir que de la manifestation d’une personnalité très tranchée et d’opinions cadrant avec cette personnalité ? Il n’aimait pas le génie de Victor Hugo, qu’il trouvait incorrect. L’extraordinaire puissance de verbe du poète ne lui faisait pas pardonner son exubérance ; entre eux d’ailleurs il y eut complète réciprocité d’antipathie : Victor Hugo ne comprit jamais le genre de beauté propre aux conceptions de Delacroix. La cause n’en est-elle pas que l’un fut toujours un grand poète en peinture, tandis que l’autre demeure le plus vigoureux peintre, le plus hardi sculpteur que nous ayons en poésie ? Les hardiesses de Berlioz dans le domaine symphonique lui furent également insupportables ; on ne manquera pas de dire qu’il en faut chercher la raison dans une éducation musicale exclusivement italienne ; nous ne le pensons pas, et s’il ne suffit point, pour établir le contraire, de rappeler le passage de cette étude dans lequel nous notions ses préférences et ses antipathies musicales, nous ajouterons que son admiration fut sans réserve à l’égard d’un compositeur tout aussi original que Berlioz, d’un génie tout aussi inventif, quoique dans un genre différent : Chopin. On trouvera dans ses jugements sur les autres contemporains : Lamartine, G. Sand, Dumas, Th. Gautier, et tant d’autres moins célèbres, l’affirmation de ses goûts esthétiques : nous ne pouvons nous étendre sur ce sujet ; contentons-nous de rappeler, pour conclure, cette idée précédemment émise, à savoir que Delacroix s’y manifeste comme un esprit d’allure plutôt classique.
En somme, et si l’on tente de résumer l’impression maîtresse qui se dégage de cette étude, si l’on s’efforce d’embrasser d’une vue d’ensemble les éléments fragmentaires de cette grande intelligence, telle qu’elle apparaît dans l’œuvre offerte au public, on doit penser que, loin d’être nuisible à la gloire de l’artiste, comme si souvent il arrive, une telle œuvre ne saurait que lui profiter, en éclairant d’une lumière complète les traits saillants de son génie. L’homme s’y révèle ce que lui-même ambitionnait d’être : discret dans ses allures, réservé dans ses rapports, subordonnant sa conduite à des principes de sage prudence que sa nature ne lui eût pas inspirés, mais dont l’expérience de la vie lui avait démontré la nécessité, et dans lesquels les envieux seuls ont pu voir un indice de sécheresse d’âme. Le penseur s’y montre avec la complexité de ses tendances, l’universalité de ses vues, son admirable aptitude à tout comprendre et à tout goûter de ce qui touche au domaine de l’esprit. L’artiste enfin, si grand qu’il nous soit déjà connu, en sort plus grand encore. En le suivant depuis l’origine de sa carrière jusqu’à sa mort, nous le voyons chérissant son art d’un amour fanatique, obéissant au seul mobile d’une destinée glorieuse, incapable de ces compromissions, fréquentes même chez les hommes de talent, et qui marquent leurs œuvres d’une tare souvent irrémédiable ! Sans doute il eut des faiblesses : les plus illustres n’en sont pas exempts ; mais elles n’étaient pas de nature à influer sur son génie et sur son œuvre : il ne fut pas insensible aux honneurs, et, quand il les ambitionna, dut se soumettre à des démarches quelque peu gênantes vis-à-vis de peintres dont il ne pouvait apprécier le talent. Qu’importe, après tout ? Ce sont là bien petites choses quand il s’agit d’un si éminent esprit. Il demeurera l’un de nos plus glorieux artistes, à n’en pas douter le plus grand peintre de ce siècle, disons mieux, un des plus grands peintres qui aient jamais paru, un de ces anneaux imbrisables qui constituent la chaîne immortelle de l’Art !
DE
EUGÈNE DELACROIX
1822
Louroux, mardi 3 septembre 1822[1]. — Je mets à exécution le projet formé tant de fois d’écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c’est de ne pas perdre de vue que je l’écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l’espère ; j’en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. Je le commence dans d’heureuses dispositions.
Je suis chez mon frère ; il est neuf heures ou dix heures du soir qui viennent de sonner à l’horloge du Louroux. Je me suis assis cinq minutes au clair de lune, sur le petit banc qui est devant ma porte, pour tâcher de me recueillir ; mais quoique je sois heureux aujourd’hui, je ne retrouve pas les sensations d’hier soir… C’était pleine lune. Assis sur le banc qui est contre la maison de mon frère, j’ai goûté des heures délicieuses. Après avoir été reconduire des voisins qui avaient dîné et fait le tour de l’étang, nous rentrâmes. Il lisait les journaux, moi je pris quelques traits des Michel-Ange que j’ai apportés avec moi : la vue de ce grand dessin m’a profondément ému et m’a disposé à de favorables émotions. La lune, s’étant levée toute grande et rousse dans un ciel pur, s’éleva peu à peu entre les arbres. Au milieu de ma rêverie et pendant que mon frère me parlait d’amour, j’entendis de loin la voix de Lisette[2]. Elle a un son qui fait palpiter mon cœur ; sa voix est plus puissante que tous autres charmes de sa personne, car elle n’est point véritablement jolie ; mais elle a un grain de ce que Raphaël sentait si bien ; ses bras purs comme du bronze et d’une forme en même temps délicate et robuste. Cette figure, qui n’est véritablement pas jolie, prend pourtant une finesse, mélange enchanteur de volupté et d’honnêteté… de fille…, comme il y a deux ou trois jours, quand elle vint, que nous étions à table au dessert : c’était dimanche. Quoique je ne l’aime pas dans ses atours qui la serrent trop, elle me plut vivement ce jour-là, surtout pour ce sourire divin dont je viens de parler, à propos de certaines paroles graveleuses qui la chatouillèrent et firent baisser de côté ses yeux qui trahissaient de l’émotion ; il y en avait certes dans sa personne et dans sa voix ; car, en répondant des choses indifférentes, elle (sa voix) était un peu altérée et elle ne me regardait jamais. Sa gorge aussi se soulevait sous le mouchoir. Je crois que c’est ce soir-là que je l’ai embrassée dans le couloir noir de la maison, en rentrant par le bourg dans le jardin ; les autres étaient passés devant, j’étais resté derrière avec elle. Elle me dit toujours de finir, et cela tout bas et doucement ; mais tout cela est peu de chose. Qu’importe ? Son souvenir, qui ne me poursuivra point comme une passion, sera une fleur agréable sur ma route et dans ma mémoire. Elle a un son de voix qui ressemble à celui d’Élisabeth, dont le souvenir commence à s’effacer.
— J’ai reçu dimanche une lettre de Félix[3], dans laquelle il m’annonce que mon tableau a été mis au Luxembourg[4]. Aujourd’hui mardi, j’en suis encore fort occupé ; j’avoue que cela me fait un grand bien et que cette idée, quand elle me revient, colore bien agréablement mes journées. C’est l’idée dominante du moment et qui a activé le désir de retourner à Paris, où je ne trouverai probablement que de l’envie déguisée, de la satiété bientôt de ce qui fait mon triomphe à présent, mais point une Lisette comme celle d’ici, ni la paix et le clair de lune que j’y respire.
Pour en revenir à mes plaisirs d’hier lundi soir, je n’ai pu résister à consacrer le souvenir de cette douce soirée par un dessin, que j’ai fait dans mon album, de la simple vue que j’avais, du banc où je me suis si bien trouvé. J’espère remonter le plus que je pourrai à mes idées et à mes jouissances intérieures…, mais au nom de Dieu, que je continue ! — Me rappeler les idées que j’ai eues sur ce que je veux faire à Paris en arrivant pour m’occuper, et sur les idées qui me sont venues pour des sujets de tableaux.
— Faire mon Tasse en prison[5] grand comme nature.
Jeudi 5 septembre. — J’ai été à la chasse avec mon frère par une chaleur étouffante ; j’ai tué une caille, en me retournant, d’une manière qui m’a attiré les éloges du frère. Ce fut, au reste, la seule pièce de la chasse, quoique j’aie tiré trois coups sur des lapins[6].
Le soir on allait au-devant de Mlle Lisette, qui est venue raccommoder mes chemises. S’étant trouvée un peu en arrière, je l’ai embrassée ; elle s’est débattue de manière à me faire peine, parce que j’ai vu résistance de son cœur. À une deuxième reprise, je l’ai retrouvée. Elle s’est nettement défaite de moi, en me disant que si elle le voulait, elle me le dirait tout de même. Je l’ai repoussée avec une humeur douloureuse et j’ai fait un tour ou deux dans l’allée, devant la lune qui se levait. Je la retrouve encore : elle allait prendre de l’eau pour le souper ; j’eus envie de bouder et de n’y pas retourner ; cependant je cédai encore… « Vous ne m’aimez donc pas ? — Non ! — En aimez-vous un autre ? — Je n’aime personne », réponse ridicule, qui voulait dire assez. Cette fois j’ai laissé tomber avec colère cette main que j’avais prise et j’ai tourné le dos, blessé et chagrin. Sa voix a laissé expirer un rire qui n’était pas un rire. C’était un reste de sa protestation faite, à demi sérieuse. Mais que ce qu’il y a d’odieux lui en reste ! Je suis retourné à mon allée et rentré en affectant de ne la point regarder.
Je désire vivement n’y plus penser. Quoique je n’en sois pas amoureux, je suis indigné et désire plutôt quelle en ait des regrets. Dans ce moment où j’écris, je voudrais exprimer mon dépit. Je me proposais, auparavant de l’aller voir laver demain. Céderai-je à mon désir ? Mais dès lors, tout n’est donc pas fini, et je serais assez lâche pour revenir ? J’espère et désire que non.
— Causé tard avec mon frère.
L’anecdote du capitaine de vaisseau Roquebert qui se fait clouer sur une planche et jeter à la mer, bras et jambes emportés : sujet à transmettre et beau nom à sauver de l’oubli.
Quand les Turcs trouvent les blessés sur le champ de bataille ou même les prisonniers, ils leur disent : « Nay bos » (N’ayez pas peur), et leur donnant par le visage un coup de la poignée de leur sabre qui leur fait baisser la tête, ils la leur font voler.
— Peu de chose remarquable, hier 4… C’était avant-hier l’anniversaire de la mort de ma bien-aimée mère…[7]. C’est le jour où j’ai commencé mon journal. Que son ombre soit présente, quand je l’écrirai, et que rien ne l’y fasse rougir de son fils !
— J’ai écrit ce soir à Philarète[8].
— Cette idée ne s’était jamais présentée à moi comme hier, et elle m’a été suggérée par mon frère : nous venions de tuer un lièvre et, la fatigue disparue, nous en prîmes occasion d’admirer combien le moral a d’influence sur le physique. Je citais le trait de l’Athénien qui expira en apprenant la victoire de Platée (je crois), des soldats français à Malplaquet, et mille autres ! C’est d’un grand poids en faveur de l’élévation de l’âme humaine, et je ne vois pas ce qu’on peut y répondre. Quelle exaltation les trompettes et surtout les tambours battant la charge !
7 septembre. — J’ai lu dans le jardin des passages de Corinne[9] sur la musique italienne qui m’ont fait plaisir ; elle décrit aussi le Miserere du vendredi saint :
« Les Italiens, depuis des siècles, aiment la musique avec transport. Le Dante dans le poème du Purgatoire rencontre un des meilleurs chanteurs de son temps ; il lui demande un de ses airs délicieux, et les âmes ravies s’oublient en l’écoutant jusqu’à ce que leur gardien le rappelle »
(sujet admirable de tableau)
« La gaieté même que la musique bouffe sait si bien exciter n’est point une gaieté vulgaire qui ne dit rien à l’imagination ; au fond de la joie qu’elle donne, il y a des sensations poétiques, une agréable rêverie que les plaisanteries parlées ne sauraient jamais inspirer. La musique est un plaisir si passager, on le sent tellement s’échapper à mesure qu’on l’éprouve, qu’une impression mélancolique se mêle à la gaieté qu’elle cause. Mais aussi quand elle exprime la douleur, elle fait encore naître un sentiment doux, le cœur bat plus vite en l’écoutant ; la satisfaction que cause la régularité de la mesure, en rappelant la brièveté du temps, donne le besoin d’en jouir. »
12 septembre. — L’oncle Riesener et son fils[10], avec Henri Hugues[11], sont venus nous surprendre ici, et je passe des journées amusantes. J’ai été ému d’un grand plaisir, quand, nous trouvant à dîner chez le curé voisin, on est venu nous annoncer qu’ils étaient là.
J’ai pris ces jours-ci la résolution d’aller chez M. Gros[12], et cette idée m’occupe bien fortement et agréablement.
— Nous avons parlé ce soir de mon digne père…[13].
Me rappeler plus en détail les différents traits de sa vie : mon père en Hollande, surpris dans un dîner avec les directeurs par les conjurés excités par le gouvernement lui-même ; il harangue les soldats ivres et brutaux, sans la moindre émotion. Un d’eux le met en joue, et le coup est détourné par mon frère. Il leur parlait en français, à ces brutaux de Hollandais. Le général français, de connivence avec les insurgés, veut lui donner une escorte ; il répond qu’il refuse l’escorte des traîtres.
L’opération[14] — faisant déjeuner auparavant ses amis et les médecins, donnant l’ouvrage à ses ouvriers. L’opération se fit en cinq temps. Il dit, après le quatrième : « Mes amis, voilà quatre actes, que le cinquième n’en fasse pas une tragédie. »
Je veux, l’année prochaine, en revenant, copier ici le portrait de mon père.
— Un homme célèbre dit à un fanfaron jeune et impertinent, qui se vantait de n’avoir jamais eu peur de rien : « Monsieur, vous n’avez donc jamais mouché la chandelle avec vos doigts ! »
— Pense à affermir tes principes. — Pense à ton père et surmonte ta légèreté naturelle ; ne sois pas complaisant avec les gens à conscience souple.
13 septembre. — Voilà la lettre que j’écris à ma sœur[15] la veille au soir de mon départ du Louroux :
« J’ai tardé jusqu’à ce jour à te répondre, parce que je comptais t’aller voir. Maintenant que je vais retourner à Paris pour des choses importantes qui regardent ma peinture, je te transmets des renseignements donnés par Félix. Comment que tu interprètes ma conduite, sois persuadée que mes sentiments n’ont point changé ; j’espère te le prouver, quand je te verrai. Je veux seulement que notre amitié soit de plus fondée à l’avenir sur l’intelligence claire de nos droits respectifs… Je vais donc très incessamment retourner à Paris, où je te retrouverai à la fin de ce mois, si tu ne changes pas d’avis. J’ai été bien peiné de voir que tu n’aies pas cru devoir répondre à la lettre que mon frère t’avait écrite, en même temps que moi. J’en avais espéré un retour et une réconciliation, qui aurait fait mon plus grand bonheur.
Adieu, etc. »
— J’ai reçu ce soir une lettre de Piron[16] et de Pierret[17] : j’ai pris subitement le parti de retourner à Paris. Il me semble, en partant ainsi sans avoir le temps de me reconnaître, que je ne goûterai pas assez d’avance le plaisir de revoir mes bons amis. Pierret, dans sa lettre, me parle de ce que Félix m’avait touché dans sa dernière. Je me trouve calmé sur tous ces articles, et je m’abandonne un peu à ce que m’amèneront les circonstances. Je ne puis décidément renoncer à ma sœur, surtout lorsqu’elle est abandonnée et malheureuse ; je pense que je n’aurai rien de mieux à faire que de confier ma position à Félix et de le prier de m’indiquer un homme de loi, honnête avant tout, pour avoir l’œil à mes affaires et à celles de mon frère.
— Je pars emportant des impressions pénibles sur la situation de mon frère[18]. Je suis libre et jeune, moi ; lui si franc et loyal, et que le caractère dont il est revêtu devait placer au premier rang des hommes estimables, vit entouré de brutaux et de canailles… Cette femme a bon cœur, mais est-ce là seulement ce qu’il devait espérer pour donner la paix à la fin de sa carrière agitée ? Henri Hugues m’a présenté sa position d’une manière que j’avais toujours sentie ainsi, mais dont le sentiment s’était émoussé par l’habitude ; je n’ose prévoir qu’avec déchirement l’avenir qui l’attend… Quelle triste chose que de ne pouvoir avouer sa compagne en présence des gens bien nés, ou d’être réduit à se faire de ce malheur une arme à braver ce qu’il arrive à nommer des préjugés !… Il y a eu avant-hier une espèce de bal précédé d’un dîner qui a mis en lumière à mes yeux tout le désagrément de sa position.
Ce matin l’oncle Riesener et son fils Henry sont partis. Cette séparation, qui doit cependant être courte, m’a été pénible. Je me suis attaché à Henry. Il est quelque peu ricaneur, d’une façon qui le fait juger peu favorablement au premier abord, mais c’est un honnête homme. Hier soir, cette veille de séparation, qui devait être sensible surtout à mon frère, nous avons dîné tard et avec expansion. Avant-hier, jour de ce dîner, je me suis raccommodé avec Lisette et ai dansé avec elle assez avant dans la nuit, me trouvant avec la femme de Charles, Lisette et Henry : j’ai éprouvé de fâcheuses impressions. J’ai du respect pour les femmes ; je ne pourrais dire à des femmes des choses tout à fait obscènes. Quelque idée que j’aie de leur avachissement, je me fais rougir moi-même, quand je blesse cette pudeur dont le dehors au moins ne devrait pas les abandonner. Je crois, mon pauvre réservé, que ce n’est pas la bonne route pour réussir auprès d’elles…
Paris, mardi 24 septembre. — Je suis arrivé hier dimanche matin. J’ai fait un voyage désagréable sur la banquette et sur l’impériale par un froid désagréable et une pluie battante. Je ne sais pourquoi le plaisir que je me promettais à revoir Paris s’affaiblissait à mesure que j’approchais. J’ai embrassé Pierret, et je me suis trouvé triste : les nouvelles du jour en sont la cause. J’ai été dans la journée voir mon tableau au Luxembourg et suis revenu dîner chez mon ami. Le lendemain, j’ai vu Édouard[19] avec bien du plaisir ; il m’a appris qu’il cherchait avec ardeur d’après Rubens. J’en suis enchanté. Il lui manquait surtout de la couleur, et je me suis réjouis de ces études qui le conduiront à un vrai talent et à des succès que je désire si fort lui voir obtenir. Il n’a rien obtenu au Salon : c’est pitoyable ! Nous nous sommes promis de nous voir cet hiver.
Sortant de chez lui, j’ai rencontré Champion[20], je l’ai revu avec un vrai plaisir ; puis j’ai revu Félix ; nous nous sommes embrassés bien tendrement.
Le soir au concours de l’académie.
— J’ai fait mes adieux à mon frère, le vendredi à deux heures environ, près du bourg de Louans. J’étais très ému, il l’était aussi. J’ai plus d’une fois tourné la tête ; je me suis assis plus loin sur des bruyères, l’âme remplie de sentiments divers. J’ai passé une soirée assez ennuyeuse à Sorigny, en attendant la diligence, qui n’a passé que fort tard.
Paris, 5 octobre. — Bonne journée. J’ai passé la journée avec mon bon ami Édouard.
Je lui ai expliqué mes idées sur le modelé : elles lui ont fait plaisir.
Je lui ai montré des croquis de Soulier[21].
J’avais été le matin avec Fedel[22] voir mon oncle Riesener, qui m’a invité à dîner lundi prochain avec la famille. Je m’en promets du plaisir.
Nous avons été tous trois et Rouget[23], que nous avons pris chez lui, voir d’abord les prix exposés. Le torse et le tableau de Debay[24], élève de Gros, élève couronné, m’ont dégoûté de l’école de son maître, et hier encore j’en avais envie !…
Mon oncle a paru touché et charmé de mon tableau. Ils me conseillent d’aller seul, et je m’en sens aujourd’hui une grande envie.
Chose unique, qui m’a tracassé toute la journée, c’est que je pensais toujours à l’habit que j’ai essayé le matin et qui allait mal ; je regardais tous les habits dans les rues. Je suis entré avec Fedel à la séance de l’Institut, où l’on a couronné les prix. Je suis revenu en hâte dîner et ai retrouvé Édouard.
— J’aime beaucoup Fedel. Je regrette qu’il ne travaille pas plus activement.
— Mon oncle m’a proposé de me mener chez M. Gérard, faire une aquarelle d’après le Paysage d’hiver, d’Ostade, et le Peintre dans son atelier, de je ne sais qui, et quelques autres petits Flamands encore.
— Voir à la poste pour étudier les chevaux.
— Le roi Balthazar, fils de Nabuchodonosor, profane dans un grand festin les vases sacrés enlevés à Jérusalem par son père… Au milieu de ce festin sacrilège, parut une main qui écrivit en caractères mystérieux et inintelligibles l’arrêt de ce prince, qui lui fut expliqué par le prophète Daniel[25].
— Gédéon défait les Madianites en faisant prendre à trois cents de ses soldats des trompettes et des lampes renfermées dans des vases de terre. Il entre la nuit au milieu de leur camp et donne lui-même le signal avec une trompette ; ses soldats firent retentir le son de leurs trompettes dans tout le camp des Madianites qu’ils entouraient. En même temps ils brisèrent les vases de terre qu’ils avaient dans l’autre main et ils élevèrent la lampe qu’ils y avaient cachée. À cet éclat et à leurs acclamations, les Madianites furent saisis d’épouvante et, tournant leurs épées contre eux-mêmes, s’entre-tuèrent.
— Pharaon fait jeter dans le Nil les enfants mâles des Hébreux.
— Booz amène Ruth, qui glanait auprès des moissonneurs qui se reposaient et prenaient leur repas.
— Une jeune Canadienne traversant le désert avec son époux est prise par les douleurs de l’enfantement et accouche ; le père prend dans ses bras le nouveau-né[26].
— Le comte d’Egmont conduit au supplice. Tout ce peuple qui l’aime se tait par peur. Le duc d’Albe, avec sa tête longue et sèche, peut être là. L’échafaud de loin tendu de noir et les cloches en branle.
— Algernon Sidney condamné à mort.
Mardi 8 octobre. — Édouard me dit qu’il avait trouvé dans la même maison deux ateliers qui pourraient nous convenir[27]. J’ai passé ma journée dans les plus tristes quartiers du monde. J’étais tout trempé de mélancolie.
J’ai vu Pierret le soir et j’ai pu apprécier plus à mon aise les charmes de sa jolie bonne.
J’ai dîné, hier 7, chez mon oncle Riesener avec l’oncle Pascot[28], la tante, Hugues, etc. Bonne journée.
Le dimanche 6, travaillé chez Champion, où je me congelais. Allé avec lui dîner à Neuilly. Bonne partie, dont je conserverai agréable souvenir. Champion est bon, malgré ses travers ; il a bon cœur, et je désire vivement le voir sortir de son bourbier.
Jeudi dernier, j’avais vu Tancrède[29] pour la troisième fois. J’y ai éprouvé bien du plaisir. Mes douces impressions ont été gâtées par une lettre de mon frère, que j’ai trouvée à mon arrivée. Le souvenir m’en contrarie à tel point que je ne veux pas me rappeler ce que j’ai éprouvé, ni étendre ici ce qu’il m’a dit.
— Il ne faut pas croire que parce qu’une chose avait été rebutée par moi dans un temps, je doive la rejeter aujourd’hui qu’elle se présente. Tel livre où on n’avait rien trouvé d’utile, lu avec les yeux d’une expérience plus avancée, portera leçon.
J’ai porté ou plutôt mon énergie s’est portée d’un autre côté ; je serai la trompette de ceux qui feront de grandes choses.
Il y a en moi quelque chose qui souvent est plus fort que mon corps, souvent est ragaillardi par lui. Il y a des gens chez qui l’influence de l’intérieur est presque nulle. Je la trouve chez moi plus énergique que l’autre. Sans elle, je succomberais…, mais elle me consumera (c’est de l’imagination sans doute que je parle, qui me maîtrise et me mène).
Quand tu as découvert une faiblesse en toi, au lieu de la dissimuler, abrège ton rôle et tes ambages, corrige-toi. Si l’âme n’avait à combattre que le corps ! mais elle a aussi de malins penchants, et il faudrait qu’une partie, la plus mince, mais la plus divine, combattît sans relâche. Les passions corporelles sont toutes viles. Celles de l’âme qui sont viles sont les vrais cancers : envie, etc. ; la lâcheté est si vile, qu’elle doit participer des deux.
Quand j’ai fait un beau tableau, je n’ai point écrit une pensée… C’est ce qu’ils disent !… Qu’ils sont simples ! Ils ôtent à la peinture tous ses avantages. L’écrivain dit presque tout pour être compris. Dans la peinture, il s’établit comme un point mystérieux entre l’âme des personnages et celle du spectateur. Il voit des figures de la nature extérieure, mais il pense intérieurement de la vraie pensée qui est commune à tous les hommes, à laquelle quelques-uns donnent un corps en l’écrivant, mais en altérant son essence déliée ; aussi les esprits grossiers sont plus émus des écrivains que des musiciens et des peintres. L’art du peintre est d’autant plus intime au cœur de l’homme qu’il paraît plus matériel, car chez lui, comme dans la nature extérieure, la part est faite franchement à ce qui est fini et à ce qui est infini, c’est-à-dire à ce que l’âme trouve qui la remue intérieurement dans les objets qui ne frappent que les sens.
Paris, 12 octobre. — Je rentre des Nozze[30] tout plein de divines impressions.
— J’ai vu M. H*** ce matin ; je suis toujours troublé comme un faible enfant. Quelle mobilité que celle de mon esprit ! Un instant, une idée dérange tout, renverse et retourne les résolutions les plus avancées… Par un sentiment intérieur de bonne foi, je ne voudrais pas paraître mieux que je ne suis, mais à quoi bon ? Chaque homme s’inquiète bien plus de la moindre de ses misères que des plus insignes calamités d’une nation tout entière.
— Ne fais que juste ce qu’il faudra. — Tu t’es trompé : ton imagination t’a trompé.
— Cette musique m’inspire souvent de grandes pensées. Je sens un grand désir de faire, quand je l’entends ; ce qui me manque, je crains, c’est la patience. Je serais un tout autre homme, si j’avais dans le travail la tenue de certains que je connais ; je suis trop pressé de produire un résultat.
— Nous avons dîné ensemble, Charles et Piron ; puis aux Italiens. Comme toutes ces femmes m’agitent délicieusement ! Ces grâces, ces tournures, toutes ces divines choses que je vois et que je ne posséderai jamais me remplissent de chagrin et de plaisir à la fois[31].
— Je voudrais bien refaire du piano et du violon.
— J’ai repensé aujourd’hui avec complaisance à la dame des Italiens.
Même soir, une heure et demie de la nuit. — Je viens de voir au milieu de nuages noirs et d’un vent orageux briller un moment Orion dans le ciel. J’ai d’abord pensé à ma vanité, en comparaison de ces mondes suspendus ; ensuite j’ai pensé à la justice, à l’amitié, aux sentiments divins gravés au cœur de l’homme, et je n’ai plus trouvé de grand dans l’univers que lui et son auteur. Cette idée me frappe. Peut-il ne pas exister ? Quoi ! le hasard, en combinant les éléments, en aurait fait jaillir les vertus, reflets d’une grandeur inconnue ! Si le hasard eût fait l’univers, qu’est-ce que signifieraient conscience, remords et dévouement ? Oh ! si tu peux croire, de toutes les forces de ton être, à ce Dieu qui a inventé le devoir, tes irrésolutions seront fixées. Car, avoue que c’est toujours cette vie, la crainte pour elle ou pour son aise, qui trouble tes jours rapides, qui couleraient dans la paix, si tu voyais au bout le sein de ton divin Père pour te recevoir !
Il faut quitter cela et se coucher : mais j’ai rêvé avec grand plaisir…
— J’ai entrevu un progrès dans mon étude de chevaux.
Mardi, 22 octobre. — J’ai passé la soirée chez Félix, où j’ai dîné. J’éprouve de la gêne avec mon neveu, surtout quand je me trouve avec deux autres amis.
— En accompagnant Pierret chez lui pour son mal au genou, je me suis reposé un moment ; je voyais sa bonne de profil presque perdu : il est d’une pureté, d’une beauté charmantes. Qu’un nez droit de cette façon est contrastant avec un nez retroussé de la manière de sa femme ! Il fut un temps où au nombre de mes faiblesses était d’estimer comme dispartagés de la nature les nez retroussés : le nez droit était une compensation à beaucoup de désavantages. Il est de fait qu’ils sont fort laids ; c’est un instinct.
— Maintenant mon exiguïté corporelle me chagrine, comme toujours. Je ne vois pas sans un sentiment d’envie la beauté de mon neveu…[32]. Je suis ordinairement souffrant ; je ne peux pas parler longtemps.
— J’ai admiré de nouveau ce soir le petit portrait de Félix, de Riesener : il me fait envie. Je ne voudrais pourtant pas changer ce que je peux faire pour cela, mais je voudrais avoir cette simplicité. Il me semble si difficile, sans un travail tendu, de rendre ces yeux, cet intervalle entre la paupière supérieure et ce qui la sépare du sourcil !
— Mardi dernier, c’était le 15, une petite femme, de dix-neuf ans, appelée Marie, est venue le matin chez moi pour poser.
Je fus voir le soir Henri Hugues. J’ai lu avec lui la prise de Constantinople, admiré l’héroïque courage de l’empereur Constantin dernier.
— Le mercredi, lendemain, j’ai eu mes amis le soir. Nous avons bu eau-de-vie brûlée et vin chaud.
— Je veux faire, pour la Société des Amis des arts, Milton soigné par ses filles[33].
— J’ai dîné dimanche, avant-hier, chez M. de Conflans, que j’avais été consulter quelques jours avant ; je m’y suis amusé. Nous avons chanté la partition des Nozze.
— J’ai acheté Don Juan. J’ai repris mon violon.
— Je me laisse toujours aller à changer de couleur ; je n’ai pas non plus le sang-froid nécessaire. Je souffre pour le modèle ; je n’observe pas assez avant de rendre.
Dimanche 27 octobre. — Mon cher *** est de retour : je l’ai embrassé aujourd’hui ; le premier moment a été tout au bonheur de le revoir. J’ai senti ensuite un serrement pénible. Comme je me disposais à le faire monter dans ma chambre, je me suis souvenu d’une maudite lettre dont l’écriture eût pu être reconnue… J’ai hésité… Cela a déchiqueté le plaisir que j’avais à le revoir : j’ai usé de subterfuges ; j’ai feint d’avoir perdu ma clef, que sais-je ? Enfin, j’ai remis ordre. Il m’a quitté pour me reprendre le soir. Nous avons été faire une promenade. J’espère que mon tort envers lui n’influera pas sur ses relations avec ***. Dieu veuille qu’il l’ignore toujours !
Et pourquoi, dans ce moment même, sens-je quelque chose comme de la vanité satisfaite ? S’il apprenait quelque chose, il serait désolé.
Il s’occupe de musique ; cela me fait plaisir. Je me promets de bonnes soirées. J’avais remarqué qu’il était difficile que des bonheurs sentis vivement se reproduisissent avec les mêmes circonstances et les mêmes personnes. Je ne vois pourtant pas ce qui empêcherait le retour de ces charmantes intimités passées avec lui et dont j’ai si bien conservé la mémoire. J’éprouve cependant une sorte de tristesse. Il est dans une classe d’hommes qui ne sont pas miens. Je sais bien aussi ce qui me tracasse sourdement, quand je me sens près de lui. C’est ce pourquoi je me suis prononcé et dont je ne veux plus que le moins possible… J’en ai parlé hier à X… ; il pense comme moi : il y a de la duperie. Il nous considère comme libres. Depuis cette conversation avec lui, je suis plus libre de soucis.
J’ai dîné avec lui ; puis Mme Pasta[34] dans Roméo[35], que j’ai revu avec bien du plaisir.
— Hier, j’ai vu Édouard et Lopez[36] à l’atelier de Mauzaisse[37]. Superbe atelier. Il m’est venu à l’idée qu’il n’y avait pas besoin d’en avoir de si beau pour faire de bonnes choses… ; peut-être le contraire !
— J’étais encore à balancer ces jours-ci si j’irais voir la Dame des Italiens ; toutes les fois que j’y vais, j’y pense avec délices ; j’en rêve. C’est pour moi comme ces bonheurs impossibles à obtenir, et qu’on n’a qu’à rêver, un souvenir de l’autre vie. Ce bonheur était peu vif quand je le possédais, aujourd’hui il se colore par mon imagination ; c’est elle qui fait mes douleurs et mes joies.
— C’est, je crois, vendredi dernier que j’ai dîné chez l’oncle Pascot ; je n’avais pas bu beaucoup, mais assez pour être étourdi : c’est un doux état, quoi que puissent dire les sévères. Félix y était ;
Henri y est venu.1823
Paris, mardi 15 avril 1823[38]. — Je reprends mon entreprise après une grande lacune : je crois que c’est un moyen de calmer les agitations qui me tourmentent depuis beaucoup de temps. Je crois voir que, depuis le retour de ***, je suis plus troublé, moins maître de moi. Je m’effarouche comme un enfant ; tous les désordres s’y joignent, celui de mes dépenses aussi bien que l’emploi de mon temps. J’ai pris aujourd’hui plusieurs bonnes résolutions. Que ce papier, au moins, à défaut de ma mémoire, me reproche de les oublier, folie qui n’eût servi qu’à me rendre malheureux.
Si on ne remédie pas d’une manière à la position de ma sœur, je me loge avec elle et vis avec elle. Ce que je demande le plus au ciel, c’est de donner à mon neveu une grande ardeur pour le travail et cette résolution extrême qu’inspire une position malheureuse et gênée. D’ici à ce que cela se décide, je veux faire des armes ; cela contribuera à régler ma vie habituelle.
— J’ai aujourd’hui bien admiré la Charité d’André del Sarte. Cette peinture, en vérité, me touche plus que la Sainte Famille de Raphaël. On peut faire bien de beaucoup de façons… Que ses enfants sont nobles, élégants et forts ! Et sa femme, quelle tête et quelles mains ! Je voudrais avoir le temps de le copier ; ce serait un jalon pour me rappeler qu’en copiant la nature sans influence des maîtres, on doit avoir un style bien plus grand.
— Il faut absolument se mettre à faire des chevaux, aller dans une écurie tous les matins ; se lever de bonne heure et se coucher de même.
« Je ne devais pas vous revoir, et tout s’est réveillé en moi ! Par bonté, vous ne m’avez pas reçu avec froideur. Que peut-il en arriver des tourments infinis qui ont déjà commencé pour moi ? Un partage ! Quels que soient vos sentiments pour un autre, il est votre ami et celui de votre famille. Mais me promènerai-je sous vos fenêtres pendant qu’il sera près de vous ?… J’avais compté sur ma fermeté, et vous avez tout détruit. N’importe ! Privé de vous voir, je conserverai bien chèrement le souvenir de votre dernier adieu. Souvenez-vous aussi d’un tendre ami.
Que prétendez-vous en m’accueillant comme vous avez fait ? Me rendre ma folie ! »
Vendredi 16 mai. — C’est samedi 10 que je l’ai revue ; je ne mettrai pas comment elle m’a reçu : je m’en souviendrai. Cela m’a troublé…
Je suis maintenant tout à fait calme. La jalousie commençait à gronder. J’ai le jour même dîné avec Pierret.
— Le lendemain matin, Bompart vient m’entretenir du concours projeté qu’il m’a présenté sous les plus belles couleurs du monde.
Aujourd’hui, vendredi, 16 mai, j’ai vu Laribe et lui ai porté la rédaction que j’avais tirée de l’histoire de France. Ce que je prévoyais arrive ; on retardera, on amoindrira l’idée, et on élaguera parmi les concurrents. Je lui ai parlé sans façon, peut-être trop. Je me suis rejeté sur la promesse de commande pour une église, mais en homme qui n’y compte guère ; il m’a répondu en homme qui ne veut guère faire de même.
— Fortifie-toi contre la première impression ; conserve ton sang-froid.
Ni les promesses brillantes de tes meilleurs amis, ni les offres de service des puissants, ni l’intérêt qu’un homme de mérite te témoigne ne doivent te faire croire à rien de réel dans tout ce qu’ils te diront ; quant à l’effet, j’entends, parce que beaucoup de prometteurs ont de bonnes intentions en vous parlant, comme les faux braves, ou les gens qui se mettent en colère à la manière des femmes, et dont toute l’effervescence se calme considérablement à l’approche de l’action. De ton côté, sois prudent dans l’accueil que tu fais toi-même, et surtout point de ces prévenances ridicules, fruits seulement de la disposition du moment.
— L’habitude de l’ordre dans les idées est pour toi la seule route au bonheur ; et pour y arriver, l’ordre dans tout le reste, même dans les choses les plus indifférentes, est nécessaire.
— Que je me sens faible, vulnérable et ouvert de tous côtés à la surprise, quand je suis en face de ces gens qui ne disent pas les paroles par hasard, et dont la résolution est toujours prête à soutenir le dire par l’action !… Mais y en a-t-il, et ne m’a-t-on pas pris souvent pour un homme ferme ?
Le masque est tout. Il faut convenir que je les crains ; et est-il rien de plus flétrissant que d’avoir peur ? L’homme le plus ferme par nature est poltron, quand ses idées sont flottantes ; et le sang-froid, la première défense, ne vient que de ce que la surprise n’a point d’accès dans une âme qui a tout vu d’avance. Je sais que cette détermination est immense, mais à force d’y revenir, on fait naturellement une grande partie du chemin.
— J’ai vu mardi dernier Sidonie. Il y a eu quelques moments ravissants. Qu’elle était bien, nue et au lit ! Surtout des baisers et des approches délicieuses…
Elle revient lundi.
— Géricault est venu me voir le lendemain mercredi. J’ai été ému à son abord[39] : sottise ! De là au manège royal, dont je n’attends pas grand fruit ; puis été voir Cogniet.
— Le soir chez les Fielding[40].
— Hier jeudi, Taurel[41] venu me voir ; il m’a donné envie de l’Italie et longue conversation à Monceaux et au retour. Quelques-unes des idées ci-dessus en sont le fruit.
— Aujourd’hui, reçu une lettre de Philarète, qui a couru après moi.
— Voici quelques-unes des folies que j’écrivais, il y a quelques jours, au crayon, tout en travaillant à mon tableau de Phrosine et Melidor[42]. C’était à la suite d’une narration de jouissances éprouvées qui m’avait donné une dose passable de mauvaise humeur.
« Pourquoi ne m’avez-vous pas reçue froidement comme vous m’aimez ? Quels droits ai-je sur vous ? Pourquoi avoir demandé de m’amener ? Vous me dites de vous aller voir ! Quel partage, ô ciel ! Quelle folie ! en sortant de vous voir, je me suis flatté que vos yeux m’avaient dit vrai. Il fallait me traiter en ami : c’était bien le moins. D’ailleurs qu’ai-je demandé ? Je serais un misérable, si j’étais revenu chez vous avec l’espoir de vous aimer et d’être aimé. Je croyais avoir tout surmonté ; je comptais surtout sur votre aide. Qu’est-ce qu’ont voulu dire vos yeux ? Vous avez eu la cruauté de me donner un baiser ! Pensez-vous que je vivrai avec cet homme, si je me mets à vous aimer ?… et que je le souffrirai près de vous ? Ou par pitié, sans doute, vous lui accorderez tout ? Cette pitié-là n’accommode pas un cœur aimant… mon cœur n’est pas si compatissant… Vous me méprisez donc ? »
Ici je ne suis plus fou. — Socrate dit qu’il faut combattre l’amour par la fuite.
— Il faudrait lire Daphnis et Chloé : c’est un des motifs antiques qu’on souffre le plus volontiers.
— Ne pas perdre de vue l’allégorie de l’Homme de génie aux portes du tombeau, et de la Barbarie qui danse autour des fagots, dans lesquels les Omar musulmans et autres jettent livres, images vénérables et l’homme lui-même. Un œil louche l’escorte à son dernier soupir, et la harpie le retient encore par son manteau ou linceul. Pour lui, il se jette dans les bras de la Vérité, déité suprême : son regret est extrême, car il laisse l’erreur et la stupidité après lui, mais il va trouver le repos. On pourrait le personnifier dans la personne du Tasse : ses fers se détachent et restent dans les mains du monstre. La couronne immortelle échappe à ses atteintes et au poison qui coule de ses lèvres sur les pages du poème.
Samedi, mai 1823. — Je rentre d’une bonne promenade avec mon cher Pierret ; nous avons bien parlé de toutes ces bonnes folies qui nous occupent tant. Je suis possédé à présent de la fine tournure de la camériste de Mme ***. Depuis qu’elle est installée dans la maison, je la saluais amicalement. Avant-hier soir, je la rencontrai sur le boulevard ; je venais de faire des visites infructueuses ; elle donnait le bras à une femme en service aussi chez sa maîtresse. Il me prit une forte tentation de les prendre sous le bras. Mille sottes considérations se croisaient dans ma tête, et je m’éloignais toujours délies, en me disant que j’étais un sot et qu’il fallait profiter de l’occasion… lui parler un peu, prendre les mains, que sais-je ?… Enfin faire quelque chose… Mais sa camarade…, mais deux femmes de chambre sous le bras… Je ne pouvais guère les mener prendre des glaces chez Tortoni. Je marchai néanmoins d’un pas plus précipité jusque chez M. H***, où je m’informai de son retour ; puis enfin…, quand il n’était plus temps de les retrouver, je courus sur leurs traces et parcourus inutilement le boulevard.
— Hier, je fus avec Champmartin[43] étudier les chevaux morts.
En rentrant, ma petite Fanny était chez la portière ; je m’installe, je cause une grande heure et je m’arrange pour remonter en même temps qu’elle. Je sentais par tout mon cœur le frisson favorable et délicieux qui précède les bonnes occasions. Mon pied pressait son pied et sa jambe. Mon émotion était charmante. En mettant le pied sur la première marche de l’escalier, je ne savais encore ce que je dirais, ce que je ferais, mais je pressentais qu’il y aurait quelque chose de décisif ; je la pris doucement par la taille. Arrivé sur son palier, je l’embrassai avec ardeur et je pressai sur ses lèvres ; elle ne me repoussa point. Elle craignait, disait-elle, d’être vue. Aurais-je dû pousser plus avant ? Mais que les mots sont froids pour peindre les émotions ! Je la baisais et la rebaisais, je la tirais sans cesse à moi ; enfin je l’abandonnai me promettant de la revoir le lendemain. Hélas ! c’est aujourd’hui, je n’ai eu tout le jour que cette pensée ; je l’ai vue, je ne sais où elle veut en venir. Elle a paru se dérober à moi ou feindre de ne pas me voir… Ce soir, dans ce moment, ma porte est entr’ouverte… J’espère je ne sais quoi,… ce qui peut arriver. J’entrevois une infinité d’obstacles. Mais que ce serait doux !… Ce n’est pas de l’amour. Ce serait trop pour elle ; c’est un singulier chatouillement nerveux qui m’agite, quand je pense qu’il est question d’une femme, car elle n’est vraiment pas séduisante… Je conserverai cependant le souvenir délicieux de ses lèvres serrées par les miennes.
Je veux lui écrire un petit billet qui nécessite une réponse, puis un autre ; il ne faut rien écrire qu’elle puisse prendre au sérieux. Je lui dirai simplement, vu les rares occasions que nous avons, de m’écrire quand je pourrai voir ce portrait qu’elle a promis de me faire voir. O folie ! folie ! folie qu’on aime et qu’on voudrait fuir. Non ! ce n’est pas le bonheur ! C’est mieux que le bonheur, ou c’est une misère bien poignante. Malheureux ! Et si je prenais pour une femme une véritable passion ! Mon lâche cœur n’ose préférer la paix d’une âme indifférente à l’agitation délicieuse et déchirante d’une passion orageuse. La fuite est le seul remède. Mais on se persuade toujours qu’il sera temps de fuir, et l’on serait au désespoir de fuir, même son malheur.
— J’ai été le soir avec Pierret retoucher un tableau de famille que le pauvre père Petit finissait en mourant. J’ai éprouvé un sentiment pénible au milieu de ce modeste asile d’un pauvre vieux peintre qui ne fut pas sans talent et à la vue de ce malheureux ouvrage de sa vieillesse languissante.
— Je me suis décidé à faire pour le Salon des scènes du Massacre de Scio[44].
Lundi 9 juin. — Pourquoi ne pas profiter des contrepoisons de la civilisation, les bons livres ? Ils fortifient et répandent le calme dans l’âme. Je ne puis douter de ce qui est véritablement bien, mais au milieu des fanatiques et des intrigants, il faut de la réserve.
— On se reproche trop souvent d’avoir changé : c’est la chose qui a changé. Quelle chose plus désolante ? J’ai deux, trois, quatre amis : eh bien ! je suis contraint d’être un homme différent avec chacun d’eux, ou plutôt de montrer à chacun la face qu’il comprend. C’est une des plus grandes misères que de ne pouvoir jamais être connu et senti tout entier par un même homme ; et quand j’y pense, je crois que c’est là la souveraine plaie de la vie : c’est cette solitude inévitable à laquelle le cœur est condamné. Une épouse qui est de votre force est le plus grand des biens. Je la préférerais supérieure à moi de tous points, plutôt que le contraire.
Dimanche 9 novembre. — Revu l’amie. Elle est venue à mon atelier ; je suis bien plus tranquille et pourtant bien délicieusement atteint. Je lui suis médiocrement cher (comme amant s’entend), car je suis convaincu qu’elle a pour moi presque tout le tendre attachement que j’ai pour elle. Singulière émotion ! Chère femme, au moins ne réveille pas dans mon cœur de nouveaux tourments… Je trouvai tant de choses à lui dire, quand je ne l’eus plus. Il m’a semblé qu’avec le secret tout était dit, puisqu’il s’agit de ne plus faire un malheureux. Mais je ne veux plus qu’on me dise qu’on m’aime et qu’on ait en même temps des procédés pour un autre… J’ai vu Piron également ce soir-là… Je la reverrai jeudi.
Dieu ! que de choses en arrière ! Et ma petite Émilie[45]… Elle est déjà oubliée, je n’en ai pas fait mention ; j’y ai trouvé de doux moments…
C’est lundi dernier que j’avais été chez elle : ce jour, j’avais été voir Regnier[46], chez qui j’ai revu une esquisse de Constable[47] : admirable chose et incroyable !
— J’ai arrêté cette semaine une composition de Scio et presque celle du Tasse[48].
10 novembre. — « Je voudrais qu’une femme ait la franchise, avec un homme qui est son ami, de s’expliquer comme le font deux hommes ensemble. Pourquoi êtes-vous venue rue de Grenelle ? C’est plus que des procédés. Ce que je hais le plus, c’est l’incertitude. Dis-moi, chère amie, que nous te sommes également chers. Et pourquoi rougir ? La femme est-elle autrement faite que nous ? Est-ce que nous nous faisons grand scrupule de faire notre cour à un objet qui nous captive momentanément ? Enfin, fais ta profession d’amour. Dis que ton cœur est assez vaste pour deux amis, car ni l’un ni l’autre n’est amant ; je ne serai pas jaloux, et je ne me regarderai pas comme coupable en te possédant. C’est de toutes les manières que je voudrais m’emparer de toi. Avec quelles délices je t’ai pressée sur mon cœur ! Toi-même, tes accents étaient vrais. Tu me dis : « Qu’il y a longtemps, cher ami, que je ne t’ai vu ainsi ! » Mais quoi, ne jamais te voir ! Ne pourrai-je, du moins, si tu es malade, aller moi-même savoir de tes nouvelles ? N’y a-t-il pas quelque moyen ?… »
Et toi, mon pauvre ami ? tu es à plaindre. On n’éprouve pas ce que tu éprouves… Je crois être plus heureux, parce que je me contente de moins… Elle ne nous voit pas coupables du tout en nous abandonnant l’un à l’autre. « Je me mets à votre discrétion », a-t-elle dit.
Ce que je désire vivement, c’est qu’il puisse cesser de l’aimer. Ce jeudi, je l’attends avec bien de l’impatience ; mais après, il n’y en aura plus ; mais elle-même, elle se résout bien facilement à se passer de moi ! Quelle me le dise elle-même, et je serai tranquille.
Même jour. —
« Bonne et chère J…, j’use de tous les privilèges de mes vacances pour me donner la consolation de vous écrire, en attendant celle de vous voir. Ce jeudi, j’y pense beaucoup trop pour un homme qui n’en veut pas souvent de semblables. Quels doux et cruels moments pour moi, bonne amie ! Il me semble que ma lettre va vous ennuyer. N’imaginez pas que je ne vous écrive que pour envoyer mes rêveries, bien tristement (dans tout cela, ma tristesse vient de ce que, comme son véritable ami avant tout, je ne puis la voir, etc.) et chèrement méditées, hélas ! à cette même place où je vous ai vue hier si bonne pour moi. Je veux vous demander une chose sur laquelle je n’ai pas insisté. Soyez assez bonne pour venir demain…
Je suis un grand et indigne indiscret : mais pensez que vous devez m’oublier après ce jeudi… Ah ! pourquoi, bonne J…, n’être pas entièrement franche avec moi ? Pourquoi n’être pas tout à fait l’amie de celui dont le cœur sera toujours plein de votre chère image, et qui donnerait tout pour vous ? Quel doux sentiment vous m’inspirez ! Mais n’appuyons pas sur tous ces sentiments-là. Il y a tant d’affections délicates dans tout, et singulières dans tout ceci, que la tête s’y perd, quand on veut s’en rendre compte : il n’y a que le cœur dont l’instinct soit sûr ; il ne ma jamais trompé sur le degré d’intérêt qu’on me porte.
Adieu ! Adieu donc ! Je compte beaucoup sur vos bontés : vous savez aussi que nous avons des articles à dresser, puis mille choses à nous dire, dont je ne me suis souvenu qu’au moment où je vous ai quittée Tout cela demande bien du temps.
Mes sottises me font rougir de pitié… Que cette vie est triste ! toujours des entraves à ce qui serait si doux ! Quoi ! si vous tombiez malade, je ne pourrais aller moi-même vous demander de vos nouvelles et vous voir à votre chevet ! Enfin ! il en est ainsi… et adieu encore une fois, et la plus tendre et la plus sûre amitié pour la vie. »
17 décembre. —
« Je n’ai reçu qu’à présent votre lettre. Depuis quelques jours je me tenais chez moi et n’étais pas allé à mon atelier. Oui, votre souvenir me sera toujours cher, et ce que vous souffrez, je le souffre avec vous ; j’ai aussi mes ennuis et une lutte à souffrir contre des adversités de plus d’une espèce. Le temps, la nécessité, tout me presse et me harcèle : Ne joignez pas à ces maux celui de croire que je suis indifférent à ce qui vous touche. Vous avez bien voulu dernièrement vous intéresser à moi, quoique infructueusement. J’aurais été vous voir si je n’avais craint qu’à cette occasion vous ne preniez ma visite pour un simple acte de politesse, comme tout le monde s’en rend. Ici je peux en remercier de tout mon cœur une amie. Vous pouvez croire que je n’ai pas attendu votre lettre pour savoir de vos nouvelles. Votre pauvre enfant ! Je vous plains bien ! Adieu ! Ma triste figure ne serait guère pour vous apporter quelques consolations. Adieu et tendre attachement. »
22 ou 23 décembre, mardi, à minuit. — Je rentre
chez moi dans des sentiments de bienveillance et de
résignation au sort. J’ai passé la soirée avec Pierret
et sa femme au coin de leur modeste feu. Nous prenons
notre parti sur notre pauvreté : et au fait, quand
je m’en plains, je suis hors de moi, hors de l’état qui
m’est propre. Il faut, pour la fortune, une espèce de
talent que je n’ai point, et quand on ne l’a point, il
en faudrait un autre encore pour suppléer à ce qui
manque.
Faisons tout avec tranquillité ; n’éprouvons d’émotions que devant les beaux ouvrages ou les belles actions… Travaillons avec calme et sans presse. Sitôt que la sueur commence à me gagner et mon sang à s’impatienter, tiens-toi en garde : la peinture lâche est la peinture d’un lâche.
— Je vais demain chez Leblond[49], le soir. J’aime bien ces soirées et aussi beaucoup Leblond, c’est un bon ami.
— J’ai été en soirée chez Perpignan[50], samedi dernier. Thé à l’anglaise, punch, glaces, etc., jolies femmes…
— Je travaille à mes sauvages. Demain mercredi, j’ai Émilie.
Mardi 30 décembre. — Aujourd’hui avec Pierret : j’avais rendez-vous aux Amis des arts, pour aller voir une galerie de tableaux, presque tous italiens, parmi lesquels est le Marcus Sextus de M. Guérin ; nous nous sommes attardés, pensant n’avoir que ce seul tableau à voir, et que nous trouverions ces vieux tableaux à l’ordinaire. Au contraire, peu de tableaux, mais supérieurement choisis, et par-dessus tout un carton de Michel-Ange… O sublime génie ! que ces traits presque effacés par le temps sont empreints de majesté !
J’ai senti se réveiller en moi la passion des grandes choses. Retrempons-nous de temps en temps dans les grandes et belles productions ! J’ai repris ce soir mon Dante ; je ne suis pas né décidément pour faire des tableaux à la mode.
En sortant de là, nous avons été chez un teinturier, où nous avons vu une fille dont la tournure et la tête sont admirables et étaient tout en harmonie avec les sentiments que ces beaux ouvrages italiens m’avaient inspirés.
Je retournerai, si je puis, souvent là. Il y a des portraits vénitiens admirables… Un Raphaël et un Corrège… Oh ! la belle Sainte Famille de Raphaël !
— Ce soir, Félix est venu chez moi ; il était arrivé ce matin ou hier soir. Le bon ami ! nous avons bien amicalement causé toute la soirée.
— La Saint-Sylvestre[51]. L’année va finir.
— C’était le 27… Dîné avec Édouard et Lopez, chez le restaurateur. Le soir ils m’ont présenté chez M. Lelièvre, leur ami[52]. J’ai reconduit Édouard jusqu’à sa porte. Beaucoup de bonne causerie et d’amitié.
— J’ai vendu ces jours-ci à M. Coutan[53], l’amateur de Scheffer, mon tableau exécrable de Ivanhoë… Le pauvre homme ! et il dit qu’il m’en prendra quelques-uns encore ; je serais d’autant plus tenté de croire qu’il n’est pas émerveillé de celui-ci.
— Il y a quelques jours, j’ai été le soir chez Géricault[54]. Quelle triste soirée ! il est mourant ; sa maigreur est affreuse ; ses cuisses sont grosses comme mes bras ; sa tête est celle d’un vieillard mourant. Je fais des vœux bien sincères pour qu’il vive, mais je n’espère plus. Quel affreux changement ! Je me souviens que je suis revenu tout enthousiasmé de sa peinture : surtout une étude de tête du carabinier… s’en souvenir ; c’est un jalon. Les belles études ! Quelle fermeté ! quelle supériorité ! et mourir à côté de tout cela, qu’on a fait dans toute la vigueur et les fougues de la jeunesse, quand on ne peut se retourner sur son lit d’un pouce sans le secours d’autrui !…
Sans date[55]. — La question sur le beau[56] se réduit à peu près à ceci : Qu’aimez-vous mieux d’un lion ou d’un tigre ? Un Grec et un Anglais ont chacun une manière d’être beau qui n’a rien de commun.
C’est l’idée morale des choses qui nous effraye ; un serpent nous fait horreur dans la nature, et les boudoirs de jolies femmes sont remplis d’ornements de ce genre : tous les animaux en pierre que nous ont laissés les Égyptiens, des crapauds, etc.
Souvent une chose, dans la nature, est pleine de caractère, par le peu de prononcé ou même de caractère quelle semble avoir au premier coup d’œil.
Le docteur Bailly met en principe : « La preuve que nos idées sur la beauté de certains peuples ne sont pas fausses, c’est que la nature semble donner plus d’intelligence aux races qui ont davantage ce que nous regardons comme la beauté. » Mais les arts ne sont pas ainsi ; car si le Grec était plus beau à représenter que l’Esquimau, l’Esquimau serait plus beau que le cheval, qui a moins d’intelligence dans l’échelle des êtres. Mais tout est si bien né dans la nature que notre orgueil est extrême. Nous bâtissons un monde sur chaque petit point qui nous entoure. La rage de tout expliquer nous jette dans d’étranges bévues. Nous disons que nos voisins ont mauvais goût, et le juge en cela, c’est notre propre goût ; car nous savons aussi que tous les autres voisins nous condamnent.
Nos peintres sont enchantés d’avoir un beau idéal tout fait et en poche qu’ils peuvent communiquer aux leurs et à leurs amis. Pour donner de l’idéal à une tête d’Égyptien, ils la rapprochent du profil de l’Antinoüs. Ils disent : « Nous avons fait notre possible, mais si ce n’est pas plus beau encore, grâce à notre correction, il faut s’en prendre à cette nature baroque, à ce nez épaté, à ces lèvres épaisses, qui sont des choses intolérables à voir. » Les têtes de Girodet sont un exemple divertissant dans ce principe ; ces diables de nez crochus, de nez retroussés, etc., que fabrique la nature, le mettent au désespoir. Que lui coûtait-il… de faire tout droit ? Pourquoi des draperies se permettent-elles de ne pas tomber avec la grâce horizontale des statues antiques ?… Telle n’était pas la méthode antique. Ils exagéraient au contraire, pour trouver l’idéal et le grand. Le laid souverain, ce sont nos conventions et nos arrangements mesquins de la grande et sublime nature… Le laid, ce sont nos têtes embellies, nos plis embellis, l’art et la nature corrigés par le goût passager de quelques nains, qui donnent sur les doigts aux anciens, au moyen âge, et à la nature enfin.
Le terreux et l’olive ont tellement dominé leur couleur, que la nature est discordante à leurs yeux, avec ses tons vifs et hardis.
L’atelier est devenu le creuset où le génie humain, à son apogée de développement, remet en question non seulement ce qui est, mais recrée avec une nature fantastique et conventionnelle que nos faibles esprits, ne sachant plus comment accorder avec ce qui est, adoptent de préférence, parce que c’est notre misérable
ouvrage.1824
Jeudi 1er janvier. — Je n’ai rapporté, comme je crois que c’est toujours, qu’une profonde mélancolie de cette bonne Saint-Sylvestre que nous a donnée Pierret ; ces aubades, ces trompettes surtout et ces cors ne sont propres qu’à vous affliger sur ce temps qui passe, au lieu de vous préparer gaiement à celui qui vient. Ce jour est le plus triste de l’année, j’entends aujourd’hui ; hier, l’année n’était pas encore finie.
Édouard a passé la soirée avec nous. J’ai revu Gouleux[57] ; nous avons rappelé nos souvenirs de collège… Plusieurs sont devenus des filous ou sont démoralisés.
Dimanche 4 janvier. — Malheureux ! que peut-on
faire de grand, au milieu de ces accointances éternelles
avec tout ce qui est vulgaire ? Penser au grand
Michel-Ange.
Nourris-toi des grandes et sévères beautés qui nourrissent l’âme.
Je suis toujours détourné de leur étude par les folles distractions[58]. Cherche la solitude. Si ta vie est réglée, ta santé ne souffrira point de ta retraite.
Voici ce que le grand Michel-Ange écrivait au bord du tombeau : « Porté sur une barque fragile au milieu d’une mer orageuse, je termine le cours de ma vie ; je touche au port commun où chacun vient rendre compte du bien et du mal qu’il a fait. Ah ! je reconnais bien que cet art qui était l’idole, le tyran de mon imagination, la plongeait dans l’erreur : tout est erreur ici-bas. Pensers amoureux, imaginations vaines et douces, que deviendrez-vous, maintenant que je m’approche de deux morts, l’une qui est certaine, l’autre qui me menace… ? Non, la sculpture, la peinture ne peuvent suffire pour tranquilliser une âme qui s’est tournée vers l’amour divin et que le feu sacré embrase. » (Vers qui ferment le recueil de ses poésies.)
Lundi 12 janvier. — Ce matin, rendez-vous avec Raymond Verninac, pour voir M. Voutier, qui vient de la Grèce où il a été employé avec distinction, et qui va y retourner. C’est un bel homme, il à l’air d’un Grec ; sa figure marquée de petite vérole et les yeux petits, mais vifs, et il semble plein d’énergie. Ce qu’il a vu cent fois, avec une nouvelle admiration, c’est le soldat grec qui, après avoir renversé son ennemi et l’avoir foulé de son talon, crie avec enthousiasme : Tito Eleutheria ! Au siège d’Athènes, où les Grecs avaient poussé leurs ouvrages jusqu’à portée du pistolet des murailles, il empêcha un soldat de tuer un Turc qui paraissait aux créneaux, tant il fut frappé de sa belle tête.
— Massacres de Scio durant un mois. C’est à la fin de ce mois que le capitaine Georges d’Ipsara, avec, je crois, cent quarante hommes, fit incendier le vaisseau-amiral ; tous les principaux officiers y périrent et le capitan-pacha lui-même. Les Grecs se sauvèrent sains et saufs. Un vaisseau qui portait de Candie à Constantinople la tête du brave Balleste, officier français, avait relâché à Scio et s’était paré de son horrible trophée. Le vaisseau fut incendié, et la tête du brave Balleste eut un tombeau digne de lui.
— En sortant de déjeuner avec Raymond Verninac
et M. Voutier, été au Luxembourg. Je suis
rentré à mon atelier saisi de zèle et, Hélène étant
arrivée peu après, j’ai de suite fait quelques ensembles
pour mon tableau. Elle a emporté malheureusement
une partie de mon énergie de ce jour.
— Le soir, Dimier[59] nous donne un punch chez Beauvilliers[60].
— Mardi dernier, 6 janvier, dîné chez Riesener, avec Jacquinot et la fille du colonel, son frère[61]. Elle n’a pas de beaux traits, mais je désire vivement conserver longtemps l’impression de sa physionomie italienne, et surtout cette netteté de teint (sans avoir précisément un beau teint), et cette pureté de formes. J’entends cet arrêté, ce tendu de la peau qui n’appartient qu’à une vierge. C’est un souvenir précieux à garder pour la peinture, mais je le sens déjà qui s’efface.
— Hier dimanche 11, dîné chez la maîtresse de Leblond ; aucune impression que vulgaire.
— C’est donc aujourd’hui lundi 12 que je commence mon tableau.
Dimanche 18 janvier. — Dîné aujourd’hui chez M. Lelièvre avec Édouard et Lopez. Bonnes et excellentes gens. Grande discussion sur les arts, et notamment grands efforts pour faire comprendre le mérite de Raphaël et de Michel-Ange.
— Aujourd’hui, Émilie Robert.
— Hier samedi et avant-hier vendredi, fait en partie ou préparé la femme du devant. — Leblond venu à mon atelier.
— Hier samedi, D. Giovanni joué par Zuchelli[62].
— Vendredi, soirée passée chez Taurel.
— J’ai eu Provost, modèle, mardi 13, et commencé par la tête du mourant sur le devant. — Le lendemain mercredi et le jeudi 15, chez Mme Lelièvre le soir, avec Édouard ; elle m’a invité à dîner pour aujourd’hui.
| À Provost, environ | 8 fr. |
| À Émilie Robert, aujourd’hui | 12 fr. |
— J’ai lu ces jours-ci dans le Journal des Débats, à propos d’un ouvrage original où l’on traite de toutes sortes de sujets, par le pseudonyme Philemnestre, qu’un juge anglais, désirant vivre longtemps, s’était mis à interroger tous les vieillards qu’il rencontrait, sur leur genre de vie et leur régime, et que leur longévité ne tenait particulièrement, ni à la nourriture, ni aux boissons fermentées. La seule chose constante chez tous, était de se lever bon matin, et surtout de ne pas refaire de somme, une fois réveillés. Chose très importante.
Samedi 24 janvier. — Aujourd’hui je me suis remis à mon tableau ; dimanche dernier 18, j’ai cessé d’y travailler. J’avais commencé le lundi précédent quelques croquis seulement, ou plutôt le mardi 13 ; j’ai dessiné et fait aujourd’hui la tête, la poitrine de la femme morte qui est sur le devant. À l’exception de la main et des cheveux, tout est fait.
— Ce soir présenté chez M. *** et demain dîner chez Mme Lelièvre. Je disais ce soir à Édouard que, au lieu de faire comme la plupart des gens qui ont fait leur progrès dans la guerre de la vie à l’aide de leur lecture, il m’arrive de ne lire que pour confirmer ceux que je fais à part moi, car depuis que j’ai quitté le collège je n’ai point lu ; aussi je suis émerveillé des bonnes choses que je trouve dans les livres ; je n’en suis aucunement blasé.
— Hier vendredi 23, en sortant de dîner chez Rouget[63], il m’a pris une paresse qui m’a conduit au cabinet littéraire, où j’ai parcouru la vie de Rossini ; je m’en suis saturé et j’ai eu tort. Mais au fait, ce Stendhal est un insolent, qui a raison avec trop de hauteur et qui parfois déraisonne.
Rossini est né en 1792, l’année où Mozart mourut.
— Jeudi 22 janvier. Passé chez moi la soirée et une partie de la journée chez Soulier, où fait l’aquarelle du Turc par terre[63]. Il m’a envoyé à sa place dîner chez sa mère.
— Le mercredi 21, passé en partie aussi chez
Sourlie et vu ma sœur.
— Été pour l’affaire du général Jacquinot chez M. Berryer[64].
Le soir, chez Leblond, qui avait passé partie de la journée chez Soulier.
Dimanche 25 janvier. — Aujourd’hui, dîné chez M. Lelièvre. Un diable de colonel, tout plein de ses hauts faits d’Espagne, nous y a ennuyés beaucoup.
En revenant avec Édouard, j’ai eu plus d’idées que dans toute la journée. Ceux qui en ont vous en font naître ; mais ma mémoire s’enfuit tellement de jour en jour que je ne suis plus le maître de rien, ni du passé que j’oublie, ni à peine du présent, ou bien je suis presque toujours tellement occupé d’une chose, que je perds de vue, ou je crains de perdre ce que je devrais faire, ni même de l’avenir, puisque je ne suis jamais assuré de n’avoir pas d’avance disposé de mon temps. Je désire prendre sur moi d’apprendre beaucoup par cœur, pour rappeler quelque chose de ma mémoire. Un homme sans mémoire ne sait sur quoi compter ; tout le trahit. Beaucoup de choses que j’aurais voulu me rappeler de notre conversation, en revenant, m’ont échappé…
Je me disais qu’une triste chose de notre condition misérable, était l’obligation d’être sans cesse vis-à-vis de soi-même. C’est ce qui rend si douce la société des gens aimables : ils vous font croire un instant qu’ils sont un peu vous, mais vous retombez bien vite dans votre triste unité. Quoi ! l’ami le plus chéri, la femme la plus aimée et méritant de l’être, ne prendront jamais sur eux une partie du poids ? Oui, quelques instants seulement ; mais ils ont leur manteau de plomb à traîner.
Je suis venu même à une autre de mes idées : c’est celle qui a précédé cette dernière. Tous les soirs, lui disais-je, en sortant de chez M. Lelièvre, je rentre chez moi, dans l’état d’un homme à qui sont arrivés les événements les plus variés. Cela finit toujours par un chaos qui m’étourdit. Je suis cent fois plus hébété, cent fois plus incapable, je crois, de m’occuper des affaires les plus ordinaires, qu’un paysan qui a labouré toute la journée. Je disais encore à Édouard qu’on s’attachait aux amis, quand ils faisaient autant de progrès que vous-même ; la preuve en est que des circonstances charmantes dans la vie et dont on conservait le souvenir avec délices, n’étaient plus bonnes à recommencer réellement et juste comme elles s’étaient passées ; témoins encore les amis d’enfance qu’on revoit longtemps après.
— J’ai reçu, aujourd’hui que j’ai commencé la femme traînée par le cheval, Riesener, Henri Hugues et Rouget. Jugez comme ils ont traité mon pauvre ouvrage[65], qu’ils ont vu justement dans le moment du tripotage, où moi seul je peux augurer quelque chose. Comment ? disais-je à Édouard, il faut que je lutte contre la fortune et la paresse qui m’est naturelle, il faut qu’avec de l’enthousiasme je gagne du pain, et des bougres comme ceux-là viendront, jusque dans ma tanière, glacer mes inspirations dans leur germe et me mesurer avec leurs lunettes, eux qui ne voudraient pas être Rubens ! Par un bonheur dont je te rends grâces, ciel propice, tu me donnes dans ma misère le sang-froid nécessaire pour retenir à une distance respectueuse les scrupules que leurs sottes observations faisaient souvent naître en moi. Pierret même m’a fait quelques observations qui ne m’ont point touché, parce que je sais ce qu’il y a à faire. Henri n’était pas si difficile que ces messieurs.
À leur départ, j’ai soulagé mon cœur par une bordée d’imprécations à la médiocrité, et puis je suis rentré sous mon manteau.
Les éloges de Rouget, qui ne voudrait pas être Rubens, me séchaient… Il m’emprunte, en attendant, mon étude, et j’ai eu tort de la lui promettre, elle me sera peut-être utile.
J’ai pensé, en revenant de mon atelier, à faire une jeune fille rêveuse qui taille une plume, debout devant une table.
Lundi 26 janvier. — J’ai donné à Émilie Robert, pour trois séances de mon tableau, 12 francs.
— J’ai oublié de noter que j’avais envie de faire par la suite une sorte de mémoire sur la peinture[66], où je pourrais traiter des différences des arts entre eux ; comme, par exemple… que, dans la musique, la forme emporte le fond ; dans la peinture, au contraire, on pardonne aux choses qui tiennent au temps, en faveur des beautés du génie.
— Dufresne[67] est venu me voir à mon atelier.
— Je retrouve justement dans Mme de Staël le développement de mon idée sur la peinture. Cet art, ainsi que la musique, sont au-dessus de la pensée ; de là leur avantage sur la littérature, par le vague.
Mardi 27 janvier. — J’ai reçu ce matin à mon atelier la lettre qui m’annonce la mort de mon pauvre Géricault[68] ; je ne peux m’accoutumer à cette idée. Malgré la certitude que chacun devait avoir de le perdre bientôt, il me semblait qu’en écartant cette idée, c’était presque conjurer la mort. Elle n’a pas oublié sa proie, et demain la terre cachera le peu qui est resté de lui… Quelle destinée différente semblait promettre tant de force de corps, tant de feu et d’imagination ? Quoiqu’il ne fût pas précisément mon ami, ce malheur me perce le cœur ; il m’a fait fuir mon travail et effacer tout ce que j’avais fait.
J’ai dîné avec Soulier et Fielding chez Tautin[69]. Pauvre Géricault, je penserai bien souvent à toi ! Je me figure que ton âme viendra quelquefois voltiger autour de mon travail… Adieu, pauvre jeune homme !
— D’après ce que m’a dit Soulier, il paraît que Gros a parlé de moi à Dufresne d’une manière tout avantageuse.
Mardi matin 2 février. — Je me lève à sept heures environ, chose que je devrais faire plus souvent. Les ignorants et le vulgaire sont bien heureux. Tout est pour eux carrément arrangé dans la nature. Ils comprennent tout ce qui est, par la raison que cela est.
Et, au fait, ne sont-ils pas plus raisonnables que tous les rêveurs, qui vont si loin qu’ils doutent de leur pensée même ?… Leur ami meurt-il ? Comme il leur semble qu’ils comprennent la mort, ils ne joignent pas à la douleur de le pleurer cette anxiété cruelle de ne pouvoir se figurer un événement aussi naturel… Il vivait, il ne vit plus ; il me parlait, son esprit entendait le mien ; rien de tout cela n’est là. Mais ce tombeau… Repose-t-il dans ce tombeau aussi froid que la tombe elle-même ? Son âme vient-elle errer autour de son monument ? Et, quand je pense à lui, est-ce elle encore qui vient secouer ma mémoire ? L’habitude remet chacun au niveau du vulgaire. Quand la trace est affaiblie, il est mort, eh bien ! la chose ne nous tracasse plus. Les savants et les raisonneurs paraissent bien moins avancés que le vulgaire, puisque ce qui leur servirait à prouver n’est pas même prouvé pour eux. Je suis un homme. Qu’est-ce que : Je ? qu’est-ce qu’un homme ? Ils passent la moitié de leur vie à attacher pièce à pièce, à contrôler tout ce qui est trouvé ; l’autre à poser les fondements d’un édifice qui ne sort jamais de terre.
Mardi 17 février. — Aujourd’hui dîner chez Tautin avec Fielding et Soulier. Je fais des progrès dans l’anglais.
— Fait aujourd’hui la draperie de la femme de coin ; hier, retouché elle. Fait aussi main et pied de la femme à genou.
| Donné à Marie Auras, après la mort de Géricault | 7 ou 8 fr. |
| À la mendiante qui m’avait posé pour l’étude dans le cimetière | 7 |
| À Émilie Robert, hier lundi, dimanche et samedi 14, 15 et 16 février. | 12 |
— J’ai dîné chez Leblond. Quinze personnes à table : dîner d’apparat.
Le soir, été chez ma tante un peu : bonne petite conversation. Dimanche prochain, je vais y dîner. J’avais été, deux ou trois jours avant, dîner avec Henry. Je me rappelle : c’était le 13 février, il n’avait pas de bureau. Je faisais le jeune homme du coin d’après la mendiante. Quelque temps avant, nous avions dîné ensemble chez Tautin. Je l’aime toujours beaucoup.
Minuit passé ! couchons-nous.
Vendredi 20 février. — Toutes les fois que je revois les gravures du Faust[70], je me sens saisi de l’envie de faire une toute nouvelle peinture, qui consisterait à calquer pour ainsi dire la nature ; on rendrait intéressantes par l’extrême variété des raccourcis, les poses les plus simples ; on pourrait, ainsi, pour de petits tableaux, dessiner le sujet et l’ébaucher vaguement sur la toile, puis copier la pose juste du modèle. Il faut chercher cela dans ce qui me reste à faire de mon tableau.
Aujourd’hui, je me suis mis à ébaucher ce qui me reste à couvrir.
| J’ai donné à Mélie | 3 fr. |
Dimanche 22 février. — Dîné chez Riesener avec Henri Hugues, qui est venu me prendre à l’atelier.
— Ébauché, avec Soulier, le fond. Mardi 24 février. — Fait d’après Bergini un croquis pour l’homme à cheval et refait l’homme couché. Ivresse de travail.
— Le Salon retardé.
| Aujourd’hui, à Bergini | 5 fr. |
Vendredi 27 février. — Ce qui me fait plaisir, c’est que j’acquiers de la raison, sans perdre l’émotion excitée par le beau. Je désire bien ne pas me faire illusion, mais il me semble que je travaille plus tranquillement qu’autrefois, et j’ai le même amour pour mon travail. Une chose m’afflige, je ne sais à quoi l’attribuer ; j’ai besoin de distractions, telles que réunions entre amis[71], etc. Quant aux séductions qui dérangent la plupart des hommes, je n’en ai jamais été bien inquiété, et aujourd’hui moins que jamais. Qui le croirait ? Ce qu’il y a de plus réel en moi, ce sont ces illusions que je crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant.
Ma santé est mauvaise, capricieuse comme mon imagination.
— Hier et aujourd’hui, fait les jambes du jeune homme du coin. Quelles grâces ne dois-je pas au ciel, de ne faire aucun de ces métiers de charlatan, qui en imposent au genre humain !… Au moins je peux en rire.
Jeudi 28 février. — Fait la tête du jeune homme du coin.
| À Nassau | 11 fr. 50 |
| À Prévost | 1 50 |
— Je pensais au bonheur qu’a eu Gros d’être chargé de travaux si propres à la nature de son talent…
J’ai ce soir le désir de faire des compositions sur
le Gœtz de Berlichingen de Goethe[72], sur ce que
m’en a dit Pierret.
Dimanche gras, 29 février. — Pait l’autre jeune homme du coin, d’après le petit Nassau, et à lui donné 3 fr.
— Dîné chez la mère de Pierret.
— Henri Scheffer venu chez moi. Il m’a parlé de Dufresne comme d’un homme très distingué ; je l’ai jugé de même, je désire qu’il soit mon ami.
Lundi 1er mars. — Je n’ai point travaillé de la journée.
— J’ai dîné chez Mme. Guillemardet.
Vu Cicéri[73], Riesener, Leblond, Piron.
— Passé une triste soirée seul au café. Rentré à dix heures. Relu mes vieilles lettres.
Écrit à Philarète la lettre suivante :
« Je m’attends à te voir d’une surprise extrême : Lui ! m’écrire, un peintre : che improvisa novella !… et devine ce qui me fait t’écrire : c’est peut-être ce que tu cherches bien loin, tandis que le plus simple à imaginer ne te sera pas venu.
Je vous écris, mon ancien ami, par ce besoin que nous comprenions mieux autrefois. Mais nous sommes avancés l’un et l’autre dans cette carrière qui se défile à mesure sous nos pas. Certains sentiments deviennent ridicules. Les objets ou dédains philosophiques de nos naïves imaginations de seize à vingt ans deviennent par contre des objets très sérieux de notre culte. J’ai passé une soirée à relire toutes mes vieilles lettres, car je suis plus conservateur qu’un Sénat, qui n’a rien conservé que ses plâtres. Tandis que vous étiez au bal de l’Opéra, au moins j’ose le penser, je suis à deux heures de la nuit enfoui dans des souvenirs doux et affligeants. Vous étiez à cette époque dégoûté de la vie et des vanités prétendues de la vie ; aujourd’hui, je prends de cette maladie de ce temps-là, et vous pourriez bien avoir pris de mon insouciance philosophique d’alors. Mais qu’en fais-je et S*** ? Mon cœur a saigné tout à l’heure au souvenir de tout ce que cet homme m’a inspiré. Cette vie d’homme qui est si courte pour les plus frivoles entreprises est pour les amitiés humaines une épreuve difficile et de longue haleine. Dans la carrière que vous suivez, vous ne devez pas trouver beaucoup d’amis et surtout d’amis pour la vie comme nous l’étions avec Sousse, avant qu’en effet la vie eût été retournée pour chacun de nous… Si tu en trouves, tant mieux, tu es plus heureux que moi.
Malgré quelques attiédissements passagers, je crois qu’il faut de loin en loin, pour quelques figures passagères, se conserver les anciens. Profitons-en surtout pendant que l’amitié peut encore entre nous être désintéressée. Si tu étais ministre, je ne t’aurais pas écrit ce soir. J’aurais relu tes lettres, rentré mon émotion, et j’aurais dit : « C’est un homme mort, n’y pensons plus. » Je ne dis pas non plus que je l’aurais écrite à mon vieux camarade resté en arrière, si c’était moi qui eus été ministre ou le parvenu. Le cœur humain est une vilaine porcherie ; ce n’est pas ma faute, mais qui ose répondre de soi ? Écris-moi, fais reprendre à mon cœur la route de certaines émotions de la jeunesse, qui ne revient plus ; quand ce ne serait qu’une illusion, ce serait encore un plaisir. Adieu, etc. »
— J’ai relu aussi des lettres d’Élisabeth Salter…
Étrange effet, après tant de temps !
— Retrouvé dans une lettre de Philarète ce sujet de la mort de R…, âgé de quatre-vingt-cinq ans. Après avoir défendu avec beaucoup de véhémence, dans le barreau de Thèbes, la cause d’un ami accusé d’un crime capital, il expira la tête appuyée sur les genoux de sa fille.
Mercredi 3 mars. — Ce matin, au Luxembourg. Je me suis étonné de l’incorrection de Girodet, particulièrement dans son jeune homme du Déluge. Cet homme, au pied de la lettre, ne sait pas le dessin.
— Été chez Émilie Robert ; mal disposé. Malade de l’estomac.
— Composé, ne sachant que faire, les Condamnés à Venise. — Émilie est venue un instant.
— Remets-toi vigoureusement à ton tableau. Pense au Dante, relis-le continuellement ; secoue-toi pour revenir aux grandes idées. Quel fruit tirerai-je de cette presque solitude, si je n’ai que des idées vulgaires ?
— Hier, couru et été chez D*** ; exécrable peinture.
— Repris l’envie de faire les Naufragés, de lord Byron, mais de les faire au bord de la mer même, sur les lieux.
— Été le soir chez Henri Scheffer[74].
— Aujourd’hui mercredi soir, je rentre de chez Leblond. Bonne soirée ; il avait fait un extraordinaire : Punch, etc… Quelque musique qui m’a fait plaisir… Dufresne est un homme qui dessèche bien quelque peu.
— Je suis donc comme un sabot ? Je ne suis remué qu’à coups de fourche ; je m’endors sitôt que manquent ces stimulants.
Jeudi 4 mars. — Aujourd’hui, été voir Champion. Déjeuné avec lui.
— Fedel est venu me voir à l’atelier. Dîné ensemble. Le soir à Moïse, et seul : j’y ai trouvé des jouissances. Admirable musique ! Il faut y aller seul pour en jouir[75]. La musique est la volupté de l’imagination ; toutes leurs tragédies sont trop positives.
— Médée m’occupe. — Aussi quelque sujet de Moïse, par exemple, les Ténèbres.
Vendredi 5 mars. — Fait la tête et le torse de la jeune fille attachée au cheval. — Dîné avec Soulier et Fielding et été, à l’Ambigu voir les Aventuriers ; beaucoup d’intérêt et manière neuve. Naturel[76].
— L’impression de Moïse reste encore, et j’ai le désir de le revoir.
Samedi 6 mars. — J’ai passé la journée à mon atelier. — Mauvaise besogne. — Dîné avec Fielding et Soulier chez Tautin.
— Pensé à faire des compositions sur Jane Shore et le théâtre d’Otway[77].
— Rencontré, chez Tautin, Fedel et autres camarades qui s’en allaient. Convenu que nous irions quelquefois ensemble faire quelques sujets de l’Inquisition.
— Philippe II.
Dimanche 7 mars. — Vu Mage un instant pour le portrait de la Pasta. Ce n’est pas ça.
— Fielding et Soulier à mon atelier. Fielding m’a arrangé mon fond.
— Leblond a passé avec sa maîtresse, et le soir chez Pierret. Excellent thé et calembours toute la soirée.
Lundi 9 mars. — À mon atelier. — Émilie. — Dîné avec Fielding. — Scheffer aîné[78] est venu me voir. — Le soir chez Henri Hugues. Fumé avec lui.
| À Émilie Robert | 13 fr. 50 |
Samedi 13. — Aujourd’hui fait le Turc à cheval. — Hier et avant, draperie de la femme.
| À Bergini | 5 fr. |
— Dîné avec Soulier et Fielding, Le soir au petit café. Reçu le soir une lettre de Philarète.
— Travaillé avec chaleur. Je me couche tard.
Dimanche 14 mars. — Aujourd’hui chez ma sœur.
— Le Sermon anglais.
— Dîné chez M. Guillemardet. Le soir chez Pierret. M. Goutan ma donné envie de faire Mazeppa.
— Faire pour frontispice au Dante, lui se promenant
dans le Colisée au clair de lune.
Lundi 15 mars. — Déjeuné avec Pierret et auparavant été voir le charmant livre anglais d’histoire naturelle. — Chez Scheffer. — Aux Champs-Élysées. Bonne promenade. — Rouget à dîner. Pierret le soir. — Fait le trait d’un Turc montant à cheval[79]. — Superbe temps de printemps.
Mardi 16. — Pauvre frère ! je reçois à l’instant ta lettre. Que je désire être utile à tes intérêts ! Quel sera ton sort, si tout te manque ainsi !
— Dîné avec Soulier et Fielding chez Tautin. And after to english Brewery and drinck Gin and Water.
— Vu Scheffer et le sauteur de son manège.
Mercredi 17. — Perdu la matinée en allées et venues relatives à la lettre de mon frère. — Travaillé à l’atelier à la petite esquisse, depuis midi jusqu’à deux heures et demie. — Avant, chez Lopez. — À la préfecture, en sortant de chez Lopez ; de là chez M. Jacob[80]. Puis, chez Fielding. — Dîné chez Rouget. — Rencontré Henri Scheffer au Palais-Royal. Chez Leblond. J’ai fait un cheval blanc à l’écurie[81].
— Bonne conversation avec Dufresne et Pierret, sur la médecine particulièrement ; puis, plus générale, sur les lois, etc. — Sorti avec tous et enfin Pierret, que j’ai laissé à sa porte. Je suis rentré plein d’un bonheur philosophique bien innocent.
— Le matin chez Mme J… Probablement manqué l’occasion. Il semble qu’aussitôt qu’elle se présente, elle me fasse peur, — l’occasion s’entend… Toujours réfléchir à tout, sottise extrême !
— Penser, en faisant mon Mazeppa, à ce que je dis dans ma note du 20 février, dans ce cahier, c’est-à-dire calquer en quelque sorte la nature dans le genre de Faust.
Jeudi 18 mars. — Rencontré Mage sur le boulevard. — Été chez Gihaut[82] et rencontré M. Coutan. Choisi des Géricault. — À la caisse de la préfecture, puis aux Champs-Élysées. — Recherché mes lithographies.
— Achevé le Turc montant à cheval.
Vendredi 19 mars. — Passé une excellente journée au Musée avec Édouard… Les Poussin !… Les Rubens !… et surtout le François Ier du Titien !… Velasquez !
Après, vu le Goya, à mon atelier, avec Édouard. Puis vu Piron. Rencontré Fedel. Dîné ensemble.
Bonne journée.
Samedi 20 mars. — À mon atelier assez tard. Retravaillé la Femme morte, — Henry, Fielding et Soulier.
— Dîné à la barrière au bord de l’eau. Puis à la Brewery.
Dimanche 21 mars. — Fait une étude au manège avec Scheffer[83]. — Le soir, la cousine chez Pierret. Petite soirée.
Lundi 22 mars. — Aujourd’hui, atelier. Commencé le cheval, — mal disposé. — Le soir chez Pierret.
Mardi 23 mars. — Perdu la journée ; excepté chez Leblond vers midi. — Dîné avec Pierret, où passé la soirée. Menjaud[84] y était. Bonnes idées sur la médecine.
— Commencé une Jane Shore[85].
Mercredi 24 mars. — Déjeuné le matin chez la
cousine. — Composé à l’atelier. — Le soir, Leblond.
Jeudi 25 mars. — Été avec Leblond voir des tableaux : surtout tête de femme ; la Marquise de Pescara du Titien[86] et un Velasquez admirable, qui occupe tout mon esprit.
— Été à Saint-Cloud avec Fielding et Soulier, et dîner. — Le soir chez Pierret, punch.
Vendredi 26 mars. — Rencontré Édouard chez Lopez et déjeuné ensemble dans le quartier de son atelier. — Passé la journée à son atelier. — Dîné chez Rouget et le soir chez M. Lelièvre, Taurel et Lamey[87].
Samedi 27 mars. — De bonne heure à l’atelier. Pierret venu. — Dîné chez lui ; lu de l’Horace[88].
— Envies de poésie, non pas à propos d’Horace. — Allégories. — Rêveries. Singulière situation de l’homme ! Sujet, intarissable. Produire, produire !
Dimanche 28 mars. — Chez Scheffer. — Au manège. Peint le cheval gris. — Le soir chez Pierret.
Lundi 29 mars. — Henri Scheffer est venu me prendre chez moi, le matin. Déjeuné avec lui, à son atelier.
De là été prendre Pierret au ministère, et été au Diorama[89]. J’ai dîné chez lui et passé la soirée. Sommeil et lourdeur.
Mardi 30 mars. — À mon atelier, le matin.
Mon poêle à arranger m’a fait faire une promenade au Musée : admiré Poussin, puis Paul Véronèse, avec une escabelle.
— Essayé de repeindre la tête du mourant.
— Le soir chez Pierret. Bonne soirée à causer de bonnes choses.
Mercredi 31 mars. — Chez Leblond. — Revenu le soir avec Dufresne : il m’a donné une nouvelle ardeur. Parlé de Véronèse : il peint aussi la passion.
— Il faut dîner peu et travailler le soir seul[90]. Je crois que le grand monde à voir de temps à autre, ou le monde tout simplement, est moins à redouter pour le progrès et le travail de l’esprit, quoi qu’en disent beaucoup de prétendus artistes, que leur fréquentation à eux. Le vulgaire naît à chaque instant de leur conversation ; il faut en revenir à la solitude, mais vivre sobrement comme Platon. Le moyen que l’enthousiasme se conserve sur une chose quand, à chaque instant, on est accessible à une partie ? quand on a toujours besoin de la société des autres ? Dufresne a bien raison : les choses qu’on éprouve seul avec soi sont bien plus fortes et vierges. Quel que soit le plaisir de communiquer son émotion à un ami, il y a trop de nuances à s’expliquer, bien que chacun peut-être les sente, mais à sa manière, ce qui affaiblit l’impression de chacun. Puisqu’il me conseille et que je reconnais la nécessité de voir l’atelier seul et de vivre seul, quand j’y serai établi, commençons dès maintenant à en prendre l’habitude : toutes les réformes heureuses naîtront de là. La mémoire reviendra et l’esprit présent fera place à celui d’ordre.
— Dufresne disait, à propos de Charlet, que ce
n’était pas assez naïf de manière de faire : on voit
l’adresse et le procédé. Y penser[91].
Jeudi 1er avril. — Été le matin avec Champmartin chez Cogniet, où j’ai déjeuné.
J’ai vu le masque moulé de mon pauvre Géricault. Ô monument vénérable ! J’ai été tenté de le baiser… sa barbe… ses cils… Et son sublime Radeau ! Quelles mains ! Quelles têtes ! Je ne puis exprimer l’admiration qu’il m’inspire.
— Vu Fedel chez lui. — Retrouvé Fedel, comme je me disposais à aller voir l’Italiana in Alaeri[92]. Endormi toute la soirée.
— Peindre avec brosses courtes et petites. Craindre le lavage à l’huile.
— Il me survient le désir de faire une esquisse du tableau de Géricault. Dépêchons-nous de faire le mien. Quel sublime modèle ! et quel précieux souvenir de cet homme extraordinaire !
Vendredi 2 avril. — À l’atelier toute la journée. Arrêté en partie mon fond.
M. Coutan est venu me voir. Il m’a donné envie de voir les dessins de Demeulemeester[93]. — Dîné chez Rouget. Vu François et Henri Verninac, etc. — Chez Pierret le soir. — Je lis à présent.
Samedi 3 avril. — Été avec Decamps chez le duc d’Orléans[94], voir sa galerie. Enchanté de la femme du brigand de Schnetz[95]. Rencontré Steuben[96].
Envie de faire de petits tableaux, surtout pour acheter quelque chose à la vente de Géricault.
— Le soir, Jane Shore.
Dimanche 4 avril. — Tout est intéressé pour moi, dans la nécessité de me renfermer davantage dans la solitude. Les plus beaux et les plus précieux instants de ma vie s’écoulent dans des distractions qui ne m’apportent au fond que de l’ennui. La possibilité ou l’attente d’être distrait commencent déjà à énerver le peu de force que me laisse le temps mal employé de la veille. La mémoire n’ayant à s’exercer sur rien d’important périt ou languit. J’amuse mon activité avec des projets inutiles. Mille pensées précieuses avortent faute de suite. Ils me dévorent, ils me mettent au pillage. L’ennemi est dans la place… au cœur ; il étend partout la main.
Pense au bien que tu vas trouver, au lieu du vide qui te met incessamment hors de toi-même : une satisfaction intérieure et une mémoire ferme ; le sang-froid que donne la vie réglée ; une santé qui ne sera pas délabrée par les concessions sans fin à l’excès passager que la compagnie des autres entraîne ; des travaux suivis et beaucoup de besogne.
— J’ai été à mon atelier. Henry Scheffer venu et commencé son portrait.
Dîné ensemble. Cela ne fait rien en passant et de la sorte… C’était, l’année dernière, l’habitude de ces dîners à jours fixes et attendus, qui étaient funestes !
— Le soir chez Mme Guillemardet, où j’ai appris
la nouvelle infortune de ma sœur. Quand sera-t-elle
tranquille ?
— Se procurer la Panhypocrisiade[97]. On pourrait en faire des dessins. — Une suite aussi sur René, sur Melmoth[98].
Lundi 5 avril. — Le matin, vu Fielding, en allant chez ma sœur.
— Rencontré Dufresne et chez Gihaut. — À l’atelier. Travaillé peu. — Rouget. — Le soir chez Pierret.
Mardi 6 avril. — Déjeuné chez Soulier et Fielding. — À l’atelier de Henry Scheffer. Commencé chez moi le petit Don Quichotte[99]. — Dîné avec Dupont et été chez Devéria[100].
— Tâcher de retrouver la naïveté du petit portrait
de mon neveu.
Mercredi 7. — Encore un mercredi… Je n’avance guère… Le temps beaucoup.
Travaillé au petit Don Quichotte. — Le soir, Leblond, et essayé de la lithographie[101]. Projets superbes à ce sujet. Charges dans le genre de Goya.
— La première et la plus importante chose en peinture, ce sont les contours. Le reste serait-il extrêmement négligé que, s’ils y sont, la peinture est ferme et terminée. J’ai plus qu’un autre besoin de m’observer à ce sujet : y songer continuellement et commencer toujours par là.
Le Raphaël doit à cela son fini, et souvent aussi Géricault.
— Je viens de relire en courant tout ce qui précède : je déplore les lacunes. Il me semble que je suis encore le maître des jours que j’ai inscrits, quoiqu’ils soient passés ; mais ceux que ce papier ne mentionne point sont comme s’ils n’avaient point été[102].
Dans quelles ténèbres suis-je plongé ? Faut-il qu’un misérable et fragile papier se trouve être, par ma faiblesse humaine, le seul monument d’existence qui me reste ? L’avenir est tout noir. Le passé qui n’est point resté, l’est autant. Je me plaignais d’être obligé d’avoir recours à cela ; mais pourquoi toujours m’indigner de ma faiblesse ? Puis-je passer un jour sans dormir et sans manger ? Voilà pour le corps. Mais mon esprit et l’histoire de mon âme, tout cela sera donc anéanti, parce que je ne veux pas en devoir ce qui peut m’en rester à l’obligation de l’écrire ; au contraire, cela devient une bonne chose que l’obligation d’un petit devoir qui revient journellement.
Une seule obligation, périodiquement fixe dans une vie, ordonne tout le reste de la vie : tout vient tourner autour de cela. En conservant l’histoire de ce que j’éprouve, je vis double ; le passé reviendra à moi… L’avenir est toujours là.
— Se mettre à dessiner beaucoup les hommes de mon temps. Beaucoup de médailles, voilà pour le nu.
Les gens de ce temps : du Michel-Ange et du Goya.
— Lire la Panhypocrisiade.
Jeudi 8 avril. — L’argent me pressera bientôt. Il faut travailler ferme. Pioché au Don Quichotte.
— À Tancrède le soir, médiocrement amusé.
— Acheté des gravures allemandes du temps de Louis XIII.
Vendredi 9. — Aujourd’hui Bergini. Refait l’homme
au coin. — Le soir, Pierret… le Leicester.
Il me vient l’envie, au lieu d’un autre tableau d’assez grande proportion, d’avoir plusieurs petits tableaux, mais faits avec plaisir.
— Il me reste environ 240 francs. Pierret me doit 20 francs.
| Aujourd’hui, déjeuné œufs et pain | 0 fr. 30 |
| À Bergini | 3 fr. " |
| Belot, couleurs | 1 fr. 50 |
| Dîner | 1 fr. 20
|
| Total | 6 fr. " |
Samedi 10. — Atelier de bonne heure. Hélène venue avec ses camarades. — Bergini. Retouché l’homme qui s’accroche au cheval ; à lui 3 francs.
Dîné avec Pappleton, Lelièvre, Gomairas, Soulier et Fedel. Été chez Gomairas : étonnante peinture. Petite soûlerie. Ce soir, ma main a peine à écrire…
Parlé philosophie dans la rue avec ce fou de Fedel.
| Dîné, | 2 fr. |
| gr. | 1 fr 16. |
Dimanche 11 avril. — Le matin, Pierret en passant. — Comairas pour tête de cheval[103].
Au Luxembourg : Révoltés du Caire[104], pleins de vigueur : grand style. Ingres charmant[105]… et puis mon tableau qui m’a fait grand plaisir[106]. Il y a un défaut qui se retrouve encore dans celui que je fais[107], spécialement dans la femme attachée au cheval ; cela manque de vigueur et d’empâtement. Ces contours sont lavés et ne sont pas francs ; il faut continuellement avoir cela en vue.
— Travaillé à l’atelier à retoucher la femme à genoux.
— Vu le Velasquez et obtenu de le copier ; j’en suis tout possédé. Voilà ce que j’ai cherché si longtemps, cet empâté ferme et pourtant fondu. Ce qu’il faut principalement se rappeler, ce sont les mains ; il me semble qu’en joignant cette manière de peindre à des contours fermes et bien osés, on pourrait faire des petits tableaux facilement.
Été chez le Turc, au Palais-Royal. Quel misérable Juif, avec son manteau, qu’il ne voulait même pas me laisser regarder ! Quoi qu’il en soit, j’en ai à peu près la coupe.
— Je rentre de bonne heure, en me félicitant de copier mon Velasquez, et plein d’entrain.
Quelle folie de se réserver toujours pour l’avenir de prétendus sujets plus beaux que d’autres !
Quant à mon tableau, il faut laisser ce qui est fait bien, quand cela serait dans une manière que je quitte. Le prochain aura sinon un progrès, au moins une variété.
Mais pour revenir à ma réflexion précédente, avec cette sotte manie, on fait toujours des choses dont on n’est pas entrain, et par conséquent mauvaises ; plus on en fait, plus on en trouve. À chaque instant, il me vient d’excellentes idées, et au lieu de les mettre à exécution, au moment où elles sont revêtues du charme que leur prête l’imagination dans la disposition où elle se trouve dans le moment, on se promet de le faire plus tard, mais quand ? On oublie, ou ce qui est pis, on ne trouve plus aucun intérêt à ce qui vous avait paru propre à inspirer. C’est qu’avec un esprit aussi vagabond et impossible, une fantaisie chasse l’autre plus vite que le vent ne tourne dans l’air et ne tourne la voile dans le sens contraire…, il arrive que j’ai nombre de sujets ; eh bien, qu’en faire ? Ils seront donc là en magasin à attendre froidement leur tour, et jamais l’inspiration du moment ne les animera du souffle de Prométhée ; il faudra les tirer du tiroir, quand la nécessité sera de faire un tableau ! C’est la mort du Génie… Qu’arrive-t-il ce soir ? Je suis, depuis une heure, à balancer entre Mazeppa, Don Juan, le Tasse, et tant d’autres. Je crois que ce qu’il y aurait de mieux à faire quand on veut avoir un sujet, c’est non pas d’avoir recours aux anciens, et de choisir dans le nombre, car quoi de plus bête ? Parmi les sujets que j’ai retenus, parce qu’ils m’ont paru beaux un jour, qui détermine mon choix pour l’un ou pour l’autre, maintenant que je sens même une disposition égale pour tous ? Rien que de pouvoir balancer entre deux suppose une absence d’inspiration. Certes, si je prenais la palette en ce moment, et j’en meurs de besoin, le beau Velasquez me travaillerait. Je voudrais étaler sur une toile brune ou rouge de la bonne grasse couleur et épaisse. Ce qu’il faudrait donc pour trouver un sujet, c’est d’ouvrir un livre capable d’inspirer et se laisser guider par l’humeur. Il y en a qui ne doivent jamais manquer leur effet : ce sont ceux-là qu’il faut avoir, de même que des gravures, Dante, Lamartine, Byron, Michel-Ange.
J’ai vu ce matin chez Drolling[108] un dessin de plusieurs fragments de figures de Michel-Ange, dessinés par Drolling… Dieu ! quel homme ! quelle beauté ! Une chose singulière et qui serait bien belle, ce serait la réunion du style de Michel-Ange et de Velasquez ! Cette idée-là m’est venue de suite, à la vue de ce dessin ; il est doux et moelleux. Les formes ont cette mollesse qu’il semble qu’il n’y ait qu’une peinture empâtée qui puisse la donner, et en même temps les contours sont vigoureux. Les gravures d’après Michel-Ange ne donnent pas l’idée de cela : c’est là le sublime de l’exécution. Ingres a de cela : ses milieux sont doux et peu chargés de détails. Comme cela faciliterait la besogne, surtout pour les petits tableaux ! Je suis content de me rappeler cette impression.
Se bien souvenir de ces têtes de Michel-Ange. Demander à Drolling pour les copier. Les mains bien remarquables ! Les grands enchâssements… Les joues simples, les nez sans détails, et véritablement, c’est là ce que j’ai toujours cherché ! Il y avait de cela dans ce petit portrait de Géricault, qui était chez Bertin, dans ma Salter[109] un peu et dans mon neveu. Je l’aurais atteint plus tôt, si j’avais vu que cela ne pouvait aller qu’avec des contours bien fermes. Cela est évidemment dans la femme debout de ma copie de Giorgione, des femmes nues dans une campagne.
Léonard de Vinci a de cela, Velasquez beaucoup, et c’est très différent de Van Dyck : on y voit trop l’huile, et les contours sont veules et languissants. Giorgione a beaucoup de cela.
Il y a quelque chose d’analogue et bien séduisant dans le fameux dos du tableau de Géricault, dans la tête et la main du jeune homme imberbe et dans un pouce du Gerfaut couché à l’extrémité du radeau.
Se souvenir du bas de la figure qu’il a faite d’après
moi[110]. — Quel bonheur ce serait d’avoir à sa vente
une ou deux copies de lui d’après les maîtres ! Son
tableau de famille d’après Velasquez.
Lundi 12 avril. — Le matin passé chez Soulier. Il n’y était pas. Je voulais avoir sa boîte pour aller copier le Velasquez.
Été chez Champion ; de là à mon atelier. Fièvre de travail. Refait et disposé l’homme près du cheval et l’homme à cheval. Entrain complet. H. Scheffer venu un instant, puis mon neveu.
— Il m’a pris fantaisie de faire des lithographies d’animaux, par exemple : un tigre sur un cadavre, des vautours, etc.
— Dîné chez M. Guillemardet. Mme C… venue le soir est charmante. Maudit insolent que je suis ! Il faut avouer que ma vie est passablement remplie ; je suis toujours possédé d’une petite fièvre qui me dispose facilement à une émotion vive. Elle m’a bien plu : ce chapeau noir et ces petites plumes. Elle a l’air bienveillant avec moi… Il faut que je pense à lui envoyer le marchand d’ombrelles, demain autant que possible.
— Le Temps luttant contre le Chaos sur le bord de l’abîme, au jour de la fin de toutes choses.
— Il faut faire une grande esquisse de Botzaris[111] :
les Turcs épouvantés et surpris se précipitent les uns
sur les autres.
Mardi 13 avril. — Le matin chez Soulier. Pris sa boîte. Déjeuné avec lui ; puis au Velasquez.
Disposition mélancolique ou plutôt chagrine en rentrant à mon atelier. Travaillé le Don Quichotte.
Pierret venu, dîné avec lui ; mené ses femmes chez M. Pastor, chez Leblond. — Terminé la lithographie. Dufresne venu. Rentré avec Pierret.
— Dispositions fugitives, qui me venez presque toujours le soir. Doux contentement philosophique, que ne puis-je te brider ! Je ne me plains pas de mon sort. Il me faut goûter plus encore de ce bon sens qui se risque aux choses inévitables.
Ne réservons rien de ce que je pourrais faire avec plaisir pour un temps plus opportun. Ce que j’aurai fait ne pourra m’être enlevé. Et quant à la crainte ridicule de faire des choses au-dessous de ce qu’on peut faire… Non, voilà le vice radical ! c’est là le recoin de sottise qu’il faut attaquer. Vain mortel, tu n’es borné par rien, ni par ta mémoire qui t’échappe, ni par les forces de ton corps qui sont minces, ni par la fluidité de ton esprit qui lutte contre ces impressions, à mesure qu’elles t’arrivent. Il y a toujours au fond de ton âme quelque chose qui te dit : « Mortel tiré pour peu de temps de la vie éternelle, songe que tes instants sont précieux. Il faut que ta vie te rapporte à toi seul tout ce que les autres mortels retirent de la leur[112]. » Au reste, je sais ce que je veux dire… Je crois qu’au fait tout le monde a été plus ou moins tourmenté de cela.
— Dimier venu chez Leblond : il va partir pour l’Égypte.
| Couleurs et toiles | 11 |
| Portier atelier | 10 |
| Commissionnaire | 1 |
— Dufresne m’a promis la Panhypocrisiade et des vers de M. de Lamartine.
Mardi 13 avril. — Ce matin, Velasquez. — Interrompu. — Chez mon oncle. Dîné avec lui.
Pierret le soir. Il prend la résolution de se faire peintre de portraits : il a raison. À compter du mois prochain, il viendra tous les matins à mon atelier.
| Déjeuné | 1 fr. 4 sous |
| Couleurs | 2 fr. 10 sous |
| Marrons | " fr. 15 sous
|
| 4 fr. 9 sous |
14 avril. — Ce matin au Velasquez. Recommencé
la tête, qui était trop forte pour le corps.
Interrompu pour aller déjeuner ; j’ai bien fait. J’ai
travaillé ensuite jusqu’à quatre heures et demie.
Leblond y est venu.
Dîné Rouget. — Retourné chez moi m’habiller pour aller à l’Opéra. — Passé chez Pierret, qui me fait dîner demain. — Trop de foule à ce concert et passé la soirée chez Mme Lelièvre. Tours de cartes, etc.
| Déjeuné | 13 sous. |
| Hier dîné | 1 fr. |
| Papier | 6 sols.
|
| Pour ceci | 1 fr. 19 sols. |
Jeudi 15 avril. — Le matin, été chercher la robe turque chez M. Job, ce qui m’a fait arriver trop tard au rendez-vous d’Hélène et de Laure.
Avancé beaucoup le petit Don Quichotte, et commencé à peindre la pénitence de Jane Skore.
— Revenu chez moi. Composé la Jane Shore pour la lithographier. — Dîné Cook et remonté chez moi. — Là, le diable au corps et quelque peu dormi.
— À onze heures (matin) passé chez Ludovic. Dufresne y était. J’y ai vu pour la première fois Leborne[113].
Adeline était charmante. — Rentré à trois heures et demie.
| Déjeuné | 1 " |
| Couleurs à la palette | 1 60 |
| Dîner | 1 20 |
| Décrotté | 0 20
|
| 4 " |
— Mon cadre ne me coûterait que 160 ou 180 au lieu de 230 que demande Lemarchal.
Samedi 17 avril. — Le matin à l’atelier. Hélène et Laure venues. — Ensuite travaillé au Don Quichotte ; puis à la Jane Shore. Fielding venu un instant ; puis Decaisne[114]. — Dîné avec Pierret et resté chez lui, où commencé un dessin de Charles IX.
| Déjeuné | 1 70 |
Dimanche 18 avril. — À l’atelier à neuf heures. Laure venue. Avancé le portrait.
— M. Lemôle venu et acheté le Turc qui monte à cheval. — Pierret venu. Tour aux Champs-Élysées. — Trouvé chez lui Félix. — Dîné chez Pierret, et passé la soirée à continuer le Charles IX.
— Vu avec bien du plaisir les calques des petits dessins de Géricault[115].
|
|
Lundi 19. — Velasquez. Interrompu vers onze heures. — À l’atelier est venu le W… Ensuite chez Fielding et dîné chez Rouget. — Retourné chez lui et puis au café de la rue Bourbon. — Rentré à dix heures un quart.
| Déjeuné | 1 40 |
| Cocher | 2 60 |
| Dîner | 1 10 |
| Bière | 0 30
|
| 5 40 |
— Désir de faire des sujets de la Révolution, tels que l’Arrivée de Bonaparte à l’armée d’Égypte, les Adieux de Fontainebleau.
Mardi 20 avril. — Je sors de chez Leblond. Il a été bien question d’Égypte : on peut y aller pour bien peu de chose. Dieu veuille que j’y aille ! Pensons bien à cela, et si mon cher Pierret y venait avec moi ? C’est l’homme qu’il me faudrait ; en attendant, travaillons à nous séparer des liens qui entravent l’esprit et débilitent la santé. Se lever matin.
Penser à l’Arabe. J’irai ces jours-ci chez D… lui demander des renseignements sur ses études.
— Qu’est-ce aller en Égypte ? chacun saute aux nues. Et si ce n’est pas plus que d’aller à Londres ? Pour trois cents francs, Deloches[116] et Planat[117] y sont passés. On y vit à meilleur marché qu’ici… Il faudrait partir en mars et revenir en septembre ; on aurait le temps de voir la Syrie.
Est-ce vivre que végéter comme un champignon attaché à un tronc pourri[118] ? Les habitudes mesquines m’absorbent tout entier. D’ailleurs, c’est d’avance qu’il faut se préparer.
Tant que j’aurai mes jambes, j’espère vivre matériellement. Plaise au ciel que le Salon me mette en passe de faire bientôt mes tournées ! Scheffer doit me faire connaître une affaire. Il a passé une partie du jour à mon atelier.
— J’ai presque fini le Don Quichotte et beaucoup avancé la Jane Shore.
La fille est venue ce matin poser. Hélène a dormi ou fait semblant. Je ne sais pourquoi je me crus bêtement obligé de faire mine d’adorateur pendant ce temps, mais la nature n’y était point. Je me suis rejeté sur un mal de tête, au moment de son départ et quand il n’était plus temps… Le vent avait changé. Scheffer m’a consolé le soir, et il s’est trouvé absolument dans les mêmes intentions.
Je me fais des peurs de tout, et crois toujours qu’un inconvénient va être éternel. Moi qui parle, je passerai aussi… Cela aussi est une consolation.
— Ma lithographie de chez Leblond n’est pas mal venue.
— Félix est venu un moment à mon atelier et Henri chez Leblond. Il y a eu trios d’instruments à vent, mais Batton[119] m’a fait plus de plaisir avec ses folies sur le piano. — Édouard est enchanté du Velasquez ; il dit que c’est le plus beau qu’il ait vu.
— Ce bon Pierret m’enchante d’être aussi possédé que moi de tous les projets qui m’ont pris ce soir ; il est aussi ivre que moi.
| Dîné et Scheffer | 2 35 |
| Café | 0 80
|
| 3 20 |
Mercredi 21. — De bonne heure au Velasquez : je n’ai pu y travailler. — Été voir Cogniet. Fait une mauvaise esquisse d’après nature pour lui.
— Faire un dessin d’après Géricault. Il faut étudier des contours comme faisait Fedel à l’atelier. Je pourrai en faire quelques-uns à l’Académie. — Cogniet m’a conseillé d’aller voir Joseph de Méhul. — Ce soir chez Pierret. Enchanté, ainsi que moi, du croquis d’après Géricault.
| Déjeuner et dîner | 2 " |
| Couleurs Belot | 1 " |
| Maréchal | 1 " |
| Gravure, Massacre des Innocents de Raphaël | 0 50
|
| 4 50 |
— Le matin chez Scheffer, pour voir son échelle ; revenu avec Henry, et perdu ma matinée chez lui. Rentré chez moi vers deux heures et trouvé une lettre de mon frère pour Munich, que j’ai jetée de suite à la poste.
Dîné avec Henri Hugues. Rencontré le soir Henri Scheffer et au café avec lui, mais sans doute par complaisance, car je m’endormais. Il m’a dit qu’aujourd’hui Didot étant chez son père, et lui parlant du projet où j’étais de prendre des rapins, Didot disait que je ferai le premier de mes rapins.
Je suis d’une mélancolie extrême.
| Déjeuné | 1 40 |
| Le soir, café | 0 75
|
| 2 15 |
Vendredi 23. — À l’atelier, travaillé et fini le petit Don Quichotte. — Dîné Henry, Fiedling, sorti à la barrière de Sèvres. Revenu chez eux le soir.
Samedi 24. — Le matin, travaillé à la lithographie pour Gihaut ; puis déjeuné. — Chez Champmartin. Trouvé Marochetti[120] et fait connaissance.
— Dîné chez Tautin, après une course vaine au Champ de Mars, pour voir l’exercice à feu. — Brewery. — Tiré au pistolet, assez bien, aux Champs-Élysées. — Punch chez Lemblin. Billard au coin, après déjeuner. — Chez Allier[121] : très charmé de sa nouvelle figure. Son Marin m’a fait le plus grand plaisir. Une chose qui m’a frappé, et que Champmartin rappelait ce soir, c’était que c’était comme la peinture de Géricault ; ce qui paraît contribuer à m’en faire voir le faible aussi bien que le beau côté. J’ai comparé les émotions que fait naître ce genre de style avec celui de Michel-Ange, dans les jambes et cuisses chez Allier.
Y penser pour ne faire ni l’un ni l’autre ; mais le bien est entre les deux.
| Déjeuné | 1 " |
| Dîné | 1 20 |
| Punch | 0 60 |
| Pistolet | 1 " |
| Billard | 1 "
|
| 4 80 |
C’est trop pour une journée de sottises.
— Le souvenir du petit groupe en pierre de Géricault m’enchante ; il serait amusant d’en faire, mais il faudrait être un travailleur forcené. Comment trouver le temps de tout faire ?
Dimanche 25. — À l’atelier, vers onze heures. — Chez Pierret d’abord, puis chez Soulier. Pierret venu nie joindre.
— Travaillé au Turc du second plan, qui s’aperçoit de l’incendie. — Félix un instant.
— Dîné avec Pierret. Été ensuite chez M. Lelièvre. Point trouvé. — Chez M. Guillemardet. Louis me paraît fort mal. J’ai éprouvé une impression bien douloureuse en le voyant et j’y mêlais aussi ce sentiment solennel et funestement poétique de la faiblesse humaine, source intarissable des émotions les plus fortes.
Pourquoi ne suis-je pas poète ? Mais, du moins, que j’éprouve, autant que possible dans chacune de mes peintures, ce que je veux faire passer dans l’âme des autres !… L’allégorie est un beau champ !
Le Destin aveugle entraînant tous les suppliants qui veulent en vain, par leurs cris et leurs prières, arrêter un bras inflexible.
Je crois et j’ai pensé ailleurs que ce serait une excellente chose que de s’échauffer à faire des vers, rimés ou non, sur un sujet pour s’aider à y entrer avec feu pour le peindre. À force de s’accoutumer à rendre toutes mes idées en vers, je les ferais facilement à ma façon. Il faut essayer d’en faire sur Scio.
Lundi 26 avril. — Le résultat de mes journées est toujours le même : un désir infini de ce qu’on n’obtient jamais, un vide qu’on ne peut combler, une extrême démangeaison de produire de toutes les manières, de lutter le plus possible contre le temps qui nous entraîne, et les distractions qui jettent un voile sur notre âme ; presque toujours aussi une sorte de calme philosophique, qui prépare à la souffrance et élève au-dessus des bagatelles. Mais c’est l’imagination qui peut-être nous abuse encore là ; au moindre accident, adieu presque toujours la philosophie ! Je voudrais identifier mon âme avec celle d’un autre.
— M. L…, chez Perpignan, parlait du roman de Saint-Léon de Godwin[122] ; il a trouvé le secret de faire de l’or et de prolonger sa vie au moyen d’un élixir. Toutes ses misères deviennent la suite de ses fatals secrets, et cependant au milieu de ses douleurs, il éprouve un secret plaisir de ces facultés étranges, qui l’isolent dans la nature. Hélas ! je n’ai pu trouver les secrets, et je suis réduit à déplorer en moi ce qui faisait la seule consolation de cet homme. La nature a mis une barrière entre mon âme et celle de mon ami le plus intime[123] : il éprouve la même chose. Encore, si je pouvais favoriser à loisir ces impressions que seul j’éprouve à ma manière ! Mais la loi de la variété se fait un jeu de cette dernière consolation. Ce ne sont pas des années qu’il faut pour détruire les innocentes jouissances que chaque incident fait éclore dans une vive imagination. Chaque instant qui s’écoule ou les emporte ou les dénature. Au moment où j’écris, j’ai commencé de sentir vingt choses que je ne reconnais plus quand elles sont exprimées. Ma pensée m’échappe. La paresse de mon esprit ou plutôt sa faiblesse me trahit plutôt que la lenteur de ma plume ou que l’insuffisance de la langue ; c’est un supplice de sentir et d’imaginer beaucoup, tandis que la mémoire laisse évaporer au fur et à mesure.
Que je voudrais être poète ! tout me serait inspiration. Chercher à lutter contre ma mémoire rebelle, ne serait-ce pas un moyen de faire de la poésie ? Car, qu’est-ce que ma position ? J’imagine. Il n’y a donc que paresse à fouiller et ressaisir l’idée qui m’échappe.
— Je me suis levé matin et j’ai été de suite à l’atelier : il n’était pas sept heures. Pierret était déjà à la besogne.
La Laure m’a manqué de parole. J’ai travaillé toute la journée avec chaleur. J’étais fatigué sur le soir. Retouché les jambes du jeune homme au coin et la vieille.
Retourné chez moi m’habiller et pris Fielding et Soulier ; dîné ensemble chez Rouget. Chez M. Guillemardet, m’informer de la santé de Louis. Chez Perpignan. Vu M. N…, fort amusant et intéressant. C’est encore un philosophe tant soit peu décourageant et qui sent le machiavélisme. Nous avons parlé de lord Byron et de ce genre d’ouvrages dramatiques qui captivent singulièrement l’imagination.
Mardi 27. — Discussions intéressantes sur le génie et les hommes extraordinaires chez Leblond.
Dimier pensait que les grandes passions étaient la source du génie ! Je pense que c’est l’imagination seule, ou bien, ce qui revient au même, cette délicatesse d’organes qui fait voir là où les autres ne voient pas, et qui fait voir d’une façon différente. Je disais même que les grandes passions jointes à l’imagination conduisent le plus souvent au dévergondage d’esprit, et Dufresne dit une chose fort juste : que ce qui faisait l’homme extraordinaire était radicalement une manière tout à fait propre à lui de voir les choses. Il l’étendait aux grands capitaines et enfin aux grands esprits de tous les temps et de tous les genres. Ainsi, point de règles pour ces grandes âmes : elles sont pour les gens qui n’ont que le talent qu’on acquiert. La preuve, c’est qu’on ne transmet pas cette faculté. Il disait : « Que de réflexions pour faire une belle tête expressive ! Cent fois plus que pour un problème, et pourtant ce n’est, au fond, que de l’instinct, car il ne peut rendre compte de ce qui le détermine. » Je remarque maintenant que mon esprit n’est jamais plus excité à produire que quand il voit une médiocre production sur un sujet qui me convient.
— À l’atelier à huit heures. Mal disposé. Champmartin venu à la fin. — Dîné chez Rouget ensemble et puis rencontré Fieiding. Chez Leblond ensemble.
Mercredi 28 avril. — Toute la journée, non en train et insipide mélancolie ; il serait bien utile de se coucher de très bonne heure, à présent que les soirées sont ennuyeuses. Qu’il serait bon d’arriver au jour à l’atelier !
— Travaillé à l’enfant.
Jeudi 29 avril. — La gloire n’est pas un vain
mot pour moi. Le bruit des éloges enivre d’un
bonheur réel ; la nature a mis ce sentiment dans tous
les cœurs. Ceux qui renoncent à la gloire ou qui ne
peuvent y arriver font sagement de montrer, pour
cette fumée, cette ambroisie des grandes âmes, un
dédain qu’ils appellent philosophique. Dans ces derniers
temps, les hommes ont été possédés de je ne
sais quelle envie de s’ôter eux-mêmes ce que la nature
leur avait donné en plus qu’aux animaux qu’ils chargent
des plus vils fardeaux.
Un philosophe, c’est un monsieur qui fait ses quatre repas les meilleurs possible, pour qui vertu, gloire et noblesse de sentiments ne sont à ménager qu’autant qu’ils ne retranchent rien à ces quatre indispensables fonctions et à leurs petites aises corporelles et individuelles. En ce sens, un mulet est un philosophe bien préférable, puisqu’il supporte de plus, sans se plaindre, les coups et les privations. C’est que ces gens regardent comme une chose dont ils doivent surtout tirer vanité, cette renonciation volontaire à des dons sublimes qui ne sont point à leur portée.
— J’ai été de bonne heure à mon atelier. J’ai fait deux traits de deux dessins arabes et leurs chevaux.
Venus Laure et Hélène et Lopez, jusqu’à trois heures et quart. Resté à l’atelier jusqu’à sept heures passées. Thil est venu à la fin. Ses éloges, qui m’ont paru sincères, m’ont réchauffé. Je suis retourné avec lui jusqu’auprès du Palais-Royal. J’irai ces jours-ci le voir.
— Été chez M. Guillemardet, après mon dîner. Rentré vers dix heures.
Vendredi 30 avril. — À l’atelier vers huit heures et demie… Déjeuné avant. — J’ai eu Abadie.
| À lui | 3 fr. |
Retouché des mains d’après lui, et fait le sabre. — Avec Champmartin et Marochetti, à la Porte-Saint-Martin.
— Jane Shore ridicule
— Pour mon tableau du Christ[124], les anges de la mort tristes et sévères portent sur lui leurs regards mélancoliques. — Penser à Raphaël.
— Ce serait une belle chose, un Passage de la mer Rouge.
Samedi 1er mai. — Ayant reçu hier une lettre de la cousine Lamey, qui m’avertissait que M. de la Valette devait venir chez elle aujourd’hui pour y voir ma sœur, je me suis proposé d’y revenir. Je suis resté à l’atelier jusqu’à midi. — Mis au trait les deux petits dessins.
Resté ensuite chez la cousine jusqu’à deux heures et demie.
— Chez Larchez, fait des armes avec Fielding. En train de me trouver avec eux, dîné avec Fielding et ensuite M. Lelièvre, quelque peu, puis les rejoindre au petit café. Joué au billard, ou plutôt bavardé, en poussant des billes.
— L’Égypte ! l’Égypte ! J’aurai, par le général R…, des armes de mameluk.
— J’ai eu un délice de composition ce matin à mon atelier, et j’ai retrouvé des entrailles pour ce tableau du Christ, qui ne me disait rien.
Ce soir, j’entrevois de ces beaux nus, simples de forme, d’un modelé à la Guerchin, mais plus ferme. Je ne suis point fait pour les petits tableaux, mais je pourrais en faire dans ce genre.
Dimanche 2 mai. — Je rentre de bonne heure ce soir, et très mal disposé, quant à la santé ; mais une lettre de mon bon frère, toute bonne et rassurante sur son sort à venir, me remet un peu en train.
J’ai dîné chez ce bon Lelièvre.
Lassitude et disposition maladive, toute la journée. J’ai colorié l’aquarelle du Turc qui caresse son cheval. Henri Scheffer y est venu quelques heures ; puis Henri, avec qui je suis revenu jusqu’aux Tuileries.
Lundi 3 mai. — Ressenti toute la journée de mon indisposition. Déjeuné avec Soulier et Fielding.
Vu les tableaux du maréchal Soult.
— Penser, en faisant mes anges pour le préfet[125], à ces belles et mystiques figures de femmes, une, entre autres, qui porte des fruits dans un plat.
— Mon Pierret dîné avec moi. — Promené au Champ de Mars, avec Pierret, Soulier et Fielding.
— Rentré avec Pierret et passé la soirée : thé, le Dante, etc.
— Écrit à Cogniet.
Mardi 4 mai. — Voici le quatrième mois depuis le commencement de l’année. Ai-je rêvé pendant ce temps ? Quel éclair ! Je ne finis point mon tableau. Je suis accroché à chaque pas… J’ai remué le fond aujourd’hui. — Félix est venu à l’atelier.
— J’ai vu Thil le matin chez lui : il m’a prêté une petite Bible qui est une mine féconde de motifs. — Je suis passé un instant chez Édouard. — Dîné avec Fielding et Soulier chez R…, puis chez Leblond.
— Dufresne est bien amusant et bon garçon. — Magnétisme. — Son tour à un médecin qui endormit une femme ; son ami souffle à la femme des choses qu’elle a la bonhomie de redire ; lui-même feint de s’endormir et répond à ravir aux questions du docteur enchanté, puisqu’il le cite dans son ouvrage. — Foi qu’il faut ajouter à ces rêveries.
— En retournant, songé avec Soulier à faire de l’aquatinte d’après mes dessins : je retoucherai à la pointe.
— Dimier, excellent homme : il a eu deux mois et demi de leçons.
— Ouvrages sur l’Orient :
Anastase, ou les mémoires d’un Grec, traduit de l’anglais.
Lettres sur la Grèce et l’Égypte, par Savary[126].
Histoire de l’Égypte, sous Méhémet-Ali, par Maugin.
Traduction en vers de l’Enfer du Dante, par M. Brait Delamathe[127].
Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, avec un joli portrait, gravé par Cousin, par, je crois, M. Quatremère de Quincy[128].
Jeudi 6 mai. — D’assez bonne heure à l’atelier ; travaillé avec ardeur à la femme du coin, et en général à tout le coin du cheval.
Dufresne vers deux heures, jusqu’à trois heures et demie : il paraît content. J’ai repris après son départ, jusqu’à sept heures et demie.
— Aujourd’hui, le Barbier de Séville à l’Odéon.
Hier mercredi 5 mai. — Travaillé au cheval, depuis neuf heures environ, jusqu’à deux heures. — Chez Champmartin. — Monté sur le cheval de Marochetti. Sauté de l’autre côté : je ne m’en croyais pas capable ; j’ai failli être écrasé par le cheval, parce que je n’ai pas su prendre mon aplomb en retombant. — Retourné par le Luxembourg… Vif sentiment de bien-être et de liberté ![129] Penser toujours que la nature humaine trouve dans toutes les situations de quoi les supporter ou en tirer avantage…, le plus souvent, du moins.
— Dîné à quatre heures et demie. Trouvé Fedel et Comairas à la porte de mon atelier. Achevé la soirée avec eux.
— J’ai vu chez Comairas des Pinelli[130] superbes… Quel effet me feront donc les originaux ? Le Combattimento est fameux.
Vendredi 7. — Le matin, un instant chez Pierret et Soulier. Emporté à lui des croquis de Naples.
Acheté pour 5 fr. de gravures, rue des Saints-Pères… Costumes orientaux et instruments de sauvages, une ancienne lithographie de Géricault, prise de la Bastille, etc.
Déjeuné, en sortant de chez Soulier, au coin de la rue des Saints-Pères et de la rue de l’Université.
— À l’atelier ; Pierret y était. J’ai travaillé à l’habit
de l’homme du milieu ; cela détache mieux l’homme
couché. Dufresne me recommande surtout de donner
la couleur locale et de faire des gens du pays.
— Il faut s’efforcer de n’interrompre que pour finir le Velasquez.
L’esprit humain est étrangement fait ! J’aurais consenti à y travailler, perché, je crois, sur un clocher ; aujourd’hui je ne puis penser à l’achever que comme à une seccatura ; tout cela, parce que j’en suis hors depuis longtemps ; il en est de même de mon tableau et de tous les travaux possibles pour moi. Il y a une croûte épaisse à rompre pour s’y mettre de cœur ; quelque chose, un terrain rebelle qui repousse le soc et la houe. Mais après un peu d’obstination, sa rigueur s’évanouit tout à coup ; il est prodigue de fleurs et de fruits : on ne peut suffire à les recueillir.
— Fielding venu à l’atelier. Dîné avec lui rue de la Harpe et M. du Fresnoy[131]. Promenade au Luxembourg ; chez eux, rue Jacob. Rentré à onze heures.
— Le rossignol. — Quel rapide instant de gaieté dans toute la nature : ces feuilles si fraîches, ces lilas, ce soleil rajeuni. La mélancolie s’enfuit pendant ces courts moments. Si le ciel se couvre de nuages et se rembrunit, c’est comme la bouderie charmante d’un objet aimé : on est sûr du retour.
J’ai entendu ce soir en revenant le rossignol[132] ; je l’entends encore, quoique fort éloigné. Ce ramage est vraiment unique, plutôt par les émotions qu’il fait naître qu’en lui-même. Buffon s’extasie en naturaliste sur la flexibilité du gosier et les notes variées du mélancolique chanteur du printemps. Moi, je lui trouve cette monotonie, charme indéfinissable de tout ce qui fait une vive impression. C’est comme la vue de la vaste mer ; on attend toujours encore une vague avant de s’arracher à son spectacle ; on ne peut le quitter. Que je hais tous ces rimeurs avec leurs rimes, leurs gloires, leurs victoires, leurs rossignols, leurs prairies ! Combien y en a-t-il qui aient vraiment peint ce qu’un rossignol fait éprouver… ? Et pourtant leurs vers ne sont pleins que de cela. Mais si le Dante en parle, il est neuf comme la nature, et l’on n’a entendu que celui-là. Tout est factice et paré et fait avec l’esprit. Combien y en a-t-il qui aient peint l’amour ? Le Dante est vraiment le premier des poètes… On frissonne avec lui, comme devant la chose, supérieur en cela à Michel-Ange, ou plutôt différent, car il est sublime autrement, mais pas par la vérité. Come colombe adunate aile pasture, etc. Come si sta a gracidar la rana, etc. Come il villanello, etc., et c’est cela que j’ai toujours rêvé sans le définir, précisément cela. C’est une carrière unique.
— Mais quand une chose t’ennuiera, ne la fais pas.
Ne cours pas après une vaine perfection. Il est certains
défauts pour le vulgaire qui donnent souvent la vie.
— Mon tableau acquiert une torsion, un mouvement énergique qu’il faut absolument y compléter. Il y faut ce bon noir, cette heureuse saleté, et de ces membres comme je sais, et comme peu les cherchent. Le mulâtre fera bien.
Il faut remplir ; si c’est moins naturel, ce sera plus fécond et plus beau. Que tout cela se tienne ! O sourire d’un mourant ! Coup d’œil maternel ! étreintes du désespoir, domaine précieux de la peinture ! Silencieuse puissance qui ne parle qu’aux yeux, et qui gagne et s’empare de toutes les facultés de l’âme ! Voilà l’esprit, voilà la vraie beauté qui te convient, belle peinture, si insultée, si méconnue, livrée aux bêtes qui t’exploitent[133]. Mais il est des cœurs qui t’accueilleront encore religieusement ; de ces âmes que les phrases ne satisfont point, pas plus que les inventions et les idées ingénieuses. Tu n’as qu’à paraître avec ta mâle et simple rudesse, tu plairas d’un plaisir pur et absolu. Plus de donquichotteries indignes de toi ! Avouons que j’y ai travaillé avec la passion. Je n’aime point la peinture raisonnable ; il faut, je le vois, que mon esprit brouillon s’agite, défasse, essaye de cent manières, avant d’arriver au but dont le besoin me travaille dans chaque chose. Il y a un vieux levain, un fond tout noir à contenter. Si je ne me suis pas agité comme un serpent dans la main d’une pythonisse, je suis froid ; il faut le reconnaître et s’y soumettre, et c’est un grand bonheur. Tout ce que j’ai fait de bien a été fait ainsi.
Recueille-toi profondément devant ta peinture et ne pense qu’au Dante. C’est ceci que j’ai toujours senti en moi !
Dimanche 9 mai. — Déjà le 9 ! Quelle rapidité !
J’ai été vers huit heures à l’atelier. Ne trouvant pas Pierret, j’ai été déjeuner au café Voltaire. J’étais passé chez Comairas, lui emprunter les Pinelli.
Je me suis senti un désir de peintures du siècle. La vie de Napoléon fourmille de motifs.
— J’ai lu des vers d’un M. Belmontet[134], qui, pleins de sottises et de romantique, n’en ont que plus, peut-être, mis en jeu mon imagination.
— Mon tableau prend une tournure différente. Le sombre remplace le décousu qui y régnait. J’ai travaillé à l’homme au milieu, assis, d’après Pierret. Je change d’exécution.
— Sorti de l’atelier à sept heures et demie. Dîner chez un traiteur nouveau pour moi ; puis chez la cousine.
Hier samedi 8. — Déjeuné avec Fielding et Soulier ; puis chez Dimier, pour voir ses antiquités : quatre vases d’albâtre magnifique et d’une belle exécution ; un sarcophage fort original : se souvenir du caractère des pieds de deux statues égyptiennes assises, qu’on prétend de la plus haute antiquité.
— Puis chez Couturier. — À l’atelier : Pierret y était. J’ai fait la veste de l’homme du milieu et fait détacher en clair sur elle l’homme couché sur le devant, ce qui change notablement en mieux.
— Dîné avec Pierret. Ce soir, une petite promenade par les Tuileries, jusque chez moi. Rentré à onze heures et demie.
— La sérénade de Paër[135] est ce qui m’a frappé davantage.
Lundi 10 mai. — À l’atelier de bonne heure. J’y ai déjeuné. Retravaillé un peu, d’après Pierret, à la jambe du cheval, à l’aquarelle du mameluk qui tient le cheval par la bride. Fielding venu un instant.
— Dîné rue Monsieur-le-Prince. Été prendre Pierret, pour aller chez Smith, qui n’est pas organisé. J’ai lu en partie chez lui le Giaour. Il faut en faire une suite.
— Promenade aux Tuileries. — Pris la lithographie de Gros. — Chez M. Guillemardet : Louis va bien ; en descendant, Félix et Caroline rentraient. Ils ont été dans mon atelier…
— Idées :… faire le Giaour.
Rapporté de chez Félix le dessin que je lui ai fait.
Mardi 11 mai. — Il arrivera donc un temps où je ne serai plus agité de pensées et d’émotions et de désirs de poésie et d’épanchements de toute espèce. Pauvre Géricault ! je l’ai vu descendre dans une étroite demeure, où il n’y a plus même de rêves ; et cependant je ne peux le croire.
Que je voudrais être poète ! Mais au moins, produis avec la peinture ! fais-la naïve et osée… Que de choses à faire ! Fais de la gravure, si la peinture te manque, et de grands tableaux. La vie de Napoléon est l’apogée de notre siècle pour tous les arts.
Mais il faut se lever matin. La peinture, je me le suis dit mille fois, a ses faveurs, qui lui sont propres à elle seule. Le poète est bien riche.
— Rappelle, pour t’enflammer éternellement, certains passages de Byron ; ils me vont bien.
La fin de la Fiancée d’Abydos.
La Mort de Sélim, son corps roulé par les vagues et cette main surtout, cette main soulevée par le flot qui vient mourir sur le rivage. Cela est bien sublime et n’est qu’à lui. Je sens ces choses-là comme la peinture les comporte.
La Mort d’Hassan, dans le Giaour. Le Giaour contemplant sa victime et les imprécations du musulman contre le meurtrier d’Hassan.
La description du palais désert d’Hassan.
Les vautours aiguisent leur bec avant le combat. Les étreintes des guerriers qui se saisissent ; en faire un qui expire en mordant le bras de son ennemi.
Les imprécations de Mazeppa[136] contre ceux qui l’ont attaché à son coursier, avec le château renversé dans ses fondements.
— J’ai lu ce matin au café Desmons un morceau couronné à la Société des bonnes lettres. Dialogue entre Fouché, Bonaparte et Carnot : il y a de belles choses, mais aussi des chefs-d’œuvre dans le genre niais.
— Travaillé chez Fielding à son Macbeth. À
l’atelier vers midi. Commencé le Combat d’Hassan et
du Giaour[137].
— Dîné. Rouget à cinq heures. — Trouvé là Julien. Promené une heure avec lui. — Leblond à sept heures. — Dufresne n’est pas venu. — M. Rivière[138] y est venu.
— Je lisais ce matin cette anecdote. Un officier anglais, dans la guerre d’Amérique, se trouvant aux avant-postes, vit venir un officier américain occupé d’observer, qui paraissait si distrait qu’il n’en fut pas aperçu, quoiqu’il en fût à une distance très petite. Il le couche en joue, mais arrêté par l’idée affreuse de tirer sur un homme comme sur une cible, il retint son doigt prêt à faire partir la détente. L’Américain pique des deux et s’enfuit… C’était Washington !
Mercredi 12. — À l’atelier à neuf heures. Déjeuné au café D… — Chez Soulier après. Soulier est venu avec M. Andrews.
— Cogniet est venu vers trois heures passées ; il m’a paru fort content de ma peinture. Il lui semblait voir, disait-il, mon ancien tableau commencé. Et puis combien ce pauvre Géricault aimerait cette peinture !… La vieille, bouche grande ouverte, ni exagération dans les yeux ; l’intention des jeunes gens du coin ; naïf et touchant. Il semblait étonné qu’on fît à présent de telle sorte de peinture, etc. Il m’a bien plu comme de juste.
Dîné à six heures et demie rue de la Harpe. Fielding is corne there and we are returned together at his home. I was then very sleepy and slept a little bit on the bed of Soulier while he was abed. Rentré à dix heures.
Samedi 15 mai, dans la journée. — Ce qui fait les hommes de génie ou plutôt ce qu’ils font, ce ne sont pas les idées neuves, c’est cette idée, qui les possède, que ce qui a été dit ne l’a pas encore été assez. — Jeudi, j’ai été chez mon oncle à son atelier ; j’ai dîné avec lui, ma tante était ici. Ils m’ont invité pour la campagne aujourd’hui.
Le soir, étant assise et serrée près de moi, elle me faisait essayer des gants.
Hier, vendredi 14. — Duponchel[139] venu vers dix heures à l’atelier. Resté après jusqu’à cinq heures pour les costumes de Bothwell[140]. Attendu vainement au Luxembourg avec lui et Leblond, pour la partie au Moulin de beurre.
— Dîné ensemble. Profonde tristesse et découragement,
toute la soirée.
— En lisant la notice sur lord Byron, au commencement du volume, ce matin, j’ai senti encore se réveiller en moi cet insatiable désir de produire. Puis-je dire que ce serait le bonheur pour moi ? Au moins me le semble-t-il. Heureux poète et plus heureux encore d’avoir une langue qui se plie à ses fantaisies ! Au reste, le français est sublime, mais il faudrait avoir livré à ce Protée rebelle bien des combats, avant de le dompter.
Ce qui fait le tourment de mon âme, c’est sa solitude. Plus la mienne se répand avec les amis et les habitudes ou les plaisirs journaliers, plus il me semble qu’elle m’échappe et se retire dans sa forteresse. Le poète qui vit dans la solitude, mais qui produit beaucoup, est celui qui jouit de ces trésors que nous portons dans notre sein, mais qui se dérobent à nous quand nous nous donnons aux autres. Quand on se livre tout entier à son âme, elle s’ouvre tout à vous, et c’est alors que la capricieuse vous permet le plus grand des bonheurs, celui dont parle la notice, celui inaperçu peut-être de lord Byron et de Rousseau, de la montrer sous mille formes, d’en faire part aux autres, de s’étudier soi-même, de se peindre continuellement dans ses ouvrages. Je ne parle pas des gens médiocres. Mais quelle est cette rage, non pas seulement de composer, mais de se faire imprimer, outre le bonheur des éloges ? C’est d’aller à toutes les âmes qui peuvent comprendre la vôtre ; et il arrive que toutes les âmes se retrouvent dans votre peinture. Que fait même le suffrage des amis ? C’est tout simple qu’ils vous comprennent, ou plutôt que vous importe ? Mais c’est de vivre dans l’esprit des autres qui vous enivre. Quoi de si désolant ? me dirai-je. Tu peux ajouter une âme de plus à celles qui ont vu la nature d’une façon qui leur est propre. Ce qu’ont peint toutes les âmes est neuf par elles, et tu les peindrais encore neuves ! Ils ont peint leur âme, en peignant les choses, et ton âme te demande aussi son tour. Et pourquoi regimber contre son ordre ? Est-ce que sa demande est plus ridicule que l’envie du sommeil que te demandent tes membres, quand ils sont fatigués et toute ta physique nature ? S’ils n’ont pas fait assez pour toi, ils n’ont pas non plus fait assez pour les autres. Ceux même qui croient que tout a été dit et trouvé, te salueront comme nouveau, et fermeront encore la porte après toi. Ils diront encore que tout a été dit. De même que l’homme, dans la faiblesse de l’âge, qui croit que la nature dégénère, aussi les hommes d’un esprit vulgaire et qui n’ont rien à dire sur ce qui a déjà été dit, pensent-ils que la nature a permis à quelques-uns et seulement dans le commencement, de dire des choses nouvelles et qui frappent. Ce qu’il y avait à dire dans le temps de ces esprits immortels, frappait aussi tous les regards de leurs contemporains, et pas un grand nombre, pour cela, n’a été tenté de saisir le nouveau, de s’inscrire à la haie, pour dérobera la postérité la moisson à recueillir. La nouveauté est dans l’esprit qui crée, et non pas dans la nature qui est peinte. La modestie de celui qui écrit l’empêche toujours de se placer parmi les grands esprits dont il parle. Il s’adresse toujours, comme on pense, à une de ces lumières, s’il en est que la nature…, etc.
… Toi qui sais qu’il y a toujours du neuf, montre-le-leur
dans ce qu’ils ont méconnu… Fais leur croire
qu’ils n’avaient jamais entendu parler du rossignol et
du spectacle de la vaste mer, et de tout ce que leurs
grossiers organes ne s’entendent à sentir, que quand
on a pris la peine de sentir pour eux d’abord. Que la
langue ne t’embarrasse pas ; si tu cultives ton âme,
elle trouvera jour pour se montrer ; elle se fera un
langage qui vaudra bien les hémistiches de celui-ci
et la prose de celui-là. Quoi ! vous êtes original,
dites-vous, et cependant votre verve ne s’allume qu’à
la lecture de Byron ou du Dante, etc. ! Cette fièvre,
vous la prenez pour la puissance de produire, ce
n’est plutôt qu’un besoin d’imiter… Eh ! non, c’est
qu’ils n’ont pas dit la centième partie de ce qu’il
y a à dire ; c’est qu’avec une seule des choses qu’ils
effleurent, il y a plus de matières aux génies nouveaux
qu’il n’y a …[141] et que la nature
a mis en dépôt dans les grandes imaginations futures,
plus de nouveautés à dire sur ses créations, qu’elle
n’a créé de choses.
Mais que ferai-je ? il ne m’est pas permis de faire une tragédie ; la loi des unités s’y oppose… Un poème ?
Mardi 18 mai. — Penses-tu que Byron eût fait au milieu du tourbillon ses scènes énergiques ? que Dante fût environné de distractions, quand son âme voyageait parmi les ombres ?… Sans elle, rien ! sans suite, rien de productif !
Des travaux interrompus sans cesse ; et la seule cause en est dans la fréquentation de beaucoup de gens.
Le samedi 15. Parti à deux heures avec Riesener, ma tante, Henry, Léon et Rouget.
Le lendemain dimanche 16. Exercé dans la matinée à sauter et à lancer des bâtons. — Promené dans les bois. — Expliqué du Child-Harold avec ma tante.
Le lundi. Parti à sept heures environ. Vu Dufresne à l’atelier. Tracé quelque peu.
Jeudi 20 mai. — Aujourd’hui à l’atelier ; trouvé le fond. — Dimier venu de bonne heure. J’étais mal disposé de l’estomac et de la tête.
— Dîné avec ces messieurs, au Moulin de beurre. J’y étais aussi assez mal disposé.
— La soirée au café. Agréable. Bonnes causeries de l’Italien.
Hier mercredi, à l’atelier. Rien fait de bon.
Vendredi 28 mai. — J’ai passé toute la soirée avec Dufresne, qui part pour la campagne. J’ai la tête si remplie de choses à cette occasion que je n’en peux retrouver aucune.
— Je reprends depuis quelques jours avec entrain mon tableau. J’ai travaillé aujourd’hui à l’ajustement de la femme morte.
— Rien de bien remarquable ces derniers jours : vu Dimier mardi, il partait le lendemain.
— Qu’au moins tu admires les grandes vertus, si tu n’es pas assez ferme pour être toi-même vraiment vertueux ! Dufresne dit qu’il est capable de dévouement pour toutes les grandes choses, etc…, mais qu’il en voit le vide, que ce n’est rien au fond. J’éprouve le contraire… J’y rends hommage, mais je suis trop faible pour les faire. Mon affaire est tout autre.
Samedi 29. — Travaillé à la draperie de la vieille femme.
— Le soir, rejoint Félix et Pierret au Palais-Royal. Vu Mme X***. Désirs.
Lundi 31. — Ce soir au Barbier à l’Odéon ; c’est fort satisfaisant. J’étais près d’un vieux monsieur qui a vu Grétry, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Il a vu Voltaire dans un certain salon, disant aux femmes des galanteries comme on les lui connaît. « Je vois en vous, disait-il en s’en allant, un siècle qui commence ; en moi, c’en est un qui finit : c’est le siècle de Voltaire. » On voit que le modeste philosophe prenait d’avance, pour la postérité, la peine de nommer son siècle. Il fut mené par un de ses amis déjeuner avec Jean-Jacques, rue Plalrière… ils sortirent ensemble. Aux Tuileries, des enfants jouaient à la balle : « Voilà, disait Rousseau, comme je veux qu’on exerce Émile », et choses semblables. Mais la balle d’un enfant vint heurter la jambe du philosophe, qui entra en colère, et poursuivit l’enfant de son bâton, quittant brusquement ses deux amis.
— Travaillé peu aujourd’hui et à la vieille. — Hier, dîné avec Leblond.
Mardi 1er juin. — Chez Leblond. — Dufresne n’est point parti : je le verrai ces jours-ci, peut-être demain. Il a amené le docteur Bailly[142].
— J’ai travaillé beaucoup l’homme nu couché, d’après Pierret.
— Soulier revenu de sa campagne.
— Le docteur Bailly : l’œil doux et le maintien
réservé. En rentrant, je me vis dans la glace, et je
me fis presque peur de la méchanceté de mes traits…
C’est pourtant lui qui doit porter dans mon âme un
fatal flambeau qui, semblable aux cierges des morts,
n’éclaire que les funérailles de ce qui y reste de
sublime.
Amant des Muses, qui voue à leur culte ton sang le plus pur, redemande à ces… divinités cet œil vif et brillant de la jeunesse, cette allégresse d’un esprit peu préoccupé. Ces chastes sœurs ont été pires que des courtisanes ; leurs perfides jouissances sont plus mensongères que la coupe de la volupté. C’est ton âme qui a énervé tes feux, tes vingt-cinq ans sans jeunesse, ton ardeur sans vigueur ; ton imagination embrasse tout, et tu n’as pas la mémoire d’un simple marchand. La vraie science du philosophe devrait consister à jouir de tout. Nous nous appliquons au contraire à disséquer et détruire tout ce qui est bon en soi, ne fût-ce qu’illusion… mais vertueuse. La nature nous donne cette vie comme un jouet à un faible enfant. Nous voulons voir comme tout cela joue ; nous brisons tout. Il nous reste entre les mains et à nos yeux ouverts trop tard et stupides, des débris stériles, des éléments qui ne décomposent rien. Le bien est si simple ! Il faut se donner tant de mal pour le détruire par des sophismes ! Et quand tout ce bien et ce beau ne seraient qu’un vernis sublime, qu’une écorce, pour nous aider à supporter le reste, qui peut nier qu’il n’existe au moins comme cela ? Singuliers hommes qui ne se laissent pas charmer par une belle peinture, parce que l’envers est un bois mangé des vers ! Tout n’est pas bien ; mais tout ne peut pas être mal, ou plutôt par cela, tout est bien.
Qui a commis une action d’égoïste sans se la reprocher ?
Vendredi 4 juin, matin. — Je vis en société avec un corps, compagnon muet, exigeant et éternel ; c’est lui qui constate cette individualité qui est le sceau de la faiblesse de notre race. Il sait que, si elle est libre, c’est pour qu’elle soit esclave, mais la faible quelle est ! elle s’oublie dans sa prison. Elle n’entrevoit que bien rarement l’azur de sa céleste patrie.
Oh ! triste destinée ! désirer sans fin mon élargissement, esprit que je suis, logé dans un mesquin vase d’argile. Tu bornes l’exercice de ta force à t’y tourmenter en cent manières. Il me semble que ce pourrait être l’organisation qui modifierait l’âme : elle est plus universelle. Qu’elle passe par le cerveau comme par un laminoir qui la martèle et la travaille, au coin de notre plate nature physique !… mais quel poids insupportable que celui de ce cadavre vivant ! Au lieu de s’élancer vers des objets de désirs qu’elle ne peut étreindre, même point définir, elle passe l’éclair de la vie à souffrir des sottises où la pousse son tyran. C’est par une mauvaise plaisanterie, sans doute, que le ciel nous a permis d’assister au spectacle du monde par cette ridicule fenêtre : sa lorgnette gauchie et terne, plus ou moins, mais toujours dans un sens, gâte tous les jugements de l’autre, dont la bonne foi naturelle se corrompt, et qui produit souvent d’horribles fruits ! Je veux bien de cette façon croire à vos influences et à vos bosses…, mais ce sera pour m’en désoler toujours. Qu’est-ce que c’est que l’âme et l’intelligence séparées ? Le plaisir de donner des noms et de classer est fatal à ces savants. Ils vont toujours trop loin et gâtent leur affaire aux yeux des indolents d’un esprit juste, qui croient que la nature est un voile impénétrable. Je sais bien que pour s’entendre, il faut nommer les choses ; mais dès lors, elles sont spécifiées, elles qui ne sont ni espèces
constantes, ni[143]— Hier vu Dufresne le matin. — Travaillé au Turc à cheval et à la vieille. — Le soir chez Leblond.
Dimanche 6. — Leblond venu à l’atelier. — Dîné chez Scheffer avec Soulier et lui. Bonne soirée et promenade avec Soulier.
Nous avions rencontré avant-hier soir Dufresne, qui a dû partir ce matin pour la campagne.
— Franklin. Ne pas oublier d’acheter la Science du bonhomme Richard.
— Quelle sera ma destinée ?… Sans fortune et
sans dispositions propres à rien acquérir : beaucoup
trop indolent, quand il s’agit de se remuer à cet effet,
quoique inquiet, par intervalles, sur la fin de tout
cela. Quand on a du bien, on ne sent pas le plaisir
d’en avoir ; quand on n’en a pas, on manque des
jouissances que le bien procure. Mais tant que mon
imagination sera mon tourment et mon plaisir à la
fois, qu’importe le bien ou non ? C’est une inquiétude,
mais ce n’est pas la plus forte.
Sitôt qu’un homme est éclairé, son premier devoir est d’être honnête et ferme : il a beau s’étourdir, il y a quelque chose en lui de vertueux qui veut être obéi et satisfait. Quelle penses-tu qu’ait été la vie des hommes qui se sont élevés au-dessus du vulgaire ? Un combat continu[144]. Lutte contre la paresse qui leur est commune avec l’homme vulgaire, quand il s’agit d’écrire, s’il est écrivain ; parce que son génie lui demande à être manifesté, et ce n’est pas par ce vain orgueil d’être célèbre seulement qu’il lui obéit, c’est par conscience. Que ceux qui travaillent froidement se taisent… Mais sait-on ce que c’est que le travail sous la dictée de l’inspiration ? Quelles craintes ! Quelles transes de réveiller ce lion qui sommeille, dont les rugissements ébranlent tout votre être !… Mais pour en revenir, il faut être ferme, simple et vrai.
Il n’y a pas de mérite à être vrai, quand on l’est naturellement, ou plutôt, quand on ne peut pas ne pas l’être ; c’est un don comme d’être poète ou musicien ; mais il y a du courage à l’être à force de réflexions, si ce n’est pas une sorte d’orgueil, comme celui qui s’est dit : « Je suis laid » et qui dit aux autres : « Je suis laid », pour qu’on n’ait pas l’air de l’avoir découvert avant lui.
Dufresne est vrai, je pense, parce qu’il a fait le tour du cercle ; il a dû commencer par être affecté, quand il n’était qu’à demi éclairé. Il est vrai, parce qu’il voit la sottise de ne pas l’être. Il avait, je suppose, toujours assez d’esprit pour chercher à déguiser des faiblesses. À présent, il préfère ne pas les avoir, et il s’en accusera de meilleur cœur, pensant à peine les avoir, qu’il ne prenait soin de les cacher quand il les sentait en lui. Je n’ai pas encore avec lui cette candeur et cette sérénité que je me trouve avec ceux dont j’ai l’habitude ; je ne suis pas assez son ami encore pour être d’un avis tout à fait opposé au sien, ou pour écouter négligemment ou ne pas au moins feindre d’avoir attention quand il me parle. Si je consulte et que je cherche le fond, peut-être y a-t-il, — et c’est sûr, — cette crainte de passer pour un homme de moindre esprit, si je ne pense pas comme lui. Sottise ridicule ! Quand tu serais sûr de lui en imposer, est-il rien de plus dur qu’une contenance incessamment mensongère ? C’est un homme après tout, et respecte-toi avant tout. C’est se respecter qu’être sans voile et franc.
Mardi 8 juin. — Travaillé beaucoup : la femme,
le cheval, tout ce coin, les deux enfants. Édouard
venu et très satisfait. — Leblond le soir. — Henry a
chanté et nous a fait plaisir.
— Hier lundi, j’ai dîné chez M. Guillemardet.
— Bélisaire.
Mercredi 9 juin. — La Laure m’a amené une admirable Adeline de seize ans, grande, bien faite et d’une tête charmante. Je ferai son portrait et m’en promets ; j’y pense…
— J’ai été voir le dessin de Gros, chez Laugier[145] ; on ne peut plus aimable.
M’a fait moins d’impression que celle du tableau ; c’est un contraste singulier avec la chaleur réelle qui est dans tant de choses, que la froideur générale d’exécution ; un peu plat. Puis, point d’individualité ; du dessin dans les parties, mais l’idée… Un peu atelier… Draperies arrangées, effet connu ; le noir sur le devant, etc. Mais c’est égal, je n’en suis pas trop découragé.
Mais il est bien important de faire toujours une esquisse.
Dimanche 13 juin. — Rien de bien remarquable
aujourd’hui. — Jeudi soir chez Leblond. — Aujourd’hui,
travaillé toute la journée à copier deux dessins.
J’avance beaucoup mon tableau. — Dîner avec
Soulier et Fielding. — Commencé mon aquatinte.
Chez Fielding et Soulier, le matin.
— À l’atelier, travaillé au coin à gauche, surtout l’homme couché. Ôté le blanc qu’il avait autour de la tête.
— Le soir chez M. de Conflans : il était seul. Café de la Rotonde.
— Reçu un billet de la Laure ; très drôle.
— En sortant vers huit heures, le soir, de la maison, rencontré la jolie grande ouvrière. Je l’ai suivie jusqu’à la rue de Grenelle, en délibérant toujours sur ce qu’il y avait à faire et malheureux presque d’avoir une occasion. Je suis toujours comme ça. J’ai trouvé, après, toutes sortes de moyens à employer pour l’aborder, et quand il était temps, je m’opposais les difficultés les plus ridicules. Mes résolutions s’évanouissent toujours en présence de l’action. J’aurais besoin d’une maîtresse pour mater la chair d’habitude. J’en suis fort tourmenté et soutiens à mon atelier de magnanimes combats. Je souhaite quelquefois l’arrivée de la première femme venue. Fasse le ciel que vienne Laure demain ! Et puis, quand il m’en tombe quelqu’une, je suis presque fâché, je voudrais n’avoir pas à agir ; c’est là mon cancer. Prendre un parti ou sortir de ma paresse. Quand j’attends un modèle, toutes les fois, même quand j’étais le plus pressé, j’étais enchanté quand l’heure se passait, et je frémissais quand je l’entendais mettre la main à la clef. Quand je sors d’un endroit où je suis le moins du monde mal à mon aise, j’avoue qu’il y a un moment de délices extrêmes dans le sentiment de ma liberté dans laquelle je me réinstalle. Mais il y a des moments de tristesse et d’ennui, qui sont bien faits pour éprouver rudement ; ce matin, je l’éprouvais à mon atelier. Je n’ai pas assez d’activité à la manière de tout le monde pour m’en tirer, en m’occupant de quelque chose. Tant que l’inspiration n’y est pas, je m’ennuie. Il y a des gens qui, pour échapper à l’ennui, savent se donner une tâche et l’accomplir.
— Je pensais aujourd’hui qu’à travers tous nos petits mots, j’aime beaucoup Soulier : je le connais et il me connaît. J’aime beaucoup Leblond. J’aime beaucoup aussi mon bon vieux frère, je le connais bien ; je voudrais être plus riche, pour lui faire quelque plaisir de temps en temps. Il faut que je lui écrive.
Mardi 15 juin. — Travaillé à la vieille femme, à ses brodequins. — Prévost l’après-midi. — Le soir, Leblond. — Thil venu le matin. Il préfère ma peinture à celle de Géricault : je les aime beaucoup toutes deux.
| À Prévost (modèle) | 2 fr. 50. |
Jeudi 17 juin. — Fielding le matin. — La planche. À midi l’atelier. — La dame des Italiens est venue. Beaucoup ému. — Perpignan est venu et M. Rivière.
— Été aux Italiens avec Fielding. — Ricciardi. Mlle Mombelli[146] et Marie. La dame y était. I am very fond of tkis pretty lady. I was looking at her incessantly.
— Il faut absolument composer, à mesure qu’ils me viennent, tous les sujets intéressants. Je sais, par expérience, que je ne peux en tirer parti, quand c’est pour les exécuter au moment.
| A Marie Aubry (modèle) | 2 fr. |
Vendredi 18. — Le matin, chez Fielding, — et ma planche au Musée. A l’atelier, mon fond. Fedel venu.
— Aux Français. La belle Mme Biez. Pierre de Portugal, et les Plaideurs sans procès[147].
Samedi 19. — Avec Pierret et Fielding, à Montfaucon.
Vu Cogniet et le tableau de Géricault. Vu les Constable. C’était trop de choses dans un jour. Ce Constable me fait un grand bien.
Revenu vers cinq heures. — J’ai été deux heures à mon atelier. Grand manque de sexe. Je suis tout à fait abandonné.
« Puis-je espérer, belle dame, de vous voir jeudi… ? et me pardonnez-vous de n’avoir pas été chez vous ? J’ose me flatter que vous ne serez pas aussi sévère que vous le disiez, et que vous n’aurez pas la barbarie de passer devant la porte jaune sans entrer. J’imagine que ce serait après midi, comme l’autre fois. Si ce n’est pas trop présumer encore, je me permettrais de vous demander un peu plus de temps. »
Un combat s’élève : l’enverrai-je ou non ?
Dimanche 20 juin. — La journée chez Fielding. — Achevé ma planche. — Dîné ensemble chez Tautin.
Lundi 21 juin. — Porté ma planche chez l’imprimeur. Ébauché les deux chevaux morts. — Vu Mayer[148]. — Ils veulent tous plus d’effet : c’est tout simple.
— Désappointé aux Français. J’avais un billet pour Bothwell, mais daté du 19.
Vendredi 25 juin. — Été, chez Dorcy, voir les études de Géricault. — Chez Gogniet. — Revu les Constable, etc.
— A Montfaucon. Dîné par là.
Samedi 26. — Parti pour Frépillon[149] avec Henry, Riesener, Léon et ses camarades. Resté jusqu’à lundi matin.
Mardi 29 juin. — Malade. Presque toute la journée à l’atelier ; le soir, Leblond.
Mercredi 30 juin. — Chez M. Auguste[150]. Vu d’admirables peintures d’après les maîtres : costumes, chevaux surtout, admirables… comme Géricault était loin d’en faire.
Il serait très avantageux d’avoir de ces chevaux et de les copier, ainsi que les costumes grecs et persans, indiens, etc.
— Vu aussi chez lui de la peinture d’après Haydon[151] : très grand talent. Mais, comme disait très bien Édouard, absence d’un style bien ferme à lui, dessin à la West. J’oubliais les belles études de M. Auguste, d’après les marbres d’Elgin[152]. Haydon a passé un temps considérable à les copier ; il ne lui en est rien resté… Les belles cuisses d’homme et de femmes ! Quelle beauté sans enflure ! incorrections qui ne se remarquent pas.
— Le soir avec Fielding. Pris du thé, rue de la Paix.
Mercredi 7 juillet. — Aujourd’hui, M. Auguste est venu à l’atelier : il est fort charmé de ma peinture ; ses éloges m’ont ranimé. Le temps s’avance. J’irai demain chez lui chercher des costumes.
— Passé la soirée avec Pierret. — Hier Leblond. — J’ai vu Édouard qui est malade et qui m’inquiète.
Jeudi 8 juillet. — Le matin chez Scheffer. — Rencontré Cogniet chez M. de Forbin[153]. — Chez M. Auguste, chercher les costumes. — M. de Forbin venu à mon atelier avec Granet[154]. — Zélie, etc. — Le soir, Pierret. — Vu Édouard, le soir, qui part ; il a meilleure mine, cela me charme.
Samedi 17 juillet. — Aujourd’hui, Gassies[155] venu à mon atelier avec M. d’Houdetot[156]. — Hier, Drolling. — Aujourd’hui, Moïse avec Pierret et Fielding.
Dimanche 18 juillet. — Quitté l’atelier de bonne heure. — Dîné avec Henry et promené avec lui le soir, et revenu par Asnières.
Lundi 19 juillet. — Comairas venu le matin. — J’ai avancé beaucoup, quoique je ne sois resté que jusqu’à quatre heures.
Mardi 20 juillet. — Le matin, chez Soulier et Fielding. — M. de Forbin, qui m’a traité avec toute la bonté imaginable. — Gassies et M. d’Houdetot. Sa peinture m’a fait le plus grand effet y penser.
— Leblond. Assez bonne petite soirée… Parlé de pèche, de chasse, de Walter Scott, etc.
— Penser beaucoup au dessin et au style de M. d’Houdetot. Faire beaucoup d’esquisses et se donner le temps : c’est en cela surtout que j’ai besoin de faire des progrès. C’est à ce propos qu’il faut avoir de belles gravures du Poussin et les étudier. La grande affaire, c’est d’éviter cette infernale commodité de la brosse. Rends plutôt la matière difficile à travailler comme du marbre : ce serait tout à fait neuf… Rendre la matière rebelle pour la vaincre avec patience.
19 août. — Vu M. Gérard[157] au Musée. Éloges les plus flatteurs. Il m’invite à venir dîner demain à sa campagne.
— Le soir, chez Soulier avec Leblond et Pierret.
— Déjeuné aujourd’hui avec Horace Vernet et Scheffer. Appris un grand principe d’Horace Vernet : finir une chose quand on la tient. Seul moyen de faire beaucoup.
Lundi 4 octobre. — Revu la Galerie des maîtres.
— Fait des études au manège et dîné avec M. Auguste.
À propos d’un de ses superbes croquis d’après
les tombeaux napolitains, il parle du caractère neuf
qu’on pourrait donner aux sujets saints, en s’inspirant
des mosaïques du temps de Constantin.
Vu chez lui le dessin d’Ingres, d’après son bas-relief et sa composition de Saint Pierre délivré de prison, etc.
Mardi 5 octobre. — Passé la journée chez M. de Conflans, à Montmorency. Promenade dans la forêt, etc., et le soir revenu avec Félix. La dame entre nous deux et Leblond.
— Reçu ce soir une lettre de Soulier.1825
Sans date[158]. — L’envie a noirci chaque feuillet de son histoire. Pendant que les Tartufe et les Basile de l’Angleterre se liguaient contre lui, il déposait la lyre à laquelle il devait sa renommée, il saisissait l’épée de Pélopidas et prodiguait en faveur des Hellènes ses travaux, ses fatigues, ses veilles, sa santé, sa fortune et enfin sa vie. — Ses ennemis ont été nombreux : mais voici son tombeau. La haine expire, l’envie pardonne. L’avenir juste va le ranger au nombre de ces hommes que des passions, le trop d’activité ont condamnés au malheur en leur donnant le génie. On dirait qu’il s’est voulu peindre dans ses vers : le malheur, voilà le partage de ces grands hommes. Telle est la récompense de leurs pensées élevées, et de ce grand sacrifice qu’ils consomment, lorsque, réunissant pour ainsi dire en des paroles harmonieuses la sensibilité de leurs organes, la délicatesse de leurs idées, leur force, leur âme, leurs passions, leur sang, leur vie, ils donnent à leurs
semblables de grandes leçons et d’immortelles voluptés.1830
Sans date. — Ordinairement, le point d’interruption de la composition, c’est-à-dire la manière dont tranche le groupe de devant avec les figures plus éloignées, doit être sombre et fait mieux au bord qu’éclairé ; encore par la raison que les devants doivent autant que possible se détacher en sombre par les bords. Jusqu’ici, je crois ce principe le plus fécond pour le clair-obscur.
Le Corrège ne me paraît pas aussi complet dans le clair-obscur que Véronèse et Rubens ; il détache trop souvent des membres très clairs sur un fond sombre ; ce qui fait bien sur un fond sombre, c’est alors des parties entièrement reflétées.
Mercredi 14 mai. — Article sur Michel-Ange[159]. Heureux homme ! il a pétri le marbre et animé la toile, etc. Mais qu’importe après tout, si la nature vous a donné, dans quelque genre que ce soit, d’animer, de faire vivre ! Quel bonheur de rendre la vie, l’âme ! — Chacun des plans, dans l’ombre, ou plutôt dans tout effet de demi-teinte, doit avoir chacun son reflet particulier ; par exemple, tous les plans qui regardent le ciel, bleuâtres ; tous ceux qui sont tournés vers la terre, chauds, etc., et changer soigneusement, à mesure qu’ils tournent. Les plans de côté reflétés verts ou gris.
Dans Véronèse, le linge froid dans l’ombre, chaud dans le clair.
Quand il y a beaucoup de figures, qu’elles aient bien l’air de se correspondre comme grandeur, suivant le plan où elles sont.
La pâleur dans les reflets indique, plus que le reste, la pâleur, ou de la maladie, ou de la mort. Burnet[160]dit que Rubens entoure ordinairement la masse de lumière de l’ombre, et ne se sert de vigueur dans le clair que pour lier. Sa lumière est composée de teintes fraîches, délicates, etc. Au contraire, dans les ombres des teintes très chaudes qui sont de l’essence ordinaire du reflet et ajoutent ainsi à l’effet du clair-obscur. Il n’y met surtout pas de noir.
Mettre dans l’ombre des tons feuille morte (Van Dyck), bruns, opposés au rouge.
La Femme au bain : pour les chairs, teinte locale plate ; pour les clairs, de rouge de Venise et blanc, dans laquelle, suivant l’endroit des clairs, jaune de Naples et blanc, de jaune de Naples, blanc et noir pêche, de blanc et noir pêche. Les ombres préparées avec tons de reflets orangés les plus chauds et des tons gris d’ombre par places, tels que blanc, jaune Naples et terre d’ombre, etc.
Un grand avantage de composer toujours les mêmes tons est pour la facilité de retoucher et de rentrer dans ce qu’on a fait.
Il y a beaucoup d’académique dans Rubens, surtout dans son exécution, surtout dans son ombre systématiquement peu empâtée et marquant beaucoup au bord.
Le Titien est bien plus simple sous ce rapport, ainsi que Murillo.
Mai. — Tu es triste, tu te ranges toi-même dans le cercle pénible de la sérénité…
— L’or ne se trouve guère dans ces terrains riants et fertiles qui portent de paisibles moissons et de gras pâturages : il se trouve dans les entrailles des rochers terribles qui effrayent le voyageur.
— Repaire des tigres et des oiseaux sauvages ; les oiseaux sauvages y effrayent les voyageurs de leurs cris sauvages, et le tigre, qui cache dans leurs
cavernes les fruits de ses amours, en écarte le…[161].1832
VOYAGE AU MAROC
Tanger, 26 janvier[162]. — Chez le pacha.
L’entrée du château : le corps de garde dans la cour, la façade, la ruelle entre deux murailles. Au bout sous l’espèce de voûte, des hommes assis se détachant en brun sur un peu de ciel[163]. Arrivé sur la terrasse ; trois fenêtres avec balustrade en bois, porte moresque de côté par où venaient les soldats et les domestiques.
Avant, la rangée de soldats sous la treille : cafetan jaune, variété de coiffures ; bonnet pointu sans turban, surtout en haut sur la terrasse.
Le bel homme à manches vertes.
L’esclave mulâtre qui versait le thé, à cafetan jaune et burnous attaché par derrière, turban. Le vieux qui a donné la rose, avec haïjck et cafetan bleu foncé.
Le pacha avec ses deux haijcks ou capuchons, de plus le burnous. Tous les trois sur un matelas blanc, avec un coussin carré long couvert d’indienne. Un petit coussin long en arlequin, un autre en crin, de divers dessins ; bouts de pieds nus, encrier de corne, diverses petites choses semées.
L’administrateur de la douane[164], appuyé sur son coude, le bras nu, si je m’en souviens : haïjck très ample sur la tête, turban blanc au-dessus, étoffe amarante qui pendait sur la poitrine, le capuchon non mis, les jambes croisées. Nous l’avions rencontré sur une mule grise en montant. La jambe se voyait beaucoup ; un peu de la culotte de couleur ; selle couverte par devant et par derrière d’une étoffe écarlate. Une bande rouge faisait le tour de la croupe du cheval en pendant. La bride rouge de même ou, plutôt, le poitrail. Un More conduisait le cheval par la bride.
Le plafond seul était peint, et les côtés du pilastre intérieurement en faïence. Dans la niche du pacha c était un plafond rayonnant, etc… ; dans l’avant-chambre des petites poutres peintes.
Le troisième personnage était le fils du pacha : deux haijcks sur la tête, ou plutôt deux tours du même, à ce que je suppose ; burnous bleu foncé sur la poitrine laissant voir un peu de blanc. Pieds, tête énorme, gras de figure, air stupide.
Le bel homme à manches vertes, chemise de dessus en basin. Pieds nus devant le pacha.
Le jardin partagé par des allées couvertes de treilles. Orangers couverts de fruits et grands, des fruits tombés par terre ; entouré de hautes murailles.
Entré dans tous les détours du vieux palais. Cour de marbre, fontaine au milieu ; chapiteaux d’un mauvais composite ; l’attique des pierres toute simple : délabrement complet.
Les plafonds des niches et même des petites salles sont remplis de sculptures peintes comme la rose d’une mandoline.
Les colonnes du tour de la cour sont en marbre blanc et la cour pavée de même.
Remarqué, en retournant vers un bel escalier à droite, un bel homme qui nous suivait, l’air dédaigneux.
Sorti par la salle où le pacha est censé rendre la justice. A gauche de la porte du fond par où nous y sommes entrés, une sorte de tambour en planches de deux pieds et demi de hauteur environ, et allant depuis la porte jusqu’à l’angle, sur lequel s’assied le pacha. Le long des murs, dans les intervalles des pilastres qui vont à la voûte, des avances de pierre pour servir de sièges. Les soldats sans fusils nous attendaient à la porte sur deux rangées aboutissant au corps de garde par lequel nous étions entrés.
Vu une Juive très bien[165] ressemblant à Mme R…
Nègre, que Mornay m’a fait remarquer ; il m’a semblé avoir une manière particulière de porter le haïjck.
Vu de côté la mosquée en allant chez un des consuls. Un Maure se lavait les pieds dans la fontaine qui est au milieu ; un autre se lavait accroupi sur le bord[166].
29 janvier[167]. — Vue ravissante en descendant le long des remparts, la mer ensuite. Cactus et aloès énormes. Clôture de cannes ; taches d’herbes brunes sur le sable.
En revenant, le contraste des cannes jaunes et sèches avec la verdure du reste. Les montagnes plus rapprochées d’un vert brun, tachées d’arbustes nains noirâtres. Cabanes.
La scène des chevaux qui se battent[168]. D’abord ils se sont dressés et battus avec un acharnement qui me faisait frémir pour ces messieurs, mais vraiment admirable pour la peinture. J’ai vu là, j’en suis certain, tout ce que Gros et Rubens ont pu imaginer de plus fantastique et de plus léger. Ensuite le gris a passé sa tête sur le cou de l’autre. Pendant un temps infini, impossible de lui faire lâcher prise. Mornay est parvenu à descendre. Pendant qu’il le tenait par la bride, le noir a rué furieusement. L’autre le mordait toujours par derrière avec acharnement. Dans tout ce conflit, le consul est tombé. Ensuite laissé tous deux ; allant sans se lâcher du côté de la rivière, y tombant tous deux et le combat continuant et en même temps cherchant à en sortir ; les jambes trébuchent dans la vase et sur le bord, tout sales et luisants, les crins mouillés. A force de coups, le gris lâche prise et va vers le milieu de l’eau, le noir en sort, etc… De l’autre côté le soldat tâchant de se retrousser pour retirer l’autre.
La dispute du soldat avec le groom. Sublime avec son tas de draperie, l’air d’une vieille femme et pourtant quelque chose de martial.
En revenant, superbes paysages à droite, les montagnes d’Espagne du ton le plus suave, la mer bleu vert foncé comme une figue, les haies jaunes par le haut à cause des cannes, vertes en bas par les aloès.
Le cheval blanc entravé qui voulait sauter sur un des nôtres.
Sur la plage, près de rentrer, rencontré les fils du kaïd, tous sur des mules. L’aîné, son burnous bleu foncé ; haïjck à peu près comme notre soldat, mais bien propre ; cafetan jaune serin. Un des jeunes enfants tout en blanc, avec une espèce de cordon qui suspendait probablement une arme.
30 janvier. — Visite au consul anglais et suédois.
Le jardin de M. de Laporte[169]. Tombeau dans la
campagne.
31 janvier. — Dessiné le Maure du consul sarde. — Pluie. — En allant chez le consul anglais, remarqué un marchand assez propre dans sa boutique ; le plancher et le tour garnis de nattes blanches avec des pots et marchandises seulement d’un côté.
2 février, jeudi. — Dessiné la fille de Jacob en femme maure[170]. — Sortie vers quatre heures. Un Maure à tête très remarquable qui avait un turban blanc par-dessus le haïjck. Tête des Maures de Rubens, narines et lèvres un peu grosses, yeux hardis. — Remarqué les canons rouillés.
Le vieux Juif dans sa boutique en redescendant à la maison (Gérard Dow)[171]. — Femme avec les talons et, je pense, les pieds peints en jaune.
Vendredi 4 février. — Dessiné après déjeuner d’après le Maure du consul sarde.
Sorti vers deux heures ; été voir le consul de Danemark ; passé devant l’école.
Incinctus, gens qui ne sont pas guerriers. Cinctus ou accinctus, militaires. Cette distinction qui existait chez les anciens se trouve ici. La gélabia, costume du peuple, des marchands, des enfants. Je me rappelle cette gélabia, costume exactement antique, dans une petite figure du Musée : capuchon, etc. Le bonnet est le bonnet phrygien.
Le palimpseste est la planche sur laquelle écrivent les enfants à l’école. L’enseignement mutuel est originaire de ces pays. Dans les moments de détresse, les enfants vont en bande portant cette planche sur la tête. Elle est enduite d’une espèce de glaise sur laquelle ils écrivent avec une encre particulière. On efface, je crois, en mouillant, et en faisant sécher au soleil.
Porte du consul danois.
Vu dans le quartier des Juifs des intérieurs remarquables en passant. Une Juive se détachant d’une manière vive ; calotte rouge, draperie blanche, robe noire.
C’est le premier jour du Rhamadan. Au moment du lever de la lune, le jour étant encore, ils ont tiré des coups de fusil, etc. ; ce soir ils font un bruit de tambours et de cornets à bouquin infernal.
Samedi 5 février. — Dans le jardin du consul suédois, après déjeuner ; chez Abraham, à midi. Remarqué, en passant devant la porte de sa sœur, deux petites Juives accroupies sur un tapis dans la cour. En entrant chez lui, toute sa famille[172] dans l’espèce de petite niche et le balcon au-dessus avec la porte d’escalier. La femme au balcon, joli motif.
11 février. — Muley-Soliman avait cinquante-quatre enfants. Il abdique nonobstant en faveur de Muley-Abd-Ehr-Rhaman, son neveu, reconnaissant à ses enfants peu de capacité.
Dimanche 12 février. — Dessiné la Juive Dititia avec le costume d’Algérienne[173].
Été ensuite au jardin de Danemark. Le chemin charmant. Les tombeaux au milieu des aloès et des iris (Ægyptiaca). La pureté de l’air. Mornay aussi frappé que moi de la beauté de cette nature.
Les tentes blanches sur tous les objets sombres. Les amandiers en fleur. Le lilas de Perse. Grand arbre. Le beau cheval blanc sous les orangers. Intérieur de la cour de la petite maison.
En sortant, les orangers noirs et jaunes à travers la porte de la petite cour. En nous en allant, la petite maison blanche dans l’ombre au milieu des orangers sombres. Le cheval à travers les arbres.
Dîner à la maison avec les consuls. Le soir, M. Rico a chanté des airs espagnols. Le Midi seul produit de pareilles émotions.
Indisposé et resté seul le soir. Rêverie délicieuse au clair de lune dans le jardin.
Mercredi 15 février. — Sorti avec M. Hay[174]. Vu le muezzin appelant du haut de la mosquée.
— L’école des petits garçons. Tous des planches avec écriture arabe. Le mot table de la loi, et toutes les indications antiques sur la manière d’écrire montrent que c’étaient des tables de bois. Les encriers et les pantoufles devant la porte.
Mardi 21 février. — La noce juive[175]. Les Maures et les Juifs à l’entrée. Les deux musiciens. Le violon, le pouce en l’air, le dessous de l’autre main très ombré, clair derrière, le haïjck sur la tête, transparent par endroits ; manches blanches, l’ombre au fond. Le violon ; assis sur ses talons et la gélabia. Noir entre les deux en bas. Le fourreau de la guitare sur le genou du joueur ; très foncé vers la ceinture, gilet rouge, agréments bruns, bleu derrière le cou. Ombre portée du bras gauche qui vient en face, sur le haïjck sur le genou. Manches de chemise retroussées de manière à laisser voir jusqu’au biceps ; boiserie verte ; à côté verrue sur le cou, nez court.
A côté du violon, femme juive jolie ; gilet, manches, or et amarante. Elle se détache moitié sur la porte, moitié sur le mur. Plus sur le devant, une plus vieille avec beaucoup de blanc qui la cache presque entièrement. Les ombres très reflétées, blanc dans les ombres.
Un pilier se détachant en sombre sur le devant. Les femmes à gauche étagées comme des pots de fleurs. Le blanc et l’or dominent et leurs mouchoirs jaunes. Enfants par terre sur le devant.
A côté du guitariste, le Juif qui joue du tambour de
basque. Sa figure se détache en ombre et cache une
partie de la main du guitariste. Le dessous de la tête
se détache sur le mur. Un bout de gélabia sous le guitariste.
Devant lui, les jambes croisées, le jeune Juif
qui tient l’assiette. Vêtement gris. Appuyé sur son
épaule un jeune enfant juif de dix ans environ.
Contre la porte de l’escalier, Prisciada ; mouchoir violâtre sur la tête et sous le cou. Des Juifs assis sur les marches ; vus à moitié sur la porte, éclairés très vivement sur le nez, un tout debout dans l’escalier ; ombre portée reflétée et se détachant sur le mur, reflet clair jaune.
En haut, les Juives qui se penchent. Une à gauche, nu-tête, très brune, se détachant sur le mur éclairé du soleil. Dans le coin, le vieux Maure à la barbe de travers : haïjck pelucheux, turban placé bas sur le front, barbe grise sur le haïjck blanc. L’autre Maure, nez plus court, très mâle, turban saillant. Un pied hors de la pantoufle, gilet de marin et manches idem.
Par terre, sur le devant, le vieux Juif jouant du tambour de basque ; un vieux mouchoir sur la tête ; on voit la calotte noire. Gélabia déchirée ; on voit l’habit déchiré vers le cou.
Les femmes dans l’ombre près de la porte, très reflétées.
21 février, le soir. — En sortant pour aller à la noce juive, les marchands dans leur boutique. Les lampes les unes au mur, le plus souvent pendues en avant à une corde, des pots sur une planche, des palancos. Ils prennent le beurre avec les mains et le mettent sur une feuille. En entrant dans la rue à droite, il y en avait un dont la lampe était cachée par un morceau de toile qui pendait de l’auvent.
Avant le dîner, en allant au jardin de Suède, les fusils pendus et le fourreau pendu à côté ; grande cruche à côté.
Le soir, toilette de la Juive. La forme de la mitre. Les cris des vieilles. La figure peinte, les jeunes mariées qui tenaient la chandelle pendant qu’on la parait. Le voile lancé sur la figure. Les filles sur le lit, debout.
Dans la journée, les nouvelles mariées contre le mur, leur proche parent en guise de chaperon. La mariée descendue du lit. Ses compagnes restées dessus. Le voile rouge. Les nouvelles mariées quand elles arrivaient dans leur haïjck. Les beaux yeux.
La venue des parents. Torches de cire ; les deux flambeaux peints de différentes couleurs. Tumulte. Figures éclairées. Maures confondus. La Juive tenue par les deux côtés ; un par derrière soutient la mitre.
En chemin, les Espagnols regardant par la fenêtre. Deux Juives ou Mauresques sur des terrasses se détachant sur le noir du ciel. — Donné à la fille de M. Hay le dessin de femme maure assise. — Les vieux Maures montés sur les pierres du chemin. Les lanternes. Les soldats avec des bâtons. Le jeune Juif qui tenait deux ou plusieurs flambeaux, la flamme lui montant dans la bouche.
Chez Abraham, les trois Juifs jouant aux cartes. —
Femmes près de la porte de la ville, vendant oranges,
branches de noisettes. Chapeaux de paille. — Paysans
tête nue, accroupis avec leurs pots de lait.
Vendredi 2 mars. — Promenade avec M. Hay. Dîné chez lui.
Le pied de côté dans l’étrier quelquefois.
Le drapeau dans son étui, et planté devant la tente.
La plaine, et la tribu rangée fuyant vers le sud. — Devant, demi-douzaine de cavaliers dans la fumée. Un homme plus en avant : burnous bleu très foncé. — En avant, nous tournant le dos, la ligne de nos soldats précédée du kaïd et des drapeaux.
La course de cinq ou six cavaliers. — Le jeune homme tête nue, cafetan vert pisseux. — Le presque nègre, bonnet pointu, cafetan bleu.
Les hommes éclairés sur le bord de côté. L’ombre des objets blancs très reflétée en bleu. Le rouge des selles et du turban presque noir.
Au passage du gué, les hommes grimpant, le cheval blanc de côté.
5 mars 1832. — 1er jour. Ahïn-El-Daliah. Parti à une heure de Tanger[176].
L’arrivée au campement. Montagnes sauvages et noires à droite, le soleil au-dessus. Marchant dans des broussailles de palmiers nains et des pierres ; toute la tribu rangée à gauche, couronnant la hauteur ; plus loin en suivant, les cavaliers sur le ciel ; les tentes plus loin.
Promenade dans le camp le soir, contraste des vêtements blancs sur le fond.
L’iman le soir appelant à la prière.
6 mars. — A Garbia.
Parti vers 7 ou 8 heures, monté une colline, le soleil à gauche ; montagnes très découpées les unes derrière les autres sur un ciel pur.
Trouvé diverses tribus. Coups de fusil en sautant en l’air, traversé une montagne (Lac-lao) très pittoresque. Pierres. Je me suis arrêté un moment.
— Hommes sous des arbres près d’une fontaine ; hommes à travers les broussailles.
Très belle vue au haut de la montagne, demi-heure avant le campement ; la mer à droite et le cap Spartel.
Courses de poudre dans la plaine avant la rivière. Les deux hommes qui se sont choqués : celui dont le cheval a touché du cul par terre. Un surtout à cafetan bleu noir et fourreau de fusil en sautoir ; plus tard un homme à cafetan bleu de ciel.
La tribu nous suivant ; désordre, poussière ; précédé
de la cavalerie. Courses de poudre : les chevaux
dans la poussière, le soleil derrière. Les bras retroussés
dans l’élan[177].
A notre descente de Lac-lao, à gauche, prés très verts ; montagne verte ; dans le fond, montagne bleu cru.
Au camp. Les soldats courant en confusion, le fusil sur l’épaule, devant la tente du pacha et se rangeant en ligne. Le pacha.
Les soldats venant, par quatre ou cinq, devant la tente du général de la cavalerie et s’inclinant. Ensuite tous en rang recevant par petits pelotons les ordres ; les autres se mettant accroupis en attendant leur tour.
Les tribus allant rendre hommage au pacha et menant des provisions.
7 mars. — A Teleta deï Rissana.
La plaine terminée par des oliviers très grands sur la colline. Nous avions déjeuné au bord de la rivière Aïacha.
— Homme au cafetan noir. Haïjck sur la tête noué sous le bras.
— Homme qui raccommodait quelque chose à sa
selle : turban sans calotte, burnous noir drapé derrière
en Romain, bottes très hautes, pièce jaune au
talon ; burnous sur la tête attaché par une corde ;
boutons à sa robe blanche.
— Nègre turban rouge et blanc.
— Les cinq lièvres pris dans la plaine.
— La rencontre avec l’autre pacha. Damas sur la croupe du pacha. Musique à cheval.
— La prière près de la tente du commandant.
— Les gens qui portent le plat de couscoussou dans un tapis ; moutons.
— Homme nu, et arrangeant son haïjck près du tombeau du saint.
— Arbres près d’un petit tas de pierres. Montagnes vertes avec terre jaune dans la distance.
— Passé la soirée avec Abou dans notre tente. Conversation sur les champs. La boîte à musique qui ne s’arrêtait point. Envie de rire.
Jeudi 8. — Atcassar-El-Kebir.
Pluie en partant. Monté une colline et entré dans un joli bois de chênes verts ; entré dans la plaine où l’armée de D. Sébastien a été défaite[178].
Traversé la rivière ; déjeuné. Jeu de poudre dans la plaine. — Montagne dans la demi-teinte.
Avant d’arriver à Alcassar, population, musique, jeux de poudre sans fin. Le frère du pacha donnant des coups de bâton et de sabre. Un homme perce la foule des soldats et vient tirer à notre nez. Il est saisi par Abou par le turban défait. Sa fureur. On l’entraîne, on le couche plus loin. Mon effroi. Nous courons ; le sabre était déjà tiré…
Sur le haut de la colline à gauche, étendards variés ; dessins sur des fonds variés, rouge, bleu, vert, jaune, blanc ; autres avec les fantassins bariolés.
— Les grandes trompettes à notre entrée à Alcassar.
Vendredi 9 mars. — Campé à Fouhouarat. Parti tard du campement d’Alcassar. Pluie. Entrée à Alcassar pour le traverser. Foule, soldats frappant à grands coups de courroies ; rues horribles ; toits pointus. Cigognes sur toutes les maisons, sur le haut des mosquées ; elles paraissaient très grandes pour les constructions. Tout en briques. Juives aux lucarnes.
Traversé dans un grand passage garni de hideuses boutiques, couvert en cannes mal assemblées.
Arrivés au bord de la rivière. Grands arbres (oliviers) au bord. Descente dangereuse.
Au milieu de la rivière, coups de fusil de l’un et de l’autre côté. Arrivés à l’autre bord, traversé pendant plus de vingt minutes une haie de tireurs assez menaçante. Coups de fusil aux pieds de nos chevaux. Homme à demi nu.
Arrivée du père du pacha, burnous violet, charmante
tournure ; petite bande de cachemire au-dessus
de son turban. Cheval gris.
Déjeuné dans les montagnes près d’une source. Pluie battante.
Trouvé l’autre pacha dans une plaine. Courses. Coups de fusil. Canaille.
— Homme renversé sur le dos et son cheval pardessus lui. Relevé à moitié mort ; remonté à cheval un instant après.
— Voracité des Maures ; le soir, Abraham nous le contait dans la tente.
Samedi 10 mars. — El-Arba de Sidi Eisa Bellasen.
Malade la nuit précédente. Nous avons été incertains si nous resterions à cause du temps. Les Juifs ne voulaient pas partir. Le soleil a paru.
Traversé la rivière Emda qui serpente en trois.
Fait une visite à Ben-Abou. Il avait un habit de drap blanc.
Il nous a dit que l’empereur courait quelquefois la poudre, avec vingt ou trente cavaliers qu’il désigne. Leurs chevaux passent la nuit en plein air, pluie, chaleur, et n’en sont que meilleurs. Il a mis des aromates dans le thé.
— L’homme qui a couru dans cette grande plaine avant d’arriver ; son bras découvert jusqu’à l’épaule et sa cuisse également découverte.
— Avant la rivière, dans une course, la selle du commandant de l’escorte du pacha a tourné ; il a perdu son turban.
Nous avons rencontré un autre second du pacha de la province.
Il fait un vent très froid, le ciel pur. — Nous sommes dans la province d’El-Garb, divisée en deux gouvernements.
— Des enfants nous ont jeté des pierres. On a envoyé arrêter le village. Ils n’en seront peut-être pas quittes pour cinquante piastres. Probablement les deux vaches données le soir à Mornay venaient de là.
Dimanche 11 mars. — A la rivière Sébou, au passage de El-Aïtem[179].
Depuis trois jours nous sommes suivis par un shérif de Fez, ami de Bias, qui veut absolument avoir un cadeau.
Quand les Maures veulent obtenir quelque chose, comme une grâce, de manière à n’être pas refusés, ils vont porter près de votre tente un mouton, même un bœuf comme présent, et l’égorgent en manière de sacrifice, et pour constater l’offrande. On est lié très fort par l’espèce d’obligation que cette action impose.
Le jour que nous avons campé à Alcassar, on est venu tuer trois moutons, l’un à la tente de Bias, le second à celle du caïd, le troisième à la nôtre, pour obtenir la grâce d’un homme accusé d’assassinat. Bias s’intéresse à l’affaire.
En attendant, il n’a été question toute la soirée, ce jour-là, que d’un pauvre Juif qui avait été bâtonné pour de l’eau-de-vie qu’il avait refusé de livrer à Lopez, l’agent français à Laroche, lequel devait probablement la donner au frère du caïd dans la tente de qui nous avons été le soir. On n’a voulu le relâcher que moyennant quatre piastres et dix onces pour le donneur de coups.
Le pacha et son frère avaient toujours un homme de chaque côté du cheval, marchant à côté et qui prennent le fusil quand ils viennent de courir.
Je n’ai pas parlé à Alcassar de la visite au pacha dans sa tente. La selle à sa droite, son sabre sur son matelas blanc, couvertures ; un homme à ses pieds dormant enveloppé dans un burnous noué par derrière.
— Presque toujours le derrière de la selle est dans l’ombre à cause des vêtements.
Le second du pacha n’ayant pas de bottes avait mis à une de ses jambes le fourreau de son fusil, un mouchoir à l’autre ; ils ont presque tous la jambe blessée par l’étrier.
Beau temps, rien de remarquable.
— Les hommes avec le fourreau du fusil sur la tête.
— Les chevaux se roulant au bord de la rivière.
— Le cheval blanc dans une course qui a glissé et a fait un écart. Le cheval ferré à froid, la corne coupée par devant.
Lundi 12 mars. — Sur les bords du fleuve Sébou. Passé le matin le Sébou. — Embarquement ridicule. Les chevaux se sauvant et roués de coups pour entrer dans les barques. Hommes nus chassant les chevaux devant eux.
Bias nous a dit en traversant avec nous qu’on ne faisait pas de ponts afin d’arrêter plus facilement les voleurs et de recevoir les taxes et d’arrêter les séditieux. C’est lui qui disait que le monde était divisé en deux, la Barbarie et le reste.
Hommes appuyés contre la barque et la poussant. Vieux soldat avec son cafetan bleu seulement.
Spectateurs sur le bord, les jambes pendantes. Lévriers, chevaux se roulant par terre.
Ennui extrême en attendant. Embarqué seulement vers une heure. Route le long du fleuve. Près d’arriver, jeux de poudre très beaux.
Homme en cafetan jaune d’or.
Le caïd ; turban à la mamelouk. — Son bourreau.
Un des chefs dans une course étant arrivé jusqu’à nous, Abou s’est mis au devant de lui et l’homme lui a déchiré un peu son manteau. Arrivé au campement, Abou a déchiré en pièces son manteau, voulant plutôt le brûler que de permettre que qui que ce soit pût en profiter. On lui a aussi cassé sa pipe. Il était furieux et intraitable pour les soldats.
— Le soir, après un dîner gai, descendu solitairement près des bords du fleuve Sébou. Beau clair de lune.
Mardi 13 mars. — A Sidi-Kassem.
Soleil très ardent. Route dans une plaine immense.
Mercredi 14 mars. — Zar Hône.
Parti par un beau soleil du matin. Côtoyé d’abord la petite rivière. Les figures éclairées de côté par le soleil levant. Montagnes nettes sur le fond blanc ; des étoffes et couleurs très vives.
Entré dans un défilé dans la montagne. Hommes et enfants en haïjck et nus en dessous. Marabouts. Descendu à travers des rochers plats jusqu’au bord d’un ruisseau et déjeuné.
Continué dans des défilés, mais plus larges, dans des sentiers au bord de fossés profonds. Parlé du voyage en Perse.
Vu une femme qui apportait à boire au commandant ; elle avait des agrafes.
Arrivés dans une plaine et vu de loin Zar Hône. Descendu au bord d’une jolie rivière. Les bords couverts de petits lauriers. Continué sur le flanc de la montagne au milieu des pierres et des ruines. En approchant de Zar Hône, vu des laboureurs ; la charrue. La fontaine vue de loin.
Jeudi 15 mars. — Meknez.
Parti matin, beau temps. La ville de Zar Hône avec ses fumées ; les montagnes à l’horizon à droite, à moitié couvertes de nuages. Entré dans les montagnes et, après quelque chemin, découvert la grande vallée dans laquelle est Meknez.
Arrêté après avoir passé une petite rivière. C’est la même que nous avons passé la veille et qui serpente. Lauriers roses.
Rencontré des cavaliers qui ont couru la poudre ; restés au grand soleil assez de temps.
Meknez était à notre gauche, et de loin nous voyons à droite en avant la garde de l’empereur sur une colline. Au bas de nous, dans la plaine, ils ont couru la poudre.
Traversé un ruisseau rapide au milieu de la confusion. Le pacha de Meknez et le chef du Mischoar étaient déjà venus à notre rencontre. Nous avons grimpé la colline. Rencontré le porteur de paroles de l’empereur, mulâtre affreux à traits mesquins : très beau burnous blanc, bonnet pointu sans turban, pantoufles jaunes et éperons dorés ; ceinture violette brodée d’or, porte-cartouches très brodé, la bride du cheval violet et or. Courses de la garde noire, bonnets sans turban. Très beau coup d’œil en regardant derrière nous cette quantité de figures bigarrées ou noires ; le blanc des vêtements terne sur le fond.
Ennuyeuse promenade, marchant derrière les
Mercredi 14 mars. — Zar Hône.
Parti par un beau soleil du matin. Côtoyé d’abord la petite rivière. Les figures éclairées de côté par le soleil levant. Montagnes nettes sur le fond blanc ; des étoffes et couleurs très vives.
Entré dans un défilé dans la montagne. Hommes et enfants en haïjck et nus en dessous. Marabouts.
(Fac-similé d’une page.)
à notre gauche ; à droite coups de fusil de l’infanterie. De temps en temps nous arrivions à des cercles formés d’hommes assis, qui se levaient à notre approche et nous tiraient au nez.
Un des ancêtres de l’empereur actuel devait faire prolonger jusqu’à Maroc la muraille qui passe des deux côtés sur le pont.
Vaches blanches sur toute cette colline. Figures de toute espèce, le blanc dominant toujours.
— Bel effet en montant, les drapeaux se détachant en terne sur l’azur le plus pur du ciel.
Une vingtaine de drapeaux à peu près passés le long du tombeau d’un saint. Palmier auprès. Bâti en briques. Porte de la ville très haute. Porcelaines variées, etc. Une fois entré à gauche, les cavaliers et les tentes sur les remparts.
— Entrée de la ville[180]. Les drapeaux inclinés sous la porte.
Dans l’intérieur de la porte, foule immense. La grande porte colossale.
Devant nous une rue. A gauche une longue et large place, et rangée en demi-cercle devant nous, l’infanterie, qui a fait feu ; la cavalerie derrière les fantassins. Populace derrière sur des tertres et sur les maisons.
Fait le tour de quelques remparts avant de rentrer. En passant par une porte, palmiers gigantesques à droite ; avant d’entrer dans une autre porte, côtoyé un rempart. Femmes en grand nombre sur un tertre à droite et criant.
Jeudi 22 mars. — Audience de l’empereur.
Vers neuf ou dix heures, partis à cheval précédés du caïd sur sa mule, de quelques petits soldats à pied et suivis de ceux qui portaient les présents. Passé devant une mosquée, beau minaret qu’on voit de la maison. Une petite fenêtre avec une boiserie.
Traversé un passage couvert par des cannes comme à Alcassar. Maisons plus hautes qu’à Tanger.
Arrivé sur la place en face la grande porte. Foule à laquelle on donnait des coups de corde et de bâton. Plaques de porte en fer garnies de clous.
Entré dans une seconde cour après être descendu de cheval et passé entre une haie de soldats ; à gauche, grande esplanade où il y avait des tentes et des soldats avec des chevaux attachés.
Entré plus avant après avoir attendu et arrivé dans une grande place où nous devions voir le roi.
De la porte mesquine et sans ornements sont sortis d’abord à de courts intervalles de petits détachements de huit ou dix soldats noirs en bonnet pointu qui se sont rangés à gauche et à droite. Puis deux hommes portant des lances. Puis le roi, qui s’est avancé vers nous et s’est arrêté très près[181]. Grande ressemblance avec Louis-Philippe, plus jeune, barbe épaisse, médiocrement brun. Burnous fin et presque fermé par devant. Haïjck par-dessous sur le haut de la poitrine et couvrant presque entièrement les cuisses et les jambes. Chapelet blanc à soies bleues autour du bras droit qu’on voyait très peu. Étriers d’argent. Pantoufles jaunes non chaussées par derrière. Harnachement et selle rosâtre et or. Cheval gris, crinière coupée en brosse. Parasol à manche de bois non peint ; une petite boule d’or au bout ; rouge en dessus et à compartiment, dessous rouge et vert[182].
Après avoir répondu les compliments d’usage et être resté plus qu’il n’est ordinaire dans ces réceptions, il a ordonné à Muchtar de prendre la lettre du roi des Français et nous a accordé la faveur inouïe de visiter quelques-uns de ses appartements. Il a tourné bride, après nous avoir fait un signe d’adieu, et il s’est perdu dans la foule à droite avec la musique.
La voiture qui était partie après lui était couverte en drap vert, traînée par une mule caparaçonnée de rouge, les roues dorées. Hommes qui l’éventaient avec des mouchoirs blancs longs comme des turbans.
Entré par la même porte ; là, remonté à cheval. Passé une porte qui menait à une espèce de rue entre deux grands murs bordés d’une haie de soldats de part et d’autre.
Descendu de cheval devant une petite porte à laquelle on a frappé quelque temps. Nous sommes entrés bientôt dans une cour de marbre avec une vasque versant de l’eau au milieu ; en haut, petits volets peints. Traversé quelques petites pièces avec des jeunes enfants, nègres pour la plupart et médiocrement vêtus. Sortis sur une terrasse d’un jardin. Portes délabrées, peintures usées. Trouvé un petit kiosque en bois non peint, une espèce de canapé bambou en menuiserie, avec une espèce de matelas roulé. À gauche rentrés par une porte mieux peinte. Très belle cour, avec fontaine au milieu ; au fond porte verte, rouge et or ; les murs en faïence à hauteur d’homme. Les deux faces donnant entrée dans des chambres avec péristyles de colonnes ; peintures charmantes dans l’intérieur et à la voûte ; faïence jusqu’à une certaine hauteur ; à droite lit un peu à l’anglaise, à gauche matelas ou lit par terre, très propre et très blanc ; dans l’angle à droite, psyché. Deux lits par terre. Joli tapis vers le fond. — Sur le devant natte jusqu’à l’entrée. Vu, de cette chambre, Abou et un ou deux autres appuyés contre le mur près de la porte d’entrée. — Filet au-dessus de la cour.
Dans la chambre en face, lit de brocart à l’européenne ; point d’autres meubles. Portière en drap relevée à moitié ; à gauche de la petite porte dans la cour rouge et vert, espèce de renfoncement avec une espèce de paysage ou miroir. — Des armoires peintes dans la chambre, dans l’ombre.
Dans le kiosque du jardin auquel on arrive par une espèce de treille portée de côté par des piliers verts et rouges. Autre jardin, jet d’eau devant une espèce de baraque en bois, dont la peinture était dégradée, dans laquelle il y avait un fauteuil bas et couvert, devant un bassin en brique à fleur de terre, devant lequel ils nous ont arrêtés pour jouir de notre admiration.
Le général en chef de la cavalerie, accroupi devant la porte des écuries. De cette porte-là en se retournant, bel effet ; le bas des murs blanchis.
Là nous retrouvâmes nos chevaux et la troupe encore sous les armes, puis nous fûmes dans un autre jardin plus agreste. Sortis par l’endroit où on met au vert les chevaux de l’empereur ; soldats et peuple nous accompagnent. L’enfant à la chemise pittoresque.
Vendredi 23 mars. — Sorti pour la première fois. La porte avec boiseries au-dessus.
Espèce de marché de fruits secs, poteries, cabanes en cannes adossées aux murs de la ville. Séparations en cannes dans les boutiques comme les treillages de jardins. Homme à l’ombre d’un chiffon sur deux bâtons. Porte fermée pour la prière. Hommes battant le mur de tapis en criant en mesure à un signal de l’un d’eux chaque fois.
Entré dans la juiverie. — Acheté des petits objets en cuivre. L’enfant à qui je donnais la main, l’homme qui a passé entre nous deux. — Au bazar ; ceinture.
Samedi 24. — Sorti pour aller à la juiverie. Homme en cafetan rouge dans le marché qui y conduit. Autre marchand de friture. Le portier de la juiverie en rouge.
Entré chez l’ami d’Abraham. Juifs sur les terrasses se détachant sur un ciel légèrement nuageux et azuré à la Paul Véronèse. — La jeune petite femme est entrée, a baisé les mains à nous tous. Les Maures mangeaient. Table peinte.
Le jeu des Juifs chez la mariée ; l’un d’eux était au milieu, un pied sur une vieille pantoufle et allongeant des coups de pied à ceux qu’il pouvait atteindre et qui lui donnaient d’affreux coups de poing.
On laisse, hiver comme été, les chevaux du roi en plein air ; seulement, pendant une quarantaine de jours des plus rigoureux, on leur met une couverture.
Muchtar, à qui on avait envoyé parmi ses présents une pièce de casimir blanc, en a envoyé hier chercher encore une aune, parce qu’il a compté sur deux habits.
L’empereur se fait apporter les présents destinés à ses ministres et choisit ce qui est à sa convenance.
Le 30, l’empereur nous a envoyé des musiciens juifs de Mogador[183]. C’est tout ce qu’il y a de mieux dans l’empire ; Abou est venu les entendre. Il a pris un petit papier dans son turban pour écrire nos noms. Mon nom ne lui a pas donné peu de peine à prononcer.
Cimetière juif.
Abraham nous disait que les maçons élevaient en général les murs sans cordeau entièrement d’instinct ; que tel ouvrier était incapable de refaire une chose qu’il avait faite avant.
1er avril. — Le matin, la cour où sont les autruches ; une d’elles a reçu un coup de corne de l’antilope ; embarras pour empêcher le sang de couler.
Sorti vers une heure. La porte de la ville au delà de la mosquée en sortant de la maison. Autre porte dans la rue.
Enfant avec des fleurs au bout de sa natte de cheveux.
Arrivé dans le marché, dans le passage obscur. Musulmans accroupis, éclairés vivement. Homme dans sa boutique, cannes derrière, couteau pendu.
Homme assis à gauche, cafetan orange, haïjck en désordre, qu’il rajustait. Noir nu et rajustant son haïjck.
Vue de la mosquée. Campagne, parties de murs peintes en jaune ; le bas en général est blanc, très propre à détacher les figures. — Petite mosquée peinte en jaune.
Chez le Juif qui m’a conduit sur les terrasses[184].
Femme assise brodant un habit de femme chez le chef des Juifs ; très vives couleurs de robes à la figure se détachant sur le mur blanc, l’enfant auprès.
La maison ruinée des Portugais. Vue du haut de la terrasse.
Autre côté. — Porte de la ville, murailles du quartier des Juifs.
Fontaine avant d’arriver à la grande place. Grande maison à gauche sur la grande place.
Corps de garde intérieur. — Intérieur de la cour.
— Porte dégradée par en bas ; tombeau de saint en descendant ; créneaux dentelés. — La rue en montant ; les hommes blancs sur les murs.
2 avril. — Biaz nous a envoyé demander une feuille de papier pour donner la réponse de l’empereur[185].
5 avril. — Parti de Meknez vers onze heures. La veille, travaillé beaucoup. — Grandes arcades contre le mur à gauche entre deux portes ; la même porte, en se retournant sur la grande place garnie de tôle.
Belle vallée à droite, à perte de vue.
Passé un pont moresque. Peintures effacées, la ville dans le fond.
Porte du marché pendant que nous marchandions du tabac. Ciel un peu nuageux. — Maison de Juifs, escalier. — Porte des marchands.
Plants d’oliviers. — Repassé la petite rivière aux lauriers-roses en deux endroits. Elle serpente beaucoup. Les femmes qui voyageaient courbées sur leurs chevaux ; celle qui était isolée du côté de la route pour nous laisser passer, un noir tenant le cheval. — Les enfants à cheval devant le père. — Les oliviers à droite et montant la montagne qui mène à Derhôon. En arrivant à Derhôon, le cheval de M. Desgranges[186] ; vingt des soldats se mirent sur lui, on a cherché à l’enlacer avec des cordes ; enfin les deux pieds de derrière pris, il cherchait à mordre. — Vu des tentes noires placées circulairement.
6 avril. — Au fleuve Sébou.
Traversé beaucoup de montagnes ; grandes places jaunes, blanches, violettes de fleurs ; le lieu où nous avons campé au bord du fleuve. Dans la journée, pendant que nous étions reposés avant d’arriver, rencontré un courrier qui nous apportait des lettres de France. Plaisir très vif.
7 avril. — A Reddat.
Passé le Sébou. Monté sur mon cheval, côtoyé le Sébou, eau fort agréable ; tentes à gauche, douars. Passage du Sébou. L’autruche.
À cheval et entré après déjeuner dans de belles montagnes. Descendu dans une superbe vallée avec beaucoup de très beaux arbres. Oliviers sur des rochers gris.
Passé la rivière de Wharrah, peu profonde ; très gros crapaud ; grande chaleur ensuite avant d’arriver au campement dans un bel endroit nommé Reddat, montagnes dans le lointain. Sorti le soir après le coucher du soleil. Vue mélancolique de cette plaine immense et inhabitée. Cris des grenouilles et autres animaux. Les musulmans faisaient leur prière en même temps.
Le soir, la querelle des domestiques.
8 avril. — À Emda.
Journée fatigante, ciel couvert et temps nerveux ; traversé beau et fertile pays, beaucoup de douars et tentes. Fleurs sans nombre de mille espèces formant les tapis les plus diaprés. Reposé et dormi auprès d’un creux d’eau.
Rencontré le matin un autre pacha qui allait à ses affaires avec des soldats ; nous avons eu au premier voyage son second qui était ici. La bride de son cheval couverte d’acier. — Abou a dîné avec nous.
9 avril. — À Alcassar-El-Kebir[187]
Montagnes, côtoyé un endroit où nous avions déjeuné au premier voyage dans un creux auprès d’une fontaine. Genêts odorants, montagnes bleues dans le fond. Quand nous avons découvert Alcassar, nous avons aperçu des soldats de Tanger campés au loin ; ils vont à Maroc. Ils étaient en ligne ; les nôtres en ont fait autant ; courses de poudre. Les chefs et soldats sont venus revoir leur chef, baisant leur main après avoir pris l’autre. Des soldats baisaient le genou.
Le lait offert par les femmes ; un bâton avec un mouchoir blanc ; d’abord le lait aux porte-drapeau qui ont trempé le bout du doigt ; ensuite au caïd et aux soldats.
Les enfants qui vont à la rencontre du caïd et lui baisaient le genou.
Le sabre dans la route ; se faire expliquer par Abraham.
10 avril. — Monté le cheval de M. Desgranges. Beau pays, montagnes très bleues, violettes à droite ; montagnes violettes le matin et le soir, bleues dans la journée ; tapis de fleurs jaunes, violettes avant d’arriver à la rivière de Wad-el-Maghazin.
Passé la rivière et déjeuné dans les mêmes broussailles ; entré dans la grande plaine où a été défait D. Sébastien ; à droite, très belles montagnes bleues ; à gauche, plaines à perte de vue, tapis de fleurs blancs, jaune clair, jaune foncé, violet.
Entré dans une forêt charmante de lièges ; lointain à gauche, fleurs. Descendu et remonté avant d’arriver au marché de Teleta deï Rissana où nous avions couché en venant ; petits lataniers sur la hauteur à gauche.
Repassé à l’entrée de la vallée étroite et tortueuse appelée le col du Chameau ; journée longue et fatigante.
11 avril. — Ahïn-El-Daliah.
Monté le cheval de Caddour, le mien étant malade ; revu les beaux oliviers sur le penchant d’une colline, observé les ombres que forment les étriers et les pieds, ombre toujours dessinant le contour de la cuisse et de la jambe en dessous. L’étrier sortant sans qu’on voie les courroies. L’étrier et l’agrafe du poitrail très blanc sans brillants, cheval gris, bride à la tête, velours blanc usé.
Masser les personnages en brun, quitte à éclaircir pour les détacher.
Déjeuné où nous avions déjeuné en venant au bord d’un ruisseau. En continuant, soldats à gauche se détachant sur le ciel, les hommes demi-teints, couleur charmante, les noirs, figures de chevaux bruns très marquées.
Selle avec poire à poudre, poitrail au pommeau, fourreau du fusil vert, tête de Michel-Ange. Couverture blanche.
Les femmes qui sont venues présenter le lait aux drapeaux et au caïd.
Repassé à l’endroit où nous avions campé la deuxième fois en venant, où la population avait commencé à paraître menaçante. Arrivé sur le haut, on voit le cap Spartel, la mer en descendant.
Vaste plaine marécageuse, très détrempée au premier voyage, très sèche à présent.
Drapeaux. Hommes éclairés par derrière, burnous transparent autour de la tête, de même que le pan qui couvrait le fusil.
Repassé une petite rivière très bourbeuse. C’est dans cet endroit que nous avons vu courir la poudre pour la première fois au premier voyage.
Commencé à monter la montagne où est la forêt de lièges. Source charmante à droite qui serpente depuis le haut, fleurs en profusion, rochers isolés comme des constructions à gauche. Harnais rouge en montant et pierres.
Vue superbe en se retournant.
Le lendemain 12 avril. — Partis d’Ahïn-El-Daliah avec le fils du pacha, escorté de chaque côté de deux hommes portant le fusil. Le sac de cheval passé au cou. L’infanterie le met quelquefois ainsi.
A moitié route, des femmes et des hommes ont mis devant lui un sabre ; se faire expliquer par Abraham.
Plus près de la ville, les enfants sont venus complimenter Abou, qui les interrogeait et leur donnait de l’argent.
Tanger. — Après le retour de Meknez.
Chez Abraham avec MM. de Praslin et d’Orsonville. — La fille avec un simple fichu sur la tête et sa toilette. — Les nègres qui sont venus danser au consulat et par la ville. Femme devant eux couverte d’un haïjck et portant un bâton avec un mouchoir au bout pour quêter. — Un accès de fièvre vers le 16 avril. — Le 20, promenade. Ma première sortie avec M. D… et M. Freyssinet à la Marine. Noir qui baignait un cheval noir ; le nègre aussi noir et aussi luisant.
Tanger, 28 avril. — Hier 27 avril, il est passé sous nos fenêtres une procession avec musique, tambours et hautbois. C’était un jeune garçon qui avait complété ses études premières et qu’on promenait en cérémonie ; il était entouré de ses camarades qui chantaient et de ses parents et maîtres. On sortait des boutiques et des maisons pour le complimenter. Lui était enveloppé dans un burnous.
Dans les occasions de détresse, les enfants sortent avec leurs tablettes d’école et les portent avec solennité. Ces tablettes sont en bois, enduites de terre glaise ; on écrit avec des roseaux et une sorte de sépia qui peut s’effacer facilement. Ce peuple est tout antique[188]. Cette vie extérieure et ces maisons fermées soigneusement : les femmes retirées. — L’autre jour querelle des marins qui ont voulu entrer dans une maison maure. Un nègre leur a jeté sa savate au nez.
Abou, le général qui nous a conduits, était l’autre jour assis sur le pas même de la porte ; il y avait sur le banc notre garçon de cuisine. Il n’a fait que s’incliner un peu de côté pour nous laisser passer. Il y a quelque chose de républicain dans ce sans-façon. Les grands de l’endroit vont se mettre dans un coin de la rue accroupis au soleil et causent ensemble ; on se juche dans quelque boutique de marchands. Ces gens-ci ont un certain nombre, et un petit nombre, de cas prévus ou possibles, quelques impôts, quelque punition dans une circonstance donnée ; mais tout cela sans l’ennui et le détail continus dont nous accablent nos polices modernes. L’habitude et l’usage antique règlent tout. Le même rend grâces à Dieu de sa mauvaise nourriture et de son mauvais manteau. Il se trouve trop heureux encore de les avoir.
Certains usages antiques et vulgaires ont de la majesté qui manque chez nous dans les circonstances les plus graves : l’usage des femmes d’aller le vendredi sur les tombeaux avec des rameaux qu’on vend au marché, les fiançailles avec la musique, les présents portés derrière les parents, le couscoussou, les sacs de blé sur les mules et sur les ânes, un bœuf, des étoffes sur des coussins.
Ils doivent concevoir difficilement l’esprit brouillon des chrétiens et leur inquiétude qui les porte aux nouveautés. Nous nous apercevons de mille choses qui manquent à ces gens-ci. Leur ignorance fait leur calme et leur bonheur ; nous-mêmes sommes-nous à bout de ce qu’une civilisation plus avancée peut produire.
Ils sont plus près de la nature de mille manières : leurs habits, la forme de leurs souliers. Aussi la beauté s’unit à tout ce qu’ils font. Nous autres, dans nos corsets, nos souliers étroits, nos gaines ridicules, nous faisons pitié. La grâce se venge de notre science.
VOYAGE EN ESPAGNE
Le 16 mai au soir, après une ennuyeuse quarantaine de sept jours, obtenu l’entrée à Cadix ; joie extrême.
Les montagnes à l’opposé de la baie très distinctes et de belle couleur. En approchant, les maisons de Cadix blanches et dorées sur un beau ciel bleu.
Cadix, vendredi 18 mai. — Minuit sonne aux Franciscains. Singulière émotion dans ce pays si étrange. Ce clair de lune ; ces tours blanches aux rayons de la lune.
Il y a dans ma chambre deux gravures de Debucourt : les Visites et l’Orange ; à l’une d’elles est inscrit : Publié le 1er jour du dix-neuvième siècle ; cela me fait souvenir que j’étais déjà du monde ! Que de temps depuis ma première jeunesse !
Promené le soir ; rencontré, chez M. Carmen, la signora Maria Josefa.
M. Gros Chamelier a dîné avec nous. C’est un homme de l’extérieur le plus doux qui n’a bu que de l’eau à son dîner. Comme il refusait de fumer au dessert, il nous a dit simplement que sa modération était une affaire de régime ; il y a plusieurs années, il en fumait trois ou quatre douzaines par jour, il buvait cinquante bouteilles d’eau-de-vie, et ne comptait pas les bouteilles de vin. Il y a quelque temps, malgré son régime, il s’est laissé aller à boire de la bière, il en a bu six ou huit bouteilles en moins de rien. Cet homme a été de même pour les femmes, avec lesquelles il a fait les plus grands excès. Il y a quelque chose de pur Hoffman dans ce caractère.
Singulière organisation de cet homme, qui a joui de toutes choses et à l’extrême. Il m’a dit que la privation du cigare lui avait plus coûté que tout le reste. Il rêvait continuellement qu’il était retourné à son ancienne habitude, qu’il se reprochait beaucoup d’avoir manqué à son régime et qu’il s’éveillait alors très content de lui. Quelle vie de jouissances a donc menée cet homme ! Ce vin et surtout ce tabac étaient pour lui d’une volupté indicible.
Vers quatre heures, au couvent des Augustins avec M. Angrand. Escaliers garnis de faïences. Le chœur des frères en haut de l’église et la pièce longue auparavant, avec tableaux ; même dans les mauvais portraits qui tapissent les cloîtres, influence de la belle école espagnole[189].
Samedi 19 mai. — Au couvent des Capucins. Le Père gardien en nous montrant son jardin nous dit de prendre des fleurs, sinon pour nous, au moins pour les dames. Il ne pensait pas que le jardin du couvent fût digne de notre visite, attendu que le vent avait gâté les pois.
En entrant, cour carrée très simple, images sur les murs et l’église à droite en face. La Vierge de Murillo : les joues parfaitement peintes et les yeux célestes.
L’église très obscure. La sacristie ; armoires de bois noirâtre, bancs, le petit jardin du Père gardien. — Le chœur derrière, corridor en continuant. Tableau de squelette couché à droite de la porte du corridor de l’infirmerie. Corridors à perte de vue, escaliers ; cartes de géographie sur les murs. Petite sculpture d’une Pietà incrustée dans le mur au-dessous d’une petite peinture d’un moine en extase en joignant les mains et contemplant le crucifix. — Cloître en bas, peintures au-dessus de chaque arceau ; la Mort au milieu des richesses de la terre ; le jardin.
Dimanche 20 mai. — Le matin, au couvent des Dominicains ; l’église très belle. — La cathédrale en ruine sans être achevée. Soleil du diable.
Séville, mercredi 23 mai. — Rapports avec les Maures[190]. — Grandes portes partout ; compartiments des plafonds et menuiserie. — Les jardins, chaussée en briques bordée de faïence, la terre plus bas. Murs crénelés ; énormes clefs.
Alcala. — La nuit : la lune sur l’eau mélancolique ; le cri des grenouilles ; la chapelle gothique moresque avant d’entrer dans la ville près de l’aqueduc.
Séville. — Le matin, la cathédrale : magnifique obscurité ; le Christ en haut sur le damas rouge ; la grande grille qui entoure le maître-autel ; le derrière de l’autel avec petites fenêtres et entrée d’un souterrain.
Arcades sur les maisons. La femme couchée à la porte de l’église : bras bruns sur le noir de la mantille et le brun de la robe. Caractère singulier venant de ce qu’on ne voit presque pas de blanc portant autour de la tête.
Promenade le soir ; terrasse qui me rappelle mon enfance à Montpellier[191].
Bords du Guadalquivir.
Le capucin en chaire ; fenêtres couvertes avec de la toile et des draperies de couleur.
Vendredi 25 mai. — M. Baron est venu me prendre de bonne heure. Monté sur la tour la Giralda, point de marches. Ses environs ressemblent à ceux de Paris ; dîné avec MM. Startley et Muller, et avec eux en voiture voir la Cartuja. Beau Zurbaran dans la sacristie, beaux tombeaux, arcanum derrière l’autel, cimetière, orangers. — Cour moresque, tableaux sur les murs et faïences avec bancs de faïence.
À midi, dessiné la signora Dolorès. — Avant aux Capucines ; sur leurs armes, les cinq plaies de Jésus, celle du milieu plus grande, et deux bras, l’un nu ; beaux Murillos ; entre autres, le saint avec la mitre et la robe noire donnant l’aumône. Le chapeau rose à une madone.
Le soir au cimetière.
En revenant des Capucines, longé les murailles ; double enceinte, — une plus basse en avant à six ou huit pieds environ.
Le soir chez M. Williams. — Mélancolica ; guitare. — En revenant, le soldat qui pinçait de la guitare devant le corps de garde. — Courts instants d’émotions diverses dans la soirée : la musique, etc… Le matin, dans la sacristie de la cathédrale, deux saintes de Goya.
Les chevaux conduits en troupe sur le pont, les hommes avec habits de peaux de mouton et culottes : cela ferait un tableau.
Le réfectoire des Chartreux[192]. — L’évêque ; chapeau vert.
Samedi 26. — Alcazar : Superbe style moresque différent des monuments d’Afrique. Le jardin remarquable et la galerie suspendue qui l’entoure en partie ; achevé l’étude de la mantille chez M. Williams.
Le fameux Romero, matador et professeur de tauromachie, ne faisait presque pas de mouvements pour éviter le taureau. Il savait l’amener devant le roi pour le tuer, et après lui avoir porté le coup, il se retournait à l’instant même pour saluer sans regarder derrière lui.
Le fameux Pepillo, très célèbre matador, fut tué à Madrid par un taureau ; il fut pris dans le côté par la corne ; il essaya vainement de se dégager en se soulevant de ses bras sur la tête même de l’animal qui le portait tout autour de l’arène et lentement de sorte que la corne entrait plus avant à chaque instant ; il le porta ainsi suspendu et déjà mort… Romero était inconsolable de n’avoir pas été présent ; il était persuadé qu’il l’aurait dégagé.
Dimanche 27. — Chez M. Williams le soir.
Danseurs : la petite qui levait la jambe, la plus grande très gracieuse. Au commencement de la soirée, ennui. Mme Forde, la sœur de M. Williams, m’a expliqué les paroles de l’air qu’elle m’a donné. Les danseurs m’ont expliqué les castagnettes. La jolie enfant qui se plaçait entre les jambes de M. D.
Mme Forde ; adieu à l’anglaise… Coquette ; j’y avais été le jour sans la trouver… ; j’avais erré dans les rues en amant espagnol ; rues couvertes de toiles.
Avant, dessiné dans une grande salle, près la cathédrale.
Dîné chez M. Startley et été au couvent de Saint-Jérôme avec ces messieurs ; le fameux Cevallos[193] y est. — Saint Jérôme de Torrigiani[194].
Lundi 28. — A la casa di Pilata[195]. Escalier superbe, faïence partout, jardin moresque.
Adieux à M. Williams et à sa famille, je ne puis quitter, probablement pour toujours, ces excellentes gens ; seul un instant avec lui ; son émotion.
Le bateau ; départ. — La dame en officier. — Bords du Guadalquivir, triste nuit. — Solitude au milieu de ces étrangers jouant aux cartes dans le sombre et incommode entrepont. — La dame qui retrousse son bras pour me montrer sa blessure.
Réveil désagréable et débarquement à Sanlucar.
Revenu en calessin avec la servante de l’hôtel de Cadix. — Pays désert ; l’homme à cheval avec sa couverture passée au cou.
1834
Sans date[196]. — Coucher de soleil. Ciel bleu, jaune clair près du soleil et les nuages voisins du soleil en une masse un peu molle, et supérieurement des flocons laineux ; lesquels, jaune clair du côté du soleil, et du reste, gris de perle jaunâtre poussière. S’élevant davantage plus loin du soleil, gris de perle moins jaune et laissant entrevoir le ciel qui paraît d’un bel azur, quoique clair ; les nuages d’en haut éclairés par-ci par-là sur le bord, comme si un léger voile couvrait le reste, laissant apercevoir leur brillant.
— Léda[197]. Son étonnement naïf en voyant le cygne se jouer dans son sein, autour de ses belles épaules nues et de ses cuisses éclatantes de blancheur. Un sentiment nouveau s’éveille dans son esprit troublé ; elle cache à ses compagnes son mystérieux amour. Je ne sais quoi de divin rayonne dans la blancheur de l’oiseau dont le col entoure mollement ses membres délicats et dont le bec amoureux et téméraire ose effleurer ses charmes les plus secrets. La jeune beauté troublée d’abord et cherchant à se rassurer en pensant que ce n’est qu’un oiseau. Ses transports n’ont pas de témoins. Couchée sous un ombrage frais au bord des ruisseaux qui réfléchissent ses beaux membres nus et dont le cristal effleure le bout de ses pieds, elle demande aux vents l’objet de son ardeur, qu’elle n’ose rappeler.
Sans date. — Sur l’autorité, les traditions, les exemples des maîtres. Ils ne sont pas moins dangereux qu’ils ne sont utiles ; ils égarent ou intimident les artistes ; ils arment les critiques d’arguments terribles contre toute originalité.
— C’est un singulier moyen d’encourager les arts que de donner permission aux mauvais ou médiocres artistes d’exposer trois tableaux et d’interdire aux gens de talent d’en exposer quatre.
1840
Sans date. — En tout objet la première chose à saisir pour le rendre avec le dessin, c’est le contraste des lignes principales. Avant de poser le crayon sur le papier, en être bien frappé. Dans Girodet, par exemple, cela se trouve bien en partie dans son ouvrage, parce qu’à force d’être tendu sur le modèle, il a attrapé à tort et à travers quelque chose de sa grâce, mais cela s’y trouve comme par hasard. Il ne reconnaissait pas le principe en l’appliquant. X…[198] me paraît le seul qui l’ait compris et exécuté. C’est là tout le secret de son dessin. Le plus difficile est comme lui de rappliquer au corps entier. Ingres l’a trouvé dans des détails des mains, etc. Sans artifices pour aider l’œil, il serait impossible d’y arriver, tel que de prolonger une ligne, etc., dessiner souvent à la vitre[199]. Tous les autres peintres, sans en excepter Michel-Ange et Raphaël, ont dessiné d’instinct, de fougue, et ont trouvé la grâce à force d’en être frappés dans la nature ; mais ils ne connaissaient pas le secret de X…[200] : la justesse de l’œil. Ce n’est pas au moment de l’exécution qu’il faut se bander à l’étude avec des mesures, des aplombs, etc. ; il faut de longue main avoir cette justesse qui, en présence de la nature, aidera de soi-même le besoin impétueux de la rendre. Wilkie[201] aussi a le secret. Dans les portraits, indispensable. Quand par exemple on a fait des ensembles avec cette connaissance de cause, qu’on sait pour ainsi dire les lignes par cœur, on pourrait en quelque sorte les reproduire géométriquement sur le tableau. Portraits de femme surtout ; il est nécessaire de commencer par la grâce de l’ensemble. Si vous commencez par les détails, vous serez toujours lourd. Témoin, ayez à dessiner un cheval fin, si vous vous laissez aller aux détails, votre contour ne sera jamais assez accusé.
— On a remarqué à Tripoli que les enfants provenant de noirs et de femmes blanches ne vivaient pas. Les enfants des Mameluks étaient dans le même cas. Avoir une idée des races.
Sans date. — Bien distinguer les différents plans en les circonscrivant respectivement ; les classer chacun dans l’ordre où ils se présentent au jour, discerner avant de peindre ceux qui sont de même valeur. Ainsi, par exemple, dans un dessin sur papier coloré, faire serpenter les luisants avec le blanc ; puis les lumières faites encore avec du blanc, mais moins vif ; ensuite celles des demi-teintes que l’on ménage avec le papier, ensuite une première demi-teinte avec le crayon, etc. Quand sur le bord d’un plan que vous avez bien établi, vous avez un peu plus de clair qu’au centre, vous prononcez d’autant plus son méplat ou sa saillie. C’est là surtout le secret du modelé. On aura beau mettre du noir, on n’aura pas de modelé. Il s’ensuit qu’avec très peu de chose on peut modeler.
1843
16 décembre. — Le poète se sauve par la succession des images, le peintre par leur simultanéité. Exemple : j’ai sous les yeux des oiseaux qui se baignent dans une petite flaque d’eau formée par la pluie, sur le plomb qui recouvre la saillie plate d’un toit ; je vois à la fois une foule de choses que le poète ne peut pas même mentionner, loin de les décrire, sous peine d’être fatigant et d’entasser des volumes, pour ne rendre encore qu’imparfaitement.
Notez que je ne prends qu’un instant : l’oiseau se plonge dans l’eau ; je vois sa couleur, le dessous argenté de ses petites ailes, sa forme légère, les gouttes d’eau qu’il fait voler au soleil, etc… Ici est l’impuissance de l’art du poète ; il faut que de toutes ces impressions il choisisse la plus frappante pour me faire imaginer toutes les autres.
Je n’ai parlé que de ce qui touche immédiatement au petit oiseau ou ce qui est lui ; je passe sous silence la douce impression du soleil naissant, les nuages qui se peignent dans ce petit lac comme dans un miroir, l’impression de la verdure qui est aux environs, les jeux des autres oiseaux attirés près de là, ou qui volent et s’enfuient à tire-d’aile, après avoir rafraîchi leurs plumes et trempé leur bec dans cette parcelle d’eau. Et tous les gestes gracieux, au milieu de ces ébats, ces ailes frémissantes, le petit corps dont le plumage se hérisse, cette petite tête élevée en l’air, après s’être humectée, mille autres détails, que je vois encore en imagination, si ce n’est en réalité. Et encore, en décrivant tout ceci[202]…
Sans date. — Il y a des lignes[203] qui sont des monstres : la droite, la serpentine régulière, surtout deux parallèles. Quand l’homme les établit, les éléments les rongent. Les mousses, les accidents rompent les lignes droites de ses monuments. Une ligne toute seule n’a pas de signification ; il en faut une seconde pour lui donner de l’expression. Grande loi. Exemple : dans les accords de la musique une note n’a pas d’expression, deux ensemble font un tout, expriment une idée.
Chez les anciens, les lignes rigoureuses corrigées par la main de l’ouvrier. Comparer des arcs antiques avec ceux de Percier et Fontaine[204]… Jamais de parallèles dans la nature, soit droites, soit courbes.
Il serait intéressant de vérifier si les lignes régulières ne sont que dans le cerveau de l’homme. Les animaux ne les reproduisent pas dans leurs constructions, ou plutôt dans les ébauches de régularité que présentent leurs ouvrages, comme le cocon, l’alvéole. Y a-t-il un passage qui conduit de la matière inerte à l’intelligence humaine, laquelle conçoit des lignes parfaitement géométriques ?
Combien d’animaux en revanche qui travaillent avec acharnement à détruire la régularité ! L’hirondelle suspend son nid sous les sophites du palais, le ver trace son chemin capricieux dans la poutre. De là le charme des choses anciennes et ruinées. Ce qu’on appelle le vernis du temps : la ruine rapproche l’objet de la nature.
— Combien de livres qu’on ne lit pas parce qu’ils veulent être des livres[205] ! Le trop d’étendue, de longueur fatigue. Rien n’est plus important pour l’écrivain que cette proportion. Comme, contrairement au peintre, il présente ses idées successivement, une mauvaise division, trop de détails fatiguent la conception. Au reste, la prédominance de l’inspiration ne comporte pas l’absence de tout génie de combinaison, de même que la prédominance de la combinaison n’explique pas l’absence complète de l’inspiration. Alexandre procédait, selon l’expression de Bossuet, par grandes et impétueuses saillies. Il chérissait les poètes et n’avait que de l’estime pour les philosophes. César chérissait les philosophes et n’avait que de l’estime pour les poètes. Tous les deux sont parvenus au faîte de la gloire, le premier par l’inspiration étayée de la combinaison, le second par la combinaison étayée de l’inspiration. Alexandre fut grand surtout par l’âme et César par l’esprit.
— « … Le vrai mérite d’un bon prince est d’avoir un attachement sincère au bien public, d’aimer sa patrie et la gloire. Je dis la gloire, car l’heureux instinct qui anime les hommes du désir d’une bonne réputation est le vrai principe d’une action héroïque ; c’est le nerf de l’âme qui la réveille de la léthargie pour la porter aux entreprises utiles, nécessaires et louables. » (Frédéric.)
— « L’homme supérieur vit en paix avec tous les hommes, sans toutefois agir absolument de même. L’homme vulgaire agit absolument de même, sans toutefois s’accorder avec eux. Le premier est facilement servi et difficilement satisfait ; l’autre, au contraire, est facilement satisfait et difficilement servi. » (Confucius.)
1844
Sans date. — Article sur les Expositions annuelles ; sur les inconvénients d’exposer dans les anciennes galeries.
— Des accidents qui peuvent résulter pour les tableaux anciens.
— Autre article sur les vocations multiples des artistes anciens ; voir les Notes pendant mon voyage avec Villot, et lui en demander d’autres.
— Dialogues sur la peinture. Cette forme, quoique vieille, est peut-être la meilleure pour sauver la monotonie et donner du piquant. Elle permet aussi les suspensions, les réflexions de toute sorte, les descriptions, les allusions aux choses les plus variées ; elle peut servir aussi par le contraste des caractères des interlocuteurs.
— Comparaison entre Puget[206] et Michel-Ange (peut venir à propos du dessin de Michel-Ange). Extraire et citer le jugement de M. Émeric-David[207] dans les Éphémérides, in extenso. Cet article pourrait être une apologie de l’art français et une comparaison du mérite de nos maîtres avec ceux de l’Italie surtout, d’où émane, suivant les critiques, toute beauté : Lesueur, son caractère, sa naïveté angélique ; Poussin et sa gravité ; Lebrun, quoique inférieur, peut se comparer aux successeurs des Carrache ; n’a pas, à la vérité, le nerf de ceux-ci et la naïve imitation des Guerchin, mais bien supérieur aux Gortone[208], aux Solimène[209].
— Description de l’esquisse en marbre de l’Alexandre sur Bucéphale.
— Revoir l’ouvrage de Cochin[210] sur la composition des artistes français et étrangers.
21 juin. — De L’abus de l’esprit chez les Français. Ils en mettent partout dans leurs ouvrages, ou plutôt ils veulent qu’on sente partout l’auteur, et que l’auteur soit homme d’esprit et entendu à tout ; de là ces personnages de roman ou de comédie qui ne parlent pas suivant leurs caractères, ces raisonnements sans fin étalant de la supériorité, de l’érudition, etc. ; dans les arts de même. Le peintre pense moins à exprimer son sujet qu’à faire briller son habileté, son adresse ; de là, la belle exécution, la touche savante, le morceau supérieurement rendu… Eh ! malheureux ! pendant que j’admire ton adresse, mon cœur se glace et mon imagination reploie ses ailes[211].
Les vrais grands maîtres ne procèdent pas ainsi. Non, sans doute, ils ne sont pas dépourvus du charme de l’exécution, tout au contraire, mais ce n’est pas cette exécution stérile, matérielle, qui ne peut inspirer d’autre estime que celle qu’on a pour un tour de force. — Paul Véronèse — l’Antique. — C’est qu’il faut une véritable abnégation de vanité pour oser être simple, si toutefois on est de force à l’être ; la preuve, même dans les grands maîtres, c’est qu’ils commencent presque toujours par l’abus que je signale ; dans la jeunesse, où toutes leurs qualités les étouffent, ils donnent la préférence à l’enflure, à l’esprit… ils veulent briller plus que toucher, ils veulent qu’on admire l’auteur dans ses personnages ; ils se croient plats, quand ils ne sont que clairs ou touchants.
— Les auteurs modernes n’ont jamais tant parlé du duel que depuis qu’on ne se bat plus. C’est le ressort principal de leurs narrations, ils donnent à leurs héros une bravoure indomptable ; il semble que s’ils peignaient des poltrons, le lecteur aurait mauvaise idée de la vaillance de l’auteur.
Les héros de lord Byron sont tous des matamores, des espèces de mannequins, dont on chercherait en vain les types dans la nature.
Ce genre faux a produit mille imitations malheureuses.
Rien n’est plus facile cependant que d’imaginer une espèce d’être complètement idéal, que l’on décore à plaisir de toutes les qualités ou de tous les vices extraordinaires qui semblent être l’apanage des natures puissantes.
22 septembre — Il serait plus raisonnable de dire que ces hommes en qui le génie se trouvait uni à une grande faiblesse de constitution, ont senti de bonne heure qu’ils ne pouvaient mener de front l’étude et la vie agitée et voluptueuse comme le commun des hommes organisés à l’ordinaire, et que la modération dont ils ont été conduits à user pour se conserver, a été pour eux l’équivalent de la santé, et a même fini, chez plusieurs, par faire triompher leur tempérament débile, sans parler des charmes de l’étude qui offre des compensations.
— Muley-abd-el-Rliaman[212], sultan du Maroc, sortant de son palais, entouré de sa garde, de ses principaux officiers et de ses ministres.
— Contre la rhétorique. La préface d’Obermann et le livre lui-même. — Un peu de rhétorique dans cette préface, celle, bien entendu, qui n’est pas de Senancour[213].
La rhétorique se trouve partout : elle gâte les tableaux comme les livres. Ce qui fait la différence entre les livres des gens de lettres et ceux des hommes qui écrivent seulement parce qu’ils ont quelque chose à dire, c’est que dans ces derniers la rhétorique est absente ; elle empoisonne, au contraire, les meilleures inspirations des premiers.
À propos de cette même préface de George Sand, pourquoi ne me satisfait-elle pas ? D’abord, à cause de ce brin de rhétorique qui mêle à la chose même une manière ornée ou recherchée de l’exprimer. Peut-être, si l’auteur s’était moins occupé à faire un morceau d’éloquence et se fût davantage mis la tête dans les mains et bien en face de ses propres sentiments, il m’eût représenté une partie des miens ? J’admire ce qu’il dit, mais il ne me représente pas mes sentiments.
Autre question. N’est-ce pas le côté le plus désolant de cet ouvrage humain que cet incomplet dans l’expression des sentiments, dans l’impression qui résulte de la lecture d’un livre ? Il n’y a que la nature qui fasse des choses entières. En lisant cette préface, je me disais : Pourquoi ce point de vue, et pourquoi pas tel autre, ou pourquoi pas tous deux, ou pourquoi pas tout ce qui peut être dit sur la matière ? Une idée dont on part, en vous conduisant à une autre idée, vous écarte entièrement du point de vue d’ensemble primitif, c’est-à-dire de cette impression générale qu’on conçoit d’un objet. Je compare, pour m’expliquer mieux, la situation d’un auteur qui se prépare à peindre une situation, à exposer un système, à faire un morceau de critique, à celle d’un homme qui, du haut d’une éminence, aperçoit devant lui une vaste contrée remplie de bois, de ruisseaux, de prairies, d’habitations, de montagnes. S’il entreprend d’en donner une idée détaillée et qu’il entre dans un des chemins qui s’offriront devant lui, il arrivera ou à des chaumières, ou à des forêts, ou à quelques parties seulement de ce vaste paysage. Il n’en verra plus et négligera souvent les principales et les plus intéressantes, pour s’être mal engagé dès le début… Mais, me dira-t-on, quel remède voyez-vous à cela ? Je n’en vois point, et il n’en est point. Les ouvrages qui nous semblent les plus complets ne sont que des boutades. Le point de vue qu’on avait au commencement, et duquel tout le reste va découler, vous a peut-être frappé par son aspect le plus mesquin et le moins intéressant ! La verve par occasion ou la persistance à fouiller dans un sol infertile nous fera trouver des passages spéciaux ou vraiment beaux, mais vous n’avez, encore une fois, fait au lecteur qu’une communication imparfaite. Vous rougirez peut-être plus tard, en revoyant votre ouvrage et en méditant, dans de meilleures dispositions, ce qui était votre sujet, de voir combien ce sujet vous a échappé.
— Sardanapale[214].
Linge de la femme sur le devant : sur un ton local, gris blanc. Terre de Cassel ou noir de pêche, etc. — Ombres avec bitume, cobalt, blanc et ocre d’or.
Base de la demi-teinte des chairs, terre de Cassel et blanc.
Demi-teinte jaune de la chair, ocre et vert émeraude.
Ajouter aux tons d’ombre habituels sur la palette : Vermillon et ocre d’or.
Ocre et vert émeraude, laque et jaune, ou jaune indien et laque pour frottis ou repiqués.
Laque brûlée et blanc, demi-teinte de chair.
Ébaucher les chairs dans l’ombre avec tons chauds, tels que terre Sienne brûlée, laque jaune et jaune indien, et revenir avec des verts, tels que ocre et vert émeraude.
De même les clairs avec tons chauds, ocre et blanc, vermillon, laque jaune, etc. ; et revenir avec des violets tels que terre de Cassel et blanc, laque brûlée et blanc.
Ne pas craindre, quand le ton de chair est devenu trop blanc par l’addition de tons froids, de remettre franchement les tons chauds du dessous, pour les mêler de nouveau.
— Si on considérait la vie comme un simple prêt, on serait moins exigeant.
Nous ne possédons réellement rien ; tout nous traverse, la richesse, etc.
— À qui ai-je prêté le portrait de Fielding[215] ?
— On n’est jamais long, quand on dit exactement tout ce qu’on a voulu dire. Si vous devenez concis, en supprimant un qui ou un que, mais que vous deveniez obscur ou embarrassé, quel but aurez-vous atteint ? Assurément, ce ne sera pas celui de l’art d’écrire, qui est avant tout de se faire comprendre.
Il faut toujours supposer que ce que vous avez à dire est intéressant ; car s’il n’en était pas ainsi, peu importe que vous soyez long ou concis.
Les ouvrages d’Hugo[216] ressemblent au brouillon d’un homme qui a du talent : il dit tout ce qui lui vient.
— Sur la fausseté du système moderne dans les romans. C’est-à-dire cette manie de trompe-l’œil dans les descriptions de lieux, de costumes, qui ne donne au premier abord un air de vérité que pour rendre plus fausse ensuite l’impression de l’ouvrage, quand les caractères sont faux, quand les personnages parlent mal à propos et sans fin, et surtout quand la fable ajustée pour les amener et les faire agir ne présente que le tissu vulgaire ou mélodramatique de toutes les combinaisons usitées pour faire de l’effet. Ils sont comme les enfants, quand ils imitent la représentation des pièces de théâtre. Ils figurent une action telle quelle, c’est-à-dire absurde le plus souvent, avec des décorations formées de vraies branches d’arbres, qui représentent des arbres, etc.
Pour arriver à satisfaire l’esprit, après avoir décrit le théâtre de l’action ou l’extérieur des personnages comme le font Balzac et les autres, il faudrait des miracles de vérité dans la peinture des caractères et dans les discours qu’on prête aux personnages ; le moindre mot sentant l’emphase, la moindre prolixité dans l’expression des sentiments, détruisent tout l’effet de ces préambules, en apparence si naturels. Quand Gil Blas dit que le seigneur *** était un grand écuyer sec et maigre avec des manières précautionneuses, il ne s’amuse pas à me dire comment étaient ses yeux, son habit dans tous ses détails, ou s’il manque un de ces détails, il y en a un qui est tellement caractéristique, qu’il peint tout le personnage, à ce point que les peintures accessoires qu’on ajouterait à celles-là ne produiraient d’autre effet que d’empêcher l’esprit de saisir nettement le trait qui donne la physionomie.
INSPIRATION. — TALENT. — (Pour le Dictionnaire.)
Le vulgaire croit que le talent doit toujours être égal à lui-même et qu’il se lève tous les matins comme le soleil, reposé et rafraîchi, prêt à tirer du même magasin, toujours ouvert, toujours plein, toujours abondant, des trésors nouveaux à verser sur ceux de la veille ; il ignore que, semblable à toutes les choses mortelles, il a un cours d’accroissement et de dépérissement, qu’indépendamment de cette carrière qu’il fournit, comme tout ce qui respire (à savoir : de commencer faiblement, de s’accroître, de paraître dans toute sa force et de s’éteindre par degrés), il subit toutes les intermittences de la santé, de la maladie, de la disposition de l’âme, de sa gaieté ou de sa tristesse. En outre, il est sujet à s’égarer dans le plein exercice de sa force ; il s’engage souvent dans des routes trompeuses ; il lui faut alors beaucoup de temps pour en revenir au point d’où il était parti, et souvent il ne s’y retrouve plus le même. Semblable à la chair périssable, à la vie faible et attaquable par tous les côtés de toutes les créatures, laquelle est obligée de résister à mille influences destructives, et qui demandent ou un continuel exercice ou des soins incessants, pour n’être pas dévoré par cet univers qui pèse sur nous, le talent est obligé de veiller constamment sur lui-même, de combattre, de se tenir perpétuellement en haleine, en présence des obstacles au milieu desquels s’exerce sa singulière puissance. L’adversité et la prospérité sont des écueils également à craindre. Le trop grand succès tend à l’énerver, comme l’insuccès le décourage. Plusieurs hommes de talent n’ont eu qu’une lueur, qui s’est éteinte aussitôt que montée. Cette lueur éclate quelquefois dès leur apparition et disparaît ensuite pour toujours. D’autres, faibles et chancelants, ou diffus, ou monotones en commençant, ont jeté, après une longue carrière presque obscure, un éclat incomparable, tels que Cervantes ; Lewis[217], après avoir fait le Moine, n’a plus rien fait qui vaille. Il en est qui n’ont pas subi d’éclipsé, etc… — Le principal attribut du génie est de coordonner, de composer, d’assembler les rapports, de les voir plus justes et plus étendus.
— Très belle opposition à un homme d’une carnation chaude et jaunâtre : chemise blanc jaune, vêtement rouge, cire à cacheter ; manteau orange terre de Sienne brûlée.
Sans date. — Le Marché d’Arabes dont j’ai commencé une aquarelle en très large.
Soleil couchant, poudreux au fond, etc., dont il y a un bon dessin à la plume.
Les Acteurs de Tanger.
Le Kaïd goûtant le lait que lui offrent les paysans : un bon dessin à la plume.
Juliette sur le lit, la chambre pleine des parents et des amis, nourrice, etc.
Juives de Tanger. (Mlle Mars.)
Berlichingen arrivant chez les Bohémiens, jeunes filles, etc.; pour M. Colet.
La Femme capricieuse et Marphise.
Weislingen enlevé.
Juives de Tanger.
Le Jardin de Méquinez, la fontaine, etc.
Le Pacha de Laroche en route vu par derrière, matin : son bourreau ; cavaliers du fond.
Juives de Méquinez. Petit croquis avec lavis ; porte de cour, devant laquelle elles sont assises.
Juifs de Méquinez. Chez eux, éclairés par la porte.
La Cour de M. Marcussen.
L’antichambre qui y conduit : obscur.
La chambre en haut, chez M. Bell ; on voit la cour par une fenêtre en fer à cheval.
Juives à Tanger, s’appuyant sur le bord des terrasses pour regarder dans la rue.
La Scène du Courban, la porte de Tanger ; les marabouts montés sur le monument de la prière ; les cavaliers, etc.
Le Nègre de Tombouctou dansant au milieu de la famille d’Abraham.
Cuisine de Méquinez. Figures.
Le Barbier de Méquinez, dans le passage de l’entrée de la cour de notre maison.
Bain mauresque.
Les hommes couchés, après le bain, s’habillant et se peignant.
Les différents cafés à Oran.
Fontaine dans une rue à Alger.
Parmi les prisonniers qu’il délivre, après avoir massacré la garde, Amadis trouve une jeune personne couverte de haillons et attachée à un poteau. Dès qu’il l’eut délivrée, elle embrassa ses genoux.
Le Connétable de Bourbon et la Conscience.
Le Jeune Clifford portant le corps de son père.
Voir dans Ovide Énée changé en dieu, au bord de la mer, je crois, avec une divinité qui le lave des souillures mortelles.
Trajan donne audience à tous les peuples de l’Empire romain : diversité prodigieuse des présents qu’ils apportent ;… animaux.
Le corps de Léandre pleuré et porté dans les flots par les Néréides.
Sujet dans Lara : un chevalier portant le corps d’une femme enveloppée[218].
Sans date. — Pour nettoyer un tableau, moyen de M. Morelli : frotter d’huile de noix ; laisser un jour entier, ensuite enlever l’huile et achever avec de la mie de pain, pour l’enlever tout à fait.
— Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. La discussion s’engagea sur le mot « Obéissance ».
Ce mot-là est bon pour Paris surtout, où les femmes se croient en droit de faire ce qu’elles veulent. Les femmes ne s’occupent que de plaisir et de toilette. Si on ne vieillissait pas, je ne voudrais pas de femme. Ne devrait-on pas ajouter que la femme n’est pas maîtresse de voir quelqu’un qui ne plaît pas à son mari ? Les femmes ont toujours ce mot à la bouche : « Vous voulez m’empêcher de voir qui il me plaît. »
L’adultère, qui dans le Code civil est un mot immense, n’est par le fait qu’une galanterie, une affaire de bal masqué.
Les femmes ont besoin d’être contenues dans ce temps-ci : elles vont où elles veulent ; elles font ce qu’elles veulent ; elles ont trop d’autorité. Il y a plus de femmes qui outragent leurs maris que de maris qui outragent leurs femmes.
Il faut un frein aux femmes, qui sont adultères pour des clinquants, des vers ; Apollon, etc., les Muses…
1846
Sans date. — Toute licence étant donnée au poète pour l’unité de temps et de lieu, le système de Shakespeare est sans doute le plus naturel, car chez lui, les faits se succèdent comme dans l’histoire : les personnages annoncés, préparés ou non, entrent en scène au moment où ils sont nécessaires, n’y paraissent que quelques minutes s’il le faut, et sont supprimés par la même raison qui les a fait amener, c’est-à-dire par le besoin de l’action. Voilà bien la manière dont les choses se passent dans la nature, mais est-ce là l’art ? On pourrait dire que le système français, au contraire, a enjambé par-dessus les conditions nécessaires à l’art, et que pour être fidèle à ces conditions, il a renoncé à être naturel. Le système français est évidemment le résultat de combinaisons très ingénieuses, pour donner à l’impression plus de nerf, plus d’unité, c’est-à-dire quelque chose de plus artiste ; mais il en résulte que chez les plus grands maîtres, ces moyens sont petits et puérils, et nuisent, à leur manière, à l’impression, par la nécessité de ressorts artificiels, de préparations, etc… Ainsi ce système amène la régularité et une sorte de froide symétrie plutôt que l’unité. Shakespeare a au moins celle d’une vaste campagne remplie d’objets confus, il est vrai, où l’œil hésitera peut-être, au milieu de l’entassement des détails, à saisir un ensemble, mais néanmoins cet ensemble doit ressortir enfin, parce que les circonstances principales, grâce à la force de son génie, s’emparent fortement de l’esprit.
Qu’un temple grec, parfaitement proportionné dans toutes ses parties, saisisse l’imagination et la satisfasse complètement, rien de plus facile à concevoir, le thème de l’architecte est bien autrement simple que celui d’un poète dramatique : il n’y a là ni l’imprévu des événements, ni les caractères excentriques, ni les mouvements ondoyants des passions, pour compliquer de mille manières les effets à produire et la manière de les exprimer : je ne serais pourtant pas éloigné de croire que les inventeurs de l’Unité de temps et de lieu ne se soient figuré qu’au moyen de certaines règles, ils pourraient introduire dans une composition dramatique quelque chose de la simplicité d’impression que l’esprit ressent à la vue d’un temple grec. Rien ne serait plus absurde, d’après ce que je viens de dire de l’immense différence.
24 avril. — J’ai vu hier soir le Déserteur, de Sedaine : voici un genre qui semble bien près de la perfection de l’art dramatique, si ce n’est la perfection même. Il était encore réservé aux Français de modifier eux-mêmes le système grandiose, mais artificiel, de leurs grands génies, de Corneille, de Racine, de Voltaire. L’amour outré du naturel ou plutôt le naturel porté à l’extrême dans des détails accessoires, comme dans les drames de Diderot, de Sedaine, etc., n’empêche pas cette forme d’être un progrès réel : elle laisse une latitude immense pour le développement des caractères et des faits, puisqu’elle permet les changements de lieux et aussi de grands intervalles entre les actes ; et cependant la loi de progression dans l’intérêt, l’art avec lequel les faits et les caractères concourent à augmenter l’effet moral, y est bien supérieur à celui des plus belles tragédies de Shakespeare : on n’y trouve pas ces entrées et ces sorties éternelles, ces changements de décoration, pour apprendre un mot qui se dit à cent lieues de là, cette foule de personnages secondaires, au milieu desquels l’attention se fatigue, en un mot cette absence d’art. Ce sont de magnifiques morceaux, des colonnes, des statues même ; mais on est réduit à faire soi-même en imagination le travail destiné à les recomposer et à en ordonner l’ensemble. Il n’y a pas de drame de deuxième et même de troisième ordre, en France, qui ne soit bien supérieur, comme intérêt, aux ouvrages étrangers : cela tient à cet art, à ce choix dans les moyens d’effet, qui est encore une invention française.
La belle idée d’un Goethe, avec tout son génie, si c’en est un, d’aller recommencer Shakespeare trois cents ans après !… La belle nouveauté que ces drames remplis de hors-d’œuvre, de descriptions inutiles, et si loin, au demeurant, de Shakespeare, par la création des caractères et la force des situations. En suivant le système français des tragédies, il eût été impossible de produire l’effet de la dernière scène du Déserteur, par exemple. Ce changement de lieu de cinq minutes, pour montrer la scène où le déserteur est prêt à subir son arrêt, fait frémir, malgré l’attente où l’on est de voir arriver la grâce. Voilà un effet que nul récit ne pourrait suppléer. Goethe ou tel autre de cette école eût mis cette scène sans doute, mais nous en aurait montré vingt autres auparavant et d’un médiocre intérêt. Il n’aurait pas manqué de mettre en action la jeune fille demandant au roi la grâce de son amant : il eût peut-être trouvé que c’était introduire de la variété dans l’action. Il n’est même peut-être pas possible, avec ce système, de supprimer grand’chose dans le fait matériel ; sans cela, il n’y a plus de proportion entre les faits que l’on montre aux spectateurs et ceux qu’on ne fait que raconter. Ainsi ces sortes de pièces ne marchent que par saccades : c’est comme dans le roulis où vous n’avancez que tout à fait penché d’un seul côté, ou tout à fait penché de l’autre ; de là, fatigue, ennui pour le spectateur, forcé de s’atteler à la machine de l’auteur et de suer avec lui, pour se tirer de toutes ces évolutions de contrées et de personnages. Il est clair que, dans un drame anglais ou allemand, la dernière scène du Déserteur, où le théâtre change, pour produire un grand effet, venant après vingt ou trente changements d’un moindre intérêt, doit trouver le spectateur plus froid, plus difficile à remuer. Ce fait, dans le génie de Goethe, de n’avoir su tirer aucun parti de l’avancement de l’art à son époque, de l’avoir plutôt fait rétrograder aux puérilités des drames espagnols et anglais, le classe parmi les esprits mesquins et entachés d’affectation. Cet homme qui se voit toujours faire, n’a pas même le sens de choisir la meilleure route, quand toutes les routes sont tracées avant lui et autour de lui, et déjà parcourues admirablement. Lord Byron, dans ses drames, a su, du moins, se préserver de cette affectation d’originalité : il reconnaissait le vice du système de Shakespeare, et, tout en étant loin de comprendre le mérite des grands tragiques français, la justesse de son esprit lui montrait néanmoins la supériorité du goût et le sens de cette forme.
25 avril. — Partant pour Champrosay.
— Je lis dans le Meunier d’Angibault[219] la scène où un jeune homme du peuple refuse la main d’une marquise, sous le prétexte de la différence de caste… Ils ne considèrent pas (les utopistes) que le bourgeois n’était pas autrefois une puissance ; aujourd’hui il est tout.
22 mai. — À propos de la pensée précédente, à savoir, cette facilité de l’enfance à imaginer, à combiner, à propos de cette puissance singulière, j’ai été conduit à cette autre idée, à cette question que je me suis faite tant de fois : Où est le point précis où notre pensée jouit de toute sa force ? Voilà des enfants, Senancour et moi, s’il vous plaît, et sans doute beaucoup d’autres, qui sommes doués de facultés infiniment supérieures à celles des hommes faits. Je vois, d’un autre côté, des gens enivrés par l’opium ou le haschisch, qui arrivent à des exaltations de la pensée qui effrayent, qui ont des perceptions totalement inconnues à l’homme de sang-froid, qui planent au-dessus de l’existence et la prennent en pitié, à qui les bornes de notre imagination ordinaire paraissent comme celles d’un petit village que nous verrions perdu dans le lointain d’une plaine, quand nous sommes arrivés sur des hauteurs immenses et perdues au-dessus des nuages. D’un autre côté, nous voyons la simple inspiration journalière d’un artiste qui compose, conduire son esprit à une lucidité, à une force qui n’a rien de commun avec le simple bon sens de tous les moments, et cependant qui est-ce qui conduit et décide ordinairement tous les événements de ce monde, si ce n’est ce simple bon sens si insuffisant dans tant de cas ?
On m’opposera que, pour le train ordinaire de la vie, cette lumière naturelle, exempte d’intermittences, est suffisante ; mais il faudra avouer aussi que dans un nombre très considérable d’autres circonstances, ces hommes si raisonnablement suffisants aux exigences ordinaires de la vie, sont non seulement tout à fait insuffisants, mais peuvent être considérés comme des fous véritables (c’est ce qui fait les mauvais généraux, les mauvais médecins), et uniquement parce qu’ils sont dépourvus de la lumière supérieure… Cet homme raisonnable qui compose péniblement et avec de grands efforts de cervelle, de mauvais ouvrages, qui le rendent un objet de risée, est certainement aussi fou que celui qui se figure être Jupiter, ou qu’il va mettre le soleil dans sa poche ; au contraire, cet homme inspiré, dont la conduite semble le plus souvent à tous ces sages vulgaires celle d’un écervelé et d’un maniaque, devient, la plume à la main, l’interprète de la vérité universelle, prête aux passions leur langage, séduit, entraîne les cœurs, et laisse des traces ineffaçables dans la mémoire des hommes. Voyez les effets de l’éloquence ; voyez cette cause soutenue avec toute la raison imaginable par un homme froid et simplement doué de ce qu’on appelle le bon sens, et comparez à cette marche lente, à ces moyens ternes, ce que serait celle d’un esprit impétueux et lumineux tout à la fois, s’emparant de toutes ces ressources qui périssent dans des mains inertes, arrachant la conviction, portant le flambeau dans les entrailles de la question, forçant l’attention par le langage animé de la vérité ou de quelque chose qui en a l’air, à force de talent et de chaleur d’âme.
Comment se fait-il que dans une demi-ivresse, certains hommes, et je suis de ce nombre, acquièrent une lucidité de coup d’œil bien supérieure, dans beaucoup de cas, à celle de leur état calme ? Si, dans cet état, je relis une page dans laquelle je ne voyais rien à reprendre auparavant, j’y vois à l’instant, sans hésitation, des mots choquants, de mauvaises tournures, et je les rectifie avec une extrême facilité. Dans un tableau, de même : les incorrections, les gaucheries me sautent aux yeux ; je juge ma peinture comme si j’étais un autre que moi-même.
Ainsi voilà l’enfance, où les organes, à ce qu’il semble, sont imparfaits ; voilà le preneur d’opium, qui est pour l’homme de sang-froid un vrai fou, et puis encore celui qui a déjeuné plus que d’habitude et à qui nous n’irions pas demander conseil pour une affaire importante ; voilà, dis-je, des êtres qui semblent tout à fait hors de l’état commun, qui raisonnent, qui combinent, qui devinent, qui inventent avec une puissance, une finesse, une portée infiniment supérieure à ce que l’homme simplement raisonnable peut se flatter de tirer et d’obtenir de sa cervelle rassise. Gros, dans le temps de ses beaux ouvrages, déjeunait avec du vin de Champagne, en travaillant. Hoffmann a trouvé certainement dans le punch et le vin de Bourgogne ses meilleurs contes ; quant aux musiciens, il est reconnu d’un consentement universel que le vin est leur Hippocrène…
Quel est l’homme si froid au potage qui ne s’anime à l’entremets et n’arrive quelquefois aux fruits tout étonné lui-même, en étonnant les autres, de sa verve ? M. Fox n’arrivait guère à la tribune que dans un état d’ivresse ; Sheridan et quelques autres de même ; il est vrai que ce sont des Anglais. Il ne faudrait pourtant pas imiter ce fameux Suisse dont me parlait je ne sais qui, lequel, voyant les bons effets d’un coup de vin pris à propos dans certains cas de maladie, était devenu un ivrogne fieffé, pour se mettre à l’abri de toute espèce de maladies. On a vu beaucoup de musiciens qui, pour conserver leur dieu, c’est-à-dire leur bouteille, avaient été trouvés morts au coin des bornes.
Boissard[220] jouait, dans l’état d’ivresse du haschisch, un morceau de violon, comme cela ne lui était jamais arrivé, du consentement des gens présents.
Champrosay, 3 juillet[221]. — Extraits de Rousseau sur l’origine des langues.
L’homme qui fait un livre s’impose l’obligation de ne pas se contredire. Il est censé avoir pesé, balancé ses idées, de manière à être conséquent avec lui-même. Au contraire, dans un livre comme celui de Montaigne, qui n’est autre chose que le tableau mouvant d’une imagination humaine, il y a tout l’intérêt du naturel et toute la vivacité d’impressions rendues, exprimées aussitôt que senties. J’écris sur Michel-Ange : je sacrifie tout à Michel-Ange. J’écris sur le Puget : ses qualités seules réapparaissent ; je ne puis rien lui comparer. Tout ce qu’on peut exiger d’un écrivain, c’est-à-dire d’un homme, c’est que la fin de la page soit conséquente avec le commencement. Le défaut de sincérité que tout homme de bonne foi trouvera à tous les livres ou à presque tous, vient de ce désir si ridicule de mettre sa pensée du moment en harmonie avec celle de la veille. « Mon ami, tu étais hier dans une disposition à voir tout bleu ; aujourd’hui tu vois tout rouge, et tu te bats contre ton sentiment. » Mentem mortalia tangunt. Le plus beau triomphe de l’écrivain est de faire penser ceux qui peuvent penser ; c’est le plus grand plaisir qu’on puisse procurer à cette dernière classe de lecteurs. Quant à la prétention d’amuser ceux qui ne pensent pas, est-il une âme noble qui consente à s’abaisser à ce rôle de proxénète de l’esprit ?
Pour le peu que j’ai fait de littérature, j’ai toujours éprouvé que, contrairement à l’opinion reçue et accréditée, surtout parmi les gens de lettres, il entrait véritablement plus de mécanisme dans la composition et l’exécution littéraire que dans la composition et l’exécution en peinture. Il est bien entendu qu’ici mécanisme ne veut pas dire ouvrage de la main, mais affaire de métier, dans laquelle n’entre pour rien l’inspiration, soit dit en passant pour MM. les littérateurs, qui ne croient pas être des ouvriers, parce qu’ils ne travaillent pas avec la main. J’ajouterai même, pour ce qui me concerne, et eu égard au peu d’essais que j’ai faits en littérature, que dans les difficultés matérielles que présente la peinture, je ne connais rien qui réponde au labeur ingrat de tourner et retourner des phrases et des mots, soit pour éviter une consonance, une répétition, soit enfin pour ajouter à la pensée des mots qui n’en donnent pas une idée précise. J’ai entendu dire à tous les gens de lettres que leur métier était diabolique, qu’il faut leur arracher leur besogne, et qu’il y avait une partie ingrate dont aucune facilité ne pouvait dispenser. Lord Byron dit : « Le besoin décrire bouillonne en moi comme une torture dont il faut que je me délivre, mais ce n’est jamais un plaisir, au contraire ; la composition ni est un labeur violent. »… Je suis bien sûr que Raphaël, Rubens, Paul Véronèse, Murillo, tenant le pinceau ou le crayon, n’ont jamais rien éprouvé de semblable. Ils étaient sans doute animés d’une sorte de fièvre qui saisit les grands talents dans l’exécution, et ce n’est pas sans une agitation inquiète ; mais cette inquiétude, qui est l’appréhension de ne pas être aussi sublime que le comporte leur génie, est loin d’être un tourment ; c’est un aiguillon sans lequel on ne ferait rien, et qui même est le présage de la réalisation du sublime pour ces natures privilégiées. Pour un véritable peintre, les moindres accessoires présentent de l’amusement dans l’exécution, et l’inspiration anime les moindres détails.
19 juillet. — Voltaire dit très justement qu’une fois qu’une langue est fixée par un certain nombre de bons auteurs, il n’y a plus à la changer. La raison, dit-il, en est bien simple : c’est que si l’on change la langue indéfiniment, ces bons auteurs finissent par ne plus être compris. Cette raison est, en effet, excellente, car à supposer qu’au milieu des innovations du langage ou à leur faveur, il s’élève de nouveaux talents, leur acquisition sera d’un médiocre intérêt, s’il faut leur sacrifier l’intelligence des anciens chefs-d’œuvre. D’ailleurs, quel besoin a-t-on d’innover dans le langage ? Voyez tous ces hommes marquants de la même époque ; ne semble-t-il pas que la langue se diversifie sous leur plume ? Voyez dans un art voisin, la musique : ici sa langue, par force, n’est pas fixée ; il est malheureusement vrai que l’invention d’un instrument nouveau, que de certaines combinaisons harmoniques qui auraient échappé aux devanciers, vont faire, je n’ose dire avancer l’art, mais changer entièrement, pour l’oreille, la signification ou l’impression de certains effets. Qu’arrive-t-il de là ? C’est qu’au bout de trente ans, les chefs-d’œuvre ont vieilli, et ne causent plus d’émotion. Qu’est-ce que les modernes ont à mettre à côté des Mozart et des Cimarosa ?… Et à supposer que Beethoven, Rossini et Weber, les derniers venus, ne vieillissent pas à leur tour, faut-il que nous ne les admirions qu’en négligeant les sublimes maîtres, qui non seulement sont tout aussi puissants qu’eux, mais encore ont été leurs modèles, et les ont menés où nous les voyons ?
27 août. — Prêté à Villot[222] cinq dessins : le grand dessin du Vitrail de Taillebourg[223], le Mendiant à la pluie[224], la Fiancée de Lammermoor[225], et deux autres.
Prêté au Musée le tableau des Empereurs turcs.
17 septembre. — Prêté à Villot une aquarelle : Le Christ au jardin des Oliviers[226], figure seule, et le calque d’icelui.
— Un original se faisant nommer Sidi-Mohammed ben Serrour est arrivé, il y a quelque temps, à Marseille, venant du Maroc, et jouant l’homme d’importance. Le public la cru aussitôt chargé de quelque négociation relative au traité pendant avec le Maroc. Les autorités ont rivalisé de zèle pour l’accueillir comme un hôte distingué, le préfet l’a accablé de civilités ; on lui fit les honneurs de la parade ; et il se prêtait à tout cela avec une dignité insouciante et majestueuse sous laquelle on croyait entrevoir une grande profondeur diplomatique. Sur la fin de son séjour, il a donné à connaître qu’il accepterait avec plaisir un témoignage de souvenir de la part des Marseillais, et a plus particulièrement fait savoir que ce qu’il désirait était une montre. Aussitôt on a fait venir de Paris une montre de prix que le Marocain a daigné recevoir. Le lendemain, il était parti, sans qu’on sût de quel côté et sans révéler ces profondes combinaisons qui tenaient en éveil l’attention publique.
— J’établis que, en général, ce ne sont pas les plus grands poètes qui prêtent le plus à la peinture ; ceux qui y prêtent le plus sont ceux qui donnent une plus grande place aux descriptions. La vérité des passions et du caractère n’y est pas nécessaire. Pourquoi l’Arioste, malgré des sujets très propres à la peinture, incite-t-il moins que Shakespeare et lord Byron, par exemple, à représenter en peinture ses sujets ? Je crois que c’est, d’une part, parce que les deux Anglais, bien qu’avec quelques traits principaux qui sont frappants pour l’imagination, sont souvent ampoulés et boursouflés. L’Arioste, au contraire, peint tellement avec les moyens de son art, il abuse si peu du pittoresque, de la description interminable ; on ne peut rien lui dérober. On peut prendre d’un personnage de Shakespeare l’effet frappant, l’espèce de vérité pittoresque de son personnage, et y ajouter, suivant ses facultés, un certain degré de finesse ; mais l’Arioste !…
— Les Bretons croient que le singe est l’ouvrage du diable. Celui-ci, après avoir vu l’homme, création de Dieu, croit pouvoir, à son tour, créer un être à mettre en parallèle, mais il n’arrive qu’à une créature ébauchée et hideuse, emblème de l’impuissance orgueilleuse.
— Walter Scott dit, dans une lettre écrite peu avant sa mort, que la maladie dont il souffrait et qui l’entraîna au tombeau peu après, devait son origine à un excès de travail intellectuel. A l’occasion de sa fortune perdue, il lui arriva de travailler plus qu’il n’avait l’habitude, c’est-à-dire sept et huit heures. Il dit que quatre à cinq heures, tout au plus, de travail d’imagination sont suffisantes. On peut, dit-il, travailler au delà pour des compilations, etc.
Je crois éprouver que ce dernier me serait peut-être plus interdit que l’autre ; tout travail où l’imagination n’a pas de part m’est impossible.
23 septembre, en revenant de Champrosay. — Voici un exemple de la difficulté qu’il y a à s’entendre en ménage et à voir de la même manière. J’ai été visiter, à peu de distance de mon logis, une maison de campagne qui est à vendre. Le propriétaire est un directeur de spectacles ou de funambules enrichi, qui a fait là, depuis quatre à cinq ans qu’il y est installé, des folies de dépense : ponts chinois, rocailles, cabinets en verre de couleur avec sofas, lac encadré proprement dans du zinc, fruits magnifiques du reste et plantations dont il n’avait encore que le désagrément, puisqu’elles sont toutes fraîches. Mon homme ayant perdu sa femme se remarie : il a soixante ans ; il prend un jeune tendron de vingt ans qui n’a pas le sou, par-dessus le marché. Au bout de quatre mois, sa jeune et charmante épouse prend en dégoût la maison de campagne, et l’époux la met en vente.
Quand j’ai appris cette histoire, j’ai pensé tout de suite que le plus grand malheur de ce pauvre homme n’est pas ce qui lui est arrivé là ; il n’est qu’à la préface d’une longue histoire, et les regrets qu’il donnera à ses espaliers et à ses petits appartements arrangés pour ses vieux loisirs, seront bien vite des roses en comparaison des soucis qui l’attendent.
— Constable dit que la supériorité du vert de ses prairies tient à ce qu’il est un composé d’une multitude de verts différents. Ce qui donne le défaut d•intensité et de vie à la verdure du commun des paysagistes, c’est qu’ils la font ordinairement d’une teinte uniforme.
Ce qu’il dit ici du vert des prairies, peut s’appliquer à tous les autres tons.
— De l’importance des accessoires. Un très petit accessoire détruira quelquefois l’effet d’un tableau : les broussailles que je voulais mettre derrière le tigre de M. Roché[227] ôtaient la simplicité et l’étendue
des plaines du fond.1847
Mardi 19 janvier. — A dix heures et demie chez Gisors[228], pour le projet de l’escalier du Luxembourg. Ensuite à la galerie retrouver M. Masson[229] ; il renonce de lui-même à graver le tableau. Chez Leleux[230] ; causé d’un projet d’exposition. Temps superbe : gelée.
— Panthéon. Coupole de Gros ; hélas ! maigreur, inutilité.
Les pendentifs de Gérard que je ne connaissais pas : la Mort, la Gloire, avec Napoléon dans ses bras, et je ne sais quel Sauvage à genoux sur le devant ; la Patrie, une grande femme armée et environnée de crêpes près d’un tombeau, gens prosternés, une figure volante sur le tombeau, qui est la seule belle chose de tout cet ouvrage : belle tournure, beau mouvement, l’œil poché par je ne sais quel accident ; la Justice : il m’est impossible de me rappeler la moindre chose de ce tableau. La Mort : une femme soutient ou frappe, on ne sait lequel, un homme encore jeune, qui cherche à se retenir à un monument dont le caractère est incertain ; sa pose n’est pas mauvaise ; sur le devant, autres gens prosternés incompréhensibles.
Tout cela d’une couleur affreuse : des ciels ardoise, des tons qui percent les uns avec les autres, de tous côtés. Le luisant de la peinture achève de choquer et donne une maigreur insupportable à tout cela. Un cadre doré d’un caractère peu assorti à celui du monument, prenant trop de place pour la peinture, etc.
— Ensuite chez Vimont[231], mon élève. Vu un Prométhée, sur son rocher, avec des nymphes qui le consolent ; l’idéal manque.
De chez Vimont au Jardin des plantes, à travers un quartier que je n’ai jamais vu :… petits passages occupés par des brocanteurs ; toute une famille logée dans une échoppe, qui est à la fois la boutique, la cuisine, la chambre à coucher.
— Cabinet d’histoire naturelle public.
Éléphants, rhinocéros, hippopotames, animaux étranges ! Rubens l’a rendu à merveille. J’ai été pénétré, en entrant dans cette collection, d’un sentiment de bonheur. À mesure que j’avançais, ce sentiment augmentait ; il me semblait que mon être s’élevait au-dessus des vulgarités ou des petites idées, ou des petites inquiétudes du moment. Quelle variété prodigieuse d’animaux, et quelle variété d’espèces, de formes, de destination ! À chaque instant, ce qui nous paraît la difformité à côté de ce qui nous semble la grâce. Ici les troupeaux de Neptune, les phoques, les morses, les baleines, l’immensité du poisson, à l’œil insensible, à la bouche stupidement ouverte ; les crustacés, les araignées de mer, les tortues ; puis la famille hideuse des serpents, le corps énorme du boa, avec sa petite tête ; l’élégance de ses anneaux roulés autour de l’arbre ; le hideux dragon, les lézards, les crocodiles, les caïmans, le gavial monstrueux, dont les mâchoires deviennent tout à coup effilées et terminées à l’endroit du nez par une saillie bizarre. Puis les animaux qui se rapprochent de notre nature : les innombrables cerfs, gazelles, élans, daims, chèvres, moutons, pieds fourchus, têtes cornues, cornes droites, tordues en anneaux ; l’aurochs, race bovine ; le bison, les dromadaires et les chameaux ; les lamas, les cigognes qui y touchent ; enfin la girafe, celles de Levaillant, recousues, rapiécées ; mais celle de 1827 qui, après avoir fait le bonheur des badauds et brillé d’un éclat incomparable, a payé à son tour le funèbre tribut, mort aussi obscure que son entrée dans le monde avait été brillante ; elle est là toute raide et toute gauche, comme la nature l’a faite. Celles qui l’ont précédée dans ces catacombes avaient été empaillées, sans doute, par des gens qui n’avaient pas vu l’allure de l’animal pendant sa vie : on leur a redressé fièrement le col, ne pouvant imaginer la bizarre tournure de cette tête portée en avant, comme l’enseigne d’une créature vivante.
Les tigres, les panthères, les jaguars, les lions !
D’où vient le mouvement que la vue de tout cela a produit chez moi ? De ce que je suis sorti de mes idées de tous les jours qui sont tout mon monde, de ma rue qui est mon univers. Combien il est nécessaire de se secouer de temps en temps, de mettre la tête dehors, de chercher à lire dans la création, qui n’a rien de commun avec nos villes et avec les ouvrages des hommes ! Certes, cette vue rend meilleur et plus tranquille.
En sortant de là, les arbres ont eu leur part d’admiration, et ils ont été pour quelque chose dans le sentiment de plaisir que cette journée m’a donné… Je suis revenu par l’extrémité du jardin sur le quai. À pied une partie du chemin et l’autre dans les omnibus. J’écris ceci au coin de mon feu, enchanté d’avoir été, avant de rentrer, acheter cet agenda, que je commence un jour heureux. Puissé-je continuer souvent à me rendre compte ainsi de mes impressions ! J’y verrai souvent ce qu’on gagne à noter ses impressions et à les creuser, en se les rappelant.
— Statue de Buffon pas mauvaise, pas trop ridicule. Bustes des grands naturalistes français, Daubenton, Cuvier, Lacépède, etc., etc.
20 janvier. — Travaillé au tableau de Valentin[232] fait le fond le soir chez J…
M. Auguste m’a prêté une aquarelle, Cheval noir, plus deux volumes des Souvenirs de la Terreur ; il m’a rendu la petite galerie d’Alger (tablette) et un portemanteau.
En rentrant le soir, j’ai trouvé la pièce de Ponsard qu’il avait pris la peine d’apporter[233].
21 janvier. — Resté chez moi toute la journée. Le pastel du lion, pour les inondés. Composé trois sujets : le Christ portant sa croix, d’après une ancienne sépia ; le Christ au jardin des Oliviers, pour M. Roché[234] ; le Christ étendu sur une pierre, reçu par les saintes femmes.
Je lis les Souvenirs de la Terreur, de G. Duval[235]. Les frais de mise en scène, les conversations supposées, imaginées, pour donner de la couleur et de la réalité, ôtent toute confiance. La haine systématique contre la révolution se montre trop à découvert. L’historien cependant aurait à profiter dans cette lecture, non pour les petits faits qui y sont rapportés, mais il y verrait, à travers la partialité de l’écrivain, qu’il y a fort à rabattre de l’enthousiasme et de la spontanéité dans les mouvements que l’on admire le plus à cette époque. Ce qu’on y voit des rouages subalternes réduit à la proportion de complots ce qui paraît souvent dans l’histoire l’effet du sentiment national.
22 janvier. — Commencé et avancé beaucoup le pastel représentant le Christ aux Oliviers.
— Robert Bruce[236], le soir, avec Mme de Forget.
— Quand j’irai voir le tableau de Rubens, rue Taranne, aller chez Mme Cavé[237].
23 janvier. — Composé le Portement de croix. Continué le pastel du Christ.
— Dans le transept de Saint-Sulpice[238], sujets qui pourraient convenir : Assomption. — Ascension. — Moïse recevant les tables de la loi, le peuple au bas de la montagne, les anciens à mi-chemin, en bas et groupés, en s’étageant, armée, chevaux, femmes, camp. — Moïse sur la montagne, tenant ses bras élevés pendant la bataille. — Déluge. — Tour de Babel. — Apocalypse. — Crucifiement, les morts ressuscitant dans le bas de la composition ; soldats partageant les habits ; anges dans le haut, recueillant le précieux sang et retournant au ciel. — Dans le Portement de croix, sur le plan en dessous du Christ, saintes femmes montant péniblement.
Penser, pour ces tableaux, à la belle exagération des chevaux et des hommes de Rubens, surtout dans la Chasse de Soutman[239].
— L’Ange exterminant l’armée des Assyriens.
Quatre beaux sujets pour le transept de Saint-Sulpice seraient quant à présent :
1e Le Portement de croix. — Le Christ vers le milieu de la composition succombant sous le faix ; sainte Véronique, etc. ; en avant, les larrons montant ; plus bas, la Vierge, ses amies, le peuple et soldats.
2e En pendant, la Mise au sépulcre. La croix en haut, avec bourreaux, soldats emportant les échelles et instruments ; le corps des larrons resté sur la croix ; anges versant des parfums sur la croix du Christ, ou pleurant ; au milieu, le Christ porté par les hommes et suivi par les saintes femmes ; le groupe descendant vers une caverne où des disciples préparent le tombeau. Hommes levant la pierre ; anges tenant une torche. Le dessous de la montagne, effet de lumière, etc.
3e Apocalypse. — Le sujet déjà médité.
4e L’Ange renversant l’année des Assyriens. — L’armée montant dans les roches ; chevaux et chars renversés.
— Venu M. Wertheimber[240] ; il me demande la Course d’Arabes.
— Le soir, chez Deforge[241]. Vu Laurent Jan[242]. — Chez Pierret. Villot et sa femme.
Temps magnifique. Lune. Revenu à pied très tard, avec plaisir.
— Travaillé aux Femmes d’Alger[243].
— Villot me parle du papier transparent pour lithographies.
24 janvier. — Le soir, chez M. Thiers. Revu d’Aragon. Quand il n’y avait plus que quelques personnes, il nous a parlé du maréchal Soult. Il nous a dit qu’il mettait au défi de lui trouver une seule action d’éclat dans sa vie. Très laborieux, etc… Au camp de Boulogne, il fut un des instruments de l’élévation à l’Empire. On ne savait comment s’y prendre. L’armée, tout attachée qu’elle était au premier Consul, le Sénat, s’y seraient probablement refusés. On eut l’idée, et je pense que ce fut le général Soult, de faire signer une pétition à un corps désorganisé de dragons, lequel, étant mis à pied et désœuvré, était tout voisin de la démoralisation qu’entraîne l’oisiveté chez les soldats. Ils signèrent la pétition, qui fut présentée au Sénat comme le vœu de l’armée. Cambacérès était contre. Fouché, voulant également rentrer en grâce, se remua beaucoup. Le Sénat imita dans cette circonstance l’exemple du Sénat de Rome, dans le temps des empereurs… Ils s’empressaient de nommer à l’avance celui qu’ils voyaient sur le point de l’être par les soldats.
25 janvier. — L’influence des lignes principales est immense dans une composition.
J’ai sous les yeux les Chasses de Rubens ; une entre autres, celle aux lions, gravée à l’eau-forte par Soutman, où une lionne s’élançant du fond du tableau est arrêtée par la lance d’un cavalier qui se retourne ; on voit la lance plier en s’enfonçant dans le poitrail de la bête furieuse. Sur le devant, un cavalier maure renversé ; son cheval, renversé également, est déjà saisi par un énorme lion, mais l’animal se retourne avec une grimace horrible vers un autre combattant étendu tout à fait par terre, qui, dans un dernier effort, enfonce dans le corps du monstre un poignard d’une largeur effrayante ; il est comme cloué à terre par une des pattes de derrière de l’animal, qui lui laboure affreusement la face en se sentant percer. Les chevaux cabrés, les crins hérissés, mille accessoires, les boucliers détachés, les brides entortillées, tout cela est fait pour frapper l’imagination, et l’exécution est admirable. Mais l’aspect est confus, l’œil ne sait où se fixer, il a le sentiment d’un affreux désordre ; il semble que l’art n’y a pas assez présidé, pour augmenter par une prudente distribution ou par des sacrifices l’effet de tant d’inventions de génie.
Au contraire, dans la Chasse à l’hippopotame, les détails n’offrent point le même effort d’imagination ; on voit sur le devant un crocodile qui doit être assurément dans la peinture un chef-d’œuvre d’exécution ; mais son action eût pu être plus intéressante. L’hippopotame, qui est le héros de l’action, est une bête informe qu’aucune exécution ne pourrait rendre supportable. L’action des chiens qui s’élancent est très énergique, mais Rubens a répété souvent cette intention. Sur la description, ce tableau semblera de tout point inférieur au précédent ; cependant, par la manière dont les groupes sont disposés, ou plutôt du seul et unique groupe qui forme le tableau tout entier, l’imagination reçoit un choc, qui se renouvelle toutes les fois qu’on y jette les yeux, de même que, dans la Chasse aux lions, elle est toujours jetée dans la même incertitude par la dispersion de la lumière et l’incertitude des lignes.
Dans la Chasse à l’hippopotame, le monstre amphibie occupe le centre ; cavaliers, chevaux, chiens, tous se précipitent sur lui avec fureur. La composition offre à peu près la disposition d’une croix de Saint-André, avec l’hippopotame au milieu. L’homme renversé à terre et étendu dans les roseaux sous les pattes du crocodile, prolonge par en bas une ligne de lumière qui empêche la composition d’avoir trop d’importance dans la partie supérieure, et ce qui est d’un effet incomparable, c’est cette grande partie du ciel qui encadre le tout de deux côtés, surtout dans la partie gauche qui est entièrement nue, et donne à l’ensemble, par la simplicité de ce contraste, un mouvement, une variété, et en même temps une unité incomparables.
26 janvier. — Travaillé à la Course arabe.
Dîné chez M. Thiers. Je ne sais que dire aux gens que je rencontre chez lui, et ils ne savent que me dire. De temps en temps, on me parle peinture, en s’apercevant de l’ennui que me causent ces conversations des hommes politiques, la Chambre, etc.
Que ce genre moderne, pour le dîner, est froid et ennuyeux ! Ces laquais, qui font tous les frais, en quelque sorte, et vous donnent véritablement à dîner… Le dîner est la chose dont on s’occupe le moins : on le dépêche, comme on s’acquitte d’une désagréable fonction. Plus de cordialité, de bonhomie. Ces verreries si fragiles… luxe sot ! Je ne puis toucher à mon verre sans le renverser et jeter sur la nappe la moitié de ce qu’il contient. Je me suis échappé aussitôt que j’ai pu.
La princesse Demidoff y est venue. M. de Rémusat y dînait ; c’est un homme charmant, mais après bonjour et bonsoir, je ne sais que lui dire.
27 janvier. — Travaillé aux Arabes en course.
— Le soir, été voir Labbé, puis Leblond. Garcia[244] y était.
Parlé de l’opinion de Diderot sur le comédien. Il prétend que le comédien, tout en se possédant, doit être passionné. Je lui soutiens que tout se passe dans l’imagination. Diderot, en refusant toute sensibilité à l’acteur, ne dit pas assez que l’imagination y supplée. Ce que j’ai entendu dire à Talma explique assez bien les deux effets combinés de l’espèce d’inspiration nécessaire au comédien et de l’empire qu’il doit en même temps conserver sur lui-même. Il disait être en scène parfaitement le maître de diriger son inspiration et de se juger, tout en ayant l’air de se livrer ; mais il ajoutait que si, dans ce moment, on était venu lui annoncer que sa maison était en feu, il n’eût pu s’arracher à la situation : c’est le fait de tout homme en train d’un travail qui occupe toutes ses facultés, mais dont l’âme n’est pas, pour cela, bouleversée par une émotion.
Garcia, en défendant le parti de la sensibilité et de la vraie passion, pense à sa sœur, la Malibran. Il nous a dit, comme preuve de son grand talent de comédienne, qu’elle ne savait jamais comment elle jouerait. Ainsi, dans le Roméo, quand elle arrive au tombeau de Juliette, tantôt elle s’arrêtait, en entrant, contre un pilier, dans un abattement douloureux, tantôt elle se prosternait en sanglotant, devant la pierre, etc. ; elle arrivait ainsi à des effets très énergiques et qui semblaient très vrais, mais il lui arrivait aussi d’être exagérée et déplacée, par conséquent insupportable. Je ne me rappelle pas l’avoir jamais vue noble. Quand elle arrivait le plus près du sublime, ce n’était jamais que celui que peut atteindre une bourgeoise ; en un mot, elle manquait complètement d’idéal. Elle était comme les jeunes gens qui ont du talent, mais dont l’âge plus bouillant et l’inexpérience leur persuadent toujours qu’ils n’en feront jamais assez ; il semblait qu’elle cherchât toujours des effets nouveaux dans une situation. Si l’on s’engage dans cette voie, on n’a jamais fini : ce n’est jamais celle du talent consommé ; une fois ses études faites et le point trouvé, il ne s’en départ plus… C’était le propre du talent de la Pasta. C’est ainsi qu’ont fait Rubens, Raphaël, tous les grands compositeurs. Outre qu’avec l’autre méthode, l’esprit se trouve toujours dans une perpétuelle incertitude, la vie se passerait en essais sur un seul sujet. Quand la Malibran avait fini sa soirée, elle était épuisée : la fatigue morale se joignait à la fatigue physique, et son frère convient qu’elle n’eût pu vivre longtemps ainsi.
Je lui dis que Garcia, son père, était un grand comédien, constamment le même, dans tous ses rôles, malgré son inspiration apparente. Il lui avait vu, pour l’Othello, étudier une grimace devant la glace ; la sensibilité ne procéderait pas ainsi.
Garcia nous contait encore que la Malibran était embarrassée de l’effet qu’elle devait chercher pour le moment où l’arrivée imprévue de son père suspend les transports de sa joie, quand elle vient d’apprendre qu’Othello est vivant. Elle consultait à cet égard Mme Naldi, la femme du Naldi qui périt par l’explosion d’une marmite, et mère de Mme de Sparre[245]. Cette femme avait été une excellente actrice ; elle lui dit qu’ayant à jouer le rôle de Galatée dans Pygmalion, et ayant conservé pendant tout le temps nécessaire une immobilité tout à fait étonnante, elle avait produit le plus grand effet, au moment où elle fait le premier mouvement qui semble l’étincelle de la vie.
La Malibran, dans Marie Stuart, est amenée devant sa rivale Élisabeth par Leicester, qui la conjure de s’humilier devant sa rivale. Elle y consent enfin, et, s’agenouillant complètement, elle implore tout de bon ; mais outrée de l’inflexible rigueur d’Élisabeth, elle se relevait avec impétuosité et se livrait à une fureur qui faisait, disait-il, le plus grand effet. Elle mettait en lambeaux son mouchoir et jusqu’à ses gants ; voilà encore de ces effets auxquels un grand artiste ne descendra jamais. Ce sont ceux-là qui ravissent les loges et font à ceux qui se les permettent une réputation éphémère.
Le talent de l’acteur a cela de fâcheux qu’il est impossible, après sa mort, d’établir aucune comparaison entre lui et les rivaux qui lui disputaient les applaudissements de son vivant. La postérité ne connaît d’un acteur que la réputation que lui ont faite ses contemporains, et pour nos descendants, la Malibran sera mise sur la même ligne que la Pasta, et peut-être lui sera-t-elle préférée, si on tient compte des éloges outrés de ses contemporains. Garcia, en parlant de cette dernière, la classait dans les talents froids et compassés, plastiques, disait-il. Ce plastique, c’était l’idéal qu’il eût dû dire. À Milan, elle avait créé la Norma avec un éclat extraordinaire ; on ne disait plus la Pasta, mais la Norma ; Mme Malibran arrive, elle veut débuter par ce rôle ; cet enfantillage lui réussit. Le public, partagé d’abord, la mit aux nues, et la Pasta fut oubliée. C’était la Malibran qui était devenue la Norma, et je n’ai pas de peine à le croire. Les gens de peu d’élévation, et point difficiles en matière de goût, et c’est malheureusement le plus grand nombre, préféreront toujours les talents de la nature de celui de la Malibran.
Si le peintre ne laissait rien de lui-même, et qu’on fût obligé de le juger, comme l’acteur, sur la foi des gens de son temps, combien les réputations seraient différentes de ce que la postérité les fait ! Que de noms obscurs aujourd’hui ont dû, dans leur temps, jeter d’éclat, grâce au caprice de la mode et au mauvais goût des contemporains ! Heureusement que, toute fragile quelle est, la peinture, et à son défaut la gravure, conserve et met sous les yeux de la postérité les pièces du procès, et permet de remettre à sa place l’homme éminent peu estimé du sot public passager, qui ne s’attache qu’au clinquant et à l’écorce du vrai.
Je ne crois pas qu’on puisse établir une similitude satisfaisante entre l’exécution de l’acteur et celle du peintre. Le premier a eu son moment d’inspiration violente et presque passionnée, dans lequel il a pu se mettre, toujours par l’imagination, à la place du personnage ; mais une fois ses effets fixés, il doit, à chaque représentation, devenir de plus en plus froid, en rendant ses effets. Il ne fait en quelque sorte que donner chaque soir une épreuve nouvelle de sa conception première, et plus il s’éloigne du moment où son idéal, encore mal débrouillé, peut lui apparaître encore avec quelque confusion, plus il s’approche de la perfection : il calque, pour ainsi dire. Le peintre a bien cette première vue passionnée sur son sujet, mais cet essai de lui-même est plus informe que celui du comédien. Plus il aura de talent, plus le calme de l’étude ajoutera de beautés, non pas en se conformant le plus exactement possible à sa première idée, mais en la secondant par la chaleur de son exécution.
L’exécution, dans le peintre, doit toujours tenir de l’improvisation, et c’est en ceci qu’est la différence capitale avec celle du comédien. L’exécution du peintre ne sera belle qu’à la condition qu’il se sera réservé de s’abandonner un peu.
— Travaillé aux Arabes en course[246] et au Valentin.
28 janvier. — Que la nature musicale est rare chez les Français !
— Travaillé au Valentin et à la copie du petit portrait de mon neveu.
— Éclairs, tonnerre vers quatre heures, avec grêle violente.
— Dîner chez Mme Marliani[247] ; elle va passer un mois dans le Midi. J’ai revu chez elle Poirel, avec lequel je me suis plu. Chopin y était ; il m’a parlé de son nouveau traitement par le massage ; cela serait bien heureux. Le soir, un M. Ameilher a joué d’une guitare bizarre, qu’il a fait faire, suivant ses idées particulières. Il n’en tire pas, à mon avis, le parti nécessaire pour faire de l’effet, il joue trop faiblement. C’est la manière de tous les guitaristes de ne faire que de petits trilles, etc.
— Revenu avec Petetin[248], qui m’a parlé économie et placement d’argent. Il m’a dit qu’il est surprenant combien en peu de temps avec ces deux moyens, bien entendus, on peut augmenter sa fortune.
29 janvier. — Fatigué de ma soirée d’hier. Leleux et Hédouin[249] sont venus me voir.
Il est probable qu’en faisant souvent sans modèle, quelque heureuse que soit la conception, on n’arrive pas à ces effets frappants qui sont obtenus simplement dans les grands maîtres, uniquement parce qu’ils ont rendu naïvement un effet de la nature, même ordinaire. Au reste, ce sera toujours l’écueil ; les effets à la Prudhon, à la Corrège, ne seront jamais ceux à la Rubens, par exemple. Dans le petit saint Martin, de Van Dyck, copié par Géricault, la composition est très ordinaire, cependant l’effet de ce cheval et de ce cavalier est immense. Il est très probable que cet effet est dû à ce que le motif a été vu sur nature par l’artiste. Mon petit Grec (le Comte Palatiano) a le même accent[250].
On pourrait dire que, par le procédé contraire, on arrive à des effets plus tendres et plus pénétrants, s’ils n’ont pas cet air frappant et magistral qui emporte tout de suite l’admiration. Le cheval blanc de saint Benoît, de Rubens, semble une chose tout à fait idéale et fait un effet bien puissant.
— Dîné chez Mme de Forget.
31 janvier. — Travaillé aux Femmes d’Alger.
— Le soir, chez J… Elle a vu Vieillard[251] ; il est toujours inconsolable.
Elle me donne un article de Gautier, sur le Luxembourg, qui est par-dessus les toits.
2 février. — Le matin chez Müller. — Chez Gaultron[252]. — Dupré et Rousseau venus dans la journée ; ils m’ont répété beaucoup d’arguments en faveur de la fameuse société ; mais j’avais pris mon parti, et leur ai déclaré ma complète aversion pour le projet.
Que faire après une journée, ou plutôt une matinée pareille ? La sortie le matin et puis la venue de ces deux parleurs, au moment où j’eusse pu retrouver quelque disposition au travail, m’ont complètement abattu jusqu’au soir.
3 février. — Müller[253] m’a rendu ma visite prestement ;
l’aplomb de ce jeune coq est remarquable. J’avais critiqué certaines parties de ses tableaux avec
une réserve extrême ; je ne puis m’empêcher en
général de le faire, et je n’aime pas à affliger. Chez
moi, il m’a paru tout à son aise : « Ceci est bien, ceci
me déplaît. » Telles étaient les formes de son discours.
Hédouin est furieux. Il m’a parlé de l’extrême confiance en lui-même de Couture[254]. C’est assez le cachet de cette école, dans laquelle Müller se confond ; l’autre cachet, c’est cet éternel blanc partout et cette lumière, qui semble faite avec de la farine.
J’ai effacé, sur ce que m’ont dit ces messieurs, la fenêtre du fond des Marocains endormis[255].
— Henry m’apprend l’accouchement de sa sœur Claire.
— Travaillé aux Arabes en course : l’obscurité me force d’y renoncer.
Je commence alors à ébaucher le Christ au tombeau (toile de 100), le ciel seulement[256].
Rivet[257] est arrivé à quatre heures. J’ai été heureux de le voir, et sa prévenance m’a charmé. Nous avons été bientôt comme autrefois. Je le trouve changé, et ce changement m’afflige. Il est très satisfait de mon article sur Prud’hon[258].
Resté le soir chez moi. Situation d’esprit mélancolique, si je puis dire, et point triste. Les diverses personnes que j’ai vues aujourd’hui ont causé sans doute cet état.
J’ai fait d’amères réflexions sur la profession d’artiste ; cet isolement, ce sacrifice de presque tous les sentiments qui animent le commun des hommes.
4 février. — Au moment de partir pour la Chambre des députés, M. Clément de Ris[259] est venu : aimable jeune homme. Laurent Jan est survenu ; j’ai frémi en le voyant ramasser le gant aussitôt, sur quelques mots de l’interlocuteur qui, heureusement, est parti peu après. Laurent n’est pas resté non plus.
Arrivé à la Chambre à onze heures et demie. Vu, en arrivant, les voussures de Vernet[260] ; il y a un volume à écrire sur l’affreuse décadence que cet ouvrage montre dans l’art du dix-neuvième siècle. Je ne parle pas seulement du mauvais goût et de la mesquine exécution des figures coloriées, mais les grisailles et ornements sont déplorables. Dans le dernier village, et du temps de Vanloo, elles eussent encore paru détestables.
J’ai revu avec plaisir mon hémicycle[261] ; j’ai vu tout de suite ce qu’il fallait pour rétablir l’effet ; le seul changement de la draperie de l’Orphée a donné de la vigueur au tout.
Quel dommage que l’expérience arrive tout juste à l’âge où les forces s’en vont ! C’est une cruelle dérision de la nature que ce don du talent, qui n’arrive jamais qu’à force de temps et d’études qui usent la vigueur nécessaire à l’exécution.
— J’ai observé dans l’omnibus, à mon retour, l’effet de la demi-teinte dans les chevaux, comme les bais, les noirs, enfin à peau luisante : il faut les masser, comme le reste, avec un ton local, qui tient le milieu entre le luisant et le ton chaud coloré ; sur cette préparation il suffit d’un glacis chaud et transparent pour le changement de plan de la partie ombrée ou reflétée, et sur les sommités de ce même ton de demi-teinte, les luisants se marquent avec des tons clairs et froids. Dans le cheval bai, cela est très remarquable.
5 février. — J’ai passé toute la journée à me reposer et à lire dans ma chambre. Commencé Monte-Cristo : c’est fort amusant, sauf cependant les immenses dialogues qui remplissent les pages ; mais, quand on a lu cela, on n’a rien lu…
Après dîner, chez Pierret, où j’ai trouvé le jeune Soulié[262]. Pierret est toujours malade de son point de côté. Ensuite chez Alberthe[263] ; sa fille est alitée.
— Voici des titres d’ouvrages à avoir, que j’ai pris chez elle :
Moyen infaillible de conserver sa vue en bon état, jusqu’à une extrême vieillesse, traduit de l’allemand de M. G.-J. Beer, docteur en médecine de l’Université de Vienne.
Ifland : l’Art de prolonger la vie.
Confucius (dans le genre de Marc-Aurèle).
Marc-Aurèle, ancienne édition, traduite par Dacier.
L’Homme de cour, de Balthazar Gracian[264], traduit par Amelot de la Houssaye[265].
— Chez Pierret, nous avons parlé des facéties et coq-à-l’âne de M. de C…
— Je disais qu’en littérature, la première impression est la plus forte ; comme preuve, les Mémoires de Casanova, qui m’ont fait un effet immense, quand je les ai lus pour la première fois dans l’édition écourtée, en 1829. J’ai eu occasion depuis d’en parcourir des passages de l’édition plus complète, et j’ai éprouvé une impression différente.
Le jeune Soulié me dit que M. Niel[266], ayant lu le Neveu de Rameau[267], dans la traduction française faite d’après celle que Goethe avait faite en allemand, le préférait à l’original ; nul doute que ce ne soit l’effet de cette vive impression de certaines formes sur l’esprit qui, sur le même objet, n’en peut plus recevoir de semblables.
(Je relis ceci en 1857. — Je relis les Mémoires de Casanova, pendant ma maladie, je les trouve plus adorables que jamais ; donc ils sont bons.)
6 février. — Peu de travail, le matin. L’après-midi, ébauché entièrement les figures du Christ au tombeau. — Dîné et passé la soirée avec J…
Planet[268] est venu à quatre heures ; il a paru très frappé de mon ébauche ; il eût voulu la voir en grand. L’admiration sincère qu’il me montre me fait grand plaisir ; il est de ceux qui me réconcilient avec moi-même. Que le ciel le lui rende ! Le pauvre garçon manque tout à fait de confiance, et c’est dommage, car il montre des qualités supérieures.
7 février. — Malaise. Je n’ai rien fait de toute la journée.
Ce bon Fleury[269] est venu me voir avec un diable d’enfant qui touchait à tout. Il m’a donné sa recette pour imprimer les panneaux, cartons ou toiles : colle de peau et blanc d’Espagne, appliqués à la brosse et unis au papier de verre.
Le soir, quand je me délassais après le bain, que j’avais fait venir avant dîner, Riesener est venu. Resté une partie de la soirée : il m’a conté que Scheffer avait réuni les membres de la future société et s’était prononcé pour un système tellement exclusif, que peu s’en est fallu qu’il n’exclût tout le monde. Il a consterné l’auditoire.
Riesener me parle toujours de ses projets admirables de travail et de procédés propres à les faciliter.
8 février. — Excellente journée.
J’ai débuté par aller voir, rue Taranne, le tableau de Saint Just, de Rubens ; admirable peinture. Les deux figures des assistants, de son gros dessin, mais d’une franchise de clair-obscur et de couleur qui n’appartient qu’à l’homme qui ne cherche pas, et qui a mis sous les pieds les folles recherches et les exigences plus sottes encore.
Puis à la Chambre des députés. Travaillé à la femme portant le petit enfant, et l’enfant par terre ; puis à l’homme couché au-dessus du Centaure[270] ; je crois que j’ai fort avancé. Séance très longue. Revenu sans fatigue.
Pour compléter la journée, j’apprends en rentrant que Mme Sand est de retour et me l’a envoyé dire. Je suis heureux de la revoir.
Resté chez moi le soir ; j’ai eu tort. La journée du lendemain s’en est ressentie. J’aurais dû faire quelques pas dehors. L’air seul contribue peut-être à accélérer la circulation ; aussi, le lendemain, je n’ai rien fait. L’estomac dérangé commande en maître, mais en maître bien indigne de régner, car il remplit mal ses fonctions, et arrête tout le reste.
9 février. — Donc mal disposé.
— Venu Demay[271]. Pendant qu’il y était, M. Haussoullier[272]. Tous les jeunes gens de cette école d’Ingres ont quelque chose de pédant ; il semble qu’il y ait déjà un très grand mérite de leur part à s’être rangé du parti de la peinture sérieuse : c’est un des mots du parti. Je disais à Demay qu’une foule de gens de talent n’avaient rien fait qui vaille, à cause de cette foule de partis pris qu’on s’impose ou que le préjugé du moment vous impose. Ainsi, par exemple, de cette fameuse beauté, qui est, au dire de tout le monde, le but des arts ; si c’est l’unique but, que deviennent les gens qui, comme Rubens, Rembrandt, et généralement toutes les natures du Nord, préfèrent d’autres qualités ? Demandez la pureté, la beauté, en un mot, au Puget, adieu sa verve !… Développer tout cela. … En général, les hommes du Nord y sont moins portés ; l’Italien préfère l’ornement ; cela se retrouve dans la musique.
Vu Don Juan[273] le soir. Sensation pareille, en voyant la pièce. Le mauvais Don Juan (l’acteur) ! Est-ce l’exécution, le décousu qu’on met dans un ouvrage ancien ? Mais comme il grandit par le souvenir, et que, le lendemain, je me le suis rappelé avec bonheur ! Quel chef-d’œuvre de romantisme ! Et cela en 1785 ! L’acteur qui fait Don Juan ôte son manteau pour se battre avec le Père ; à la fin, ne sachant quelle contenance tenir, il se met à genoux devant le Commandeur ; je suis sûr qu’il n’y a pas deux personnes dans la salle qui s’en soient aperçues.
Je pensais à la dose d’imagination nécessaire au spectateur pour être digne d’entendre un tel ouvrage. Il me paraissait évident que presque tous les gens qui étaient là écoutaient avec distraction. Ce serait peu de chose ; mais les parties les plus faites pour frapper l’imagination ne les arrêtaient pas davantage. Il faut beaucoup d’imagination pour être saisi vivement au spectacle… Le combat avec le Père, l’entrée du Spectre frapperont toujours un homme d’imagination ; la plus grande partie des spectateurs n’y voient rien de plus intéressant que dans le reste.
10 février. — Hier 9, à quatre heures, j’ai été voir Mme Sand ; elle était souffrante. Revu sa fille et son gendre futur[274].
Aujourd’hui, il était plus de midi quand je suis parti pour le Palais-Bourbon. Il a fait un temps affreux : neige, gelée, gâchis. Il faut aller en voiture à mon travail, et on y reste si longtemps, qu’il y a des maladies à prendre. J’ai travaillé aux hommes du milieu.
Revenu de bonne heure et resté également très longtemps en voiture. Demeuré chez moi le soir, fatigué et souffrant.
— Ton local de la nymphe debout dans l’Orphée[275] : vert émeraude, vermillon et blanc ; plus de blancs dans les clairs.
Deuxième Nymphe : ton orangé et vert émeraude.
11 février. — Je devais retourner à la Chambre. J’écrirai à Henry[276], pour suspendre jusqu’à la semaine prochaine. Le froid est trop incommode. J’ai besoin de repos.
12 février. — Mis au net la composition de Foscari[277].
Essayé avec une toile de 80 ; je crois que cela ira ainsi.
— Vu Mme Sand à quatre heures et dîné chez Piron. Don Juan avec lui. J.-J… y était.
14 février. — Le Beau est assurément la rencontre de toutes les convenances… Développer ceci, en se rappelant le Don Juan que j’ai vu hier.
Quelle admirable fusion de l’élégance, de l’expression, du bouffon, du terrible, du tendre, de l’ironique ! chacun dans sa nature. Cuncta fecit in pondere numero et mensura. Chez Rossini, l’Italien l’emporte, c’est-à-dire que l’ornement domine l’expression. Dans beaucoup d’opéras de Mozart, le contraire n’a pas lieu, car il est toujours orné et élégant ; mais l’expression des sentiments tendres prend une mesure mélancolique qui»ne va pas indifféremment à tous les sujets. Dans le Don Juan, il ne tombe pas dans cet inconvénient ; le sujet, au reste, était merveilleusement choisi, à cause de la variété des caractères : D. Anna, Ottavio, Elvira sont des caractères sérieux, les deux premiers surtout ; chez Elvira, déjà on voit une nuance moins sombre. Don Juan tour à tour bouffon, insolent, insinuant, tendre même ; la paysanne, d’une coquetterie inimitable ; Leporello, parfait d’un bout à l’autre.
Rossini ne varie pas autant les caractères.
15 février. — Levé en mauvaise disposition, je me suis mis à reprendre l’ébauche du Christ au tombeau[278]. L’attrait que j’y ai trouvé a vaincu le malaise, mais je l’ai payé par une courbature le soir et le lendemain. Mon ébauche est très bien, elle a perdu de son mystère ; c’est l’inconvénient de l’ébauche méthodique. Avec un bon dessin pour les lignes de la composition et la place des figures, on peut supprimer l’esquisse, qui devient presque un double emploi. Elle se fait sur le tableau même, au moyen du vague où on laisse les détails. Le ton local du Christ est terre d’ombre naturelle, jaune de Naples et blanc ; là-dessus, quelques tons de noir et blanc glissés çà et là, les ombres avec un ton chaud.
Le ton local des nuances de la Vierge : un gris légèrement roussâtre, les clairs avec jaune de Naples et noir.
— Essayé Foscari, sur la toile de 80… Décidément, cela est trop noyé. J’essayerai sur toile de 60.
18 février. — Aujourd’hui été voir le Christ de Préault, à Saint-Gervais[279]. J’avais été au Luxembourg auparavant pour m’informer de la cause des refus d’entrée.
19 février. — T… me dit très justement que le modèle rabaisse son homme. Une personne sotte vous assotit. L’homme d’imagination, dans son travail pour élever le modèle jusqu’à l’idéal qu’il a conçu, fait aussi, malgré lui, des pas vers la vulgarité qui le presse et qu’il a sous l’œil[280].
— Vu deux actes des Huguenots… Où est Mozart ? Où est la grâce, l’expression, l’énergie, l’inspiration et la science ? le bouffon et le terrible… ? Il sort de cette musique tourmentée des efforts qui surprennent, mais c’est l’éloquence d’un fiévreux, des lueurs suivies d’un chaos.
Piron m’y a donné des nouvelles de Mlle Mars, qui est bien mal.
Charles[281] très affligé.
20 février. — Les moralistes, les philosophes, j’entends les véritables, tels que Marc-Aurèle, le Christ, en ne le considérant que sous le rapport humain, n’ont jamais parlé politique. L’égalité des droits et vingt autres chimères ne les ont pas occupés, ils n’ont recommandé aux hommes que la résignation à la destinée, non pas à cet obscur fatum des anciens, mais à cette nécessité éternelle que personne ne peut nier, et contre laquelle les philanthropes ne prévaudront point, de se soumettre aux arrêts de la sévère nature. Ils n’ont demandé autre chose au sage que de s’y conformer et de jouer son rôle à la place qui lui a été assignée au milieu de l’harmonie générale. La maladie, la mort, la pauvreté, les peines de lame, sont éternelles et tourmenteront l’humanité sous tous les régimes ; la forme, démocratique ou monarchique, n’y fait rien.
— Dîné chez M. Moreau[282] ; revenu avec Couture : il raisonne très bien, il est surprenant… Quel regard nous avons pour caractériser les défauts les uns des autres ! Tout ce qu’il m’a dit de chacun est très vrai et très fin, mais il ne tient pas compte des qualités ; surtout il ne voit et n’analyse, comme tous les autres, que des qualités d’exécution. Il me dit, et je le crois bien, qu’il se sent surtout propre à faire d’après nature. Il fait, dit-il, des études préparatoires, pour apprendre par cœur, en quelque sorte, le morceau qu’il veut peindre et s’y met ensuite avec chaleur : ce moyen est excellent à son point de vue. Je lui ai dit comment Géricault se servait du modèle, c’est-à-dire librement, et cependant faisant poser rigoureusement. Nous nous sommes récriés l’un et l’autre sur son immense talent !
Quelle force que celle qu’une grande nature tire d’elle-même ! Nouvel argument contre la sottise qu’il y a à y résister et à se modeler sur autrui.
21 février. — Aujourd’hui, fermé ma porte par excès d’ennui des visiteurs.
Repris les Comédiens arabes[283] de bonne heure, à cause du concert de Franchomme[284], où je devais aller à deux heures. En y allant, trouvé Mme Sand, qui m’a fait achever la route dans sa voiture. Je l’ai revue avec un vrai plaisir. Excellente musique. Quatuor d’Haydn, des derniers qu’il ait faits. Chopin me dit que l’expérience y a donné cette perfection que nous y admirons. Mozart, a-t-il ajouté, n’a pas eu besoin de l’expérience ; la science s’est toujours trouvée chez lui au niveau de l’inspiration. Quintettes de lui, déjà entendus chez Boissard. Le trio de Rodolphe de Beethoven : passages communs, à côté de sublimes beautés.
Résisté à dîner chez Mme Sand, pour rentrer et me reposer.
Le soir chez M. Thiers ; il n’y avait que Mme Dosne.
22 février. — Continué les Comédiens arabes et avancé beaucoup.
— Chez Asseline[285] à sept heures et demie, pour aller à Vincennes ; le prince paraît fort aimable[286].
Revenus de bonne heure ; nous étions avec Decamps et Jadin[287]. Ce dernier m’a dit que Mme D… remarquait avec mécontentement que je n’allasse pas la voir, et cela m’a beaucoup affligé, Asseline m’a présenté à sa femme : elle a l’air très simple et bon enfant.
Decamps était arrivé chez Asseline, pour aller chez le prince, avec une cravate noire fripée, à dessins, et un gilet de couleur fané ; on lui a prêté une cravate blanche. J’ai intercédé, mais inutilement, pour qu’il ne fumât pas dans la voiture, en allant à Vincennes.
J’ai rencontré, chez le prince, Ch. His[288], en grand sautoir de commandeur, l’Auxerrois, mon ancien camarade, bardé d’ordres turcs ; j’y ai vu Boulanger[289], L’Haridon[290], qui m’a l’air d’un fort aimable garçon.
23 février. — Travaillé aux Comédiens arabes[291]. Préault[292] est venu.
Chez Alberthe, le soir ; petite réunion. Je l’ai revue avec grand plaisir, cette chère amie ; elle était rajeunie dans sa toilette et a été infatigable toute la soirée ; sa fille aussi était très bien, elle danse avec grâce, surtout l’insipide polka. Vu M. de Lyonne et M. de la Baume. Cet homme ne vieillit pas.
Mareste[293] nous cite la lettre de Sophie Arnould au ministre Lucien : « Citoyen Ministre, j’ai allumé beaucoup de feux dans ma vie, je n’ai pas un fagot à mettre dans le mien ; le fait est que je meurs de faim. » Signé : « Une vieille actrice qui n’est pas de votre temps. »
« Mlle de Châteauvieux,… Mlle de Châteauneuf… Qu’est-ce, lui disait-on, que toutes ces demoiselles-là ? » Elle répondit : « Autant de châteaux branlants ! »
Au plus fort de la Terreur, Mlle Clairon[294] était retirée à Saint-Germain, et dans le dernier besoin. Un soir, on heurte violemment à sa porte ; elle ouvre après quelques hésitations ; un homme vêtu en charbonnier se présente : c’était son camarade Larive, qui dépose un sac contenant du riz ou de la farine et s’en va sans mot dire.
24 février. — Travaillé aux Arabes comédiens.
Le soir, chez M. le duc de Nemours : vu Pelletan[295], qui m’a fait des éloges de mon plafond, Philarète[296], Rivet. Désordre en sortant.
25 février. — Chez Mme de Forget, le soir. Mme Henri m’a joué d’infâme musique moderne, entre autres, comme régal, les deux morceaux que les voisines du jardin ont écorchés tout l’été.
26 février. — Dauzats[297] m’avait prévenu la veille que Mme la duchesse d’Orléans irait à l’Exposition de la rue Saint-Lazare et désirait m’y voir. Elle a été fort aimable pour moi.
En sortant, j’ai été rejoindre Villot, qui était venu le matin à une Exposition, rue Grange-Batelière : un Titien magnifique, Lucrèce et Tarquin, et la Vierge, de Raphaël, levant le voile… Gaucherie et magnificence du Titien ! Admirable balancement des lignes de Raphaël ! Je me suis aperçu tout à fait de ce jour que c’est sans doute à cela qu’il doit sa plus grande beauté. Hardiesses et incorrections que lui fait faire le besoin d’obéir à son style et à l’habitude de sa main. Exécution vue à la loupe : à petits coups de pinceau.
27 février. — Lassalle[298], puis Arnoux[299], sont venus. Ce dernier cherche à se caser, après le naufrage de l’époque. J’ai écrit à Buloz[300] pour lui.
Grenier[301] est venu faire une étude au pastel d’après le Marc-Aurèle. Nous avons parlé de Mozart et de Beethoven ; il trouve dans ce dernier cette verve de misanthropie et de désespoir, surtout une peinture de la nature, qui n’est pas à ce degré chez les autres ; nous lui comparons Shakespeare. Il me fait l’honneur de me ranger dans la classe de ces sauvages contemplateurs de la nature humaine. Il faut avouer que, malgré sa céleste perfection, Mozart n’ouvre pas cet horizon-là à l’esprit. Cela viendrait-il de ce que Beethoven est le dernier venu ? Je crois qu’on peut dire qu’il a vraiment reflété davantage le caractère moderne des arts, tourné à l’expression de la mélancolie et de ce qu’à tort ou à raison on appelle romantisme ; cependant, Don Juan est plein de ce sentiment.
Dîné chez Mme de Forget et passé la soirée avec elle. Elle souffre encore, et je voudrais bien la voir se soigner mieux.
Rêvé de Mme de L… Décidément il ne se passe presque pas de nuit que je ne la voie ou que je ne sois heureux près d’elle, et je la néglige bien sottement : c’est un être charmant !
28 février. — Tracé au blanc le Foscari et couvert la toile avec grisaille, noir de pêche et blanc ; ce serait une assez bonne préparation pour éviter les tons roses et roux. La grande copie de Saint Benoît[302], que j’ai faite ainsi, a une fraîcheur difficile à obtenir par un autre moyen ; ma composition me paraît offrir des difficultés de perspective, que je n’attendais pas.
En somme, journée mal employée, quoique je n’aie pas été interrompu.
Gaultron est venu un seul moment pour l’affaire de Bordeaux[303].
Dîné chez M. Thiers ; j’éprouve pour lui la même amitié et le même ennui dans son salon.
À dix heures avec d’Aragon chez Mme Sand ; il nous parle d’un ouvrage très intéressant, traduit par un M. Cazalis : La douloureuse Passion de N. S., par la Sœur Catherine Emmerich, extatique allemande. Lire cela. Ce sont des détails très singuliers sur la Passion, qui sont révélés à cette fille.
1er mars. — L’Afrique vaincue, nos soldats se jetant à la mer pour en prendre possession.
— La bataille d’Isly traitée poétiquement.
— L’Égypte soumise au génie de Bonaparte, etc.
— Je me suis mis, après mon déjeuner, à reprendre le Christ au tombeau[304]. C’est la troisième séance d’ébauche ; et, malgré un peu de malaise au milieu de la journée, je l’ai remonté vigoureusement et mis en état d’attendre une quatrième reprise.
Je suis satisfait de cette ébauche, mais comment conserver, en ajoutant des détails, cette impression d’ensemble qui résulte des masses très simples ? La plupart des peintres, et j’ai fait ainsi autrefois, commencent par les détails et donnent l’effet à la fin.
Quel que soit le chagrin que l’on éprouve à voir l’impression de simplicité d’une belle ébauche disparaître à mesure qu’on y ajoute des détails, il reste encore beaucoup plus de cette impression que vous ne parviendrez à en mettre quand vous avez procédé d’une façon inverse.
— Projeté toute la journée d’aller m’enterrer dans une loge en haut, au Mariage secret. Après dîner, le courage m’a manqué, et je suis resté lisant Monte-Cristo, qui ne m’a pas préservé du sommeil.
2 mars. — Le ton des rochers du fond, dans le Christ au tombeau.
Clairs ; terre d’ombre et blanc à côté de jaune de Naples et noir ; ce dernier ton ôte la teinte rose.
Autres clairs dorés exprimant de l’herbe : le ton d’ocre jaune et noir, modifié en sombre ou en clair.
Ombre : terre d’ombre et terre verte brûlée.
La terre verte naturelle se mêle également à tous les tons ci-dessus, suivant le besoin.
— Ce matin, s’est présenté un modèle qui m’a rappelé la nature de la pauvre Mme Vieillard (c’est Mme Labarre, rue Vivienne, 38 bis). Elle n’est pas bien et a cependant quelque chose de piquant ; c’est une nature originale.
Dufays est venu ; puis Colin[305]. Le premier des deux est frappé de la nécessité d’une révolution ; l’immoralité générale le frappe, il croit à l’avènement d’un état de choses où les coquins seront tenus en bride par les honnêtes gens.
Le jeune Knepfler est venu me montrer des esquisses et compositions.
— Mal disposé. J’ai essayé, très tard, de travailler au fond du Christ. Retravaillé les montagnes.
Un des grands avantages de l’ébauche par le ton et l’effet, sans inquiétude des détails, c’est qu’on est forcément amené à ne mettre que ceux qui sont absolument nécessaires. Commençant ici par finir les fonds, je les ai faits le plus simples possible, pour ne pas paraître surchargés, à côté des masses simples que présentent encore les figures. Réciproquement, quand j’achèverai les figures, la simplicité des fonds me permettra, me forcera même de n’y mettre que ce qu’il faut absolument. Ce serait bien le cas, une fois l’ébauche amenée à ce point, de faire autant que possible chaque morceau, en s’abstenant d’avancer le tableau en entier : je suppose toujours que l’effet et le ton sont trouvés partout. Je dis donc que la figure qu’on s’attacherait à finir parmi toutes les autres qui ne sont que massées, conserverait forcément de la simplicité dans les détails, pour ne pas la faire trop jurer avec les voisines, qui ne seraient qu’à l’ébauche. Il est évident que si, le tableau arrivé par l’ébauche à un état satisfaisant pour l’esprit, comme lignes, couleur et effet, on continue à travailler jusqu’au bout dans le même sens, c’est-à-dire en ébauchant toujours en quelque sorte, on perd en grande partie le bénéfice de cette grande simplicité d’impression qu’on a trouvée dans le principe ; l’œil s’accoutume aux détails qui se sont introduits de proche en proche dans chacune des figures et dans toutes en même temps ; le tableau ne semble jamais fini. Premier inconvénient : les détails étouffent les masses ; deuxième inconvénient : le travail devient beaucoup plus long.
— Bornot[306] le soir.
3 mars. — Ce mercredi, repris les rochers du fond du Christ et achevé l’ébauche de la Madeleine[307] : la figure nue du devant. Je regrette que cette ébauche manque un peu d’empâtement. Le temps lisse incroyablement les tableaux ; ma Sibylle[308] me paraissait déjà toute rentrée en quelque sorte dans la toile. C’est une chose à observer avec soin.
— Vu les Puritains[309] le mardi soir, avec Mme de Forget. Cette musique m’a fait grand plaisir. Le clair de lune de la fin est magnifique, comme ceux que fait le décorateur au théâtre. Ce sont des teintes très simples, je pense, du noir, du bleu et peut-être de la terre d’ombre, seulement bien entendu de plans, les uns sur les autres. La terrasse qui figure le dessus des remparts, ton très simple, avec rehauts très vifs de blanc, figurant les intervalles du mortier dans les pierres. La détrempe prête admirablement à cette simplicité d’effets, les teintes ne se mêlant pas comme dans l’huile. Sur le ciel très simplement peint, il y a plusieurs tours ou bâtiments crénelés, se détachant les uns sur les autres par la seule intensité du ton, les reflets bien marqués, et il suffit de quelques touches de blanc à peine modifié, pour toucher les clairs.
4 mars. — Ce matin, Villot venu ; je l’ai vu avec plaisir.
M. Geoffroy, de la part de Buloz. Villot ne lève jamais le siège, quand vient un étranger ; c’est incroyable d’indiscrétion.
— Retourné à la Chambre et pris la résolution de faire mon ménage de peintre moi-même ; je m’en suis fort bien tiré et j’y gagnerai de la liberté. C’était la onzième fois que j’y retournais, et le tableau est déjà bien avancé. Travaillé surtout à l’Orphée.
Ces ébauches avec le ton et la masse seule sont vraiment admirables pour ce genre de travaux sur parties comme des têtes, par exemple, préparées par une seule tache à peine modelée. Quand les tons sont justes, les traits se dessinent comme d’eux-mêmes. Ce tableau prend de la grandeur et de la simplicité ; je crois que c’est ce que j’ai fait de mieux dans le genre.
— Le soir, un instant chez Leblond, qui était venu après sa maladie.
Vieillard est venu aussi pendant la journée. J’ai bien regretté d’être absent.
5 mars. — Hier, en travaillant l’enfant qui est près de la femme de gauche dans l’Orphée, je me souvins de ces petites touches multipliées faites avec le pinceau et comme dans une miniature, dans la Vierge de Raphaël, que j’ai vue rue Grange-Batelière, avec Villot. Dans ces objets où l’on sacrifie au style avant tout, le beau pinceau libre et fier de Vanloo ne mène qu’à des à peu près. Le style ne peut résulter que d’une grande recherche, et la belle brosse est forcée de s’arrêter quand la touche est heureuse.
Tâcher de voir au Musée les grandes gouaches du Corrège : je crois qu’elles sont faites à très petites touches.
— Arnoux sort d’ici ce matin. Nous parlions des artistes qui se trouvent dans la position d’écrire sur leurs confrères, et il me rapporte le mot d’un M. Gabriel, vaudevilliste, qui dit à ce sujet : « On ne peut à la fois tenir les étrivières et montrer son derrière. »
— Je reçois une invitation pour dîner lundi chez le duc de Montpensier. Fatigue.
— Arnoux est venu me trouver ce matin ; il n’est pas agréé pour le Salon, à la Revue[310].
— Été à la Chambre. Travaillé avec un entrain médiocre, mais néanmoins avancé beaucoup.
— Le soir, fatigué et humeur affreuse ; je suis resté chez moi. En vérité, je ne suis pas assez reconnaissant de ce que le ciel fait pour moi. Dans ces moments de fatigue, je crois tout perdu.
— Reçu en rentrant une lettre de Mme R…, avec un bon de 300 francs payable le 15 ; elle m’écrit aussi pour me demander comment il faut placer les fenêtres de son atelier, que je n’ai jamais vu.
6 mars. — Reposé par ma nuit.
Rentré dans mon atelier, j’y ai retrouvé de la bonne humeur ; je regarde les Chasses de Rubens : celle de l’hippopotame, qui est la plus féroce, est celle que je préfère. J’aime son emphase, j’aime ses formes outrées et lâchées. Je les adore de tout mon mépris pour les sucrées et les poupées qui se pâment aux peintures à la mode et à la musique de M. Verdi.
Mme Leblond, avant-hier, ne pouvait rien comprendre à mon admiration pour les deux charmants dessins de Prud’hon qu’a son mari.
— Mme G*** me demande un dessin pour une loterie et m’a assuré de son amitié.
— J’écris enfin à M. Roché[311].
— J’ai fait quelques croquis d’après les Chasses de Rubens ; il y a autant à apprendre dans ses exagérations et dans ses formes boursouflées que dans des imitations exactes.
— Dîné chez Mme de Forget. Revu M. Gayrac et sa fille, qui a fait un peu de musique.
7 mars. — Pierret est arrivé vers une heure et demie, comme j’allais m’habiller pour aller au Conservatoire.
Arrivé et entendu le premier morceau, seul dans la loge ; Mme Sand n’arrivait pas. Elle est venue juste pour entendre le morceau d’Onslow[312], morceau fort ennuyeux. En général, ce concert ne m’a pas ravi ; un morceau de piano et basse seulement, de Beethoven, m’a plu médiocrement, et un quatuor de Mozart a conclu. J’ai dit à Mme Sand, au retour chez elle, que Beethoven nous remue davantage, parce qu’il est l’homme de notre temps : il est romantique au suprême degré. Dîné avec elle : elle a été fort aimable ; nous devions aller ensemble voir le Luxembourg et la Chambre des députés.
D’Arpentigny venu le soir et rentré très tard.
La vue du Jugement de Pâris, de Raphaël, dans une épreuve affreusement usée, m’apparaît sous un jour nouveau, depuis que j’ai admiré, dans la Vierge au voile, de la rue Grange-Batelière, son admirable entente des lignes. Cet intérêt, mis à tout, est aussi une qualité qui efface complètement tout ce qu’on voit après. Il n’y faut même pas trop penser, de peur de jeter tout par les fenêtres.
Est-ce que l’espèce de froideur que j’ai toujours sentie pour le Titien ne viendrait pas de l’ignorance presque constante où il est relativement au charme des lignes ?
8 mars. — Repris l’Othello toute la journée ; il est très avancé. A cinq heures, parti pour Vincennes. Dîné chez le Prince, en passant par chez M. Delessert[313]. Dîné entre deux hommes qui m’étaient inconnus ; mon voisin de droite est un vieux major d’artillerie, qui est à moitié sourd, par l’effet du canon, sans doute. Nous avons causé néanmoins. Vu Spontini, auquel j’ai été présenté[314].
9 mars. — Hoffmann a fait un article sur Walter Scott. M. Dufays est venu ce matin et me le dit entre autres choses. Voilà qu’il me demande une recommandation auprès de Buloz. Je lui ai dit que je venais de parler pour Arnoux. Hoffmann, m’a-t-il dit, ayant lu les premiers ouvrages de Walter Scott, en fut très frappé ; il se regardait comme incapable de ce beau calme, et peut-être ne se savait-il pas gré des qualités tout opposées qui forment son talent.
Paresse extrême et lassitude de la veille.
Monte-Cristo me prend une partie de la journée.
10 mars. — Hésitation jusqu’à midi et demi. Je suis allé à la Chambre à cette heure et j’ai travaillé raisonnablement : les hommes à la charrue, la femme et les bœufs.
J’apprends, à mon retour, que mon vieux maître d’écriture Werdet est passé pour me voir. J’ai été heureux de ce souvenir.
Je reçois une lettre pour le convoi de la fille unique de Barye : ce malheureux va se trouver bien triste et bien seul.
11 mars. — Villot le matin. Il me parle des exécutions du jury.
Au convoi de la fille de Barye. Il ne s’y trouvait aucun des artistes ses amis que je vois ordinairement avec lui. A l’église sont venus Zimmermann, Dubufe, Brascassat, que je voyais pour la première fois : petite figure noire et rechignée. De l’église, chez Vieillard, que j’ai trouvé au lit ; il souffre d’un rhume. Il est toujours inconsolable. Nous avons beaucoup causé de l’éternelle question du progrès que nous entendons si diversement. Je lui ai parlé de Marc-Aurèle ; c’est le seul livre où il ait puisé quelque consolation depuis son malheur. Je lui ai cité le malheur de Barye, plus seul encore que lui ; d’abord c’est sa fille, ensuite il a certainement moins d’amis. Son caractère réservé, pour ne pas dire plus, écarte l’épanchement. Je lui ai dit qu’à tout bien considérer, la religion expliquait mieux que tous les systèmes la destinée de l’homme, c’est-à-dire la résignation. Marc-Aurèle n’est pas autre chose.
— Vu Perpignan pour toucher. Il m’a parlé de l’usine de Monceau comme placement.
Le dernier actionnaire restant de la première classe sur la tontine Lafarge a trente mille francs de rente ; il a cent ans. C’est un peu tard pour en jouir beaucoup.
— Rentré chez moi, et reparti à deux ou trois heures, pour aller chez M. Delessert. Trouvé Colet dans l’omnibus[315] ; il ne paraît pas ébloui par la gloire de Rossini ; il me dit qu’il n’était pas assez savant, etc… Vu M. Delessert, M. de Rémusat. M. Delessert venu ; il nous a parlé de la fin de son frère. J’ai vu avec grand plaisir le Samson tournant la meule, de Decamps : c’est du génie[316].
Revenu par le froid le plus glacial, malgré le soleil.
— Après mon dîner, j’ai été chez Mme de Forget ; c’était son jeudi. Larrey[317] et Gervais sont venus ; David[318]… Comme j’allais partir, il m’a fait des compliments sur ma coupole[319], mais ces compliments-là ne signifient rien.
— Perpignan m’avait raconté l’anecdote du vieux Thomas Paw, qui a vécu cent quarante ans. Un homme qui désirait le voir rencontra un vieillard décrépit qui se lamentait, et qui lui dit qu’il venait d’être battu par son père, pour n’avoir pas salué son grand-père, lequel était Paw.
Il dit très justement que les émotions usent la vie autant que les excès ; il me cite une femme qui avait expressément défendu qu’on lui racontât le moindre événement capable d’impressionner.
J’éprouve, du reste, combien je suis fatigué de parler avec action, même de prêter une attention soutenue à la pensée d’un autre.
12 mars. — Journée de fainéantise complète… J’ai essayé, au milieu de la journée, de me mettre au Valentin : j’ai été obligé de l’abandonner ; je suis retombé sur Monte-Cristo.
Après mon dîner, chez Mme Sand. Il fait une neige affreuse, et c’est en pataugeant que j’ai gagné la rue Saint-Lazare.
Le bon petit Chopin[320] nous a fait un peu de musique… Quel charmant génie ! M. Clésinger, sculpteur, était présent ; il me cause une impression peu favorable. Après son départ, d’Arpentigny m’a commencé son apologie dans le sens de mon impression.
13 mars. — Lacroix Gaspard[321] venu un instant. Il m’a beaucoup loué du dessin de mon Christ de la rue Saint-Louis. C’est la première fois qu’on m’en fait compliment.
Hier, Clésinger m’a parlé d’une statue de lui qu’il ne doutait pas que je n’aimasse beaucoup, à cause de la couleur qu’il y a mise. La couleur étant, à ce qu’il paraît, mon lot exclusif, il faut que j’en trouve dans la sculpture, pour qu’elle me plaise, ou seulement pour que je la comprenne… !
— Repris le Valentin.
— Mme de Forget est venue me chercher pour dîner, et à neuf heures j’ai été chez M. Moreau ; Couture y était.
14 mars. — Gaspard Lacroix est venu me prendre, et nous avons été chez Corot. Il prétend, comme quelques autres qui n’ont peut-être pas tort, que, malgré mon désir de systématiser, l’instinct m’emportera toujours.
Corot est un véritable artiste. Il faut voir un peintre chez lui pour avoir une idée de son mérite. J’ai revu là et apprécié tout autrement des tableaux que j’avais vus au Musée, et qui m’avaient frappé médiocrement. Son grand Baptême du Christ plein de beautés naïves ; ses arbres sont superbes. Je lui ai parlé de celui que j’ai à faire dans l’Orphée. Il m’a dit d’aller un peu devant moi, et en me livrant à ce qui viendrait ; c’est ainsi qu’il fait la plupart du temps… Il n’admet pas qu’on puisse faire beau en se donnant des peines infinies. Titien, Raphaël, Rubens, etc., ont fait facilement. Ils ne faisaient à la vérité que ce qu’ils savaient bien ; seulement leur registre était plus étendu que celui de tel autre qui ne fait que des paysages ou des fleurs, par exemple. Nonobstant cette facilité, il y a toutefois le travail indispensable. Corot creuse beaucoup sur un objet. Les idées lui viennent, et il ajoute en travaillant ; c’est la bonne manière.
— Chez M. Thiers, le soir.
Je suis rentré souffrant et dans une humeur affreuse, après une courte promenade sur le boulevard. Ce Paris est affreux ! que cette tristesse est cruelle !… Pourquoi ne pas voir les biens que le ciel m’a accordés ?… L’hypocondrie offusque tout.
15 mars. — Grenier venu à la Chambre. Il est venu me joindre. Après avoir servi d’enclume, je vais, selon lui, servir de marteau.
Le Sénèque est une de ses préférences ; il aime le Socrate pour la couleur.
C’était la quatorzième fois !… J’ai peu travaillé, à cause de cette interruption ; j’ai pris le groupe des déesses en l’air.
— Ensuite chez Mlle Mars ; elle était mourante[322]. Je l’ai vue : c’était la mort !
— Rentré fatigué, et chez Leblond le soir. Il m’a montré des aquarelles du temps de nos soirées ; j’ai été étonné de celles de Soulier ; elles font toutes une impression sur l’imagination bien supérieure à celle que font les Fielding, etc.
16 mars. — Peu disposé ce matin.
J… venue dans la journée, en sortant du Salon ; mes tableaux n’y font pas mal. Elle est sortie à la vue de Vieillard ; il venait de l’Exposition des Artistes, rue Saint-Lazare. La tête de Cléopâtre admirée par lui et par M. Lefebvre[323], qui trouvait que c’était la seule qui eût cette force… Et d’où vient qu’ils ne voyaient pas cela il y a dix ans ? Il faut donc que la mode se mêle de tout !…
M. Van Isaker[324] venu me demander quels étaient ceux de mes tableaux à vendre : le Christ, l’Odalisque lui convenaient. Je lui ai montré les Femmes d’Alger et le Lion en train avec le Chasseur mort ; il me prend les premiers pour quinze cents francs ; l’autre pour huit cents francs.
Le prévenir quand j’aurai achevé.
Je voulais le soir retourner chez Mlle Mars et aller chez Asseline, mais j’ai préféré me reposer et me suis couché de bonne heure.
— Grenier me dit que le ton qui est violet dans la partie supérieure du tableau des Marocains endormis aurait fait également la lumière de la lampe, étant orangé. Je crois qu’il a raison, témoin le terrain dans l’Othello[325], qui était violâtre et que j’ai massé d’un ton orangé. L’observer dans le Valentin.
17 mars. — Travaillé à la Chambre. J’ai éprouvé combien ce lieu est malsain ; j’y suis trop resté.
Mlle Mars, en sortant. La pauvre femme est toujours dans le même état.
Malade ce soir et la journée suivante.
Grenier venu le matin ; il m’a donné des nouvelles du Salon.
Lacroix venu ensuite pour me donner l’adresse d’un maître de dessin, pour des gens qui m’ont été adressés par Mme Babut.
18 mars. — Je devais aller le soir chez Bertin[326], j’y ai renoncé ; mal d’oreille, joint au mal de gorge.
Sorti vers quatre heures ; cette promenade, au lieu de me disposer favorablement, a fait le contraire.
19 mars. — Chez J…, vers midi et demi ; elle allait sortir avec Mme de Querelles. Elles ont un peu modifié leurs arrangements, et nous sommes sortis ensemble vers trois heures. Elles m’ont mené chez M. Barbier[327] ; j’y ai vu Mme Robellean ; je suis rentré chez moi, en passant chez Mme Sand, que je n’ai pas trouvée.
Resté le soir et souffrant.
20 mars. — Resté toute la journée chez moi lire le Chevalier de Maison-Rouge, de Dumas, très amusant et très superficiel. Toujours du mélodrame.
21 mars. — Écrit à Mme Babut et à M. Thiers, pour mexcuser de ne pas dîner avec lui ; nous partons ce matin.
27 mars. — Parti de Champrosay à quatre heures et demie. Le matin, promenade charmante : pris par la petite rue qui longe le parc de M. Barbier, puis un sentier à gauche ; continué sur le côté de la colline jusqu’à la petite fontaine, où je me suis assis. Station charmante, que je ferai souvent, si je puis, jusqu’à la mare aux grenouilles, et revenu par la plaine, avec beaucoup de chaleur.
M. Barbier est venu dans la journée.
28 mars. — Dîné chez Bornot. Vu là un dernier cousin Berryer, Gaultron, Riesener et sa femme.
29 mars. — Dîné chez J… Hier, repris le Lion et l’Homme mort, et remis dans un état qui me donne envie de l’achever.
Le lendemain, repris les Femmes d’Alger[328], la négresse et le rideau qu’elle soulève.
30 mars. — Aux Italiens avec Mme de Forget pour la clôture : le premier acte du Mariage secret ; deuxième de Nabucho ; deuxième et troisième d’Othello[329].
Le Mariage m’a paru plus divin que jamais ; c’était la perfection… il fallait bien descendre… mais quelle chute jusqu’à Nabucho ! Je m’en suis allé avant la fin.
31 mars. — Chez Mme Sand le soir. Convenus d’aller le lendemain au Luxembourg.
Depuis mon retour de la campagne, je ne travaille pas, excepté les deux premiers jours ; je suis pris d’une lassitude ou fièvre, vers deux heures.
1er avril. — A onze heures, avec Mme Sand et Chopin au Luxembourg. Nous avons vu ensemble la galerie, après avoir vu la coupole. Ils m’ont ramené, et je suis rentré chez moi vers trois heures. Revenu dîner avec eux. Le soir, elle allait chez Clésinger ; elle ma proposé d’y aller, mais j’étais très fatigué, et suis rentré.
2 avril. — Au Conservatoire le soir avec Mme de Forget. Symphonie de Mendelssolm qui m’a excessivement ennuyé, sauf un presto. — Un des beaux morceaux de Cherubini, de la Messe de Louis XVI. — Fini par une symphonie de Mozart, qui m’a ravi.
La fatigue et la chaleur étaient excessives ; et il est arrivé ce que je n’ai jamais éprouvé là, que non seulement ce dernier morceau m’a paru ravissant de tous points, mais il me semblait que ma fatigue fut suspendue en l’écoutant. Cette perfection, ce complet, ces nuances légères, tout cela doit bien dissiper les musiciens qui ont de l’âme et du goût.
Elle m’a ramené dans sa voiture.
3 avril. — Je suis sorti de bonne heure pour aller voir Gautier[330]. Je l’ai beaucoup remercié de son article splendide fait avant-hier, et qui m’a fait grand plaisir ; Wey[331] y était.
Il ma donné l’idée (Gautier) de faire une exposition particulière de tous ceux de mes tableaux que je pourrais réunir… Il pense que je peux faire cela, sans sentir le charlatan, et que cela rapporterait de l’argent.
— Chez M. de Morny. J’ai vu là un luxe comme je ne l’avais vu encore nulle part. Ses tableaux y font beaucoup mieux. Il a un Watteau magnifique ; j’ai été frappé de l’admirable artifice de cette peinture. La Flandre et Venise y sont réunies, mais la vue de quelques Ruysdaël, surtout un effet de neige et une marine toute simple où on ne voit presque que la mer par un temps triste, avec une ou deux barques, m’ont paru le comble de l’art, parce qu’il y est caché tout à fait. Cette simplicité étonnante atténue l’effet du Watteau et du Rubens ; ils sont trop artistes. Avoir sous les yeux de semblables peintures dans sa chambre, serait la jouissance la plus douce.
Chez Mornay.
— Chez Mme Delessert, par le quai, où j’ai acheté le Lion de Denon[332], ne l’ayant point trouvé chez Maindron[333]. J’ai été reçu en son absence par sa vieille mère, qui m’a montré son groupe. Ce petit jardin a quelque chose d’agréable ; il est peuplé des infortunées statues dont le malheureux artiste ne sait que faire. Atelier froid et humide ; cet entassement de plâtres, de moules, etc.
Il est revenu et a été sensible à ma visite ; son groupe en marbre qu’il a chez lui, depuis quelques années, sans le vendre ; le bloc seul a coûté 3,000 francs.
— Le soir chez Mme Sand. Arago[334] m’a parlé du projet qu’il retourne avec Dupré, pour vendre avantageusement nos peintures et nous passer des marchands.
4 avril. — Donné à Lenoble 1,000 francs pour acheter des chemins de fer de Lyon, plus 2,000 francs pour mettre chez Laffitte.
— M. Dufays, 150 francs, qu’il me demande pour deux mois.
— Demander à Lenoble où en sont les actions sur Lyon qu’il m’a achetées il y a quelques mois.
— M. Dufays, le matin ; Arnoux ensuite, qui a paru très froid en sa présence, malgré la coquetterie de l’autre.
— Journée nulle, et le même malaise.
— Le soir, avec Mme de Forget, au Conservatoire : La Symphonie pastorale — Agnus de Mozart — Ouverture entortillée de Léonore par Beethoven[335], et Credo du Sacre de Cherubini, bruyant et peu touchant.
— Pierret venu après dîner. J’ai été fâché de le renvoyer pour m’habiller. Quand je le trouve un peu moins désagréable, je me fonds et le crois redevenu comme autrefois. Il est réconcilié avec le Christ de la rue Saint-Louis et il l’admire en entier.
5 avril. — Chez Mme de Rubempré[336] le soir ; et puis chez Mme Sand, qui part demain ; j’ai un rhume de cerveau, pris hier, qui m’anéantit.
6 avril. — Je voulais aller chez Asseline ; mon rhume me retient. Dans la journée, mis sur un panneau et ébauché en grisaille Saint Sébastien à terre et tes Saintes femmes[337].
7 avril. — Travaillé quelque peu à l’esquisse des Bergers chaldéens, que j’achève un peu d’après le pastel[338], qui m’avait servi. J’ai été forcé de l’interrompre.
Dîné chez Pierret ; Soulier y était. Villot y est venu. Rentré fatigué.
23 avril. — Sorti un peu vers midi et demi, pour aller chez M. Thiers ; mais le froid et la fatigue m’ont fait rentrer.
— Le soir, Villot est venu me tenir compagnie. Il me dit que le Titien, à la fin de sa vie, disait qu’il commençait à apprendre le métier.
Il y a dans les châteaux de l’État de Venise beaucoup de fresques de Paul Véronèse. Le Tintoret travaillait extrêmement à dessiner en dehors de ses tableaux ; il a copié des centaines de fois certaines têtes de Vitellius, dessins de Michel-Ange.
24 avril. — Scheffer venu le matin.
— En parcourant dans la journée le livre des Emblèmes de Bocchi[339], je retrouve encore une foule de choses ravissantes d’élégance à étudier. J’essaye avant dîner, mais la fatigue me prend ; je ne suis pas encore remis.
25 avril. — Lassalle venu ce matin : il me prévient peu en faveur d’Arnoux.
Riesener venu, et Boissard ; puis Mme Beaufils, qui m’a fort fatigué avec son insistance pour me faire promettre d’aller chez elle cet automne.
Riesener dit une chose très juste, à propos de l’enthousiasme exagéré que peuvent inspirer les peintures de Michel-Ange. Je lui parlais de ce que m’avait dit Corot, de la supériorité prodigieuse de ces ouvrages ; Riesener dit très bien que le gigantesque, l’enflure, et même la monotonie que comportent de tels objets, écrasent nécessairement ce qu’on peut mettre à côté. L’Antique mis à côté des idoles indiennes ou byzantines se rétrécit et semble terre à terre… ; à plus forte raison, des peintures comme celles de Lesueur et même de Paul Véronèse. Il a raison de prétendre que cela ne doit pas déconcerter, et que chaque chose est bien à sa place.
— Dans la journée, chez Mme Delessert. Elle était au lit ; j’ai eu beaucoup de plaisir à la revoir, malgré son indisposition, qui, je le crois, n’est pas dangereuse.
Revenu sans trouver de fiacre, et forcé de prendre l’omnibus.
— Rendu ce même jour à Villot et à lui renvoyé par la femme de ménage un cadre contenant des pastels, costumes vénitiens ; une petite toile, idem, peinte à l’huile ; une feuille de croquis, aquarelle de la salle du Palais ducal, et une esquisse sur carton, d’après un tableau de Rubens qui est à Nantes.
26 avril. — Reçu une lettre de V…, qui m’a fait plaisir et montré, par cette prévenance, qu’il était sous l’empire du même sentiment que moi.
— Vers une heure, chez Villot, à son atelier, et bonne après-midi ; je suis revenu assez gaillardement.
— Le soir, Pierret est venu passer une partie de la soirée. En somme, bonne journée.
Il me parle de sa soirée chez Champmartin, où Dumas a démontré la faiblesse de Racine, la nullité de Boileau, le manque absolu de mélancolie chez les écrivains du prétendu grand siècle. J’en ai entrepris l’apologie.
Dumas ne tarit pas sur cette place publique banale, sur ce vestibule de palais, où tout se passe chez nos tragiques et dans Molière. Ils veulent de l’art sans convention préalable. Ces prétendues invraisemblances ne choquaient personne ; mais ce qui choque horriblement, c’est, dans leurs ouvrages, ce mélange d’un vrai à outrance que les arts repoussent, avec les sentiments, les caractères ou les situations les plus fausses et les plus outrées… Pourquoi ne trouvent-ils pas qu’une gravure ou qu’un dessin ne représente rien, parce qu’il y manque la couleur ?… S’ils avaient été sculpteurs, ils auraient peint les statues et les auraient fait marcher par des ressorts, et ils se seraient crus beaucoup plus près de la vérité.
27 avril. — Barroilhet[340] venu : il a envie du Lion et l’Homme, justement parce que je ne peux le lui donner. Il voudrait quelque chose dans ce genre ; je l’ai accompagné jusque chez lui, en allant vers midi chez J… J’y ai fait un petit second déjeuner, et ai été ramené vers deux heures.
Revu une dernière fois le portrait de Joséphine de Prud’hon[341]. Ravissant, ravissant génie ! Cette poitrine avec ses incorrections, ces bras, cette tête, cette robe parsemée de petits points d’or, tout cela est divin. La grisaille est très apparente et reparaît presque partout.
— Carrier[342] était venu ce matin ; il m’a beaucoup parlé de Prud’hon. Il préférait beaucoup Gros à David. — Reçu une lettre de Grzimala[343] le soir, qui me demande la Barque.
28 avril. — Malaise le matin.
Sorti vers une heure pour voir M. Thiers ; il était sorti, ou ne recevait pas.
Vers trois heures, Grzimala et son comte polonais ; ensuite M. de Geloës[344], qui venait me demander le Christ ou le Bateau. Entré dans mon atelier, il me demande le Christ au tombeau[345], et nous convenons de 2,000 francs, sans la bordure.
29 avril. — Prêté à Vieillard la Révolution de Michelet ; il m’a rendu la Mare au diable.
Hédouin et Leleux venus ce matin ; ils vont en Afrique.
Mornay et Vieillard dans la journée ; ils se sont encore rencontrés.
30 avril. — J’essaye de travailler et j’éprouve toujours cette irritation intérieure ; il faut de la patience.
Vers trois heures j’ai été chez Mme Delessert : je l’ai trouvée changée. Je suis parti avec elle : elle m’a déposé chez Souty[346], où j’ai été voir le tableau de Susanne, attribué à Rubens. C’est un Jordaens des plus caractérisés et un magnifique tableau.
On voit là quelques tableaux modernes, qui font une triste figure à côté du flamand. Ce qui attriste dans toutes ces malheureuses toiles, c’est l’absence absolue de caractère ; on voit dans chacun celui qu’ils ont voulu se donner, mais rien ne porte un cachet ; il faut en excepter l’Allée d’arbres, de Rousseau, qui est une œuvre excellente dans beaucoup de parties ; le bas est parfait ; le haut est d’une obscurité qui doit tenir à quelques changements ; le tableau tombe par écailles. — Il y a un tableau de Cottreau[347], déplorable : la tête d’un certain sultan qui rit est l’ouvrage du plus sot des hommes, et il s’en faut bien que l’auteur soit cela. Pourquoi a-t-il choisi une profession dans laquelle son esprit lui est inutile ?
Le Jordaens est un chef-d’œuvre d’imitation, mais d’imitation large et bien entendue, comme peinture. Voici un homme qui fait bien ce qu’il est propre à faire !… Que les organisations sont diverses ! Cette absence complète d’idéal choque malgré la perfection de la peinture : la tête de cette femme est d’une vulgarité de traits et d’expression qui passe toute idée. Comment ne s’est-il pas senti le besoin de rendre le côté poétique de ce sujet, autrement qu’avec les admirables oppositions de couleur qui en font le chef-d’œuvre ?… La brutalité de ces vieillards, le chaste effroi de la femme honnête, ses formes délicates, qu’il semble que l’œil lui-même ne dût point voir, tout cela eût été chez Prud’hon, chez Lesueur, chez Raphaël ; ici elle a l’air d’intelligence avec eux et il n’y a d’animé chez eux que l’admirable couleur de leurs têtes, de leurs mains, de leurs draperies. Cette peinture est la plus grande preuve possible de l’impossibilité de réunir d’une manière supérieure la vérité du dessin et de la couleur à la grandeur, à la poésie, au charme. J’ai d’abord été renversé par la force et la science de cette peinture, et j’ai vu qu’il m’était également impossible de peindre aussi vigoureusement et d’imaginer aussi pauvrement ; j’ai besoin de la couleur, j’en ai un besoin égal, mais elle a pour moi un autre but ; je me suis donc réconcilié avec moi-même, après avoir reçu d’abord l’impression d’une admirable qualité qui m’est refusée ; ce rendu, cette précision sont à mille lieues de moi, ou plutôt j’en suis à mille lieues ; cette peinture ne m’a pas saisi, comme beaucoup de belles peintures. Un Rubens m’eût ému davantage ; mais quelle différence entre ces deux hommes ! Rubens, à travers ses couleurs crues et ses grosses formes, arrive à un idéal des plus puissants. La force, la véhémence, l’éclat le dispensent de la grâce et du charme.
1er mai. — Été chez J… vers midi ; nous avons été promener au bois de Boulogne, après avoir passé une matinée charmante.
2 mai. — Je ne me sens pas encore en train de travailler.
— Martin[348], ancien élève, sot parfait, revient d’Italie, tout bouffi de ce qu’il a vu, et encore plus sot à raison de cela.
— Journée insipide sans travail, et nullité complète.
— Après dîner, chez Pierret par le temps le plus froid ; revenu assez tard et à pied, ce en quoi j’ai eu tort, car je me suis fatigué.
— Planet était venu le matin ; je lui ai promis une étude pour la mansarde qu’il fait maintenant.
— Mme Marliani venue dans la journée ; elle est toujours au même point avec son mari. Elle me parle de Clésinger comme d’un prétendant pour Solange[349] ; cette idée ne m’était pas venue.
3 mai. — Resté au lit jusqu’à onze heures. Grenier est venu pour m’acheter le Naufrage : c’est trop tard. Il voulait l’emporter dans sa retraite, à la campagne, pour en jouir.
Dufays ensuite ; j’ai tort de dire si librement mon avis avec des gens qui ne sont pas mes amis. Le docteur Laugier[350] ensuite. Je lui ai parlé varicocèle ; il est d’avis d’un bandage particulier. Je vois que tous mes petits maux sont, suivant lui, objets inhérents à ma constitution, et avec lesquels il faut vivre.
— Femme nue et debout : la Mort s’apprête à la saisir.
— Femme qui se peigne[351] : la Mort apprête son râteau.
— Adam et Ève : les Maux et la Mort en perspective, au moment où ils vont manger le fruit, ou plutôt groupés sur les branches fatales et sur le point de fondre sur l’humanité.
— Chez Jacquet[352] : le petit Faune, un pied environ. La Vénus grecque, trois pieds. Bas-relief : Combat d’Hercule et d’Apollon. Minerve au serpent, bas-relief.
— Sorti dans la journée ; passé voir un dessin de Lacroix[353] chez Aubry[354]. Revenu chez moi par le boulevard.
— Le soir, sorti pour aller chez Leblond ; il sortait. Fatigué de ces deux courses.
4 mai. — Malaise dans le milieu de la journée, qui ressemble à de la fièvre. Je crois quelle revient un peu à l’heure quelle venait dans le commencement. Je me suis endormi vers deux ou trois heures, et l’état fiévreux était complètement passé.
Aubry était venu le matin. Ce que j’ai vu hier chez lui est fort triste pour l’avenir de notre école. Le Boucher et le Vanloo sont les grands hommes sur lesquels elle a les yeux, pour suivre leurs traces ; mais il y avait chez ces hommes un véritable savoir mêlé à leur mauvais goût. Une niaise adresse de la main est le but suprême.
— Il est venu me chercher à cinq heures et demie, et j’y ai dîné : bonne et douce soirée.
— Je vois dans la presse l’annonce du mariage de Solange ; cette précipitation est incroyable !
5 mai. — Resté au lit jusqu’à dix heures et demie. Villot m’a trouvé au lit ; j’ai eu du plaisir à le voir.
Nous avons parlé des horribles ennuis de la vie. Chacun fait bonne contenance, mais chacun est dévoré… Il rencontre l’autre jour Colet, qui se montre joyeux de le voir et de causer avec lui, mais il le quitte bientôt et lui dit avec accablement : « Je rentre chez moi… Et pourquoi, et comment cela se peut-il autrement ? »
De là nous passons à la nécessité de s’occuper pour échapper passagèrement au sentiment de nos maux. Il a remarqué que les vieillards n’éprouvent pas autant ce besoin. Il me cite M. Barbier, père de sa femme, et M. Robelleau. Ces deux hommes lisent très peu. Ils vivent avec leurs souvenirs, et l’ennui ne les gagne pas. Il me rappelle que Bataille[355], qui était désœuvré comme eux, en apparence, ne se plaignait jamais du poids du temps.
— Le soir, entré à Notre-Dame de Lorette. Entendu de la musique.
Ensuite chez Leblond ; Garcia y était. Il m’a chanté un superbe air de Cimarosa, du Sacrifice d’Abraham. Mme Leblond m’a chanté quelque chose et m’a fait plaisir.
Je n’ai dans la tête qu’accords de Cimarosa. Quel génie varié, souple et élégant ! Décidément, il est plus dramatique que Mozart.
6 mai. — Chez Villot vers une heure et resté à son atelier jusqu’à cinq heures et demie.
Vu de l’anatomie ; il y a à faire avec ses fragments de Chaudet[356] et son ouvrage gravé de l’anatomie de Gamelin[357], peintre de Toulouse en 1779. J’ai même ébauché un Père du désert couché, auquel un corbeau apporte du pain.
J’ai trouvé du plaisir dans ces heures passées avec lui. Peu ou prou d’amitié est une bonne chose.
— Sujets : La Mort planant sur un champ de bataille : des squelettes.
La Mort dans sa caverne, qui entend la trompette du jugement dernier.
7 mai. — Reçu une lettre de Mme Sand… La pauvre amie m’écrit la lettre la plus aimable, et son cœur a du chagrin.
— J’ai été voir la figure de Clésinger. Hélas ! je crois que Planche a raison : c’est du daguerréotype en sculpture, sauf une exécution vraiment très habile du marbre. Ce qui le prouve, c’est la faiblesse de ses autres morceaux : nulle proportion, etc. Le défaut d’intelligence comme lignes, dans sa figure ; on ne la voit entière de nulle part.
— J’ai vu le Salon très agréablement, sans rencontrer qui que ce soit. Le tableau de Couture m’a fait plaisir[358] ; c’est un homme très complet dans son genre. Ce qui lui manque, je crois qu’il ne l’acquerra jamais ; en revanche, il est bien maître de ce qu’il sait. Son portrait de femme m’a plu.
J’ai vu mes tableaux sans trop de déplaisir, surtout les Musiciens juifs et le Bateau[359]. Le Christ[360] ne m’a pas trop déplu.
Resté le soir, fatigué, mais point souffrant du tout.
8 mai. — Dîné chez Mme de Forget. — Repris le Christ au tombeau dans la journée.
9 mai. — Chez Mme Marliani le soir. Elle m’apprend la maladie de Chopin. Le pauvre enfant est malade depuis huit jours, et très gravement. Il va un peu mieux à présent.
D’Arpentigny a recommencé ses antiennes sur Clésinger. Nous sommes revenus côte à côte une partie du chemin.
10 mai. — Été le matin chez Chopin, sans être reçu.
Travaillé dans la soirée au Christ et à la figure du devant.
11 mai. — Lessore[361] venu le matin. — Chez Chopin vers onze heures.
Retrouvé chez moi R… avec ses portefeuilles que j’ai vus avec plaisir, mais avec encore plus de fatigue. Mornay y assistait aussi. Il me demande de lui faire un petit tableau au sujet de la scène qui suit la bataille de Coutras : Henri IV dans sa maison, etc.
— Dîné avec J… Elle m’a conduit vers neuf heures chez Chopin ; j’y suis resté jusqu’à minuit passé ; Mlle de R… y était, et son ami Herbaut.
12 mai. — Vu M. Boileux[362], de Blois. Est venu me demander avec empressement mes Juifs du Salon pour un amateur de son pays ; c’est un peu tard.
J’avais mille choses à faire avant mon départ pour Champrosay : le mauvais temps, la paresse me font remettre.
Vers trois heures, je réponds à Mme Sand, hélas !
Lu les Mousquetaires jusqu’à cette heure-là ; fort amusé.
M. L. Ménard[363] : l’avertir de la terminaison des peintures à la Chambre des députés.
Champrosay, lundi 22 mai. — Le matin, assis dans la forêt. — Je pensais à ces charmantes allégories du Moyen Age et de la Renaissance, ces cités de Dieu, ces élysées lumineux, peuplés de figures gracieuses, etc… N’est-ce pas la tendance d’époques dans lesquelles les croyances aux puissances supérieures ont conservé toute leur force ? L’âme s’élançait sans cesse des trivialités ou des misères de la vie réelle dans des demeures imaginaires que l’on embellissait de tout ce qui manquait autour de soi.
C’est aussi celles d’époques malheureuses où des puissances redoutables pèsent sur les hommes et compriment les élans de l’imagination. La nature, qui n’a pas été vaincue par le génie de l’homme à ces époques, augmentant les besoins matériels, fait trouver la vie plus dure et fait rêver avec plus d’énergie à un bien-être inconnu. De notre temps, au contraire, les jouissances sont plus communes, l’habitation meilleure, les distances plus facilement franchies. Le désir poétisait donc alors comme toujours l’existence des malheureux mortels, condamnés à dédaigner ce qu’ils possèdent.
Les actes n’étaient occupés qu’à élever l’âme au-dessus de la matière. De nos jours c’est tout le contraire. On ne cherche plus à nous amuser qu’avec le spectacle de nos misères dont nous devrions être avides de détourner les yeux. Le protestantisme d’abord a disposé à ce changement. Il a dépeuplé le ciel et les églises. Les peuples d’un génie positif l’ont embrassé avec ardeur. Le bonheur matériel est donc le seul pour les modernes. La révolution a achevé de nous fixer à la glèbe de l’intérêt et de la jouissance physique. Elle a aboli toute espèce de croyance : au lieu de cet appui naturel que cherche une créature aussi faible que l’homme dans une force surnaturelle, elle lui a présenté des mots abstraits : la raison, la justice, l’égalité, le droit. Une association de brigands se régit aussi bien par ces mots-là que peut le faire une société moralement organisée. Ils n’ont rien de commun avec la bonté, la tendresse, la charité, le dévouement. Les bandits observent les uns avec les autres une justice, une raison qui les fait se préférer avant tout, une certaine égalité dans le partage de leurs rapines qui leur semble justice exercée sur des riches insolents ou sur des heureux qui leur semblent l’être à leurs dépens. Il n’est pas besoin d’y regarder de bien près pour voir que la société actuelle se gouverne à peu près d’après les mêmes principes et en en faisant la même interprétation.
Je ne sais si le monde a vu encore un pareil spectacle, celui de l’égoïsme remplaçant toutes les vertus qui étaient regardées comme la sauvegarde des sociétés.
— Revenu de Champrosay, le soir, où j’étais depuis le jeudi 13.
23 mai. — Chez J… le matin. Temps affreux de chaleur. Le soir, resté chez moi tout abattu.
25 mai. — Repris le Christ.
26 mai. — Travaillé avec ardeur, quoique peu de moments. — Femmes d’Alger. — Composé un Intérieur d’Oran avec figures. — La Femme qui se lave les pieds, paysage de Tanger.
— Chez Pierret le soir. Parlé du départ de son fils.
— Villot venu le matin : je l’ai trouvé changé.
— Reçu de M. Labello, pour le comte Tyszkiewiez, 500 francs pour le Canot naufragé[364].
— Chopin venu dans la journée ; il repart vendredi pour Ville-d’Avray.
27 mai. — Travaillé avec plaisir aux Femmes d’Alger : la femme du devant.
— Dîné chez Chabrier avec M. Poinsot, Rayer, David, Vieillard.
Bonne journée, soirée charmante : conversation toujours intéressante. Le génie, l’esprit, la finesse, la simplicité, la raison, le sens, tout ce qui est si rare. Il adore Voltaire, c’est tout simple ; je lui ai trouvé des idées justes sur tout.
5 juin. — Dîné avec Vieillard chez Mme de Forget. — Le matin, Planet est venu avec M. Martens, pour daguerréotyper la Cléopâtre[365]. Petite réussite.
6 juin. — Petit livre de croquis, avec crayon qui ne s’use pas, chez Ricois, rue des Petits-Augustins.
7 juin. — Au Père-Lachaise, avec Jenny[366], pour arranger les tombes et voir l’ouvrage de David. Commencé, à partir de ce jour, l’arrangement avec le jardinier susdit, pour entretenir, moyennant vingt francs par an, les tombeaux de ma mère, etc., puis autre arrangement avec lui pour recreuser l’inscription de ma mère et nettoyer la pierre.
8 juin. — Varcollier[367]. — Cave[368]. — Nilson. — Scheffer. — Delessert.
9 juin. — Chez la plupart des hommes, l’intelligence est un terrain qui demeure en friche presque toute la vie. On a droit de s’étonner en voyant une foule de gens stupides ou au moins médiocres, qui ne semblent vivre que pour végéter, que Dieu ait donné à ses créatures la raison, la faculté d’imaginer, de comparer, de combiner, etc., pour produire si peu de fruits. La paresse, l’ignorance, la situation où le hasard les jette, changent presque tous les hommes en instruments passifs des circonstances. Nous ne connaissons jamais ce que nous pouvons obtenir de nous-mêmes. La paresse est sans doute le plus grand ennemi du développement de nos facultés. Le Connais-toi toi-même serait donc l’axiome fondamental de toute société, où chacun de ses membres ferait exactement son rôle et le remplirait dans toute son étendue.
13 juin. — Mannequin à 350 francs, chez Lefranc, rue du Four-Sakit-Germain, 23.
— Dîné avec Villot et Pierret.
— Chez Villot vers trois heures et retouché le cuivre des Arabes d’Oran[369].
14 juin. — Travaillé à la Chambre. Ébauché le groupe des Barbares du devant[370].
15 juin. — À Neuilly. Revenu avec Laurent Jan.
« … Une pareille manière d’écrire qui transporte dans le style l’abandon familier ou cynique de la conversation (le style de Michelet, les mots de polisson, etc.) est blâmable à plus d’un titre, car elle dénote chez l’auteur qui se la permet non moins de prétention que d’impuissance. Il se propose en effet de trancher sur les autres écrivains par l’audace de ses expressions, la bigarrure de ses couleurs, l’allure débraillée de ses phrases ; et pourquoi ne pas prouver plutôt la force, en acceptant toutes les conditions, en se jouant en maître de toutes les difficultés de l’art d’écrire ? C’est dans l’accord des qualités individuelles avec les lois générales du beau et du bon, qu’éclate la véritable originalité. »
(Lerminier, Sur Michelet, Lamartine. — Revue des Deux Mondes, 15 juin 1847.)
17 juin. — Dîné chez Leblond avec Halévy, Adam, Duponchel, Garcia, Guasco, etc. Halévy m’invite pour mercredi.
20 juin. — Chez Boissard. Reprise de la musique.
Roberetti n’étant pas d’abord arrivé, trio de Beethoven. Puis Mozart a fait tous les frais jusqu’à la fin. Je l’ai trouvé plus varié, plus sublime, plus plein de ressources que jamais.
J’ai beaucoup remarqué, en présence du tableau de Boissard représentant un Christ, le dessus de porte de son atelier. Ces peintures, quoique médiocres, sont une excellente leçon, que je lui appliquais à l’instant même, de ce principe, qui veut qu’un objet, même très clair, s’enlève presque toujours en brun sur un objet plus brun. Elles mériteraient pour cela qu’on en fît des esquisses.
— Je suis en très bonne santé depuis quelque temps et vais très souvent à la Chambre.
25 juin. — Ce jour, probablement à l’heure de mon dîner, est venu Grzimala. Il m’a dit sur ma peinture des choses qui m’ont plu, entre autres : l’idée le frappant toujours plus que la convention de la peinture ; de plus, tous les tableaux présentent quelque chose de ridicule qui tient à des modes, etc. Il ne trouve jamais cela dans les miens. Aurait-il vraiment raison ? Pourrait-on inférer de là que moins l’élément transitoire qui contribue le plus souvent au succès actuel se mêle aux ouvrages, plus ils ont la condition de durée et de grandeur ?… Développer ceci.
27 juin. — Travaillé à la Chambre. Fait les deux cavaliers[371].
Dans la journée chez Roberetti, et le soir dîné avec Leblond, Garcia, Guasco, Ronconi[372].
28 juin. — Dîné chez Pierret avec Soulier, que je n’ai pas vu depuis un an au moins. Sa vue m’a fait beaucoup de plaisir.
— L’Académie des sciences morales et politiques remet au concours la question suivante :
Rechercher quelle influence les progrès et le goût du bien-être matériel exercent sur la moralité du peuple. — Le prix est de 1,500 francs.
29 juin. — Travaillé à la Chambre et dîné chez moi avec Soulier, Villot, Pierret. Bonne soirée.
J’ai mis quelque ordre dans mes croquis aujourd’hui et hier.
— Repris du goût pour l’allégorie de la gloire. Ugolin[373], etc. — Saint-Marcel[374] venu dans la journée.
30 juin. — Triqueti[375] venu dans la journée. Nous devons aller lundi chez le duc de Montpensier.
Mme de Forget venue me prendre vers quatre heures et demie pour aller à Monceaux ; nous nous sommes promenés, après dîner, aux Champs-Élysées.
Vu son ancienne pension sur le quai[376] et la maison de Riesener ; elle est encore pleine de maçons.
1er juillet. — À la Chambre le matin. — Séance chez Chopin à trois heures. Il a été divin. On lui a exécuté son trio, puis il la exécuté lui-même et de main de maître.
— Grzimala nous a fait dîner avec une petite femme de sa connaissance, qui va aux Eaux-Bonnes.
9 juillet. — Travaillé au Christ au tombeau.
— À Passy, vers trois heures et demie. Mme Delessert part lundi pour Plombières ; je l’avais revue à Vincennes, à la soirée du Prince, deux ou trois jours auparavant. C’est en revenant de cette course à Passy que j’ai rencontré Scheffer jeune, rue Blanche, qui m’a fait une plaisanterie au sujet d’une rose que j’avais à la main.
10 juillet. — Le cousin Delacroix[377] venu dans la journée : sa vue m’a fait plaisir. Il passe ici une huitaine. Chopin est venu pendant qu’il y était.
Fait la Madeleine dans le tableau susdit.
Se rappeler l’effet simple de la tête : elle était ébauchée d’un ton très gris et éteint. J’étais incertain si je la mettrais dans l’ombre davantage, ou si je mettrais des clairs plus vifs : j’ai légèrement prononcé nonce ces derniers sur cette masse, et il a suffi de colorer avec des tons chauds et reflétés toute la partie ombrée ; et, quoique le clair et l’ombre soient presque de même valeur, les tons froids de l’un et chauds de l’autre suffisent à accentuer le tout. Nous disions avec Villot, le lendemain, qu’il faut bien peu de chose pour faire de l’effet de cette manière. En plein air surtout, cet effet est des plus frappants ; Paul Véronèse lui doit une grande partie de son admirable simplicité.
Un principe que Villot regarde comme le plus fécond, c’est celui de faire détacher les objets un peu foncés sur ceux qui sont derrière, par la masse de l’objet et dans l’ébauche par le ton local établi dès le principe. Je n’en comprends pas l’application autant que lui. A rechercher.
Véronèse doit aussi beaucoup de sa simplicité à l’absence de détails qui lui permet l’établissement du ton local, dès le commencement. La détrempe l’a forcé presque à cette simplicité. La simplicité dans les draperies en donne singulièrement à tout le reste. Le contour vigoureux qu’il trace à propos autour de ses figures contribue à compléter l’effet de la simplicité de ses oppositions d’ombre et de lumière, et achève et relève le tout.
Paul Véronèse n’affiche pas, comme Titien, par exemple, la prétention de faire un chef-d’œuvre à chaque tableau. Cette habileté à ne pas faire trop partout, cette insouciance apparente des détails qui donne tant de simplicité est due à l’habitude de la décoration. On est forcé dans ce genre de laisser beaucoup de parties sacrifiées.
Il faut appliquer surtout à la représentation des natures jeunes ce principe du peu de différence de valeur des ombres par rapport aux clairs. Il est à remarquer que plus le sujet est jeune, plus la transparence de la peau établit cet effet.
11 juillet. — Remarquer combien la prétendue civilisation émousse les sentiments naturels. Hector dit à Ajax, livre VII, en cessant le combat : « Déjà la nuit est avancée, et nous devons tous obéir à la nuit, qui met un terme aux travaux des hommes. »
20 juillet. — Jour de mon départ pour Champrosay, où je vais passer plus de quinze jours. Reçu le matin même la lettre où Mme Sand me parle de sa querelle avec sa fille.
Chopin venu le matin, comme je déjeunais après être rentré du Musée où j’avais reçu la commande de la copie du Corps de garde[378]. Il m’a parlé de la lettre qu’il a reçue ; mais il me l’a lue presque tout entière depuis mon retour. Il faut convenir qu’elle est atroce. Les cruelles passions, l’impatience longtemps comprimée s’y font jour ; et, par un contraste qui serait plaisant, s’il ne s’agissait d’un si triste sujet, l’auteur prend de temps en temps la place de la femme et se répand en tirades qui semblent empruntées à un roman ou à une homélie philosophique.
— Le matin au Louvre, chez M. de Gailleux[379], qui m’a demandé la répétition du Corps de garde[380].
— Je me suis occupé pendant ce séjour de Lara, Saint Sébastien et Arabes jouant aux échecs[381].
— Vieillard venu me surprendre un jour avant dîner. Nous avons passé un bon après-dîner.
30 juillet. — Revenu à Paris ce jour-là et retourné le soir.
12 août. — Vu au ministère la Sainte Anne, de Riesener.
24 août. — Donné à Lenoble 4,000 francs pour acheter trois actions de canaux et faire le versement des actions du Nord.
28 août. — Travaillé à la Chambre. Mornay venu me voir ; je l’ai invité à dîner pour demain. Villot est arrivé après son départ, vers cinq heures ; je l’ai retenu à dîner.
29 août. — Refait la tête du Christ.
Mornay et Piron sont venus dîner avec moi.
30 août. — Travaillé à la Chambre. Resté le soir.
31 août. — Travaillé à la copie du Corps de garde. — Repris la petite Lélia et une ancienne esquisse de Médée[382] que j’ai métamorphosée.
— Dîné chez Mme de Forget. Revenu le soir par la rue du Houssaye, de la Victoire.
1er septembre. — Sur les distances à Londres, j’écrivais à Vieillard :
« Car c’est par lieues qu’il faut compter ; cette disproportion seule entre l’immensité du lieu que ces gens-là habitent et l’exiguïté naturelle des proportions humaines me les fait déclarer ennemis de la vraie civilisation qui rapproche les hommes, de cette civilisation attique qui faisait le Parthénon grand comme une de nos maisons et qui renfermait tant d’intelligence, de vie, de force, de grandeur dans les limites étroites de frontière qui font sourire notre barbarie si étriquée dans ses immenses États. »
— Travaillé à la Chambre.
2 septembre. — Travaillé à la Chambre.
Je ne sortirai pas, je crois, de cet Attila et de son cheval.
— Fait route dans l’omnibus avec deux religieuses : cet habit m’a imposé au milieu de la corruption générale, de l’abandon de tout principe moral ; j’ai aimé la vue de cet habit qui impose au moins à celui ou celle qui le porte le respect absolu, du moins en apparence, des vertus, du dévouement, du respect de soi et des autres.
— Mornay venu dans la journée.
— Je n’ai pas eu le courage de sortir le soir et me suis couché de bonne heure.
5 septembre. — Travaillé dans la journée à rajeunir une petite esquisse de Mater dolorosa faite alors pour M. D…
Le soir, chez Mme Marliani. Le pauvre Enrico est bien mal. Il y avait là une femme aimable, Mme de Barrère, qui parle bien de tout, sans sentir la pédante.
— Leroux[383] a décidément trouvé le grand mot, sinon la chose, pour sauver l’humanité et la tirer du bourbier : « L’homme est né libre », dit-il, après Rousseau. Jamais on n’a proféré une pareille sottise, quelque philosophe qu’on puisse être.
Voilà le début de la philosophie chez ces messieurs. Est-il dans la création un être plus esclave que n’est l’homme ? La faiblesse, les besoins, le font dépendre des éléments et de ses semblables. C’est encore peu des objets extérieurs. Les passions qu’il trouve chez lui sont les tyrans les plus cruels qu’il ait à combattre, et on peut ajouter que leur résister, c’est résister à sa nature même. Il ne veut pas non plus de la hiérarchie en quoi que ce soit ; c’est en quoi il trouve surtout le christianisme odieux ; c’est, à mon sens, ce qui en fait la morale par excellence : soumission à la loi de la nature, résignation aux douleurs humaines, c’est le dernier mot de toute raison (et partant soumission à la loi écrite, divine ou humaine).
13 septembre. — A Versailles ; j’y ai repris la fièvre.
17 septembre. — Sorti pour aller voir Mme Marliani ; arrivé près de chez elle, la fatigue m’a forcé de revenir en voiture.
18 septembre. — M. Laurens[384] venu ce matin ; il me vante beaucoup Mendelssohn.
La peinture est le métier le plus long et le plus difficile : il lui faut l’érudition comme au compositeur, mais il lui faut aussi l’exécution comme au violon.
19 septembre. — Je vois dans les peintres des prosateurs et des poètes. La rime les entrave ; le tour indispensable aux vers et qui leur donne tant de vigueur est l’analogue de la symétrie cachée, du balancement en même temps savant et inspiré qui règle les rencontres ou l’écartement des lignes, les taches, les rappels de couleur, etc. Ce thème est facile à démontrer, seulement il faut des organes plus actifs et une sensibilité plus grande pour distinguer la faute, la discordance, le faux rapport dans des lignes et des couleurs, que pour s’apercevoir qu’une rime est inexacte et l’hémistiche gauchement ou mal suspendu ; mais la beauté des vers ne consiste pas dans l’exactitude à obéir aux règles dont l’inobservation saute aux yeux des plus ignorants : elle réside dans mille harmonies et convenances cachées, qui font la force poétique et qui vont à l’imagination ; de même que l’heureux choix des formes et leur rapport bien entendu agissent sur l’imagination dans l’art de la peinture. Les Thermopyles de David sont de la prose mâle et vigoureuse, j’en conviens. Poussin ne réveille presque jamais d’idée par d’autres moyens que la pantomime plus ou moins expressive de ses figures. Ses paysages ont quelque chose de plus ordonné, mais le plus souvent chez lui comme chez les peintres que j’appelle des prosateurs, le hasard a l’air d’avoir assemblé les tons et agencé les lignes de la composition. L’idée poétique ou expressive ne vous frappe pas au premier coup d’œil.
20 septembre. — Essayer de prendre du chocolat avec du café : deux ou trois cuillerées de café dans une tasse de chocolat comme à l’ordinaire.
22 septembre. — Aujourd’hui, j’ai été me promener à l’église Saint-Denis ; j’ai revu auparavant le groupe du Puget.
24 septembre. — Lenoble emporte quatorze actions de Lyon et six du Nord pour faire les versements. Comme les actions seront dorénavant au porteur, il les fera conserver sous mon nom, dans la caisse de l’agent de change.
25 septembre. — Les Nymphes de la mer détellent les coursiers du Soleil.
26 septembre. — M. Cournault[385] me dit avoir vu à Alger un ouvrier, qui taillait des morceaux de cuir ou d’étoffe pour des ornements, regardant avec grande attention un bouquet de fleurs pour le guider. Ils ne doivent probablement qu’à l’observation de la nature l’harmonie qu’ils savent mettre dans les couleurs. Les Orientaux ont toujours eu ce goût ; il ne paraît pas que les Grecs et les Romains l’aient eu au même degré, à en juger par ce qui reste de leurs peintures.
— Mlle de Rosier venue. Chopin ensuite.
2 octobre, — Prêté à Soulier petite esquisse, d’après Rubens, de la vie de Marie de Médicis, la Paix mettant le feu à des armes… des monstres sur le devant, la Reine dans le fond entrant dans le temple de Janus.
5 octobre. — Prêté à Villot le numéro de la Revue où est l’article de Gautier sur Töpffer.
— Villot venu me voir ; nous avons parlé du procédé de la figure de l’Italie[386].
J’ai été reprendre mon travail pour la première fois, depuis le 12 septembre. Je suis satisfait de l’effet de cette figure. Toute la journée, j’ai été occupé, et très agréablement, d’idées et de projets de peintures relatives à cela. J’ai peint en quelques instants la petite figure de l’homme tombé en avant percé d’une flèche.
Il faudrait faire ainsi des tableaux esquisses qui auraient la liberté et la franchise du croquis. Les petits tableaux m’énervent, m’ennuient ; de même les tableaux de chevalet, même grands, faits dans l’atelier ; on s’épuise à les gâter. Il faudrait mettre dans de grandes toiles, comme Cournault me disait qu’était la Bataille d’Ivry de Rubens, à Florence, tout le feu que l’on ne met d’ordinaire que sur des murailles.
La manière appliquée à la figure de l’Italie est très propre pour faire des figures dont la forme serait aussi rendue que l’imagination le désire, sans cesser d’être colorées, etc.
La manière de Prud’hon s’est faite en vue de ce besoin de revenir sans cesse, sans manquer à la franchise. Avec les moyens ordinaires, il faut toujours gâter une chose pour en obtenir une autre ; Rubens est lâché dans ses Naïades, pour ne pas perdre sa lumière et sa couleur. Dans le portrait de même : si l’on veut arriver à une extrême force d’expression et de caractère, la franchise de la touche disparaît, et avec elle la lumière et la couleur. On obtiendrait des résultats très prompts et jamais de fatigue. On peut toujours reprendre, puisque le résultat est presque infaillible.
La cire m’a beaucoup servi pour cette figure, afin de faire sécher promptement et revenir à chaque instant sur la forme. Le vernis copal peut remplir cet objet ; on pourrait y mêler de la cire.
Ce qui donne tant de finesse et d’éclat à la peinture sur papier blanc, c’est sans doute cette transparence qui tient à la nature essentiellement blanche du papier… L’éclat des Van Eyck et ensuite de Rubens tient beaucoup sans doute au blanc de leurs panneaux.
Il est probable que les premiers Vénitiens peignirent sur des fonds très blancs ; leurs chairs brunes ne semblent que de simples glacis laqueux sur un fond qui transparaît toujours. Ainsi, non seulement les chairs, mais les fonds, les terrains, les arbres, sont glacés sur fond blanc, dans les premiers flamands, par exemple. Se rappeler dans la Nymphe endormie[387] que j’ai commencée ces jours-ci, et à laquelle j’ai travaillé devant Soulier et Pierret, aujourd’hui dimanche, quel a été l’effet du rocher, derrière la figure et le terrain, ainsi que le fond de forêt, après que je l’eus glacé de laques jaunes et de vert malachite, etc., sur une préparation blanche que j’avais remise sur l’ancien affreux rocher de terre d’ombre, etc.
Dans les anciens tableaux flamands sur panneaux et faits de la sorte en glacis, l’aspect roussâtre est manifeste. La difficulté consiste donc à trouver une convenable compensation de gris, pour balancer le jaunissement et l’ardent des teintes.
J’avais eu une idée de tout cela dans l’esquisse que j’ai faite, il y a quelque dix ans, de Femmes enlevées par des hommes à cheval[388], d’après une estampe de Rubens ; comme elles sont, il n’y manque que quelque gris. Il n’est même pas possible que les fonds, les draperies ne participent entièrement à l’exécution des chairs, quand on les exécute par glacis sur des fonds blancs. Le disparate est insupportable d’une autre manière. Il me semblait, après avoir modelé cette Nymphe avec du blanc pur, que le fond qui était derrière, fond de rochers faits avec des tons opaques comme dans une peinture ébauchée dans le système de la demi-teinte locale, n’était pas le fond qui convenait, mais qu’il fallait un ton clair de draperies ou de murailles : j’ai donc couvert de blanc ce rocher ; et quand ensuite je me suis avisé d’en faire un autre rocher avec des tons aussi transparents que possible, la chair a pu s’accorder avec cet accessoire ; mais il m’a fallu repeindre de même la draperie, le terrain et le fond de forêt.
6 octobre. — La Desdémone, la Femme à la rivière, la Lélia[389] feront mieux ainsi (en petite dimension). Quant aux autres, la plus grande dimension sera le mieux.
— Le charme particulier de l’aquarelle, auprès de laquelle toute peinture à l’huile paraît toujours rousse et pisseuse, tient à cette transparence continuelle du papier ; la preuve, c’est quelle perd de cette qualité quand on gouache quelque peu ; elle la perd entièrement dans une gouache. Les peintures flamandes primitives ont beaucoup de ce charme : l’emploi de l’essence y contribue en éloignant l’huile.
8 octobre. — Se rappeler l’impression d’un tableau de Jacquand[390], que j’ai vu un de ces jours à côté d’un tableau de Diaz, chez Durand-Ruel. Dans le premier, l’imitation minutieuse d’après nature des moindres objets, sécheresse, gaucherie ; dans l’autre, où tout est sorti de l’imagination du peintre, mais où les souvenirs sont fidèles, la vie, la grâce, l’abondance.
Le tableau de Jacquand représentait des moines de l’Inquisition, montrant l’entrée d’une espèce de trou à une femme assise à terre et qu’ils semblaient menacer. Le dos de cette femme était enfoncé dans la muraille, qui était derrière elle, etc. ; on eût dit ce tableau fait par un homme incapable du moindre souvenir des objets, et pour lequel le détail qu’il a sous les yeux est le seul qui puisse le frapper.
9 octobre. — J’ai vu avec Mme de Forget, chez Maigret, un papier de Chine pour tenture. Il nous a dit qu’aucun art, chez nous, ne pouvait approcher de la solidité de leurs couleurs. Il a essayé de raccorder une partie du fond qui est devenu horrible en peu de temps. Ce papier est très bon marché relativement ; tous ces charmants oiseaux sont faits à la main, et, nous a-t-il dit, la totalité des ornements, ce sont des bambous blanchâtres, rehaussés d’argent, qui courent sur tout le champ qui est rose, parfaitement uni ; le tout semé d’oiseaux, de papillons, etc., d’une perfection qui ne tire pas son charme de l’exactitude minutieuse, de l’imitation, comme nous faisons toujours dans nos ornements, au contraire ; c’était pour le port et la grâce de la pose et le contraste des tons, tout l’animal, mais le tout fait avec un esprit qui avait choisi et résumé l’objet de manière à en faire un ornement à la manière des animaux dans les monuments et manuscrits égyptiens.
14 octobre. — Parti pour Champrosay.
15 octobre. — Vieillard est venu passer une partie de la journée avec moi. Le cher ami paraît mieux de son voyage en Angleterre. Il m’a conté l’anecdote de l’officier des hussards anglais, qui entend dire que le tabac réussirait bien à Ceylan. Il profite aussitôt de quatre mois de congé pour s’embarquer, aller faire sa plantation, et revenir.
28 octobre. — Revenu de Champrosay, où j’ai eu presque constamment le plus beau temps du monde.
29 octobre. — Lenoble m’a apporté les quatorze actions du chemin de fer de Lyon qu’il a dû placer dans la caisse de l’agent de change, M. Gavet, attendu quelles sont au porteur[391].
2 novembre. — Prêté à M. Lessore onze feuilles de dessins d’anatomie, partie contre épreuves, dessins à la plume, etc. (Rendus.)
Prêté à Villot des calques de faïences d’Alger.
14 décembre. — Élie s’étant enfui dans le désert pour fuir la colère de Jézabel et résolu à se laisser mourir de faim, est réveillé par un ange qui lui apporte un pain et de l’eau, en lui enjoignant de prendre courage et de se nourrir. (Bible, p. 241.)
— Abigaïl vient apaiser David par des présents comme il s’apprêtait à tirer vengeance de Nabal, son mari. (Bible, p. 189.)
— Saint Étienne[392], après son supplice, recueilli par les saintes femmes et des disciples.
15 décembre. — Alexandre faisant violence à la Pythie.
— Énée suivant la Sibylle, qui le précède avec le rameau d’or, ferait bien pour petits sujets accessoires dans une grande décoration comme l’escalier de la Chambre des députés.
— L’Encan de Pertinax. Il vend la cour de Commode, choses et hommes, esclaves, parasites, vases, statues, etc. Lui, sévère, préside.
— Voir la préface de Raison et folie.
— Deux emblèmes de la Force persévérante.
— Les Nymphes de la mer détellent les chevaux du Soleil.
1849
6 janvier[393]. — À M. Jame, à Lyon.
« Monsieur, je vous avais confié au mois de mai de l’année dernière, pour trois ou quatre mois, mon tableau de la Liberté de 1830[394]. J’avais résisté, à plusieurs reprises, à vos offres, préférant renoncer à ce qu’elles présentaient d’avantageux aux inconvénients nombreux d’un déplacement pour un ouvrage déjà ancien et nécessitant une foule d’opérations toujours dangereuses, telles que clouer et déclouer plusieurs fois la toile, la rouler, l’emballer, la transporter, etc… J’ai cédé, avec le désir de vous obliger personnellement, et pressé également par le consentement de M. Ch. Blanc[395], votre ami ; vous deviez, dans la quinzaine qui a suivi la remise du tableau, me compter une somme de mille francs, quel que fût le résultat de votre entreprise. Vous ne vous êtes pas acquitté de cet engagement. Dans l’entrevue que j’ai eue avec vous, environ un mois après, vous m’avez assuré que cette somme allait m’être comptée, et cependant cette nouvelle promesse est restée sans effet. J’ai attribué à la difficulté du moment le retard que j’éprouvais, mais j’attendais au moins que vous me tiendriez au courant de ce que vous comptiez faire à cet égard. Je n’ai reçu de vous aucune nouvelle, ni en ce qui concerne l’engagement que vous aviez contracté relativement à la somme promise, ni même au sujet du sort du tableau dont je n’avais entendu, en aucune manière, me priver pendant un si long espace de temps. Huit mois se sont écoulés, et je suis sur tous ces points dans la même ignorance.Je désire donc, Monsieur, que vous ayez l’obligeance de me renvoyer au plus tôt le tableau dont j’ai appris indirectement que vous n’avez pas tiré parti comme vous le pensiez. J’ose attendre de vous que vous fassiez prendre tous les soins nécessaires, pour qu’il soit emballé et expédié avec toutes les précautions convenables. Je vous avais prié de faire consolider la caisse pour le retour ; elle en a le plus grand besoin, la route devant être plus longue et plus difficile dans cette saison. Comme vous êtes à Lyon, à ce que je crois, vous pourrez surveiller les précautions que je vous demande, car je vous avoue aussi qu’après la promesse que vous m’aviez faite également au mois de mai de suivre le tableau à son départ, et d’assister, de votre personne, à sa mise en état pour l’Exposition, j’avais été fort désappointé que cette opération n’ait pas été faite comme vous me l’aviez assuré, c’est-à-dire en votre présence.
Veuillez, Monsieur, m’écrire un mot à ce sujet. Vous voudriez bien adresser le tableau directement à M. le directeur du Musée du Louvre ; cela évitera de le retendre, détendre et retendre plusieurs fois.
J’espère donc, dans cette circonstance, dans l’obligeance que je réclame de vous, et vous prie de recevoir l’assurance de ma considération. »
14 janvier. — Rendez-vous au Palais-Royal à midi, avec la commission, pour visiter les lieux pour l’Exposition. … Dévastation dégoûtante, galeries transformées en magasin d’équipement. Caisse d’escompte établie avec bureaux, etc. Club avec tribune,… l’odeur de la pipe et de la caserne, etc. Ensuite aux Tuileries pour le même objet : le même spectacle affligeant, à cela près que le palais ne contient plus d’hôtes du genre de ceux que nous avions trouvés au Palais-Royal ; mais partout les traces de la dégradation, de la puanteur. Le lit de l’ex-Roi porte encore les matelas et les couvertures qui lui ont servi, ainsi qu’à la Reine. Dans le théâtre, était un monceau de débris de meubles brisés, d’écrins forcés, d’armoires enfoncées, et partout les portraits mis en pièces, à l’exception toutefois de ceux du prince de Joinville ; d’où vient cette préférence ? Il est difficile de s’en rendre compte.
Je devais, en sortant, aller chez J… ; j’étais trop fatigué et suis rentré chez moi.
24 janvier. — A la commission à neuf heures. Bonne journée.
— Vu Mornay chez lui.
29 janvier. — Alertes dès le matin pour la révolte de la garde mobile.
— Le soir, été voir Chopin ; je suis resté avec lui jusqu’à dix heures. Cher homme ! Nous avons parlé de Mme Sand[396], de cette bizarre destinée, de ce composé de qualités et de vices. C’était à propos de ses Mémoires. Il me disait qu’il lui serait impossible de les écrire. Elle a oublié tout cela ; elle a des éclairs de sensibilité et oublie vite. Elle a pleuré son vieil ami Pierret et n’y a plus pensé. Je lui disais que je lui voyais à l’avance une vieillesse malheureuse. Il ne le pense pas… Sa conscience ne lui reproche rien de ce que lui reprochent ses amis. Elle a une bonne santé qui peut se soutenir : une seule chose l’affecterait profondément, ce serait la perte de Maurice, ou qu’il tournât mal.
Quant à Chopin, la souffrance l’empêche de s’intéresser à rien, et à plus forte raison au travail. Je lui ai dit que l’âge et les agitations du jour ne tarderaient pas à me refroidir aussi. Il m’a dit qu’il m’estimait de force à résister. « Vous jouissez, a-t-il dit, de votre talent dans une sorte de sécurité qui est un privilège rare, et qui vaut bien la recherche fiévreuse de la réputation. »
— Désappointement le soir : j’avais dîné chez Mme de Forget avec l’intention d’aller le soir chez Rivet ; on nous envoie deux stalles des Italiens, pour l’Italiana. Nous arrivons et nous avons l’Elisire[397]. Froid mortel tout le temps et peu de dédommagement dans la musique.
5 février. — M. Baudelaire[398] venu comme je me mettais à reprendre une petite figure de femme à l’orientale, couchée sur un sofa, entreprise pour Thomas[399], de la rue du Bac. Il m’a parlé des difficultés qu’éprouve Daumier à finir.
Il a sauté à Proudhon qu’il admire et qu’il dit l’idole du peuple. Ses vues me paraissent des plus modernes et tout à fait dans le progrès.
Continué la petite figure après son départ et repris les Femmes d’Alger.
Situation d’esprit fort triste ; aujourd’hui ce sont les affaires publiques qui en sont cause ; un autre jour, ce sera pour un autre sujet. Ne faut-il pas toujours combattre une idée amère ?
— J’éprouve sur le tableau des Femmes d’Alger combien il est agréable et même nécessaire de peindre sur le vernis. Il faudrait seulement trouver un moyen de rendre le vernis de dessous inattaquable dans les opérations subséquentes de dévernissage, ou vernir d’abord sur l’ébauche avec un vernis qui ne puisse s’en aller, comme celui de Desrosiers ou de Sœhnée, je crois, ou bien faire de même pour finir.
10 février. — Chez Pierret le soir : beaucoup de monde. J’y ai vu Lassus[400], perdu de vue depuis longtemps.
Un imbécile nommé M…, que je n’y avais pas vu depuis longtemps, y était en toilette exacte et ganté hermétiquement. Il a l’air de se croire beau ou intéressant pour le sexe ; cela lui impose la tenue. Je ne mentionne ceci que parce que, à propos de cet individu qui n’est qu’un fat, j’ai pensé à certains hommes à bonnes fortunes, qui sont les victimes de l’obligation où ils se croient d’être toujours beaux.
11 février. — Vers deux heures chez J… ; V… y était. Ensuite à Passy, où je n’avais pas été depuis le 14 novembre dernier, veille de la Saint-Eugène. J’y ai revu Thiers : entrevue aigre-douce. Il a sur le cœur mon opposition à ses désirs. J’étais en train de causer, et cela aura augmenté sa mauvaise humeur. Il ne m’a pas dit de revenir le voir et s’en est allé assez brusquement. Je suis revenu par le jardin jusqu’au pont, avec M. de Valon[401] et Bocher[402]. J’ai reconduit ce dernier en cabriolet jusqu’à la place de la Concorde. Il voit en noir l’avenir de l’Assemblée future. Il croit l’établissement de Napoléon plus solide que ne le pensent ses amis ; il est plus populaire que tous les gouvernants, depuis trente ans. Les idées républicaines ont plus pénétré qu’on ne semble le croire. Je crois aussi que rien de semblable à ce qui a été ne peut être ; tout est changé en France, et tout change encore. Il me faisait remarquer l’aspect terne et négligé de cette foule, bien que ce soit dimanche et qu’il fasse le temps le plus extraordinaire, car tout Paris semble dehors.
Mercredi 14 février. — Dîné chez le président du Corps législatif[403], avec Poinsot, Gay-Lussac, Thiers, Molé, Rayer, Jussieu. Vieillard et Chabrier y étaient. Le premier m’a présenté à Léon Faucher.
J’ai une longue conversation après dîner avec Jussieu, sur les fleurs, à propos de mes tableaux : je lui ai promis d’aller le voir au printemps. Il me montrera les serres et me fera obtenir toute permission pour l’étude.
Thiers a été très froid avec moi, et plus que je ne le pensais encore. Je commence à croire ce que Vieillard me disait lundi chez C…, qu’il a l’esprit élevé et l’âme petite. Il devrait au fond m’estimer de la résistance que je lui ai opposée dans une chose qui choquait mes sentiments… Tant pis pour lui assurément.
Je n’ai pu causer avec Poinsot[404], ni l’entendre causer. Ces hommes là et leur sang-froid me font beaucoup d’effet. Celui-ci est un des plus remarquables qu’on puisse voir…
Le Prince a fait compliment à Ingres sur son beau tableau des Capucins, lequel est de Granet, et dont il est propriétaire. La figure d’Ingres était curieuse en entendant ce coq-à-l’âne.
— Chez Mme Marliani, en sortant. Elle m’a fait lire une lettre de Mme Sand. Elle s’excuse grandement dans l’affaire du mariage et ne croit pas ou feint de croire qu’elle n’a jamais pensé au Clésinger pour son compte. À la bonne heure.
— Fleury a eu l’idée qu’on imprimerait avantageusement la toile avec de la pâte de papier ; il me semble effectivement que ce sera un dessous excellent, absorbant à la fois et hors d’état d’influer sur la peinture comme la céruse à laquelle il attribue la plupart des changements, surtout dans les parties qui ne sont que frottées, comme dans les ombres des Flamands. Il pense que les tableaux et toiles de maîtres étaient imprimés avec toute autre chose que la céruse : plâtre avec colle de pâte, terre de pipe, etc.
Dimanche 25 février. — Fait peu de chose… Dîné chez Bixio avec Lamartine, Mérimée, Malleville, Scribe, Meyerbeer et deux Italiens. Je me suis beaucoup amusé ; je n’avais jamais été aussi longtemps avec Lamartine.
Mérimée l’a poussé au dîner sur les poésies de Pouchkine, que Lamartine prétend avoir lues, quoiqu’elles n’aient jamais été traduites par personne. Il donne le pénible spectacle d’un homme perpétuellement mystifié. Son amour-propre, qui ne semble occupé qu’à jouir de lui-même et à rappeler aux autres tout ce qui peut ramener à lui, est dans un calme parfait au milieu de cet accord tacite de tout le monde à le considérer comme une espèce de fou. Sa grosse voix a quelque chose de peu sympathique.
Le soir, Mme Menessier est venue avec sa fille ; je n’avais pas causé avec elle depuis des siècles : elle ne m’a pas paru changée ; j’ai causé une heure avec elle. Elle doit venir voir mes fleurs. Elle est atteinte de noirs, comme moi ; je vois que je ne suis pas le seul. L’âge y est pour quelque chose.
Vendredi 2 mars. — Pelletier[405], que j’ai rencontré en omnibus, en allant chercher des lunettes, ma dit que je surmonterais la cacochymie du corps et de l’esprit en faisant de temps en temps un voyage, un séjour dans les montagnes par exemple. Il m’a parlé du Jura ; j’ai pensé aux Ardennes.
Descendu à Saint-Sulpice et visité la chapelle ; l’ornementation sera difficile sans dorure.
De là choisi des lunettes, et revenu à la maison de bonne heure. Au moment où je me remettais au tableau des Hortensias, est arrivé Dubufe pour me demander d’aller voir sa République. M. de Geloës survenu, puis Mornay, à qui l’on a fait des ouvertures. Enfin, vers trois heures et demie, j’ai pu travailler et j’ai donné bonne tournure au tableau.
— Le soir, sorti pour aller voir Chopin et rencontré Chenavard[406]. Nous avons causé près de deux heures. Nous nous sommes abrités pendant quelque temps dans le passage qui sert de lieu d’attente aux domestiques, à l’Opéra-Comique ; il me disait que les vrais grands hommes sont toujours simples et sans affectation. C’était la suite d’une conversation dans laquelle il m’avait beaucoup parlé de Delaroche[407], pour qui il professe peu d’admiration quant au talent et même quant à l’esprit, dont on lui accorde généralement une part. Il y a effectivement dans ce caractère une contradiction remarquable : il est évident qu’il s’est composé des dehors de franchise et même… de rudesse, qui semblent contraster avec la position qu’il occupe et à laquelle sa valeur, comme artiste, n’aurait pu le conduire sans beaucoup d’adresse.
Chenavard me disait que les vrais hommes de mérite n’avaient besoin de nulle affectation et n’avaient nul rôle à jouer, pour parvenir à l’estime. Voltaire était plein de petites colères qu’il laissait échapper devant tout le monde. Il me citait des caricatures qu’un certain Hubert avait faites de lui, qui le représentaient dans toutes sortes de situations ridicules dans lesquelles il se laissait très bien surprendre. Bossuet était l’homme le plus simple, coquetant avec les vieilles dévotes, etc. On connaît l’aventure de Turenne et de la claque que lui donne son palefrenier. Une autre fois, on le vit sur le boulevard, qui était alors un lieu à peu près désert, servant d’arbitre à des joueurs de boule, à qui il prêtait sa canne pour mesurer les distances, et se mettant lui-même de la partie.
Il m’a dit, en me quittant, que les hommes se divisaient en deux parties : les uns n’ont qu’une loi unique et qui est leur intérêt ; pour ceux-là, la ligne à suivre est bien simple, et ils n’ont en toutes choses qu’à suivre ce juge infaillible ; les autres ont le sentiment de la justice et l’intention de s’y conformer ; mais la plupart n’y obéissent qu’à moitié ou mieux n’y obéissent point du tout, tout en se faisant reproches ; ou bien, après avoir perdu de vue pendant quelque temps cette règle de leurs actions, y reviennent en donnant dans un excès qui leur ôte le fruit de leur conduite précédente, tout en leur laissant le blâme. Ainsi ils auront, par exemple, flatté les passions d’un protecteur dont ils attendent une faveur, et puis brusquement ils cesseront de le voir et iront jusqu’à se faire ses ennemis.
Pelletier m’avait dit le matin que, pour n’avoir rien à se reprocher, il avait mis son ambition dans sa poche. Je disais à Chenavard que je pensais qu’il était impossible de se trouver mêlé aux affaires des autres et de s’en tirer complètement honnête. « Comment voulez-vous, disait-il, qu’il en soit autrement ? Celui qui prend l’équité pour règle ne peut absolument lutter contre celui qui ne songe qu’à son intérêt : il sera toujours battu dans la carrière de l’ambition. »
Lundi 5 mars. — Le matin, Dubufe[408] est venu me chercher pour voir à la Chambre des députés sa République ; il m’a ramené.
Soleil magnifique. Le temps, depuis quinze jours, et au reste pendant presque tout cet hiver, est d’une douceur extrême. Je n’en suis pas moins horriblement enrhumé, si bien que j’hésitais à aller ce soir chez Boissard.
J’y ai été cependant. La jeune somnambule pantomime devait y venir. Elle n’est venue qu’à onze heures passées, amenée par Gautier, qui avait été la chercher et l’avait trouvée couchée. Elle a une tête charmante et pleine de grâce ; elle a fait à merveille les simagrées de l’endormement. Ses poses contournées et pleines de charme sont tout à fait faites pour les peintres.
En attendant son arrivée, j’ai été avec Meissonier[409] chez lui, voir son dessin de la Barricade. C’est horrible de vérité, et quoiqu’on ne puisse dire que ce ne puisse être exact, peut-être manque-t-il le je ne sais quoi qui fait un objet d’art d’un objet odieux. J’en dis autant de ses études sur nature ; elles sont plus froides que sa composition et tracées du même crayon dont Watteau eût dessiné ses coquettes et ses jolies figures de bergers. Immense mérite malgré cela.
J’y vois de plus en plus, pour mon instruction et pour ma consolation, la confirmation de ce que Cogniet me disait l’année dernière, à propos de l’Homme dévoré par un lion[410], lorsqu’il voyait ce tableau à côté des vaches de Mlle Bonheur[411], à savoir qu’il y a dans la peinture autre chose que l’exactitude et le rendu précis d’après le modèle. J’ai éprouvé ce matin une impression analogue, mais beaucoup plus concevable, puisqu’il s’agissait d’une peinture d’un ordre tout à fait inférieur. En revenant de voir la figure de Dubufe, les peintures de mon atelier et entre autres mon triste Marc-Aurèle[412], que je me suis accoutumée dédaigner, m’ont paru des chefs-d’œuvre. À quoi tient donc l’impression ? Voici assurément : dans le dessin de Meissonier, elle était infiniment supérieure aux études d’après nature.
Fait la connaissance de Prudent[413] ; il imite beaucoup Chopin. J’en ai été fier pour mon pauvre grand homme mourant.
Mercredi 7 mars. — Préault venu le matin. Il y avait bien longtemps que je ne l’avais vu ; il m’a intéressé et amusé. Il a l’air de la bienveillance, sinon les sentiments, et cela me suffit pour me séduire. Au reste, je l’aime beaucoup.
Il me disait, à propos de la Pharsale, que c’était une mine féconde : par exemple, César s’arrêtant au bord du Rubicon, l’Évocation de la Pythonisse, etc. Il me conseille de faire pour l’année prochaine quelque sujet terrible. Cet élément est le plus fort pour frapper tout le monde.
Jeudi 8 mars. — Le soir, Chopin. Vu chez lui un original qui est arrivé de Quimper pour l’admirer et pour le guérir ; car il est ou a été médecin et a un grand mépris pour les homéopathes de toutes couleurs. C’est un amateur forcené de musique ; mais son admiration se borne à peu près à Beethoven et à Chopin. Mozart ne lui paraît pas à la hauteur de ces noms-là ; Cimarosa est perruque, etc.
Il faut être de Quimper pour avoir de ces idées-là, et pour les exprimer avec cet aplomb : cela passe sur le compte de la franchise bretonne… Je déteste cette espèce de caractère ; cette prétendue franchise à l’aide de laquelle on débite des opinions tranchantes ou blessantes est ce qui m’est le plus antipathique. Il n’y a plus de rapports possibles entre les hommes, s’il suffit de cette franchise-là pour répondre à tout. Franchement il faut, avec cette disposition, vivre dans une étable, où les rapports s’établissent à coups de fourche ou de cornes ; voilà de la franchise que je préfère.
— Le matin, chez Couder[414], pour parler du tableau de Lyon. Il est spirituel, et sa femme est fort bien. Si nous avions été francs l’un et l’autre, à la manière de mon Breton, nous nous serions battus avant la fin de la séance ; nous nous sommes, au contraire, quittés en fort bonne intelligence.
Samedi, 10 mars. — Vu Mme de Forget le soir, M. de T… le matin.
J’ai été frappé de son Albert Dürer, et comme je ne l’avais jamais été ; j’ai remarqué, en présence de son Saint Hubert, de son Adam et Ève, que le vrai peintre est celui qui connaît toute la nature. Ainsi ses figures humaines n’ont pas chez lui plus de perfection que celles des animaux de toutes sortes, des arbres, etc. ; il fait tout au même degré, c’est-à-dire avec l’espèce de rendu que comporte l’avancement des arts à son époque. Il est un peintre instructif ; tout, chez lui, est à consulter.
Vu une gravure que je ne connaissais pas, celle du Chanoine luxurieux, qui s’est endormi près de son poêle : le diable lui montre une femme nue, laquelle est d’un style plus élevé qu’à l’ordinaire, et l’Amour tout éclopé cherche à se grandir sur des échasses.
Il ma montré une lettre de mon père ; cela m’a fait plaisir. Ce qui m’a le plus frappé dans ses autographes est un écrit de Léonard de Vinci, sur lequel il y a des croquis où il se rend compte du système antique de dessins par les boules[415] ; il a tout découvert. Ces manuscrits sont écrits à rebours.
Onslow y est venu. La liaison intime qui est entre eux a un peu refroidi mon désir d’être invité à ses quatuors.
— En revenant, travaillé au rideau de table, au Vase de fleurs[416].
Dimanche 11 mars. — Travaillé de bonne heure au tableau des Hortensias et de l’Agapanthus[417]. Je ne me suis occupé que de ce dernier.
— A une heure et demie chez Leblond, pour aller prendre sa femme à Notre-Dame de Lorette, et de là au concert Sainte-Cécile, au bénéfice du monument pour Habeneck[418] : salle immense, foule confuse et sale, quoique le dimanche. Jamais un pareil lieu ne réunira une élite de connaisseurs.
La divine symphonie par ton la entendue avec bonheur, mais avec un peu de distraction, à cause du manque de recueillement de mes voisins. Le reste consacré à des virtuoses qui m’ont fatigué et ennuyé.
J’ai osé remarquer que les morceaux de Beethoven sont en général trop longs, malgré l’étonnante variété qu’il introduit dans la manière dont il fait revenir les mêmes motifs. Je ne me rappelle pas, du reste, que ce défaut me frappât autrefois dans cette symphonie ; quoi qu’il en soit, il est évident que l’artiste nuit à son effet en occupant trop longtemps l’attention.
La peinture, entre autres avantages, a celui d’être plus discrète ; le tableau le plus gigantesque se voit en un instant. Si les qualités de certaines parties attirent l’admiration, à la bonne heure : on peut s’y complaire plus longtemps même que sur un morceau de musique. Mais si le morceau vous paraît médiocre, il suffit de tourner la tête pour échapper à l’ennui. Le jour du concert de Prudent, l’ouverture de la Flûte enchantée m’a paru non seulement ravissante, mais d’une proportion parfaite. Doit-on dire qu’avec le progrès de l’instrumentation, il arrive plus naturellement au musicien la tentation d’allonger des morceaux pour amener des retours d’effets d’orchestre qu’il varie à chaque fois qu’il nous les remontre ?
Il ne faut jamais compter comme un dérangement le temps donné à un concert, pourvu qu’il y ait seulement un bon morceau. C’est pour l’âme la meilleure nourriture. Se préparer, sortir, être distrait même d’occupations importantes, pour aller entendre de la musique, ajoute du prix au plaisir ; je trouve, dans un lieu choisi et au milieu de gens que la communauté des sentiments semble avoir réunis pour une jouissance goûtée en commun ; tout cela, même l’ennui éprouvé en présence de certain morceau et par certain virtuose, ajoute à notre insu à l’effet de la belle chose. Si on était venu m’exécuter cette belle symphonie dans mon atelier, je n’en conserverais peut-être pas à cette heure le même souvenir.
Cela explique aussi comment les grands et les riches sont blasés précocement sur l’effet des plaisirs de toutes sortes. Ils arrivent dans de bonnes loges, garnies de bons tapis, retirés de manière à être le plus possible à l’abri de la distraction que donnent dans un milieu de réunion les tumultes, les dérangements occasionnés par les allants et venants, par les petits troubles de toutes sortes qui s’élèvent dans une foule et semblent devoir fatiguer l’attention. Ils ne viennent qu’au moment précis où commence le morceau important, et par une juste punition de leur peu de dévotion au beau, ils en perdent ordinairement le meilleur en arrivant trop tard. Les habitudes de la société font aussi que les conversations qu’ils ont entre eux à propos du plus frivole motif, ou la survenance de quelque importun leur ôte tout recueillement ; c’est un plaisir très imparfait que d’entendre dans une loge avec des gens du monde la plus belle musique. Le pauvre artiste assis au parterre et seul dans son coin, ou près d’un ami aussi attentif que lui, jouit seul complètement de la beauté d’un ouvrage et à raison de cela en emporte l’impression sans un mélange de souvenir ridicule.
Mardi 13 mars. — Travaillé toute la journée au rideau dans le tableau de la console. Vers la fin de la journée, à la Desdemona.
— Le docteur venu vers cinq heures ; il m’a inquiété ; il parle de petites sondes, etc… Je suis resté au coin du feu.
— Weill[419] a emporté ce matin :
| L’Odalisque, et m’a donné | 200 fr. |
| Hommes jouant aux échecs | 200 » |
| Homme dévoré par le lion | 500 » |
| — (Lefebvre) Christ au pied de la croix | 200 » |
| — (Thomas) Petit Christ aux Oliviers | 100 » |
| Femme turque | 100 » |
| — (Bouquet) Hamlet (Scène du rat) | 100 » |
| — (Weill) Berlichingen écrivant ses Mémoires | 100 » |
| — (Lefebvre) Esquisse, répétition du Christ au tombeau | 200 » |
| — (Lefebvre) Odalisque | 150 » |
| Christ à la colonne | 150 » |
Mercredi 21 mars. — Chez Mercey[420] le soir. Grande soirée. Mon pauvre Mercey acquiert de l’importance ; il a l’air d’un homme d’État. Il était meilleur garçon autrefois. Peut-être est-ce devant le monde qu’il est ainsi. Dans le tête-à-tête avec moi, il est plus simple. Mareste, que je revois avec plaisir, m’apprend qu’Alberthe est partie à Turin auprès de sa fille mourante. En voilà encore une qui mourra seule au monde.
Impression désagréable de toutes ces figures d’artistes attirés chez l’homme qui donne les travaux. J’y avais été à pied, et je pensais trouver chez elle Mme Villot ; elle n’y était pas.
Je suis entré à la Madeleine, où l’on prêchait. Le prédicateur, usant d’une figure de rhétorique, a répété dix ou douze fois, en parlant du juste : Il va en paix !… il va en paix ! « Va en paix » a été ce qu’il y a eu de plus remarquable dans son discours. Je me suis demandé quel fruit pouvait résulter des lieux communs répétés à froid par cet imbécile. Je suis obligé de reconnaître aujourd’hui que cela va avec le reste, fait parti ? de la discipline comme le costume, les pratiques, etc… Vive le frein !
Vendredi 30 mars. — Vu le soir chez Chopin l’enchanteresse Mme Potocka. Je l’avais entendue deux fois ; je n’ai guère rencontré quelque chose de plus complet… Vu Mme Kalerji… Elle a joué, mais peu sympathiquement ; en revanche, elle est vraiment fort belle, quand elle lève les yeux en jouant à la manière des Madeleines du Guide ou de Rubens.
Samedi 31 mars. — Le soir, vu Athalie, avec Mme de Forget dans la loge du président.
Rachel ne m’a pas fait plaisir dans toutes les parties. Mais comme j’ai admiré ce grand prêtre ! Quelle création ! Comme elle semblerait outrée dans un temps comme le nôtre ! et comme elle était à sa place avec cette société ordonnée et convaincue qui a vu Racine et qui l’a fait ce qu’il était ! Ce farouche enthousiaste, ce fanatique verbeux n’est guère de notre temps ; on égorge et on renverse à froid et sans conviction. Mathan, dans sa scène avec son confident, dit trop naïvement : « Je suis un coquin, je suis un être abominable. » Racine sort ici de la vérité, mais il est sublime quand Mathan, sortant tout troublé pour se soustraire aux imprécations du grand prêtre, ne sait plus où il va, et se dirige, sans savoir ce qu’il fait, du côté de ce sanctuaire qu’il a profané et dont l’existence l’importune.
Mercredi 4 avril. — Jour du dîner de Véron[421]. J’étais exténué en y allant.
Je me suis ranimé et amusé. Son luxe est surprenant : des pièces tendues en soie magnifique, le plafond compris ; argenterie somptueuse, musique pendant le dîner : usage, du reste, qui n’ajoute rien à la bonté du dîner et qui déroute la conversation qui en est l’assaisonnement.
Armand Bertin m’a parlé chez Véron d’un livre sur la vie de Mozart, compulsé et extrait de tout ce qui a été fait sur lui ; il m’a promis de me le prêter. Ce livre est très rare, à ce qu’il paraît.
L’homme recommence toujours tout, même dans sa propre vie. Il ne peut fixer aucun progrès. Comment un peuple en fixerait-il un dans sa forme ? Pour ne parler que de l’artiste, sa manière change. Il ne se rappelle plus, après quelque temps, les moyens qu’il a employés dans son exécution. Il y a plus, ceux qui ont systématisé leur manière au point de refaire toujours de même, sont ordinairement les plus inférieurs et froids nécessairement.
Dîné chez Véron avec Rachel, M. Molé, le duc d’Ossuna, général Rulhieri, Armand Bertin, M. Fould, qui était près de moi et s’est montré prévenant. Rachel est spirituelle et fort bien de toutes manières. Un homme né et élevé comme elle serait difficilement devenu ce qu’elle est tout naturellement. Causé le soir avec *** d’Athalie, etc. Il a été fort aimable.
Venu des hommes de toutes couleurs. Une madame Ugalde qui a du succès à présent, à l’Opéra-Comique, a chanté un air du Val d’Andorre ; elle m’est peu sympathique, prononce d’une manière vulgaire et a la juiverie peinte sur la figure… Contraste avec Rachel.
Beaucoup causé musique avec Armand Bertin. Parlé de Racine et de Shakespeare. Il croit qu’on aura beau faire dans ce pays, on en reviendra toujours à ce qui a été le beau une fois pour notre nation ; je crois qu’il a raison. Nous ne serons jamais shakespeariens. Les Anglais sont tout Shakespeare. Il les a presque faits tous ce qu’ils sont, en tout.
Jeudi 5 avril. — Journée d’abattement et de mauvaise santé.
Je suis sorti vers quatre heures, pour aller chez Deforge[422] ; j’y ai rencontré Cabat[423] et Édouard Bertin[424], que j’ai revu avec plaisir.
— Le soir chez Mme de Forget, qui m’a lu un fragment du discours de Barbès[425] devant ses juges. On voit dans les discours de ces gens-là tout le faux et tout l’ampoulé qui est dans leurs pauvres et coupables têtes ; c’est bien toujours la race écrivassière, l’affreuse peste moderne qui sacrifie tranquillement un peuple à des idées de cerveau malade.
« Le but, dit-il, est tout. Sans doute le suffrage universel était quelque chose et avait installé cette Chambre, mais et cette Chambre, et le gouvernement provisoire qui l’avait précédée, sorti aussi, à ce qu’ils croient, d’une espèce de vœu général, tout cela ne lui a pas paru devoir être soutenu, bien plus, lui a semblé devoir être renversé, du moment qu’on s’écartait du but que Barbès avait fixé dans son esprit, malheureusement sans nous prévenir de ce but admirable. Il préfère donc la prison, le cachot plutôt que la douleur d’assister, sans y pouvoir rien changer, à cette déviation sacrilège de ce but suprême de l’humanité. »
Il faudra bien, bon gré, mal gré, que l’humanité finisse par suivre les sublimes aspirations de Barbès.
Dans le discours de Blanqui, quelques jours auparavant, les images prétendues poétiques à la moderne se mêlent à son argumentation ; il parle d’une crevasse qu’il fallait que la Révolution franchît, pour passer des anciennes idées aux nouvelles. L’élan trop faible n’a pas permis de franchir cette fatale crevasse où l’avenir est bien près de se noyer, mais qui n’embourbe pas le moins du monde la rhétorique de Blanqui. Tout est, dans ce style, ardu, crevassé ou boursouflé. Les grandes et simples vérités n’ont pas besoin, pour s’énoncer et pour frapper les esprits, d’emprunter le style d’Hugo, qui n’a jamais approché de cent lieues de la vérité et de la simplicité.
Vendredi (soir) 6 avril. — Au Conservatoire avec Mmes Bixio et Menessier. On m’avait promis Cavaignac[426], et j’ai eu à sa place Ch. Blanc[427]. J’aurais été curieux de voir de près le fameux général. Le concert n’a pas été très beau ; j’avais conservé de la Symphonie héroïque un plus grand souvenir. Décidément Beethoven est terriblement inégal… Le premier morceau est bien ; l’andante, sur lequel je comptais, m’a complètement désappointé. Rien de beau, de sublime comme le début ! Tout d’un coup, vous tombez de cent pieds au milieu de la vulgarité la plus singulière. Le dernier morceau manque également d’unité.
— Je reçois ce soir, en sortant, l’invitation au convoi de M. Dosne[428], mort en deux jours du choléra.
Samedi 7 avril. — Revu Alard[429] au convoi, qui m’entraîne dans sa suite. Il n’est pas assez pénétré du souvenir des vertus de M. Dosne pour aller s’entasser une heure dans une église en son honneur.
De là chez Chopin : Alkan[430] y était. Il me conte un trait de lui dans le genre de mon histoire avec Thiers. Pour avoir tenu tête à Auber, il a éprouvé et éprouvera sans doute de très grands désagréments.
Vers trois heures et demie, accompagné Chopin en voiture dans sa promenade. Quoique fatigué, j’étais heureux de lui être bon à quelque chose… L’avenue des Champs-Élysées, l’Arc de l’Étoile, la bouteille de vin de guinguette ; arrêté à la barrière, etc.
Dans la journée, il m’a parlé musique, et cela l’a ranimé. Je lui demandais ce qui établissait la logique en musique. Il m’a fait sentir ce que c’est qu’harmonie et contrepoint ; comme quoi la fugue est comme la logique pure en musique, et qu’être savant dans la fugue, c’est connaître l’élément de toute raison et de toute conséquence en musique. J’ai pensé combien j’aurais été heureux de m’instruire en tout cela qui désole les musiciens vulgaires. Ce sentiment m’a donné une idée du plaisir que les savants, dignes de l’être, trouvent dans la science. C’est que la vraie science n’est pas ce que l’on entend ordinairement par ce mot, c’est-à-dire une partie de la connaissance différente de l’art ; non ! La science envisagée ainsi, démontrée par un homme comme Chopin, est l’art lui-même, et par contre l’art n’est plus alors ce que le croit le vulgaire, c’est-à-dire une sorte d’inspiration qui vient de je ne sais où, qui marche au hasard, et ne présente que l’extérieur pittoresque des choses. C’est la raison elle-même ornée par le génie, mais suivant une marche nécessaire et contenue par des lois supérieures. Ceci me ramène à la différence de Mozart et de Beethoven. « Là, m’a-t-il dit, où ce dernier est obscur et paraît manquer d’unité, ce n’est pas une prétendue originalité un peu sauvage, dont on lui fait honneur, qui en est cause ; c’est qu’il tourne le dos à des principes éternels ; Mozart jamais. Chacune des parties a sa marche, qui, tout en s’accordant avec les autres, forme un chant et le suit parfaitement ; c’est là le contrepoint, « punto contrapunto. » Il m’a dit qu’on avait l’habitude d’apprendre les accords avant le contrepoint, c’est-à-dire la succession des notes qui mène aux accords… Berlioz plaque des accords, et remplit comme il peut les intervalles.
Ces hommes épris à toute force du style, qui aiment mieux être bêtes que ne pas avoir l’air grave.
Appliquer ceci à Ingres et à son école.
Mardi 10 avril. — Pour la chapelle de Saint-Sulpice : L’archange saint Michel terrassant le démon.
Pour le plafond ou dans la chapelle, ou pour l’un des pendentifs : Jésus-Christ tirant les âmes du purgatoire.
Pour pendentif encore : le Péché originel, ou Adam et Ève après la faute.
Et plus loin, pour le plafond de Saint-Sulpice : la Descente aux limbes. Jésus-Christ est debout, tenant de la main gauche la croix de résurrection. De la main droite, il fait signe à Adam et Ève et à quatre autres saints de sortir de la gueule monstrueuse qui représente l’Enfer, — ou Jésus sortant du tombeau, les soldats renversés alentour.
Mercredi 11 avril. — Je crois que c’est ce soir que j’ai revu Mme Potocka chez Chopin. Même effet admirable de la voix. Elle a chanté des morceaux, des nocturnes et de la musique de piano de Chopin, entre autres celui du Moulin de Nohant, qu’elle arrangeait pour un O salutaris. Cela faisait admirablement. Je lui ai dit ce que je pense très sincèrement : c’est qu’en musique, comme sans doute dans tous les autres arts, sitôt que le style, le caractère, le sérieux, en un mot, vient à se montrer, le reste disparaît. Je l’aime bien mieux quand elle chante le Salice, que tous ses charmants airs napolitains. Elle a essayé le Lac de Lamartine avec l’air si connu et si prétentieux de Niedermeyer. Ce maudit motif ma tourmenté pendant deux jours.
Jeudi 12 avril. — Chez Édouard Bertin. Revu là Amaury Duval[431], Mottez[432], Orsel[433]. Ces gens-là ne jurent que par la fresque ; ils parlent de tous les noms gothiques de l’École italienne primitive, comme si c’étaient leurs amis… La bonne et la mauvaise fresque, la tempérée, etc.
Revenu fort fatigué ; je m’y étais traîné.
Vendredi 13 avril. — Villot venu le matin. Il me parle du projet de Duban[434] de me faire faire dans la galerie restaurée d’Apollon la peinture correspondante à celle de Lebrun. Il lui a parlé de moi dans des termes très flatteurs. Cette initiative de sa part me surprend étrangement, surtout après l’opposition que j’ai faite à ses projets. T… y voit un désir de me ménager. Que m’importe, après tout ?
Ce soir, migraine, et soirée passée tristement chez moi sans dîner.
Samedi 14 avril. — Le soir chez Chopin ; je l’ai trouvé très affaissé, ne respirant pas. Ma présence au bout de quelque temps l’a remis. Il me disait que l’ennui était son tourment le plus cruel. Je lui ai demandé s’il ne connaissait pas auparavant le vide insupportable que je ressens quelquefois. Il m’a dit qu’il savait toujours s’occuper de quelque chose ; si peu importante qu’elle soit, une occupation remplit les moments et écarte ces vapeurs. Autre chose sont les chagrins.
Jeudi 19 avril. — Dîner chez Pierret avec une Mlle Thierry qui accompagne Subetti avec le violon ; le soir, quelques morceaux de Mozart, etc.
Vendredi 20 avril. — Dîner chez Mme H…, et été avec elle au Prophète. Il y avait le prince Poniatowski, M. Richetzki et M. Cabarrus[435]. Je n’ai conservé le souvenir d’aucun morceau frappant ou intéressant.
Samedi 21 avril. — Mme Cavé, venue dans la journée comme j’étais en train de travailler, est restée longtemps. Allé chez le Président le soir.
Dimanche 22 avril. — Resté chez moi, fatigué de la veille.
M. Poujade[436], venu vers une heure, m’a intéressé ; mais resté trop longtemps et fatigué.
Leblond ensuite. Je l’ai vu avec plaisir, malgré ma fatigue ; je l’aime véritablement. La présence d’un ami est chose si rare quelle seule vaut tous les bonheurs ou compense toutes les peines.
Après dîner, chez Chopin, autre homme exquis pour le cœur, et je n’ai pas besoin de dire pour l’esprit. Il m’a parlé des personnes que j’ai connues avec lui… Mme Kalerji, etc. Il s’était traîné à la première représentation du Prophète : son horreur pour cette rapsodie.
— Faire les lettres d’un Romain du siècle d’Auguste ou des Empereurs, démontrant par toutes les raisons que nous trouverions à présent, que la civilisation de l’ancien monde ne peut périr.
Les esprits forts du temps attaquent les augures et les pontifes, croyant qu’ils s’arrêteront à temps.
Rapports avec la civilisation actuelle de l’Angleterre, où les abus maintiennent l’État.
Lundi 23 avril. — Je crois, d’après les renseignements qui nous crèvent les yeux depuis un an, qu’on peut affirmer que tout progrès doit amener nécessairement non pas un progrès plus grand encore, mais à la fin négation du progrès, retour au point d’où on est parti. L’histoire du genre humain est là pour le prouver. Mais la confiance aveugle de cette génération et de celle qui l’a précédée dans les temps modernes, dans je ne sais quel avènement d’une ère dans l’humanité qui doit marquer un changement complet, mais qui, à mon sens, pour en marquer un dans ses destinées, devrait avant tout le marquer dans la nature même de l’homme, cette confiance bizarre que rien ne justifie dans les siècles qui nous ont précédés, demeure assurément le seul gage de ces succès futurs, de ces révolutions si désirées dans les destinées humaines. N’est-il pas évident que le progrès, c’est-à-dire la marche progressive des choses, en bien comme en mal, a amené à l’heure qu’il est la société sur le bord de l’abîme où elle peut bien tomber pour faire place à une barbarie complète ; et la raison, la raison unique n’en est-elle pas dans cette loi qui domine toutes les autres ici-bas, c’est-à-dire la nécessité du changement, quel qu’il soit ?
Il faut changer… Nil in eodem statu permanet. Ce que la sagesse antique avait trouvé, avant d’avoir fait autant d’expériences, il faudra bien que nous l’acceptions et que nous le subissions. Ce qui est en train de périr chez nous se reformera sans doute ou se maintiendra ailleurs un temps plus ou moins long.
L’affreux Prophète, que son auteur croit sans doute un progrès, est l’anéantissement de l’art ; l’impérieuse nécessité où il s’est cru de faire mieux ou autre chose que ce qu’on a fait, enfin de changer, lui a fait perdre de vue les lois éternelles de goût et de logique qui régissent les arts. Les Berlioz, les Hugo, tous les réformateurs prétendus ne sont pas encore parvenus à abolir toutes les idées dont nous parlons ; mais ils ont fait croire à la possibilité de faire autre chose que vrai et raisonnable… En politique de même. On ne peut sortir de l’ornière qu’en retournant à l’enfance des sociétés, et l’état sauvage, au bout des réformes successives, est la nécessité forcée des changements.
Mozart disait : « Les passions violentes ne doivent jamais être exprimées jusqu’à provoquer le dégoût ; même dans les situations horribles, la musique ne doit jamais blesser les oreilles, ni cesser d’être de la musique. » (Revue des Deux Mondes, 15 mars 1849, p. 892.)
Mardi 8 mai. — Dîné chez Mme Kalerji avec Meyerbeer, M. de Pontois, M. de la Redorte[437], de Mézy. On était inquiet de la crise qui commençait[438].
J’ai remarqué les gros pieds et les grosses mains de Meyerbeer.
— Un de ces jours-ci, vu Mme Sand, venue du Berry pour affaires. J’ai été la voir chez Mme Viardot[439], au milieu du jour, et elle a désiré venir voir mes fleurs qui lui ont fait plaisir.
Jeudi 17 mai, Ascension. — A Passy. Vu M. de Rémusat chez M. Delessert. Parlé des affaires du temps.
M. de Vallon m’a fait promettre d’aller le voir en Limousin, si je vais aux Pyrénées.
Entré à l’église de Chaillot. Admiré la pauvreté de deux ou trois tableaux de l’École de David qui y sont, entre autres une Adoration des Rois. Le Saint Joseph est assis sans façon, les pieds pendants et dans l’attitude d’un fumeur dans une tabagie. Le peintre n’a pas senti à quel point les maîtres ont rempli ce personnage d’une sainte abnégation. Il est le principe du tableau… Je passe sur mille impertinences.
Chez Chopin, en sortant ; il allait véritablement un peu mieux. Mme Kalerji y est venue.
Retourné avec M. Herbaut.
Dimanche 20 mai. — Reçu la notification du ministre de l’intérieur et la commande de Saint-Sulpice. J’avais été quelques jours avant faire mes remerciements à Varcollier, chez lui, rue du Mont-Thabor.
Jeudi 31 mai. — Beaux sujets :
Le Christ sortant du tombeau. L’ange éblouissant de lumière ôtant la pierre, les linceuls pendent de ses pieds ; les gardes renversés. Le Christ en jardinier ; la Madeleine à ses pieds éperdue ; le tombeau dans le fond avec les saintes femmes et les disciples éplorés qui ne le voient pas.
— Moïse recevant les Tables de la loi : le peuple au bas de la montagne, les anciens à moitié chemin ; au bas, chevaux, armée, femmes, camp.
— Moïse sur la montagne, tenant les bras élevés : bataille au bas dans des gorges.
— Tour de Babel.
— Apocalypse.
— Lazare et le mauvais riche : les chiens lèchent ses plaies.
— Le héros sur un cheval ailé qui combat le monstre pour délivrer la femme nue.
Vendredi 1er juin. — Travaillé beaucoup ce matin et jours précédents pour terminer la petite Fiancée d’Abydos[440] et la Baigneuse de dos[441].
Vers trois heures au Musée, pour mettre la petite retouche à mon tableau. Vu le tableau de Cœdès[442], qui m’a fait le plus grand plaisir : il y a mille études à en faire.
Villot m’a fait remarquer dans la grande salle française la supériorité que témoigne une telle École. Très frappé surtout de Gros et principalement de la Bataille d’Eylau ; tout m’en plaît à présent. Il est plus maître que dans Jaffa ; l’exécution est plus libre.
Dans la grande galerie, admiré les Rubens : sa figure de la Victoire placée dans lavant-dernier tableau. Comme cette figure tranche sur les autres ! les jambes même semblent faites par un autre que le maître ; le soin s’y montre ; mais la sublime tête en feu et le bras plié,… tout cela est le génie même.
Les Sirènes également ne m’ont jamais semblé si belles. L’abandon seul et l’audace la plus complète peuvent produire de semblables impressions.
Vu le Christ ressuscitant, du Carrache. Le terne et le poids de cette peinture m’ont fait voir ce que le sujet a de beau. L’ange, les yeux brillants comme un éclair, écartant la pierre ; le Christ éblouissant de lumière, s’élançant du sein de la mort, et les gardes renversés de tous côtés.
Samedi 2 juin. — Mme de Querelles m’a dit qu’elle avait vu chez un doreur le petit Arabe à cheval arrivant au galop sur cheval alezan. Elle m’a raconté les mêmes impressions que j’éprouve moi-même devant les sublimes Rubens ; c’est incroyable dans une personne du monde !… La peinture, dit-elle, quand elle a ce genre de verve naturelle, la transporte comme la musique, lui fait battre le cœur. Elle me l’a répété sur tous les tons.
Impressions favorables à la fougue et au sentiment naturel.
— Le Bouclier magique. — Relire la Jérusalem.
— Les sujets de Roméo : Juliette endormie : ses parents la croient morte.
— Jésus présenté au peuple par Pilate.
— Jésus devant Caïphe, le grand prêtre, déchirant ses habits.
— Jésus insulté par les soldats.
Revoir pour ces sujets la petite Passion d’Albert Dürer.
— Baiser de Judas.
— Jésus entre les mains des soldats.
— Madeleine essuyant les pieds du Christ.
— Le Repas chez Simon.
Mardi 5 juin. — Parti pour Champrosay à huit heures du soir ; trouvé tout en désordre dans le petit jardin ; été chercher de l’eau à la petite source pour faire de l’eau de Seltz avec la nouvelle machine que j’ai apportée.
Mercredi 6 juin. — En mettant la tête à la fenêtre, le matin, je vois Dupré qui allait passer la journée chez Mme Quantinet ; je me suis engagé à y aller l’après-midi. J’y ai été effectivement et ai fait la connaissance d’une personne très aimable et par-dessus le marché très bonne musicienne.
J’allais, en sortant de là, dîner chez Mme Villot, qui m’avait fait inviter le matin. Je ne la savais pas à Champrosay, cela m’a surpris agréablement. Après le dîner, promenade dans le jardin et remonté dans le salon achever la soirée.
Champrosay. — Dimanche 17 juin. — Villot qui était ici depuis huit jours est reparti ce soir avec sa femme, emmenant ses enfants qu’on avait tirés du collège, à cause du choléra. La présence de Villot m’a été douce pendant cette semaine. Tous les matins, je travaillais assidûment, et il venait l’après-midi.
— J’ai ébauché depuis mon arrivée et jusqu’au 26, jour où je retourne à Paris pour deux jours :
Tarn O’Shanter[443].
Une petite Ariane[444].
Daniel dans la fosse aux lions[445], — sur papier.
Un Giaour au bord de la mer[446].
Un Arabe à cheval descendant une montagne.
Un Samaritain[447].
Travaillé à la petite Fiancée d’Abydos[448].
à l’Ugolin[449].
à la Desdémone[450].
à Lady Macbeth[451].
Je me trouve souvent dans l’embarras le matin, quand il faut reprendre une besogne, dans la crainte de ne pas trouver mes peintures assez sèches.
Dimanche 24 juin. — Mauvaise disposition dans la matinée. Essayé d’esquisser un Samson et une Dalila[452] : j’en suis resté au crayon blanc.
L’après-midi, j’ai été à la forêt, par l’entrée du maquis : je n’avais pas vu ce côté depuis l’année dernière. Je me suis mis en tête de faire un bouquet de fleurs des champs que j’ai formé à travers les halliers, au grand détriment de mes doigts et de mes habits écorchés par les épines ; cette promenade m’a paru délicieuse. La chaleur, qui avait été étouffante et orageuse dans la matinée, était d’une autre nature, et le soleil donnait à tout une gaieté que je ne trouvais pas autrefois au soleil couchant… Je suis, en vieillissant, moins susceptible des impressions plus que mélancoliques que me donnait l’aspect de la nature ; je m’en félicitais tout en cheminant. Quai-je donc perdu avec la jeunesse ?… Quelques illusions qui me remplissaient à la vérité et passagèrement d’un bonheur assez vif, mais qui étaient cause, par cela même, d’une amertume proportionnée.
En vieillissant, il faut bien s’apercevoir qu’il y a un masque sur presque toutes choses, mais on s’indigne moins contre cette apparence menteuse, et on s’accoutume à se contenter de ce qui se voit.
Lundi 9 juillet. — Chez Piron, pour M. Duriez[453] : je le trouve on ne peut plus aimable. Il me retient à dîner pour le soir avant mon retour à Champrosay.
Samedi 14 juillet. — Travaillé à l’Ugolin et fait le soir la vue de ma fenêtre[454].
Dimanche 15 juillet. — J’écris à Peisse[455], à propos de son article du 8. Lundi 23 juillet. — Je dînais chez Mme de Forget avec Cavé, sa femme, etc.
Le soir, M. Meneval[456] me parlait de l’affreuse conduite des généraux et maréchaux de l’Empereur, à Arcis-sur-Seine ou sur Aube. M. F…, logeant dans une autre maison que celle de l’Empereur, et traversant une place pour se rendre près de lui, trouva un groupe de généraux, parmi lesquels le maréchal Ney, qui délibéraient entre eux s’ils ne feraient pas subir à leur bienfaiteur le sort de Romulus : le tuer, l’enterrer là, leur semblait un moyen comme un autre de se débarrasser et d’aller jouir dans leur hôtel ; c’était, disaient-ils, le fléau de la France, etc. L’Empereur, à qui M. F… raconta la chose avec l’émotion concevable, se contenta de dire qu’ils étaient fous.
Le maréchal Ney fut le plus inconvenant vis-à-vis de lui, après la bataille de la Moskowa,… se plaignant qu’en ménageant la garde, il l’avait privée des fruits d’une victoire plus complète. Ce fut encore lui le plus cruel à Fontainebleau ; il alla jusqu’à menacer l’Empereur de lui faire un mauvais parti, s’il n’abdiquait pas.
Dans le cours de la campagne de Russie, dans un village où l’Empereur, étant logé à l’étroit, n’avait pu avoir près de lui le prince Berthier, M. Meneval, ayant été le trouver pour les affaires de l’armée, le trouva la tête dans les mains, la figure couverte de larmes ; il lui demanda la cause de son chagrin. Berthier ne craignit pas de lui dire combien il était affreux de se voir contrarié sans fin dans ses entreprises : « A quoi sert, disait-il, d’avoir des richesses, des hôtels, des terres, s’il faut sans cesse faire la guerre et compromettre tout cela ? »
Napoléon n’opposait que la patience à leurs plaintes et à leurs reproches souvent odieux ; il les aimait, malgré leur ingratitude, et comme de vieux compagnons.
Avant les dernières années, me disait M. Meneval, personne n’avait osé se permettre une observation devant un ordre de lui… La confiance l’avait en partie abandonné, mais point du tout la sûreté et la fermeté de son génie, comme la campagne de France l’a si bien prouvé. Si à Waterloo, à la fin de la bataille, il eût eu sous la main cette réserve de la garde qu’il refusa d’engager à la Moskowa, il eût encore gagné la bataille, malgré l’arrivée des Prussiens.
Je demandai à M. Meneval s’il n’avait pas été tout à fait indisposé à la Moskowa, suivant l’opinion accréditée généralement. Il fut effectivement souffrant et atteint, surtout après la bataille, d’une telle extinction de voix qu’il lui fut impossible de donner un ordre verbal. Il était obligé de griffonner ses ordres sur des chiffons de papier ; cependant il avait toute sa tête. Mais après la bataille de Dresde, l’indisposition subite dont il fut saisi paralysa toutes les opérations, entraînant la défaite de Vandamme, etc.
Pendant le consulat, il était fort souffrant de la gale rentrée qu’il avait contractée au siège de Toulon. Il s’appuyait contre sa table, se pressant le côté avec les mains dans des crises de souffrances violentes. Sa pâleur, sa maigreur, à cette époque, expliquent cet état maladif. Corvisart le débarrassa, au moins en apparence, de son mal, mais il est probable que le mal dont il mourut doit sa cause première à cette cruelle maladie.
Paris. — Samedi 11 août. — J’ai passé plus d’un mois à Paris. Je n’ai pas, je crois, noté l’époque de mon retour de la campagne, le samedi, probablement.
J’ai dîné chez Chabrier. Je voulais lui parler de l’affaire de Villot et de la commission dont Chabrier fait partie pour juger le règlement futur du Musée et les attributions des conservateurs. Je lui ai remis la note de Villot.
Vers neuf heures et demie, pris une calèche et été chez Villot. Je n’ai trouvé que sa femme. Elle était encore sur sa chaise longue à travailler. Elle était fort bien ainsi, tout en blanc, avec des fleurs charmantes sur le petit guéridon. J’ai attendu Villot jusqu’à onze heures.
Samedi 18 août. — Retourné le soir chez Chabrier pour avoir la réponse de la note. Il m’en a parlé comme un homme qui avait étudié la chose. Le directeur du Musée avec lequel il s’est trouvé à la commission l’avait captivé jusqu’à un certain point.
Retourné achever la soirée chez Villot, j’ai vu là le joli nécessaire, etc.
Charnprosay. — Samedi 25 août. — Revenu de Paris par le chemin de fer de cinq heures. F… était dans la voiture en petite veste pour aller dîner chez M. V…
Villot était dans le même convoi. Remonté avec lui à Charnprosay. Il a voulu que je vinsse le voir le soir, mais j’étais fatigué.
Dimanche 26 août. — Longue séance avec Villot chez moi. Il me parle des baigneurs installés chez lui. Je dîne effectivement avec tout ce monde-là. Le soir ils partent tous. Nous allons les conduire au chemin de fer, ainsi que M. B…, qui en était.
Mercredi 29 août. — Il y a quelques jours à peine que je suis revenu du long séjour que j’ai fait à Paris. J’ai été en bateau avec Mme Villot et son fils, qui ont tous deux la fureur des bains. Dîné avec elle et passé agréablement la soirée.
Vendredi 31 août. — J’ai reçu avant-hier du bon N… une invitation pour aller passer deux ou trois jours à Écoublay, et lui ai répondu.
Je dînais ces jours avec M. Villot et M. Bontemps ; ce dernier m’a appris la mort de Mme de Mirbel[457]. J’ai été très affecté de ce malheur.
Le soir, après dîner, resté au clair de lune dans le jardin. M. Bontemps nous a fort divertis par des chansons et coq-à-l’âne de toute espèce. Partie de loto avant de se séparer.
Samedi 1er septembre. — Parti à huit heures moins un quart avec Jenny ; courses diverses avant d’arriver à la maison. Le temps était assommant ; je n’en pouvais plus, et, ce qu’il y a de singulier, les pressentiments de tristesse que je sentais avaient moi-même pour objet.
Parti à deux heures et demie par l’affreuse diligence de Fontenay. Confusion incroyable : foule de chasseurs et de chiens.
3 septembre. — La lettre de l’architecte Baltard[458] qui m’apprend la nécessité de changer mes sujets pour Saint-Sulpice.
Champrosay. — Samedi 15 septembre. — Dîné avec M. Villot.
Soirée insipide ; jetais mal disposé et me suis retiré plus tôt.
Je ne vaux pas grand’chose ce soir ; le dîner est une affaire. Je déjeune si peu que l’appétit m’entraîne le soir, et que je suis plus disposé au sommeil qu’à la conversation.
Dimanche 16 septembre. — Bonne journée. Composé et ébauché le matin la Femme qui se peigne et Michel-Ange dans son atelier[459].
Promenade charmante dans la forêt, par un petit sentier tout à fait nouveau, derrière le terrain de Lamouroux, en allant vers la gauche, le chêne d’Antin à droite.
Vu la fourmilière, sur laquelle je me suis amusé à écrire dans mon calepin.
Le soir chez M. Quantinet. Sonates de Beethoven, avec violon. Il avait été question de dîner chez eux avec Chenavard et Dupré ; ces messieurs n’ont pu venir.
Lundi 17 septembre. — Je me lève toujours avec un malentrain incroyable. — Hier, où j’ai tant travaillé, c’était de même… Je me suis remis : j’ai retouché l’ébauche en grisaille de la Femme qui se peigne, et puis dessiné et ébauché entièrement en peu de temps l’Arabe qui grimpe sur des roches pour surprendre un lion[460].
28 septembre. — J’étais mal disposé ; j’ai été chercher la grosse Bible ; pensé beaucoup de sujets.
Le soir, resté chez moi et dormi.
Mardi 2 octobre (SS. Anges gardiens). — C’est aujourd’hui que j’ai arrêté avec le curé et son vicaire, M. Goujon, que je ferais les Saints Anges, et je m’aperçois, en écrivant ceci, que c’est le jour même de leur fête que j’ai pris ce parti.
Rouen. — Jeudi 3 octobre. — Le retard que j’ai mis à mon départ qui devait avoir lieu hier est cause que j’ai manqué à Rouen l’occasion de voir mon tableau de Trajan[461]. Quand je suis arrivé au Musée, il était depuis le matin seulement couvert à moitié par des charpentes élevées pour l’exposition des peintres normands… Si j’avais persévéré dans mes projets, je l’aurais vu à mon aise.
Je ne me rappelle pas qu’un de mes tableaux, vu dans une galerie longtemps après l’avoir oublié, m’ait fait autant de plaisir. Malheureusement une des parties les plus intéressantes, la plus intéressante peut-être, était cachée, c’est-à-dire la femme aux genoux de l’Empereur… Ce que j’ai pu en voir m’a paru d’une vigueur et d’une profondeur qui éteignaient sans exception tout ce qui était alentour. Chose singulière ! le tableau paraît brillant, quoiqu’en général le ton soit sombre.
— Parti à huit heures au lieu de sept ; j’ai fort pesté de n’avoir retardé mon départ que pour ne pas partir à sept heures et d’arriver sottement, pour ne pas m’être informé, une heure plus tôt qu’il ne fallait. Du reste, placé comme je désirais, la route m’a semblé charmante. La forêt de Saint-Germain, à partir de Maisons, occupe les deux côtés de la route. Il y a là des clairières, des allées couvertes, etc., dont l’aspect est délicieux.
Arrivé à Rouen à midi et demi. Ces tunnels sont bien dangereux. Je passe sur l’immense danger ; ils ont encore l’ennui de couper la route sottement. Déjeuné fort bien à l’Hôtel de France, où je me suis trouvé avec plaisir, en pensant au premier voyage que j’ai fait dans ce pays.
Vers trois heures au Musée ; j’ai eu le désappointement dont je viens de parler. J’ai remarqué pour la première fois deux ou trois tableaux de Lucas de Leyde, ou dans son genre, qui m’ont charmé. Grande délicatesse dans l’expression des détails qui rendent le tempérament, la finesse de la peau et des cheveux, la grâce des mains, etc. La peinture traitée largement ne peut donner ce genre d’impressions. — Berger, au-dessus de ces tableaux. — Admiré les Bergers de Rubens. Il y a à côté un tableau de H…, qui représente le Christ devant Pilate ; je l’avais précédemment admiré, à cause de la naïveté et de la vérité de l’aspect… A côté des bergers de Rubens, il redescend jusqu’à n’être que des portraits de modèles.
A Saint-Ouen ensuite. Ce lieu m’a toujours donné une sublime impression ; je ne compare aucune église à celle-là.
Rentré fatigué et peu dispos. Dîné tard et peu. Ressorti pour une seconde. Trempé par la pluie qui est continuelle dans le pays, je suis rentré vers dix heures.
Samedi 6 octobre. — Ce jour, sorti tard.
Vu la cathédrale, qui est à cent lieues de produire l’effet de Saint-Ouen ; j’entends à l’intérieur, car extérieurement, et de tous côtés, elle est admirable. La façade : entassement magnifique, irrégularité qui plaît, etc… Le portail des libraires aussi beau.
Ce qui m’a le plus touché, ce sont les deux tombeaux de la chapelle du fond, mais surtout celui de M. de Brézé. Tout en est admirable, et en première ligne la statue. Les mérites de l’Antique s’y trouvent réunis au je ne sais quoi moderne, à la grâce de la Renaissance : les clavicules, les bras, les jambes, les pieds, tout cela d’un style et d’une exécution au-dessus de tout. L’autre tombeau me plaît beaucoup, mais l’exécution a quelque chose de singulier ; peut-être est-ce l’effet de ces deux figures posées là comme au hasard. Celle du cardinal, en particulier, est de la plus grande beauté, et d’un style qu’on ne peut comparer qu’aux plus belles choses de Raphaël… : la draperie, la tête, etc.
A Saint-Maclou ; vitraux superbes, portes sculptées, etc. ; le devant sur la rue a gagné à être dégagé. On a fait là depuis quelques années une nouvelle rue à la moderne qui va jusqu’au port.
Rentré d’assez bonne heure, après avoir été à Saint-Patrice, dont les vitraux sont beaux, mais m’ont ému faiblement. (Se rappeler l’allégorie de la Chute de l’homme et de la femme; le démon à côté, ensuite la Mort qui apprête son dard, et enfin le Péché, sous les traits d’une femme couverte de parures, mais les yeux fermés et liée d’une chaîne.)
Dîné à trois heures ; parti à quatre heures et demie. Cette route faite le soir par un temps riant et charmant… Dérangé par les caquetages d’un jeune avocat, insolent comme tous les jeunes gens, et de son client, bavard insupportable.
A Yvetot, désappointement. Pris un cabriolet ; arrivé tard. La grande allée du château a disparu J’ai éprouvé là l’émotion la plus vive du retour dans un endroit aimé[462]. Mais tout est défiguré… le chemin est changé, etc.
Le lendemain dimanche 7, visité le jardin tout mouillé. Je n’ai pas été trop désappointé. Les arbres ont grandi dans une proportion extraordinaire et donnent à l’aspect quelque chose de plus triste qu’autrefois, mais dans certaines parties un caractère presque sublime. La montagne à gauche vue d’en bas, avant d’arriver aux petites cascades ; les arbres verts entourés de lierre vers le pont. Malheureusement le lierre qui les embrasse et fait un bel effet, les dévore et les fera périr avant peu.
Après déjeuner, visité avec Bornot et Gaultron la chapelle[463]. Le temps est mauvais et nous tient enfermés.
Avant dîner, j’étais souffrant. Je ne suis pas très bien depuis mon arrivée à Rouen. Nous sommes sortis malgré la pluie et avons grimpé la côte d’Angerville… Ces routes sont devenues superbes.
Le lendemain, journée de pluie tellement continue, qu’il ne m’a pas été possible de mettre le pied dehors. Quelques personnes à dîner : le curé, personnage grassouillet, qui sourit à chaque instant avec un petit sifflement entre les dents et qui ne dit mot ; la directrice des postes, personne aimable, et la bonne madame d’Argent. Joué au billard, etc.
Mardi 9 octobre. — Par quelle triste fatalité l’homme ne peut-il jamais jouir à la fois de toutes les facultés de sa nature, de toutes les perfections dont elle n’est susceptible qu’à des âges différents ? Les réflexions que j’écris ici m’ont été suggérées par cette parole de Montesquieu, que je trouvai ici ces jours-ci, à savoir qu’au moment où l’esprit de l’homme a atteint sa maturité, son corps s’affaiblit.
Je pensais à propos de cela qu’une certaine vivacité d’impression, qui tient plus à la sensibilité physique, diminue avec l’âge. Je n’ai pas éprouvé, en arrivant ici, et surtout en y vivant quelques jours, ces mouvements de joie ou de tristesse dont ce lieu me remplissait, mouvements dont le souvenir m’était si doux… Je le quitterai probablement sans éprouver ce regret que j’avais autrefois. Quant à mon esprit, il a, bien autrement qu’à l’époque dont je parle, la sûreté, la faculté de combiner, d’exprimer ; l’intelligence a grandi, mais l’âme a perdu son élasticité et son irritabilité. Pourquoi l’homme, après tout, ne subirait-il pas le sort commun des êtres ? Quand nous cueillons le fruit délicieux, aurions-nous la prétention de respirer en même temps le parfum de la fleur ? Il a fallu cette délicatesse exquise de la sensibilité au jeune âge pour amener cette sûreté, cette maturité de l’esprit. Peut-être les très grands hommes, et je le crois tout à fait, sont-ils ceux qui ont conservé, à l’âge où l’intelligence a toute sa force, une partie de cette impétuosité dans les impressions,… qui est le caractère de la jeunesse ?
Passé la matinée à lire Montesquieu.
— A Fécamp, vers deux heures ; la mer était magnifique. Beaux aspects de la vallée. Après dîner, discussion politique.
— Je comparais ces jours-ci les peintures qui sont dans le salon du cousin. Je me suis rendu compte de ce qui sépare une peinture qui n’est que naïve, de celle qui a un caractère propre à la faire durer. En un mot, je me suis souvent pris à me demander pourquoi l’extrême facilité, la hardiesse de touche, ne me choquent pas dans Rubens, et qu’elles ne sont que de la pratique haïssable dans les Vanloo… j’entends ceux de ce temps-ci comme ceux de l’autre. Au fond, je sens bien que cette facilité dans le grand maître n’est pas la qualité principale ; qu’elle n’est que le moyen et non le but, ce qui est le contraire dans les médiocres… J’ai été confirmé avec plaisir dans cette opinion, en comparant le portrait de ma vieille tante[464] avec ceux de l’oncle Riesener. Il y a déjà, dans cet ouvrage d’un commençant, une sûreté et une intelligence de l’essentiel, même une touche pour rendre tout cela qui frappait Gaultron lui-même. Je n’attache d’importance à ceci que parce que cela me rassure… Une main vigoureuse, disait-il, etc.
— Le temps est tout à fait beau : nous avons été à Saint-Pierre[465], à travers la vallée.
Revu, en y allant, Angerville, où je suis venu, il y a tant d’années, avec ma bonne mère, ma sœur, mon neveu, le cousin,… tous disparus ! Cette petite maison est toujours là, comme la mer que l’on voit de là, et qui y sera encore à son tour, quand la maison aura disparu.
Nous sommes descendus à la mer par un chemin à droite, que je ne connaissais pas ; c’est la plus belle pelouse en pente douce que l’on puisse imaginer. L’étendue de mer que l’œil embrasse de la hauteur est des plus considérables. Cette grande ligne bleue, verte, rose, de cette couleur indéfinissable qui est celle de la vaste mer, me transporte toujours. Le bruit intermittent qui arrive déjà de loin et l’odeur saline enivrent véritablement.
— Je m’aperçois que mes belles réflexions des pages précédentes m’ont empêché de noter, je ne sais plus quel jour, notre première course à Fécamp, par un temps tout différent… La mer était forte et se brisait admirablement contre la jetée… Nous avons vu sortir deux petits bâtiments.
Aujourd’hui elle est, au contraire, très calme, et je l’adore ainsi, avec le soleil, qui semait d’étincelles et de diamants le côté d’où il venait, et donnait de la gaieté à cette nappe majestueuse.
Nous avons visité la maison du curé, qui a appartenu au bon M. Hébert. Décidément c’est un peu triste ; un solitaire surtout finirait par s’y changer en pierre.
On démolit l’ancienne église du lieu, qui est charmante, pour en faire une neuve. Nous avons été indignés.
Mercredi 10 octobre. — Le lendemain à Cany.
Quelques futaies ont disparu le long de la route, mais elles ne font pas encore de tort à la vue qu’on a du château. Ce lieu enchanteur ne m’avait jamais fait autant de plaisir… Se rappeler ces masses d’arbres, ces allées ou plutôt ces percées qui, se continuant sur la montagne avec les allées qui sont en bas, produisent l’effet d’arbres entassés les uns sur les autres.
Le parc est plein de magnifiques arbres, dont les branches touchent à terre, entre autres le plateau qui est à droite en venant du bout du parc. Beautés des eaux.
Revenus par Ourville. En remontant de Cany, belle vue. Tons de cobalt apparaissant dans les masses de verdure du fond et parfois doré des devants. Vu à Cany M. Foy, vieilli comme les autres.
Jeudi 11 octobre. — À Fécamp l’après-midi.
Nous allions surtout pour voir Mme Laporte[466] ; j’y suis arrivé seul, en attendant Bornot et sa femme. La pauvre dame ne voulait d’abord recevoir personne, mais en apprenant mon nom, elle m’a fait venir près d’elle ; je l’ai trouvée dans ce qui était sa salle à manger sans doute, parce que cette pièce est au rez-de-chaussée et plus à portée pour les soins que son état exige, mais seule dans un petit lit, toute diminuée elle-même et dans un grand état de maigreur. Elle a éprouvé beaucoup de sensibilité en me voyant ; je lui rappelais des moments et des personnes disparus depuis longtemps, au moment où elle sent bien qu’elle va tout quitter à son tour. J’ai tenu avec plaisir sa main maigrie et ridée.
Bornot et sa femme sont survenus. Elle nous a parlé de ses maux, ce qui est tout simple, mais avec une grande liberté, plaisantant même avec cette humeur qu’elle a toujours eue. Nous l’avons quittée au bout de quelques instants. Ce spectacle m’a beaucoup touché.
Nous sommes entrés un instant dans ce salon où elle ne doit plus rentrer et où nous avons passé des moments si gais avec le bon cousin, avec Riesener, avec tous les originaux qui composaient sa société, et qui m’ont bien l’air de ne guère s’informer d’elle à présent.
Nous allions vers le port, au-devant de Gaultron. Nous sommes revenus sans avoir été jusqu’à la mer, ce qui a été pour moi une mystification.
Passé assez de temps à voir chez un orfèvre des pendeloques anciennes du pays, et revenu plus tard à Valmont par une pluie qui me gâte bien ce pays-ci.
Vendredi 12. — La petite Mme Duglé, fille de Zimmerman[467], est venue déjeuner avec sa sœur. Journée de pluie complète.
Samedi 13. — Matinée employée à terminer la lecture d’Arsace et Isménie[468], de Montesquieu. Tout le talent de l’auteur ne peut vaincre l’ennui de ces aventures rebattues, de ces amours, de cette constance éternelle ; la mode et, je crois aussi, un sentiment de la vérité, ont relégué ces sortes d’ouvrages dans l’oubli.
Avant déjeuner, examiné les vitraux. Se rappeler ce beau caractère raphaélesque et plus encore corrégien : le beau et simple modelé et la hardiesse de l’indication. Contours noirs très prononcés pour la distance, etc. Après déjeuner, au cimetière.
Auparavant vers Saint-Ouen, chez une pauvre fabricante de mouchoirs au métier. Pauvres gens ! on leur paye vingt francs les vingt-quatre douzaines de ces mouchoirs ; cela ne fait pas vingt sous pour chaque douzaine.
La chapelle où repose le corps de Bataille ne me plaît pas. Je regrette de n’avoir pas été consulté.
Tué le temps jusqu’à dîner. Dormi dans ma chambre, puis fait un tour de parc à la nuit tombante. Ce parc et ces arbres gigantesques ont pris un aspect qui est presque lugubre ; mais en vérité, si l’on pouvait, en peinture, rendre de pareils effets, ce serait ce que j’ai vu en paysage de plus sublime. Je ne peux rien comparer à cela… Cette forêt de colonnes formées par les sapins, le vieux noyer en montant, etc.
Le pharmacien M. Leglay, la directrice des postes, venus dîner.
Dimanche 14 octobre. — Aux Petites-Dalles avec Bornot. Gaultron, qui part demain, était resté à peindre.
Passé devant le château de Sassetot. Environs magnifiques ; la descente pour aller à la mer. Effet de ces grands bouquets de hêtres. Arrivé à la mer par une ruelle étroite ; on la découvre tout au bout du chemin.
Mer basse. J’ai été sur les rochers et ramassé deux des coquillages qu’on y trouve collés ; j’ai essayé de les manger… chair dure, sauf un je ne sais quoi de jaune qui a un goût agréable de moule.
Fait plusieurs croquis.
Lundi 15 octobre. — Accompagné Gaultron avec Bornot jusqu’à la route d’Yvetot. Revenu avec Bornot par les bois de M. Barbet, pour descendre au vivier. Grand couvert de hêtres en haut ; allées de sapins.
Traversé sur le flanc de la colline des herbages par lesquels nous sommes descendus au vivier qui est charmant et nettoyé. J’y ai vu voler des cygnes pour la première fois. Revenu mourant de faim.
Dans la journée, qui était belle, été aux Grandes-Dalles. Le même chemin jusqu’à Sassetot, seulement pris à gauche. J’ai admiré la porte de l’église sur le cimetière ; elle est évidemment un ouvrage de fantaisie et faite par un ouvrier qui avait du goût. Elle montre combien cette dernière qualité est le nerf de cet art pour lequel les livres ont des proportions toutes faites, qui n’engendrent que des ouvrages dénués de tout caractère.
— Dessiné. La mer basse encore.
— Ce jour-là et l’avant-veille, promenade le matin avant déjeuner avec Bornot, dans son bois au-dessus du parc ; jolies allées.
Mardi 16 octobre. — J’ai été seul avant déjeuner sur la route de Fécamp. J’ai voulu grimper dans le petit bois à gauche et dans les jolies prairies où sont les sapins. Arrêté par les haies et les clôtures, à chaque pas. Le peuple qui sera toujours en majorité, se trompe en croyant que les grandes propriétés n’ont pas une grande utilité ; c’est aux pauvres gens qu’elles sont utiles, et le profit qu’ils en retirent n’appauvrit pas les riches, qui les laissent profiter de petites aubaines qu’ils y trouvent.
Le laisser-aller du bon cousin faisait le bonheur des pauvres ramasseurs de fougère et de branches sèches ; les petits bourgeois enrichis s’enferment chez eux et barricadent partout les avenues. Les pauvres, privés complètement de ce côté, ne profitent même pas des droits dérisoires que leur donne l’État républicain.
Bornot me donnait, à déjeuner, le résultat de l’élection pour un député dans le canton. Sur 4,360 inscrits, à peine 1,600 ont pris part au vote. A Limpiville, personne ne se présentait ; le maire désolé a appelé les citoyens par toutes les manières. Dans d’autres communes, c’était à peu près de même, et cependant le vote a lieu le dimanche.
En revenant, déjeuné. J’ai traversé la vallée vers le moulin, qui est à cheval sur la rivière, qu’on passe sur une planche. Revu le chemin qu’on prenait si souvent derrière le lavoir ; là, les bois de B… enceints encore d’un fossé. Nouvelles réflexions analogues à celles ci-dessus. Le chemin, à partir du lavoir pour rentrer à la maison, ne passe plus le long des murs. Tout cela est refait à la Louis-Philippe.
Bornot me rappelait que c’est à ce lavoir que j’embrassais la petite femme du maçon, qui était si gentille, et qui venait de temps en temps rendre ses devoirs au vieux cousin[469].
— A Fécamp, avec toutes ces dames, chez le bijoutier, pâtissier, papetier ; acheté un carton.
Vu l’église auparavant. J’avais oublié son importance. Charmantes chapelles autour du chœur, séparées par des clôtures à jour d’un charmant goût. Tombeaux d’évêques ou abbés. Petites figures au tombeau et grand tombeau de la Vierge aux figures grandes coloriées ; les poses sont si naïves, et il y a tant de caractère, que le coloriage ne les gâte pas trop. L’une des têtes m’a paru celle du Laocoon, bien surpris de se trouver en pareil lieu et en pareille compagnie. Il y a une de ces figures qui tient un encensoir, et qui souffle dessus pour en ranimer les charbons. — Chapelle de la Vierge avec vitraux du treizième siècle, semblables à ceux de la cathédrale de Rouen. — Belle copie de l’Assomption du Poussin, à l’autel de cette chapelle. — Charmant ouvrage d’albâtre ou de marbre pour contenir le précieux sang, adossé à l’autel principal. Petites figures dans le style de Ghiberti[470]. — Les figures dont j’ai parlé sont à droite, au pied d’un grand crucifix ; à gauche, il y a un tombeau où l’on voit le Christ couché sous l’autel, à travers des treillages. — En face, copie du Fra Bartolomeo du Musée.
En allant au port, il faisait très beau temps. Les montagnes qui mènent à la mer, magnifiques et grandioses.
La mer, basse comme je ne l’ai jamais vue ici, est on ne peut plus majestueuse dans son calme et par ce beau temps.
Causé avec un pilote de la plus belle figure.
Mercredi 17 octobre. — Passé toute la journée sans sortir, malgré le beau temps. Nous nous sommes occupés des vitraux ; cela m’a fatigué. Avant de dîner, fait un tour dans le parc ; c’est un lieu enchanteur : ces arbres, ces cygnes, etc.
— J’ai pensé avec plaisir à reprendre certains sujets, surtout le Génie arrivant à l’immortalité[471]. Il serait temps de mettre en train celui-là et le Léthé, etc.
— Le soir, vu le four à chaux : arbres éclairés vivement ; l’intérieur de la fournaise ; flammes vertes, la chaux éclatante de blancheur, avec des veines de feu incandescent.
Jeudi 18 octobre. — Dans la matinée, avant déjeuner, délicieux temps ; dessiné dans le jardin des masses d’arbres ; le soleil du matin y donne des effets charmants.
Parti vers deux heures pour Fécamp ; nous voulions aller aux fameux Trous aux chiens. Cet ignoble sobriquet, appliqué aux beaux phénomènes que j’ai vus là, dépose contre la petite dose de poésie de notre peuple et son peu d’imagination… Nous sommes arrivés trop tôt, et je suis resté longtemps sur la jetée. La mer très bonne à étudier.
Partis pour notre excursion quand la mer a été assez basse. Il est bien difficile de décrire ce que j’ai vu, et malheureusement ma mémoire sera bien peu fidèle pour se le rappeler. La mer n’étant pas d’abord assez basse, nous avons eu quelque peine à arriver jusqu’à ces piliers, qui semblent d’architecture romane, et qui soutiennent la falaise, en laissant une percée par-dessous. Ensuite deux magnifiques amphithéâtres à plusieurs rangs, les uns au-dessus des autres, dont un beaucoup plus vaste que l’autre.
Dans l’un d’eux, je crois, cette grotte profonde, qui semble la retraite d’Amphitrite. Enfin, pour conclure, la grande arche par laquelle on aperçoit un autre amphithéâtre avec ces espèces de promontoires réguliers en forme de champignons placés à côté les uns des autres, et qui sont là comme des niches d’animaux féroces dans un cirque romain.
Nous nous sommes arrêtés là, apercevant de loin quelques beautés qui nous ont paru inférieures, et qui de près, peut-être, auraient mérité notre admiration.
Le sol, sous cette arche étonnante, semblait sillonné par les roues des chars et simulait les ruines d’une ville antique. Ce sol est ce blanc calcaire dont les falaises sont presque entièrement faites. Il y a des parties sur les rocs qui sont d’un brun de terre d’ombre, des parties très vertes et quelques-unes creuses. Les pierres détachées par terre sont généralement blanches. On voit courir sous ses pieds de petites souris qui vont rejoindre la mer.
Revenus très rapidement. Le soleil était couché.
Vendredi 19 octobre. — Je lis ce matin, dans Montesquieu, une peinture à grands traits des exploits de Mithridate. La grande idée qu’il donne du caractère de ce roi diminue beaucoup dans mon esprit l’impression que m’avait laissée la pièce de Racine. Décidément ces petites histoires amoureuses mêlées à la peinture d’un pareil colosse, le réduisent à la proportion d’un homme de notre temps. Quand on songe que Mithridate était une espèce de barbare, commandant à des nations féroces, on se le figure difficilement occupé d’intrigues d’intérieur. … Au reste, il faudrait relire.
— Je recule de jour en jour l’instant de mon départ.
… Ils sont aimables pour moi, et cette molle flânerie dans un lieu que j’aime me berce, et me fait reculer le moment de reprendre mon train de vie ordinaire.
Lu le matin Montesquieu, Grandeur et décadence.
Promené dans le jardin, avant déjeuner. Après cela, en bateau avec la cousine et une partie des petites filles[472] ; j’étais fatigué de la course de la veille et aussi de la vie que je mène, et surtout de ces repas, de ces vins, etc.
Je me suis occupé l’après-midi à composer avec des fragments de vitraux la fenêtre que Bornot veut mettre à l’ouverture laissée dans la chapelle de la Vierge.
Le soir, plusieurs parties de billard avec la cousine, pendant que Bornot dessinait les vues qui nous ont frappés dans les falaises.
Samedi 20 octobre. — J’ai appris, après déjeuner, la mort du pauvre Chopin. Chose étrange, le matin, avant de me lever, j’étais frappé de cette idée. Voilà plusieurs fois que j’éprouve de ces sortes de pressentiments.
Quelle perte ! Que d’ignobles gredins remplissent la place, pendant que cette belle âme vient de s’éteindre !
— Promenades dans le jardin… Adieu à ces beaux lieux, dont le charme est vraiment délicieux… Ce charme est bien peu goûté par les habitants de ce manoir. Au milieu de tout cela, le bon cousin ne nous a parlé que d’acres de terre, de réparations, de murs, ou des querelles du conseil municipal. Il en résulte que la plupart du temps je demeure muet et consterné. Les repas surtout, où l’on s’épanche d’ordinaire, sont à la glace. Sont-ils heureux ainsi ?
Promenade avec Bornot à Angerville, dans le char à bancs. On a coupé la plupart des sapins qui étaient aux environs de l’église. Hélas ! ces lieux ont encore moins changé que les personnes que j’y ai vues.
Revenus par Boudeville, et visité la petite église, Touché extrêmement de cet endroit : le presbytère est charmant… Je parlais à Bornot de la condition tranquille du curé d’un lieu pareil. Mes considérations ne le touchent pas, et au retour il est retombé dans les acres de terre, les herbages, etc.
En redescendant par le chemin creux qui borde son bois, il m’a montré ses améliorations : défrichements, four à briques, etc.
Nous sommes repassés devant le cimetière : je n’ai pu m’empêcher de penser à la petite place qu’occupe le bon Bataille… J’étais muet, triste, gelé ; mais pas le moindre sentiment d’envie.
Dimanche 21 octobre. — Perdu la journée. Nous devions aller à Fécamp. À peine hors de Valmont, une petite pluie fine a découragé le cousin, qui n’avait peut-être pas grande envie d’y aller.
Nous sommes rentrés, et je me suis mis à faire ma malle.
La directrice des postes dînait. J’ai été assez révolté de certaines duretés.
Lundi 22 octobre. — Je lis ce matin dans la Description de Paris et de ses édifices, publiée en 1808, le détail effrayant des richesses, des monuments en tous genres qui ont disparu des églises pendant la Révolution. Il serait curieux de faire un travail sur cette matière, pour édifier sur le résultat le plus clair des révolutions.
Mardi 23 octobre. — Le matin, examiné de nouveau les vitraux et achevé de composer la fenêtre de Bornot, pour la chapelle de la Vierge. Le vitrier m’a réparé ceux que j’emporte.
J’ai été à Saint-Pierre seul avec Malestrat. J’ai beaucoup étudié la mer, qui était toujours la même et toujours belle.
A dîner la petite Mme Duglé, sa sœur, une madame Cardon et sa fille, de Fécamp.
Mercredi 24 octobre. — Parti à neuf heures et demie avec Bornot. Pris l’ancienne route d’Ypreville, par le plus beau temps du monde. J’ai parcouru avec bien du plaisir cette route. Revu la futaie à l’entrée d’Ypreville. Embarqué à Alvimare.
Cette route est toute changée depuis trois semaines : tons dorés et rouges des arbres. Ombres bleues et brumeuses.
A Rouen vers une heure, et fait toute la route jusqu’à Paris sans compagnon de route. Avant Rouen, il était venu une délicieuse femme avec un homme âgé ; j’ai beaucoup joui de sa vue, pendant le peu de temps qu’elle a passé dans la voiture.
J’étais assez mal disposé. J’avais déjeuné sans faim, et cette disposition, qui m’a empêché de manger toute la journée, a agi sur mon humeur. Admiré cependant les bords de la Seine, les rochers qu’on voit le long de la route, depuis Pont-de-l’Arche jusqu’au delà de Vernon, ces mamelons presque réguliers, qui donnent un caractère particulier à tout ce pays, Mantes, Meulan. Aperçu Vaux, etc.
Triste en arrivant : la migraine y contribuait. Attendu longtemps pour les paquets. Trouvé Jenny qui m’attendait. Je n’ai pas été fâché de trouver, en arrivant, ses bons soins.
Sans date. — Passé les jours suivants dans l’oisiveté. Quelques visites.
Vu Mme Marliani qui m’avait écrit ; elle a passé un mois à Nohant, et y a été malade. Mme Sand est triste et ennuyée. Elle a maintenant la fureur du domino. Elle grondait tout de bon cette pauvre Charlotte de ne point sentir toutes les profondeurs de combinaisons que renferme ce sublime jeu. On fait aussi des charades où elle fait sa partie. Les costumes l’occupent.
Clésinger, que j’ai rencontré dans la rue, m’a envoyé sa femme, qui est venue me prendre pour me faire voir la statue qu’il a faite pour le tombeau de Chopin. Contre mon attente, j’ai été tout à fait satisfait. Il m’a semblé que je l’aurais faite ainsi. En revanche, le buste est manqué. D’autres bustes d’hommes que j’ai vus là m’ont déplu. Solange me disait qu’il cherchait à varier son genre. En effet, j’ai vu là une figure de l’Envie, qui n’accuse guère que l’imitation de Michel-Ange. Cependant, en sortant de l’imitation exacte du modèle que son premier ouvrage indiquait comme sa vocation, il montre de l’imagination et une entente de la grâce des lignes, qui est fort rare. Il fait un groupe en pierre d’une Pieta, dans lequel on trouve ce mérite.
1850
7 janvier. — Haro m’a rapporté les deux petites études que j’ai faites à Champrosay[473], de ma fenêtre, l’une de la cour des gendarmes, l’autre par la salle à manger, l’été avec des moissons, etc.
Lui redemander l’Arabe accroupi, qui devait être sur la grande toile où était la Suzanne[474], que j’ai achevée pour Villot.
12 janvier. — Travaillé à retoucher le petit Hamlet, la Femme de dos, de Beugniet[475] ; ébauché un petit lion pour le même.
Voir Gavard[476], Cavé, Rivet, Couder, Guillemardet, Halévy, la princesse Marcellini[477]. Passé chez les Wilson-Quantinet. Voir Meissonier et Daumier.
18 janvier. —
« Mon cher Monsieur, j’apprends à l’instant que M. de Mornay, dont les procédés avec moi ne me commandent point de ménagements, a mis en vente, à la rue des Jeûneurs, six tableaux de moi, dont l’un, la Cléopâtre, ne m’a pas été payé, depuis plusieurs années qu’il l’a chez lui. Je désirerais donc, si vous croyez que la chose soit faisable, mettre de suite opposition à la vente dudit tableau, afin de le ravoir du moins ; car, dans l’état de ruine où se trouve M. de Mornay, j’aurais encore plus de peine à en recouvrer le prix. Peut-être vous demandé-je une chose qui exigerait des formalités que j’ignore ? peut-être aussi le temps vous manque-t-il ?… Je laisse cela à votre appréciation, pensant bien que vous ne consentiriez pas à me voir m’engager dans une sotte affaire. J’avoue que le trait me semble si fort qu’il m’a semblé que je serais plus que dupe en ne protestant pas pour le moins.
Si je calcule bien, il n’y aurait pas de temps à perdre : nous sommes aujourd’hui vendredi ; il est probable que la vente aura lieu demain. »
Dimanche 20 janvier. — Concert de l’Union musicale. Symphonie de Mozart ; admirable ouverture de Coriolan, de Beethoven.
Entendu deux fois et mal composé.
21 janvier. — J’avais écrit derrière la toile du petit Christ à la colonne que j’envoie à Gaultron : blanc, momie, vermillon ; je me rappelle que j’avais employé pour les ombres laque Robert J. et terre verte, ou bien vert malachite clair.
A Gaultron, prêté le tableau de fruits de Chardin. Rendu à la fin d’avril.
Jeudi 24. — Donné à Haro, pour la rentoiler, la petite étude de l’Étang de Louroux ; ciel grisâtre clair.
Composé la Pandore sur toile assez grande.
Vendredi 25 janvier. — Je pensais que les artistes qui ont un style assez vigoureux sont dispensés de l’exécution exacte, témoin Michel-Ange. Arrivé à ce point, ce qu’ils perdent en vérité littérale, ils le regagnent bien en indépendance et en fierté.
30 janvier. — Soirée chez Gudin[478]. Je disais à Pradier que je dînais très fortement, ne pouvant déjeuner à cause de mon travail, et que pour faire passer ce dîner, je faisais force exercice ensuite. Il me dit : « Quand on a une vieille voiture, on ne lui fait pas faire de longs voyages ; on la met sous la remise, et on ne l’en tire que pour le besoin et pour des courses légères. »
Revenu à deux heures du matin, très fatigué ; premier oubli de la leçon que je venais de recevoir.
31 janvier. — « Ne négligez rien de ce qui peut vous faire grand », m’écrivait le pauvre Beyle[479].
— Cette réflexion [au 20 février] me fait surmonter l’ennui de me déranger pour aller en Belgique.
Lundi 4 février. — Faire à Saint-Sulpice[480] des cadres de marbre blanc, autour des tableaux ; ensuite cadres de marbre rouge ou vert, comme dans la chapelle de la Vierge, et le fond du tout en pierre avec ornements en pierre, et imitant l’or, comme les cuivres dorés de la même chapelle. (Si on pouvait faire les cadres en stuc blanc.)
La dimension du plafond est de 15 pieds[481].
— Magnifiques tons d’ombre reflétée dans une chair rouge : vert cobalt, vermillon Chine, ocre jaune ; je l’ai employé pour fondre les touches de terre de Sienne brûlée et autres tons chauds qui formaient la préparation des hommes qui regardent par le trou, dans le Daniel.
Les clairs, sur ces préparations, peuvent se faire et ont été faits avec laque fixe, ocre jaune et blanc.
L’ocre jaune pur, ton le plus vrai et le plus frappant pour les lions.
Mardi 5 février. — Très beau ton pour les chairs très claires, pour servir d’intermédiaires entre les plus grands clairs et les ombres : terre de Cassel, blanc, vermillon, ocre jaune.
— Dîné chez Ed. Bertin. Revu là Mme P…, avec laquelle j’ai causé beaucoup. Fleury Cuvillier[482] et sa femme y étaient. Desportes[483] m’a entrepris sur la dévotion, il a trouvé en moi un terrain tout préparé ; mais au fond c’est un fou. Il regarde Mozart comme un grand corrupteur, il lui préfère beaucoup les vieux maîtres, y compris Rameau.
Jeudi 7 février. — Hecquet, au concert, l’autre jour, me citait un critique connu, qui appelle Mozart le premier des musiciens médiocres.
À ce concert et au suivant, je comparais les deux ouvertures de Beethoven à celle de la Flûte enchantée, par exemple, et à tant d’autres de Mozart… Quelle réunion, dans ces dernières, de tout ce que l’art et le génie peuvent donner de perfection ! Dans l’autre, quelles incultes et bizarres inspirations !
Vendredi 8 février. — Ce serait une bonne chose, en commençant, que d’établir la gamme d’un tableau par un objet clair dont le ton et la valeur seraient exactement pris sur nature : un mouchoir, une étoffe, etc. Ciceri me conseillait cela il y a quelques années.
10 février. — Chez Bixio le soir[484]. Avant dîner, chez Louis Guillemardet.
Duverger me disait en revenant que B*** était sans imagination et avait du feu, et que lui (Duverger) était presque tout le contraire ; c’est la réunion de ces deux facultés, l’imagination et la raison, qui fait les hommes exceptionnels.
Il me présente l’idée originale et pourtant assez raisonnable que la tradition napoléonienne est le résultat nécessaire de la révolution.
11 février. — Dîné chez Meissonier avec Chenavard. Fait là, inter pocula, le beau projet d’aller en Hollande voiries dessins de Raphaël. Chenavard dit à dîner que Raphaël lui déplaisait parce qu’il le trouvait impersonnel, c’est-à-dire se métamorphosant à mesure que d’autres personnalités vigoureuses le frappaient : le contraire de Michel-Ange, Corrège, Rembrandt, etc…
13 février. — Retravaillé au Saint Sébastien.
— Vu la princesse Marcellini, vers trois heures ; j’ai été bien frappé de ce qu’elle m’a joué de Chopin. Rien de banal, composition parfaite. Que peut-on trouver de plus complet ? Il ressemble plus à Mozart que qui que ce soit. Il a, comme lui, de ces motifs qui vont tout seuls, qu’il semble qu’on trouverait.
Jeudi 14 février. — Travaillé à la Femme impertinente. Je l’avais reprise, il y a dix ou douze jours.
— Je commence à prendre furieusement en grippe les Schubert, les rêveurs, les Chateaubriand (il y a longtemps que j’avais commencé), les Lamartine, etc. Pourquoi tout cela se passe-t-il ? Parce que ce n’est point vrai… Est-ce que les amants regardent la lune, quand ils trouvent près d’eux leur maîtresse ?… À la bonne heure, quand elle commence à les ennuyer.
Des amants ne pleurent pas ensemble ; ils ne font pas d’hymnes à l’infini, et font peu de descriptions. Les heures vraiment délicieuses passent bien vite, et on ne les remplit pas ainsi.
Les sentiments des Méditations sont faux, aussi bien que ceux de Raphaël, du même auteur. Ce vague, cette tristesse perpétuelle ne peignent personne. C’est l’école de l’amour malade… C’est une triste recommandation, et cependant les femmes font semblant de raffoler de ces balivernes ; c’est par contenance ; elles savent bien à quoi s’en tenir sur ce qui fait le fond même de l’amour. Elles vantent les faiseurs d’odes et d’invocations, mais elles attirent et recherchent soigneusement les hommes bien portants et attentifs à leurs charmes.
— Ce même jour, Mme P… est venue avec sa sœur, la princesse de B… La nudité de la Femme impertinente[485], et celle de la Femme qui se peigne, lui ont sauté aux yeux : … « Que pouvez-vous trouver là de si attrayant, vous autres artistes, vous autres hommes ? Qu’est-ce que cela a de plus intéressant que tout autre objet vu dans sa nudité, dans sa crudité, une pomme, par exemple ? »
— J’avais cheminé, vers quatre heures et demie, avec le vieux père Isabey[486]. Il m’a fait un cours sur les lunettes. C’est Charles qui lui a donné le conseil d’avoir ses lunettes divisées en deux. Il lui a dit : « Change de verre, aussitôt que tu t’aperçois que tes yeux se fatiguent le moins du monde. » En ne le faisant pas, on risque d’être forcé de sauter un numéro, ce qui m’est arrivé. « Tu vivrais, lui a-t-il dit, comme Mathusalem, que tu aurais encore de quoi y voir clair. » — Il fait de petits repas assez fréquents : cela lui réussit.
Samedi 16 février. — J’ai revu chez M. de Geloës mon tableau du Christ au tombeau qu’il éclaire le soir avec un quinquet ad hoc ; il ne m’a pas déplu.
Dimanche 17 février. — Passé toute ma journée en état de langueur, et je n’avais à faire que des besognes ennuyeuses. Je ne fais rien qui me prépare à ce voyage de Hollande, et cela, pendant que je suis fort bien en train de peindre. Le soir, dîné chez Mme de Forget.
Mardi 19 février. — Dîné avec Chenavard, Meissonier. — Parlé du voyage qui, j’espère, ne se fera pas. (Voir au 31 janvier précédent.)
Chez Berlioz ensuite ; l’ouverture de Léonore m’a produit la même sensation confuse ; j’ai conclu qu’elle est mauvaise, pleine, si l’on veut, de passages étincelants, mais sans union. Berlioz de même : ce bruit est assommant ; c’est un héroïque gâchis.
Le beau ne se trouve qu’une fois et à une certaine époque marquée. Tant pis pour les génies qui viennent après ce moment-là. Dans les époques de décadence, il n’y a de chance de surnager que pour les génies très indépendants. Ils ne peuvent ramener leur public à l’ancien bon goût qui ne serait compris de personne ; mais ils ont des éclairs qui montrent ce qu’ils eussent été dans un temps de simplicité. La médiocrité dans ces longs siècles d’oubli du beau est bien plus plate encore que dans les moments où il semble que tout le monde puisse faire son profit de ce goût du simple et du vrai qui est dans l’air. Les artistes plats se mettent alors à exagérer les écarts des artistes mieux doués, ce qui est la platitude à force d’enflure, ou bien ils s’adonnent à une imitation surannée des beautés de la bonne époque, ce qui est le dernier terme de l’insipidité. Ils remontent même en deçà. Ils se font naïfs avec les artistes qui ont précédé les belles époques. Ils affectent le mépris de cette perfection, qui est le terme naturel de tous les arts.
Les arts ont leur enfance, leur virilité et leur décrépitude. Il y a des génies vigoureux qui sont venus trop tôt, de même qu’il y en a qui viennent trop tard ; dans les uns et les autres, on trouve des saillies singulières. Les talents primitifs n’arrivent pas plus à la perfection que les talents des temps de la décadence. Du temps de Mozart et de Cimarosa, on compterait quarante musiciens qui semblent être de leur famille, et dont les ouvrages contiennent, à des degrés différents, toutes les conditions de la perfection. À partir de ce moment, tout le génie des Rossini et des Beethoven ne peut les sauver de la manière. C’est par la manière qu’on plaît à un public blasé et avide par conséquent de nouveautés ; c’est aussi la manière qui fait vieillir promptement les ouvrages de ces artistes inspirés, mais dupes eux-mêmes de cette fausse nouveauté qu’ils ont cru introduire dans l’art. Il arrive souvent alors que le public se retourne vers les chefs-d’œuvre oubliés et se reprend au charme impérissable de la beauté.
Il faudrait absolument écrire ce que je pense du gothique ; ce qui précède y trouverait naturellement sa place.
Dimanche 24 février. — Pierret venu me voir dans la journée avec son fils Henry, qui va en Californie. Je lui ai donné le Petit Lion.
Le soir, au divin Mariage secret, avec Mme de Forget. Cette perfection se rencontre dans bien peu d’ouvrages humains.
On pourrait refaire pour tous les beaux ouvrages restés dans la mémoire des hommes ce que de Piles[487] fait pour les peintres seulement… Je me suis interrogé là-dessus, et pour ne parler que de la musique, j’ai successivement préféré Mozart à Rossini, à Weber, à Beethoven, toujours au point de vue de la perfection. Quand je suis arrivé au Mariage secret, j’ai trouve non pas plus de perfection, mais la perfection même. Personne n’a cette proportion, cette convenance, cette expression, cette gaieté, cette tendresse, et par-dessus tout cela, et ce qui est l’élément général, qui relève toutes ces qualités, cette élégance incomparable, élégance dans l’expression des sentiments tendres, élégance dans le bouffon, élégance dans le pathétique modéré qui convient à la pièce.
On est embarrassé pour dire en quoi Mozart peut être inférieur à l’idée que j’ai ici de Cimarosa. Peut-être une organisation particulière me fait-elle incliner dans le sens où j’incline ; cependant une raison comme celle-là serait la destruction de toute idée du goût et du vrai beau ; chaque sentiment particulier serait la mesure de ce beau et de ce goût. J’osais bien me dire aussi que je trouvais dans Voltaire un coin fâcheux, rebutant pour un adorateur de son admirable esprit ; c’est l’abus de cet esprit même. Oui, cet arbitre du goût, ce juge exquis abuse aussi des petits effets ; il est élégant, mais spirituel trop souvent, et ce mot est une affreuse critique. Les grands auteurs du siècle précédent sont plus simples, moins recherchés.
— J’ai été voir à quatre heures les études de Rousseau, qui m’ont fait le plus grand plaisir… Exposés ensemble, ces tableaux donneront de son talent une idée dont le public est à cent lieues, depuis vingt ans que Rousseau est privé d’exposer[488].
Mardi 26 février. — J’ai été convoqué par Durieu[489], pour juger le procédé Haro, que nous devons aller voir fonctionner à Saint-Eustache.
J’ai appris là ce que l’univers ne croira pas : la cathédrale de Beauvais manque d’une aile qui n’a jamais été achevée ; ladite cathédrale est d’un gothique mêlé du seizième siècle. On discute sérieusement si le morceau qui reste à faire sera refait dans le style du reste ou dans celui du treizième siècle, qui est le style favori des antiquaires dans ce moment. De cette manière, on apprendrait à vivre à ces ignorants du seizième siècle, qui ont eu le malheur de n’être pas nés trois siècles plus tôt.
Après la commission, j’ai été voir Duban, en société de Vaudoyer[490], qui est dans mes idées sur l’architecture. Vu Duban.
Vu la galerie d’Apollon, etc.
Mercredi 27 février. — Je travaille aux croquis pour Saint-Sulpice à soumettre à la Préfecture.
Vers trois heures, j’ai été voir Cavé, qui a été mordu par son chien au point d’avoir failli en perdre le nez et la mâchoire. Le Constitutionnel a imprimé qu’il en était quitte seulement pour le premier des deux. Les amis alarmés viennent les uns après les autres s’informer de ce qui lui reste réellement, et il a pris le parti d’écrire au journal pour lui demander grâce.
Vendredi 1er mars. — Vu l’exposition des tableaux de Rousseau pour sa vente. Charmé d’une quantité de morceaux d’une originalité extrême.
Dimanche 3 mars. — A l’Union musicale : Symphonie en fa, de Beethoven, pleine de fougue et d’effet ; puis l’ouverture d’Iphigénie en Aulide y avec toute l’introduction, airs d’Agamemnon, et le chœur de l’arrivée de Clytemnestre.
L’ouverture, un chef-d’œuvre : grâce, tendresse, simplicité et force par-dessus tout. Mais il faut tout dire : toutes ces qualités vous saisissent fortement, mais la monotonie vous endort un peu. Pour un auditeur du dix-neuvième siècle, après Mozart et Rossini, cela sent un peu le plain-chant. Les contrebasses et leurs rentrées vous poursuivent comme les trompettes dans Berlioz.
Tout de suite après venait l’ouverture de la Flûte enchantée ; à la vérité, c’est un chef-d’œuvre. J’ai été aussitôt saisi de cette idée, en entendant cette musique qui venait après Glück. Voilà donc où Mozart a trouvé, et voici le pas qu’il lui a fait faire ; il est vraiment le créateur, je ne dirai pas de l’art moderne, car il n’y en a déjà plus à présent, mais de l’art porté à son comble, après lequel la perfection ne se trouve plus.
Je disais à la princesse Radoïska, chez laquelle j’ai été en sortant de là : « Nous savons par cœur Mozart et tout ce qui lui ressemble. Tout ce qui a été fait à leur imitation et dans ce style ne le vaut pas, et nous a d’ailleurs fatigués ou rassasiés. Que faire pour être émus de nouveau ?… surtout surpris ? Se contenter des tentatives hardies, mais moins souvent heureuses, des génies quelquefois très éminents que le siècle produit. Que feront ces derniers, quand les modèles semblent n’être là que pour montrer ce qu’il faut éviter ? Il est impossible qu’ils ne tombent pas dans la recherche. »
Lundi 4 mars. — Au Louvre pour la restauration.
Vendredi 8 mars. — A l’atelier de Clésinger. Scène pitoyable avec ce butor et notre comité.
Samedi 9 mars. — Je suis accablé de toutes ces corvées successives.
— Plusieurs jours se passent à ne rien faire jusqu’au lundi 11.
Lundi 11 mars. — Repris le dernier tableau de fleurs.
A notre comité chez Pleyel à une heure.
Le soir, chez Mme Jaubert[491]. Vu des portraits et dessins persans, qui m’ont fait répéter ce que Voltaire dit quelque part, à peu près ainsi : Il y a de vastes contrées où le goût n’a jamais pénétré ; ce sont ces pays orientaux, dans lesquels il n’y a pas de société, où les femmes sont abaissées, etc. Tous les arts y sont stationnaires.
Il n’y a dans ces dessins ni perspective ni aucun sentiment de ce qui est véritablement la peinture, c’est-à-dire une certaine illusion de saillie, etc. : les figures sont immobiles, les poses gauches, etc… Nous avons vu ensuite un portefeuille de dessins d’un M. Laurens[492], qui a voyagé dans toutes ces contrées.
Chose qui me frappe surtout, c’est le caractère de l’architecture en Perse. Quoique dans le goût arabe, tout néanmoins est particulier au pays ; la forme des coupoles, des ogives, les détails des chapiteaux, les ornements, tout est original. On peut, au contraire, parcourir l’Europe aujourd’hui, et depuis Cadix jusqu’à Pétersbourg, tout ce qui se fait en architecture a l’air de sortir du même atelier. Nos architectes n’ont qu’un procédé, c’est de revenir toujours à la pureté primitive de l’art grec. Je ne parle pas des plus fous, qui font la même chose pour le gothique ; ces puristes s’aperçoivent tous les trente ans que leurs devanciers immédiats se sont trompés dans l’appréciation de cette exquise imitation de l’Antique. Ainsi Percier et Fontaine ont cru dans leur temps l’avoir fixé pour jamais. Ce style, dont nous voyons les restes dans quelques pendules faites il y a quarante ans, paraît aujourd’hui ce qu’il est véritablement, c’est-à-dire sec, mesquin, sans aucune des qualités de l’Antique.
Nos modernes ont trouvé la recette de ces dernières dans les monuments d’Athènes. Ils se croyaient les premiers qui les aient regardés ; en conséquence, le Parthénon devient responsable de toutes leurs folies. Quand j’ai été à Bordeaux, il y a cinq ans, j’ai trouvé le Parthénon partout : casernes, églises, fontaines, tout en tient. La sculpture de Phidias obtient le même honneur auprès des peintres. Ne leur parlez même pas de l’antique romain ou du grec d’avant ou d’après Phidias.
J’ai vu, parmi les dessins faits en Perse, un entablement complet, chapiteaux, frise, corniche, etc., entièrement dans les proportions grecques, mais avec des ornements qui le renouvellent complètement, et qui sont d’invention.
— Dans la journée, j’avais été chez Pleyel, me réunir à ces messieurs pour finir l’affaire de Clésinger.
— Se rappeler dans les dessins persans ces immenses portails à des édifices qui sont plus petits qu’eux ; cela ressemble à une grande décoration d’opéra dressée devant le bâtiment. Je n’en sache pas d’exemple nulle part.
16 mars. — Mme Cavé est venue et m’a lu quelques chapitres de son ouvrage sur le dessin. C’est charmant d’invention et de simplicité… Je l’ai revue avec plaisir et j’ai causé de même.
Le soir chez Chabrier avec Mme de Forget. Je me suis ennuyé.
Dimanche 17 mars. — Union musicale. Concert : Symphonie d’Haydn, admirable d’un bout à l’autre. Chef-d’œuvre d’ordre et de grâce ; Concerto pour le piano de Mozart, autant ; Chœur Que de grâces, de Glück, suivi d’un petit air de ballet ridicule, qu’on aurait dû laisser dans l’oubli, par respect pour sa mémoire.
Vendredi, 19 mars. — Soirée de musique chez le Président. Causé là avec Fortoul[493], qui est fort aimable pour moi. Je m’y suis enrhumé. C’est le souvenir le plus saillant de la soirée. — Thiers y est venu. Cela a fait une certaine sensation.
Jeudi 21 mars. — Toute la journée chez moi, occupé de mes esquisses pour la Préfecture.
Tous les jours derniers, occupé de la composition du plafond du Louvre[494]. Je m’étais d’abord arrêté pour les Chevaux du soleil dételés par les nymphes de la mer. J’en suis revenu jusqu’à présent à Python.
Vendredi 22 mars. — Lettre de Voltaire, dans laquelle il s’écrie à propos du Père de famille de Diderot, que tout s’en va, tout dégénère ; il compare son siècle à celui de Louis XIV.
Il a raison. Les genres se confondent ; la miniature, le genre succèdent aux genres tranchés, aux grands effets et à la simplicité. J’ajoute : Voltaire se plaint déjà du mauvais goût, et il touche pour ainsi dire au grand siècle ; sous plus d’un rapport, il est digne de lui appartenir. Cependant le goût de la simplicité, qui n’est autre chose que le beau, a disparu !…
— Comment les philosophes modernes qui ont écrit tant de belles choses sur le développement graduel de l’humanité, accordent-ils, dans leur système, cette décadence des ouvrages de l’esprit avec le progrès des institutions politiques ? Sans examiner si ce dernier progrès est un bien aussi réel que nous le supposons, il est incontestable que la dignité humaine a été relevée, au moins dans les lois écrites ; mais est-ce la première fois que des hommes se sont aperçus qu’ils n’étaient pas tout à fait des brutes et ne se sont pas laissé gouverner en conséquence ? Ce prétendu progrès moderne dans l’ordre politique n’est donc qu’une évolution, un accident de ce moment précis. Nous pouvons demain embrasser le despotisme avec la fureur que nous avons mise à nous rendre indépendants de tout frein.
Ce que je veux dire ici, c’est que, contrairement à ces idées baroques de progrès continu que Saint-Simon et autres ont mises à la mode, l’humanité va au hasard, quoi qu’on ait pu dire. La perfection est ici quand la barbarie est là. Fourier ne fait pas au genre humain l’honneur de le trouver adulte. Nous ne sommes encore que de grands enfants ; du temps d’Auguste et de Périclès, nous étions dans les langes ; nous avons balbutié à peine sous Louis XIV avec Racine et Molière. L’Inde, l’Égypte, Ninive et Babylone, la Grèce et Rome, tout cela a existé sous le soleil, a porté les fruits de la civilisation à un point dont l’imagination des modernes se fait à peine une idée, et tout cela a péri, sans laisser presque de traces ; mais ce peu qui est resté pourtant est tout notre héritage ; nous devons à ces civilisations antiques nos arts, dans lesquels nous ne les égalerons jamais, le peu d’idées justes que nous avons sur toutes choses, le petit nombre de principes certains qui nous gouvernent encore dans les sciences, dans l’art de guérir, dans l’art de gouverner, d’édifier, de penser enfin. Ils sont nos maîtres, et toutes les découvertes dues au hasard, qui nous ont donné de la supériorité dans quelques parties des sciences, n’ont pu nous faire dépasser le niveau de supériorité morale, de dignité, de grandeur qui élève les anciens au-dessus de la portée ordinaire de l’humanité. Voilà ce que n’a pas vu Fourier avec son association, son harmonie, ses petits pâtés et ses femmes complaisantes.
Mercredi 27 mars. — Beau ton de cheveux châtain clair dans la Desdémone : frottis de bitume, sur fonds assez clairs. Clairs : terre verte brûlée et blanc.
Demi-teinte de la chair du saint Sébastien : bitume, blanc, laque terre verte, un peu de jaune brillant ; clairs, jaune brillant, blanc, laque. Un peu de bitume, suivant le besoin.
Dimanche 31 mars. — Énée va tuer Hélène, qui se cache dans le temple de Vesta. Vénus vient l’arrêter.
— Les Harpies troublent le repos des Troyens.
— Villot venu me voir ce matin : tous ces jours-ci je reste chez moi, grâce à mon affreux rhume qui ne se guérit pas.
Ce soir cependant dîné chez Pierret ; son fils va partir.
Mercredi 3 avril. — Séance pour juger le concours de restauration Séance dans la galerie d’Apollon, en présence de mon plafond. Revenu très fatigué.
J’aurai des difficultés dans l’atelier qu’on me donne au Louvre.
Samedi 6 avril. — Travaillé beaucoup ces jours-ci à la composition du plafond. Un de ces jours, j’ai été trop longtemps et me suis fatigué.
Lundi 8 avril. — Je devais aller assister tantôt à la séance de jugement des restaurateurs de tableaux ; j’ai été obligé de me recoucher le matin et ai été très souffrant toute la journée.
J’ai fait venir le docteur. Au demeurant, c’était un état passager ; je n’ai eu à le consulter que sur mon rhume. J’ai causé avec lui des affaires du temps, puis de sa profession.
Le pauvre homme n’a pas un moment de relâche. En comparant sa vie à la mienne, je me suis applaudi de mon lot… Les cours, l’hôpital, les examens lui prennent tout le temps qu’il ne donne pas à ses malades, aux opérations, etc. Aussi me dit-il qu’il se sent très souvent très lourd et très fatigué. Dupuytren est mort sous le faix et dans un âge peu avancé. C’est le sort presque immanquable de tous ses confrères, qui prennent à cœur leur profession.
Vraiment, je devrais réfléchir à tout cela, quand je me trouve à plaindre.
Samedi 20 avril. — Concert de Delsarte[495] et Darcier[496] : Anciens Noëls ou Cantiques chantés en chœur pour se conformer à cette passion du gothique, sans la satisfaction de laquelle les Parisiens ne peuvent trouver aujourd’hui de plaisir à rien.
Ce Darcier ne manque pas d’une certaine verve, et est doué d’une belle voix ; mais les refrains vulgaires et cette musique de mauvais goût faisaient un effet désolant auprès des morceaux de Delsarte.
Un malheureux enfant de chœur a psalmodié, sans une étincelle de sentiment, quelques complaintes gothiques, accompagné par une espèce d’orgue qui ne marquait aucune nuance et l’écrasait complètement.
Mme Kalerji était devant moi et auprès de M. J… et M. Piscatory[497].
Il a fallu livrer bataille, en sortant, pour avoir ma redingote, et j’y ai sans doute repris une seconde édition de mon rhume.
Dimanche 21 avril. — Fatigué de la séance d’hier soir.
— Travaillé quelque peu à la composition du plafond et resté chez moi le soir.
— M. Lafont[498] venu dans la journée ; il me plaît beaucoup. Je l’ai entrepris sur la peinture religieuse et monumentale, comme l’entendent les modernes. La mode a un empire incroyable sur les meilleurs esprits.
Lundi 22 avril. — Enterrement de M. Meneval. Isabey, à côté de qui j’étais, me disait qu’il était contraire à l’architecture colorée. On y trouve à chaque instant des tons qui enfoncent ce qui devrait être saillant, et réciproquement. Les ombres produites par les saillies dessinent suffisamment les ornements. Tout cela se disait pendant la cérémonie, en face des peintures et de l’architecture de Notre-Dame de Lorette, où l’on ne voit que des contresens, il faudrait dire des contre-bon sens.
Il critique également avec raison les fonds d’or pour la peinture. Ils détruisent toute saillie dans les figures et désaccordent tout effet de peinture, en venant au-devant de tout, et en privant le tableau de fonds destinés à faire tout valoir. Revenu de l’église par une pluie affreuse.
Champrosay. — Vendredi 26 avril. — Parti pour Champrosay à onze heures et demie. Ravi de m’y retrouver. La sensation la plus délicieuse est celle de l’entière liberté dont j’y jouis. Là, les ennuyeux ne peuvent venir m’y trouver, quoique cela me soit arrivé, tant ils sont difficiles à éviter.
Le jardin était très en ordre, et tout s’est bien passé.
Samedi 27 avril. — Je dors le soir outrageusement, et même dans la journée. L’écueil de la campagne, pour un homme qui craint de lire beaucoup, c’est l’ennui et une certaine tristesse que le spectacle de la nature inspire.
Je ne sens pas tout cela quand je travaille ; mais cette fois, j’ai résolu de ne rien faire absolument pour me reposer du travail un peu abstrait de la composition de mon plafond.
Dimanche 28 avril. — Le matin, grande promenade dans la forêt de Sénart.
Entré par la ruelle du marquis, revu les inscriptions amoureuses de la muraille de son parc ; chaque année la pluie, l’effet du temps en emporte quelque chose ; à présent elles sont presque illisibles. Je ne puis m’empêcher toutes les fois que je passe là, et j’y passe souvent exprès, d’être ému des regrets et de la tendresse de ce pauvre amoureux ! Il a l’air bien pénétré de l’éternité de son sentiment pour sa Célestine. Dieu sait ce qu’elle est devenue, aussi bien que ses amours ! Mais qui est-ce qui n’a pas connu cette jeune exaltation, le temps où l’on n’a pas un instant de repos, et où l’on jouit de ses tourments ?
J’ai été jusqu’à l’endroit des grenouilles et revenu par le petit chemin le long de la colline.
J’ai été avec la servante cueillir dans la journée des fleurs dans le champ de Candas.
Lundi 29 avril. — Je ne sais pourquoi il m’est venu la fantaisie d’écrire sur le bonheur. C’est un de ces sujets sur lesquels on peut écrire tout ce qu’on veut.
— Je me suis promené le matin dans le jardin abandonné et livré à la nature des pauvres gendarmes ; leurs petits carrés de choux si bien alignés, leurs treilles, leurs arbres fruitiers, source de consolation et d’un petit produit sensible dans leur misère, sont presque effacés, ruinés par les allants et venants, par le vent, par les accidents de toutes parts ; le vent fait battre les contrevents des fenêtres et achève de briser les vitres. Cela va devenir un repaire d’oiseaux et de créatures sauvages.
Sur le tantôt, promené avec Jenny vers le petit sentier de la colline où j’ai été lire.
Mardi 30 avril. — Sorti vers neuf heures. Pris la ruelle du marquis et marché jusqu’à l’ermitage. En face de l’ermitage, immense abatis ; tous les ans j’éprouve ce crève-cœur de voir une partie de la forêt à bas, et c’est toujours la plus belle, c’est-à-dire la plus fournie ou la plus ancienne. Il y avait un petit sentier couvert charmant.
Pris à droite jusqu’au chêne Prieur. J’ai vu là, le long du chemin, une procession de fourmis que je défie les naturalistes de m’expliquer. Toute la tribu semblait défiler en ordre comme pour émigrer ; un petit nombre de ces ouvrières remontait le courant en sens contraire. Où allaient-elles ? Nous sommes enfermés pêle-mêle, animaux, hommes, végétaux, dans cette immense boîte qu’on appelle l’Univers. Nous avons la prétention de lire dans les astres, de conjecturer sur l’avenir et sur le passé qui sont hors de notre vue, et nous ne pouvons comprendre un mot de ce qui est sous nos yeux. Tous ces êtres sont séparés à jamais, et indéchiffrables les uns pour les autres.
Mercredi 1er mai. — Sur la réflexion et l’imagination données à l’homme. Funestes présents.
Il est évident que la nature se soucie très peu que l’homme ait de l’esprit ou non. Le vrai homme est le sauvage ; il s’accorde avec la nature comme elle est. Sitôt que l’homme aiguise son intelligence, augmente ses idées et la manière de les exprimer, acquiert des besoins, la nature le contrarie en tout. Il faut qu’il se mette à lui faire violence continuellement ; elle, de son côté, ne demeure pas en reste. S’il suspend un moment le travail qu’il s’est imposé, elle reprend ses droits, elle envahit, elle mine, elle détruit ou défigure son ouvrage ; il semble qu’elle porte impatiemment les chefs-d’œuvre de l’imagination et de la main de l’homme. Qu’importent à la marche des saisons, au cours des astres, des fleuves et des vents, le Parthénon, Saint-Pierre de Rome, et tant de miracles de l’art ? Un tremblement de terre, la lave d’un volcan vont en faire justice… Les oiseaux nicheront dans ces ruines ; les bêtes sauvages iront tirer les os des fondateurs de leurs tombeaux entrouverts. Mais l’homme lui-même, quand il s’abandonne à l’instinct sauvage qui est le fond même de sa nature, ne conspire-t-il pas avec les éléments pour détruire les beaux ouvrages ? La barbarie ne vient-elle pas presque périodiquement, et semblable à la Furie qui attend Sisyphe roulant sa pierre au haut de la montagne, pour renverser et confondre, pour faire la nuit après une trop vive lumière ? Et ce je ne sais quoi qui a donné à l’homme une intelligence supérieure à celle des bêtes, ne semble-t-il pas prendre plaisir à le punir de cette intelligence même ?
Funeste présent, ai-je dit ? Sans doute, au milieu de cette conspiration universelle contre les fruits de l’invention du génie, de l’esprit de combinaison, l’homme a-t-il au moins la consolation de s’admirer grandement lui-même de sa constance ou de jouir beaucoup et longtemps de ces fruits variés émanés de lui ? Le contraire est le plus commun. Non seulement le plus grand par le talent, par l’audace, par la constance, est ordinairement le plus persécuté, mais il est lui-même fatigué et tourmenté de ce fardeau du talent et de l’imagination. Il est aussi ingénieux à se tourmenter qu’à éclairer les autres. Presque tous les grands hommes ont eu une vie plus traversée, plus misérable que celle des autres hommes.
A quoi bon alors tout cet esprit et tous ces soins ? Le vivre suivant la nature veut-il dire qu’il faut vivre dans la crasse, passer les rivières à la nage, faute de ponts et de bateaux, vivre de glands dans les forêts, ou poursuivre à coups de flèches les cerfs et les buffles, pour conserver une chétive vie cent fois plus inutile que celle des chênes qui servent du moins à nourrir et à abriter des créatures ? Rousseau est donc de cet avis, quand il proscrit les arts et les sciences, sous le prétexte de leurs abus. Tout est-il donc piège, condition d’infortune ou signe de corruption dans ce qui vient de l’intelligence de l’homme ? Que ne reproche-t-il au sauvage d’orner et d’enluminer à sa manière son arc grossier ?… de parer de plumes d’oiseaux le tablier dont il cache sa chétive nudité ? Et pourquoi la cacher au soleil et à ses semblables ? N’est-ce pas encore là un sentiment trop relevé pour cette brute, pour cette machine à vivre, à digérer, à dormir ?
Jeudi 2 mai. — Chez M. Quantinet, vers deux heures. Vu lui et sa femme. Il faisait encore un froid du diable.
Monté dans la bibliothèque : vue enchanteresse, dont deux parties intéressantes : vu le couchant et vu le levant.
Samedi 4 mai. — Travaillé ce matin ; été voir Mme Quantinet dans le milieu de la journée ; refusé le lendemain dimanche son invitation à dîner : j’avais la gorge fatiguée, et vraiment besoin d’être tranquille. Elle m’a lu les extraits de ses lectures ; il y avait entre autres cette pensée de l’Adolphe de Benjamin Constant : « L’indépendance a pour compagnon l’isolement. » C’est autrement dit, mais c’est le sens.
Lundi 6 mai. — Travaillé ce jour, hier et avant-hier au comte Ugolin.
— Ce matin est venu le nommé Hubert, pépiniériste, me réclamer, au bout de deux ans et demi, le payement d’une note d’arbres fruitiers et autres, que je lui ai payée en octobre 1847. J’ai trouvé heureusement le reçu. Il n’osera pas probablement revenir.
J’ai remarqué plus d’une fois combien des actes d’une immoralité profonde étaient traités doucement par notre Code athée. Je me rappelle le fait que j’ai lu, il y a un an ou deux, d’un malheureux qui, ayant porté plainte contre sa femme, laquelle vivait authentiquement en concubinage avec son propre fils, avait été mis, lui le père et l’époux, à la porte de son domicile commun… ; la femme n’a été condamnée qu’à un mois ou deux de prison.
Mardi 7 mai. — Je n’ai pas mis le pied dehors de toute la journée, malgré le projet d’aller à Fromont.
Je me suis occupé de rechercher à mettre au net la composition de Samson et Dalila. Quoique cela ne m’ait pris que peu de temps et dans la matinée seulement, je ne me suis pas ennuyé.
Écrit à Andrieu[499], à son oncle, à Haro pour le plafond, et à Duban.
— Pourquoi ne pas faire un petit recueil d’idées détachées qui me viennent de temps en temps toutes moulées et auxquelles il serait difficile d’en coudre d’autres ? Faut-il absolument faire un livre dans toutes les règles ? Montaigne écrit à bâtons rompus… Ce sont les ouvrages les plus intéressants. Après le travail qu’il a fallu à l’auteur pour suivre le fil de son idée, la couver, la développer dans toutes ses parties, il y a bien aussi le travail du lecteur qui, ayant ouvert un livre pour se délasser, se trouve insensiblement engagé, presque d’honneur, à déchiffrer, à comprendre, à retenir ce qu’il ne demanderait pas mieux d’oublier, afin qu’au bout de son entreprise, il ait passé avec fruit par tous les chemins qu’il a plu à l’auteur de lui faire parcourir.
Mercredi 8 mai. — Travaillé toute la matinée sans entrain ; j’étais mal à l’aise, car je n’ai rien mangé jusqu’au dîner.
— Vers trois heures, je me suis décidé à faire la corvée de Fromont. J’ai beaucoup joui de cette promenade, quoique je n’aie vu du parc que ce qui se trouve depuis la porte sur la grande route, jusqu’à la serre du jardinier. J’ai vu, dans ce trajet, deux ou trois magnolias, dont un ou deux sur la fin de la floraison. Je n’avais pas d’idée de ce spectacle : cette profusion vraiment prodigieuse de fleurs énormes sur cet arbre dont les feuilles ne font que commencer à poindre, l’odeur délicieuse, une jonchée incroyable de pétales de fleurs déjà passées ou fanées m’ont arrêté et charmé. Il y avait devant la serre des rhododendrons rouges et un camélia d’une taille extraordinaire.
Revenu par Ris et pris des pâtisseries en passant. La vue du paysage au pont et en grimpant est charmante, à cause de la verdure printanière et des effets d’ombre que les nuages font passer sur tout cela. J’ai fait, en rentrant, une espèce de pastel de l’effet de soleil en vue de mon plafond.
Jeudi 9 mai. — Je crois que les pâtisseries d’hier mangées à mon dîner pour égayer ma solitude ont contribué à me donner ce matin la plus affreuse et la plus durable morosité. Me sentant mal disposé pour quoi que ce soit, j’ai, vers neuf heures, gagné la forêt et été directement jusqu’au chêne Prieur. Quoique la matinée fût magnifique, rien n’a pu me distraire de cette humeur noire. J’ai fait un petit croquis du chêne ; le frais qui commençait à s’élever m’a chassé.
J’ai été particulièrement frappé, sans en être égayé, de cette pourtant charmante musique des oiseaux au printemps : les fauvettes, les rossignols, les merles si mélancoliques, le coucou dont j’aime le cri à la folie, semblaient s’évertuer pour me distraire. Dans un mois au plus, tous ces gosiers seront silencieux. L’amour les épanouit pour le sentiment ; un peu plus, il les ferait parler. Bizarre nature, toujours semblable, inexplicable à jamais !
— Vers trois ou quatre heures, la servante m’a parlé de l’homme qu’elle avait vu entrer dans la maison des gendarmes. Le garçon de la ferme est venu avec le garde champêtre, et je me suis joint à eux pour faire une visite domiciliaire ; toute la soirée nous avons fait de grotesques préparatifs de défense en cas d’attaque de nuit ; tout a été fort heureusement inutile.
Samedi 11 mai. — J’ai reculé encore indéfiniment mon projet de départ que j’avais fixé pour aujourd’hui.
— Le matin, vu Candas dans la maison des gendarmes. Je lui ai parlé de mes projets et de ce qu’on pourrait faire. Ce lieu est charmant : il est bien dommage qu’il n’y ait pas de vignes de ce côté-là.
J’ai joui aujourd’hui délicieusement, et comme un enfant qui entre en vacances, de ma résolution subite de demeurer encore. Que l’homme est faible et facilement étrange dans ses émotions et ses résolutions !
J’étais hier soir d’une tristesse mortelle. En revenant de ma soirée, je ne rêvais que catastrophes ; ce matin, la vue des champs, le soleil, l’idée d’éviter encore quelque temps ce brouhaha affreux de Paris m’ont mis au ciel.
Heureux ou malheureux, je le suis presque toujours à l’extrême !
Lundi 13 mai. — J’ai passé ma journée tout seul et ne me suis pas ennuyé. Jenny et la servante sont allées à Paris dès le matin et sont revenues seulement à six heures.
J’étais en train de faire mon dîner, quand elles sont arrivées trempées par une pluie affreuse, qui n’a presque pas cessé tout le jour.
Je me suis plu dans l’isolement complet et le silence de cette journée.
Mardi 14 mai. — Sur l’isolement de l’homme.
« L’indépendance a pour conséquence l’isolement », Mme Quantinet me cite cet extrait de l’Adolphe de Benjamin Constant. Hélas ! l’alternative d’être ennuyé et harcelé toute la vie, comme l’est un homme engagé dans des liens de famille par exemple, ou d’être abandonné de tout et de tous, pour n’avoir voulu subir aucune contrainte, cette alternative, dis-je, est inévitable. Il y en a qui ont mené la vie la plus dure sous les impérieuses lois d’une femme acariâtre, ou souffrant les caprices d’une coquette à laquelle ils avaient lié leur sort, et qui à la fin de leurs jours n’ont pas même la consolation d’avoir pour leur fermer les yeux ou leur donner leurs bouillons cette créature qui serait bonne du moins pour adoucir le dernier passage. Elles vous quittent ou meurent au moment où elles pourraient vous rendre le service de vous empêcher d’être seul. Les enfants, si vous en avez eu, après vous avoir occasionné tous les soucis de leur enfance ou de leur sotte jeunesse, vous ont abandonné depuis longtemps.
Vous tombez donc nécessairement dans cet isolement affreux dans lequel s’éteint ce reste de vie et de souffrances.
Jeudi 16 mai. — A Paris, par le premier convoi.
Vendredi 17 mai. — Travaillé ce matin à la femme qui se peigne.
— Grande promenade dans la forêt, par le côté de Draveil. Pris en contournant la forêt par l’allée qui en fait le tour.
J’ai vu là le combat d’une mouche d’une espèce particulière et d’une araignée. Je les vis arriver toutes deux, la mouche acharnée sur son dos et lui portant des coups furieux ; après une courte résistance, l’araignée a expiré sous ses atteintes ; la mouche, après l’avoir sucée, s’est mise en devoir de la traîner je ne sais où, et cela avec une vivacité, une furie incroyables. Elle la tirait en arrière, à travers les herbes, les obstacles, etc. J’ai assisté avec une espèce d’émotion à ce petit duel homérique. J’étais le Jupiter contemplant le combat de cet Achille et de cet Hector. Il y avait, au reste, justice distributive dans la victoire de la mouche sur l’araignée, il y a si longtemps que l’on voit le contraire arriver. Cette mouche était noire, très longue, avec des marques rouges sous le corps.
Samedi 18 mai. — Le matin, travaillé à la Femme qui se peigne, que je suis en train de gâter probablement, puis au Michel-Ange.
— Vers une heure, à la forêt avec ma bonne Jenny. J’avais un plaisir infini à la voir jouir si expansivement de cette charmante nature si verte, si fraîche. Je l’ai fait reposer longtemps, et elle est revenue sans accident. Nous avons été jusqu’au Chêne d’Antain. En parcourant le clos de Lamouroux, elle me disait douloureusement : « Comment ! ne vous verrai-je jamais autrement que dans une position mince et peu digne de vous ? Quoi ! je ne vous verrai jamais un enclos comme celui-ci à habiter, à embellir ? » Elle a raison. Je ressemble en ceci à Diderot qui se croyait prédestiné à habiter des taudis, et qui vit sa mort prochaine, quand il fut installé dans un bel appartement, dans des meubles splendides, qu’il devait aux bontés de Catherine.
Au reste, j’aime la médiocrité ; j’ai le faste et l’étalage en horreur ; j’aime les vieilles maisons, les meubles antiques ; ce qui est tout neuf ne me dit rien. Je veux que le lieu que j’habite, que les objets qui sont à mon usage me parlent de ce qu’ils ont vu, de ce qu’ils ont été, et de ce qui a été avec eux.
Ai-je l’âme plus rétrécie en cela que mon voisin Minoret, qui vient d’abattre une partie du logement qu’il avait, pour construire un affreux chalet qui va offenser mes regards, tant que je vivrai ici ? Quand ce Minoret est venu succéder au général Ledru[500], il s’est hâté de jeter bas sa modeste et ancienne maison ; il aime mieux ces pierres toutes neuves qu’il a tirées de la carrière… La vieille d’Esnont en a fait autant. A la vérité, la maison lui tombait sur la tête. Cela me vaut deux constructions à la moderne, affreuses à tolérer.
Il y a, au reste, dans Champrosay, depuis quelque temps, émulation de mauvaises bâtisses. Gibert avait commencé avec sa magnifique grille. Les gens qui ont succédé au marquis de La Feuillade font recrépir la maison et ont imaginé d’y ajouter des ornements qui la rendent ridicule et lui ôtent tout caractère et toute proportion.
— Ce matin, Georges[501] est venu m’invitera dîner de la part de sa mère, qui vient pour deux jours avec Mme Barbier[502] et M. P… et son mari.
Villot vient un moment dans la journée ; nous avons été assez tristes à cause de toutes les menaces du temps.
Le soir pourtant je me suis mis en train et ai causé un peu. Revenu à onze heures. Mme Barbier est très amusante.
Lundi 20 mai. — J’ai été vers deux heures les voir jusqu’au départ de quatre heures et demie et les ai menés jusqu’au chemin de fer. Je disais à Mme Barbier que l’indigne pantalon des femmes était un attentat aux droits de l’homme.
Jeudi 23 mai. — Travaillé au Chasseur de lions et au Michel-Ange[503].
— Sorti pour aller voir Mme Quantinet. Elle est partie pour Paris…
Vers cinq heures, promenade à l’allée de l’Ermitage. Temps charmant, quoique chaud. Joui délicieusement de cette heure charmante qui m’attriste moins qu’autrefois.
J’ai découvert dans cette grande allée un petit sentier délicieux, qui conduit à des retraites charmantes. Pensé involontairement à la dame à la robe de chambre bariolée.
Le soir, clair de lune ravissant dans mon petit jardin. Resté à me promener très tard. Je ne pouvais assez jouir de cette douce lumière sur ces saules, du bruit de la petite fontaine et de l’odeur délicieuse des plantes qui semblent, à cette heure, livrer tous leurs trésors cachés.
Paris, lundi 3 juin. — Ce jour, dîné chez Bixio avec Lamoricière[504], etc. Cavaignac devait y être. Le premier est charmant et plein de véritable esprit.
— Tous ces jours-ci, je ne vois personne, enfoncé que je suis dans mon esquisse.
Jeudi 6 juin. — Passé la journée au Jardin des plantes. Jussieu[505] m’a conduit partout.
Samedi 8 juin. — Quinze jours sans avoir lien écrit ici !…
Revenu de Champrosay il y a quinze jours, jour pour jour.
Jenny y est retournée aujourd’hui pour y prendre les lunettes du maire et les lui rendre.
— Je suis resté jusqu’à midi sur mon canapé, dormant et lisant l’évasion de mon cher Casanova.
— Je me disais, en regardant ma composition du plafond qui ne me plaît que depuis hier, grâce aux changements que j’ai faits dans le ciel avec du pastel, qu’un bon tableau était exactement comme un bon plat, composé des mêmes éléments qu’un mauvais : l’artiste fait tout. Que de compositions magnifiques ne seraient rien sans le grain de sel du grand cuisinier ! Cette puissance du je ne sais quoi est étonnante dans Rubens ; ce que son tempérament, — vis poetica, — ajoute à une composition, sans qu’il semble qu’il la change, est prodigieux. Ce n’est autre chose que le tour dans le style ; la façon est tout, le fond est peu en comparaison.
Le nouveau est très ancien, on peut même dire que c’est toujours ce qu’il y a de plus ancien.
— Pour imprimer le mur de l’église, huile de lin et non autre, bouillante, blanc de céruse et non pas blanc de zinc, qui ne tient pas. L’ocre jaune serait la meilleure impression.
Lundi 10 juin. — La partie du ciel[506] — après les plus grands clairs du soleil, c’est-à-dire déjà foncé : Jaune chrome foncé blanc — blanc laque et vermillon.
La terre de Cassel et blanc forme la demi-teinte décroissante. En général, excellent pour demi-teinte.
Les clairs jaune clair sur les nuages au-dessous du char : Cadmium, blanc, une pointe de vermillon.
La partie du ciel plus orangé, à partir du cercle lumineux : Sur une préparation orangée, frôler à sec un ton de jaune de Naples, vert bleu et blanc, en laissant un peu paraître le ton orangé.
Ton orangé, très beau pour le ciel : Terre d’Italie naturelle, blanc, vermillon. — Vermillon, blanc, laque et quelquefois un peu de cadmium et de blanc.
Robe de Minerve, sur une préparation convenable : Clairs des plis peints, avec bleu de Prusse et blanc assez cru, peut-être un peu de laque. — À sec, pardessus, clairs avec blanc et chrome ; enfin ton citron. Glacer par-dessus à sec avec cobalt et laque. — Enfin, rehauts sombres et chauds avec terre d’Italie brûlée et carmin fixe.
Apollon, la robe peinte d’un ton rouge un peu fade dans les clairs, glacé avec laque jaune et laque rouge.
Localité des chairs de la Diane : Terre de Cassel, blanc et vermillon. Assez gris partout. Clairs : blanc et vermillon, un peu de vermillon.
Les reflets ton chaud, presque citron ; il y entre un peu d’antimoine, le tout très franchement.
Localité des cheveux de l’Apollon : Terre d’ombre, blanc, cadmium, très peu de terre d’Italie ou d’ocre.
Pour la tunique de la Diane, un ton de reflet analogue à celui de sa chair dans l’ombre : Antimoine, cadmium, etc.
Localité chaude des nuages sous le char : Cadmium et blanc, un peu foncé, et terre de Cassel et blanc, touché par-dessus avec ton froid de terre de Cassel et blanc (tout ceci pour l’ombre).
Demi-teinte du Cheval soupe de lait (l’Arabe passant un gué)[507] : Terre d’ombre naturelle et blanc, antimoine, blanc et brun rouge : le rouge ou le jaune prédominant, suivant la convenance.
Vendredi 14 juin. — Un architecte qui remplit véritablement toutes les conditions de son art me paraît un phénix plus rare qu’un grand peintre, un grand poète et un grand musicien. Il me saute aux yeux que la raison en est dans cet accord absolument nécessaire d’un grand bon sens avec une grande inspiration. Les détails d’utilité qui forment le point de départ de l’architecte, détails qui sont l’essentiel, passent avant tous les ornements. Cependant il n’est artiste qu’en prêtant des ornements convenables à cet Utile, qui est son thème. Je dis convenables ; car même après avoir établi en tous points le rapport exact de son plan avec les usages, il ne peut orner ce plan que d’une certaine manière. Il n’est pas libre de prodiguer ou de retrancher les ornements. Il les faut aussi appropriés au plan, comme celui-ci l’a été aux usages. Les sacrifices que le peintre et le poète font à la grâce, au charme, à l’effet sur l’imagination, excusent certaines fautes contre l’exacte raison. Les seules licences que se permette l’architecte peuvent peut-être se comparer à celles que prend le grand écrivain, quand il fait en quelque sorte sa langue. En réservant des termes qui sont à l’usage de tout le monde, le tour particulier en fait des termes nouveaux ; de même l’architecte, par l’emploi calculé et inspiré en même temps des ornements qui sont le domaine de tous les architectes, leur donne une nouveauté surprenante et réalise le beau qu’il est donné à son art d’atteindre. Un architecte de génie copiera un monument et saura, par des variantes, le rendre original ; il le rendra propre à la place, il observera dans les distances, les proportions, un ordre tel qu’il le rendra tout nouveau. Les architectes vulgaires, nos modernes architectes, ne savent que copier littéralement, de sorte qu’ils joignent à l’humiliant aveu qu’ils semblent faire de leur impuissance le défaut de succès dans l’imitation même ; car le monument qu’ils ont imité à la lettre ne peut jamais être exactement dans les mêmes conditions que celui qu’ils imitent. Non seulement ils ne peuvent inventer une belle chose, mais ils gâtent la belle invention qu’on est tout surpris de retrouver, entre leurs mains, plate et insignifiante.
Ceux qui ne prennent pas le parti d’imiter en bloc et exactement, font pour ainsi dire au hasard. Les règles leur apprennent qu’il faut orner certaines parties, et ils ornent ces parties, quel que soit le caractère du monument et quel que soit son entourage.
(Joindre à ce qui précède ce que je dis de la proportion des monuments imités avec l’ouvrage définitif, par exemple le Parthénon ou la Maison carrée, et la Madeleine et l’Arc de triomphe.)
LES MAÎTRES DE L’ART
COLLECTION DE MONOGRAPHIES D’ARTISTES
PUBLIÉE SOUS LE HAUT PATRONAGE
LE BERNIN, par M. Reymond Un vol.
CHARDIN, par Edmond Pilon —
DONATELLO, par E. Bertaux —
FRA ANGELICO, par Alfred Pichon
ÉGRICAULT, par Léon Rosenthal —
GHIRLANDAIO, par Henri Hauvette —
BENOZZO GOZZOLI, par Urbain Mengin —
HOLBEIN, par François Benoit —
CHARLES LE BRUN, par Pierre Marcel —
PHILIBERT DE L’ORME, par Henri Clouzot —
REYNOLDS, par François Benoit —
SCHONGAUER, par A. Girodie —
SCOPAS et PRAXITÈLE, par Maxime Collignon —
LES SCULPTEURS FRANÇAIS AU XIIIe SIÈCLE, par Mlle Louise Pillion Un vol.
SODOMA, par L. Gielly —
CLAUS SLUTER, par A. Kleinclausz —
VERROCCHIO, par Marcel Reymond —
PETER VISCHER, par Louis Réau —
Ces volumes, sont complétés par des appendices, qui en font de véritables livres indispensables à toute personne s’intéressant aux choses de l’art : table chronologique mettant en regard des dates les plus importantes de la vie de l’artiste, les noms de ses principales œuvres ; catalogue des œuvres des maîtres conservées dans les musées et les collections privées ; notices sur les dessins ; notice sur les gravures ; bibliographie comprenant la liste des principaux travaux publiés sur le maître ; index alphabétique des noms cités dans le volume.
Broché. … … 15 fr. | Cartonné. … … 20 fr.
DE
EUGÈNE DELACROIX
TOME DEUXIÈME
1850-1854
PRÉCÉDÉ D’UNE ETUDE SUR LE MAITRE
par PAUL FLAT
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS PAR MM. PAUL FLAT ET RENÉ PIOT
Portraits et fac-similé
PARIS
LIBRAIRIE PLON
PLON-NOURRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIÈRE-6e
Tous droits réservés
DE
EUGÈNE DELACROIX

d’après un portrait peint par lui-même en 1829
Musée du Louvre
DE
EUGÈNE DELACROIX
TOME DEUXIÈME
1850-1854
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS PAR MM. PAUL FLAT ET RENÉ PIOT
Portraits et fac-similé
PARIS
LIBRAIRIE PLON
PLON-NOURRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIÈRE-6e
Tous droits réservés
Bruxelles, samedi 6 juillet. — Parti pour Bruxelles avec Jenny, à huit heures, et nous étions arrivés à cinq heures moins un quart. Cela tente vraiment pour voyager.
Mauvaise installation dans l’auberge, qui me donne de l’humeur.
Promenade, le soir, au Parc qui me paraît d’une tristesse extrême.
Je remarque en une foule de choses le manque de goût de ce pays-ci, et quand on compare, j’ose le dire, tous les pays avec la France, on éprouve le même sentiment. Il y a dans ce parc, entre autres ornements, des figures terminées par des gaines qui entourent le bassin. C’était dans les intervalles qu’il les fallait ! La manière inégale avec laquelle les arbres s’élancent, les rend gauches et de travers. Elles sont là comme par hasard. On voit là des statues dont les piédestaux ont un pied de hauteur ; on peut converser avec ces héros et ces demi-dieux, et les statues sont ordinairement plus grandes que nature ; elles sont disproportionnées, l’agrandissement, dans ce cas, n’étant calculé qu’à cause de la distance présumée où le piédestal doit placer la figure.
Bruxelles, dimanche 7 juillet. — Le matin à Sainte-Gudule.
Magnifiques vitraux du seizième siècle. Charles V à genoux sous une espèce de portique qui laisse voir le ciel dans le fond ; sa femme derrière lui ; lignes comme celles de la Vierge, etc., du plus beau style italien. La composition occupe toute la hauteur de la fenêtre qui estime des deux de la croix de l’église. Celle d’en face, même composition, plus remarquable encore par le style ; c’est aussi une figure d’empereur. Les arabesques, les figures qui s’y trouvent mêlées sont incomparables. Il y a encore trois ou quatre fenêtres du même style dans les fenêtres qui entourent le chœur ; dans l’une d’elles François Ier à genoux, ainsi que l’empereur et sa femme derrière lui. Ils ont tous, rois ou empereurs, la couronne en tête ; leur armure dorée pour la plupart avec le tabar armorié jusqu’au-dessus du genou ; ainsi les fleurs de lis sont azur, etc., le manteau royal aussi. Celui de François Ier est bleu et fleurdelisé ; celui de l’empereur est, je crois, de brocart.
Dans la partie du chœur qui fait face, qui est la chapelle de la Vierge, les fenêtres sont du siècle suivant. C’est le style de Rubens châtié[508]. L’exécution est très belle ; on a cherché à colorer comme dans les tableaux, mais cette tentative, quoique aussi habile que possible, est un argument en faveur des vitraux des siècles précédents, et notamment de ceux dont j’ai parlé plus haut[509]. Le parti pris, la convention pour simplifier sont absolument nécessaires.
Il y a au fond du chœur des vitraux, d’après les dessins de Navez[510], qui entrent dans les inconvénients de ce genre bâtard. Il en résulte dans ces derniers, qui sont l’ouvrage de mauvais artistes venus dans de mauvais temps, qu’en voulant éviter ce qu’ils regardent comme des effets fâcheux, en plaçant les plombs à la manière des artistes anciens, ils les placent de manière à donner des idées toutes contraires à celles qu’ils veulent exprimer, ou à faire des effets ridicules. Leurs draperies et certaines parties qu’ils regardent comme moins importantes ont l’air d’être entourées à dessein de bordures noires, parce que leurs têtes, par exemple, se détachant sur des ciels, sans être contournées par des plombs, affectent de se rapprocher de l’effet des tableaux. Cet effet est complètement boiteux et manqué. Ils cherchent ainsi à colorer les chairs outre mesure. A quoi tient ce goût de certaines époques, et à quoi encore cette sottise de certaines autres, qui les rend impropres à reproduire même ce qui a été déjà bien fait !
— Beau sujet : David jouant de la harpe pour calmer les humeurs noires de Saül. Il y a un petit tableau de Lucas de Leyde[511]. Voici ce qu’on lit dans le catalogue : Saül, courbé par l’âge et par l’adversité, est assis dans une stalle sous un dais de pourpre. Il soulève une pique. David, qui se tient debout en face du roi, joue de la harpe. Diverses figures groupées convenablement pour le sujet.
Pendant que je regardais les vitraux de la chapelle de la Vierge, j’ai entendu, au milieu de la musique très bonne qu’on exécutait, le psaume favori de Chopin, de Juda vainqueur : voix d’enfants, accompagnement d’orgue, etc. J’ai été un instant dans le ravissement. C’est un argument à donner contre le rajeunissement outré du chant grégorien ou plutôt contre l’anathème prononcé si sottement contre les efforts de la musique chez les modernes, pour parier aux imaginations à l’église.
— Au Musée, dans la journée, et assez tard pour ne pas voir assez longtemps. Rubens est là magnifique[512] ; la Montée au Calvaire[513], le Jésus qui veut foudroyer le monde, enfin tous, à des degrés différents, m’ont donné une sensation supérieure à ceux d’Anvers. Je crois que cela tient à leur réunion dans un seul local et tous rapprochés les uns des autres.
— Le soir à un petit théâtre : L’homme gris et le sous-préfet. J’ai beaucoup ri.
Anvers, lundi 8 juillet. — Parti pour Anvers à huit heures.
— Le Musée très mal arrangé. L’ancien faisait plus d’effet[514]. Les Rubens disséminés perdent beaucoup. Je ne leur ai toutefois jamais trouvé à ce degré cette supériorité qui écrase tout le reste. Le Saint François que je n’estimais pas autant, a été mon favori cette fois, et j’ai beaucoup goûté aussi le Christ sur les genoux du Père éternel, qui doit être du même temps. Je lis dans le catalogue que le Saint François a été peint quand Rubens avait quarante ou quarante-deux ans.
— Il y a des primitifs très remarquables au fond. En sortant, le Jésus flagellé, le Saint Paul…, chef-d’œuvre de génie s’il en fut. Il est un peu déparé par le grand bourreau qui est à gauche. Il faut vraiment un degré de sublime incroyable pour que cette ridicule figure ne gâte pas tout. A gauche, au contraire, et à peine visible, un nègre ou mulâtre qui fait partie des bourreaux, et qui est digne du reste. Ce dos en face, cette tête qui exprime si bien la fièvre de la douleur, le bras qu’on voit, tout cela est d’une inexprimable beauté.
— Je n’ai pas vu Saint-Jacques : je voulais revenir de bonne heure, et on ne se pressait pas d’ouvrir.
— J’avais été auparavant à Saint-Augustin. Grand tableau de Rubens à l’autel, et fait pour la place. — Mariage mystique de sainte Catherine ; superbe composition, dont j’ai la gravure ; mais l’effet est nul, à cause de la dégradation, de la moisissure et de l’absence complète de vernis. — Le Christ sortant du tombeau, de la cathédrale, est tout à fait invisible, à cause de la moisissure.
Bruxelles, mardi 9 juillet. — Revenu à Bruxelles. Je devais partir aujourd’hui ; je me suis donné encore ce jour.
J’ai fait une longue séance au Musée, où j’ai grelotté tout le temps, malgré la saison.
Le Calvaire et le Saint Liévin sont le comble de la maestria de Rubens.
L’Adoration des mages, que je trouve supérieure à celle d’Anvers, a de la sécheresse quand on la compare à ces deux autres ; on n’y voit point de sacrifices ; c’est au contraire l’art des négligences à propos, qui élève si haut les deux favoris dont j’ai parlé. Les pieds et la main du Christ à peine indiqués.
Il faut y joindre le Christ vengeur. La furie du pinceau et la verve ne peuvent aller plus loin.
L’Assomption[515] un peu sèche : la Gloire me paraît manquée ; je ne puis croire qu’il n’y aiteu des accidents.
Il y a une belle Vierge couronnée, à droite en entrant. Vigueur d’effet, point autant de laisser aller que dans les beaux. Les nuages sont poussés jusqu’au noir. Ce diable d’homme ne se refuse rien. Le parti pris de faire briller la chair avant tout le force à des exagérations de vigueur.
— Chez le duc d’Arenberg, vers deux heures. Beau Rembrandt.
Tobie guéri par son fils. Esquisse de Rubens très grossièrement dessinée au pinceau, quelques figures ayant de la couleur, allégorie dans le genre de celle du Musée.
Lion de Van Thulden[516] sur son fond frotté d’une espèce de grisaille.
— Rubens indique souvent des rehauts avec du blanc ; il commence ordinairement à colorer par une demi-teinte locale très peu empâtée. C’est là-dessus, à ce que je pense, qu’il place les clairs et les parties sombres. J’ai bien remarqué cette touche dans le Calvaire. Les chairs des deux larrons très différentes, sans efforts apparents. Il est évident qu’il modèle ou tourne la figure dans ce ton local d’ombre et de lumière, avant de mettre ses vigueurs. Je pense que ses tableaux légers comme celui-ci, et un Saint Benoît, qui lui ressemble, ont dû être faits ainsi. Dans la manière plus sèche, chaque morceau a été peint plus isolément.
Se rappeler les mains de la Sainte Véronique, le linge tout à fait gris ; celles de la Vierge à côté, d’une sublime négligence ; les deux larrons sublimes de tout point… La pâleur et l’air effaré du vieux coquin qui est par devant.
Dans le Saint François cachant le monde avec sa robe, simplicité extraordinaire d’exécution. Le gris de l’ébauche paraît partout. Un très léger ton local sur les chairs et quelques touches un peu plus empâtées pour les clairs.
Se rappeler souvent l’étude commencée, de Femme au lit, il y a un mois environ ; le modelé déjà arrêté dans le ton local, sans rehauts d’ombres et de clairs ; j’avais trouvé cela, il y a bien longtemps, dans une étude couchée[517]. L’instinct m’avait guidé de bonne heure.
Mercredi 10 juillet. — Quitté Bruxelles. Pays charmant entre Liège et Verviers. Passé à Aix-la-Chapelle, sans pouvoir y entrer. Qu’il y a de temps que j’y suis venu avec ma bonne mère, ma bonne sœur et mon pauvre Charles !… Nous étions enfants tous les deux… J’ai aperçu assez longtemps le Louisberg où nous allions enlever des cerfs-volants avec Leroux, le cuisinier de ma mère. Où sont-ils tous ?
Un peu avant, nous avions pris les voitures prussiennes, beaucoup plus étroites et incommodes que celles des Belges. Route insipide jusqu’à Cologne.
Arrivés par une pluie continue. Logé à l’hôtel de Hollande, sur le Rhin, d’où on a une très belle vue,… à ce que j’ai conjecturé, à cause du brouillard et du mauvais temps. Sensation triste de ces uniformes étrangers et de ce jargon.
Le vin du Rhin, à dîner, m’a fait trouver la situation tolérable ; malheureusement, j’avais le plus mauvais lit possible, quoique le logis fût un des plus considérés.
Jeudi 11 juillet. — Le matin, départ à cinq heures et demie en bateau par la pluie. Ennuis excessifs pour l’embarquement, le bagage, etc. La veille, à l’arrivée à Cologne, attente éternelle pour la visite de la douane.
Le voyage a été assez agréable, à partir de Bonn ; les deux rives, surtout la rive droite, présentent de beaux aspects de montagnes, qui sont un peu gâtées par la culture. Vu, en passant, les Sept montagnes, célèbres dans les légendes allemandes.
Arrivés à Coblentz vers une heure, et départ pour Ems, où les ennuis du logement m’ont occupé jusqu’à cinq ou six heures. Casé provisoirement avec Jenny, dans une espèce de grenier, et le lendemain provisoirement encore, mais tolérablement.
Ce lendemain, après la visite du médecin, qui m’a plu assez, et qui ne m’appelle que M. Sainte-Croix, pris d’une petite migraine qui a été en empirant jusqu’au soir. Je n’ai rien mangé du tout et me suis guéri de la sorte.
Ems, samedi 13 juillet. — Pris mon premier verre d’eau.
Ouverture de la Flûte enchantée, en plein air, exécutée par un petit orchestre, qui se tient là pour amuser les buveurs d’eau.
L’après-midi, petite promenade vers la hauteur, en passant le pont, et vu le cimetière et l’église. Tout cela est charmant, et pourtant je vis dans l’insipidité[518]. Est-ce que tout cela n’est point fait pour faire éprouver quelque sentiment de plaisir, ou bien est-ce que je commence à être moins susceptible ? Je ne sais comment je vais remplir mon temps. Je n’ai pas de gravures, et n’ai de livres que l’Homme de cour et les Extraits de Voltaire… Je trouverai peut-être à en louer.
Dimanche 14. — Aujourd’hui dimanche, je peux dire que je suis rentré en possession de mon esprit. Aussi est-ce le premier jour où j’ai trouvé de l’intérêt à tout ce qui m’environne.
Ce lieu est vraiment charmant. J’ai été l’après midi, et dans une bonne disposition, me promener de l’autre côté de l’eau[519]. Là, assis sur un banc, je me suis mis à jeter sur mon calepin des réflexions analogues à celles que je trace ici. Je me suis dit et je ne puis assez me le redire pour mon repos et pour mon bonheur, — l’un et l’autre sont une même chose, — que je ne puis et ne dois vivre que par l’esprit ; la nourriture qu’il demande est plus nécessaire à ma vie que celle qu’il faut à mon corps. Pourquoi ai-je tant vécu ce fameux jour ? (J’écris ceci deux jours après.) C’est que j’ai eu beaucoup d’idées qui sont dans ce moment à cent lieues de moi.
Le secret de n’avoir pas d’ennuis, pour moi du moins, c’est d’avoir des idées. Je ne puis donc trop rechercher les moyens d’en faire naître. Les bons livres ont cet effet, et surtout certains livres parmi ceux-ci. La première condition est bien la santé ; mais même dans un état languissant, certains livres peuvent rouvrir la porte par où s’épanche l’imagination.
Jeudi 18 juillet. — « Dans la peinture et surtout dans le portrait, dit Mme Cavé dans son traité, c’est l’esprit qui parle à l’esprit, et non la science qui parle à la science. » Cette observation, plus profonde qu’elle ne l’a peut-être cru elle-même, est le procès fait à la pédanterie de l’exécution. Je me suis dit cent fois que la peinture, c’est-à-dire la peinture matérielle, n’était que le prétexte, que le pont entre l’esprit du peintre et celui du spectateur. La froide exactitude n’est pas l’art ; l’ingénieux artifice, quand il plaît ou qu’il exprime, est l’art tout entier. La prétendue conscience de la plupart des peintres n’est que la perfection apportée à l’art d’ennuyer. Ces gens-là, s’ils le pouvaient, travailleraient avec le même scrupule l’envers de leurs tableaux… Il serait curieux de faire un traité de toutes les faussetés qui peuvent composer le vrai.
Dimanche 21 juillet. — Fait une promenade très longue, en prenant par la ruelle qui est en face du pont. Monté au plus haut de la montagne et revenu par une autre route. J’ai trouvé tout à coup un petit sentier charmant rempli de thyms et de genévriers, et je me suis trouvé, à cette hauteur, au milieu des champs cultivés, des blés mûrs, et des prairies un peu en pente, à la vérité. Après avoir gravi de l’autre côté parmi les rochers, on trouve ici un tout autre aspect… Cette course a été au moins de trois heures.
— Dans la journée, je me suis mis sérieusement à l’article de Mme Cavé[520].
— J’ai résolu, ce qui m’a réussi, de boire l’eau avant le dîner. Après le dernier verre, vers cinq heures, je suis retourné dans ces charmantes prairies, qui longent la Lahn, en passant le pont et en prenant à gauche. J’étais tout rempli d’idées que le travail de la journée me faisait naître. Tout me semblait facile. J’aurais fait, je crois, l’article d’une haleine, si j’avais eu la force d’écrire pendant le temps nécessaire.
J’écris ceci le lendemain, c’est-à-dire le lundi, et ce beau feu s’est refroidi. Il faudrait, comme lord Byron, pouvoir retrouver l’inspiration à commandement. J’ai peut-être tort de l’envier en ceci, puisque dans la peinture j’ai la même faculté ; mais soit que la littérature ne soit pas mon élément ou que je ne l’aie pas encore fait tel, quand je regarde ce papier rempli de petites taches noires, mon esprit ne s’enflamme pas aussi vite qu’à la vue de mon tableau ou seulement de ma palette. Ma palette fraîchement arrangée et brillante du contraste des couleurs suffit pour allumer mon enthousiasme.
Au reste, je suis persuadé que si j’écrivais plus souvent, j’arriverais à jouir de la même faculté en prenant la plume. Un peu d’insistance est nécessaire, et une fois la machine lancée, j’éprouve en écrivait autant de facilité qu’en peignant ; et, chose singulière, j’ai moins besoin de revenir sur ce que j’ai fait. S’il ne s’agissait que de coudre des pensées à d’autres pensées, je me trouverais plus vite armé et sur le terrain dans l’attitude convenable ; mais la suite à observer, le plan à respecter, et ne pas embrouiller le milieu de ses phrases, voilà ce qui fait la grande difficulté et qui entrave le jet de l’esprit. Vous voyez votre tableau d’un coup d’œil ; dans votre manuscrit, vous ne voyez pas même la page entière, c’est-à-dire, vous ne pouvez pas l’embrasser tout entière par l’esprit ; il faut une force singulière pour pouvoir en même temps embrasser l’ensemble de l’ouvrage et le conduire avec l’abondance ou la sobriété nécessaires, à travers les développements qui n’arrivent que successivement. Lord Byron dit que quand il écrit, il ne sait pas ce qui va venir après, et qu’il ne s’en inquiète guère… Sa poésie est en général dans le genre que j’appellerai admiratif ; il tient plus de l’ode que de la narration, il peut donc s’abandonner à son caprice… La tâche de l’histoire me semble la plus difficile ; il lui faut une attention soutenue sur mille objets à la fois, et à travers les citations, les énumérations précises, les faits qui ne tiennent qu’une place relative, il lui faut conserver cette chaleur qui anime le récit et en fait autre chose qu’un extrait de gazette.
L’expérience est indispensable pour apprendre tout ce qu’on peut faire avec son instrument, mais surtout pour éviter ce qui ne doit pas être tenté ; l’homme sans maturité se jette dans des tentatives insensées ; en voulant faire rendre à l’art plus qu’il ne doit et ne peut, il n’arrive pas même à un certain degré de supériorité dans les limites du possible. Il ne faut pas oublier que le langage (et j’appliquerai au langage dans tous les arts) est imparfait. Le grand écrivain supplée à cette imperfection par le tour particulier qu’il donne à la langue. L’expérience seule peut donner, même au plus grand talent, cette confiance d’avoir fait tout ce qui pouvait être fait. Il n’y a que les fous et les impuissants qui se tourmentent pour l’impossible. Et pourtant il faut être très hardi !… Sans hardiesse, et une hardiesse extrême, il n’y a pas de beautés. Jenny me disait, quand je lui lisais ce passage de lord Byron, où il vante le genièvre comme son Hippocrène, que c’était à cause de la hardiesse qu’il y puisait… Je crois que l’observation est juste, tout humiliante qu’elle est pour un grand nombre de beaux esprits, qui ont trouvé dans la bouteille cet adjuventum du talent qui les a fait atteindre la crête escarpée de l’art. Il faut donc être hors de soi, amens, pour être tout ce qu’on peut être ! Heureux qui, comme Voltaire et autres grands hommes, peut se trouver dans cet état inspiré, en buvant de l’eau et en se tenant au régime !
24 juillet. — Le jour de fête du duc de Nassau.
La musique du régiment prussien a joué plusieurs morceaux, un entre autres admirablement : c’était un pot pourri d’airs de Freyschütz.
Vendredi 2 août. — Promenade dans le bois de sapins. Dessiné le clocher de l’église.
Samedi 3 août. — Promenade par le chemin qui passe devant la petite église catholique.
Remonté assez loin, entre les deux montagnes ; parvenu à une entrée de bois fort intéressante : un ravin très profond, dans lequel doit couler en hiver un torrent étroit bordé de grands hêtres… Tournure diabolique à la Robin des bois.
Dimanche 4 août. — Parti d’Ems à sept heures environ. Route charmante dans une petite voiture, qui nous laissait admirer le paysage ; les bords de la Lahn sont charmants. Château de Lahneck, ruine escarpée. Déjeuné à Coblentz.
Embarqué à midi et demi. Chaleur extrême, qui a un peu gâté le voyage. Les petites cultures, les vignes continuellement disposées en étage sur toute la hauteur de ces montagnes augmentent l’uniformité et ôtent l’aspect sauvage. Les ruines paraissent très petites ; cela tient à la grande largeur du Rhin. À partir de Bingen, l’aspect change ; les rives sont plates, mais ne manquent pas de charme… des îlots, des saules, etc. : le soleil couchant faisait merveille.
Arrivé à Mayence de mauvaise humeur. Bien soupe à l’hôtel du Rhin et passé une bonne nuit dans des lits enfin passables.
Relevé la nuit, admiré le clair de lune sur le Rhin ; spectacle vraiment magnifique : le croissant, les étoiles, etc.
Cologne, lundi 5 août. — Le matin aussi magnifique qu’avait été la nuit : le soleil en face et éblouissant.
Parti à sept heures et demie. Fait la route très rapidement et repassé par tout ce que j’avais vu la veille, éclairé diversement. À Coblentz, de bonne heure. Depuis Coblentz, resté dans la cabine du bateau pour me reposer de la veille et éviter la chaleur.
Avant quatre heures à Cologne, que j’ai trouvée tout en fête, et pavoisée de tous les drapeaux allemands possibles… On tirait des coups de canon sur le Rhin, etc. Hôtel du Rhin, où je n’ai pas été aussi bien qu’à Mayence.
Sorti vers cinq heures, à travers la ville qui me rappelle beaucoup Aix-la-Chapelle… Très animée et très intéressante. Couru à travers la ville par une chaleur affreuse.
Vu l’église de Sainte-Marie du Capitole, que j’avais prise pour Saint-Pierre. Attendu énormément pour se faire ouvrir, dans une espèce de cloître rarrangé, mais qui a dû être beau. L’église, extérieurement, du côté du chevet, très ancienne : gothique roman, en pierres de diverses couleurs. Portique intérieur très beau sous les orgues ; marbre blanc et noir. Figures et petits tableaux, dans la nef, de la vie de saint Martin et autres, composés pour la plupart avec des figures de Rubens. Tableau double d’Albert Dürer dans une petite chapelle fermée.
De là, reparti pour trouver mon Saint Pierre. Après avoir demandé inutilement, tiré d’embarras par un confrère peintre en bâtiments qui, la brosse à la main et ôtant pour ainsi dire son bonnet au nom de Rubens, que tout le monde connaît ici, même les enfants et les fruitières, m’a renseigné comme il a pu. Église assez mesquine, précédée d’un cloître rempli de petites stations, calvaire, etc. La dévotion est extrême. Moyennant mes quinze silbergroschen ou un florin ou deux francs, j’ai vu le fameux Saint Pierre, lequel a pour envers une infâme copie. Le Saint est magnifique ; les autres figures qui me paraissent avoir été faites seulement pour l’accompagner, et probablement composées et trouvées après coup, sont des plus faibles, mais toujours de la verve… En somme, j’en ai eu assez d’une fois. Je me rappelle pourtant encore avec admiration les jambes, le torse, la tête ; c’est du plus beau, mais la composition ne saisit pas.
Rentré exténué à travers les rues, mais dîné de bonne heure.
Malines, mardi 6 août. — A Cologne. Je comptais partir pour Bruxelles ou Malines dans la journée. Forcé de partir à dix heures, à cause des heures de départ.
Pris le commissionnaire pour aller voir la cathédrale. Ce malheureux édifice, qui ne sera jamais terminé, est encombré, pour l’éternité par conséquent, de baraques et de planches servant aux travaux. Saint-Ouen de Rouen, auquel on a cru devoir ajouter les clochers qui lui manquaient, pouvait très bien s’en passer ; mais Cologne est à un état d’ébauche singulier, la nef n’est pas même couverte. Voilà ce qu’on devrait s’appliquer à finir ; le portail entraînerait des travaux gigantesques, et les quelques pauvres diables qu’on aperçoit et qu’on entend dans ces baraques picoter des morceaux de pierre n’avanceront pas en trois siècles la besogne au dixième, à supposer qu’on leur donne de l’argent.
Ce qui est fait est magnifique. On sent une impression de grandeur, qui m’a rappelé la cathédrale de Séville. Le chœur et la croix sont faits depuis longtemps. On s’est amusé à dorer et peindre en rouge les chapiteaux du chœur. Les petits pendentifs sont occupés par des figures d’anges en style soi-disant raphaélesque, de l’effet le plus mesquin.
Plus j’assiste aux efforts qu’on fait pour restaurer les églises gothiques, et surtout pour les peindre, plus je persévère dans mon goût de les trouver d’autant plus belles qu’elles sont moins peintes. On a beau me dire et me prouver qu’elles l’étaient, chose dont je suis convaincu, puisque les traces existent encore, je persiste à trouver qu’il faut les laisser comme le temps les a faites ; cette nudité les pare suffisamment ; l’architecture a tout son effet, tandis que nos efforts, à nous autres hommes d’un autre temps, pour enluminer ces beaux monuments, les couvrent de contresens, font tout grimacer, rendent tout faux et odieux. Les vitraux que le roi de Bavière a donnés à Cologne sont encore un échantillon malheureux de nos écoles modernes ; tout cela est plein du talent des Ingres et des Flandrin. Plus cela veut ressembler au gothique, plus cela tourne au colifichet, à la petite peinture néo-chrétienne des adeptes modernes. Quelle folie et quel malheur, quand cette fureur, qui pourrait s’exercer sans nuire dans nos petites expositions, est appliquée à dégrader de beaux ouvrages comme ces églises ! Celle de Cologne est remplie de monuments curieux : des archevêques, des guerriers, des retables, tableaux ou sculptures, représentant la Passion, etc.
Vu en sortant l’église des Jésuites. Voilà le contre-pied de ce que nous faisons aujourd’hui : au lieu de s’amuser à imiter des monuments d’une autre époque, on faisait ce qu’on pouvait, mêlant gothique, Renaissance, tous les styles enfin ; et de tout cela des artistes vraiment artistes savaient faire des ensembles charmants. On est ébloui dans ces églises de la profusion des richesses en marbres, statues, tombeaux, tapissant les murs et s’étalant sous les pieds. Des stalles en bois se prolongent tout le long des murs ; l’orgue orné, etc.
En revenant, à l’Hôtel de ville : édifice charmait, de la Renaissance ; en face, une maison probablement du temps de Henri IV : très imposant style rustique.
Cette ville est des plus intéressantes, animée, gaie et, sauf les uniformes prussiens qui me font un effet désagréable, faite pour l’imagination.
En allant au chemin de fer, revu l’extérieur des tours, etc.
— Parti à dix heures ; chaleur extrême et route fatigante. Corvée des douanes, avant Verviers ou à Verviers même.
Écrivassé pendant la route sur mon petit calepin.
— Arrivé à Malines à six heures environ. Bon petit hôtel de Saint-Jacques et bon souper qui m’a remis. Les grands hommes qui écrivent leurs mémoires ne parlent pas assez de l’influence d’un bon souper sur la situation de leur esprit. Je tiens fort à la terre par ce côté, pourvu toutefois que la digestion ne vienne pas contre-balancer l’effet favorable de Cérès et de Bacchus. Encore serait-il vrai que, tout le temps qu’on tient table et même encore quelque temps après, le cerveau voit les choses sous un autre aspect qu’auparavant. C’est une grande question qui humilie certains hommes, qui se croient ou qui se voudraient beaucoup plus qu’hommes, que ce feu qui naît de la bouteille et vous porte plus loin que vous n’eussiez été sans cela. Il faut bien s’y résigner, puisque non seulement cela est, mais que, de plus, cela est fort agréable.
Malines, 7 août. — Couru les églises à Malines.
Église de Saint-Jean : là, l’Adoration des rois, le Saint Jean dans la chaudière, et le Saint Jean-Baptiste, trois chefs-d’œuvre. C’est au rang des plus beaux. Les volets sont beaux aussi. Saint Jean écrivant, l’aigle au-dessus de lui, et de l’autre le Baptême de Notre-Seigneur. J’ai été voir le sacristain pour lui demander de les dessiner.
De là, à la cathédrale de Saint-Rombaud (Rumoldus). Magnifique église. Monuments de tous côtés : statues couchées des archevêques dans le chœur ; statues des douze apôtres dans la nef, adossées aux piliers. La même chose à l’église de Sainte-Marie, où est la Pêche miraculeuse. Il y a dans la cathédrale un Van Dyck, le Christ au milieu des larrons, que j’ai trouvé très faible. Très grand tableau. Les tons bistrés dans les ombres le rendent très triste.
A Sainte-Marie, la Pêche de Rubens, avec les côtés, y compris les volets dont saint Pierre debout, de face, les clefs au-dessus de lui. De l’autre, saint André vêtu de couleurs obscures et déjà presque invisible par la moisissure, ainsi que la Pêche, qui commence à se ternir. Rubens est le peintre qui a le plus à perdre avec cette dégradation. Son habitude constante de faire les chairs plus claires que le reste en fait comme des fantômes quand les fonds sont devenus obscurs. Il est obligé de les pousser au sombre pour faire ressortir les tons des chairs.
Malines, jeudi 8 août. — Parti pour Alost, à sept heures. Rencontré Raisson[521] à la station. Cette vieille figure de camarade m’a fait plaisir. Il est un peu froid, et cela n’en vaut peut-être que mieux. Nous avons été ensemble jusqu’à Audeghen, où j’ai pris l’omnibus d’Alost. Les ennuis de ce petit voyage étaient sauvés par le sentiment de plaisir que me cause ce pays, et aussi par cette vie décousue qui a son charme.
Arrivé par la pluie, descendu chez la bonne dame de l’auberge des Trois Rois, pauvre auberge de commis marchands.
J’ai commencé par aller voir le tableau : j’ai vu tout de suite, quoi qu’on prétende qu’il a peu souffert, que son aspect lisse et jaune était l’effet de la restauration. Il y a au-dessous, sur l’autel, deux esquisses de Rubens, représentant saint Roch.
Revenu déjeuner à l’auberge et attendu l’heure de retourner. Enfin, passé deux heures seul dans l’église à faire un croquis.
J’ai été, dans ce voyage, la providence des bedeaux.
À trois heures, reparti en société de trois prêtres d’une gaieté remarquable. Ils ont l’air dans ce pays d’être tout à fait chez eux ; ils ont cet air heureux et confiant qui ne se rencontre pas, chez nous, chez les gens de cette robe.
Malines, vendredi 9 août. — Malines. Couru encore les églises dans la matinée ; la Pêche m’a paru bien plus belle ; le Saint Pierre et le Saint André, qui servent de volets, admirables. Le Tobie, qui est l’envers du volet de saint André, est moins remarquable que l’autre, qui est le poisson trouvé par saint Pierre. … Quelle aisance dans ce saint Pierre debout, drapé dans son manteau ! Qu’il a peu cherché pour cela ! Ces pieds vigoureux, cet arrangement puissant, ce bout de filet qui pend ! Quelle force et quelle facilité[522] !
Charmante Élévation en croix. Bas-relief dans les bas côtés.
Temps charmant. Couru les autres églises avec un plaisir extrême. D’abord Notre-Dame d’Answyck : église moderne et bizarre ; grands bas-reliefs au-dessus des arcades portant le dôme. Portement de croix, etc. Chaire à prêcher : Adam et Ève se cachant après le péché.
Pris les remparts par le temps le plus gai, pour aller à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, très belle église style Louis XIV, très riche, la plus riche de là.
Enfilades de tableaux représentant des miracles de Jésuites et autres religieux, peu remarquables, mais faisant leur effet, adossés aux murs et dans l’architecture. Peintres occupés à repeindre les piliers. On repeint sans cesse ici.
La place de l’Église a fort bon air.
Revenu à Saint-Rombaud et revu le Van Dyck, qui m’a moins déplu.
Rentré fatigué. J’avais abusé un peu, dans l’intention où j’étais d’aller dessiner. Reposé une heure environ et parti avec Jenny pour l’église Saint-Jean, où j’ai dessiné deux ou trois heures. Acheté des pots d’étain.
Le soir, je suis sorti de nouveau par la porte de ville qui est au bout de notre rue. Le matin, j’avais fait cette connaissance ; le soir, elle était très pittoresque.
Revenu près de l’église de Notre-Dame. Dévotion des femmes devant les stations.
Je me suis enfoncé dans les rues. Côtoyé un grand canal, et enfin, vers neuf heures, je me suis perdu vers la cathédrale, dont j’ai eu de la peine à revenir.
Samedi 10 août. — Samedi matin, parti pour Anvers. Une certaine lâcheté me faisait hésiter ; j’ai eu tout sujet de m’applaudir, comme on verra, de mon courage.
Parti à sept heures. Déjeuné au Grand Laboureur. Des Anglais, toujours et partout !
Cathédrale : le tableau d’autel.
Couru après Braekeleer[523], qui se faisait d’abord tirer l’oreille, et qui m’a enfin donné rendez-vous pour le soir à six heures et demie.
Église Saint-Jacques Saint-Paul ; les Jésuites, que j’ai fort admirés et qui m’a fait penser à l’ornementation de ma chapelle ; marbres incrustés, etc.
Le port d’Anvers.
Saint-Antoine de Padoue. Église petite. Un Rubens médiocre, représentant le Saint et la Vierge, — La Flagellation de saint Paul, plus sublime que jamais.
— Le Calvaire dans ladite église. Je me suis rappelé que je l’avais vu il y a onze ans, dans des circonstances différentes.
Enfin le Musée. Fait un croquis d’après Cranach. Admiré les Ames du purgatoire, c’est de la plus belle manière de Rubens. Je ne pouvais me détacher du tableau de la Trinité, du Saint François, de la Sainte Famille, etc. Enfin, le jeune homme qui copie le grand Christ en croix ma prêté son échelle, et j’ai vu le tableau dans un autre jour. C’est du plus beau temps ; la demi-teinte est franchement tournée dans la préparation et les touches hardies de clair et d’ombres mises dans la pâte très épaisse, surtout dans le clair. Comment ne me suis-je aperçu que maintenant à quel point Rubens procède par la demi-teinte, surtout dans ses beaux ouvrages ? Ses esquisses auraient dû me mettre sur la voie. Contrairement à ce qu’on dit du Titien, il ébauche le ton des figures qui paraissent foncées sur le ton clair. Cela explique aussi qu’en faisant le fond ensuite et par un besoin extrême de faire de l’effet, il s’applique à rendre les chairs brillantes outre mesure en rendant le fond obscur. La tête du Christ, celle du soldat qui descend de l’échelle, les jambes du Christ et celles de l’homme supplicié très colorées dans la préparation, et clairs posés seulement à petites places. La Madeleine remarquable pour cette qualité : on voit clairement les yeux, les cils, les sourcils, les coins de la bouche dessinés par-dessus, je crois, dans le frais, contrairement à Paul Véronèse.
Se rappeler aussi les Ames du purgatoire. La demi-teinte tournée est évidente dans les figures du bas et les touches qui reviennent dessiner les traits. L’esquisse du tableau devait être bonne pour mettre à même de faire le tableau ainsi et à coup sûr. Chercher dans l’esquisse et aller sûrement dans l’exécution du tableau.
— Le soir, après dîner, parti par un beau soleil, pour aller chez Braekeleer ; admiré, en remontant sa rue, de magnifiques chevaux flamands, un jaune et un noir.
Vu enfin la fameuse Élévation en croix : émotion excessive ! Beaucoup de rapports avec la Méduse… Il est encore jeune et pense à satisfaire les pédants… Plein de Michel-Ange. Empâtement extraordinaire. Sécheresse qui touche au Mauzaisse, dans quelques parties, et pourtant point choquante. Cheveux très sèchement faits dans des têtes frisées, dans le vieillard à tête rouge et à cheveux blancs qui soulève la croix en bas à droite, dans le chien, etc. ; n’est point préparé par la demi-teinte. Dans le volet de droite, on voit des préparations empâtées comme celles que je fais souvent et le glacis par-dessus, notamment dans le bras du Romain, qui tient le bâton, et dans les criminels qu’on crucifie. Encore plus probable, quoique dissimulé par le fini, dans le volet de gauche. La coloration a disparu dans les chairs, dont les clairs sont jaunes et les ombres noires. Plis étudiés pour faire du style, coiffures soignées. Plus de liberté, quoique d’un pinceau académique, dans le tableau du milieu, mais entièrement libre et revenu à sa nature, dans le volet du cheval, qui est au-dessus de tout.
Cela m’a grandi Géricault, qui avait cette force-là, et qui n’est en rien inférieur. Quoique d’une peinture moins savante dans l’Élévation en croix, il faut avouer que l’impression est peut-être plus gigantesque et plus élevée que dans les chefs-d’œuvre. Il était imbu d’ouvrages sublimes ; on ne peut pas dire qu’il imitait. Il avait ce don-là, avec les autres en lui. Quelle différence avec les Carrache ! En pensant à eux, on voit bien qu’il n’imitait pas ; il est toujours Rubens.
Cela me sera utile pour mon plafond[524]. J’avais ce sentiment quand j’ai commencé. Peut-être le devais-je aussi à d’autres ? La fréquentation de Michel-Ange a exalté et élevé successivement au-dessus d’eux-mêmes toutes les générations de peintres. Le grand style ne peut se passer du trait arrêté d’avance. En procédant par la demi-teinte, le contour vient le dernier : de là plus de réalité, mais plus de mollesse et peut-être moins de caractère.
Le soir, Braekeleer, qui m’avait dit qu’il lui serait impossible de me faire revoir les tableaux le lendemain, qu’il avait une partie, je ne sais quoi, est revenu, s’étant ravisé, je crois, sur ce que d’autres lui auront fait sentir que je méritais qu’on se dérange pour moi ; est revenu, dis-je, me chercher pour passer la soirée avec ses amis les artistes et me promettre qu’il me mènerait derechef le lendemain.
Achevé la soirée avec M. Leys[525], un autre peintre et un amateur. Ils m’ont reconduit à mon hôtel des Pays-Bas.
Malines, dimanche 11 août. — À Anvers. Vers dix heures, Braekeleer est venu me prendre pour retourner voir les tableaux de Rubens en restauration. Cet intarissable bavard m’a gâté cette seconde séance en étant sans cesse sur mon dos et ne parlant que de lui. L’impression d’hier soir, au crépuscule, avait été la bonne.
J’ai été tellement fatigué qu’après l’avoir accompagné chez l’amateur qui m’avait invité la veille à voir ses tableaux, je suis rentré à mon auberge, et j’ai dormi au lieu de retourner au Musée, ce qui aurait complété mes observations d’hier. Je suis donc resté paresseusement, écoutant le carillon qui m’enchante toujours, en attendant le dîner.
Nous partons à sept heures et demie. Trouvé au chemin de fer M. Van Huthen et un M. Cornelis, major d’artillerie, qui a été fort aimable et fort empressé, regrettant de n’avoir pu m’être utile. Mes amis ne me montrent pas cet intérêt-là. Il faut que la personne d’un homme dont le public s’occupe soit inconnue pour que ce sentiment d’empressement persiste. Quand on a vu plusieurs fois un homme remarquable, on le trouve fort justement à peu près semblable à tous les autres ! Ses ouvrages nous l’avaient grandi et lui prêtaient de l’idéal. De là le proverbe : « Il n’y a pas de héros pour son valet de chambre. » Je crois qu’en y pensant mieux, on se convaincra qu’il en est autrement. Le véritable grand homme est bon à voir de près. Que les hommes superficiels, après s’être figuré qu’il était hors de la nature comme des personnages de roman, en viennent très vite à le trouver comme tout le monde, il n’y a là rien d’étonnant. Il appartient au vulgaire d’être toujours dans le faux ou à côté du vrai. L’admiration fanatique et persistante de tous ceux qui ont approché Napoléon me donne raison.
Le dimanche soir, en rentrant à Malines, sensation agréable de m’y retrouver. Tous ces bons Flamands étaient en fête ; ces gens-là sont bien dans notre nature française.
— Dessiné de mémoire tout ce qui m’avait frappé pendant mon voyage d’Anvers.
Bruxelles, lundi 12 août. — Sorti à neuf heures. Hôtel Tirlemont. Revu la cathédrale et ses magnifiques vitraux. Dessiné trop tôt et trouble d’estomac qui m’a causé un accident passager dont je me suis senti toute la journée. C’est en allant au Musée. J’y suis resté cependant jusqu’à trois heures.
— Tableau de Flinck. Celui de la première salle librement peint.
Le coup de lance. Le soldat qui perce le côté, d’une tonalité plus foncée que le larron qui est derrière, ce qui l’enlève parfaitement. Le larron, d’un ton doré, — son linge également de même valeur qui se confond avec le ciel qui est d’un gris chaud. Le cou du cheval plus clair : — un luisant très vif sur l’armure sous le bras du soldat à la lance, et le ciel très bleu entre les bras de l’autre.
La lumière dégradée sur les jambes du Christ depuis les genoux. La tête, le bras et l’autre main de la Madeleine très vifs. Les pieds du Christ, très demi-teintés, mais d’une légèreté admirable. Le genou se détachant à merveille sur le bras et la main de la Madeleine. Tout le genou du soldat qui descend de l’échelle, d’une valeur analogue aux pieds du Christ, sauf quelques luisants, mais doux.
Le linge du haut du bras de la Madeleine d’un blanc mat, quoique vif et analogue au col. La partie éclairée de l’échelle qui sépare ses cheveux du manteau rouge de saint Jean, d’un gris perle jaunâtre, presque comme les cheveux.
L’échelle contre les jambes du larron, ses deux jambes (sauf le genou droit un peu plus coloré), mais les pieds surtout, sauf l’ombre, du même ton gris bleuâtre, brunâtre. La croix près des pieds, de même. Le ciel à peu près de même valeur. Le bras du soldat se détache de la jambe du larron, seulement parce qu’il est un peu plus rouge.
Le groupe de la Vierge plus sombre en masse que la Madeleine, quoique dans le clair ; mais la tête très brillante, quoiqu’un peu moins que la Madeleine, et les mains aussi brillantes que possible. Le saint Jean d’une valeur très demi-teintée du haut en bas. Le manteau bleu de la Vierge un peu plus clair que le rouge du manteau. Sa robe gris violet un peu plus foncée.
Le bâton de l’échelle a un clair qui se prolonge jusqu’à la jambe du larron.
La tête de la Madeleine se détache à merveille sur la partie demi-teinte claire du bois de la croix et par derrière sur le ciel de même valeur ; comme je l’ai dit, toute cette grappe sublime de l’échelle, des pieds du larron, des jambes du soldat, de la cuirasse foncée avec son luisant qui relève le tout.
— Les petites esquisses sont bien plus fermes et mieux dessinées que les grands tableaux.
— Promenade dans le parc, pour me remettre, par un temps gris. Descendu dans l’enfoncement. Le soir, promenade vers le théâtre et à travers les passages, J’aimais à revoir tous ces lieux où je me suis plu il y a onze ans.
Mardi 13 août. — Je lis à Bruxelles, dans le journal, qu’on a fait à Cambridge des expériences photographiques pour fixer le soleil, la lune et même des images d’étoiles. On a obtenu de l’étoile Alpha, de la Lyre, une empreinte de la grosseur d’une tête d’épingle. La lettre qui constate ce résultat fait une remarque aussi juste que curieuse : c’est que la lumière de l’étoile daguerreotypée mettant vingt ans à traverser l’espace qui la sépare de la terre, il en résulte que le rayon qui est venu se fixer sur la plaque avait quitté sa sphère céleste longtemps avant que Daguerre eût découvert le procédé au moyen duquel on vient de s’en rendre maître
J’ai été languissamment au Musée ; j’étais sous l’impression du malaise d’hier. Il y avait des courants d’air qui m’ont chassé.
Le matin, j’avais été chercher M. Van Huthen, au bout de la ville ; il m’a mené chez quelques marchands d’estampes. J’ai remarqué de plus en plus combien le Portement de croix, le Christ foudroyant le monde, le Saint Liévin caractérisent une manière à part chez Rubens. Je crois que c’est la dernière. C’est la plus habile. L’opposition des tableaux voisins ne sert qu’à faire ressortir cette différence, L’Assomption est très sèche. Il en est de même de l’Adoration des mages, qui m’avait tant séduit le premier jour, sans doute à cause du soir.
Paris, mercredi 14 août. — Parti de Bruxelles à neuf heures. Journée assez fatigante. Arrivé à Paris vers six heures.
Trouvé dans la diligence un original de soixante-dix ans ressemblant à M. Bertin le père, qui a une excellente philosophie ; il vit à Louviers chez ses enfants. Le bonhomme s’est gardé la libre disposition de son argent qui n’est pas considérable, à ce qu’il dit, mais qui, employé comme il le sait faire, le rend très heureux. A tout instant il part, il va faire un voyage et revient quand il a assez de ses tournées. Il vit certainement davantage.
— Il me semble qu’il y a trois mois que j’ai quitté Paris.
Samedi 17 août. — Ton fin pour demi-teinte d’or et pour draperie neutre propre à relever ce qui entoure par une opposition : Base, chrome le plus clair. — Demi-teinte, soit terre d’ombre, soit terre de Cassel blanc. Ocre ou autre ajouté suivant la convenance.
Ton jaune pour le ciel après le ton clair de jaune de Naples et blanc, qui entoure l’Apollon[526] : ocre jaune, blanc, chrome no 2. En dégradant, la terre d’ombre naturelle substituée à l’ocre jaune.
Clairs du manteau de l’Éole : terre d’Italie naturelle, vermillon. Ombres : laque brûlée, terre d’Italie brûlée.
Clairs de la robe d’Iris : vert émeraude, jaune de chrome no 2. — Ombres : vert émeraude, terre d’Italie naturelle.
Pour le ciel, le ton doré, à partir de la Gloire, clair autour du soleil : la terre d’Italie naturelle et blanc ; le ton bleu de Prusse et blanc vient s’y marier, mais à sec.
— Pour préparer les figures pour le tableau, partir d’un bon trait, et quand Andrieu aura appliqué la couleur et commencé à tourner sa figure, le redresser dans ce premier travail et tâcher d’obtenir qu’il en vienne à bout avec cette aide… Les retouches que je ferai seront plus faciles. Il faudrait conserver le trait et le perfectionner même avant de s’en servir, de manière à poncer de nouveau sur la préparation peinte, quand le dessin se perdra.
Il faudra suivre en tout la préparation des décorateurs, et particulièrement pour les figures éloignées ; les modeler avec teintes plates, comme nous avons fait dans le carton, les tailler par l’ombre, et pour ainsi dire sans ajouter de clairs.
Vendredi 25 août. — Un critique dit de M. Bazin[527] : « M. Bazin est un homme de beaucoup d’esprit et qui se pique de n’avoir rien, en écrivant, de l’érudit de profession et du pédant. » Je me permettrai seulement de demander si, dans cette abstinence absolue de toute citation et de toute note en un genre d’ouvrage qui les réclame naturellement, si dans cette suppression exacte de tout nom propre moderne, là même où l’auteur y songe le plus et y fait allusion, si dans cette attention tout épigrammatique de ne laisser sans rectification aucune des petites erreurs d’autrui, il n’y a pas une sorte de pédantisme. L’honnête homme est celui qui ne se pique de rien, a dit La Rochefoucauld ; M. Bazin se pique d’être honnête homme. Quand on fait un métier, il faut franchement en être ; c’est à la fois plus simple, plus commode, et de meilleur goût.
— Ce que dit M. Villemain de l’histoire (quelle est toujours à faire, etc.) peut se dire de tout. Non seulement je puis trouver, dans les récits d’un autre, matière à de nouveaux récits intéressants à mon point de vue, mais le propre récit que je viens de faire, je le referai de vingt manières différentes. Il n’y a probablement que Dieu ou qu’un dieu pour ne dire des choses que ce qui doit en être dit.
Mardi 3 septembre. — Commencé au Louvre pour le plafond[528].
J’ai aidé Andrieu à tracer les carreaux sur le carton.
Mardi 17 septembre. — Reçu la visite de M. Laurens, de Montpellier, avec un M. Schirmer[529], paysagiste de Dusseldorf, et M. Saint-René Taillandier[530], de la Revue, qui m’a plu.
Puis Bonvin[531] avec une lettre de Mme Sand. Il a également de bonnes manières. Une Mme Camilla Gondolfi, pittrice sarda ; elle habite Gênes et Turin pendant les sessions.
— Laurens m’apprend que Ziegler[532] fait une grande quantité de daguerréotypes, et entre autres des hommes nus. J’irai le voir pour lui demander de m’en prêter.
Mercredi 18 septembre. — Visite de Wappers[533]. Il me parle de l’alumine. En la broyant avec tous les tons possibles, on obtient un transparent qui en fait une laque.
Lundi 23 septembre. — Wappers, Halévy, Mercey, Duban ont dîné avec moi. Delaroche n’était pas à Paris.
24 septembre. — Je remarquais dans la Susanne, de Paul Véronèse, combien l’ombre et la lumière sont simples chez lui-même sur les premiers plans. Dans une vaste composition comme le plafond, c’est encore bien plus nécessaire. La poitrine de la Susanne semble d’un seul ton, et elle est en pleine lumière ; ses contours sont également très prononcés : nouveau moyen d’être clair à distance. Je l’ai éprouvé également sur le carton, après avoir tracé autour des figures un contour presque niais et sans accents.
— Sur le préjugé qu’on naît coloriste et qu’on devient dessinateur, ou bien le « nascuntur poetæ, fiunt oratores ».
— Sur les peintres-poètes et les peintres-prosateurs.
Dimanche 29 septembre. — Mme Cavé est venue me lire partie de son traité de l’aquarelle, plein de choses charmantes.
En regardant l’esquisse que j’ai colorée de mémoire du Portement de croix de Rubens, je me dis qu’il faudrait ébaucher ainsi les tableaux avec cette intensité de ton qui manque un peu de lumière, mais qui établit les rapports de localité, et ensuite se livrer là-dessus et mettre la lumière et les accents avec la fantaisie et la verve nécessaires ; ce serait le moyen de l’avoir (cette verve) quand il le faut, pour n’en pas dépenser inutilement, c’est-à-dire à la fin. C’est le contraire qui arrive le plus souvent, et à moi particulièrement.
On voit dans le tableau de Van Dyck (je ne parle pas de ses portraits) qu’il n’avait pas toujours la hardiesse nécessaire pour revenir vivement et avec inspiration sur cette préparation où la demi-teinte domine un peu trop.
Il faut à la fois concilier ce que Mme Cavé me disait de la couleur couleur et de la lumière lumière : faire trop dominer la lumière et la largeur des plans conduit à l’absence de demi-teintes et par conséquent à la décoloration ; l’abus contraire nuit surtout dans les grandes compositions destinées à être vues de loin, comme les plafonds, etc. Dans cette dernière peinture, Paul Véronèse l’emporte sur Rubens par la simplicité des localités et la largeur de la lumière. (Se rappeler la Susanne et les vieillards du Musée, qui est une leçon à méditer.) Pour ne point paraître décolorée avec une lumière aussi large, il faut que la teinte locale de Paul Véronèse soit très montée de ton.
Mercredi 9 octobre 1850. — Donné au sieur Lacroix, pour Bourges, marchand de couleurs incendié, un petit pastel représentant un Tigre qui lèche sa patte[534].
Mercredi 16 octobre. — Des licences pittoresques. Chaque maître leur doit souvent des effets les plus sublimes : l’inachevé de Rembrandt, l’outré de Rubens. Les médiocres ne peuvent oser de la sorte ; ils ne sont jamais hors d’eux-mêmes. La méthode ne peut tout régler ; elle conduit tout le monde jusqu’à un certain point. Comment aucun des grands artistes n’a-t-il essayé de détruire cette foule de préjugés ? ils auront été effrayés de la tâche et auront abandonné la foule à ses sottes idées.
Champrosay, samedi 19 octobre. — Payé à Joseph Tissier, ce jour ou deux auparavant, la somme de 55 francs pour vingt-deux journées de travail au jardin. Il a eu l’effronterie de me présenter ce résultat depuis mon départ. De plus, 2 fr. 50 pour un jardinier, auquel il a acheté des fleurs.
3 novembre. — Rubens met franchement la demi-teinte grise du bord de l’ombre entre son ton local de chair et son frottis transparent. Ce ton chez lui règne tout du long. Paul Véronèse met à plat la demi-teinte de clair et celle de l’ombre. (J’ai remarqué par ma propre expérience que ce procédé donne déjà une illusion étonnante.) Il se contente de lier l’un à l’autre par un ton plus gris mis par places et à sec par-dessus. De même, il met, en frôlant, le ton vigoureux et transparent qui borde l’ombre du côté du ton gris.
Titien probablement ne savait pas comment il finirait un tableau… Rembrandt devait être souvent dans ce cas ; ses emportements excessifs sont moins un effet de son intention que celui de tâtonnements successifs.
— Nous avons, dans notre promenade, observé des effets étonnants. C’était un soleil couchant : les tons de chrome, de laque les plus éclatants du côté du clair, et les ombres bleues et froides outre mesure. Ainsi l’ombre portée des arbres sur l’herbe naissante, laquelle était au soleil l’émeraude la plus chaude, était toute froide dans l’ombre portée des arbres tout jaunes, terre d’Italie, brun rouge et éclairés en face par le soleil, se détachant sur une partie de nuages gris qui allaient jusqu’au bleu. Il semble que plus les tons du clair sont chauds, plus la nature exagère l’opposition grise : témoin les demi-teintes dans les Arabes et natures cuivrées. Ce qui faisait que cet effet paraissait si vif dans le paysage, c’était précisément cette loi d’opposition.
Hier, je remarquais le même phénomène au soleil couchant : il n’est plus éclatant, plus frappant que le midi, que parce que les oppositions sont plus tranchées. Le gris des nuages, le soir, va jusqu’au bleu ; la partie du ciel qui est pure est jaune vif ou orangé. Loi générale : plus d’opposition, plus d’éclat.
Samedi 23 novembre. — Donné 10 francs d’avance au jardinier de Mme Desnous. Je suis convenu avec lui de 50 francs par an.
Paris, 26 novembre. — Réunion au Palais-Royal de l’ancien jury, pour dépouiller le scrutin relatif au Salon. Resté jusqu’au dîner.
Mercredi 27 novembre. — J’ai passé la matinée avec Guillemardet, chez lequel j’avais été pour lui recommander Mme Filleau.
Il me donne ce moyen de M. Dupin[535] pour trouver facilement ce qu’on a à dire : c’est de ne point penser aux expressions, lorsqu’on roule à l’avance sa matière dans sa tête, mais seulement de penser à la chose même et s’en bien pénétrer ; l’expression arrive toute seule quand on vient à parler.
Samedi 14 décembre. — Fini aujourd’hui l’examen pour la réception et le placement des tableaux.
Dans huit jours, nous retournerons pour voir de nouveau. Il y a trois semaines que nous ne faisons que cela.
Dimanche 15 décembre. — M. Baldus me donne les recettes suivantes : pour coller le papier sur un panneau pour peindre, avoir des panneaux encadrés en bois simple et qui coûtent meilleur marché. Il faut nettoyer le verre sur lequel on doit calquer le dessin qu’on veut grandir, avec un chiffon et de l’eau-de-vie. Prendre de la colle forte et y mêler un peu de blanc d’Espagne, quand elle est chaude. En mettre sur le panneau et sur le dessin, et appliquer fortement. Quand le tout est bien pris et qu’on veut peindre, passer une couche de gélatine. En mettre de même sur la peinture faite avant de vernir.
Pour reboucher les crevasses dans les tableaux avant de restaurer : Mastic qu’on trouve chez tous les restaurateurs de tableaux, fait de blanc d’Espagne et de colle de peau de lapin. Avant de retoucher, passer légèrement un siccatif, de manière à faire revenir le ton et à imbiber les endroits où est le mastic. Il est entendu qu’en lavant avec soin le tableau avant de retoucher, on n’a laissé le mastic que dans les crevasses. Pour retoucher des épreuves de photographie, mouiller le papier et l’appliquer sur un verre ; il adhérera au moins pendant deux heures ; retoucher dans l’humide avec aquarelle et rehaut de gouache.
Samedi 28 décembre. — Chez Chabrier le soir. J’ai vu là Desgranges[536], qui me disait qu’il s’était heurté une fois contre un pendu dans les rues de Constantinople. C’était un boucher en contravention… Il en faut de très légères pour être puni du dernier supplice ; une augmentation de moins d’un liard sur le prix fixé par la police est une raison suffisante. Au reste, cela n’étonne personne. Les janissaires lui disaient (à Desgranges), et c’est l’opinion commune dans le peuple, que le sultan a quatorze hommes à tuer par jour.
— Il y avait Villemain l’ingénieur et un ingénieur des ponts et chaussées. Ces messieurs regardaient une invasion comme impossible, d’abord parce que tout le monde se réunirait contre l’étranger (plaisante sécurité dans un pays divisé) ; ensuite parce que l’artillerie était si perfectionnée que nulle force envahissante n’était capable d’en triompher, non plus que des tirailleurs combattant isolément et armés d’excellentes carabines, sous ce prétexte qu’une armée d’invasion devait agir par colonnes profondes, et que les habitants s’éparpillant et travaillant sur elle devaient en avoir raison. On avait beau leur objecter que l’artillerie d’une part était perfectionnée pour tout le monde, et que les assaillants auraient à ce sujet un avantage égal ; que, de l’autre côté, rien ne les empêchait d’agir en tirailleurs… Il n’y a pas eu moyen de les tirer de là.
1851
Jeudi 2 janvier. — Ovale du plafond de Saint-Sulpice :
3 mètres 84 cent. = 12 pieds.
Lundi 13 janvier. — M. Haro a à m’arranger :
Le Cheval gris terrassé par une lionne. Le rentoilage s’était dédoublé.
Arabe accroupi, provenant d’une toile plus grande, sur laquelle était la Susanne de Villot.
La grande toile où étaient deux études de Chats, au bitume[537].
Le Boissy d’Anglas[538]
28 février. — De Liszt sur Chopin.
« Quelque regretté qu’il soit et par tous les artistes et par tous ceux qui l’ont connu, il nous est permis de douter que le moment soit déjà venu où, apprécié à sa juste valeur, celui dont la perte nous est si particulièrement sensible, occupera le haut rang que lui réserve probablement l’avenir. »
Quelle que soit donc la popularité d’une partie des productions de celui que les souffrances avaient brisé longtemps avant la mort, il est néanmoins à présumer que la postérité aura pour ses ouvrages une estime moins frivole et moins légère que celle qui leur est encore accordée. Ceux qui, dans la suite, s’occuperont de l’histoire de la musique, feront sa part, et elle sera grande, à celui qui y marqua par un si rare génie mélodique, par de si heureux et remarquables agrandissements du tissu harmonique, que ses conquêtes seront avec raison plus prisées que mainte œuvre de surface plus étendue, jouée et rejouée par un grand nombre d’instruments, chantée et rechantée par la foule des prima donna.
En se renfermant dans le cadre exclusif du piano, Chopin, à notre sens, a fait preuve d’une des qualités les plus essentielles à un écrivain, la juste appréciation de la forme dans laquelle il lui est donné d’exceller, et néanmoins ce fait, dont nous lui faisons un sérieux mérite, nuisit à l’importance de sa renommée.
Difficilement peut-être un autre, en possession de si hautes facultés mélodiques et harmoniques, eût-il résisté aux tentations que présentent les chants de l’archet, les alanguissements de la flûte, les assourdissements de la trompette, que nous nous obstinons encore à croire la seule messagère de la vieille déesse dont nous briguons les subites faveurs. Quelle conviction réfléchie ne lui a-t-il pas fallu pour se borner à un cercle plus aride en apparence et y faire éclore par son génie ce qui semblait ne pouvoir fleurir sur ce terrain ? Quelle pénétration intuitive ne révèle pas ce choix exclusif qui, arrachant les divers effets des instruments à leur domaine habituel, où toute l’écume du bruit fût venue se briser à leurs pieds, les transportait dans une sphère plus restreinte, mais plus idéalisée ? Quelle confiante aperception des puissances futures de son instrument a dû présider à cette renonciation volontaire d’un empirisme si répandu qu’un autre eût probablement considéré comme un contresens d’enlever d’aussi grandes pensées à leurs interprètes ordinaires ! Combien nous devons sincèrement admirer cette unique préoccupation du beau pour lui-même, qui d’une part a soustrait son talent à la propension commune de répartir entre une centaine de pupitres chaque brin de mélodie, et qui de l’autre lui fit augmenter les ressources de l’art, en enseignant à les concentrer dans un moindre espace !
Loin d’ambitionner le fracas de l’orchestre, Chopin se contenta de voir sa pensée intégralement reproduite sur l’ivoire du clavier. Il atteignit toujours son but, celui de ne rien faire perdre en énergie à la conception musicale ; mais il ne prétendait jamais aux effets d’ensemble et à la brosse du décorateur. On n’a point assez sérieusement et assez attentivement réfléchi sur la valeur des dessins de ce pinceau délicat, habitué qu’on est de nos jours à ne considérer comme compositeurs dignes d’un grand nom que ceux qui ont laissé au moins une demi-douzaine d’opéras, autant d’oratorios et quelques symphonies, demandant ainsi à chaque musicien de faire tout et un peu plus que tout.
Cette notion, si généralement répandue qu’elle soit, n’en est pas moins d’une justesse très problématique. Nous sommes loin de contester la gloire plus difficile à obtenir et la supériorité réelle des chantres épiques qui déploient sur un large plan leurs splendides créations ; mais nous désirerions qu’on appliquât à la musique le prix qu’on met aux proportions matérielles dans les autres arts, qui, en peinture par exemple, place une toile de vingt pouces carrés, comme la Vision d’Ézéchiel de Raphaël ou le Cimetière de Ruysdaël, parmi les chefs-d’œuvre évalués plus haut que tel immense tableau, fût-il de Rubens ou du Tintoret. En littérature, Béranger est-il un moins grand poète pour avoir resserré sa pensée dans les limites étroites de la chanson ? Pétrarque ne doit-il pas son triomphe à ses sonnets, et de ceux qui ont le plus répété leurs suaves rimes, en est-il beaucoup qui connaissent l’existence de son poème sur l’Afrique ? Or, on ne saurait s’appliquer à faire une analyse intelligente des travaux de Chopin sans y trouver des beautés d’un ordre très élevé, d’une expression parfaitement neuve et d’une contexture harmonique aussi originale qu’accomplie. Chez lui la hardiesse se justifie toujours, la richesse, l’exubérance même n’excluent pas la clarté ; la singularité ne dégénère pas en bizarrerie baroque ; les ciselures ne sont pas désordonnées, et le luxe de l’ornementation ne surcharge pas l’élégance des lignes principales. Les meilleurs ouvrages abondent en combinaisons qui, on peut le dire, forment époque dans le maniement du style musical. Osées, brillantes, séduisantes, elles déguisent leur profondeur sous tant de grâce, et leur habileté sous tant de charme, que ce n’est qu’avec peine qu’on peut se soustraire à ce charme entraînant pour les juger à froid sous le point de vue de leur valeur théorique ; valeur qui a déjà été sentie, mais qui se fera de plus en plus reconnaître, lorsque le temps sera venu d’un examen attentif des services rendus à l’art, durant la période que Chopin a traversée.
C’est à lui que nous devons cette extension des accords, soit plaqués, soit en arpèges, soit en batteries ; ces sinuosités chromatiques et enharmoniques dont ses études offrent de si frappants exemples ; ces petits groupes de notes surajoutées, tombant par-dessus la figure mélodique, pour la diaprer comme une rosée, et dont on n’avait encore pris le modèle que dans les fioritures de l’ancienne grande école de chant italien. Recalant les bornes dont on n’était pas sorti jusqu’à lui, il donna à ce genre de parure l’imprévu et la variété que ne comportait pas la voix humaine servilement copiée par le piano, dans des embellissements devenus stéréotypés et monotones.
Il inventa ces admirables progressions harmoniques qui ont doté d’un caractère sérieux même les pages qui, par la légèreté de leur sujet, ne paraissaient pas devoir prétendre à cette importance. Mais qu’importe le sujet ? N’est-ce pas l’idée qu’on en fait jaillir, l’émotion qu’on y fait vibrer, qui l’élève, l’ennoblit et le grandit ? Que de mélancolie, que de finesse, que de sagacité, que d’art surtout, dans ces chefs-d’œuvre de la Fontaine dont les sujets sont si familiers et les titres si modestes ! Le titre d’études et de préludes l’est aussi ; pourtant les morceaux de Chopin qui les portent n’en resteront pas moins des types de perfection dans un genre qu’il a créé, et qui relève, ainsi que toutes ses œuvres, du caractère de son genre poétique.
Écrits presque en premier jet, ils sont empreints d’une verve juvénile qui s’efface dans quelques-uns de ses ouvrages subséquents plus élaborés, plus achevés, plus savants, pour se perdre tout à fait dans ses dernières productions d’une sensibilité surexcitée, qu’on dirait être la recherche de l’épuisement.
Si nous avions à parler ici en termes d’école du développement de la musique de piano, nous disséquerions ces magnifiques pages qui offrent une si riche glane d’observations ; nous explorerions, en première ligne, ces nocturnes, ballades, impromptus, scherzos, qui tous sont pleins de raffinements harmoniques aussi inattendus qu’inentendus ; nous les rechercherions également dans ses polonaises, mazurkas, valses, boléros… Mais ce n’est ni l’instant ni le lieu d’un travail pareil, qui n’offrirait d’intérêt qu’aux adeptes.
C’est par le sentiment qui déborde de toutes ces œuvres qu’elles se sont répandues et popularisées ; sentiment éminemment romantique, individuel, propre à leur auteur et néanmoins sympathique non seulement au pays qui lui doit une illustration de plus, mais à tous ceux que purent jamais toucher les infortunes de l’exil et les attendrissements de l’amour.
Ne se contentant pas toujours des cadres où il était libre de dessiner les contours si heureusement choisis par lui, Chopin voulut aussi enclaver sa pensée dans les classiques barrières. Il a écrit de beaux concertos et de belles sonates : toutefois il n’est pas difficile de distinguer dans ces productions plus de volonté que d’inspiration. La sienne était impérieuse, fantasque, irréfléchie. Ses allures ne pouvaient être que libres, et nous croyons qu’il a violenté son génie chaque fois qu’il a cherché à l’astreindre aux règles, aux classifications, à une ordonnance qui n’était pas la sienne et ne pouvait concorder avec les exigences de son esprit, un de ceux dont la grâce se déploie surtout lorsqu’ils semblent aller à la dérive.
Il a pu être entraîné à désirer ce double succès par l’exemple de son ami Mickiewicz[539], qui, après avoir réussi dans une poésie fantastique qui lui est propre, réussit jusqu’à un certain point dans la forme classique. Chopin n’obtint pas aussi complètement le même succès, à notre avis ; il n’a pas pu maintenir, dans le carré d’une coupe anguleuse et raide, ce contour flottant et indéterminé qui fait le charme de sa pensée ; il n’a pas pu y enserrer cette indécision nuageuse et estompée, qui, en détruisant toutes les arêtes de la forme, la drape de longs plis comme de flocons brumeux.
Ces essais brillent pourtant par une rare distinction de styles et renferment des fragments d’une surprenante grandeur. Nous citerons l’adagio du second concerto, pour lequel il avait une prédilection marquée et qu’il se plaisait à redire fréquemment. Ses dessins accessoires appartiennent à la plus belle manière de l’auteur… Tout ce morceau est plein d’une idéale perfection, son sentiment tour à tour radieux et plein d’apitoiements. Il fait songera un magnifique paysage inondé de lumière, à quelque fortunée vallée de Tempé qu’on aurait fixée pour être le lieu d’un récit lamentable, d’une scène attendrissante ; on dirait un irréparable regret, accueillant le cœur humain en face d’une incomparable splendeur de la nature. Contraste soutenu par une fusion de tons, une dégradation de teintes incomparable qui empêche que rien de heurté ou de brusque ne vienne faire dissonance à l’impression émouvante qu’il produit, et qui en même temps mélancolise la joie et rassérène la douleur.
Mardi 29 avril[540]. — Ton des enfants dans le tableau de Python. Après avoir cherché et massé avec des tons frais et demi-teinte en même temps, modelé à sec en mettant des clairs très empâtés de blanc et très peu de vermillon.
Sur les ombres, frotté le ton de vermillon, bleu de Prusse et blanc, lequel doit déborder pour faire la demi-teinte bleuâtre, et sur lequel, pour faire le reflet, on met le ton de blanc et vermillon avec antimoine ou cadmium, mais l’antimoine fait plus frais. En repassant ce reflet qui doit faire mieux à sec, il faut ajouter le ton de bleu de Prusse ci-dessus à l’antimoine.
Les tons de repiqués vigoureux dans les ombres ou de contours prononcés en brun avec vermillon et cobalt. Ce ton est excellent pour préparer et chercher le dessin par la couleur dans les natures fraîches.
Pour finir les clairs, repeindre légèrement avec des demi-pâtes pour lier le rehaut de blanc avec la masse générale.
Pour retoucher la Vénus qui était trop jaune, frotté les ombres surtout et presque toutes les parties avec laque jaune et laque rouge. Pour le reflet dans les ombres sur ce frottis, antimoine avec bleu de Prusse, vermillon et blanc. Ce ton est très remarquable.
Pour les reflets de chairs tendres plus chauds, mettre cadmium, au lieu d’antimoine. Cette dernière couleur fait très bien aussi avec terre de Cassel, et blanc.
Cette préparation de bleu de Prusse, vermillon et blanc s’applique aux chairs dont la demi-teinte est violette, comme dans le pastel que j’ai fait d’après Mme Cavé. Pour celles, au contraire, dont la demi-teinte est verte, préparer avec terre d’ombre naturelle, blanc on tout autre ton verdâtre.
La terre verte peut servir beaucoup. Sur un de ces enfants qui étaient préparés trop rouge, un simple glacis de terre verte a fort bien fait.
Autre ton vert plus vif, que j’ai employé dans la Nymphe, en contraste avec le ton bleu de Prusse : vermillon, blanc, vert émeraude, jaune de Naples.
— La Nymphe sur une ébauche frottée et presque au ton, frotté le tout avec laque jaune et laque rouge. Remarqué les principaux accents, au bord d’ombres, avec cobalt et vermillon, ou peut-être mieux terre de Cassel et blanc foncé et vermillon (ton excellent pour les bords d’ombres ou pour des enfoncements qu’on rend chauds ou froids à volonté) ; posé demi-teinte de bleu de Prusse, vermillon, blanc, également vers l’ombre et vers le clair, de manière qu’en reflétant l’ombre avec un ton chaud ou doré vers le clair, ce ton se mêle avec les tons de chair dans le clair posés avec la variété convenable…
Par places dans l’ombre, le ton vert fait avec vert émeraude, jaune de Naples, et par places aussi comme demi-teintes dans le clair. Dans les parties sanguines, cette demi-teinte est nécessaire pour reprendre, comme dans l’Enfant au trident, où elle est faite avec de la terre verte, frottée presque sur toute la préparation qui était d’un ton de chair clair et déjà brillant.
Les tons de chairs, en s’ajoutant et se mêlant à ces frottis de terre verte, donnaient la demi-teinte sanguine.
— Dans la Nymphe, employé très beau ton de chair brillant et vigoureux de vermillon, blanc, jaune de chrome foncé avec vert émeraude, jaune de Naples.
— Le Cheval rouge. Sur une préparation demi-teinte de cheval alezan foncé, clairs presque couleur de chair, mais un peu plus vifs et en rubans. Plaques d’une demi-teinte plus forte et assez chaude, tout contre les clairs touchés de terre d’Italie brûlée et brun rouge et même vermillon, les côtoyant presque nettement. Dans l’ombre, sur une demi-teinte d’ombre, parties brunes avec terre d’Italie brûlée et momie, modifiées à propos avec terre de Cassel et blanc très foncé faisant un gris violet. Reflets sous le ventre orangés verdâtres, violâtres. — Reflets du côté du ciel très franc avec bleu de Prusse, vermillon, blanc.
Nuages du deuxième plan sous le char.
Lundi 5 mai. — Sur le gris jaunâtre du fond clair des nuages jaune de Naples, blanc, enfin le ton de l’esquisse ; l’ombre avec un ton liquide jaunâtre ou le jaune de Naples, la momie, etc., qui laisse un filet de ton gris de dessous entre le clair et lui ; sur cette ombre jaune, revenir avec terre de Cassel et blanc ; achevé de donner la finesse et le nacré.
Excellent reflet pour mettre sur une préparation grise à plat dans l’ombre des natures tendres, comme dans le groupe des trois enfants près de la Minerve : antimoine, cendre d’outremer et un ton rose plus ou moins foncé.
Ajouter du cobalt et vermillon de laque, autre variété très belle et plus foncée, avec du blanc, très beau violet rompu pour demi-teinte de chair.
— Les hommes de Daniel[541] : ils étaient préparés très heurtés, l’un d’un ton très sanguin, l’autre plus jaune. Pour les achever, passé sur le premier un ton vert à demi-pâte, sur l’autre un ton gris violet. Le tout est devenu d’un ton louche voilant les clairs et les ombres ; touché par-dessus les chairs analogues et reflété les ombres ; le ton vert et violet donnant une espèce de demi-teinte intermédiaire.
Ombre pour l’or dans le char et en général : terre de Sienne naturelle, laque jaune, le jaune indien y fait également bien.
— Le cheval blanc : peint avec des tons carnés dans les ombres, mais formés plutôt de tons lilas et violâtres {terre de Cassel). Relevé ensuite par le ton de terre d’ombre et blanc, qui a donné le satiné.
Clairs définitifs des nuages portant la Junon, etc. : cadmium, blanc ou jaune de Naples, avec rose ; ils étaient modelés avec terre d’ombre naturelle et blanc et noir de pêche ; les premiers clairs avec momie et blanc.
— L’homme de devant : les clairs pour retouches, blanc, ocre jaune, teinte rose, terre de Cassel et blanc, jaune de zinc le plus citron. Demi-teinte : terre verte brûlée et blanc ; brun de Florence, terre verte ; à peu près de même pour les ombres, avec moins de blanc, c’est-à-dire la terre verte brûlée pure, etc.
— Renvoi pour la Nymphe : Sur la préparation des ombres faites avec un frottis de laque jaune et laque rouge, et surtout dans les parties obscures, revenir avec le ton de laque rouge et vermillon, et le vert qu’il faut mettre sur la palette à côté de ce dernier, terre verte, vert émeraude, blanc.
Sur le frottis pour revenir de laque rouge et laque jaune, rendre d’abord plus vigoureuses les ombres avec ce même frottis. Mettre ensuite à cheval sur le clair et l’ombre un ton gris violet ou gris bleu, soit bleu de Prusse, vermillon, blanc ou noir de pêche et blanc, ou un ton gris plus approprié encore à l’objet.
Dans les clairs, mettre franchement sur le frottis ci-dessus laque jaune et laque rouge, qui doit régner partout, les tons de vermillon et blanc (pour rose) ou cadmium et blanc (jaune orange), ou cobalt, vermillon, blanc (violet).
Dans les ombres, remarqué les bords avec cobalt, vermillon ou terre de Cassel foncée et vermillon, et dans le corps de l’ombre, projeter tons verts crus et violets ou bleus. Ensuite tons de cadmium et blanc et vermillon qui fait le ton orangé de l’ombre, et le vermillon, cobalt, laque rouge et blanc pour le violet rouge. Sur tout cela, dans l’ombre, revenir avec des tons de clair qui ôtent l’ardeur du ton.
Pour repeindre le bras de la Minerve : Sur l’ancien fond couleur de chair, marqué les ombres avec laque et laque jaune très solidement empâté ; peut-être un peu de terre verte dedans. — Teintes de vert et de violet mises crûment çà et là dans le clair sans le mêler, mais suivant la place ; ces teintes d’une valeur assez foncée, pour faire le bord de l’ombre.
Quelques-unes de ces teintes dans l’ombre sur le frottis.
Sur la partie dans le clair, ajouté ensuite tons de chairs clairs blanc et vermillon, ocre de ru et blanc, pour les plaques jaunes qui se trouvent dans la chair. Ton de laque et blanc (lequel suffit si c’est le vert de cobalt d’Édouard) ; si c’est celui qui est plus commun et qui ressemble à de la terre verte, y ajouter du cobalt. Ce ton de vert est très particulier à la chair fine des belles peaux, et prend beaucoup de valeur, mêlé au ton de laque et blanc.
Pour reprendre le ciel jaunâtre derrière le serpent, frottis de cobalt et vermillon. Clairs de laque jaune et le ton mauve de cobalt, vermillon, laque blanc.
Mardi 13 mai. — Très beau violet pour la chair : le ton de laque et vermillon mêlé sans trop le confondre avec celui de vert émeraude fin, terre verte et blanc (lesquels sont à côté l’un de l’autre sur la palette qui m’a servi en dernier lieu pour le Python).
— La Femme impertinente[542] était préparée très empâtée et d’un ton très chaud et surtout très rouge. Passé dessus un glacis de terre verte, peut-être un peu de blanc. Cela a fait la demi-teinte gris opale irisée ; là-dessus touché simplement des clairs avec l’excellent ton terre Cassel, blanc et un peu de vermillon ; puis quelques tons orangés francs par places. Tout ceci n’était encore qu’une préparation, mais de la plus grande finesse. La demi-teinte était complètement chair.
— Dans l’Andromède, probablement à cause du fond très chaud, mêler beaucoup de jaune de Naples avec le vermillon dans le clair.
— Pour le Lion dans les montagnes, effet de matin ; pour le ciel sur la toile, frottis noir et blanc. Un peu de cobalt par places. Lumière immanquable avec jaune de zinc le plus clair (celui qui semble avoir du blanc), avec laque brûlée et blanc.
Tons alpestres dans les montagnes : sur frottis de noir, blanc et bleu de Prusse, quelques tons de vert émeraude fin et blanc, ou le ton de vert émeraude, bleu de Prusse et blanc. Mettre du rose dans les tons très lointains.
Belle demi-teinte d’or verdâtre : ocre jaune, vert émeraude. Plus chaude : les mêmes, avec une pointe de chrome foncé.
Approchant de ceux-ci et fort bon pour les chairs, surtout à côté des violets : ocre jaune, vert de Scheele ou ocre jaune, vert de Scheele et chrome no 2, tous deux charmants.
Beau ton de chair : terre d’Italie brûlée, blanc, vert émeraude, terre Sienne naturelle et terre Sienne brûlée remplacent le jaune mars. Beau avec blanc, jaune indien ; bitume remplace le jaune de Rome, laque jaune, équivaut au stil de grain.
Demi-teinte rosée chairs fraîches : vert de zinc, le plus clair à côté de vermillon blanc, une pointe de laque ; mêler ces deux tons tout faits suivant le degré convenable.
Chrome foncé avec vert de zinc foncé ou clair, admirable ton pour paysage. Fait clairs chauds dans les feuilles, soit reflets dans l’ombre. Fait bien surtout sur feuilles préparées d’un vert trop cru — éloigne.
Vendredi 6 juin. — Hier, inauguration des salles du Musée[543]. L’impression profonde que m’ont faite les Lesueur ne m’empêche pas de me rendre compte du degré de force que la couleur peut ajouter à l’expression. Contre l’opinion vulgaire, je dirais que la couleur a une force beaucoup plus mystérieuse et peut-être plus puissante ; elle agit pour ainsi dire à notre insu. Je suis convaincu même qu’une grande partie du charme de Lesueur est due à sa couleur. Il a l’art, qui manque tout à fait au Poussin, de donner l’unité à tout ce qu’il représente. La figure en elle-même est un ensemble parfait de lignes et d’effets, et le tableau, réunion de toutes les figures, est accordé partout. Cependant il est permis de croire que s’il avait eu à peindre la Reine à cheval dont Rubens a fait un si magnifique tableau, il n’eût pas été aussi avant à l’imagination dans un sujet dépourvu d’expression comme l’est celui-là. Un coloriste seul pouvait imaginer ce panache, ce cheval, cette ombre transparente de la jambe de derrière, qui se lie au manteau.
Poussin[544] perd beaucoup au voisinage de Lesueur… La grâce est une muse qu’il n’a jamais entrevue. L’harmonie des lignes, de l’effet de la couleur est également une qualité ou une réunion des qualités les plus précieuses qui lui a été complètement refusée. La force de la conception, la correction poussée au dernier terme, jamais de ces oublis ou de ces sacrifices faits au liant, à la douceur de l’effet ou à l’entraînement de la composition ! Il est tendu dans ses sujets romains, dans ses sujets religieux ; il l’est dans ses bacchanales ; ses faunes et ses satyres sont un peu trop retenus et sérieux ; ses nymphes sont bien chastes pour des êtres mythologiques ; ce sont de très belles personnes qui n’ont rien de mythologique ou de surnaturel. Il n’a jamais pu peindre la tête du Christ ; le corps pas davantage, ce corps d’une complexion si tendre ; cette tête où se lisent l’onction et la sympathie pour les misères humaines. En faisant ses Christs, il a plus pensé à Jupiter, même à Apollon. La Vierge lui a manqué également ; il n’a rien entrevu de ce personnage plein de divinité et de mystère. Il n’intéresse à son enfant Jésus ni les hommes épris de sa grâce, ni les animaux que l’Évangile intéresse à la venue de l’enfant divin. Le bœuf et l’âne manquent autour de la crèche du Dieu qui vient de naître sur la même paille où ils reposent… ; la rusticité des bergers qui viennent l’adorer est un peu relevée par un souvenir des figures antiques… ; les rois mages ont un peu de la raideur et de l’économie de draperies et d’accoutrements qu’on remarque dans les statues ; je ne trouve pas ces manteaux de soie ou de velours couverts de pierreries portés par des esclaves, et qu’ils traînent dans cette étable aux pieds du Maître de la nature qu’un pouvoir surnaturel leur vient révéler. Où sont ces dromadaires, ces encensoirs, toute cette pompe ? Admirable contraste dans un humble réduit !
Je suis convaincu que Lesueur n’avait pas cette méthode du Poussin de disposer l’effet de ses tableaux au moyen de petites maquettes éclairées par le jour de l’atelier. Cette prétendue conscience donne aux tableaux du Poussin une sécheresse extrême… Il semble que toutes ses figures sont sans lien les unes avec les autres et semblent découpées ; de là ces lacunes et cette absence d’unité, de fondu, d’effet, qui se trouve dans Lesueur et dans tous les coloristes. Raphaël tombe dans ce décousu, par suite d’une autre pratique, celle de dessiner consciencieusement chaque figure nue, avant de la draper.
Bien qu’il soit nécessaire de se rendre compte de toutes les parties de la figure, pour ne pas s’écarter des proportions que les vêtements peuvent dissimuler, je ne saurais être partisan de cette méthode exclusive, et à laquelle il semble, si on s’en rapporte à toutes les études qui nous sont restées de lui, qu’il se soit toujours conformé scrupuleusement. Je suis bien sûr que si Rembrandt se fût astreint à cet usage d’atelier, il n’aurait ni cette force de pantomime, ni cette force dans l’effet qui rend ses scènes la véritable expression de la nature. Peut-être découvrira-t-on que Rembrandt est un beaucoup plus grand peintre que Raphaël[545].
J’écris ce blasphème propre à faire dresser les cheveux de tous les hommes d’école, sans prendre décidément parti ; seulement je trouve en moi, à mesure que j’avance dans la vie, que la vérité est ce qu’il y a de plus beau et de plus rare… Rembrandt n’a pas, si vous voulez, absolument l’élévation de Raphaël…
Peut-être cette élévation que Raphaël a dans les lignes, dans la majesté de chacune de ses figures, Rembrandt l’a-t-il dans la mystérieuse conception du sujet, dans la profonde naïveté des expressions et des gestes. Bien qu’on puisse préférer cette emphase majestueuse de Raphaël, qui répond peut-être à la grandeur de certains sujets, on pourrait affirmer, sans se faire lapider par les hommes de goût, mais j’entends d’un goût véritable et sincère, que le grand Hollandais était plus nativement peintre que le studieux élève du Pérugin.
Samedi 14 juin. — L’exécution des corps morts dans le tableau de Python, voilà ma vraie exécution, celle qui est le plus selon ma pente. Je n’aurais pas celle-là d’après nature, et la liberté que je déploie alors fait passer sur l’absence du modèle. — Se rappeler cette différence caractéristique entre cette partie de mon tableau et les autres.
— Allégorie sur la Gloire[546]. — Dégagé des liens terrestres et soutenu par la Vertu, le Génie parvient au séjour de la Gloire, son but suprême : il abandonne sa dépouille à des monstres livides, qui personnifient l’envie, les injustes persécutions, etc.
11 août. —« Je suis triste de votre ennui. Avec tant de moyens pour passer votre temps agréablement dans ce monde, vous ne jouissez pas des avantages que vous avez sous la main, et que le ciel accorde relativement à bien peu de créatures, dans notre état de civilisation. Vous avez raison, quand vous me trouvez heureux de l’exercice d’un art qui m’amuse et m’intéresse réellement ; mais à quel prix acquiert-on ce talent souvent médiocre et contestable, qui nous console, si vous voulez, dans certains moments !… Et que de chagrins l’accompagnent, dont on ne raconte jamais la centième partie ! Notez que vous faites partie de ce petit nombre pour lequel, nous autres mouches à miel, nous nous exterminons ; c’est pour vous plaire que nous jaunissons et que nous avons des gastrites… Vous n’avez autre chose à faire que de nous admirer, et, ce qui est infiniment plus agréable, de nous critiquer ; et cela, avec des conditions de digérer infiniment supérieures, car vous prenez le repos et l’exercice quand il vous plaît… Vous allez, vous venez, vous vous reposez. Mais les bonnetiers eux-mêmes ne travaillent, comme des nègres, trente ans de leur vie que pour se reposer un jour. Vous êtes donc arrivé tout porté là où nous tendons, nous autres nègres, de toute la force de nos muscles ou de notre intelligence ; vous êtes à l’abri des journalistes, des envieux. Avez-vous un ennemi ?… vous lui donnez à dîner, vous l’enchaînez même à vous amuser dans l’occasion.
Allons donc, mon ami, égayez-vous un peu, pour ce qui vous concerne, au spectacle de ce que souffrent tant de malheureux qui, loin de donner à dîner et d’avoir du superflu et des jouissances, n’ont pas même le nécessaire ; et surtout allez voir la mer. Là, pour le coup, on ne peut jamais s’ennuyer. C’est un spectacle dont on ne peut se lasser… »
Jeudi 14 août. — Pour les pendentifs[547] : Anges, l’un sonnant de la trompette, l’autre montrant le livre redoutable. — Anges présentant de l’encens ou la flamme des vœux. — Le Chandelier. — Des Palmes. — Ange gardien. — Ange conduisant les âmes à la sortie du corps. — Ange réveillant les morts.
1852
Mercredi 21 janvier. — Avez-vous vu par hasard le pont Neuf, comme on nous le fait ? Il sera véritablement digne de son nom, n’ayant plus aucun rapport avec l’ancien, qui était celui que nous avons vu toujours et si connu qu’on disait : Connu comme le pont Neuf. Il faudra rayer le proverbe, avec beaucoup d’autres illusions.
26 janvier. — Vu les tapisseries sublimes de la Vie d’Achille, de Rubens, à la vente faite à Mousseaux. Ses grands tableaux ou ses tableaux en général n’ont pas cette incorrection ; mais ils n’ont pas cette verve incomparable. Ici il ne cherche pas et surtout il n’améliore pas. En voulant châtier la forme, il perd cet élan et cette liberté qui donnent l’unité et l’action ; la tête d’Hector renversée, d’une expression et même d’une couleur incomparables ; car il est à remarquer que, toutes passées qu’elles sont, ces tapisseries conservent étonnamment le sentiment de la couleur, d’autant plus qu’elles n’ont dû être faites que d’après des cartons légèrement colorés.
Les trépieds apportés devant Achille avec Briséis que les vieillards lui ramènent. Que d’alambiquages, que de petites intentions les modernes auraient prodigués sur ce sujet ! Lui va au fait comme Homère… C’est le caractère le plus frappant de ces cartons.
Achille plongé dans le Styx : les petites jambes qui s’agitent, pendant que le haut du corps est caché par l’eau… La vieille qui tient un flambeau, et le fond qui est magnifique. Caron, les suppliciés, etc.
Achille découvert par Ulysse. Le geste d’Ulysse qui s’applaudit de sa ruse et montre Achille à un compère qui est avec lui.
Ne pas oublier les décorations de ces tapisseries : les enfants qui portent des guirlandes ; les figures de termes, de chaque côté de la composition, et surtout l’emblème qui caractérise chaque sujet au bas et au milieu. Ainsi dans la Mort d’Hector, la bataille de coqs, dont l’énergie est inexprimable ; dans celui du Styx, Cerbère couché et endormi sous la colère d’Achille ; un lion rugissant, dans le dernier.
L’Agamemnon, superbe dans son indignation mêlée de crainte. Il est sur son trône. D’un côté, les vieillards s’avancent pour arrêter Achille ; de l’autre, Achille tirant son épée, mais retenu par Minerve, qui le prend par les cheveux, brusquement comme dans Homère.
Achille à cheval sur Chiron m’a paru ridicule : il est comme au manège et a l’air d’un cavalier du temps de Rubens.
La mort d’Achille : celui-ci s’affaisse au pied de l’autel où il sacrifie ; un vieillard le soutient ; la flèche a traversé le talon. A la porte même du temple, Pâris, avec un petit arc ridicule à la main, et au-dessus de lui, Apollon qui le lui montre avec un geste qui venge toute la guerre de Troie. Rien n’est plus antifrançais que tout cela. Tout ce qu’il y avait, même d’italien, auprès paraissait bien froid.
J’espère y retourner…
Mardi 27 janvier. — Retourné ce jour voir les tapisseries. J’étais dans un état de malaise qui m’a empêché d’en tirer le parti que j’aurais voulu ; j’ai fait quelques croquis et éprouvé la même impression et la même impossibilité de m’en aller. En sortant, chez Penguilly[548], où j’ai vu M. Fremiet[549], sculpteur ; puis chez Cavé, que j’ai trouvé malade, je crois, gravement.
Il est impossible d’imaginer quelque chose qui soit au-dessus de cet Agamemnon. Quelle simplicité ! La belle tête… avec un mélange d’appréhension, que domine l’indignation ! Le vieillard lui prend la main, comme pour le calmer, et en même temps regarde Achille. La tête d’Hector mourant est une de ces choses qu’on n’oublie jamais ; elle est la plus juste de tous points et la plus expressive que je connaisse dans la peinture. La barbe simple et d’un modelé admirable. La manière dont la lance le frappe, ce fer déjà caché dans sa gorge, et qui y porte la mort, font frémir. Voilà Homère et plus qu’Homère, car le poète ne me fait voir son Hector qu’avec les yeux de l’esprit, et ici je le vois avec ceux du corps. Ici est la grande supériorité de la peinture : à savoir, quand l’image offerte aux yeux non seulement satisfait l’imagination, mais encore fixe pour toujours l’objet et va au delà de la conception.
La Briséis est charmante : elle montre un mélange de pudeur et de joie ; il semble qu’Achille, séparé d’elle par les figures d’hommes qui déposent à terre des trépieds, sente augmenter son désir de satisfaire sa tendresse en l’embrassant ;… le vieillard, qui la lui présente, s’avance en s’inclinant avec un sentiment de honte, mêlé du désir de plaire à Achille. Dans l’Achille découvert, le groupe des filles est admirable : elles sont partagées entre le désir de s’occuper des chiffons et des bijoux, et la surprise de voir Achille, le casque en tête et déjà émancipé… Jambes charmantes.
J’ai déjà parlé du geste d’Achille, qui est incomparable : la vie et l’esprit éclatent dans ses yeux. La Mort d’Achille pleine des mêmes beautés. En étudiant davantage pour dessiner, on est confondu de cette science. Celle des plans est ce qui élève Rubens au-dessus de tous les prétendus dessinateurs ; quand ils les rencontrent, il semble que ce soit une bonne fortune : lui, au contraire, dans ses plus grands écarts, ne les manque jamais. Figure superbe ; force et vérité ; l’acolyte couronné de feuillage, qui soutient Achille au moment où il succombe et s’affaisse en se tournant vers son meurtrier avec des regrets qui semblent dire : « Comment as-tu osé détruire Achille ? » Il y a même quelque chose de tendre dans ce regard, dont l’intention peut aller jusqu’à Apollon, qui se tient implacable au-dessus de Pâris et, presque collé à lui, lui indique avec fureur où il faut frapper. Le Vulcain est une des figures les plus complètes et les plus achevées : la tête est bien celle du dieu ; l’épaisseur de ce corps est prodigieuse.
Le Cyclope qui apporte l’enclume et ses deux compagnons qui battent sur l’enclume, le Triton qui reçoit d’un enfant ailé le casque redoutable chefs-d’œuvre d’imagination et de composition !
Le parti pris et certaines formes outrées montrent que Rubens[550] était dans la situation d’un artisan qui exécute le métier qu’il sait, sans chercher à l’infini des perfectionnements.
Il faisait avec ce qu’il savait, et par conséquent sans gêne pour sa pensée. L’habit qu’il donne à ses pensées est toujours sous la main ; ses sublimes idées, si variées, sont traduites par des formes que les gens superficiels accusent de monotonie, sans parler de leurs autres griefs. Cette monotonie ne déplaît pas à l’homme profond qui a sondé les secrets de l’art. Ce retour aux mêmes formes est à la fois le cachet du grand maître et en même temps la suite de l’entraînement irrésistible d’une main savante et exercée. Il en résulte l’impression de la facilité avec laquelle ces ouvrages ont été produits, sentiment qui ajoute à la force de l’ouvrage.
Dimanche 1er février. — Pierret m’apprend que les belles tapisseries se sont vendues à deux cents francs pièce : il y en avait là de très belles et des Gobelins, avec des fonds d’or. Un chaudronnier les a achetées pour les brûler et en retirer le métal.
Lundi 2 février. — Mme Sand[551] arrivée vers quatre heures… Je me reprochais, depuis qu’elle est ici, de n’avoir pas été la voir. Elle est fort souffrante, outre sa maladie de foie, d’une espèce d’asthme analogue à celui du pauvre Chopin.
— Le soir chez Mme de Forget.
— J’ai à peu près terminé, dans la journée, le petit Samaritain pour Beugniet[552]. Le matin, trouvé à peu près sur la toile la composition du plafond de l’Hôtel de ville.
Je parlais à Mme Sand de l’accord tacite d’aplatissement et de bassesse de tout ce monde qui était si fier il y a peu de temps : l’étourderie, la forfanterie générale, suivie en un clin d’œil de la lâcheté la plus grande et la plus consentie. Nous n’en sommes pas encore cependant au trait des maréchaux, en 1814, avec Napoléon ; mais c’est uniquement parce que l’occasion ne s’en présente pas. C’est la plus grande bassesse de l’histoire.
Mardi 3 février. — Dîné chez Perrin avec Morny, Delangle, Romieu, Saint-Georges, Alard, Auber, Halévy, Boilay[553], aimables gens : sa femme et sa belle-sœur. Cette dernière que j’ai vue pour la première fois est une femme fort aimable et dont les yeux sont charmants ; elle peint et m’a beaucoup parlé de peinture.
Je suis parti très tard avec Auber et Alard. Reconduit ce dernier jusqu’au Palais-Bourbon par le plus beau clair de lune : il m’a raconté des proverbes de sa façon : L’homme qui raconte la prise de la Bastille, etc.
Mercredi 4 février. — Chez Boilay, en sortant de chez le ministre. Revu là avec plaisir la fille d’Hippolyte Lecomte[554]. Mocquart[555] y est venu ; il a raconté avec emphase des particularités sur Géricault. Parlant de la présence de Mustapha[556] à l’enterrement, il a fait une description pittoresque de la douleur de ce pauvre Arabe, qui s’était, disait-il, prosterné la face contre terre sur la tombe. Le fait est qu’il n’en fut rien et qu’il resta à distance, non sans produire un effet touchant sur l’assistance. Mocquart prétend qu’A… n’y vint pas, et lui en fait un sujet grave de blâme. Il me semble que mes souvenirs le justifient, et je crois le voir encore avec un surtout blanchâtre. J’aime mieux, pour lui, croire à ma mémoire qu’à celle de Mocquart.
Samedi 7 février. — En sortant de Saint-Germain l’Auxerrois — enterrement Lahure — j’ai rencontré, sur le quai, Cousin qui allait à Passy. J’avais rendez-vous au ministère, et j’allais, à pied, causer avec Romieu. J’ai accompagné Cousin jusqu’à la barrière des Bonshommes, à travers les Tuileries et le long de l’eau. Ensuite longue conversation : il m’a amusé en me parlant des relations intimes de personnes de notre connaissance à tous deux. « Thiers[557], m’a-t-il dit, a le talent et l’esprit que tout le monde sait ; mais autour d’un tapis vert, et la main au timon de l’État, il est au-dessous de tout. Guizot de même, et ne le vaut pas pour le cœur. » Il m’en a donné la plus mauvaise idée. J’irai peut-être le voir à la Sorbonne.
Dimanche 8 février. — Chez Halévy le soir. Peu de monde. — J’avais travaillé toute la journée à finir mes petits tableaux : le Tigre et le Serpent[558], le Samaritain[559], et travaillé à mon esquisse de mon plafond de l’Hôtel de ville[560].
— Halévy disait qu’on devrait écrire, jour par jour, ce qu’on voit et ce qu’on entend, Il l’a essayé plusieurs fois comme moi, et il en a été dégoûté par les lacunes que l’oubli ou les affaires vous forcent à laisser dans votre journal…
Se rappeler l’histoire de l’homme qui mettait son doigt dans tous les trous, et que cette singularité avait fait remarquer. Il se trouva, sans beaucoup de titres, porté sur une liste de gens de la Cour qui sollicitaient un régiment. Louis XV, en voyant son nom, demande : « Est-ce ce gentilhomme qui met son doigt dans les trous ? — Oui, Sire ! — Eh bien, je lui donne le régiment. »
Lundi 9 février. — Soirée chez M. Devinck[561]. J’ai trouvé là M. Manceau, qui m’a entretenu longuement du conseil municipal[562]. Ces gens-là ont l’air de croire qu’on peut faire le bien entre gens réunis pour discuter.
L’allégorie des hommes qui forgent le même fer représente assez bien l’idéal d’un gouvernement auquel concourent plusieurs personnes. Malheureusement, ce n’est qu’une image propre pour un tableau. Depuis le peu de temps que je suis là, je me suis convaincu que la raison avait peu d’ascendant, qu’un rien la rendait maussade, malgré tous les soins de la présenter du côté séduisant. L’entraînement, la vanité conduisent les meilleures têtes. Dans la question du chauffage de l’hôpital du Nord, deux systèmes étaient en présence : le plus spécieux était celui d’une imposante commission de savants et défendu avec beaucoup d’éloquence par notre confrère Pelouze[563], savant lui-même et partisan de la théorie en général. Les bonnes têtes se rangeaient évidemment pour ce système si bien défendu. L’autre avait l’air de l’être par des gens intéressés. Sur cela, Thierry[564] veut en introduire un troisième qui est repoussé avant d’avoir été entendu. Que croyez-vous que fût au fond l’opinion de la plupart des membres et de Thierry lui-même, comme je l’ai su, en le leur demandant ? Exactement la même que je croyais mètre propre à moi seul, à savoir que les appareils de chauffage, comme on les fait, sont bons pour des corridors, pour des lieux de passage et de circulation, mais que la difficulté de modérer et de conduire cette chaleur la rend nuisible ou insuffisante dans les chambres des malades, dortoirs, et que le feu, en définitive, dans les bons poêles, de bon bois dans de bonnes cheminées est le meilleur de tous les chauffages. C’est ce que nous nous disions tous à l’oreille. La somme nécessaire cependant pour un gigantesque établissement d’appareils était votée, et avec ce prix on aurait eu du bois ou du charbon pour chauffer vingt ans l’hôpital.
Mardi 10 février. — Soirée chez M. Chevalier, rue de Rivoli, dans des appartements très splendides au premier. Détestables tableaux sur les murs, livres magnifiques dans des armoires qu’on n’ouvre pas plus que les livres. Point de goût. J’y ai vu Mme Ségalas[565], qui m’a rappelé que nous ne nous étions pas rencontrés depuis 1832 ou 1833, chez Mme O’Reilly. C est là aussi et chez Nodier[566] d’abord, que j’ai vu pour la première fois Balzac[567], qui était alors un jeune homme svelte, en habit bleu, avec, je crois, gilet de soie noire, enfin quelque chose de discordant dans la toilette et déjà brèche-dent. Il préludait à son succès.
Vendredi 13 février. — Occupé tous ces jours-ci de mes compositions pour l’Hôtel de ville.
Aujourd’hui à l’Hôtel de ville, où je me suis senti singulièrement troublé, quand j’ai fait un mince rapport sur les peintures à restaurer à Saint-Severin et à Saint-Eustache ; j’étais sous l’impression d’un malaise et d’une lourdeur de tête qui m’en ont fait omettre les trois quarts.
Convoqué pour voir les projets de Lehmann[568].
Samedi 14 février. — Dîné chez le préfet. Je devais le soir mener Varcollier chez Chabrier ; il n’a pu venir.
Dimanche 15 février. — Symphonie en sol mineur de Mozart, au concert Sainte-Cécile. J’avoue que je m’y suis ennuyé un peu.
Le commencement (et je crois un peu que c’était parce que c’était le commencement), indépendamment du vrai mérite, m’a fait beaucoup de plaisir. L’ouverture et un finale d’Obéron[569]. Ce fantastique de l’un des plus dignes successeurs de Mozart a le mérite de venir après celui du maître divin, et les formes en sont plus récentes. Ça n’a pas encore été aussi pillé et rebattu par tous les musiciens, depuis soixante ans. — Chœur de Gaulois par Gounod, qui a tout l’air d’une belle chose ; mais la musique a besoin d’être appréciée à plusieurs reprises.
Il faut aussi que le musicien ait établi l’autorité ou seulement la compréhension de son style par des ouvrages assez nombreux. Une instrumentation pédantesque, un goût d’archaïsme donnent quelquefois dans l’ouvrage d’un homme inconnu l’idée de l’austérité et de la simplicité. Une verve quelquefois déréglée, soutenue de réminiscences habilement plaquées et d’un certain brio dans les instruments, peut faire l’illusion d’un génie fougueux emporté par ses idées et capable de plus encore. C’est l’histoire de Berlioz ; l’exemple précédent s’appliquerait à Mendelssohn. L’un et l’autre manquent d’idées, et ils cachent de leur mieux cette absence capitale par tous les moyens que leur suggèrent leur habileté et leur mémoire.
Il y a peu de musiciens qui n’aient trouvé quelques motifs frappants. L’apparition de ces motifs dans les premiers ouvrages du compositeur donne une idée avantageuse de son imagination ; mais ces velléités sont trop tôt suivies d’une langueur mortelle. Ce n’est point cette heureuse facilité des grands maîtres qui prodiguent les motifs les puis heureux souvent dans de simpies accompagnements ; ce n’est plus cette richesse d’un fonds toujours inépuisable et toujours prêt à se répandre, qui fait que l’artiste trouve toujours sous la main ce qu’il lui faut, et ne passe pas son temps à chercher sans cesse le mieux et à hésiter ensuite entre plusieurs formes de la même idée. Cette franchise, cette abondance, est le plus sûr cachet de la supériorité dans tous les arts. Raphaël, Rubens ne cherchaient pas les idées ; elles venaient à eux d’elles-mêmes, et même en trop grand nombre. Le travail ne s’applique guère à les faire naître, mais à les rendre le mieux possible par l’exécution.
Jeudi 19 février. — Dîné chez Desgranges. Le hasard me place encore auprès de Rayer : j’ai été étonné de sa sobriété. Je voudrais me rappeler plus souvent quelle est l’importance de cette vertu, surtout pour un homme qui se trouve dans le triste cas où je suis ; ne mangeant qu’une seule fois par jour, il m’est bien difficile de ne pas être entraîné au delà des justes bornes par un appétit de vingt-quatre heures.
Réunion ennuyeuse au premier chef : la sottise du maître de la maison, l’inertie glaciale de sa femme auraient tenu en échec la plus communicative gaieté. J’ai vu chez lui le portrait du sultan Mahmoud en hussard, qui est la chose la plus grotesque du monde.
Je me suis échappé aussi vite que j’ai pu pour aller chez Bertin. Delsarte a chanté[570] et a ravi tout le monde. J’étais à côté d’un monsieur qui m’a appris qu’il avait assisté à la maladie et aux derniers moments de mon pauvre Charles[571]… Cruels détails ! cruelle nature !
Vendredi 20 février. — Dîné chez Villot. Ces dîners continuels me troublent beaucoup. Dîner servi plus que jamais à la russe. Tout le temps du service, la table est couverte de gimblettes, de sucreries ; au milieu, un étalage de fleurs, mais nulle part la plus petite parcelle de ce qu’attend un estomac affamé quand il approche la table. Les domestiques servant pitoyablement et à leur fantaisie des morceaux de hasard, en un mot ce qu’ils dédaignent de se conserver pour eux-mêmes. Tout cela est trouvé charmant ; adieu la cordialité, adieu l’aimable occupation de faire un bon dîner ! Vous vous levez repu tant bien que mal, et vous regrettez votre dîner de garçon du coin de feu. Cette pauvre femme s’est jetée dans une habitude mondaine qui lui donne exclusivement comme société les gens les plus futiles et les plus ennuyeux.
Je me suis sauvé en évitant la musique pour aller chez mon confrère en municipalité Didot[572]. La promenade pour aller chez lui par un froid sec m’a réussi un peu. En arrivant, cohue, musique encore plus détestable, mauvais tableaux accrochés aux murs, excepté un, cet homme nu d’Albert Dürer, qui m’a attiré toute la soirée.
Cette trouvaille inespérée, le chant de Delsarte, la veille chez Bertin, m’ont fait faire cette réflexion qu’il y a beaucoup de fruit à retirer du monde, tout fatigant qu’il est et tout futile qu’il paraît. Je n’aurais eu aucune fatigue, si j’étais resté au coin de mon feu ; mais je n’aurais eu aucune de ces souffrances mi doublent peut-être, par le rapprochement de la trivialité et de la banalité, des plaisirs que le vulgaire va chercher dans les salons.
V… était là. Il ne m’a pas paru atteint comme moi par ce terrible tableau, il est borné dans ses admirations ; c’est que son sentiment ne le sert plus au delà d’une certaine mesure de talent, qu’il n’apprécie encore que dans un certain nombre d’artistes d’une certaine école : il est excellent et cause sérieusement ; mais il ne vous échauffe jamais. C’est un homme de mérite auquel il manque toutes les grâces. Nous avons vu ensemble le tableau de la vieillesse de David[573], qui représente la Colère d’Achille ; c’est la faiblesse même ; l’idée et la peinture sont également absentes. J’ai pensé aussitôt à l’Agamemnon et l’Achille de Rubens, que j’ai vus il y a à peine un mois.
Samedi 21 février. — Le soir au Jardin d’hiver, où j’ai mené Mme de Forget, au bal du IXe arrondissement, pour lequel j’avais souscrit. Il m’est arrivé comme les deux jours précédents : je me suis préparé avec répugnance, et j’ai été dédommagé de mes appréhensions.
L’aspect de ces arbres exotiques dont quelques-uns sont gigantesques, éclairés par des feux électriques, m’a charmé. L’eau, et le bruit qu’elle fait au milieu de tout cela, faisait à merveille. Il y avait deux cygnes qui se faisaient mouiller à plaisir, dans un bassin rempli de plantes, par la pluie continue d’un jet d’eau qui a quarante à cinquante pieds de haut. La danse même m’a amusé, ainsi que le vulgaire orchestre ; mais cet aplomb, cet archet, ce coup de tambour, ces cornets à piston, cet entrain de ces courtauds de boutique se trémoussant dans leurs beaux habits excitaient en moi un sentiment qu’on ne peut, j’en suis certain, éprouver qu’à Paris. Mme de Forget ne partageait pas ma satisfaction. Elle avait compromis étourdiment, sur le pavé de bitume et au milieu des trépignements de cette foule mélangée, une robe neuve de damas rose turc, qui aura perdu un peu de sa fraîcheur. Mme Sand, Maurice[574], Lambert et Manceau avaient dîné avec moi. Impression bizarre de la situation de ces jeunes gens près de cette pauvre femme.
— J’ai commencé dans la seule matinée d’hier tous mes sujets de la Vie d’Hercule[575] pour le salon de la Paix.
Lundi 23 février. — Les peintres qui ne sont pas coloristes font de l’enluminure et non de la peinture. La peinture proprement dite, à moins qu’on ne veuille faire un camaïeu, comporte l’idée de la couleur comme une des bases nécessaires, aussi bien que le clair-obscur, et la proportion et la perspective. La proportion s’applique à la sculpture comme à la peinture. La perspective détermine le contour ; le clair-obscur donne la saillie par la disposition des ombres et des clairs mis en relation avec le fond ; la couleur donne l’apparence de la vie, etc.
Le sculpteur ne commence pas son ouvrage par un contour ; il bâtit avec sa matière une apparence de l’objet qui, grossier d’abord, présente dès le principe la condition principale qui est la saillie réelle et la solidité. Les coloristes, qui sont ceux qui réunissent toutes les parties de la peinture, doivent établir en même temps et dès le principe tout ce qui est propre et essentiel à leur art. Ils doivent masser avec la couleur comme le sculpteur avec la terre, le marbre ou la pierre ; leur ébauche, comme celle du sculpteur, doit présenter également la proportion, la perspective, l’effet et la couleur.
Le contour est aussi idéal et conventionnel dans la peinture que dans la sculpture ; il doit résulter naturellement de la bonne disposition des parties essentielles. La préparation combinée de l’effet qui comporte la perspective et de la couleur approchera plus ou moins de l’apparence définitive suivant le degré d’habileté de l’artiste ; mais dans ce point de départ, il y aura le principe net de tout ce qui doit être plus tard.
Mardi 24 février. — Soirée d’enfants chez Mme Herbelin[576] ; je remarque combien nos costumes sont affreux par le contraste des costumes de ces petits êtres qui étaient fort bariolés et qui, à raison de leur petite taille, ne se confondaient pas avec les hommes et les femmes. C’était comme une corbeille de fleurs.
Pérignon[577] m’a parlé de la manière de vernir provisoirement un tableau : c’est avec de la gélatine, comme celle que vendent les charcutiers, qu’on fait dissoudre dans un peu d’eau chaude et qu’on passe avec une éponge sur le tableau. Pour l’enlever, on prend de même de l’eau tiède.
Villot nous disait qu’on détruit l’ombre avec un mélange, parties égales d’essence, d’eau et d’huile. Bon pour repeindre.
Mercredi 25 février. — Dîné chez Lehmann. — Revenu à l’Opéra-Comique et fini chez Boilay.
Je n’ai rien retiré de tout cela qu’une immense promenade à pied, pour venir de la rue Neuve de Berry jusqu’au théâtre.
— Les gens médiocres ont réponse à tout et ne sont étonnés de rien. Ils veulent toujours avoir l’air de savoir mieux que vous ce que vous allez leur dire ; quand ils prennent la parole à leur tour, ils vous répètent avec beaucoup de confiance, comme si c’était de leur cru, ce qu’ils ont, ailleurs, entendu dire à vous-même.
Il est bien entendu que l’homme médiocre dont je parle est en même temps pourvu de connaissances auxquelles tout le monde peut parvenir. Le plus ou moins de bon sens ou d’esprit naturel qu’ils peuvent avoir, peut seul les empêcher d’être des sots parfaits. Les exemples qui se présentent en foule à ma mémoire sont tous à l’appui de ce ridicule si commun. Ils ne diffèrent, comme je l’ai dit, que par le degré de sottise. L’air capable et supérieur va de soi-même avec ce caractère.
Jeudi 26 février. — Soirée chez Mlle Rachel[578]. Elle a été fort aimable. J’ai revu Musset[579] et je lui disais qu’une nation n’a de goût que dans les choses où elle réussit. Les Français ne sont bons que pour ce qui se parle ou ce qui se lit. Ils n’ont jamais eu de goût en musique ni en peinture. La peinture mignarde et coquette… Les grands maîtres comme Lesueur et Lebrun ne font pas école. La manière les séduit avant tout ; en musique presque de même.
— Bleu de ciel de l’esquisse de la Paix :
Sur bleu de Prusse et blanc, introduction de bleu de Prusse, blanc et vert de Scheele. Le ton verdâtre, produit en deux opérations, double l’effet et donne une franchise incomparable.
Lundi 1er mars. — L’homme qui apporte ordinairement le charbon de terre et le bois est un drôle plein d’esprit… Il cause beaucoup. Il demande l’autre jour la gratification et dit qu’il a beaucoup d’enfants. Jenny lui dit : « Et pourquoi avez-vous tant d’enfants ? » Il lui répond : « C’est ma femme qui les fait. » C’est un mot du plus pur gaulois… Il nous en a dit un de la même force, l’année dernière, que j’ai oublié…
Lundi 8 mars. — Pour la première fois, au dîner de tous les mois, des seconds lundis.
— En sortant, promenade sur le boulevard avec Varcollier, et fini la soirée chez Perrin. Revu là la lithographie de Géricault[580] des chevaux qui se battent. Grand rapport avec Michel-Ange. Même force, même précision, et, malgré l’impression de force et d’action, un peu d’immobilité, par suite de l’étude extrême des détails, probablement.
— Le jury, depuis jeudi dernier, m’assassine tous les jours, et le soir, je suis comme un homme qui aurait fait dix lieues à pied.
Vendredi 12 mars. — Prêté à M. Hédouin six esquisses de la Chambre des députés : le Lycurgue, le Chiron, l’Hésiode, l’Ovide, l’Aristote, le Démosthène.
— A lui prêté, le 2 mai, le dessin sous verre du Chiron et de l’Achille[581].
Samedi 13 mars. — Fini au Jury.
Lundi 15 mars. — Andrieu revenu aujourd’hui ou hier. Il avait fait deux jours au commencement du mois, interrompus par le Jury.
Jeudi 1er avril. — Enterrement du pauvre Cavé. Sa mort me fait beaucoup de peine.
Vendredi 2 avril. — A l’issue du conseil municipal, vu chez Varcollier les esquisses pour Sainte-Clotilde : la folie ne peut aller plus loin. Le pauvre Préault forcé de faire une statue gothique ! Que peut-on critiquer dans des ouvrages contemporains, après ces cochonneries ?
Lundi 5 avril. — J’ai été à Saint-Sulpice ébaucher un des quatre pendentifs.
Le soir, en me promenant et un moment avant d’être noyé par la pluie d’orage qui est survenue, rencontré, rue du Mont-Thabor, Varcollier, qui m’a parlé avec horreur des petits échantillons de couleurs de L… à l’Hôtel de ville. Il voudrait que je me constitue le vengeur et le dénonciateur de ses crimes. Je lui ai objecté qu’il faudrait se mettre trop en colère, et que les méfaits nombreux de ce genre auraient dû être réprimés il y a longtemps. Je lui ai cité des ouvrages de ses amis.
Le lendemain de ce jour, mardi 6, en revenant de Saint-Sulpice, entré à Saint-Germain, où j’ai vu les barbouillages gothiques dont on couvre les murs de cette malheureuse église. Confirmation de ce que je disais à mon ami : j’aime mieux les imaginations de Luna que les contrefaçons de Baltard, Flandrin et Cie[582].
Mardi 6 avril. — Ébauché les trois autres pendentifs.
Rencontré Cousin en revenant et toujours sur le quai.
Mercredi 7 avril. — Les animaux ne sentent pas le poids du temps. L’imagination, qui a été donnée à l’homme pour sentir les beautés, lui procure une foule de maux imaginaires ; l’invention des distractions, les arts qui remplissent les moments de l’artiste qui exécute, charment les loisirs de ceux qui ne font que jouir de ces productions. La recherche de la nourriture, des courts moments de la passion animale, de l’allaitement des petits, de la construction des nids ou des tanières, sont les seuls travaux que la nature ait imposés aux animaux. L’instinct les y pousse, aucun calcul ne les y dirige. L’homme porte le poids de ses pensées aussi bien que celui des misères naturelles qui font de lui un animal. A mesure qu’il s’éloigne de l’état le plus semblable à l’animal, c’est-à-dire de l’état sauvage à ses différents degrés, il perfectionne les moyens de donner l’aliment à cette faculté idéale refusée à la bête ; mais les appétits de son cerveau semblent croître à mesure qu’il cherche à les satisfaire ; quand il n’imagine ni ne compose pour son propre compte, il faut qu’il jouisse des imaginations des autres hommes comme lui, ou qu’il étudie les secrets de cette nature qui l’entoure et qui lui offre ses problèmes. Celui même que son esprit moins cultivé ou plus obtus rend impropre à jouir des plaisirs délicats où cet esprit a part, se livre, pour remplir ses moments, à des délassements matériels, mais qui sont autre chose que l’instinct qui pousse l’animal à la chasse. Si l’homme chasse dans un état moyen de civilisation, c’est pour occuper son temps. Il y a beaucoup d’hommes qui dorment pour éviter l’ennui d’une oisiveté qui leur pèse et qu’ils ne peuvent néanmoins secouer par des occupations offrant quelque attrait. Le sauvage, qui chasse ou qui pêche pour avoir à manger, dort pendant les moments qu’il n’emploie pas à fabriquer, à sa manière, ses grossiers outils, son arc, ses flèches, ses filets, ses hameçons en os de poisson, sa hache de caillou.
Jeudi 8 avril, — Coulé sur l’Hercule attachant Nérée : vermillon et laque ; jaune de zinc clair et terre de Cassel.
Coulé sur le Nérée : jaune de zinc clair, laque, cobalt, bleu de Prusse.
Après avoir modelé dans la demi-teinte, reflété en ajoutant par places quelques tons chauds ; touché la demi-teinte du clair avec un ton de clair rose orangé joint au ton de terre de Cassel, jaune de zinc et un mauve plus clair que celui qui a servi pour le coulé. — Les clairs du Nérée, ton dominant : jaune zinc clair et ton mauve clair et tant soit peu d’orangé clair, c’est-à-dire cadmium, blanc vermillon.
Très belle demi-teinte reflétée : vert de Scheele avec rouge de zinc, avec mauve clair, plus foncé avec ocre de ru.
Vendredi 23 avril. — Première représentation du Juif errant[583].
Jeudi 29 avril. — Chez Bertin le soir : il y avait peu de monde. Goubaux[584] venu dans la journée. Parlé de la négligence avec laquelle les pièces classiques sont représentées. Il n’y a pas un directeur de théâtre du boulevard qui la souffrît dans les pièces modernes. Les acteurs du Français se sont fait une habitude de chanter leurs rôles d’une façon monotone, comme des écoliers qui récitent une leçon. Il me citait un exemple, le début d’Iphigénie : Oui, c’est Agamemnon, etc.
Il se rappelait avoir vu Saint-Prix[585], qui passait pour un talent et qui de plus avait la tradition, se lever tranquillement d’un coin du théâtre, venir réveiller Arcas et lui dire tout d’une haleine : Oui, c’est Agamemnon, etc. Quelle est évidemment l’intention de Racine ? Ce oui qui commence répond évidemment à la surprise que doit manifester le serviteur éveillé avant l’aurore ; par qui ? par son maître, par son roi, le Roi des rois. Sa réponse ne dit-elle pas aussi que ce roi, que ce père a veillé dans l’inquiétude, longtemps avant de venir à ce confident, pour décharger une partie de son souci en en parlant ? Il a dû se promener, s’agiter sur sa couche, avant de se lever. Il ne répond même pas, dans sa préoccupation, qui semble continue, à la demande de cet ami fidèle. Il se parle à lui-même ; son agitation se trahit dans ce regard jeté sur sa destinée : Heureux qui, satisfait, etc.
Oui, c’est Agamemnon… répond à la surprise d’Arcas. Ces mots doivent être entrecoupés par des jeux muets et non pas défilés comme un chapelet ou comme un homme qui lirait dans un livre. Les acteurs sont des paresseux, qui ne se sont même jamais demandé s’ils pouvaient mieux faire. Je suis convaincu qu’ils suivent la route tracée, sans se douter des trésors d’expression que renferment tant de beaux ouvrages.
Goubaux me disait que Talma lui avait raconté qu’il notait toutes ses inflexions, indépendamment de la prononciation des mots. C’était un fil conducteur qui l’empêchait de dévier quand il était moins inspiré. Cette espèce de musique, une fois dans sa mémoire, ramenait toutes les intonations dans un cercle dont il ne serait pas sorti sans péril de s’égarer et d’être entraîné trop loin ou à faux.
30 avril. — Au conseil municipal, pour parler pour la bourse du fils de Roehn[586].
Mercredi 5 mai. — Parti pour Champrosay.
J’ai donné congé à Andrieu au commencement de la semaine.
Tombé au milieu du déménagement qui a été mis en ordre le lendemain. L’habitation me plaît, et le bon propriétaire empressé à me plaire.
— Il faut ébaucher le tableau comme serait le sujet par un temps couvert, sans soleil, sans ombres tranchées. Il n’y a radicalement ni clairs ni ombres. Il y a une masse colorée pour chaque objet, reflétée différemment de tous côtés. Supposez que, sur cette scène, qui se passe en plein air par un temps gris, un rayon de soleil éclaire tout à coup les objets : vous aurez des clairs et des ombres comme on l’entend, mais ce sont de purs accidents. La vérité profonde, et qui peut paraître singulière, de ceci est toute l’entente de la couleur dans la peinture. Chose étrange ! elle n’a été comprise que par un très petit nombre de grands peintres, même parmi ceux qu’on répute coloristes.
Champrosay, jeudi 6 mai. — (Le dos contre la barrière, au pied du grand chêne de l’allée de l’Ermitage.)[587] Arrivé hier mercredi 5 à Champrosay pour passer deux ou trois jours, et m’installer dans mon nouveau logement.
Vers quatre heures, sorti sur la route vers Soisy[588], pour gagner de l’appétit. J’ai trouvé là sur la poussière une trace d’eau répandue comme par le bout d’un entonnoir, qui m’a rappelé mes observations précédentes, et en différents lieux, sur les lois géométriques qui président aux accidents de même espèce, qui semblent au vulgaire des effets du hasard : tels que sillons que creusent les eaux de la mer, sur le sable fin qu’on trouve sur les plages, comme j’en ai observé l’année dernière à Dieppe, et comme j’en avais vu à Tanger. Ces sillons présentent, dans leur irrégularité, le retour des mêmes formes, mais il semble que l’action de l’eau ou la nature du sable qui reçoit ces empreintes, détermine des aspects différents, suivant les lieux : ainsi, les marques à Dieppe, des espaces d’eau sur un sable très fin, qui se trouvaient séparés çà et là ou enfermés par de petits rochers, figuraient très bien les flots mêmes de la mer. En les copiant avec des colorations convenables, on eût donné l’idée du mouvement des vagues si difficile à saisir. A Tanger, au contraire, sur une plage unie, les eaux, en se retirant, laissaient l’empreinte de petits sillons, qui figuraient à s’y méprendre les rayures de la peau des tigres. La trace que j’ai trouvée hier sur la route de Soisy représentait exactement les branches de certains arbres, quand ils n’ont pas de feuilles ; la branche principale était l’eau répandue, et les petites branches qui s’enlaçaient de mille manières étaient produites par les éclaboussures qui partaient et se croisaient de droite et de gauche.
J’ai en horreur le commun des savants : j’ai dit ailleurs qu’ils se coudoyaient dans l’antichambre du sanctuaire où la nature cache ses secrets, attendant toujours que de plus habiles en entre-bâillent la porte : que l’illustre astronome danois ou norvégien ou allemand Borzebilocoquantius[589] découvre avec sa lunette une nouvelle étoile, comme je l’ai vu dernièrement mentionné, le peuple des savants enregistre avec orgueil la nouvelle venue, mais la lunette n’est pas fabriquée qui leur montre les rapports des choses.
Les savants ne devraient vivre qu’à la campagne, près de la nature ; ils aiment mieux causer autour des tapis verts des académies, de l’Institut, de ce que tout le monde sait aussi bien qu’eux ; dans les forêts, sur les montagnes, vous observez des lois naturelles, vous ne faites pas un pas sans trouver un sujet d’admiration.
L’animal, le végétal, l’insecte, la terre et les eaux sont des aliments pour l’esprit qui étudie et qui veut enregistrer les lois diverses de tous ces êtres. Mais ces messieurs ne trouvent pas là la simple observation digne de leur génie ; ils veulent pénétrer plus avant, et font des systèmes du fond de leur bureau qu’ils prennent pour un observatoire. D’ailleurs, il faut fréquenter les salons et avoir des croix ou des pensions ; la science qui met sur cette voie-là vaut toutes les autres.
Je compare les écrivains qui ont des idées, mais qui ne savent pas les ordonner, à ces généraux barbares qui menaient au combat des nuées de Perses ou de Huns, combattant au hasard, sans ordre, sans unité d’efforts, et par conséquent sans résultats ; les mauvais écrivains se trouvent aussi bien parmi ceux qui ont des idées, que chez ceux qui en sont dépourvus.
Promenade charmante dans la forêt, pendant qu’on arrange chez moi. Mille pensées diverses suggérées au milieu de ce sourire universel de la nature. Je dérange à chaque pas, dans ma promenade, des rendez-vous, effets du printemps ; le bruit que je fais en marchant dérange les pauvres oiseaux, qui s’envolent toujours par couple de deux.
Ah ! les oiseaux, les chiens, les lapins ! Que ces humbles professeurs de bon sens, tous silencieux, tous soumis aux décrets éternels, sont au-dessus de notre vaine et froide connaissance !
A tout moment, le bruit de mes pas fait fuir ces pauvres oiseaux, qui s’envolent toujours deux par deux. C’est le réveil de toute cette nature ; elle a ouvert la porte aux amours. Il vient de nouvelles feuilles verdoyantes, il va naître des êtres nouveaux, pour peupler cet univers rajeuni. Le sens savant s’éveille chez moi plus actif que dans la ville. Ces imbéciles (les savants) vivent-dans leur cabinet, ils le prennent pour le sanctuaire de la nature. Ils se font envoyer des squelettes et des herbes desséchées, au lieu de les voir baignées de rosée.
— Me voici assis dans un fossé sur des feuilles séchées, près du grand chêne qui se trouve dans la grande allée de l’Ermitage.
— Je suis toujours sujet, au milieu de la journée, à un abattement qui est le dernier acte de la digestion.
— Quand je rentre aussi de ces promenades du matin, je suis moins disposé, ou plutôt je ne suis plus disposé du tout au travail.
Vendredi 7 mai. — Revenu à Paris pour voir l’esquisse de Riesener chez Varcollier ; elle ne s’y est pas trouvée, quoiqu’il l’y eût envoyée. J’avais fait une séance le matin au Jardin des plantes. J’y ai fait renouveler ma carte. Travaillé au soleil, parmi la foule, d’après les lions.
En arrivant, pris, dans le jardin, de ma langueur ; je me suis mis à dormir au soleil, sur une chaise.
— Couru l’après-midi, pour l’affaire du fils de Varcollier, de l’Hôtel de ville jusque passé la place de la Bourse, sans trouver une voiture libre. Je suis venu chez moi voir mes lettres, envoyer les billets disponibles pour la fête de lundi, et reparti à cinq heures. — Arrivée toujours charmante dans cet endroit. Revenu à travers la plaine.
Lundi 10 mai. — Jour de la distribution des aigles, que j’ai passé à Champrosay.
Paris, mardi 11 mai. — Parti de Champrosay à onze heures un quart. J’ai envoyé ces demoiselles[590] à la maison et suis resté au Jardin des plantes. Vu les galeries d’anatomie au milieu d’une foule énorme ; malgré les inconvénients, j’ai été intéressé.
Venu pour dîner.
Mercredi 12 mai. — J’extrais d’une lettre à Pierret mes réflexions sur l’interruption de mon travail pendant huit jours.
« … Il ne faut pas quitter sa tâche : voilà pourquoi le temps, voilà pourquoi la nature, en un mot tout ce qui travaille lentement et incessamment, fait de si bonne besogne. Nous autres, avec nos intermittences, nous ne filons jamais le même fil jusqu’au bout. Je faisais, avant mon départ, le travail de M. Delacroix d’il y a quinze jours : je vais faire à présent le travail de Delacroix de tout à l’heure. Il faut renouer la maille, le tricot sera plus gros ou plus fin. »
Le cousin Delacroix a dîné avec moi. J’avais trouvé sa carte vendredi dernier. Nous avons été finir la soirée au café de Foy.
Mardi 1er juin. — Superbe ton jaune pour mettre à côté de terre de Cassel, blanc et laque, composé de quatre des principaux tons de la palette, à savoir :
Laque, cobalt, blanc,
Ocre de ru, vermillon,
Vert émeraude, laque de gaude, jaune de zinc,
Cadmium, vermillon, laque de gaude.
Très beau ton d’ombre pour chair très colorée (exemple : la figure à côté de la Furie) : le ton de terre de Cassel, laque jaune, jaune indien, terre d’Italie naturelle.
Ton de chair (très beau dans l’ombre de l’enfant à la corne de l’abondance) ; le ton de laque, terre de Cassel, blanc le plus foncé des deux et le ton de cadmium, laque de gaude et vermillon.
Dans l’enfant qui vole en haut, faire dominer, en finissant, des tons d’orangé (laque jaune, cadmium, vermillon) avec un gris de terre d’ombre et blanc, ou momie et blanc, ou Cassel et blanc.
Ce ton orangé et terre verte.
Ces tons orangés, en finissant, très essentiels pour ôter la froideur ou le violacé du ton.
Pour les luisants, très beau ton très applicable : terre verte et mauve clair (cobalt, laque et blanc).
Très belle demi-teinte ou luisant analogue à la dernière : terre verte et rose (vermillon et blanc).
Pour reprendre le ciel autour des contours, momie et blanc assez foncé avec bleu et blanc. Un peu de jaune de Naples.
Mardi 8 juin. — Dîné chez Véron, à Auteuil.
Mercredi 9. — Dîné chez Halévy avec Janin[591] et le docteur Blache[592], qui me plaît assez.
Lundi 5 juillet. — Dîné chez Perrin avec X…
On parlait de la susceptibilité des gens nerveux pour sentir le temps qu’il faisait. Il dit très bien que l’intérêt mis en jeu était encore plus perspicace. En sa qualité de directeur de spectacle, il avait flairé avec chagrin la continuité de la chaleur. Dîné là avec Halévy, Boilay, Varcollier, Guillardin. Revenu prendre des glaces avec eux sur le boulevard.
Mardi 6 juillet. — Mardi soir, arrivé à Champrosay.
Prêté à Mme Halévy, en partant pour Champrosay, les deux copies de Raphaël, l’Enfant et le Portrait à la main.
Samedi 10 juillet. — Prêté à Lehmann les Études de lions. — Rendues.
Dimanche 11 juillet. — Autre jaune très beau : Ocre de ru ou ocre jaune et rouge de zinc. — Ton à mettre en vessies : ocre jaune, jaune indien, cassel, blanc (se remplace par ocre jaune, momie et blanc).
A côté, ocre de ru, terre Sienne brûlée.
Lundi 12 juillet. — Très beau ton brun transparent : noir d’ivoire, terre de Sienne naturelle, et l’orangé transparent de la palette un peu plus verdâtre.
Le ton terre de Cassel, laque jaune, jaune indien, avec le même orangé (laque jaune, vermillon, cadmium).
Le plus intense de ces tons est très beau avec l’orangé et momie ou bitume.
Beau brun très simple et très utile : momie, terre Sienne naturelle. Brun foncé transparent, remplaçant le jaune de mars et plus foncé : laque et vermillon, terre Sienne naturelle.
Mardi 13 juillet. — Le ton de vermillon de Chine et laque, la nuance foncée à côté de blanc et noir foncé. La nuance claire de vermillon et laque à côté de la laque de gaude pure.
Ce mélange sert à réchauffer les ombres vigoureuses que l’on ébauche avec le ton de terre de Cassel et vermillon.
— Mettre le ton de terre de Cassel, blanc clair, terre de Cassel, laque et brun rouge plus foncé, au milieu des tons de rose, d’orangé, de violet, d’ocre de ru et de vermillon, etc., qui font les tons clairs.
Le beau ton jaune : ocre jaune, jaune indien blanc, cassel mêlé avec le petit violet.
Autre mélange avec le ton vermillon clair et laque : ton sanguine charmant.
— Beau ton jaune : rouge orangé de zinc, ocre de ru.
— Clairs de l’Hercule et du Centaure : Terre Cassel et blanc clair. — Cadmium, vermillon, blanc comme base.
Ombres chaudes : laque jaune et vermillon laque ; au bord de l’ombre, un peu de gros violet ; sur ce frottis, le ton de terre de Sienne, vert émeraude, le gros violet mêlé avec laque jaune et laque rouge, vermillon fait des vigueurs superbes.
Il faut mettre sur la palette le gros violet à côté du laque foncé, vermillon, laque jaune.
Ombres et demi-teinte de l’Antée : Gros violet, laque, vermillon, gaude foncée, avec le ton de Sienne naturelle et vert émeraude.
Jaune indien, jaune de zinc clair. — Superbe gomme-gutte. Ton des montagnes, dans l’Antée : Vert émeraude ; deuxième avec noir, blanc foncé, bitume, etc., vert émeraude et laque Cassel et bleu foncé. — Beau ton neutre pour montagnes.
— Terre d’Italie naturelle et vermillon ou vermillon et laque équivaut à peu près à rouge de zinc.
Le ton paille de terre de Cassel, blanc, ocre jaune et jaune indien, excellente demi-teinte de l’enfant à la corne d’abondance, en le mêlant, soit avec cobalt ou laque et vermillon, soit avec ton orangé.
Demi-teinte pour la chair, veines, bords d’ombre, etc. : le ton de noir et blanc avec vert émeraude.
Autre plus beau : le ton de cobalt, blanc, laque claire avec vert émeraude.
Brun très beau (approche de jaune laque de Rome) : laque brûlée, terre Sienne naturelle, jaune foncé, laque de gaude.
Plus intense, avec laque jaune de Rome foncée.
Brun très transparent demi-foncé, très utile : terre Sienne naturelle et vert émeraude avec laque et vermillon,
— Brun plus clair, violâtre paille, en ajoutant au précédent le ton de cobalt, laque et blanc (mauve clair). — Brun jaune clair transparent ; le ton de vert émeraude, jaune de zinc avec le ton orangé transparent de cadmium, gaude, vermillon — ce dernier dominant.
— Brun jaune foncé : terre Sienne naturelle, vert émeraude, avec le ton orangé transparent.
— Beau vert approchant du ton de ciel de l’Apollon : vert émeraude, jaune de zinc, avec le ton orangé transparent.
Bel orangé transparent : gaude avec rouge de zinc ; le même avec une pointe de vert émeraude et zinc clair, donne le ton de ciel de l’Apollon.
— Brun foncé dans le genre de la laque de Rome : jaune, terre de Cassel, gaude, jaune indien avec laque et vermillon foncé…
— Très beau aussi : Brun de Florence, terre Sienne naturelle et gaude.
— Très beau aussi : Brun de Florence et jaune indien.
— Brun clair transparent : le même ton avec terre de Cassel, blanc, jaune de zinc clair, rouge de zinc, etc.
Jaune paille très fin, très fin : le précédent avec addition de jaune de Naples et le ton de jaune de zinc et vert émeraude.
— Plus beau : avec une pointe de laque et vermillon et du ton vert clair de zinc et d’émeraude.
Brun demi-teinte pour chair : Rouge de zinc et le ton de Cassel, blanc et laque. — Le plus simple de ces bruns paille clair et demi-clair est peut-être la terre Cassel, blanc avec terre de Sienne naturelle, plus ou moins foncé.
Le ton paille, ocre jaune, terre de Cassel, blanc avec une pointe de vermillon. — Excellent ton de chair point violacé.
— Vert émeraude et blanc clair, avec pointe d’ocre jaune : Clairs d’arbres, dans le lointain.
Pour retoucher en éclaircissant comme dans la Muse : ton d’ombre des chairs, le ton de Sienne naturelle et vert émeraude, avec vermillon et laque clair, et jaune paille un peu intense.
Bord d’ombre très beau, vert émeraude et le ton de laque, vermillon, laque jaune.
Brillants de la chair dans le Mercure et le Neptune : Brun rouge, blanc, avec jaune de Naples.
Main de la Vénus tenant le miroir, fraîcheur extraordinaire : Demi-teinte générale des doigts touchée avec le ton mauve, cobalt, laque et blanc un peu foncé mêlé à vert émeraude fin ; plus ou moins de blanc suivant la place.
A côté, pour les ombres, glacis très léger d’un ton chaud de laque jaune, laque rouge, vermillon et plus ou moins d’un ton jaune rompu, mais toujours en transparent. Le même, par exemple, qui se glisse sur un fond de chair déjà peint où je veux augmenter une demi-teinte. — Je commence par ce glacis chaud et je mets à sec (surtout) un gris par-dessus (se rappeler la retouche de la Vénus), notamment sur la jambe ; les gris remis sur un fond chaud ont reproduit l’effet demi-teintes de l’esquisse de la Médée.
Demi-teinte sur une partie trop claire, par exemple le dentelé du côté du clair de Neptune, préparé avec un ton chaud transparent, plus ou moins foncé, suivant le besoin, par exemple le ton de Sienne naturelle, vert émeraude, et mettre le ton gris par-dessus, soit terre Cassel, blanc, laque, soit le ton mauve.
— Rompre sur la palette les tons très clairs de cadmium, vermillon, blanc, et de vermillon et blanc. Dans ce dernier, ajouter terre de Cassel ou un peu plus de vermillon.
— Ton pour la mer d’Andrieu, dans l’Hercule et Hésione.
— Dans cette Vénus, employé avec succès le bord d’ombre, de vert émeraude et ton de vermillon, laque et laque jaune. Ce ton opposé aux tons orangés de la figure est d’un grand charme.
— Dans les retouches, pour ajouter des demi-teintes, comme dans cette figure, toujours préparer avec des tons chauds et mettre le ton gris ensuite.
— Reflets pour la chair (la Vénus des caissons de l’Hôtel de ville). — La réunion, sans les mêler, des TROIS TONS ORANGÉS TRANSPARENTS (cadmium, laque jaune, vermillon) VIOLET CLAIR (laque rose, cobalt, blanc) et VERT CLAIR (zinc et émeraude) ; le même reflet, pour ainsi dire, partout, linge, armures, etc.
Ton de laque brûlée, vermillon, blanc, et à côté le même plus clair, avec très peu de laque brûlée. Ce ton, à côté de l’orangé, vermillon, laque jaune, cadmium.
— Excellent ton avec plus ou moins de blanc ou d’orangé, pour couler sur la grisaille, ou pour reprendre une chair vive.
La petite Andromède couchée ainsi.
— Mauve un peu foncé à côté du ton rose — demi-teinte d’une jeune ingénue ; le moindre vert, à côté, la complète.
Vert émeraude, terre d’Italie, très beau jaune vert.
En y ajoutant du vermillon, il devient sanguiné, sans être rouge, et est très utile ; il peut se placer à côté du ton Sienne naturelle, vert émeraude, jaune indien.
Dieppe. — Lundi 6 septembre. — Parti pour Dieppe à huit heures ; à neuf heures à Mantes ; à dix heures un quart, à peu près, à Rouen. Le reste du trajet, n’étant pas direct, a été beaucoup plus long.
Arrivé à Dieppe à une heure. Trouvé là M. Maison. Logé hôtel de Londres avec la vue sur le port que je souhaitais, et qui est charmante. Cela me fera une grande distraction.
Dans toute cette fin de journée, dont j’ai passé une grande partie sur la jetée, je n’ai pu échapper à un extrême ennui. Dîné seul à sept heures, près de gens que j’avais rencontrés déjà sur la jetée, et qui m’avaient, dès ce moment, inspiré de l’antipathie ; ce sentiment s’est encore augmenté pendant ce triste dîner. Naturel de chasseurs demi-hommes du monde, la pire espèce de toutes.
J’ai trouvé dans la voiture jusqu’à Rouen un grand homme barbu et très sympathique, qui m’a dit les choses les plus intéressantes sur les émigrants allemands et particulièrement sur certaines des colonies de cette race, qui se sont établies dans plusieurs parties de la Russie méridionale, où il les a vues. Ces gens, descendant en grande partie des Hussites, qui sont devenus les Frères Moraves. Ils vivent là en communauté, mais ne sont point des communistes, à la manière dont on entendait cette qualification en France, dans nos derniers troubles : la terre seulement est en commun, et probablement aussi les instruments de travail, puisque chacun doit à la communauté le tribut de son travail ; mais les industries particulières enrichissent les uns plus que les autres, puisque chacun a son pécule, qu’il fait valoir avec plus ou moins de soin et d’habileté ; il y a possibilité de se faire remplacer pour le travail commun. Ils se donnent le nom de Méronites ou Ménonites.
Mercredi 8 septembre. — Trouvé Durieu[593] et sa pupille à Dieppe : je les ai menés dans les églises.
Jeudi 9 septembre. — Tous ces jours-ci, j’ai, eu mauvais temps et difficulté de jouir de la mer et de la promenade.
Rencontré Dantan[594], qui m’a dit des choses aimables.
Vu l’église du Pollet. Cette simplicité est toute protestante ; cela ferait bien avec des peintures. Le soir, j’ai joui de la mer, pendant une heure et demie ; je ne pouvais m’en détacher.
Vraiment, il faut accorder à la littérature moderne d’avoir donné, par les descriptions, un grand intérêt à certains ouvrages, qui n’avaient pas une place suffisante. Seulement, l’abus qu’on a fait de cette qualité, à ce point qu’elle est devenue presque tout, a dégoûté du genre.
Vendredi 10 septembre. — Ce matin, sorti à sept heures et demie, contre ma coutume. Je m’étais mis à lire Dumas, qui me fait supporter le temps que je ne passe pas au bord de la mer. La mer la plus calme, la vue avec le soleil du matin, toutes ces voiles de pécheurs à l’horizon m’ont enchanté. Je suis rentré en retournant plusieurs fois la tête.
En revenant vers quatre heures du quartier des bains, rencontré M. Perrier. Il a dîné avec nous. Le soir, nous avons été ensemble à la jetée. Il a dit, comme moi, que c’était magnifique, sans regarder, et il m’a parlé tout le temps du conseil. Je l’ai remis dans sa chambre, où il m’a causé longuement, pendant que je m’endormais,
Samedi 11 septembre. — En me réveillant, j’ai vu de mon lit le bassin à peu près plein et les mâts des bâtiments se balançant plus qu’à l’ordinaire ; j’en ai conclu que la mer devait être belle ; j’ai donc couru à la jetée et j’ai effectivement joui, pendant près de quatre heures, du plus beau spectacle.
La jeune dame de la table d’hôte, qui se trouve être seule, y était à son avantage ; il est vrai que le noir lui sied mieux et ôte un peu de vulgarité. Elle était vraiment belle par instants, et moi assez occupé d’elle, surtout quand elle est descendue au bord de la mer, où elle a trouvé charmant de se faire mouiller les pieds par le flot. A table, sur le tantôt, je l’ai trouvée commune. La pauvre fille jette ses hameçons comme elle peut : le mari, ce poisson qui ne se trouve pas dans la mer, est l’objet constant de ses œillades, de ses petites mines. Elle a un père désolant… J’ai cru longtemps qu’il était muet ; depuis qu’il a ouvert la bouche, ce qui, à la vérité, est fort rare, il a perdu encore dans mon opinion ; car auparavant, c’était l’écorce seule qui était peu flatteuse.
Ce soir, je les ai retrouvés à la jetée.
Rentré, lu mon cher Balsamo[595].
Déjeuné vers une heure et demie, contre mon habitude. — Habillé et sorti. — J’ai été finir mes emplettes chez l’ivoirier et ai passé mon temps délicieusement jusqu’à dîner, au pied des falaises.
La mer était basse et m’a permis d’aller fort loin sur un sable qui n’était pas trop humide. J’ai joui délicieusement de la mer ; je crois que le plus grand attrait des choses est dans le souvenir qu’elles réveillent dans le cœur ou dans l’esprit, mais surtout dans le cœur. Je pense toujours à Bataille, à Valmont[596], quand je m’y suis trouvé pour la première fois, il y a tant d’années… Le regret du temps écoulé, le charme des jeunes années, la fraîcheur des premières impressions agissent plus sur moi que le spectacle même. L’odeur de la mer, surtout à marée basse, qui est peut-être son charme le plus pénétrant, me remet, avec une puissance incroyable, au milieu de ces chers objets et de ces chers moments qui ne sont plus.
Dimanche 12 septembre. — Très belle journée : le soleil de bonne heure. J’avais devant mes fenêtres les bâtiments pavoisés.
J’ai trouvé sur la jetée Mme Sheppard. Elle m’a invité à dîner pour demain. J’ai esquivé la jeune dame d’hier, qui devient assommante ; elle et son monde ont encore gâté ma soirée ; impossible de les éviter à la jetée… En vérité, je suis d’une bêtise extrême : je suis simplement poli et prévenant pour les gens ; il faut qu’il y ait dans mon air quelque chose de plus. Ils s’accrochent à moi, et je ne peux plus m’en défaire. Entré un moment à l’établissement le soir, grâce à l’instance de Possoz[597], qui est là comme chez lui : la mer, qui était pleine, se brisait avec une belle fureur.
— Je fais ici d’une manière assez complète cette expérience qu’une liberté trop complète mène à l’ennui. Il faut de la solitude et il faut de la distraction. La rencontre de P…, que je redoutais, m’est devenue une ressource à certains moments. Celle de Mme Sheppard de même pour quelques instants. Sans Dumas et son Balsamo, je reprenais le chemin de Paris, si bien que maintenant ces interruptions à ma solitude sont ce qui me prend le plus de temps, et je suis loin de regretter mes vagues rêveries.
Tout ce qui est grand produit à peu près la même sensation. Qu’est-ce que la mer et son effet sublime ? celui d’une énorme quantité d’eau… Hier soir, j’écoutais avec plaisir le clocher de Saint-Jacques qui sonne très tard, et en même temps je voyais dans l’ombre la masse de l’église. Les détails disparaissant, l’objet était plus grand encore ; j’éprouvais la sensation du sublime, que l’église vue au grand jour ne me donne nullement, car elle est assez vulgaire. Le modèle exact en petit de la même église serait encore plus loin de faire éprouver ce sentiment. Le vague de l’obscurité ajoute encore beaucoup à l’impression de la mer : c’est ce que je voyais à la jetée pendant la nuit, quand on n’entrevoit qu’à peine les vagues, qui sont tout près, et que le reste se perd dans l’horizon. Saint-Remy me produit beaucoup plus d’effet que Saint-Jacques, qui est cependant d’un meilleur goût, plus ensemble et d’un style continu. La première de ces deux églises est d’un goût bâtard tout à fait semblable à l’église de l’abbaye de Valmont, et qui prêterait beaucoup à la critique des architectes. Saint-Eustache, qui est dans le même cas, quoique plus conséquent dans toutes ses parties, est assurément l’église la plus imposante de Paris. Je suis sûr que Saint-Ouen[598] regratté ne fera plus d’effet ; l’obscurité des vitraux et les murs noircis, les toiles d’araignée, la poussière, voilaient les détails et agrandissaient le tout. Les falaises ne font d’effet que par leur masse, et cet effet est immense, surtout quand on y touche, ce qui augmente encore le contraste de cette masse avec les objets qui les avoisinent et avec notre propre petitesse.
Lundi 13 septembre. — Comment ! sot que tu es, tu t’égosilles à discuter avec des imbéciles, tu argumentes vis-à-vis de la sottise en jupons, pendant une soirée entière, et cela sur Dieu, sur la justice de ce monde, sur le bien et le mal, sur le progrès ?
Ce matin, je me lève fatigué, sans haleine… Je ne suis en train de rien, pas même de me reposer. O folie, trois fois folie !… Persuader les hommes ! Quel entassement de sottises dans la plupart de ces têtes ! Et ils veulent donner de l’éducation à tous les gens nés pour le travail, qui suivent tout bonnement leur sillon, pour en faire à leur tour des idéologues !… Toutes ces réflexions, à propos du dîner chez Mme Sheppard.
Ce matin, trouvé une méduse à la jetée. Ces gens que je rencontre m’empêchent de jouir de la mer. Il est temps de s’en aller… Après déjeuner, j’ai été sur le galet vers les bains. Rentré fatigué, après avoir dessiné, en revenant, à Saint-Remy, les tombeaux. Resté chez moi jusqu’à l’heure de cet affreux dîner… Ce matin, avant de sortir, écrit à Mme de Forget,
— Agis pour ne pas souffrir. Toutes les fois que tu pourras diminuer ton ennui ou ta souffrance en agissant, agis sans délibérer. Cela semble tout simple au premier coup d’œil. Voici un exemple trivial : je sors de chez moi ; mon vêtement me gêne ; je continue ma route par paresse de retourner et d’en prendre un autre.
Les exemples sont innombrables. Cette résolution appliquée aux vulgarités de l’existence, comme aux choses importantes, donnerait à lame un ressort et un équilibre qui est l’état le plus propre à écarter l’ennui. Sentir qu’on a fait ce qu’il fallait faire vous élève à vos propres yeux. Vous jouissez ensuite, à défaut d’autre sujet de plaisir, de ce premier des plaisirs, être content de soi. La satisfaction de l’homme qui a travaillé et convenablement employé sa journée est immense. Quand je suis dans cet état, je jouis délicieusement ensuite du repos et des moindres délassements. Je peux même, sans le moindre regret, me trouver dans la société des gens les plus ennuyeux. Le souvenir de la tâche que j’ai accomplie me revient et me préserve de l’ennui et de la tristesse.
Mardi 14 septembre. — Ma dernière journée à Dieppe n’a pas été la meilleure. J’avais la gorge irritée d’avoir trop parlé la veille. J’ai été au Pollet, après avoir fait ma malle, pour éviter les rencontres. J’ai vu entrer dans le port le bâtiment qu’on venait de lancer, remorqué par une chaloupe. Rentré mal disposé. J’ai été faire ma dernière visite à la mer, vers trois heures. Elle était du plus beau calme et une des plus belles que j’aie vues. Je ne pouvais m’en arracher. J’étais sur la plage et n’ai point été sur la jetée de toute la journée. L’âme s’attache avec passion aux objets que l’on va quitter.
Parti à sept heures moins un quart. Chose merveilleuse ! nous étions à Paris à onze heures cinq. Un jeune homme fort bienveillant, mais qui m’a fatigué, a partagé ma société. Il avait dîné avec moi en tête-à-tête. J’ai trouvé à Rouen Fau et sa petite fille.
— C’est d’après cette mer que j’ai fait une étude de mémoire : ciel doré, barques attendant la marée pour rentrer.
Paris, 15 septembre. — Sophocle, à qui on demandait si, dans sa vieillesse, il regrettait les plaisirs de l’amour[599], répondit : « L’amour ? Je m’en suis délivré de bon cœur comme d’un maître sauvage et furieux. »
Dimanche 19 septembre. — Dîné chez M. Guillemardet, à Passy, avec M. Talentino, employé par Demidoff.
Je travaille énormément, depuis mon retour de Dieppe, aux caissons de l’Hôtel de ville. Je ne vois personne. Je fais d’excellentes journées.
Lundi 20 septembre. — Sur l’architecture. C’est l’idéal même ; tout y est idéalisé par l’homme. La ligne droite elle-même est de son invention, car elle n’est nulle part dans la nature. Le lion cherche sa caverne ; le loup et le sanglier s’abritent dans l’épaisseur des forêts ; quelques animaux se font des demeures, mais ils ne sont guidés que par l’instinct ; ils ne savent ce que c’est de les modifier ou de les embellir. L’homme imite dans ses habitations la caverne et le dôme aérien des forêts ; dans les époques où les arts sont portés à la perfection, l’architecture produit des chefs-d’œuvre : à toutes les époques, le goût du moment, la nouveauté des usages introduisent des changements qui témoignent de la liberté du goût.
L’architecture ne prend rien dans la nature directement, comme la sculpture ou la peinture ; en cela elle se rapproche de la musique, à moins qu’on ne prétende que, comme la musique rappelle certains bruits de la création, l’architecture imite la tanière, ou la caverne, ou la forêt ; mais ce n’est pas là l’imitation directe, comme on l’entend en parlant des deux arts qui copient les formes précises que la nature présente.
Mardi 28 septembre. — Ce jour est le dernier où j’ai travaillé avant mon indisposition. Villot est tombé des nues chez moi, et sa visite m’a fait plaisir ; mais à partir de ce jour, j’ai été pris d’une langueur et d’un mal de gorge[600] qui m’a couché tout à plat. Je venais de remonter mon tableau, que je craignais de trouver trop sombre en place.
Samedi 2 octobre. — Tous ces jours-ci malade, et pourtant je sortais le soir, malgré la bise, pour conserver encore quelques forces. Aujourd’hui, par le conseil de Jenny, et presque poussé par les épaules, j’ai été faire une promenade au milieu du jour sur la route de Saint-Ouen et Saint-Denis ; je suis revenu fatigué, mais, je crois, mieux. La vue de ces collines de Sannois et de Cormeilles m’a rappelé mille moments délicieux du passé. Un omnibus qui va et vient sur cette route de Paris à Saint-Denis m’a inspiré l’idée d’y aller m’y promener quelquefois. J’ai une envie démesurée d’aller à la campagne, et je suis cloué par cette indisposition.
Je lis le soir les Mémoires de Balsamo. Ce mélange de parties de talent avec cet éternel effet de mélodrame vous donne envie quelquefois de jeter le livre par la fenêtre ; et dans d’autres moments, il y a un attrait de curiosité qui vous retient toute une soirée sur ces singuliers livres, dans lesquels on ne peut s’empêcher d’admirer la verve et une certaine imagination, mais dont vous ne pouvez estimer l’auteur en tant qu’artiste. Il n’y a point de pudeur, et on s’y adresse à un siècle sans pudeur et sans frein.
Dimanche 3 octobre. — Sorti aussi, plaine Monceau. Beau ciel : monuments de Paris dans le lointain.
Lundi 4 octobre. — Jenny est partie ce matin pour aller passer quelque temps, le plus quelle pourra, auprès de Mme Haro, et moi, je suis souffrant et arrêté dans mon travail.
Haro se sert, pour mater les tableaux, de cire dissoute dans l’essence rectifiée, avec légère addition de lavande (essence) ; pour ôter ce matage, il emploie de l’essence mêlée à de l’eau. Il faut battre beaucoup pour que le mélange se fasse.
Ce matage, frotté avec de la laine, donne un vernis qui n’a pas les inconvénients des autres.
Samedi 9 octobre. — Je disais à Andrieu qu’on n’est maître que quand on met aux choses la patience qu’elles comportent. Le jeune homme compromet tout en se jetant à tort et à travers sur son tableau.
Pour peindre, il faut de la maturité ; je lui disais, en retouchant la Vénus, que les natures jeunes avaient quelque chose de tremblé, de vague, de brouillé. L’âge prononce les plans. Dans l’exécution des maîtres, des différences qui en amènent dans le genre d’effet. Celle de Rubens, qui est formelle, sans mystères, comme Corrège et Titien, vieillit toujours, donne l’air plus vieux : ses nymphes sont de belles gaillardes de quarante-cinq ans ; dans ses enfants, presque toujours le même inconvénient.
Lundi 11 octobre. — Sur mes figures de la terre, et qui étaient trop rouges, j’ai mis des luisants avec jaune de Naples, et j’ai vu, quoique cela me semble contrarier l’effet naturel qui me paraît faire les luisants gris ou violets, que la chair devenait à l’instant lumineuse, ce qui donne raison à Rubens. Il y a une chose certaine, c’est qu’en faisant des chairs rouges ou violâtres, et en faisant des luisants analogues, il n’y a plus d’opposition, partant le même ton partout. Si, par-dessus le marché, les demi-teintes sont violettes aussi, comme c’est un peu mon habitude, il est de nécessité que tout soit rougeâtre. Il faut donc absolument mettre plus de vert dans les demi-teintes dans ce cas. Quant au luisant doré, je ne me l’explique pas, mais il fait bien : Rubens le met partout… Il est écrit dans la Kermesse.
Mardi 12 octobre. — Aujourd’hui, vu Cinna avec Mlle Rachel. J’y avais été pour le costume de Corinne : je l’ai trouvé à merveille. Beauvallet[601] n’est décidément pas mal dans Auguste, surtout à la fin. Voilà un homme qui fait des progrès ; aussi les rides lui viennent, et probablement les cheveux blancs, ce que la perruque d’Auguste ne m’a pas permis de juger.
Comment ! l’acteur qui a toute sa vie, ou du moins pendant toute sa jeunesse, dans l’âge de la force et du sentiment, à ce qu’on dit, été mauvais ou médiocre, devient passable ou excellent, quand il n’a plus de dents ni de souffle, et il n’en serait pas de même dans les autres arts ! Est-ce que je n’écris pas mieux et avec plus de facilité qu’autrefois ? A peine je prends la plume, non seulement les idées se pressent et sont dans mon cerveau comme autrefois, mais ce que je trouvais autrefois une très grande difficulté, l’enchaînement, la mesure s’offrent à moi naturellement et dans le même temps où je conçois ce que j’ai à dire.
Et, dans la peinture, n’en est-il pas de même ? D’où vient qu’à présent, je ne m’ennuie pas un seul instant, quand j’ai le pinceau à la main, et que j’éprouve que, si mes forces pouvaient y suffire, je ne cesserais de peindre que pour manger et dormir ? Je me rappelle qu’autrefois, dans cet âge prétendu de la verve et de la force dé l’imagination, l’expérience manquant à toutes ces belles qualités, j’étais arrêté à chaque pas et dégoûté souvent. C’est une triste dérision de la nature que cette situation quelle nous fait avec l’âge. La maturité est complète et l’imagination aussi fraîche, aussi active que jamais, surtout dans le silence des passions folles et impétueuses que l’âge emporte avec lui ; mais les forces lui manquent, les sens sont usés et demandent du repos plus que du mouvement. Et pourtant, avec tous ces inconvénients, quelle consolation que celle qui vient du travail ! Que je me trouve heureux de ne plus être forcé d’être heureux comme je l’entendais autrefois ! A quelle tyrannie sauvage cet affaiblissement du corps ne m’a-t-il pas arraché ? Ce qui me préoccupait le moins était ma peinture. Il faut donc faire comme on peut ; si la nature refuse le travail au delà d’un certain nombre d’instants, ne point lui faire violence et s’estimer heureux de ce qu’elle nous laisse ; ne point tant s’attacher à la poursuite des éloges qui ne sont que du vent, mais jouir du travail même et des heures délicieuses qui le suivent, par le sentiment profond que le repos dont on jouit a été acheté par une salutaire fatigue qui entretient la santé de l’âme. Cette dernière agit sur celle du corps ; elle empêche la rouille des années d’engourdir les nobles sentiments.
Lundi 18 octobre. — J’ai travaillé tous ces jours-ci avec une ténacité extrême, avant d’envoyer mes peintures qu’on colle demain ; je suis resté sans me reposer pendant sept, huit et près de neuf heures devant mes tableaux.
Je crois que mon régime d’un, seul repas est décidément celui qui me convient le mieux.
Mardi 19 octobre. — Commencé à coller à l’Hôtel de ville. Tous les jours suivants, j’y serai assidu. Je ne pourrai guère commencer à retoucher que samedi ou dimanche. Je fais faire bonne garde à la porte de ma salle. Haro a renvoyé le préfet[602], qui a approuvé ma résolution de m’enfermer ; ce qui me fait étendre la mesure à tout le monde et avec son ordre exprès.
Cette salle est, je crois, la plus obscure de toutes[603]. J’ai été un peu inquiet, surtout de l’effet des fonds des caissons, qu’il faut, je crois, faire clairs.
Mercredi 20 octobre. — Ce matin, j’ai fait enlever toutes les planches, et la vue de l’ensemble m’a rassuré. Tous mes calculs relatifs à la proportion et à la grâce de la composition totale sont justes, et je suis ravi de cette partie du travail. Les obscurités qui sont l’effet de cette salle et auxquelles il était impossible de s’attendre à ce degré, seront, j’espère, facilement corrigées.
Vendredi 22 octobre. — En sortant de ma salle, vers dix heures, trouvé le préfet qui m’a promené devant toutes ces maudites peintures. Il m’a fait tomber sur la jambe un cadre de bois, qui m’a fait une entaille qui paraît être, le lendemain, assez légère, mais qui m’a inquiété, par la crainte d’être arrêté dans la terminaison de mon salon.
Vendredi 29 octobre. — Vu M. Cazenave[604] le matin. — Travaillé à mes retouches du plafond tous ces jours derniers, avec des chances diverses d’ennui et de joie : ce qu’il y a à faire est gigantesque ; mais si je ne suis pas malade, je m’en tirerai.
— Sur la différence du génie français et du génie italien dans les arts : le premier marche l’égal du second pour l’élégance et le style, au temps de la Renaissance. Comment se fait-il que ce détestable style, mou, carrachesque, ait prévalu ? Alors, malheureusement, la peinture n’était pas née. Il ne reste de cette époque que la sculpture de Jean Goujon. Il faut, au reste, qu’il y ait dans le génie français quelque penchant plus prononcé pour la sculpture ; à presque toutes les époques, il y a eu de grands sculpteurs, et cet art, si on excepte Poussin et Lesueur, a été en avant de l’autre. Quand ces deux grands peintres ont paru, il n’y avait plus de traces des grandes écoles d’Italie : je parle de celles où la naïveté s’unissait au plus grand savoir. Les grandes écoles venues soixante ou cent ans après Raphaël ne sont que des académies où l’on enseignait des recettes. Voilà les modèles que Lesueur et Poussin ont vus prévaloir de leur temps : la mode, l’usage les ont entraînés, malgré cette admiration sentie de l’antique, qui caractérise surtout les Poussin, les Legros[605] et tous les auteurs de la galerie d’Apollon.
J’aime mieux m’entretenir avec les choses qu’avec les hommes : tous les hommes sont ennuyeux ; les tics, etc. L’ouvrage vaut mieux que l’homme. Corneille était peut-être assommant ; Cousin, de même ; Poinsot, etc. Il y a dans l’ouvrage une gravité qui n’est pas dans l’homme. Le Poussin est peut-être celui qui est le plus derrière son œuvre. — Les ouvrages où il y a du travail, etc.
Lundi 1er novembre. — Faire des traités sur les arts ex professo, diviser, traiter méthodiquement, résumer, faire des systèmes pour instruire catégoriquement : erreur, temps perdu, idée fausse et inutile. L’homme le plus habile ne peut faire pour les autres que ce qu’il fait pour lui-même, c’est-à-dire noter, observer, à mesure que la nature lui offre des objets intéressants. Chez un tel homme, les points de vue changent à chaque instant. Les opinions se modifient nécessairement ; on ne connaît jamais suffisamment un maître pour en parler absolument et définitivement.
Qu’un homme de talent, qui veut fixer les pensées sur les arts, les répande à mesure qu’elles lui viennent ; qu’il ne craigne pas de se contredire ; il y aura plus de fruit à recueillir au milieu de la profusion de ses idées, même contradictoires, que dans la trame peignée, resserrée, découpée, d’un ouvrage dans lequel la forme l’aura occupé[606]… Quand le Poussin disait, dans une boutade, que Raphaël était un âne, à côté de l’antique, il savait ce qu’il disait : il ne pensait qu’à comparer le dessin, les connaissances anatomiques de l’un et des autres, et il avait beau jeu à prouver que Raphaël était ignorant à côté des anciens.
À ce compte-là, il aurait pu dire aussi que Raphaël n’en savait pas autant que lui même Poussin, mais dans une autre disposition… En présence des miracles de grâce et de naïveté unies ensemble, de science et d’instinct de composition poussés à un point où personne ne l’a égalé, Raphaël lui eût paru ce qu’il est en effet, supérieur même aux anciens, dans plusieurs parties de son art, et particulièrement dans celles qui ont été entièrement refusées au Poussin.
L’invention chez Raphaël, et j’entends par là le dessin et la couleur, est ce qu’elle peut ; non pas que j’entende dire par là qu’elle est mauvaise ; mais telle quelle est, si on la compare aux merveilles en ce genre du Titien, du Corrège, des Flamands, elle devient secondaire, et elle devait l’être ; elle eût pu l’être encore beaucoup davantage, sans distraire notablement des mérites qui mettent Raphaël non seulement au premier rang, mais au-dessus de tous les artistes, anciens et modernes, dans les parties où il excelle. J’oserais même affirmer que ces qualités seraient amoindries par une plus grande recherche dans la science anatomique ou le maniement du pinceau et de l’effet. On pourrait presque en dire autant du Poussin lui-même, eu égard aux parties dans lesquelles il est supérieur. Son dédain de la couleur, la précision un peu dure de sa touche, surtout dans les tableaux de sa meilleure manière, contribuent à augmenter l’impression de l’expression ou des caractères.
Mardi 17 novembre. — L’homme est un animal sociable qui déteste ses semblables. Expliquez cette singularité : plus il vit rapproché d’un sot être pareil à lui, plus il semble vouloir de mal à cet autre malheureux. Le ménage et ses douceurs, les amis voyageant ensemble, qui se supportaient quand ils se voyaient tous les huit jours, qui se regrettaient quand ils étaient éloignés, se prennent dans une haine mortelle, quand une circonstance les force à vivre longtemps face à face.
L’esprit volontaire et taquin qui nous fait nous préférer, nous et nos opinions, à celles de notre voisin, ne nous permet pas de supporter la contradiction et l’opposition à nos fantaisies. Si vous joignez à cette humeur naturelle celle que la maladie ou les chagrins vous donnent dans une plus grande proportion, l’aversion qu’inspire une personne à qui notre sort est lié peut devenir un véritable supplice. Les crimes auxquels on voit se porter une foule de malheureux en l’état de société, sont plus affreux que ceux que commettent les sauvages. Un Hottentot, un Iroquois fend la tête à celui qu’il veut dépouiller ; chez les anthropophages, c’est pour le manger qu’ils l’égorgent, comme nos bouchers font d’un mouton ou d’un porc. Mais ces trames perfides longtemps méditées, qui se cachent sous toutes sortes de voiles, d’amitié, de tendresse, de petits soins, ne se voient que chez les hommes civilisés.
— Aujourd’hui, à la séance de la mairie du IVe arrondissement, pour le choix des jurés.
Déjà fort indisposé, je suis rentré après avoir été un instant à l’Hôtel de ville, et ai fait tout le chemin à pied ; mais c’est une vaillantise qui ne m’a point réussi. Peut-être eussé-je été plus malade sans cela. Mais à partir de ce jour a commencé l’indisposition qui m’a fort retenu et fort donné à penser sur la sottise de vouloir se crever de travail et compromettre tout par le sot amour-propre d’arriver à temps.
Vendredi 19 novembre. — Je vois que les élégants font à Pétersbourg des cigarettes de thé vert. Elles n’ont pas du moins l’inconvénient d’être narcotiques.
Jeudi 25 novembre. — Première promenade hors des barrières avec Jenny. Excellent remède pour l’esprit et le corps. Le froid me ranime au lieu de m’être importun ou insupportable comme d’habitude. Je serais ravi de cette disposition très favorable à la santé.
Vendredi 26 novembre. — Grande promenade avec Jenny par les boulevards extérieurs, Monceau, la barrière de Courcelles et la place d’Europe, et à travers cette grande plaine où nous étions quasi perdus ; cela est excellent pour la santé.
Il faudrait sortir tous les jours avant dîner, s’habiller, voir ses amis et sortir de la poussière du travail.
Se rappeler Montesquieu, qui ne se laissait jamais gagner par la fatigue, après avoir donné à la composition un temps raisonnable. L’expérience, en rendant le travail plus facile et plus ordonné, peut conquérir cette faculté qui est refusée à la jeunesse.
Samedi 27 novembre. — Il est décidé que mes plafonds et peintures[607] vont être couverts de papier et la salle livrée au public : j’en suis enchanté. J’aurai le temps d’y revenir à loisir.
Je viens d’examiner tous les croquis qui m’ont servi à faire ce travail. Combien y en a-t-il qui m’ont grandement satisfait au commencement, et qui me paraissent faibles ou insuffisants, ou mal ordonnés, depuis que les peintures ont avancé ! Je ne puis assez me dire qu’il faut beaucoup de travail pour amener un ouvrage au degré d’impression dont il est susceptible. Plus je le reverrai, plus il gagnera du côté de l’expression… Que la touche disparaisse, que la prestesse de l’exécution ne soit plus le mérite principal, il n’y a nul doute à cela ; et encore combien de fois n’arrive-t-il pas qu’après ce travail obstiné, qui a retourné la pensée dans tous les sens, la main obéit plus vite et plus sûrement pour donner aux dernières touches la légèreté nécessaire !
28 novembre. — Adam et Ève chassés du Paradis (La chute)[608]. — Le Christ sortant du tombeau (La mort vaincue).
— Pour l’estomac : prendre du bismuth en petite dose, avec la soupe. Magnésie calcinée : une petite cuillerée avec fleur d’oranger ou sirop de gomme dans un peu d’eau, quelque temps avant le repas, deux fois par jour, s’il est possible. Bicarbonate de soude dans l’eau ou dans l’eau de Vichy, pour la renforcer.
30 novembre. — Sur la manière, à propos des peintures de l’Hôtel de ville, comparée à celle de Riesener. — Boucher, Vanloo admirés, imitateurs de Michel-Ange et de Raphaël ; même cohue.
Sans date[609]. — Penser que l’ennemi de toute peinture est le gris : la peinture paraîtra presque toujours plus grise qu’elle n’est, par sa position oblique sous le jour. — Les portraits de Rubens, ces femmes du Musée, — à la chaîne, etc., qui laissent voir partout le panneau Van Eyck, etc.
De là aussi un principe qui exclut les longues retouches, c’est d’avoir pris son parti en commençant… Il faudrait essayer, pour cela, de se contenter pleinement avec les figures peintes sans le fond ; en s’exerçant dans ce sens, il serait plus facile de subordonner ensuite le fond.
— Il faut, de toute nécessité, que la demi-teinte, dans le tableau, c’est-à-dire que tous les tons en général soient outrés. Il y a à parier que le tableau sera exposé le jour venant obliquement ; donc forcément ce qui est vrai sous un seul point de vue, c’est-à-dire le jour venant de face, sera gris et faux, sous tous les autres aspects. — Rubens outré ; Titien de même ; Véronèse quelquefois gris, parce qu’il cherche trop la vérité.
Rubens peint ses figures et fait le fond ensuite ; il le fait alors de manière à les faire valoir : il devait peindre sur des fonds blancs ; en effet, la teinte locale doit être transparente, quoique demi-teinte ; elle imite, dans le principe, la transparence du sang sous la peau.
Remarquer que toujours, dans ses ébauches, les clairs sont peints et presque achevés sur de simples frottis pour les accessoires.
À la fin de l’Agenda de 1852, se trouvent les notes ci-après :
| Le 27 décbre 1852, reçu pour les tableaux de Bordeaux. | 700 fr. | |
| Le 27 décembre 1852, reçu de Thomas, pour un Petit Tigre | 300 | |
| Le 1er février, reçu de Weill, à compte sur mon marché de 1,500 fr | 500 | |
| Le 3 mars, reçu de Thomas, à compte sur mon marché de 2,100 fr | 1.000 | |
| Le 10 mars, reçu de M. Didier, pour l’Andromède. | 600 | |
| Le 22 — de Beugniet, pour le Petit Christ, et le Lion et Sanglier. | 1.000 | |
| Le 4 avril, reçu de Weill un second à compte. | 500 | (reste 500). |
| Le 10 — de Thomas | 1.100 |
- (J’ai à lui donner les Lions sur ce marché, et en lui livrant la Desdémone dans sa chambre, il n’aura à me donner que 500 fr.).
| 10 avril, reçu de Mme Herbelin, pour les Pèlerins d’Emmaüs | 3.000 fr. | |||||||||
| 10 avril, reçu de Tedesco, pour les Chevaux qui sortent de l’eau (deux chevaux gris) | 500 | |||||||||
| 1er mai, reçu de Thomas, pour solde (sauf la répétition du Christ au tombeau) | 500 | |||||||||
| 28 juin, reçu de Tedesco, pour le Maréchal marocain | 800 | |||||||||
| ||||||||||
|
1.500 fr. | |||||||||
| ||||||||||
| J’ai reçu à compte le 1er février, en lui livrant la Vue de Tanger | 500 | |||||||||
| Depuis, il m’a demandé Saint Sébastien | 500 | |||||||||
| Répétition du plafond d’Apollon à M. Ronnet[611] | 1.000 | |||||||||
| ||||||||||
|
2.100 fr. | |||||||||
| (En avril) Desdémone dans sa chambre | 500 fr. | |||||||||
| La répétition du Christ de M. de Geloës[612] | 1.000 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
1.000 | |||||||||
| ||||||||||
|
1.000 | |||||||||
|
1.000 | |||||||||
|
1.500 fr. |
1853
2 janvier. — La couleur n’est rien, si elle n’est pas convenable au sujet, et si elle n’augmente pas l’effet du tableau par l’imagination. Que les Boucher et les Vanloo fassent des tons légers et charmants à l’œil, etc.
Lundi 10 janvier. — Halévy nous contait, à Trousseau[615] et à moi, — à ce dîner, — qu’entendant parler d’un vieillard battu par son fils, il avait trouvé dans ce prétendu vieillard un homme de cinquante à cinquante-deux ans ; mais c’était un homme qui paraissait vingt ans de plus : c’était quelque marchand de vin retiré. Ces natures brutes s’affaissent promptement, quand l’activité physique ne les soutient plus. Nous disions à ce propos que les gens qui travaillent de l’esprit se conservent mieux. Il m’arrive très souvent le matin d’être ou de me croire malade jusqu’au moment où je me mets à travailler. J’avoue qu’il se pourrait qu’un travail ennuyeux ne fît pas le même effet, mais quel est le travail qui n’attache pas l’homme qui s’y consacre ? Je disais à Trousseau que je ne ressemblais pas à ces musiciens qui disent du mal de la musique, etc. Il m’a dit qu’il aimait passionnément son métier, qui est un des plus répugnants qu’on puisse embrasser. C’est un homme de plaisir, qui doit aimer ses aises. Tous les jours, dans cette saison, son réveille-matin le fait lever et courir à son hôpital, lever des appareils, tâter le pouls, et pis encore, à des malades dégoûtants, dans un air empesté où il passe la matinée. Quand la disposition ne l’y porte guère, il est à croire que l’amour-propre le fait. Dupuytren n’y a jamais manqué, et il n’est pas probable que ce soit cette assiduité qui l’ait fait mourir prématurément. Au contraire, elle aura peut-être combattu quelque mauvaise influence, qui aura fini par le tuer.
15 janvier. — Pour le tableau espagnol dont j’ai fait une esquisse :
Teinte de petit vert, avec très peu de brun rouge et de blanc, comme teinte locale, sur un frottis de bitume par exemple ;
Ou simplement : petit vert pour l’ombre, sur lequel on met des tons de vermillon et de brun rouge.
Clairs empâtés avec rose, brun rouge, laque et blanc suivant le besoin. — La terre de Cassel et blanc ou la momie et blanc, suivant le besoin, font des tons violets suffisants : sur cette préparation, les tons dessinés avec beau rouge, laque, vermillon très chaud, et sur les saillies, clairs vifs, roses ou jaunâtres.
Pour le berger, dans le même tableau : passé sur les clairs un ton de petit vert, rendu plus foncé avec vert émeraude : ce frottis était du vert pur. Mis le ton chaud, avec vermillon et brun rouge purs.
Les clairs ajoutés ensuite, comme aux autres figures, avec tons chauds empâtés analogues, et uniformément aussi tous les endroits colorés, soit dans l’ombre, soit dans les clairs plus prononcés de rouge, comme le bout de nez, les paupières, les mains, aux articulations surtout, et principalement les doigts, les genoux. — Repiqués d’ombre de terre de Sienne brûlée et laque, avec vermillon ; et clairs sur les parties saillantes ; c’est-à-dire dessiner avec ce rouge de terre de Sienne et laque le contour des oreilles, les narines, etc., et sur les parties saillantes, telles que le bout du nez, les nœuds des mains ; la joue, clairs plus ou moins roses, qui font le luisant et le complément.
Ton vert jaune de reflet dans une chair fraîche, indispensable : Terre d’ombre naturelle, jaune de Naples, jaune de zinc brillant, vert émeraude. — Mêlé avec le ton orange transparent de la palette laque jaune, vermillon, cadmium, il donne un ton rompu charmant, analogue à celui de la partie jaune du ciel d’Apollon, et excellent dans les préparations chaudes pour les clairs.
Le ton vert chou ci-dessus fait bien à côté de vermillon, blanc et laque brûlée ; également à côté de brun rouge et blanc.
Tête de la femme sous les arbres dans l’ombre : ce qui fait le ton violâtre de l’ombre est brun rouge et blanc, et un peu de terre de Cassel plus foncé que le même ton, pour faire ce qu’il y a de plus violet dans le clair ; en un mot, sur le frottis vert, qui est commun au clair comme à l’ombre, mais avec une intensité différente, pour rendre le clair moins participant du ton vert du dessous : brun rouge et blanc. Dans l’ombre sur ce ton vert, pour donner un ton rose, le ton que j’ai dit de brun rouge, blanc et terre de Cassel ; ce ton mêlé à celui de terre d’ombre naturelle, bleu de Prusse et blanc, fait admirablement. Ce mélange du vert et du violet, qui caractérise le passage de l’ombre au clair, dans certaines parties, la joue, les jambes couleur de poisson, etc., etc. Pour faire ce ton d’ombre, quand il est plus jaune sur les parties jaunâtres, mettre le ton de terre d’ombre naturelle, bleu de Prusse et un peu d’ocre jaune, mêlé à plus ou moins de brun rouge et blanc. Le ton de bleu de Prusse, terre naturelle et blanc, magnifique ton d’ombre violette, en y mêlant du vermillon (employé, je crois, si je m’en souviens, entre les jambes de la petite Ariane assise — la seconde) — terre d’ombre et cobalt, au lieu de bleu de Prusse, ferait peut-être aussi bien et serait plus solide ; — ce ton passé sur les parties rouge prononcé qu’on met sur les genoux, etc. — Dans le ton vert, dans l’ombre de l’Espagnol en question, surtout de l’enfant vu de dos sous l’arbre ; — sur ces tons verdâtres, atténuer aussi avec brun rouge, blanc et noir.
Le ton de terre d’ombre naturelle excellent, avec bleu de Prusse, pour les ombres légères verdâtres qui bordent les cheveux, le cou, la partie jaune du bras, du dos, etc. Exemple : Genoux de l’Andromède (vérifier si je n’ai pas voulu dire l’Ariane). — Bord d’ombre des jambes.
Pour faire une ombre moins fade qu’avec le petit vert, quand elle est un accident et non une teinte à plat, la préparer avec terre d’ombre, cobalt, et vert émeraude, et ensuite vermillon. — Entre-deux des jambes : pour ne pas le faire trop rouge, préparer avec terre d’ombre, vert émeraude, cobalt, et passer le vermillon par-dessus ; et, mieux que vermillon, brun rouge qui fait moins ardent ; ce ton est le plus sanguine possible pour une ombre intense, réunissant merveilleusement le vert et le violet ; mais il est indispensable de passer l’un après l’autre, et non pas de les mêler sur la palette. Le ton de terre d’ombre naturelle, blanc et bleu de Prusse foncé avec brun rouge, magnifique ton d’ombre de chair vigoureuse. Les mettre à côté l’un de l’autre sur la palette ; — fait également une demi-teinte locale de chair. — Le vert chou jaune : terre d’ombre naturelle, jaune de Naples, jaune de zinc, vert émeraude, avec brun rouge et blanc, très belle localité de chair (jambe de Talma).
Ton jaune vert, qui règne dans la copie du plafond d’Apollon, le ton clair de terre d’ombre naturelle, bleu de Prusse et blanc avec ocre jaune. — Excellent frottis pour préparer des chairs fraîches comme la cuisse de Junon et son pied : Ton orangé de laque jaune, vermillon, cadmium avec laque rouge et blanc, mais assez foncé, pour faire une opposition prononcée ; les mettre à côté l’un de l’autre. Jaune de zinc et noir plus ou moins foncé : beau vert rompu.
Tons très fins, analogues du ton jaune du ciel de l’Apollon, propres à placer sur une chair dans le clair comme préparation d’un ton d’ombre, vert chou et le ton orangé transparent.
Autre : Sienne naturelle, vert émeraude, jaune de zinc. Fait ainsi, il est un peu chaud et cru ; on le tempère avec le vert chou.
Ton gris violet très joli : Vert chou avec laque et blanc foncé.
Ton d’or clair : Ocre jaune, jaune de Naples. Autre demi-teinte plaquée d’or : Terre d’Italie seule (fauteuil de Talma).
Ton important de laque rouge et blanc foncé, à côté du même ton dans lequel on ajoute de la laque brûlée ; mettre l’un et l’autre à côté de jaune indien.
— Ton de jaune indien, Sienne et vert émeraude : opposition toute prête du jaune et du vert au violet.
Laque jaune et jaune de zinc, important.
Main gauche de Talma : Préparée avec des tons très roux et non encore rompus. Sur cette préparation, sèche depuis quelque temps, passé une demi-pâte très transparente avec brun rouge et blanc, et terre d’ombre naturelle, bleu de Prusse et blanc… a donné tout de suite une demi-teinte de chair d’une grande finesse. Les ombres chaudes étant placées et les saillies du clair avec des tons convenables, l’effet était complet. (Pourrait s’appliquer avec succès à toute préparation faite à la Titien avec ton de Sienne ou brun rouge, etc., comme, par exemple, était celle de la petite Andromède.)
Localité de la main appuyée par terre de la femme qui essuie le sang de saint Étienne : ton demi-teinte de terre de Cassel, blanc avec vermillon et laque. Le moindre ton vert {cobalt et émeraude, par exemple) et orangé donne un brillant magnifique, au-dessus peut-être de celui du Sardanapale, qui était analogue, à cause des tons verts ajoutés.
Coulé pour la chair — très fin : le ton de laque jaune et jaune de zinc avec laque rouge dorée.
Le charmant jaune paille (demi-teinte) : Ocre jaune, terre de Cassel, blanc avec pointe de vert émeraude et zinc, et peut être sali avec pointe de laque rouge. A côté de beau vermillon et laque rouge, — mêlés ensemble modérément : tons sanguine très beaux.
Autre ton sanguine plus verdâtre : bon coulé, préparation, etc. A côté du ton beau vermillon clair et laque, ton d’ocre jaune et petit vert. — Ces tons très fins seraient d’ailleurs glacés (non essayé) pour remonter du ton des chairs déjà avancées, mais un peu trop blanches.
Beau brun : jaune de Mars et brun de Florence ; mettre à côté de la masse des tons verts verdâtres, vert chaud, vert chou, et le ton de terre de Cassel, blanc et laque.
Ton bois violâtre : brun de Florence, blanc avec ocre de ru et une pointe de noir ou autre, pour salir un peu.
— Demi-teinte de cheveux blonds : jaune paille un peu sombre avec brun rouge et blanc sombre ; aussi ajouter jaune indien ou ton de terre de Sienne et vert émeraude. Ajouter laque et vermillon clair au ton orangé transparent.
— Beau brun jaune vert : Vert émeraude, terre d’Italie naturelle ; en y ajoutant du vermillon, il devient sanguine, sans être rouge.
Vermillon, laque brûlée, blanc, à côté de celui-ci, qui est un peu foncé ; faire le même plus clair, mais avec très peu de laque brûlée et plus de laque et vermillon.
Avec ce dernier et vert émeraude, est fait le ton des montagnes les plus lointaines dans le Saint Sébastien.
Le clair du chemin et des montagnes plus rapprochées avec le petit vert et l’orangé de cadmium, blanc et vermillon.
Brun de Florence et blanc mêlé à l’orangé de zinc ; les mettre à côté l’un de l’autre.
Jeudi 27 janvier. — Dîné chez Bixio avec d’Argent, Decazes, le prince Napoléon. Après, chez Manceau.
De tout cela, je ne me rappelle que deux ou trois morceaux de la Flûte enchantée, dont nous a régalés Mme Manceau.
Je n’éprouve pas, à beaucoup près, pour écrire, la même difficulté que je trouve à faire mes tableaux[616]. Pour arriver à me satisfaire, en rédigeant quoi que ce soit, il me faut beaucoup moins de combinaisons de composition, que pour me satisfaire pleinement en peinture. Nous passons notre vie à exercer, à notre insu, l’art d’exprimer nos idées au moyen de la parole. L’homme qui médite dans sa tête comment il s’y prendra pour obtenir une grâce, pour éconduire un ennuyeux, pour attendrir une belle ingrate, travaille à la littérature sans s’en douter. Il faut tous les jours écrire des lettres qui demandent toute notre attention et d’où quelquefois notre sort peut dépendre.
Telles sont les raisons pour lesquelles un homme supérieur écrit toujours bien, surtout quand il traitera de choses qu’il connaît bien. Voilà pourquoi les femmes écrivent aussi bien que les plus grands hommes. C’est le seul art qui soit exercé par les indifférentes… Il faut ruser, séduire, attendrir, congédier, en arrivant et en partant. Leur faculté d’à-propos, la lucidité, extrême dans certains cas, trouvent ici merveilleusement leur application. Au reste, ce qui confirme tout cela, c’est que, comme elles ne brillent pas par une grande puissance d’imagination, c’est surtout dans l’expression des riens qu’elles sont maîtresses passées. Une lettre, un billet, qui n’exige pas un long travail de composition, est leur triomphe.
Lundi 7 février. — Aujourd’hui, l’insipide et indécente cohue de la fête du Sénat. Aucun ordre, tout le monde pêle-mêle, et dix fois plus d’invités que le local n’en peut contenir. Obligé d’arriver à pied et d’aller de même retrouver la voiture à Saint-Sulpice… Que de gueux ! que de coquins s’applaudissent dans leurs habits brodés ! Quelle bassesse générale dans cet empressement !
Vendredi 4 mars.
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.
Mardi 15 mars. — Je retrouve sur un chiffon de
papier les lignes suivantes que j’ai écrites il y a longtemps ;
j’étais alors plus misanthrope que je ne suis.
J’avais plus de raisons d’être heureux, puisque j’étais
plus jeune. Je ne laissais pas d’être attristé du spectacle
auquel nous assistons et dont nous sommes
nous-mêmes les acteurs et les victimes.
Voici la boutade : « Comment ce monde si beau renferme-t-il tant d’horreurs ! Je vois la lune planer paisiblement sur des habitations plongées, en apparence, dans le silence et dans le calme… les astres semblent se pencher dans le ciel sur ces demeures paisibles, mais les passions qui les habitent, les vices et les crimes ne sont qu’endormis ou veillent dans l’ombre et préparent des armes ; au lieu de s’unir contre les horribles maux de la vie mortelle, dans une paix commune et fraternelle, les hommes sont des tigres et des loups animés les uns contre les autres pour s’entre-détruire. Les uns laissent un libre cours aux détestables emportements qu’ils ne peuvent maîtriser : ce sont les moins dangereux. Les autres renferment, comme dans des abîmes sans fond, les noirceurs, la bile amère qui les anime contre tout ce qui porte le nom d’homme. Tous ces visages sont des masques, ces mains empressées qui serrent votre main sont des griffes acérées prêtes à s’enfoncer dans votre cœur. À travers cette horde de créatures hideuses, apparaissent des natures nobles et généreuses. Les rares mortels qui ne semblent laissés à la terre que pour témoigner du fabuleux âge d’or, sont les victimes privilégiées de cette multitude de traîtres et de scélérats qui les entourent et les pressent. Le sort s’unit aux passions de mille monstres pour conspirer la perte de ces hommes innocents, et presque tous rendent à ce ciel ingrat une détestable vie, en maudissant un présent si funeste, et presque également leur inutile vertu, but des attaques et des haines, fardeau volontaire, et qu’ils n’ont traîné que pour leur malheur, à travers mille maux. »
Vendredi 18 mars. — Vu, après le conseil, l’admirable Saint Just[617] de Rubens. Le lendemain, en essayant de me le rappeler, au moyen d’une esquisse d’après la gravure, j’ai pu m’assurer que l’emploi du pinceau, au lieu de la brosse, a déterminé l’exécution lisse et plus achevée, c’est-à-dire sans plans heurtés, de Rubens. Ce mode mène à une exécution plus ronde, comme est la sienne, mais qui, en même temps, donne plus vite l’expression du fini. D’ailleurs, l’emploi des panneaux force pour ainsi dire à se servir de pinceaux. La touche lisse et un peu molle laisse moins d’aspérités. Avec les martres et les brosses ordinaires, on arrive à une dureté, à une difficulté de fondre les couleurs qui est presque inévitable ; les traces de la brosse laissent des sillons impossibles à dissimuler.
Dimanche 27 mars. — Aux partisans exclusifs de la forme et du contour.
Les sculpteurs vous sont supérieurs… En établissant la forme, ils remplissent toutes les conditions de leur art. Ils recherchent également, comme les partisans du contour, la noblesse des formes et de l’arrangement. Vous ne modelez pas, puisque vous méconnaissez le clair-obscur qui ne vit que des rapports de la lumière et de l’ombre établis avec justesse. Avec vos ciels couleur d’ardoise, avec vos chairs mates et sans effet, vous ne pouvez produire la saillie. Quant à la couleur qui est partie de la peinture, vous faites semblant de la mépriser, et pour cause…
Lundi 28 mars. — A Irène :
« Je suis le premier puni de mon horrible paresse à écrire, puisqu’elle me prive de recevoir souvent de vos nouvelles et de renouveler, en m’entretenant avec vous, le charme des souvenirs d’enfance. Je suis en cela d’autant plus coupable et ennemi de moi-même, qu’isolé comme je suis, je vis bien plus souvent dans mon esprit avec le passé qu’avec ce qui m’entoure. Je n’ai nulle sympathie pour le temps présent ; les idées qui passionnent mes contemporains me laissent absolument froid ; mes souvenirs et toutes mes prédilections sont pour le passé, et toutes mes études se tournent vers les chefs-d’œuvre des siècles écoulés. Il est heureux, au moins, qu’avec ces dispositions, je n’aie jamais songé au mariage : j’aurais certainement paru à une femme jeune et aimable infiniment plus ours et plus misanthrope que je ne le parais à ceux qui ne me voient qu’en passant. »
A Andrieu :
« Je n’ai pas autant de mérite qu’on pourrait le penser, à travailler beaucoup, car c’est la plus grande récréation que je puisse me donner… J’oublie, à mon chevalet, les ennuis et les soucis qui sont le lot de tout le monde. L’essentiel dans ce monde est de combattre l’ennui et le chagrin. Sans doute, parmi les distractions qu’on peut prendre, je pense que celui qui les trouve dans un objet comme la peinture, doit y trouver des charmes que ne présentent point les amusements ordinaires. Ils consistent surtout dans le souvenir que nous laissent, après le travail, les moments que nous lui avons consacrés. Dans les distractions vulgaires, le souvenir n’est pas ordinairement la partie la plus agréable ; on en conserve plus souvent du regret, et quelquefois pis encore. Travaillez donc le plus que vous pourrez : c’est toute la philosophie et la bonne manière d’arranger sa vie[618]. »
1er avril. — J’ai usé pour la première fois de mes entrées aux Italiens… Chose étrange ! j’ai eu toutes les peines du monde à m’y décider ; une fois que j’y ai été, j’y ai pris grand plaisir ; seulement j’y ai rencontré trois personnes, et ces trois personnes mont demandé à venir me voir. L’une est Lasteyrie[619], qui veut bien m’apporter son livre sur les vitraux ; la seconde est Delécluze[620], qui m’a frappé sur l’épaule avec une amabilité qu’on n’attendrait guère d’un homme qui m’a peu flatté, la plume à la main, depuis environ trente ans qu’il m’immole à chaque Salon. Le troisième personnage qui m’a demandé à venir me voir est un jeune homme que je me rappelle avoir vu, sans savoir où et sans connaître son nom ; cette distraction est fréquente chez moi.
Le souvenir de cette délicieuse musique (Sémiramis)[621] me remplit d’aise et de douces pensées, le lendemain 1er avril. Il ne me reste dans l’âme et dans la pensée que les impressions du sublime, qui abonde dans cet ouvrage. A la scène, le remplissage, les fins prévues, les habitudes de talent du maître refroidissent l’impression, mais ma mémoire, quand je suis loin des acteurs et du théâtre, fond dans un ensemble le caractère général, et quelques passages divins viennent me transporter et me rappellent en même temps celui de la jeunesse écoulée.
L’autre jour, Rivet[622] vint me voir, et, en regardant la petite Desdémone aux pieds de son père[623], il ne put s’empêcher de fredonner le Se il padre m’abbandonna, et les larmes lui vinrent aux yeux. C’était notre beau temps ensemble. Je ne le valais pas, au moins pour la tendresse et pour bien d’autres choses, et combien je regrette de n’avoir pas cultivé cette amitié pure et désintéressée ! Il me voit encore, et, je n’en doute pas, avec plaisir ; mais trop de choses et trop de temps nous ont séparés. Il me disait, il y a peu d’années, en se rappelant cette époque de Mantes et de notre intimité : « Je vous aimais comme on aime une maîtresse. »
Il y a aux Italiens, qui jouent maintenant dans le désert, une Cruvelli[624] dont on parle très peu dans le monde et qui est un talent très supérieur à la Grisi, qui enchantait tout le monde quand les Bouffes étaient à la mode.
Une chose dont on ne s’est pas douté, à l’apparition de Rossini, et pour laquelle on a oublié de le critiquer, parmi tant de critiques, c’est à quel point il est romantique. Il rompt avec les formules anciennes illustrées jusqu’à lui par les plus grands exemples. On ne trouve que chez lui ces introductions pathétiques, ces passages souvent très rapides, mais qui résument, pour l’âme, toute une situation, et en dehors de toutes les conventions. C’est même une partie, et la seule, dans son talent, qui soit à l’abri de l’imitation. Ce n’est pas un coloriste à la Rubens. J’entends toujours parler de ces passages mystérieux. Il est plus cru ou plus banal dans le reste, et, sous ce rapport, il ressemble au Flamand ; mais partout la grâce italienne, et même l’abus de cette grâce.
Dimanche 3 avril. — Retourné aux Italiens : le Barbier. Tous ces motifs charmants, ceux de la Sémirarnis et du Barbier sont continuellement avec moi.
Je travaille à finir mes tableaux pour le Salon, et tous ces petits tableaux qu’on me demande. Jamais il n’y a eu autant d’empressement. Il semble que mes peintures sont une nouveauté découverte récemment[625].
Lundi 4 avril. — Vu le soir Mme de Rubempré dans sa nouvelle maison. J’ai été enchanté de l’habitation : il y aura de quoi s’y plaire. J’en suis heureux pour cette bonne amie. Elle raffole des curiosités, des ameublements, et elle se trouve servie à souhait. Elle me faisait, ou plutôt nous faisions ensemble, cette réflexion : que tout le bonheur vient tard. C’est comme ma petite vogue auprès des amateurs ; ils vont m’enrichir après m’avoir méprisé.
Vendredi 8 avril. — Sorti d’assez bonne heure pour aller voir les artistes qui m’avaient prié de les visiter. Que de tristes plaies, que d’incurables maladies de cerveau ! Je n’ai eu qu’une compensation, mais elle a été complète : j’ai vu un véritable chef-d’œuvre : c’est le portrait que Rodakowski[626] vient de rapporter d’après sa mère. Cet ouvrage confirme le précédent qui m’avait tant frappé à l’Exposition.
Rentré très fatigué, et, après un sommeil presque léthargique et insurmontable, reposé tout à fait, et dîné avec Mme de Forget. Nous avons été voir les Cerfbeer aussitôt après, et promené un peu sur les boulevards.
Mardi 12 avril. — Dîné chez Riesener avec Gautier[627], qui a été aimable ; il me boudait depuis quelque temps.
J’ai été voir en revenant le dernier acte de Sémiramis.
Dans la journée, Mme Villot, Mme Barbier et Mme Herbelin sont venues voir mes tableaux. Cette dernière s’est affolée des Pèlerins d’Emmaüs[628], et veut l’avoir au prix que j’avais demandé.
Mercredi 13 avril. — Il faut toujours gâter un peu un tableau pour le finir. Les dernières touches destinées à mettre de l’accord entre les parties ôtent de la fraîcheur. Il faut paraître devant le public en retranchant toutes les heureuses négligences qui sont la passion de l’artiste. Je compare ces retouches assassines à ces ritournelles banales qui terminent tous les airs et à ces espaces insignifiants que le musicien est forcé de placer entre les parties intéressantes de son ouvrage, pour conduire d’un motif à l’autre ou les faire valoir. Les retouches pourtant ne sont pas aussi funestes au tableau qu’on pourrait croire, quand le tableau est bien pensé et a été fait avec un sentiment profond. Le temps redonne à l’ouvrage, en effaçant les touches, aussi bien les premières que les dernières, son ensemble définitif.
Jeudi 14 avril. — Dîné chez M. Fould[629]. Le Moniteur[630] a envie d’avoir de ma prose : cela tombe mal au milieu de mes occupations.
Été chez R… finir la soirée pour entendre la répétition et le choix que Delsarte fait des morceaux de son concert. Cette éternelle musique primitive, sans interruption, est bien monotone ; un air de Cherubini risqué au milieu de tout cela m’a paru un foudre d’invention.
Vendredi 15 avril. — Le préfet nous dit ce matin à notre comité, où on débattait une question de cimetière, qu’à propos de l’insuffisance des cimetières de Paris il existait un projet d’un sieur Lamarre ou Delamarre, qui proposait sérieusement d’envoyer les morts en Sologne, ce qui aurait l’avantage de nous en débarrasser et de fortifier le terrain.
J’avais été, avant la séance, voir les peintures de Courbet[631]. J’ai été étonné de la vigueur et de la saillie de son principal tableau[632] ; mais quel tableau ! quel sujet ! La vulgarité des formes ne ferait rien ; c’est la vulgarité et l’inutilité de la pensée qui sont abominables ; et même, au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle, était claire ! Que veulent ces deux figures ? Une grosse bourgeoise, vue par le dos et toute nue sauf un lambeau de torchon négligemment peint qui couvre le bas des fesses, sort d’une petite nappe d’eau qui ne semble pas assez profonde seulement pour un bain de pieds. Elle fait un geste qui n’exprime rien, et une autre femme, que l’on suppose sa servante, est assise par terre, occupée à se déchausser. On voit là des bas qu’on vient de tirer : l’un d’eux, je crois, ne l’est qu’à moitié. Il y a entre ces deux figures un échange de pensées qu’on ne peut comprendre. Le paysage est d’une vigueur extraordinaire, mais il n’a fait autre chose que mettre en grand une étude que l’on voit là près de sa toile ; il en résulte que les figures y ont été mises ensuite et sans lien avec ce qui les entoure. Ceci se rattache à la question de l’accord des accessoires avec l’objet principal, qui manque à la plupart des grands peintres. Ce n’est pas la plus grande faute de Courbet. Il y a aussi une Fileuse[633] endormie, qui présente les mêmes qualités de vigueur, en même temps que d’imitation… Le rouet, la quenouille, admirables ; la robe, le fauteuil, lourds et sans grâce. Les Deux Lutteurs montrent le défaut d’action et confirment l’impuissance dans l’invention. Le fond tue les figures, et il faudrait en ôter plus de trois pieds tout autour.
O Rossini ! O Mozart ! O les génies inspirés dans tous les arts, qui tirent des choses seulement ce qu’il faut en montrer à l’esprit ! Que diriez-vous devant ces tableaux ? Oh ! Sémiramis !… Oh ! entrée des prêtres, pour couronner Ninias !
Samedi 16 avril. — Dans la matinée, on m’a amené Millet[634]… Il parle de Michel-Ange et de la Bible, qui est, dit-il, le seul livre qu’il lise ou à peu près. Cela explique la tournure un peu ambitieuse de ses paysans. Au reste, il est paysan lui-même et s’en vante. Il est bien de la pléiade ou de l’escouade des artistes à barbe qui ont fait la révolution de 1848, ou qui y ont applaudi, croyant apparemment qu’il y aurait l’égalité des talents, comme celle des fortunes. Millet me paraît cependant au-dessus de ce niveau comme homme, et, dans le petit nombre de ses ouvrages, peu variés entre eux, que j’ai pu voir, on trouve un sentiment profond, mais prétentieux, qui se débat dans une exécution ou sèche ou confuse.
Dîné chez le préfet avec les artistes qui ont peint à l’Hôtel de ville récemment et tutti quanti. Germain Thibaut[635] qui était là, je ne sais pourquoi, me parlait à table de peinture, et me disait qu’il n’avait jamais pu comprendre la peinture de Decamps[636] : il est parti de là pour faire, au contraire, un éloge magnifique de la Stratonice, d’Ingres.
Ensuite chez Mme Barbier. Riesener retournait prendre sa femme, et nous avons été à pied. M. Bourée, l’ancien consul à Tanger, me disait que les Yacoubs, quand ils se font mordre par les serpents, lesquels sont venimeux, à ce qu’il m’a affirmé, appliquent vivement sur leur bras, par exemple, la gueule ouverte du serpent, de manière à aplatir les crochets qui contiennent le poison. J’aime mieux croire qu’ils ne risquent pas à ce point de devenir victimes d’une maladresse, et que ces serpents sont moins venimeux qu’on ne le suppose.
J’ai travaillé toute la journée aux habits du portrait de M. Bruyas. J’aurai une séance demain, qui, j’espère, sera la dernière.
Dimanche 17 avril. — Sur l’École anglaise[637] d’il y a trente ans : Lawrence, Wilkie. — Les Mille et une Nuits, Reynolds, Gainsborough.
Sur Oudry[638] et les Discours de Reynolds[639] à l’occasion : sa prédilection pour les dessinateurs. — Lettres du Poussin.
Sur la différence de l’ébauche et de l’esquisse avec l’objet fini ; sur l’effet en général de ce qui n’est pas complet et du manque de proportions pour contribuer à agrandir.
Lundi 18 avril. — Le jour des opérations du jury. J’ai vu, après le jury, ce pauvre Vieillard ; il était au lit. Je le trouve bien affaibli et j’ai beaucoup de craintes. Quand je l’ai quitté, il m’a serré fortement la main et m’a accompagné d’un regard comme je ne lui en ai jamais vu.
Mercredi 20 avril. — Après la journée fatigante du jury, qui est la troisième, et réveillé à grand’peine d’un terrible sommeil après mon dîner, je suis parti vers dix heures pour aller chez Fortoul[640], que j’ai trouvé au moment où son salon se vidait, et quoiqu’il fût alors près de onze heures, je n’ai pas hésité à aller voir la princesse Marcellini.
Je suis arrivé à temps pour avoir encore un peu de musique. Mme Potocka y était, et assez à son avantage. En revenant avec Grzymala, nous avons parlé de Chopin. Il me contait que ses improvisations étaient beaucoup plus hardies que ses compositions achevées. Il en était pour cela, sans doute, comme de l’esquisse du tableau comparée au tableau fini. Non, on ne gâte pas le tableau en le finissant ! Peut-être y a-t-il moins de carrière pour l’imagination dans un ouvrage fini que dans un ouvrage ébauché. On éprouve des impressions différentes devant un édifice qui s’élève et dont les détails ne sont pas encore indiqués, et devant le même édifice quand il a reçu son complément d’ornements et de fini. Il en est de même d’une ruine qui acquiert quelque chose de plus frappant par les parties qui manquent. Les détails en sont effacés ou mutilés, de même que dans le bâtiment qui s’élève on ne voit encore que les rudiments et l’indication vague des moulures et des parties ornées. L’édifice achevé enferme l’imagination dans un cercle et lui défend d’aller au delà. Peut-être que l’ébauche d’un ouvrage ne plaît tant que parce que chacun l’achève à son gré. Les artistes doués d’un sentiment très marqué, en regardant et en admirant même un bel ouvrage, le critiquent non seulement dans les défauts qui s’y trouvent réellement, mais par rapport à la différence qu’il présente avec leur propre sentiment. Quand le Corrège dit le fameux : Anch’io son’pittore, il voulait dire : « Voilà un bel ouvrage, mais j’y aurais mis quelque chose qui n’y est pas. » L’artiste ne gâte donc pas le tableau en le finissant ; seulement, en fermant la porte à l’interprétation, en renonçant au vague de l’esquisse, il se montre davantage dans sa personnalité, en dévoilant ainsi toute la portée, mais aussi les bornes de son talent.
Jeudi 21 avril. — à la vente de Decamps[641]… J’ai éprouvé une profonde impression à la vue de plusieurs ouvrages ou ébauches de lui qui m’ont donné de son talent une opinion supérieure à celle que j’avais. Le dessin du Christ dans le prétoire, le Job, la petite Pêche miraculeuse, des paysages, etc. Quand on prend une plume pour décrire des objets aussi expressifs, on sent nettement, à l’impuissance d’en donner une idée de cette manière, les limites qui forment le domaine des arts entre eux. C’est une espèce de mauvaise humeur contre soi-même de ne pouvoir fixer ses souvenirs, lesquels pourtant sont aussi vivaces dans l’esprit après cette imparfaite description que l’on fait à l’aide des mots. Je n’en dirai donc pas davantage, sinon qu’à cette exposition, comme le soir au concert de Delsarte, j’ai éprouvé, pour la millième fois, qu’il faut, dans les arts, se contenter, dans les ouvrages même les meilleurs, de quelques lueurs, qui sont les moments où l’artiste a été inspiré.
Le Josué, de Decamps, m’a déplu au premier abord, et quand je le regardais de près, c’était une mêlée confuse et des indications de formes lâches et tortillées ; à distance, j’ai compris ce qui faisait beauté dans ce tableau : la distribution des groupes et de la lumière touche au sublime.
Le soir, dans le trio de Mozart, pour alto, piano et clarinette, j’ai senti délicieusement quelques passages, et le reste m’a paru monotone. En disant que des ouvrages comme ceux-là ne peuvent donner que quelques moments de plaisir, je n’entends pas du tout que ce soit toujours la faute de l’ouvrage, et, quant à ce qui concerne Mozart, je suis persuadé que c’était de la mienne. D’abord, certaines formes ont vieilli, été ressassées et gâtées par tous les musiciens qui sont venus après lui, première condition pour nuire à la fraîcheur de l’ouvrage. Il faut même s’étonner que certaines parties soient restées aussi délicieuses après tant de temps (le temps marche vite pour les modes dans les arts), et après tant de musique bonne ou mauvaise calquée sur ce type enchanteur. Il y a une autre raison pour qu’une création de Mozart saisisse moins par cette abrupte nouveauté que nous trouvons aujourd’hui à Beethoven ou à Weber : premièrement, c’est qu’ils sont de notre temps, et en second lieu, c’est qu’ils n’ont pas la perfection de l’illustre devancier. C’est exactement le même effet que celui dont je parlais à la page précédente : c’est celui que produit l’ébauche comparée à un ouvrage fini, de la ruine d’un monument ou de ses premiers rudiments, au monument terminé. Mozart est supérieur à tous par sa forme achevée. Les beautés comme celles de Racine ne brillent point par le voisinage de traits de mauvais goût ou d’effets manqués ; l’infériorité apparente de ces deux hommes les consacre pourtant à jamais dans l’admiration des hommes, et les élève à une hauteur où il est le plus rare d’atteindre.
Après ces ouvrages, ou à côté si l’on veut, sont ceux qui réellement offrent des négligences considérables ou des défauts qui les déparent peut-être, mais ne nuisent à la sensation qu’à proportion du plus ou moins de supériorité des parties réunies ; Rubens est plein de ces négligences ou choses hâtées. La sublime Flagellation d’Anvers, avec ses bourreaux ridicules ; le Martyre de saint Pierre, de Cologne, où on trouve le même inconvénient, c’est-à-dire la figure principale admirable et toutes les autres mauvaises. Rossini est un peu de cette famille.
Après la nouveauté qui fait souvent tout accepter d’un artiste, ainsi qu’on l’a fait avec lui, après le temps de lassitude et de réaction où l’on ne voit presque que ses taches, arrive celui où la distance consacre les beautés et rend le spectateur indifférent aux imperfections. C’est ce que j’ai éprouvé avec Sémiramis.
26 avril. — Je disais hier à R…, au bal des Tuileries, à propos du mariage d’un auguste personnage, que l’un des plus grands inconvénients du caractère français, celui qui a plus contribué peut-être que quoi que ce soit aux catastrophes et déconfitures dont notre histoire abonde, c’est l’absence, chez toutes les têtes, du sentiment du devoir. Il n’y a pas un homme ici qui soit exact à un rendez-vous, qui se regarde comme lié absolument par une promesse ; de là, cette élasticité de la conscience dans une foule de cas. L’imagination place l’obligation dans ce qui nous plaît ou nous porte intérêt. Chez la race anglaise, au contraire, qui n’a pas au même degré cette force d’impulsion qui entraîne à tout moment, la nécessité du devoir est sentie par tout le monde. Nelson, à Trafalgar, au lieu de parler à ses matelots de la gloire et de la postérité, leur dit simplement dans sa proclamation : « L’Angleterre compte que chaque homme fera son devoir. »
En sortant de chez Boilay, ce soir à minuit et demi, je cours jusqu’aux Italiens pour trouver une glace, car tous les cafés étaient fermés. J’en trouve au café du Passage de l’Opéra, sur le boulevard. J’y vois M. Chevandier[642], qui m’accompagne chez moi ; il me raconte, entre autres particularités sur Decamps, d’abord son impossibilité de travailler d’après le modèle dans ses tableaux ; en second lieu, ce qui me paraît la conséquence de cette disposition, sa timidité extrême, quand il travaille d’après nature. L’indépendance de l’imagination doit être entière devant le tableau. Le modèle vivant, en comparaison de celui que vous avez créé et mis en harmonie avec le reste de votre composition, déroute l’esprit et introduit un élément étranger dans l’ensemble du tableau.
Mercredi 27 avril. — Dîné chez la princesse Marcellini avec Grzimala. Délicieux trio de Weber, qui a malheureusement précédé un trio de Mozart : il fallait intervertir cet ordre. J’avais une grande envie de dormir, qui a été tenue en respect par le premier morceau ; mais je n’ai pas pu tenir devant le second. La forme de Mozart, moins imprévue et, j’ose le dire, plus parfaite, mais surtout moins moderne, a vaincu mon attention, et la digestion a triomphé.
Jeudi matin 28 avril. — Il faut une foule de sacrifices pour faire valoir la peinture, et je crois en faire beaucoup, mais je ne puis souffrir que l’artiste le montre. Il y a pourtant de fort belles choses qui sont conçues dans le sens outré de l’effet : tels sont les ouvrages de Rembrandt, et chez nous, Decamps. Cette exagération leur est naturelle et ne choque point chez eux. Je fais cette réflexion en regardant mon portrait de M. Bruyas[643] ; Rembrandt n’aurait montré que la tête ; les mains eussent été à peine indiquées, ainsi que les habits. Sans dire que je préfère la méthode qui laisse voir tous les objets suivant leur importance, puisque j’admire excessivement les Rembrandt, je sens que je serais gauche en essayant, ces effets. Je suis en cela du parti des Italiens. Paul Véronèse est le nec plus ultra du rendu, dans toutes les parties ; Rubens est de même, il a peut-être dans les sujets pathétiques cet avantage sur le glorieux Paolo, qu’il sait, au moyen de certaines exagérations, attirer l’attention sur l’objet principal, et augmenter la force de l’expression. En revanche, il y a dans cette manière quelque chose d’artificiel qui se sent autant et peut-être plus que les sacrifices de Rembrandt, et que le vague qu’il répand d’une manière marquée sur les parties secondaires. Ni l’un ni l’autre ne me satisfait, quant à ce qui me regarde. Je voudrais, — et je crois le rencontrer souvent, — que l’artifice ne se sentît point, et que néanmoins l’intérêt soit marqué comme il convient ; ce qui, encore une fois, ne peut s’obtenir que par des sacrifices ; mais il les faut infiniment plus délicats que dans la manière de Rembrandt, pour répondre à mon désir.
Mon souvenir ne me présente pas dans ce moment, parmi les grands peintres, un modèle parfait de cette perfection que je demande. Le Poussin ne l’a jamais cherchée et ne la désire pas ; ses figures sont plantées à côté les unes des autres comme des statues ; cela vient-il de l’habitude qu’il avait, dit-on, de faire de petites maquettes pour avoir des ombres justes ? S’il obtient ce dernier avantage, je lui en sais moins de gré que s’il eût mis un rapport plus lié entre ses personnages, avec moins d’exactitude dans l’observation de l’effet. Paul Véronèse est infiniment plus harmonieux (et je ne parle ici que de l’effet), mais son intérêt est dispersé. D’ailleurs, la nature de ses compositions, qui sont très souvent des conversations, des sujets épisodiques, exige moins cette concentration de l’intérêt. Ses effets, dans ses tableaux où le nombre des personnages est plus circonscrit, ont quelque chose de banal et de convenu. Il distribue la lumière d’une manière à peu près uniforme, et, à ce sujet, on peut chez lui, comme chez Rubens et chez beaucoup de grands peintres, remarquer cette répétition outrée de certaines habitudes d’exécution. Ils y ont été conduits sans doute par la grande quantité de commandes qui leur étaient faites ; ils étaient beaucoup plus ouvriers que nous ne croyons, et ils se considéraient comme tels. Les peintres du quinzième siècle peignaient les selles, les bannières, les boucliers, comme des vitriers. Cette dernière profession était confondue avec celle du peintre, comme elle l’est aujourd’hui avec celle des peintres en bâtiment.
C’est une gloire pour les deux grands peintres français, Poussin et Lesueur, d’avoir cherché, avec succès, à sortir de cette banalité. Sous ce rapport, non seulement ils rappellent la naïveté des écoles primitives de Flandre et d’Italie, chez lesquelles la franchise de l’expression n’est gâtée par aucune habitude d’exécution, mais encore ils ont ouvert dans l’avenir une carrière toute nouvelle. Bien qu’ils aient été suivis immédiatement par des écoles de décadence, chez lesquelles l’empire de l’habitude, celle surtout d’aller étudier en Italie les maîtres contemporains, ne tarda pas à arrêter cet élan vers l’étude du vrai, ces deux grands maîtres préparent les voies aux écoles modernes, qui ont rompu avec la convention, et cherché, à la source même, les effets qu’il est donné à la peinture de produire sur l’imagination. Si ces mêmes écoles qui sont venues ensuite n’ont pas exactement suivi les pas de ces grands hommes, elles ont du moins trouvé chez eux une protestation ardente contre les conventions d’école, et par conséquent contre le mauvais goût. David, Gros, Prud’hon, quelque différence qu’on remarque dans leur manière, ont eu les yeux fixés sur ces deux pères de l’art français ; ils ont, en un mot, consacré l’indépendance de l’artiste en face des traditions, en lui enseignant, avec le respect de ce qu’elles ont d’utile, le courage de préférer, avant tout, leur propre sentiment.
Les historiens du Poussin, — et le nombre en est grand, — ne l’ont pas assez considéré comme un novateur de l’espèce la plus rare. La manie au milieu de laquelle il s’est élevé et contre laquelle il a protesté par ses ouvrages, s’étendait au domaine entier des arts, et, malgré la longue carrière du Poussin, son influence a survécu à ce grand homme. Les écoles de la décadence en Italie donnent la main aux écoles des Lebrun, des Jouvenet, et plus loin encore, à celle des Vanloo et de ce qui les a suivis. Lesueur et Poussin n’ont pas arrêté ce torrent. Quand le Poussin arrive en Italie, il trouve les Carrache et leurs successeurs portés aux nues et les dispensateurs de la gloire… Il n’y avait pas d’éducation complète pour un artiste sans le voyage en Italie, ce qui ne voulait pas dire qu’on l’y envoyait pour étudier les véritables modèles, tels que l’antique et les maîtres du seizième siècle. Les Carrache et leurs élèves avaient accaparé toute la réputation possible, et ils étaient les dispensateurs de la gloire, c’est-à-dire qu’ils n’exaltaient que ce qui leur ressemblait, et ils cabalaient avec toute l’autorité que leur donnait l’engouement du moment contre tout ce qui tendait à sortir de l’ornière tracée. La vie du Dominiquin, issu lui-même de cette école, mais porté par la sincérité de son génie à la recherche des expressions et des effets vrais, devient l’objet de la haine et de la persécution universelles. On alla jusqu’à menacer sa vie, et la fureur jalouse de ses ennemis le força à se cacher et presque à disparaître. Ce grand peintre joignait à la vraie modestie, presque inséparable des grands talents, la timidité d’un caractère doux et mélancolique ; il est probable que cette conspiration universelle contribua à abréger ses jours.
Au plus fort de cette guerre acharnée de tout le monde contre un homme qui ne se défendait pas, même par ses ouvrages, le Poussin, inconnu encore, étranger aux coteries[644],
Cette indépendance de toute convention se retrouve fortement chez Poussin, dans ses paysages, etc. Comme observateur scrupuleux et poétique en même temps de l’histoire et des mouvements du cœur humain, le Poussin est un peintre unique !…
Vendredi 29 avril. — Au conseil de bonne heure, pour la sotte affaire du bois de Boulogne. Le préfet me demande de faire tout de suite le rapport. Je l’ai lu à la fin de la séance, et il a été adopté.
Revenu à l’Exposition avec E. Lamy[645] pour informations ; de là chez Decamps, que j’ai trouvé dans un atelier bouleversé ; il m’a montré des choses admirables.
Il y avait là la répétition plus grande de son Job pour le ministère, aussi beau que le petit, et, je crois, plus avancé. Il m’a fait voir un Samaritain dans l’auberge : le malade est porté pour être introduit dans l’hôtellerie ; on emmène sur le devant les chevaux qui ont porté le malade et son bienfaiteur ; les gens de la maison mettent la tête à la fenêtre, enfin tous les détails caractéristiques. Effet de soleil toujours le même et toujours séduisant. Cette force constante d’impression dans la monotonie est un des grands privilèges du talent.
Autre tableau ébauché dans ce genre : Intérieur d’un potier en Italie.
Sur le chevalet, une grande Fuite de Loth, que je n’approuve pas autant. Puis, petite esquisse charmante de l’Agonie du Christ, millier de figures, effet charmant.
Mais ce qui passe tout pour moi, aujourd’hui, c’est son David en déroute fuyant devant Saül et rencontré par un partisan de ce dernier égaré dans des solitudes, et qui, de l’autre côté d’un torrent, l’injurie et lui jette des pierres : le site, la composition admirables ; la description s’arrête devant mon souvenir.
Samedi 30 avril. — Ébauche le Christ dans la tempête[646], pour Grzymala. — Avancé le Christ montré au peuple, esquissé Mme Herbelin, et quelques touches à celui de M. Roché ; tout cela avec assez de succès, quoique dans une mauvaise disposition de corps et d’esprit… Qu’est-ce que cette inquiétude, pour une raison tantôt fondée, tantôt vague, et ne se prenant à rien ?
Dîné chez Chabrier avec son ami Chevigné[647], dont il me vante les talents en poésie : il n’a pas celui de l’éloquence, il ne s’exprime point comme tout le monde, et il cherche ses mots pour la moindre phrase. Ce dîner à quatre n’était pas suffisamment animé.
Le soir, Mme L… m’a plu, quoiqu’elle ne soit pas jeune. Elle était près de Mme de F…, en grands frais de toilette. Le mari de Mme de F… est un homme charmant. Il s’étonne que je n’aille pas en Italie[648] ; il me cite les lacs du nord de l’Italie comme des merveilles qu’il faut voir absolument, et qu’on voit très facilement ; on peut même faire son excursion en deux fois, s’il le faut : une fois, Florence, Rome et Naples ; une autre fois, Milan, Venise, etc.
Dimanche 1er mai. — J’ai été mené le soir par M. et Mme Mancey chez M. Gentié, où j’ai vu la belle Mariette Lablache[649], et entendu de la musique assez choisie, mais surtout vu la belle Mariette. Elle diminuait tout autour d’elle, comme une déesse au milieu de simples mortelles. Toutes ces natures du Nord étaient bien chétives, en comparaison de cette splendeur méridionale. Rentré très tard, et sorti sans que ce fût fini.
Lundi 2 mai. — Boissard me dit qu’il a vu à Florence Rossini, qui s’ennuie horriblement.
Ce jour, dîné chez Pierret avec Riesener, son ami Lassus, Feuillet[650], Durieu. J’en ai rapporté cette triste impression, qui dure encore le lendemain et que le travail a pu seul atténuer, celle de la secrète inimitié de ces gens-là pour moi. Il y a là-dessous une foule de sentiments, qui, par moments, ne prennent pas seulement la peine de mettre un masque… Je suis isolé maintenant au milieu de ces anciens amis !… Il y a une infinité de choses qu’ils ne me pardonnent point, et en première ligne les avantages que le hasard me donne sur eux.
— Le protégé de David se nomme Albert Borel-Roget, fils d’Émile Roget, graveur en médailles de talent, mort sans fortune. Il a obtenu le 1er février 1852 une demi-bourse d’élève communal au lycée Napoléon ; sa mère ne peut payer les cinq cents francs de surplus et demande une bourse entière.
— « Voltaire, dit Sainte-Beuve prenant Gui Patin sur l’ensemble de ses lettres, l’a jugé sévèrement et sans véritable justice. » Voici ce qu’en dit Voltaire : « Il sert à faire voir combien les auteurs contemporains qui écrivent précipitamment les nouvelles du jour, sont des guides infidèles pour l’histoire. Ces nouvelles se trouvent souvent fausses ou défigurées par la malignité ; d’ailleurs, cette multitude de petits faits n’est guère précieuse qu’aux petits esprits. » — « Petits esprits, ajoute Sainte-Beuve[651], je n’aime pas qu’on dise cela des autres, surtout quand ces autres composent une classe, un groupe naturel ; c’est une manière commode et allégée d’indiquer qu’on est soi-même d’un groupe différent. »
Je crois pour ma part que Sainte-Beuve, qui fait partie de ce groupe d’anecdotiers antipathiques à Voltaire, a tort de lui en vouloir de ce qu’il attaque, dit-il, un groupe. Certes, les sots forment un groupe qui n’est pas plus respectable pour être plus nombreux. Il est naturel qu’on attaque ce qu’on n’aime pas, sans considérer si ce quelque chose forme un groupe ou non. Je suis, pour moi, de l’avis de Voltaire : j’ai toujours détesté les collecteurs et raconteurs d’anecdotes, celles surtout de la veille et qui sont précisément de la nature de celles qui déplaisaient à Voltaire. Le pauvre Beyle[652] avait le travers de s’en nourrir. C’est un des faibles de Mérimée[653], et qui me le rend ennuyeux. Il faut qu’une anecdote arrive comme autre chose dans la conversation ; mais ne mettre d’intérêt qu’à cela, c’est imiter les collectionneurs de choses curieuses, autre groupe que je ne puis souffrir, qui vous dégoûtent des beaux objets pour vous en crever les yeux par leur abondance et leur confusion, au lieu d’en faire ressortir un petit nombre en les choisissant et en les mettant dans le jour qui leur convient.
Mardi 4 mai. — Invité par Nieuwerkerke[654] à aller entendre au Louvre un discours sur l’art ou les progrès de l’art d’un sieur R…
Grande réunion d’artistes, de moitiés d’artistes, de prêtres et de femmes. Après avoir attendu convenablement l’arrivée, d’abord de la princesse Mathilde[655] et ensuite très longtemps encore celle de M. Fould, le professeur a commencé d’une voix altérée, avec un accent légèrement gascon. Il n’y a que les gens de ce pays-là pour ne douter de rien et faire un discours comme celui dont je n’ai, du reste, entendu que la moitié. Ce sont des idées néo-chrétiennes dans toute leur pureté : le Beau n’est qu’à un point donné, et il ne se trouve qu’entre le treizième et le quinzième siècle presque exclusivement ; Giotto et, je crois, Pérugin sont le point culminant ; Raphaël décline à partir de ses premiers essais ; l’Antique n’est estimable que dans une moitié de ses tentatives ; il faut le détester dans ses impuretés ; il le querelle à propos de l’abus qu’on en a fait dans le dix-huitième siècle. Les saturnales de Boucher et de Voltaire, qui, à ce que dit le professeur, ne préférait décidément que les peintures immodestes, suffisent pour faire haïr tout ce côté malheureusement inséparable de l’antique, des satyres, des nymphes poursuivies et de tous les sujets érotiques. Il n’y a pas de grand artiste sans l’amitié d’un héros ou d’un grand esprit dans un autre genre. Phidias n’est aussi grand que par l’amitié d’un Périclès… Sans le Dante, Giotto ne compte pas. Quelle affection singulière ! Aristote, dit-il en commençant, met en tête ou à la fin de ses traités d’esthétique que les plus beaux raisonnements sur le Beau n’ont jamais fait et ne feront jamais rencontrer le Beau à personne. Tout le monde a dû se demander ce que venait alors faire là le professeur. Après avoir parlé de l’opinion de Voltaire sur les arts, il cite à son tribunal le pauvre baron de S…, qui lui en eût répondu de bonnes, s’il avait pu lui répondre. Ce pauvre baron, selon lui, ne voit l’avènement du Beau moderne que quand le gouvernement des deux Chambres aura fait le tour de l’Europe, et que la garde nationale sera installée chez tous les peuples. Ç’a été la plaisanterie capitale de la séance, et qui a excité cette explosion de gaieté de sacristie particulière aux gens d’Église, dont on voyait çà et là les robes noires dans cet auditoire fort mélangé.
Je m’en suis allé peut-être un peu scandaleusement après cette première partie, dont je ne donne qu’un pâle résumé. J’y ai été encouragé par l’exemple de quelques personnes qui se sont trouvées, ainsi que moi, suffisamment édifiées sur le Beau.
De là, j’ai été à pied trouver Rivet, par un temps magnifique, et avec une grande jouissance de remuer les jambes en liberté, après ma captivité de tout à l’heure.
Vendredi 6 mai. — J’étais invité par le ministre d’État à assister ce soir à une représentation du Conservatoire donnée par des élèves.
Dîné chez Mme de Forget avec le jeune X…, et promené le soir : j’ai renoncé à la partie. J’avais passé ma journée à faire mes paquets pour aller à Champrosay ; j’ai fait des provisions énormes de couleurs et de toile, et malheureusement cet article[656] maudit que je me suis engagé à faire me fera renoncer à toute peinture pendant mon séjour.
Champrosay, samedi 7 mai. — Parti hier à huit heures et demie pour Champrosay. Enfermé dans le compartiment avec M. X…, que j’ai cru reconnaître d’abord, et auquel je n’ai pas parlé, m’étant ensuite convaincu que ce n’était pas lui. Ensuite, à Juvisy, il m’a adressé la parole, et nous avons regretté de n’avoir pas plus tôt renouvelé connaissance. Je ne l’ai vu que deux fois, et très peu de temps, encore était-ce le soir.
Broklé est venu avec nous poser les glaces et nous a rendu toutes sortes de services. Je suis heureux du plaisir qu’a eu ce brave homme à jouir de la bonne réception qu’on lui a faite.
J’ai été un instant dans la forêt et me suis couché de très bonne heure et fatigué.
Dimanche 8 mai. — L’homme est capable des choses les plus diverses.
La Bruyère dit : « C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n’en attendre rien et de la négliger… » Et plus bas : « Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’éducation ne donne pas à l’homme un autre cœur ni une autre complexion, qu’elle ne change rien dans son fond et ne touche qu’aux superficies, je ne me lasserais pas de dire qu’elle ne lui est pas inutile. »
Je suis tout à fait de son avis, et j’ajoute que l’éducation dure toute la vie[657] ; je la définis : une culture de notre âme et de notre esprit par l’effet de soins et par celui des circonstances extérieures. La fréquentation des honnêtes gens ou des méchants est la bonne ou mauvaise éducation de toute la vie. L’esprit se redresse avec les esprits droits ; il en est de même de l’âme. On s’endurcit dans la société des gens durs et froids, et s’il était possible qu’un homme de vertu seulement ordinaire vécût avec des scélérats, il faudrait qu’il finît par leur ressembler, pour peu qu’il n’en soit pas éloigné dès le premier moment.
Essayé pendant toute cette journée de débrouiller mon article du Poussin. Je me persuade qu’il n’y a qu’un moyen d’en venir à bout, si toutefois j’y parviens : c’est de ne point penser à la peinture, jusqu’à ce qu’il soit fait. Ce diable de métier[658] exige une contention plus grande que je ne suis habitué à en mettre à la peinture, et cependant j’écris avec une grande facilité ; je remplirais des pages entières sans presque faire de ratures. Je crois avoir consigné dans ce cahier même que j’y trouve plus de facilité que dans mon métier. La peine que j’éprouve vient de la nécessité de faire un travail dans une certaine étendue, dans lequel je suis obligé d’embrasser beaucoup de choses diverses ; je manque d’une méthode fixe pour coordonner les parties, les disposer dans leur ordre, et surtout, après toutes les notes que je prends à l’avance, pour me rappeler tout ce que j’ai résolu de faire figurer dans ma prose.
Il n’y a donc qu’une application assidue au même objet qui puisse m’aider dans ce travail. Je n’ose donc point penser à la peinture, de peur d’envoyer tout au diable. Je ne fais que rêver à un ouvrage dans le genre de celui du Spectateur : un article court de trois ou quatre pages et de moins encore, sur le premier sujet venu. Je me charge d’en extraire ainsi à volonté de mon esprit, comme d’une carrière inépuisable.
Promenade le soir assez insipide dans la plaine ; traversé la route qui va au pont ; été jusqu’au terrain de Delarche, et revenu par la ruelle avec Jenny, qui avait voulu aussi régaler Julie de la promenade pour son dimanche.
Lundi 9 mai. — J’ai été le lendemain, vers dix ou onze heures, me promener vers les coupes nouvelles qu’on a faites le long des murs des propriétés de Quantinet et de Minoret, etc. Matinée délicieuse.
Arrivé au chêne d’Antain que je ne reconnaissais pas, tant il m’a paru petit ; fait de nouvelles réflexions, que j’ai consignées sur mon calepin, analogues à celles que j’ai écrites ici, sur l’effet que produisent les choses inachevées : esquisses, ébauches, etc.
Je trouve la même impression dans la disproportion. Les artistes parfaits étonnent moins à cause de la perfection même ; ils n’ont aucun disparate qui fasse sentir combien le tout est parfait et proportionné. En m’approchant, au contraire, de cet arbre magnifique, et placé sous ses immenses rameaux, n’apercevant que des parties sans leur rapport avec l’ensemble, j’ai été frappé de cette grandeur… J’ai été conduit à inférer qu’une partie de l’effet que produisent les statues de Michel-Ange est dû à certaines disproportions ou parties inachevées qui augmentent l’importance des parties complètes. Il me semble, si on peut juger de ses peintures par des gravures, qu’elles ne présentent pas ce défaut au même degré. Je me suis dit souvent qu’il était, quoi qu’il pût croire lui-même, plus peintre que sculpteur. Il ne procède pas, dans sa sculpture, comme les anciens, c’est-à-dire par les masses ; il semble toujours qu’il a tracé un contour idéal qu’il s’est appliqué à remplir, comme le fait un peintre. On dirait que sa figure ou son groupe ne se présente à lui que sous une face : c’est le peintre. De là, quand il faut changer d’aspect comme l’exige la sculpture, des membres tordus, des plans manquant de justesse, enfin tout ce qu’on ne voit pas dans l’Antique.
— Les soirs, je me promène avec Jenny ; je dîne de bonne heure et suis bien forcé de me coucher de même : cela fait la nuit trop longue. Plus je dors, moins je veux me lever le matin… Toujours triste dans ce moment-là… Il faut le travail pour secouer cette mauvaise disposition, qui est purement physique.
Sans date[659]. — Je suis à Champrosay depuis samedi. — Je fais ce matin une promenade dans la forêt, en attendant que ma chambre soit en état pour me remettre au fameux Poussin. — En apercevant de loin le chêne d’Antain que je ne reconnaissais pas d’abord, tant je le trouve ordinaire, mon esprit s’est reporté sur une note de mon cahier de tous les jours que j’ai écrite, il y a quinze jours environ, sur l’effet de l’ébauche par rapport à l’ouvrage fini. J’y dis que l’ébauche d’un tableau, d’un monument, qu’une ruine, enfin que tout ouvrage d’imagination auquel il manque des parties, doit agir davantage sur l’âme, à raison de ce que celle-ci y ajoute, tout en recueillant l’impression de cet objet. J’ajoute que les ouvrages parfaits, comme ceux d’un Racine et d’un Mozart, ne font pas, au premier abord, autant d’effet que ceux des génies incorrects ou négligés, dont les parties saillantes le sont d’autant plus qu’il y en a d’autres à côté qui sont effacées ou complètement mauvaises.
En présence de ce bel arbre si bien proportionné, je trouve une nouvelle confirmation de ces idées. À la distance nécessaire pour en embrasser toutes les parties, il paraît d’une grandeur ordinaire ; si je me place au-dessous de ses branches, l’impression change complètement : n’apercevant que le tronc auquel je touche presque et la naissance de ses grosses branches, qui s’étendent sur ma tête comme d’immenses bras de ce géant de la forêt, je suis étonné de la grandeur de ses détails ; en un mot, je le trouve grand, et même effrayant de grandeur. La disproportion serait-elle une condition pour l’admiration ? Si, d’une part, Mozart, Cimarosa, Racine étonnent moins, à cause de l’admirable proportion de leurs ouvrages, Shakespeare, Michel-Ange, Beethoven ne devront-ils pas une partie de leur effet à une cause opposée ? Je le crois pour mon compte.
L’antique ne surprend jamais, ne montre jamais le côté gigantesque et outré ; on se trouve comme de plain-pied avec ces admirables créations ; la réflexion seule les grandit et les place à leur incomparable élévation. Michel-Ange étonne[660] et porte dans l’âme un sentiment de trouble qui est une manière d’admiration, mais on ne tarde pas à s’apercevoir de disparates choquants, qui sont le fruit d’un travail trop hâté, soit à cause de la fougue avec laquelle l’artiste a entrepris son ouvrage, soit à cause de la fatigue qui a dû le saisir à la fin d’un travail impossible à compléter ; cette dernière cause est évidente. Quand les historiens ne nous diraient pas qu’il se dégoûtait presque toujours en finissant, par l’impossibilité de rendre ses sublimes idées, on voit clairement, à des parties laissées à l’état d’ébauche, à des pieds enfoncés dans le socle et où la matière manque, que le vice de l’ouvrage vient plutôt de la manière de concevoir et d’exécuter que de l’exigence extraordinaire d’un génie fait pour atteindre plus haut, et qui s’arrête sans se contenter. Il est plus que probable que sa conception
Fac-simile d’une lettre
d’Eugène Delacroix à Ingres.
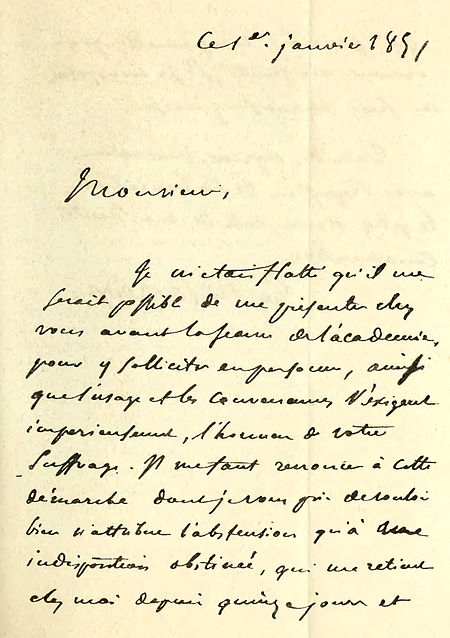
Monsieur,
Je m’étais flatté qu’il me serait possible de me présenter chez vous avant la séance de l’académie, pour y solliciter en personne, ainsi que l’usage et les convenances l’exigent impérieusement, l’honneur de vote suffrage. Il me faut renoncer à cette démarche dont je vous prie de vouloir bien n’attribuer l’abstention qu’à une indisposition obstinée, qui me retient chez moi depuis quinze jours et

Veuillez agréer, monsieur, avec l’expression de l’admiration la plus sincère, celle de ma haute considération.
Eg. Delacroix.
moment pour les développements de sa pensée, et s’il s’est souvent arrêté avec découragement, c’est qu’effectivement il ne pouvait faire davantage.
Mardi 10 mai. — Les matins, je me débats avec Poussin… Tantôt je veux envoyer tout promener, tantôt je m’y reprends avec une espèce de feu. Cette matinée n’a pas été trop mauvaise pour le pauvre article.
Après avoir commencé à disposer clairement sur de grandes feuilles de papier, et en séparant les alinéas, les objets principaux que j’ai à traiter, je suis sorti vers midi, enchanté de moi-même et de mon courage à monter à l’assaut de mon article.
La forêt m’a ravi : le soleil se montrait, il était tiède et non pas brûlant ; il s’exhalait des herbes, des mousses, dans les clairières où j’entrais, une odeur délicieuse, Je me suis enfoncé dans un sentier presque perdu, environ au coin du mur du marquis ; je désirais trouver là une communication entre cette partie et l’allée qui remonte de la route pour rejoindre celle qui va au chêne Prieur : j’ai livré bataille aux ronces, aux arbrisseaux qui se croisaient devant mes pas, et je n’ai pas réussi néanmoins à atteindre mon but. Je suis retourné par un sentier plus facile, mais très couvert, à travers la partie de bois qui dépend, je crois, de la maison du marquis.
En retournant, je me suis assis le long des murs de son enclos, mais sur la partie qui mène à l’entrée de la forêt, et j’ai fait un croquis d’un chêne, pour me rendre compte de la distribution des branches.
Je me suis mis à lire le journal en rentrant. La littérature a eu le dessous, mais, au demeurant, je ne m’ennuie pas, c’est l’essentiel.
Vers quatre heures, au lieu de sortir, j’ai fait le vitrier, et j’ai peint une vieille glace.
Le soir, promenade vers Soisy. Descendu par une ruelle qui m’a conduit dans des endroits très solitaires et assez attrayants ; j’ai fait amitié à un chat angora charmant qui me suivait et qui s’est laissé caresser.
Jeudi 12 mai. — J’ai beaucoup travaillé au damnable article. Débrouillé comme j’ai pu, au crayon, tout ce que j’ai à dire, sur de grandes feuilles de papier. Je serais tenté de croire que la méthode de Pascal, — d’écrire chaque pensée détachée sur un petit morceau de papier, — n’est pas trop mauvaise, surtout dans une position où je n’ai pas le loisir d’apprendre le métier d’écrivain. On aurait toutes ses divisions et subdivisions sous les yeux comme un jeu de cartes, et l’on serait frappé plus facilement de l’ordre à y mettre. L’ordre et l’arrangement physique se mêlent plus qu’on ne croit des choses de l’esprit. Telle situation du corps sera plus favorable à la pensée : Bacon composait, à ce qu’on dit, en sautant à cloche-pied ; à Mozart, à Rossini, à Voltaire, les idées leur venaient dans leur lit ; à Rousseau, je crois, en se promenant dans la campagne.
Habituellement, promenade avant dîner, après avoir secoué les paperasses et l’encre, et aussi après le dîner, pour chasser le sommeil. Mais comme je dîne toujours entre cinq heures et cinq heures et demie, la soirée ne peut aller sans de grandes difficultés jusqu’à neuf heures.
Vendredi 13 mai. — J’ai essayé de l’article, et après avoir écrit quelques lignes que je veux mettre en tête de la première partie (car j’ai envie de le faire en deux fois, une partie biographique, une autre sur l’examen du talent et des ouvrages), après avoir écrit ces quelques mots, une mauvaise disposition m’a saisi, et je n’ai fait que lire et même dormir jusqu’au milieu de la journée ; puis j’ai emmené Jenny, par le plus beau temps du monde auquel nous n’étions plus accoutumés, faire une grande promenade dans la forêt. Nous avons suivi l’allée de l’Ermitage jusqu’au grand chêne, au pied duquel nous nous sommes reposés ; nous étions entrés auparavant à l’Ermitage, dont une partie est à vendre. C’est un manoir comme cela qu’il me faudrait ! Le jardin, qui n’est qu’un potager, est charmant : il est encore rempli de vieux arbres qui ont donné leurs fruits aux environs. Ces troncs noueux, tordus par les années, se couvrent encore de magnifiques fleurs et de fruits, au milieu de ces bâtiments ruinés, non par le temps, mais par la main des hommes. On est attristé, devant ce spectacle inhumain, de la rage stupide de démolition qui a signalé les époques de nos discordes.
Abattre, arracher, brûler, c’est ce que le fanatisme de liberté sait aussi bien faire que le fanatisme dévot ; c’est par là que l’un ou l’autre commence son œuvre, quand il est déchaîné ; mais là s’arrête l’impulsion brutale… Élever quelque chose de durable, marquer son passage autrement que par des ruines, voilà ce que la plèbe aveugle ne sait point faire ; et, en même temps, je remarquais combien les ouvrages qui sont dus à l’esprit de suite, conçus dans une grande idée de durée et exécutés avec le soin nécessaire, apportent un cachet de force jusque dans des débris qu’il est presque impossible de faire disparaître complètement. Ces corporations anciennes, les moines surtout, se sont crus éternels, car ils semblent avoir fondé pour les siècles des siècles. Ce qui reste des vieux murs fait honte aux ignobles bâtisses plus modernes qu’on leur a accolées. La proportion de ces restes a quelque chose de gigantesque, en comparaison de ce que des particuliers font tous les jours sous nos yeux.
Je pensais, en même temps, qu’il en était un peu de même pour l’ouvrage d’un homme de talent… Pour la sculpture, c’est incontestable, car les restaurations les plus maladroites laissent encore apercevoir clairement ce qui appartient à l’original ; mais dans la peinture elle-même, toute fragile qu’elle est, et quelquefois toute massacrée qu’elle est par des retouches inhabiles, la disposition, le caractère, une certaine empreinte ineffaçable montrent la main et la conception d’un grand artiste.
Reçu dans la soirée une lettre de Riesener, qui me demande de le recevoir avec Pierret ; aussi de Mme de Forget, dont le fils est parti pour voyager avec un médecin, mais sur l’état duquel elle n’est pas rassurée, d’après les lettres qu’elle a reçues.
Samedi 14 mai. — J’ai beaucoup travaillé toute la matinée à extraire des notes, pour la partie historique du Poussin. Il y a peu de jours où je me livre à ce travail avec beaucoup d’entrain ; d’autres où il me répugne horriblement. Quoi qu’il en soit, je persévère et j’espère que j’en viendrai à bout : ce sera une raison de rester ici un peu davantage.
Vers trois heures, j’ai fait une promenade à travers le village, pour aller à l’autre extrémité ; je comptais, en passant, voir le maire et acheter des cigares ; je n’ai eu de succès que dans cette dernière tentative ; mais j’ai fait en chemin toutes sortes de rencontres, qui m’ont donné de l’ennui, parce quelles me présagent la fin de la tranquillité dont je jouis. Toute la maison Barbier va venir demain, et s’installer pour deux jours ; Mme Villot peut-être demain… Que le ciel les conduise !
— L’entrée de la forêt, celle que je prenais quand j’étais dans mon premier logement, m’a paru charmante, surtout l’allée qui conduit au chêne d’Antain. Les coupes qu’on a faites à droite et à gauche, et qui vont s’étendre encore, malheureusement, donnent des aspects qui varient toute cette partie.
Le soir, descendu vers la rivière, et promenade au bord de l’eau, en allant vers le pont. J’étais ravi de la grandeur et de l’aspect paisible de cette eau : jamais je ne l’avais vue si pittoresque. Du côté du couchant, elle rappelait tout à fait les teintes à la Ziem… Quelques tours encore dans le jardin, par un petit clair de lune, qui se confondait avec le jour finissant.
J’ai trouvé dans cette promenade solitaire quelques instants de bonheur. Les sentiments mélancoliques qu’inspire le spectacle de la nature m’ont paru, plus que jamais, au bord de cette rivière, une nécessité de notre être. Ce sentiment mal défini, que chaque homme peut-être a cru lui être particulier, s’est trouvé avoir un écho chez tous les êtres sensibles. Les modernes n’ont eu que le tort de lui faire tenir trop de place dans leurs compositions ; aussi les poètes des contrées du Nord, les Anglais particulièrement, sont-ils les pères du genre. Tout porte à la rêverie chez eux : les mœurs plus recueillies, et la nature plus sévère dans son aspect.
Dimanche 15 mai. — Barbier et sa femme venus pour faire divers travaux.
Mauvaise journée.
Promenade dans la forêt vers dix heures et prolongée sous l’impression d’idées désagréables. Rentré au milieu du sens dessus dessous que ce brave homme a occasionné dans la maison pour ses travaux ; j’ai fait le vitrier et j’ai achevé de mastiquer la glace.
J’ai eu pourtant des moments de plaisir à continuer la lecture de l’aventure de la femme arabe délivrée au milieu de la traite des nègres, de la Revue britannique.
J’ai commencé aussi et continué, en dînant dans l’atelier, l’article sur Charles-Quint dans le cloître[661] ; je suis très impressionné par chaque chose intéressante qu’il m’arrive de rencontrer dans les livres. Les grands hommes en déshabillé et étudiés à la loupe, s’ils ne relèvent pas beaucoup la nature humaine dans ses plus nobles échantillons, consolent du moins de leur propre faiblesse les hommes mécontents d’eux-mêmes par trop de modestie, ou par un trop grand désir de la perfection. Ce grand empereur était un gourmand déterminé, et il ressent à tous moments les inconvénients de ce défaut, sans en être corrigé, ni par le sentiment de sa suprême dignité, ni par la faiblesse de son estomac… La goutte, punition ordinaire des gourmands, ne peut mettre un frein à sa sensualité.
Je vois avec plaisir, dans cet article, que c’était un grand homme doué de beaucoup d’énergie et en même temps de qualités aimables. Ce n’est pas sous cet aspect que l’histoire prise en gros le considère ; on le croit communément un être froid et perfide. Les historiens, ou plutôt l’imagination de tout le monde, qui exagère tout, qui veut toujours des contrastes tranchés, en fait en tout l’opposé de François Ier, qui ne nous apparaît qu’avec les qualités d’un joyeux compère, très brave et très étourdi. Charles-Quint a eu, comme un autre, ses faiblesses ; il était très brave aussi et plein de bonté et d’indulgence pour ceux qui l’approchaient. Le chagrin qu’il conçut de la mort de sa dernière femme contribua beaucoup à lui faire prendre la résolution qui mit fin à son rôle sur la scène du monde.
— Le soir de ce jour, sorti après dîner pour faire une promenade. Encore tout échauffé de mon repas et de cette lecture, j’ai cheminé dans les petits sentiers du coteau, encore tout mouillés par la pluie.
J’ai éprouvé un sentiment de malaise, qui ne s’est calmé que quand je suis rentré à la maison, où je me suis promené en tous sens, pendant près d’une heure, avant de me coucher.
Lundi 16 mai. — Passé toute la journée dans ma chambre à paresser délicieusement, à écrire un peu sur ce livre, et à lire la Revue britannique, surtout le morceau de la nièce blanche de l’oncle Tom, quand l’Américain Jonathan traverse l’Afrique, sur un dromadaire, pour aller chercher sa maîtresse arabe, au centre de ce continent.
Je me suis arraché avec peine à cette lecture, pour m’habiller et aller dîner avec Mme Barbier et Mme Parchappe[662], M. et Mme Béal et M. Barbier, qu’on n’attendait pas et qui est arrivé au moment du dîner. En revanche, Mme Villot, qu’on attendait, a manqué de parole. Nous avons fait un fort bon dîner, avec le vin de Champrosay, que j’ai trouvé fort bon. M. Barbier a été au Salon, et j’ai vu en lui le goût bourgeois dans tout son lustre ; il n’a remarqué que ce qui lui allait, par conséquent peu de choses remarquables. Les portraits de Dubufe[663] ont emporté toutes ses prédilections, et ce nom a provoqué, parmi ces dames, une explosion d’admiration… Je me suis amusé médiocrement. — Rentré vers dix heures par un clair de lune délicieux, et promené un peu sur la route, avant de rentrer.
— M. Barbier m’a communiqué ses projets, pour faire quelque chose, dit-il, du jardin qui suffisait à son père. Un grand planteur de jardins lui élèverait à droite et à gauche, à partir de la maison, de grands monticules, et ne ferait qu’une pente jusqu’en bas, en supprimant la terrasse, le seul endroit où l’on puisse se promener, sans monter ou descendre. J’ai essayé de lui faire comprendre cet avantage, mais l’absurde l’emportera, comme infiniment plus… fashionable.
Girardin[664] croit toujours fermement à l’avènement du bien-être universel, et l’un des moyens de le produire, sur lequel il revient avec prédilection, c’est le labourage à la mécanique, et sur une grande échelle, de toutes les terres de France. Il croit grandement contribuer au bonheur des hommes, en les dispensant du travail ; il fait semblant de croire que tous ces malheureux, qui arrachaient leur nourriture à la terre, péniblement, j’en conviens, mais avec le sentiment de leur énergie et de leur persévérance bien employée, seront des gens bien moraux et bien satisfaits d’eux-mêmes, quand ce terrain, qui était au moins leur patrie, celle sur laquelle naissaient leurs enfants et dans laquelle ils enterraient leurs parents, ne sera plus qu’une manufacture de produits, exploitée par les grands bras d’une machine, et laissant la meilleure partie de son produit dans les mains impures et athées des agioteurs. La vapeur s’arrêtera-t-elle devant les églises et les cimetières ?… Et le Français qui rentrera dans sa patrie après plusieurs années, serait-il réduit à demander la place où étaient son village et le tombeau de ses pères ? Car les villages seront inutiles comme le reste ; les villageois sont ceux qui cultivent la terre, parce qu’il faut bien demeurer là où les soins sont réclamés à toute minute ; il faudra faire des villes proportionnées à cette foule désœuvrée et déshéritée, qui n’aura plus rien à faire aux champs ; il faudra leur construire d’immenses casernes où ils se logeront pêle-mêle. Que faire là, les uns près des autres, le Flamand auprès du Marseillais, le Normand et l’Alsacien, autre chose que consulter le cours du jour, pour s’inquiéter, non pas si dans leur province, dans leur champ chéri, la récolte a été bonne, non pas s’ils vendront avec avantage leur blé, leur foin, leur vendange, mais si leurs actions sur l’anonyme propriété universelle montent ou descendent ? Ils auront du papier, au lieu d’avoir du terrain !… Ils iront au billard jouer ce papier contre celui de ces voisins inconnus, différents de mœurs et de langage, et quand ils seront ruinés, auront-ils au moins cette chance qui leur restait, quand la grêle avait détruit les fruits ou les moissons, de réparer leur infortune à force de travail et de constance, de puiser au moins dans la vue de ce champ arrosé tant de fois de leurs sueurs, un peu de consolation ou l’espoir d’une meilleure année ?…
O indignes philanthropes !… O philosophes sans cœur et sans imagination ! Vous croyez que l’homme est une machine, comme vos machines ; vous le dégradez de ses droits les plus sacrés, sous prétexte de l’arracher à des travaux que vous affectez de regarder comme vils, et qui sont la loi de son être, non pas seulement celle qui lui impose de créer lui-même ses ressources contre le besoin, mais celle qui l’élève en même temps à ses propres yeux et emploie d’une manière presque sacrée les courts moments qui lui sont accordés… faiseurs de feuilletons, écrivassiers, faiseurs de projets ! Au lieu de transformer le genre humain en un vil troupeau, laissez-lui son véritable héritage, l’attachement, le dévouement au sol ! Que le jour où des invasions nouvelles de barbares menacent ce qu’ils appellent encore leur patrie, ils se lèvent avec joie pour la défendre. Ils ne se battront pas pour défendre la propriété des machines, pas plus que ces pauvres Russes, ces pauvres serfs enrégimentés ne travaillaient pour eux, quand ils venaient ici venger les querelles de leurs maîtres et de leur empereur… Hélas ! les pauvres paysans, les pauvres villageois ! Vos prédications hypocrites n’ont déjà que trop porté leurs fruits ! Si votre machine ne fonctionne pas sur le terrain, elle fonctionne déjà dans leur imagination abusée. Leurs idées de partage général, de loisir et même de plaisir continuel, sont réalisées dans ces indignes projets. Ils quittent déjà à qui mieux mieux, et sur le plus faible espoir, le travail des champs ; ils se précipitent dans les villes, pour n’y trouver que des déceptions ; ils achèvent d’y pervertir les sentiments de dignité que donne l’amour du travail, et plus vos machines les nourriront, plus ils se dégraderont !… Quel noble spectacle dans ce meilleur des siècles, que ce bétail humain engraissé par les philosophes !
Mardi 17 mai. — Fait encore le paresseux, toute la journée, à lire l’article de Charles-Quint et un peu de l’Essai sur les mœurs, sur ledit et sur François Ier et Louis XI aussi.
Vers trois heures, embarqué vers Draveil, mais la pluie presque tout le temps, et en revenant, acheté une quantité de cigares.
Je trouve dans la Presse un article de Gautier, sur une nouvelle création de Frédérick, le Vieux Caporal[665] : « Il parcourt d’un bout à l’autre le clavier de l’âme humaine, don admirable, qui se rencontre rarement chez la même personne ; il a la passion, la foi, l’ironie et le scepticisme ; il sait rendre tous les beaux mouvements du cœur et s’en railler avec une verve diabolique ; il peut être, dans la même soirée, Roméo et Méphistophélès, Ruy Blas et Robert Macaire, Gennaro et le Joueur. Le manteau lui sied comme la souquenille, la pourpre comme le haillon ; mais, quel que soit le personnage qu’il représente, il lui donne la vie, et infuse aux veines du mélodrame le plus débile un sang rouge et généreux. Frédérick Lemaître est de la race des Hugo, des Dumas, des Balzac, des Delacroix, des Préault ; il appartient à cette forte et puissante génération romantique dont il a partagé le succès et soulevé les enthousiasmes ; c’est l’acteur shakespearien[666] par excellence, la plus complète incarnation du drame moderne. »
Jeudi 19 mai. — Promenade l’après-midi par la porte du jardin avec Jenny, et délicieux aspect de tout le côté de Corbeil : grands nuages à l’horizon éclairés en face par le soleil.
Admiré la petite source près du lavoir et des grands peupliers, puis remontés ensemble pour dîner.
Vendredi 20 mai. — Parti pour aller au conseil par l’omnibus du chemin de fer de Lyon ; cela m’a rappelé les voyages de ma jeunesse. La nature, en chemin de fer, ne fait pas le même effet ; cette rêverie délicieuse qui s’empare de vous, quand on se sent installé dans son coin de coupé, sans cet ennui perpétuel de voir de nouvelles figures monter et descendre, le mouvement des chevaux, et surtout moins de rapidité à traverser tous les aspects.
Arrivé dans une mauvaise disposition au Jardin des Plantes, j’ai redouté la pluie un moment ; cela m’avait fait presque résoudre de revenir aussitôt le conseil fini. Mais arrivé à l’Hôtel de ville, j’ai appris qu’il n’y avait pas de séance ; j’ai déjeuné sur la place et, me trouvant réconforté, j’ai été à pied au Jardin des Plantes ; fait des études de lions et d’arbres, en vue du sujet de Renaud[667], par une chaleur très incommode, et au milieu d’un public très désagréable. Enfin, reparti à deux heures moins un quart et revenu par le bord de l’eau jusqu’à la maison. L’aspect de la rivière et de ses bords toujours ravissant quand je reviens ; c’est là où je sens que mes chaînes me quittent. Il semble qu’en traversant cette eau, je laisse derrière moi les importuns et les ennuis.
Lu, en déjeunant, l’article de Peisse[668] qui examine en gros le Salon et qui recherche la tendance des arts à présent. Il la trouve très justement dans le pittoresque, qu’il croit une tendance inférieure. Oui, s’il n’est question que de faire de l’effet aux yeux par un arrangement de lignes et de couleurs, autant vaudrait dire : arabesque ; mais si, à une composition déjà intéressante par le choix du sujet, vous ajoutez une disposition de lignes qui augmente l’impression, un clair-obscur saisissant pour l’imagination, une couleur adaptée aux caractères, vous avez résolu un problème plus difficile, et, encore une fois, vous êtes supérieur : c’est l’harmonie et ses combinaisons adaptées à un chant unique. Il appelle musicale cette tendance dont il parle ; il la prend en mauvaise part, et moi, je la trouve aussi louable que toute autre…
Son ami Chenavard lui a insinué ses principes sur les arts : celui-ci trouve que la musique est un art inférieur ; c’est un esprit à la française, auquel il faut des idées comme celles que les mots peuvent exprimer ; quant à celles devant lesquelles le langage est impuissant, il les retranche du domaine des arts. Même en admettant que le dessin soit tout, il est clair qu’il ne se contente pas de la forme pure et simple. Il y a, dans ce contour qui lui suffit, de la grossièreté ou de la grâce : ce contour fait par Raphaël ou par Chenavard ne charmera pas de la même façon. Qu’y a-t-il de plus vague et de plus inexplicable que cette impression ? Faudra-t-il établir des degrés de noblesse entre les sentiments ? C’est ce que fait le docte et malheureusement trop froid Chenavard… Il met au premier rang la littérature ; la peinture vient ensuite, et la musique n’est que la dernière. Cela serait peut-être vrai, si l’une d’elles pouvait contenir les autres ou les suppléer ; mais devant une peinture ou une symphonie que vous aurez à décrire avec des mots, vous donnerez facilement une idée générale où le lecteur comprendra ce qu’il pourra ; mais vous n’aurez vraiment donné aucune idée exacte de cette symphonie ou de cette peinture. Il faut voir ce qui est fait pour les yeux ; il faut entendre ce qui est fait pour les oreilles. Ce qui a été écrit pour être débité fera même plus d’effet dans la bouche d’un orateur que par un simple lecteur. Un grand acteur transformera, pour ainsi dire, un morceau par son accent… Je m’arrête.
F… me conseille d’imprimer, comme elles sont, mes réflexions, pensées, observations, et je trouve que cela me va mieux que des articles ex professo. Il faudrait les récrire pour cela à part, chacune sur une feuille séparée, et les mettre au fur et à mesure dans un carton… Je pourrais ainsi, dans les moments perdus, en mettre au net une ou deux, et au bout de quelque temps, j’aurais fait un fagot de tout cela, comme fait un botaniste, qui va, mettant dans la même boîte les herbes et les fleurs qu’il a cueillies dans cent endroits, et chacune avec une émotion particulière.
Samedi 21 mai. — Jour où Pierret et Riesener sont venus.
Toute la matinée, fait des pastels d’après les lions et les arbres que j’avais étudiés la veille, au Jardin des Plantes ; vers deux heures un quart, j’ai été au-devant d’eux ; je trouve Pierret bien changé…
Pourquoi la vue de deux amis si anciens, et dans ce lieu en pleine liberté, sous le ciel et au milieu des beautés du printemps, ne me donne-t-elle pas une plénitude de bonheur que je n’eusse pas manqué de sentir autrefois ?… Je sentais en moi des mouvements irrésistibles de ce sentiment qui n’était pas en eux : j’étais devant des témoins, et non pas avec des amis.
Je les ai menés à la maison, puis à la forêt. Riesener a repris sa critique de la recherche d’un certain fini dans mes petits tableaux, qui lui semble leur faire perdre beaucoup, en comparaison de ce que donne l’ébauche ou une manière plus expéditive et de premier jet. Il a peut-être raison, et peut-être qu’il a tort. Pierret a dit, probablement pour le contredire, qu’il fallait que les choses fussent comme le sentait le peintre, et que l’intérêt passait avant toutes ces qualités de touche et de franchise. Je lui ai répondu par cette observation, que j’ai mise dans ce livre il y a quelques jours, sur l’effet immanquable de l’ébauche comparée au tableau fini, qui est toujours un peu gâté quant à la touche, mais dans lequel l’harmonie et la profondeur des expressions deviennent une compensation.
Au chêne Prieur, je leur ai montré combien des parties isolées paraissaient plus frappantes, etc. ; en un mot, l’histoire de Racine comparé à Shakespeare. Ils m’ont rappelé ma chaleur d’il y a quelques mois, quand je m’étais repris à relire ou à revoir au théâtre Cinna et quelques pièces de Racine ; ils ont confessé le souvenir de l’émotion que je leur ai communiquée, quand je leur en ai parlé.
Après dîner, ils ont regardé les photographies que je dois à l’obligeance de Durieu. Je leur ai fait faire l’expérience que j’ai faite moi-même, sans y penser, deux jours auparavant : c’est-à-dire qu’après avoir examiné ces photographies qui reproduisaient des modèles nus, dont quelques-uns étaient d’une nature pauvre et avec des parties outrées et d’un effet peu agréable, je leur ai mis sous les yeux les gravures de Marc-Antoine. Nous avons éprouvé un sentiment de répulsion et presque de dégoût, pour l’incorrection, la manière, le peu de naturel, malgré la qualité de style, la seule qu’on puisse admirer, mais que nous n’admirions plus dans ce moment. En vérité, qu’un homme de génie se serve du daguerréotype comme il faut s’en servir, et il s’élèvera à une hauteur que nous ne connaissons pas. C’est en voyant surtout ces gravures, qui passent pour les chefs-d’œuvre de l’école italienne, qui ont lassé l’admiration de tous les peintres, que l’on ressent la justesse du mot de Poussin, que « Raphaël est un âne, comparativement aux anciens ». Jusqu’ici, cet art à la machine ne nous a rendu qu’un détestable service : il nous gâte les chefs-d’œuvre, sans nous satisfaire complètement.
Dimanche 22 mai. — Mauvaise disposition, sommeil, lectures prolongées, néant complet…
M. Beck venu me surprendre dans le jardin : visite prolongée, vers cinq heures et demie, chez Mme Villot, qui n’était pas encore rentrée. J’ai été dans le jardin de la grande maison admirer les lilas, et je n’ai pu résister au désir d’aller jusqu’au bas, à la fontaine. Que les objets changent peu, malgré l’instabilité des choses humaines, si on les compare à nous-mêmes et à nos sentiments ! Cependant, en revoyant ces beaux arbres, je me suis reporté avec vivacité à quelques années en arrière… La petite fontaine du bon père Barbier ne coulait plus : un des côtés était cultivé, et j’ai vu dans l’intérieur les tuyaux en plomb qui épanchaient, sans se montrer, l’eau de la source limpide. Cet aspect prosaïque n’a pas suffi pour me désenchanter : je suis remonté rapidement, mais avec regret, en abandonnant cet endroit agréable.
Causé à dîner des tables tournantes : Mme Villot a vu et fait des expériences ; elle en vient à croire presque au surnaturel. J’ai effectivement, après dîner, éprouvé par mes yeux, sinon autrement, cette fameuse découverte. Geneviève, la femme de chambre, a fait tourner un chapeau… ; un guéridon a sensiblement tourné et levé le pied d’un côté ; mais après nous être mis une demi-heure autour de la grande table à manger, il a été impossible de l’arracher à son immobilité de nature. Ces dames ont prétendu que j’étais un sujet peu propre : de même, d’une ou deux personnes présentes…
L’homme fait des progrès en tous sens : il commande à la matière, c’est incontestable, mais il n’apprend pas à se commander à lui-même. Faites des chemins de fer et des télégraphes, traversez en un clin d’œil les terres et les mers, mais dirigez les passions comme vous dirigez les aérostats ! Abolissez surtout les passions mauvaises, qui, dans les cœurs, n’ont pas perdu leur empire détestable, en dépit des maximes libérales et fraternelles de l’époque ! Là est le problème du progrès, et même du véritable bonheur. Il semble, tout au contraire, que nos instincts de convoitise ou de jouissance égoïste soient infiniment plus excités par toutes ces matérialistes améliorations.
Le désir d’un bonheur impossible, puisqu’il serait obtenu indépendamment de la satisfaction que donne la paix de l’âme, vient toujours se placer à côté de chaque nouvelle conquête et semble faire reculer la chimère de ce bonheur des sens. La fourberie et la trahison, l’ingratitude et la bassesse intéressée veillent toujours dans les cœurs ! Vous n’avez pas même pour les inventeurs de ces perfectionnements ingénieux la reconnaissance qu’il semble que vous leur devriez, si réellement vous vous trouvez heureux par leur moyen. Au lieu de leur dresser des statues et de les faire jouir les premiers de ce bien-être tant souhaité, vous les laissez mourir dans l’obscurité, ou vous permettez qu’on leur conteste, sous vos yeux, le mérite de leurs inventions.
Lundi 23 mai. — Toujours la même apathie le matin…
Quelques extraits de Balzac, mais c’est à cela que s’est borné mon effort. Je suis mécontent de moi, et cela me gâte bien des moments qui seraient agréables dans cette douce solitude.
Vers trois heures, promenade avec Jenny, qui est souffrante, vers le chêne Prieur.
Le soir, chez M. et Mme Beck, et revenu par un clair de lune délicieux. Les exhalaisons des plantes sont, en ce moment de la saison et à cette heure-là, d’un charme enivrant.
Mardi 24 mai. — Passé la journée presque seul : Jenny a été à Paris avec Julie, au-devant du vin. Travaillé toute la matinée et paperasse ou pris d’une belle ardeur.
La langueur est arrivée vers deux heures. Promenade vers Soisy, par les champs. J’ai été plus loin qu’à l’ordinaire, mais pas encore jusqu’à la grande allée ; je vais à la découverte comme Robinson ; je finirai par connaître les environs dans le rayon où mes jambes peuvent me porter.
Jenny revenue au moment où j’allais dîner avec un dîner froid. Mon dînera été installé autrement, et j’ai dîné plus gaiement.
Le soir, extases nombreuses devant les étoiles. Quel silence ! que de choses la nature accomplit au milieu de ce charme si majestueux ! Que de bruits, chez nous, qui doivent cesser sans laisser de traces !
Mercredi 25 mai. — Journée de travail complète. Je suis à flot : je sors des fatras et je rédige ; j’espère définitivement m’en tirer.
Après une journée fatigante, écrivant près de la fenêtre, par un soleil qui m’avait obligé de mettre un store de toile, je suis sorti vers quatre heures, et j’ai été délicieusement jusqu’au bout de l’allée de l’Ermitage. J’étais ravi…
Revenu dîner, et, après dîner, descendu vers la rivière ; côtoyé jusqu’auprès du pont, et revenu à travers le pré, dans le petit sentier tracé. Au lieu de prendre la ruelle, continué sur le coteau et revenu par le petit chemin habituel, au milieu des vignes et des blés verts. Le temps était orageux : les éclairs, quelques tonnerres, qui ont bien fini sans secousse.
Dimanche 29 mai. — Tous ces jours derniers se sont écoulés rapidement, moitié travaillant et moitié sortant, mais beaucoup moins le dernier, à cause de la pluie que nous avons depuis deux ou trois jours. Tantôt je veux jeter Poussin par les fenêtres, tantôt je le reprends avec fureur ou par raison.
Mme Barbier, qui est venue passer la journée, malgré cet affreux temps, m’a invité à dîner ; j’ai éprouvé dans la causerie de cette femme, qui a de l’esprit, le plaisir et le besoin que j’éprouve dans la conversation ; mais il faut avec l’esprit les petites manières du monde que les rustres de nos jours peuvent critiquer, mais qui ajoutent le piquant nécessaire. Nos pères devaient prodigieusement s’amuser, car ces manières étaient infiniment plus répandues, et ce qui reste encore de politesse dans notre nation, malgré la grossièreté qui envahit tout, prouve ce que la société a dû être. Pour ceux qui éprouvent cette sorte de charme, il n’y a pas de progrès matériels qui puissent le compenser. Il n’est pas étonnant qu’on trouve insipide le monde à présent. La révolution qui s’accomplit dans les masses le remplit continuellement de parvenus, ou plutôt ce n’est plus le monde comme il était : ce qu’on appelle ainsi est effectivement tout ce qu’il y a de plus ennuyeux. Quel agrément pouvez-vous trouver chez des marchands enrichis, qui sont à peu près tout ce qui compose aujourd’hui les classes supérieures ? Les idées rétrécies du comptoir en lutte avec l’ambition de paraître distingué est le contraste le plus sot… Que dirai-je à M. Minoret, par exemple, qui n’a ni instruction, ni envie de plaire, ni envie de parler ?
Il faudrait cultiver les gens aimables, pour le peu qu’il s’en trouve ; avec les gens aimables, la frivolité est charmante, mais la frivolité dans le salon des gens qui ont rangé les comptoirs et mis leurs livres de comptes dans leur armoire pour donner un bal, et qui ont fait endimancher leurs commis pour offrir la main aux dames ! Je préfère une réunion de paysans[669] !
Revenu vers dix heures ; la pluie donnait à toute cette verdure toute fraîche une odeur délicieuse ; les étoiles brillantes, mais surtout cette odeur ! Vers le potager de Gibert, jusqu’à celui de Quantinet, une odeur de ma jeunesse, si pénétrante, si délicieuse, que je ne peux la comparer à rien. Je suis passé et repassé cinq ou six fois : je ne pouvais m’en arracher. Il m’a rappelé l’odeur de certaines petites plantes de potager, — que je voyais à Angerville, dans le jardin de M. Gastillon le père, — qui portent une espèce de fruit qui fait explosion dans la main.
Dans la conversation de ce soir, Mme Barbier m’a parlé de P… ; quoiqu’en laissant percer l’animosité qu’elle conserve peut-être justement, comme elle l’a fait valoir, elle m’a fait réfléchir profondément sur ses qualités, sur son dévouement à sa manière, sur l’affection qu’elle a pour moi, et que je retrouve chez moi pour elle ; il y a des êtres qui naissent accouplés : son souvenir me plaît et me remue toujours.
Lundi 30 mai. — Lu dans le feuilleton de Gautier, sur un jeune violoniste prodige, le mot d’Alphonse Karr[670], qui se trouvait également en présence d’un petit prodige de cette espèce. On lui demande après le morceau comment il le trouve ; il répond qu’il l’aimait mieux auparavant, parce qu’il était plus vieux… Quelle drôle d’idée et amusante !
Suite de ce que j’ai écrit hier dimanche. — Il y a peu de gens avec qui je ne puisse me plaire ; il y en a peu, quand on a le désir de leur plaire soi-même, qui ne vous rendent quelque chose pour vos frais ; j’ai beau chercher dans ma mémoire les gens les moins amusants, il me semble que par le moyen de ce simple désir d’être avec eux le mieux possible, ce qu’ils ont eux-mêmes de chaleur, et je parle des plus froids et des plus revêches, revient à la surface, se montre à vous, vous répond et entretient votre bonne disposition. De ce qu’on les oublie vite et de ce que leur souvenir ne réveille pas en vous la moindre parcelle de sentiment, il ne faut pas conclure que vous soyez un ingrat, ni eux plus intéressants… Ce sont deux métaux, deux corps quelconques qui sont inertes chacun séparément, et qui jettent un peu de flamme quand ils sont en contact. Éloignez-les l’un de l’autre, ils rentrent très justement dans leur insensibilité.
Quand je pense à P…, à R…[671], et que je ne les vois pas, je suis comme le métal insensible… Quand je suis près deux, après les premiers instants pour réchauffer cette glace, je retrouve peu à peu les mouvements d’autrefois : je me fonds près d’eux… peut-être qu’ils sont eux-mêmes étonnés de se sentir amollir, mais je parie que je garde plus longtemps qu’eux la secousse de cette étincelle du souvenir. Nul vil intérêt ne m’éloigne deux. Quand je vois dans mes rêves des gens qui sont mes ennemis, et dont la vue m’offense, quand je suis éveillé, je les trouve charmants, alors je m’entretiens avec eux comme avec des amis, je me sens tout étonné de les trouver si aimables : je me dis, dans ma simplicité de somnambule, que je ne les avais pas assez appréciés, et que je ne leur rendais pas justice ; je me promets de les rechercher et de les voir. Est-ce qu’en rêvant, je devine leurs qualités, ou est-ce qu’en étant éveillé, ma méchanceté, si j’en ai réellement autant qu’eux, s’obstine à ne voir que leurs défauts, ou bien suis-je tout simplement meilleur quand je dors ?
Mardi 31 mai. — Pluie toute la journée ou brouillard. Je n’ai pas quitté ma chambre et m’en suis tiré en travaillant à l’article : j’ai écrit ou copié beaucoup.
Après dîner, continuation de la même disposition ; ce paysage tout embaumé, pendant que je me promenais en long, en large, dans le logement, tout plein d’idées et de bonnes dispositions, me ravissait chaque fois que je tournais la tête pour le regarder… Quelques fables de La Fontaine m’ont enchanté.
Sorti, qu’il faisait encore soir, et promené sur la route de Soisy, dans le même état d’esprit. Le brouillard et le temps mauvais ne font rien pour la tristesse de l’esprit ; c’est quand il fait nuit dans notre âme que tout nous paraît ou lugubre ou insupportable, et il ne suffit pas d’être libre de vrais sujets de tristesse ; il suffit de l’état de la santé pour tout changer… L’infâme digestion est le grand arbitre de nos sentiments.
Mercredi 1er juin. — En ouvrant la fenêtre de l’atelier, le matin, toujours avec ce même temps brumeux, je suis comme enivré de l’odeur qui s’exhale de toute cette verdure trempée de gouttes de pluie et de toutes ces fleurs courbées et ravagées, mais belles encore.
De quels plaisirs n’est pas privé le citadin, le cancre d’employé ou d’avocat, qui ne respire que l’odeur des paperasses ou de la boue de l’infâme Paris ! Quelles compensations pour le paysan, pour l’homme des champs ! Quel parfum que celui de cette terre mouillée, de ces arbres ! Cette forte odeur des bois, qu’elle est pénétrante, et quelle réveille aussitôt des souvenirs gracieux et purs, souvenirs du premier âge et des sentiments qui tiennent au fond de l’âme ! chers endroits où je vous ai vus, chers objets que je ne dois plus revoir, chers événements qui m’avez enchanté et qui êtes évanouis !… Que de fois cette vue de la verdure et cette délicieuse odeur des bois ont réveillé ces souvenirs qui sont l’asile, le saint des saints où on se réfugie, si on peut, sur les ailes de l’âme, pour se tirer du souci de chaque jour ! Cette affection qui me console et, seule, me donne ces mouvements du cœur comme autrefois, combien de temps le sort me les laissera-t-il ?
Dimanche 5 juin. — Tous ces jours derniers, à peu près même vie.
Travaillé et presque terminé l’article ; sorti ordinairement vers trois heures, deux ou trois fois, entre autres, par l’allée de l’Ermitage : vue ravissante… jardin d’Armide, la verdure nouvelle… Les feuilles, étant à toute leur grandeur, donnent une grâce, une frondaison d’une richesse admirable ; le touffu, le rond domine, les troncs garnis de feuilles…
Ce soir, après dîner, sorti par le crépuscule ; au lieu d’aller chez les Barbier, promenade sur la route de Soisy. Charmantes étoiles au-dessus des grands peupliers de la route. En allant, fraîcheur délicieuse. La veille, promenade avant dîner avec Jenny. J’étais ravi du plaisir qu’elle avait, toute souffrante qu’elle était.
Il y a deux jours, avant dîner, par la même grande allée vers Soisy, à partir du grand rond, par une très grande allée couverte remplie de bruyères. Sorti sur de grandes plaines vertes vers Soisy. Carrières reboisées. C’est le jour où j’avais trouvé le troupeau de moutons dans la grande allée ; je l’ai retrouvé là, au loin. Rentré dans la forêt par l’allée qui va au chêne Prieur, où il y a de l’eau.
Lundi 6 juin. — En ouvrant ma fenêtre ce matin par le plus délicieux temps du monde, qui donne tant de regrets de se plonger dans les paperasses, je vois deux hirondelles se poser dans l’allée du jardin ; je remarque quelles ne marchent que très lentement et en se dandinant. Quand elles veulent franchir un espace de deux pieds seulement, elles se mettent à voleter. La nature, qui les a si bien douées avec leurs grandes ailes, ne leur a pas donné des pieds aussi agiles.
Ce spectacle qu’on a de ces fenêtres est délicieux à toutes les heures du jour : je ne puis m’en arracher… L’odeur de la verdure et des fleurs du jardin ajoute encore à ce plaisir.
Mardi 7 juin. — Achevé l’article.
Vers quatre heures, promenade dans la forêt. J’y ai revu les mêmes objets que l’autre jour, dans cette allée qui va à l’Ermitage, éclairés de même ; et cependant ils ne m’ont pas fait le même plaisir.
Dîné chez Mme Barbier ; toute la soirée, on n’a parlé que de l’amour et de ses singularités. Elle a eu l’idée la plus drôle du monde : on parlait de la quantité d’enfants qu’on rencontre à Soisy… « Au fait, dit-elle, que pourraient-ils faire dans un endroit si triste ? On n’y a pas de vue : il faut bien se distraire par quelque chose. »
Le soir, en revenant, les étoiles, qui n’avaient pas paru depuis quelques jours, ont brillé de tout leur éclat. Quel spectacle au-dessus de ces masses noires que forment les arbres, ou aperçues à travers les branches ! J’ai été au jardin de Gibert, et j’ai retrouvé la même odeur divine qui m’avait déjà charmé, mais un peu affaiblie… Je m’en suis éloigné avec peine.
Je crois enfin que je partirai demain. J’ai peut-être un peu moins de plaisir, non pas parce que je suis ici depuis longtemps, mais parce que j’ai arrêté de partir. Je me dis souvent, en pensant à l’amertume qui se joint toujours à tous les plaisirs : Peut-on être véritablement heureux dans une situation qui doit finir ? Cette appréhension de la rapidité et du néant, à la fin, gâte toute jouissance.
Mercredi 8 juin. — Parti le soir à huit heures. — Toute la journée disposition décousue, à cause du départ. — Vu le maire vers trois heures ; dîné à quatre heures. Après dîner, sorti un peu par la porte du jardin. Été jusqu’à la source aux peupliers.
Paris, vendredi 10 juin. — Au Salon le matin, avant le conseil. Je ne remarque rien de très extraordinaire. Le petit Meissonier charmant : le Jeune homme qui déjeune. — Le portrait de Rodakowski, de même. C’est aussi beau que tout.
— Au Palais-Royal, vu Varcollier, en sortant du conseil. Il est installé admirablement. L’occupation et le mouvement lui rendent de la santé.
— Vu Mme de Forget, le soir, qui m’apprend que Vieillard est installé à Saint-Cloud.
Samedi 11 juin. — Travaillé enfin avec assez d’entrain. Il me semblait que je ne pourrais plus peindre. Je finis l’homme qui ferre le cheval.
Le soir chez Chabrier.
Jeudi 16 juin. — Je crois que c’est aujourd’hui que j’ai dîné avec la bonne Alberthe, en société de Saint-Germain, avec lequel j’ai beaucoup causé : il m’a parlé des commencements de Mme Sand, qu’il a connue à ses débuts. Il y avait là une dame russe assez bien.
Alberthe me retient pour aller dimanche voir les pièces du Palais-Royal à la salle Ventadour.
Dimanche 19 juin. — Le soir, avec Alberthe, à la salle Ventadour : le Bourreau des crânes[672]. Nous nous sommes trouvés là en tête-à-tête, et revenus avec tous les accidents du mauvais temps.
Dimanche 26 juin. — Ce matin, l’article du Poussin a paru. Hier encore j’écrivais à Mérimée que je n’avais pas de nouvelles, et le soir, à mon dîner, on est venu me faire corriger les épreuves à la hâte.
J’ai fait ma journée de travail à l’Hôtel de ville ; je suis revenu à pied.
Arrêté longtemps à Saint-Eustache, à entendre les vêpres : cela m’a fait comprendre, quelques instants, le plaisir qu’il y a d’être dévot… J’ai vu passer et repasser tout le personnel de l’église, depuis l’éclopé donneur d’eau bénite, affublé comme un personnage de Rembrandt, jusqu’au curé dans son camail de chanoine et sa chape de cérémonie.
Tout ce retard a été cause de la contrariété que j’ai éprouvée de trouver pour aujourd’hui, en rentrant, l’invitation d’aller dîner à Saint-Cloud. Elle y était depuis neuf heures du matin, avec une lettre de Vieillard. Je me suis pourtant remonté malgré ma fatigue et je m’en suis bien tiré.
Mardi 28 juin. — Depuis que je suis de retour de Champrosay, je ne peux plus écrire ici ; il m’a fallu employer tous mes moments pour terminer les tableaux que j’avais promis ; et depuis samedi 25, je suis retourné travailler à l’Hôtel de ville. J’ai fini, plus promptement que je ne l’aurais cru, le Christ en croix[673] pour Bocquet, la répétition du Christ au tombeau, du Belge[674], pour Thomas, le Christ dormant pendant la tempête pour Grzymala[675].
Je suis sorti aujourd’hui, vers deux heures, de mon travail où j’avais peint pour la première fois au plafond ; j’ai été voir la chapelle de Signol[676] à Saint-Eustache : c’est toujours la même chose que ce que font tous les autres. J’ai été ensuite chez Henry, pour la question de l’Institut[677], qui se présente fort mal.
Mercredi 29 juin. — Musique délicieuse chez l’aimable princesse Marcellini. Le souvenir de la fantaisie de Mozart, morceau grave et touchant au terrible, par moments, et dont le titre est plus léger que ne le comporte le caractère de morceau. Sonate de Beethoven déjà connue, mais admirable. Cela me plaît beaucoup sans doute, surtout à la partie douloureuse de l’imagination. Cet homme est toujours triste. Mozart, qui est moderne aussi, c’est-à-dire qui ne craint pas de toucher au côté mélancolique des choses, comme les hommes de son temps (gaieté française, nécessité de ne s’occuper que de choses attrayantes, bannir de la conversation et des arts tout ce qui attriste et rappelle notre malheureuse condition), Mozart réunit ce qu’il faut de cette pointe de délicieuse tristesse à la sérénité et à l’élégance facile d’un esprit qui a le bonheur de voir aussi les côtés agréables. Je me suis élevé contre leur ami R… qui n’aime pas Cimarosa, qui ne le sent pas, à ce qu’il dit, avec une certaine satisfaction de lui-même. Que Chopin est un autre homme que cela ! Voyez, leur ai-je dit, comme il est de son temps, comme il se sert des progrès que les autres ont fait faire à son art ! Comme il adore Mozart, et comme il lui ressemble peu ! Son ami Kiatkowski lui reprochait souvent quelques réminiscences italiennes, qui sentent, malgré lui, les productions modernes des Bellini, etc… C’est une chose aussi qui me déplaît un peu… Mais quel charme ! Quelle nouveauté d’ailleurs !
1er juillet. — En commission chez M. Fould, pour l’Exposition universelle de 1855.
Samedi 2 juillet. — Travaillé ce matin à la figure de l’Abondance[678]. Mme Cavé à l’Hôtel de ville.
À Saint-Cloud ; ensuite M. Vieillard. — Chabrier venu tout à coup.
Rencontré le soir Véron, qui m’a fait compliment et invité pour vendredi. Je suis rentré la tête tout échauffée.
— Il y a à faire quelque chose sur le romantisme[679].
— M. Meneval avait raconté à Vieillard, qui me le redit aujourd’hui, ce trait de l’empereur Napoléon Ier : il visitait un monument en construction dont, sans doute, il avait examiné les mémoires ; en passant sur un sol couvert de dalles de marbre, il frappa du pied, et répétant avec une canne qu’il demanda, l’espèce d’expérience qu’il semblait faire, il demanda de quelle épaisseur était chaque dalle de marbre. Sur la réponse qui lui fut faite, il envoya chercher un ouvrier, et lui fit desceller, en sa présence, un des morceaux de marbre, qui fut trouvé de la moitié de l’épaisseur qui avait été annoncée.
Mercredi 6 juillet. — J’ai été ce soir voir la princesse Marcellini ; par extraordinaire, elle était seule… son fils un peu malade. Elle a eu la bonté de ne me jouer que du Chopin, et tout admirable. Elle m’invite à dîner pour mercredi prochain.
Jeudi 7 juillet. — Travail tous ces jours-ci au maudit plafond par une chaleur étouffante, qui me fait bénir mon étoile d’être né dans un climat où on n’éprouve ce martyre que quelques jours de l’année.
Vendredi 8 juillet. — Dîné chez Véron, que j’avais rencontré il y a quelques jours sur le boulevard. Il m’avait complimenté sur mon article du Poussin. Jusqu’à présent, j’ai récolté un assez grand nombre de compliments à cette occasion. Cela me payera-t-il de l’ennui que j’ai eu à le faire ?
Véron me demande des notes sur moi et quelques gens de ma connaissance, dont il se servirait pour des Mémoires sur l’époque de la Restauration[680].
Adam[681] nous conte, entre autres traits de Cherubini, qui était inépuisable en boutades chagrines ou désobligeantes, qu’un graveur, ayant fait son portrait dans une médaille qu’il avait publiée, lui en apportait un certain nombre qu’il avait de reste, pensant qu’il en pourrait gratifier ses parents et amis ; il lui répond : « Je ne donne rien à mes parents et je n’ai pas d’amis. »
J’ai, ce matin, été à une commission à l’instruction publique, pour renouveler l’enseignement du dessin.
Dimanche 10 juillet. — J’ai été, après mon travail, au Salon, pour examiner les tableaux, relativement à la distribution des médailles. Ce mode de les donner me paraît des plus vicieux. Tous ceux qui, comme moi, sont chargés de ce choix auront été frappés du même inconvénient. Il arrive presque toujours que chaque peintre qui me paraît mériter une troisième, une deuxième, ou une première médaille, l’a déjà obtenue.
Voilà, par exemple, un homme qui a déjà eu la deuxième ; lui donnera-t-on la première parce qu’il mérite la deuxième qu’on ne peut pas lui donner ? Il arrive ainsi qu’un artiste reçoit rarement une récompense pour celui de ses ouvrages qui la mérite davantage. C’est au moment où il fait un chef-d’œuvre qu’on n’a rien à lui offrir pour le récompenser ou l’encourager. Celui qui fait bien deux fois a plus de mérite que celui qui fait bien une fois. Si les femmes donnaient la médaille, elles seraient de cet avis. Mlle Rosa Bonheur[682] a fait cette année un effort supérieur à tous ceux des années précédentes ; vous êtes réduit à l’encourager de la voix et du geste. M. Rodakowski, qui a fait un chef-d’œuvre cette année[683], est obligé de se consoler avec la médaille qu’il a obtenue l’année dernière pour un ouvrage inférieur. M. Ziem, avec sa Vue de Venise, se maintient à la hauteur de ses tableaux de l’année dernière ; mais il est interdit au jury de lui témoigner sa satisfaction[684]. Par contre, voici une Annonciation de M. Jalabert[685], qui est un tableau de deuxième médaille. Or, M. Jalabert l’ayant obtenue déjà, lui donnera-t-on la première, qui est une récompense supérieure au mérite de son tableau de cette année ? Si vous êtes juste et si vous suivez le règlement, vous ne lui donnerez rien, et cependant il mérite quelque chose. Doit-on assimiler les artistes qui mettent au Salon à ces élèves de petites pensions, dans lesquelles le maître, pour encourager les parents encore plus que les élèves, donne des prix à tout le monde ? Si le but des récompenses est de s’adresser à ce qui est supérieur dans une exposition, il faut récompenser tout ce qui s’élève, mais dans la juste proportion du mérite de l’œuvre, et si l’artiste présente dans son ouvrage la dose de talent qui lui attribue la troisième, la deuxième ou la première médaille, il est juste qu’il l’obtienne, quand même il l’aurait déjà obtenue ; ce serait un meilleur moyen d’entretenir l’émulation et de donner quand même des récompenses, de telle sorte que tout homme doué d’une dose de talent raisonnable puisse se flatter d’arriver aux récompenses à son tour.
Mardi 16 août. — Jenny partie pour Dieppe ; elle me manque fort ici.
Dimanche 28 août. — Tous ces jours derniers, travaillé à l’Hôtel de ville ; j achève le plafond. Aujourd’hui, je suis resté à la maison jusqu’à midi et demi. Avancé le petit Christ portant sa croix et le Berlichingen ou Weislingen.
À une heure, à la distribution de l’École gratuite. — Revenu avec Fleury[686]… La chaleur est tombée tout à fait. Le jour où je l’ai vu, quelques jours avant l’élection, et où il m’a avoué qu’il ne votait pas pour moi, ce n’étaient que protestations pour la prochaine fois ; aujourd’hui, le voilà planté là avec tous les honneurs de la guerre, membre s’il en fut, professeur, etc. ; il n’a plus qu’une faible estime pour les infortunés qui sont encore sur le terrain de tout le monde.
Le soir, j’ai été voir Britannicus et l’École des maris, et tous les deux m’ont enchanté. Beauvallet a été très bon dans Burrhus ; j’ai trouvé là avec plaisir Thierry[687].
Vendredi 2 septembre. — Dîné chez Véron ; je lui avais rapporté ses épreuves.
Lundi 26 septembre. — Plafond de Saint-Sulpice. — Samson et Dalila[688].
Dessins d’après des costumes et armures pour la Jérusalem. — Les deux Marocains. — Le Christ portant sa croix[689]. — Tableau de Beugniet (Berlichingen). — Lion (id.). — Christ dans le bateau.
Mercredi 28 septembre. — Sept heures du matin, en me levant. — On ne se figure pas à quel point la médiocrité abonde : Lefuel[690], Baltard, mille exemples, qui se pressent, de gens chargés de grosses affaires dans les arts, dans le gouvernement, dans les armées, dans tout. Ce sont ces gens-là qui enrayent partout la machine lancée par les hommes de talent. Les hommes supérieurs sont naturellement novateurs. Ils arrivent et trouvent partout la sottise et la médiocrité qui tient tout dans sa main, et qui éclate dans tout ce qui se fait. Leur impulsion la plus naturelle les jette à redresser, à tenter des routes nouvelles, pour sortir de cette platitude et de cette sottise. S’ils réussissent et qu’ils finissent par avoir le dessus sur les routines, ils ont pour eux, à leur tour, les incapables, qui se font un mérite d’outrer leurs pratiques, et qui gâtent encore tout ce qu’ils touchent. Après ce mouvement, qui porte les novateurs à sortir de l’ornière tracée, vient presque toujours celui qui les porte, à la fin de leur carrière, à retenir l’impulsion indiscrète qui va trop loin et qui ruine par l’exagération ce qu’ils ont inventé. Ils se prennent à vanter ce qu’ils ont été cause qu’on a abandonné, en voyant le triste usage qu’on fait des nouveautés qu’ils ont lancées dans le monde. Peut-être y a-t-il un secret mouvement d’égoïsme qui les porte à régenter à ce point leurs contemporains, que personne ne puisse qu’eux-mêmes toucher à ce qui leur paraît critiquable ? Ils sont médiocres par ce côté ; cette faiblesse leur fait jouer souvent un rôle ridicule et indigne de la considération qu’ils ont acquise.
Champrosay. — Jeudi 6 octobre. — Parti pour Champrosay à onze heures. J’ai eu cette fois deux fiacres pour me transporter et faire transporter mes bagages ; moyen préférable et plus économique que celui de la voiture du commissionnaire.
J’étais souffrant depuis plus d’une semaine. Dimanche, j’ai pris un froid aux oreilles qui m’a donné des douleurs dont je souffre encore : c’était pendant mon équipée du Jardin des Plantes. J’ai pu dire, en arrivant comme Tancrède, ce que je dis toujours en arrivant ici :
Avant dîner, le temps était fort beau, contre son habitude ; j’ai fait un grand tour de forêt au détriment de ma chaussure et de mon pantalon. Pris par l’allée qui mène au chêne Prieur ; mais, à moitié chemin, pris l’allée qui descend vers le milieu, pour tomber sur la grande route qui croise celle de l’Ermitage. Sentiment délicieux de la solitude et de l’indépendance, en rentrant dans mon ermitage et en m’attablant… Je l’ai bien éprouvé le lendemain, et j’espère qu’il sera ainsi tout le temps que je serai ici.
Vendredi 7 octobre. — Grande promenade dans le jardin. Ravi par les odeurs de fleurs et du raisin. Mais étant remonté dans une situation paresseuse, elle s’est prolongée toute la journée que je suis resté à lire le Spectateur, à dormir, à le reprendre.
Le soleil s’était montré dans la journée, et j’ai eu l’esprit d’attendre qu’il fût passé, pour me mettre en route, vers trois heures seulement, ou deux heures. Une pluie battante m’a pris dans la forêt ; heureusement, elle s’est calmée au moment où j’allais rentrer, et j’ai continué par une allée que je n’avais jamais prise, partant de ce même centre qui va au chêne Prieur et à l’allée descendante, mais plus à droite, et remplie de bruyères. Remonté ensuite au chêne, etc.
Rentré avec appétit, ce qui est le grand point pour que la digestion se fasse convenablement. Dîné dans mon atelier, où je suis mieux pour cela, et arpenté toute la soirée le logement en tous sens, car la pluie et l’obscurité rendent toute sortie bien difficile, le soir. Samedi 8 octobre. — J’ai lu hier l’excellent passage du Spectateur sur la vieillesse. Je me réserve de le copier tout entier.
Je crois me rappeler qu’il met au premier rang des avantages quelle nous donne sur la jeunesse, la tranquillité. Effectivement, c’est là le véritable bien dont le vieillard doit jouir, s’il vit selon l’état où il est arrivé. Quoiqu’on dise que la vieillesse est l’âge de l’ambition, ce ne peut être que celui d’une ambition légitime ou facile, en comparaison, à satisfaire. En effet, quand on voit un homme mûr aspirer aux honneurs, ce ne peut être, à moins de folie complète de sa part, qu’à ceux auxquels il a le droit d’espérer comme étant la suite des avantages qu’il a su déjà se faire et de la position qu’il a prise par les travaux de toute sa vie. Certes, on ne se fait pas une carrière à cinquante ans. On goûte alors les fruits de celle qu’on s’est faite ; les honneurs vont trouver naturellement celui qui possède déjà la considération. Il faut donc au vieillard, je ne dirai pas dans la poursuite, ce mot sent encore trop la jeunesse, mais dans la recherche calme des prérogatives auxquelles il a droit, la même tranquillité que je regarde comme le souverain bien à cet âge. Que si la fortune n’a pas favorisé les efforts de la jeunesse, car je ne parle toujours ici que de celui qui a fait preuve de mérite ou de constance, si la position est médiocre, une longue habitude de cette médiocrité doit la lui rendre moins pénible, de même que la perspective de la continuation du même état jusqu’à la fin de sa vie. Est-il rien de plus ridicule que de s’agiter dans l’âge où tout invite, où tout force au repos ? d’être le compétiteur de gens doublement encouragés par la force de l’âge et par l’intérêt qui s’attache à la jeunesse ? L’homme de mérite que les circonstances n’ont pas servi, doit jouir encore, dans la situation où il voit s’achever ses jours, du calme que cette situation comporte ; et il n’y a que la misère qui puisse rendre cette condition intolérable ; et ceci ne s’adresse pas à ceux qui seraient, par un hasard fort rare et malgré de notables qualités, tombés dans un état si bas. C’est de la force d’âme alors, et une force bien rare, qui serait nécessaire à cet infortuné, pour faire tête au malheur. Chez celui-là, il y aurait encore lieu à tirer des consolations du sentiment de son propre mérite et de l’injustice de la fortune.
La jeunesse voit tout devant elle et veut aspirer à tout ; c’est ce qui fait son inquiétude et son agitation continuelles. L’idée du repos est aussi incompatible avec cet âge que celle de l’agitation l’est pour la vieillesse. Le vieillard, au contraire, serait inexcusable d’entretenir cette agitation fiévreuse. Il a mesuré ses forces et il connaît le prix du temps ; il sait celui qu’il lui faudrait pour parvenir à un but incertain. Il faut, à son âge, avoir atteint celui auquel on tendait, et non pas remettre encore en question quel sera l’avenir. Ce sont toutes ces raisons qui doivent le porter au calme et lui faire tirer de la position telle quelle qu’il s’est acquise, tout le fruit quelle comporte raisonnablement.
Samedi 8 octobre. — Il faut mettre ici mon aventure de la forêt. Parti vers une heure et demie, après avoir travaillé, je suis passé sans m’en apercevoir dans le grand Senart ; tous les poteaux sont repeints pour les menus plaisirs de Fould, qui a fait restaurer la faisanderie. J’ai donc erré, pendant près de cinq heures, dans les marécages de la forêt, car je ne marchais que dans une boue grasse et glissante, sans savoir où j’allais. Un bonhomme que j’ai rencontré dans le moment le plus embarrassant m’a aidé à me retrouver, et je suis revenu par Soisy à cinq heures et demie, assez fatigué, mais très heureux de n’avoir pas éprouvé le désagrément de coucher dans la forêt.
Dimanche 9 octobre. — Peint le Christ dans la barque[691], d’après mon ancienne esquisse, jusqu’à deux heures.
Sorti vers la partie de Draveil. Fait un grand tour en contournant la forêt, et revenu par les environs du chêne Prieur. Je me porte mieux : j’espère grandement en ce petit séjour pour me remettre tout à fait.
J’écris à la cousine :
« La rareté des visites que je fais en ce lieu me le fait trouver charmant, quand j’y reviens. Le secret du bonheur n’est pas de posséder les choses, mais d’en jouir ; je serais certes moins heureux d’être le maître d’un grand château où je m’ennuierais et où je serais ennuyé par les autres. Mais ceux qui n’aiment pas la solitude ne peuvent sentir le plaisir que j’éprouve à être roi dans une bicoque ! La liberté, mais des loisirs occupés, l’esprit en travail sans cesse font trouver enchanteurs tous les sites et tous les temps possibles. Pendant ces jours de pluie, je n’ai pas été ennuyé jusqu’à présent. »
Lundi 10 octobre. — Surpris ce matin, pendant que j’étais en train de peindre, par Mme Villot, Mme Halévy, Halévy[692], ses enfants, Georges et le frère de Mme Villot. Cette invasion dans ma cabane m’a désagréablement surpris et m’a laissé à la fin très satisfait.
J’ai dîné aujourd’hui chez Mme Villot et demain chez Halévy.
Travaillé beaucoup le fond de la Sainte Anne[693] sur un dessin d’arbres d’après nature, que j’ai fait dimanche, sur la lisière de la forêt vers Draveil.
Travaillé au Christ dans la barque, de Petit[694].
Vers deux heures, charmante promenade vers les carrières de Soisy. Revenu par le chêne Prieur et l’allée de l’Ermitage. Beaux effets au chêne Prieur, qui se détachait entièrement en ombre sur l’allée claire et fuyante.
La conversation de ces oisifs est bien ennuyeuse, quand ils se lancent dans les chevaux, les spectacles ; des discussions qui durent une heure sur une bride, une selle, etc.
Faire un Dictionnaire des arts et de la peinture[695] : thème commode. Travail séparé pour chaque article.
Autorités. — La peste pour les grands talents et la presque totalité du talent pour les médiocres. Elles sont des lisières qui aident tout le monde à marcher, quand on entre dans la carrière, mais elles laissent à presque tout le monde des marques ineffaçables. Les gens comme Ingres ne les quittent plus. Ils ne font pas un pas sans les invoquer. Ils sont comme des gens qui mangeraient de la bouillie toute leur vie ; ainsi de suite.
— Dumas, ce matin, commence ainsi l’analyse de la pièce d’Antony, dans la Presse : « Cette pièce a donné lieu à de telles controverses, que je demande la permission de ne pas l’abandonner ainsi ; d’ailleurs, non seulement c’est mon œuvre la plus originale, mon œuvre la plus personnelle, mais encore c’est une de ces œuvres rares qui ont une influence sur leur époque. »
Dîné chez Halévy, à Fromont[696] ; je suis toujours sourd comme un pot : heureusement que l’indisposition va changeant de côté et se porte tantôt à droite, tantôt à gauche. Il y avait là Viegra, Vatel, l’ancien directeur des Italiens, etc. Comment entretiendront-ils cette magnifique habitation ?… Hier, le général Parchappe[697] répondait à mon admiration pour ce beau lieu, en disant que la maison était pitoyable, et qu’il fallait la rebâtir pour la rendre habitable.
Mercredi 12 octobre. — Dîné chez Mme Barbier. Mme Villot revenue le soir ; j’ai parlé imprudemment, avec certains regrets, des restaurations des tableaux du Musée : le grand Véronèse, que ce malheureux Villot a tué sous lui[698], a été un texte sur lequel je n’ai pas trop insisté, en voyant avec quelle chaleur elle défendait la science de son mari. Elle ne lui trouve probablement que cette qualité, et elle l’en pare comme de raison. Elle m’a dit qu’en fait de restauration, il ne se donnait pas un coup de pinceau, à moins que M. Villot ne prît lui-même la palette. Grande recommandation, à ce qu’on peut croire !
Dans la journée, travaillé un peu mollement, et pourtant avec succès, à la petite Sainte Anne. Le fond refait sur des arbres que j’ai dessinés il y a deux ou trois jours, à la lisière de la forêt vers Draveil, a changé tout ce tableau. Ce peu de nature prise sur le fait, et qui pourtant s’encadre avec le reste, lui a donné un caractère. J’ai repris également pour les figures, les croquis faits à Nohant d’après nature, pour le tableau de Mme Sand. J’y ai gagné de la naïveté et de la fermeté dans la simplicité.
De l’emploi du modèle. — C’est cet effet qu’il faut obtenir de l’emploi du modèle et de la nature en général ; c’est aussi la chose la plus rare dans la plupart des tableaux où le modèle joue un grand rôle. Il tire tout à lui, et il ne reste plus rien du peintre. Chez un homme très savant et très intelligent à la fois, son emploi bien entendu supprime, dans le rendu, les détails que le peintre, qui fait d’idée, prodigue toujours trop, de peur d’omettre quelque chose d’important, et qui empêche de toucher franchement et de mettre dans tout leur jour les détails vraiment caractéristiques. Les ombres, par exemple, sont toujours trop détaillées dans la peinture faite d’idée, dans les arbres particulièrement, dans les draperies, etc.
Rubens est un exemple remarquable de l’abus des détails. Sa peinture, où l’imagination domine, est surabondante partout ; ses accessoires sont trop faits ; son tableau ressemble à une assemblée où tout le monde parle à la fois. Et cependant, si vous comparez cette manière exubérante, je ne dirai pas à la sécheresse et à l’indigence modernes, mais à de très beaux tableaux où la nature a été imitée avec sobriété et plus d’exactitude, vous sentez bien vite que le vrai peintre est celui chez lequel l’imagination parle avant tout.
Jenny me disait hier, avec son grand bon sens, quand nous étions dans la forêt et que je lui vantais la forêt de Diaz, « que l’imitation exacte n’en était que plus froide », et c’est la vérité ! Ce scrupule exclusif de ne montrer que ce qui se montre dans la nature rendra toujours le peintre plus froid que la nature qu’il croit imiter ; d’ailleurs, la nature est loin d’être toujours intéressante au point de vue de l’effet de l’ensemble. Si chaque détail offre une perfection, que j’appellerai inimitable, en revanche la réunion de ces détails présente rarement un effet équivalent à celui qui résulte, dans l’ouvrage du grand artiste, du sentiment de l’ensemble et de la composition[699]. C’est ce qui me faisait dire tout à l’heure que, si l’emploi du modèle donnait au tableau quelque chose de frappant, ce ne pouvait être que chez des hommes très intelligents : en d’autres termes, qu’il n’y avait que ceux qui savent faire de l’effet, en se passant du modèle, qui puissent véritablement en tirer parti, quand ils le consultent.
Que sera-ce d’ailleurs, si le sujet comporte beaucoup de pathétique ? Voyez comme, dans de pareils sujets, Rubens l’emporte sur tous les autres ! Comme la franchise de son exécution, qui est une conséquence de la liberté avec laquelle il imite, ajoute à l’effet qu’il veut produire sur l’esprit !… Voyez cette scène intéressante, qui se passera, si vous voulez, autour du lit d’une femme mourante : rendez, s’il est possible, saisissez par la photographie, cet ensemble ; il sera déparé par mille côtés. C’est que, suivant le degré de votre imagination, la scène vous paraîtra plus ou moins belle ; vous serez poète plus ou moins, dans cette scène où vous êtes acteur ; vous ne voyez que ce qui est intéressant, tandis que l’instrument aura tout mis.
Je fais cette observation et je corrobore toutes celles qui précèdent, c’est-à-dire la nécessité de beaucoup d’intelligence dans l’imagination, en revoyant les croquis faits à Nohant pour la Sainte Anne : le premier, fait d’après nature, est insupportable, quand je revois le second, qui pourtant est presque le calque du précédent, mais dans lequel mes intentions sont plus prononcées et les choses inutiles éloignées, en introduisant aussi le degré d’élégance que je sentais nécessaire pour atteindre à l’impression du sujet.
Il est donc beaucoup plus important pour l’artiste de se rapprocher de l’idéal qu’il porte en lui, et qui lui est particulier, que de laisser, même avec force, l’idéal passager que peut présenter la nature, et elle présente de telles parties ; mais encore un coup, c’est un tel homme qui les y voit, et non pas le commun des hommes, preuve que c’est son imagination qui fait le beau, justement parce qu’il suit son génie.
Ce travail d’idéalisation se fait même presque à mon insu chez moi, quand je recalque une composition sortie de mon cerveau. Cette seconde édition est toujours corrigée et plus rapprochée d’un idéal nécessaire ; ainsi, il arrive ce qui semble une contradiction et qui explique cependant comment une exécution trop détaillée comme celle de Rubens, par exemple, peut ne pas nuire à l’effet sur l’imagination. C’est sur un thème parfaitement idéalisé que cette exécution s’exerce ; la surabondance des détails qui s’y glissent, par suite de l’imperfection de la mémoire, ne peut détruire cette simplicité bien autrement intéressante qui a été trouvée d’abord dans l’exposition de l’idée, et, comme nous venons de le voir à propos de Rubens, la franchise de l’exécution achève de racheter l’inconvénient de la prodigalité des détails. Que si, au milieu d’une telle composition, vous introduisez une partie faite avec grand soin d’après le modèle, et si vous le faites sans occasionner un désaccord complet, vous aurez accompli le plus grand des tours de force, accordé ce qui semble inconciliable ; en quelque sorte, c’est l’introduction de la réalité au milieu d’un songe ; vous aurez réuni deux arts différents, car l’art du peintre vraiment idéaliste est aussi différent de celui du froid copiste que la déclamation de Phèdre est éloignée de la lettre d’une grisette à son amant. La plupart de ces peintres, qui sont si scrupuleux dans l’emploi du modèle, n’exercent la plupart du temps leur talent de le copier avec fidélité que sur des compositions mal digérées et sans intérêt. Ils croient avoir tout fait, quand ils ont reproduit des têtes, des mains, des accessoires imités servilement et sans rapport mutuel.
— Fait une promenade avec Jenny vers le chêne Prieur. Sortis par la lisière de la forêt et revenus par la grande allée. Ces bruyères, ces fougères, cette herbe fine et verte rappelaient à la pauvre femme son pays et sa jeunesse.
— Sur l’imitation de la nature, ce grand point de départ de toutes les écoles et sur lequel elles se divisent profondément, aussitôt qu’elles l’interprètent, toute la question semble réduite à ceci : l’imitation est-elle faite en vue de plaire à l’imagination ou de satisfaire simplement une sorte de conscience d’une singulière espèce, qui consiste, pour l’artiste, à être content de lui quand il a copié, aussi exactement que possible, le modèle qu’il a sous les yeux ?
Jeudi 13 octobre. — Travaillé beaucoup au Christ dormant dans ta tempête, pour Petit[700]. Sorti vers trois heures et fait une longue course dans la forêt, dans les coupes des environs du chêne d’Antain.
Vendredi 14 octobre. — C’était aujourd’hui la corvée de R… à Paris. Je suis parti le matin chez Mme Villot pour m’excuser de lui avoir manqué de parole hier ; elle m’a parlé de la situation de H. V…
Impossibilité de voyager dans ces maudits chemins de fer sans être assassiné par la conversation. J’y ai trouvé un personnage que j’ai vu autrefois chez Mme Marliani, et que j’avais déjà rencontré dans cette maudite voiture… Bavardages sans fin sur le gothique, etc.
En revenant, de même, mon confrère Chevalier, que je révère, m’a trouvé dans l’omnibus et reconduit jusqu’à Ris. J’étais obligé de me tourner vers lui, pendant que je mourais d’envie de voir le paysage : il m’a gâté tout le plaisir de mon retour. J’étais encore destiné à une autre rencontre : Mme Villot, son frère, ses frères, que sais-je ? étaient allés au-devant du cher M. Villot ; il a fallu poliment remonter avec eux.
Samedi 15 octobre. — Dîné chez Mme Villot. Il a été question de peinture à l’huile d’olive.
Si cette invention eût été faite il y a trente ans, ainsi que celle du daguerréotype, peut-être ma carrière eût-elle été plus remplie. La facilité de peindre à chaque instant, sans avoir l’ennui de palette, ensuite l’instruction que donne le daguerréotype à un homme qui peint de mémoire, sont des avantages inestimables.
Dimanche 16 octobre. — Achevé ou presque achevé le Weislingen. Promenade vers Soisy par la forêt. Vu les derrières du parc Vandeuil (actuel) : il y a des effets superbes. — Plus loin, en remontant, j’ai dessiné un site superbe.
Lu un article des Mémoires de Dumas sur Trouville, où il y a des choses charmantes… Que manque-t-il à ces gens-là ? du goût, du tact, l’art de choisir dans tout ce qui leur vient et celui de savoir s’arrêter à propos. Il est probable qu’ils ne travaillent pas ; leur suffirait-il de travailler, pour acquérir ce qui leur manque ?… Je ne le crois pas.
Lundi 17 octobre. — Après une journée de travail et un peu, je crois, de sommeil, parti tard vers Soisy. La pluie a détrempé les routes. J’ai fait le croquis du lavoir au soleil couchant. Descendu dans la ruelle où j’avais une fois trouvé un chat charmant. Rencontré Baÿvet en revenant. Voilà un homme à l’ancienne mode, à la mienne : il était pataugeant sur la route comme moi, et visitant ses travaux ; il portait de vieux habits dont son domestique ne voudrait certes pas ; son pantalon était retroussé de peur de la crotte. C’est ainsi qu’on faisait quand on désirait ne pas se gêner chez soi ou à la campagne. M. X… ou M. Y…, enfin tel sot à la moderne, serait bien malheureux d’être rencontré dans l’équipage où le pauvre Baÿvet se promenait tranquillement avec la conscience tranquille de ses cent mille livres de revenu, au milieu de tout cela.
J’éprouve tous les jours, et particulièrement quand il fait du soleil, un charme pénétrant en ouvrant ma fenêtre ; il y a dans le spectacle de la tranquillité de la nature un attrait plus particulier encore pour l’homme qui vieillit et qui apprécie la tranquillité et le calme. Il me semble que ce spectacle est fait pour moi. Une ville ne peut rien offrir de semblable : partout l’agitation qui ne convient qu’à la sotte jeunesse.
— J’écris à Piron :
« Je ne voulais venir ici que pour cinq ou six jours ; en voilà bientôt quinze que j’y suis, et je ne pense pas à revenir. La campagne m’est nécessaire de temps en temps. Comme j’y travaille, elle ne m’assomme pas, comme ceux qui se condamnent à y passer six mois de suite. Les gens du monde y vont mécaniquement au mois de juillet, et ils en reviennent en décembre ; moi, j’y vais quinze jours de temps en temps et de loin en loin. Plus il y a longtemps que je n’y ai été, plus j’en jouis ; j’aime aussi à y mener une vie opposée à celle de Paris ; j’abhorre les visites et les dérangements des voisins… Cette nature que je vois rarement me parle alors et me renouvelle. Une promenade dans la forêt, après que j’ai consacré ma matinée au travail, est un véritable délice, mais il faut absolument faire quelque chose. »
— Toujours sur l’emploi du modèle et sur l’imitation.
Jean-Jacques dit avec raison qu’on peint mieux les charmes de la liberté quand on est sous les verrous, qu’on décrit mieux une campagne agréable quand on habite une ville pesante et qu’on ne voit le ciel que par une lucarne et à travers les cheminées. Le nez sur le paysage, entouré d’arbres et de lieux charmants, mon paysage est lourd, trop fait, peut-être plus vrai dans le détail, mais sans accord avec le sujet. Quand Courbet a fait le fond de la femme qui se baigne, il l’a copié scrupuleusement d’après une étude que j’ai vue à côté de son chevalet. Rien n’est plus froid ; c’est un ouvrage de marqueterie. Je n’ai commencé à faire quelque chose de passable, dans mon voyage d’Afrique, qu’au moment où j’avais assez oublié les petits détails pour ne me rappeler dans mes tableaux que le côté frappant et poétique ; jusque-là, j’étais poursuivi par l’amour de l’exactitude, que le plus grand nombre prend pour la vérité.
— J’ai travaillé toute la journée par la pluie à la petite Sainte Anne, et j’ai fait une esquisse du Soleil couchant que j’ai dessiné hier, au lavoir.
Petit tour avant dîner, malgré les mauvais chemins dans la forêt, le long de Baÿvet, avec ma bonne et pauvre Jenny[701], dont la santé paraît meilleure et m’enchante… Quel profond bon sens dans cette fille de la nature, et quelle vertu au fond de ses préjugés les plus singuliers !
J’avais refusé le dîner de Mme Villot ; j’ai été la joindre et sa société, comme elle était au dessert, et nous avons achevé la soirée chez Mme Barbier. J’ai ri aux larmes presque tout le temps, aussi bien de ce que je lui disais que de ce qu’elle me répondait. Elle m’a raconté l’aventure de son ami Chevigné, qui vient un de ces jours derniers pour la voir, et qui trouve dans le chemin de fer cet être antipathique qui se trouvait venir aussi chez elle et qu’il voyait par conséquent sans cesse à ses côtés ou devant lui tout le temps, y compris la voiture qui devait les ramener du chemin de fer chez elle.
Le livre de Véron[702] était là sur la table… Une femme qui n’est pas sotte, et qui est là, le trouve ennuyeux ; c’est une façon d’exprimer qu’il lui a déplu, et il déplaira à la moindre personne qui a quelque notion de ce que c’est qu’une chose passable. Nulle philosophie (grand article sur ce mot à propos des arts en général : sans cette philosophie que j’entends, nulle durée pour le livre ou pour le tableau, ou plutôt nulle existence) ; ce tas d’anecdotes, les unes intéressantes, les autres niaises et dignes d’amuser des laquais ; des nomenclatures, des répétitions textuelles de pièces historiques, qui sont partout, pour qui veut les y aller chercher, ne constituent pas un livre. C’est une anonyme réunion de pièces de toutes couleurs, auxquelles il a ôté la couleur en les ajustant… Quoi ! pas une réflexion pour souder un fait à un autre, ou plutôt quelles réflexions !… Car je me trompe : il met du sien de temps en temps ; mais quelle vulgarité ! Le pauvre homme a donné prématurément sa mesure. Après avoir pris la peine de nous ôter la pensée qu’il était capable d’écrire quelque chose qui eût le sens commun, il s’amuse même à détruire ce faible prestige qui l’entourait, à savoir qu’il avait quelque capacité pour les affaires, et que son savoir-faire du moins l’avait conduit à la fortune… Point du tout ; il établit que toutes ses combinaisons pour faire ses affaires ont été déjouées par le hasard, et que c’est le même hasard qui l’a fait réussir souvent par les moyens les plus inattendus et les plus opposés à ses prévisions.
Je n’ai, dans le jugement que je porte, nulle animosité ; au contraire, je l’aime beaucoup, malgré ses airs cavaliers ; mais ils sont inséparables du parvenu. Je crois qu’il perdra beaucoup à ce livre malencontreux. Il gagnait beaucoup, au contraire, à ne pas le publier, mais à laisser croire qu’il s’en occupait. Il confirme malheureusement tout ce que les gens plus fins que le vulgaire pouvaient augurer de lui… Je l’ai toujours pensé plus important par son air que par ses qualités réelles.
Un certain tact m’a rarement trompé ; j’écrivais ici, il y a quelque temps, sur la quantité des hommes médiocres ; mais que de degrés encore dans la médiocrité ! En voici un de la dernière catégorie ! J’entends parmi ceux qui se piquent d’œuvres d’esprit. Il sert à faire voir la valeur de ceux qui sont des chefs de bande, comme Dumas, par exemple, dont il est tant question depuis quelques jours. Mis en regard de Véron, Dumas paraît un grand homme, et je ne doute pas que ce ne soit son opinion à lui-même ; mais qu’est-ce que Dumas et presque tout ce qui écrit aujourd’hui, en comparaison d’un prodige tel que Voltaire, par exemple ? Que deviennent, à côté de cette merveille de lucidité, d’éclat et de simplicité tout ensemble, ce bavardage désordonné, cet alignement sans fin de phrases et de volumes semés de bonnes et de détestables choses, sans frein, sans loi, sans sobriété, sans ménagement pour le bon sens du lecteur ! Celui-là donc est médiocre dans l’emploi de facultés qui sont pourtant au-dessus de l’ordinaire ; ils se ressemblent tous… La pauvre Aurore[703] elle-même lui donne la main pour des défauts analogues, à côté de qualités de beaucoup de valeur. Ils ne travaillent ni l’un ni l’autre, mais ce n’est pas par paresse. Ils ne peuvent pas travailler, c’est-à-dire élaguer, condenser, résumer, mettre de l’ordre. La nécessité d’écrire à tant la page est la funeste cause qui minerait de plus robustes talents encore. Ils battent monnaie[704] avec les volumes qu’ils entassent ; le chef-d’œuvre est aujourd’hui impossible.
Jeudi 20 octobre. — Quelle adoration que celle que j’ai pour la peinture ! Le seul souvenir de certains tableaux me pénètre d’un sentiment qui me remue de tout mon être, même quand je ne les vois pas, comme tous ces souvenirs rares et intéressants qu’on retrouve de loin en loin dans sa vie, et surtout dans les toutes premières années.
Hier je revenais de Fromont, où je me suis fort ennuyé : j’arrive chez Mme Villot, à qui j’avais à rapporter son ombrelle de la part des habitants de Fromont. Elle était là avec Mme Pécourt, qui a parlé des tableaux de son mari[705]. Là-dessus, Mme V… a rappelé quelques-uns de ceux de Rubens qu’elle a vus à Windsor. Elle a parlé d’un grand portrait équestre, d’une de ces grandes figures d’autrefois, armées de toutes pièces, avec un jeune homme près de lui. Il m’a semblé que je le voyais. Je sais beaucoup de ce que Rubens a fait, et crois savoir tout ce qu’il peut faire. Ce seul souvenir d’une femmelette qui certes n’a pas éprouvé, en voyant le tableau, l’émotion que je ressens seulement en me le figurant, sans l’avoir vu, a réveillé en moi les grandes images de ceux qui ont tant frappé ma jeunesse à Paris, au Musée Napoléon, et en Belgique, dans les deux voyages que j’y ai faits.
Gloire à cet Homère[706] de la peinture, à ce père de la chaleur et de l’enthousiasme dans cet art où il efface tout, non pas, si l’on veut, par la perfection qu’il a portée dans telle ou telle partie, mais par cette force secrète et cette vie de l’âme qu’il a mise partout. Chose singulière ! le tableau qui m’a peut-être donné la sensation la plus forte, l’Élévation en croix, n’est pas celui où brillent le plus les qualités qui lui sont propres et où il est incomparable. Ce n’est ni par la couleur, ni par la délicatesse ou la franchise de l’exécution que ce tableau l’emporte sur les autres, et, chose bizarre, c’est par des qualités italiennes, qui chez les Italiens ne me ravissent pas au même degré ; et je trouve à propos de me rendre compte ici du sentiment tout à fait analogue que j’ai éprouvé devant les batailles de Gros et devant la Méduse, surtout quand je l’ai vue à moitié faite. C’est quelque chose de sublime, qui tient en partie à la grandeur des personnages. Les mêmes tableaux en petite dimension me produiraient, j’en suis sûr, un tout autre effet. Il y a aussi dans celui de Rubens et dans celui de Géricault un je ne sais quoi de style michelangesque qui ajoute encore à l’effet que produit la dimension des personnages et leur donne quelque chose d’effrayant. La proportion entre pour beaucoup dans le plus ou moins de puissance d’un tableau. Non seulement, comme je le disais, ces tableaux ne seraient qu’ordinaires dans l’œuvre du maître exécutée en petit ; mais même grands simplement comme nature, ils n’atteindraient pas à l’effet sublime. La preuve, c’est que la gravure du tableau de Rubens ne me le produit nullement.
Je dois dire que la dimension ne fait pas tout, car plusieurs de ses tableaux où les figures sont très grandes ne me donnent pas ce genre d’émotion, qui est le plus élevé pour moi ; je ne puis dire non plus que ce soit exclusivement quelque chose de plus italien dans le style, car les tableaux de Gros qui n’en offrent point de trace et qui ne sont qu’à lui, me transportent au même degré dans cette situation de l’âme que je trouve la plus puissante que cet art puisse inspirer. C’est un mystère curieux que celui de ces impressions produites par les arts sur des organisations sensibles : confuses impressions, si on veut les décrire, pleines de force et de netteté, si on les éprouve de nouveau, seulement par le souvenir ! Je crois fortement que nous mêlons toujours de nous-mêmes dans ces sentiments qui semblent venir des objets qui nous frappent. Il est probable que ces ouvrages ne me plaisent tant que parce qu’ils répondent à des sentiments qui sont les miens ; et puisque, quoique dissemblables, ils me donnent le même degré de plaisir, c’est que le genre d’effet qu’ils produisent, j’en retrouve la source en moi.
Ce genre d’émotion propre à la peinture est tangible en quelque sorte ; la poésie et la musique ne peuvent le donner. Vous jouissez de la représentation réelle de ces objets, comme si vous les voyiez véritablement, et en même temps le sens que renferment les images pour l’esprit vous échauffe et vous transporte. Ces figures, ces objets, qui semblent la chose même à une certaine partie de votre être intelligent, semblent comme un pont solide sur lequel l’imagination s’appuie pour pénétrer jusqu’à la sensation mystérieuse et profonde dont les formes sont en quelque sorte l’hiéroglyphe, mais un hiéroglyphe bien autrement parlant qu’une froide représentation, qui ne tient que la place d’un caractère d’imprimerie : art sublime dans ce sens, si on le compare à celui où la pensée n’arrive à l’esprit qu’à l’aide des lettres mises dans un ordre convenu ; art beaucoup plus compliqué, si l’on veut, puisque le caractère n’est rien et que la pensée semble être tout, mais cent fois plus expressif, si l’on considère qu’indépendamment de l’idée, le signe visible, hiéroglyphe parlant, signe sans valeur pour l’esprit dans l’ouvrage du littérateur, devient chez le peintre une source de la plus vive jouissance, c’est-à-dire la satisfaction que donnent, dans le spectacle des choses, la beauté, la proportion, le contraste, l’harmonie de la couleur, et tout ce que l’œil considère avec tant de plaisir dans le monde extérieur, et qui est un besoin de notre nature.
Beaucoup de gens trouveront que c’est précisément dans cette simplification du moyen d’expression que consiste la supériorité de la littérature. Ces gens-là n’ont jamais considéré avec plaisir un bras, une main, un torse de l’antique ou du Puget[707] ; ils aiment la sculpture encore moins que la peinture, et ils se trompent étrangement s’ils pensent que quand ils ont écrit : un pied ou une main, ils ont donné à mon esprit la même émotion que celle que j’éprouve quand je vois un beau pied ou une belle main… Les arts ne sont point de l’algèbre où l’abréviation des figures concourt au succès du problème ; le succès dans les arts n’est point d’abréger, mais d’amplifier, s’il se peut, de prolonger la sensation, et par tous les moyens… Qu’est-ce que le théâtre ? Un des témoignages les plus certains de ce besoin de l’homme d’éprouver à la fois le plus d’émotions possible ! Il réunit tous les arts pour sentir davantage : la pantomime, le costume, la beauté de l’acteur, doublent l’effet de l’ouvrage parlé ou chanté. La représentation du lieu dans lequel se passe l’action augmente encore tous ces genres d’impression.
On comprend donc tout ce que j’ai dit de la puissance de la peinture. Si elle n’a qu’un moment, elle concentre l’effet de ce moment ; le peintre est bien plus maître de ce qu’il veut exprimer que le poète ou le musicien livré à des interprètes ; en un mot, si son souvenir ne s’exerce pas sur autant de parties, il produit un effet parfaitement un et qui peut satisfaire complètement ; en outre, l’ouvrage du peintre n’est pas soumis aux mêmes altérations, quant à la manière dont il peut être compris dans des temps différents. La mode qui change, les préjugés du moment, peuvent faire envisager différemment sa valeur ; mais enfin il est toujours le même ; il reste tel que l’artiste a voulu qu’il fut, tandis qu’il n’en est pas de même d’un ouvrage livré à l’interprétation, comme les ouvrages de théâtre. Le sentiment de l’artiste n’étant plus là pour guider les acteurs ou les chanteurs, l’exécution ne peut plus répondre à l’intention primitive : l’accent disparaît, et avec lui la partie la plus délicate. Heureux encore l’auteur, quand on ne mutile pas son ouvrage, affront auquel il est exposé même de son vivant ! Le changement seul d’un acteur change toute la physionomie.
21 octobre. — Les Arago[708], Bixio, etc., dînaient chez Mme Villot ; j’y étais invité, mais je vis encore un peu de régime et n’y ai été qu’après.
22 octobre. — Villot et sa femme venus, en arrivant de Paris, lui du moins. Je devais y aller le soir, mais j’ai préféré une grande promenade ravissante vers Draveil.
23 octobre. — Dîné chez les Barbier, sorti vers dix heures pendant que tout le monde était occupé à jouer, et j’ai fait, par le plus beau clair de lune, la même promenade que la veille, mais encore plus charmante.
Promenade dans la forêt avec Jenny.
Lundi 24 octobre. — Travaillé jusqu’à quatre heures ; je ne suis sorti qu’à peine une heure, mais j’en ai joui délicieusement. Descendu par la ruelle, le long du jardin Barbier. Admiré les grands arbres près du bord de la Seine. Mille aspects charmants de la pente de Champrosay, etc.
C’est bien là qu’on sent l’impuissance de l’art d’écrire. Avec un pinceau, je ferai sentir à tout le monde ce que j’ai vu, et une description ne montrera rien à personne.
Le soir, encore vers Draveil ; mais le brouillard s’étendait sur toute la vallée de la Seine, et la lune se levait si tard que je n’ai pu en jouir.
Depuis deux ou trois jours, les journées sont si ravissantes que je passerais volontiers tout le temps à ma fenêtre. Je suis sorti quelques instants par le jardin et j’ai été m’asseoir avec enchantement, sous ce soleil si doux, en face de Trousseau.
Mardi 25 octobre. — Je n’écris pas tous ces jours-ci, parce que j’ai trop à écrire. Le temps est si rempli par mon travail et un peu de promenade, que quand je me mets à en écrire trop long ici, je n’ai plus le même entrain pour travailler.
J’ai tenu la petite Sainte Anne la matinée, en entremêlant le travail de petites promenades dans le jardin. J’adore ce petit potager : cette vigne jaunissante, ces tomates le long du mur, ce soleil doux sur tout cela, me pénètrent d’une joie secrète, d’un bien-être comparable à celui qu’on éprouve quand le corps est parfaitement en santé. Mais tout cela est fugitif ; je me suis trouvé une multitude de fois dans cet état délicieux, depuis les vingt jours que je passe ici.
Il semble qu’il faudrait une marque, un souvenir particulier pour chacun de ces moments, ce soleil qui envoie les derniers rayons de l’année sur ces fleurs et sur ces fruits, cette belle rivière que je voyais aujourd’hui et hier couler si tranquillement en réfléchissant le ciel du couchant, et la poétique solitude de Trousseau, ces étoiles que je vois dans mes promenades de chaque soir briller comme des diamants au-dessus et à travers les arbres de la route.
Le soir, chez Mme Barbier, où elle a lu des Mémoires de Véron… Ai-je été trop sévère en en parlant il y a deux ou trois jours ? Quoique je ne connaisse encore que ces passages détachés, je ne le pense pas.
Qu’est-ce que les mémoires d’un homme vivant sur des vivants comme lui ? Ou il faut qu’il se mette tout le monde à dos en disant sur chacun ce qu’il y a à dire, et un pareil projet mènerait loin, ou il prendra le parti de ne dire que du bien de tous ces gens qu’il coudoie et avec lesquels il se rencontre à chaque moment. De là la fastidieuse nécessité d’appeler à son secours les anecdotes qui traînent partout, ou qui, pour lui avoir été communiquées, n’en sont pas plus intéressantes, parce que tout cela ne se tient point, en un mot que ce ne sont pas ses mémoires, c’est-à-dire ses véritables et sincères jugements sur les hommes de son temps. Ajoutez à cela l’absence de toute composition et la banalité du style, que Barbier admire pourtant beaucoup.
Mercredi 26 octobre. — Le Spectateur parle de ce qu’il appelle génies de premier ordre, tels que Pindare, Homère, la Bible, — confus au milieu de choses sublimes et inachevées, — Shakespeare, etc. ; puis de ceux dans lesquels il voit plus d’art, tels que Virgile, Platon, etc…
Question à vider ! Y a-t-il effectivement plus à s’émerveiller dans Shakespeare, qui mêle à des traits surprenants de naturel des conversations sans goût et interminables, que dans Virgile et Racine, où toutes ces inventions sont à leur place et exprimées avec une forme convenable ? Il me semble que le dernier cas est celui qui offre le plus de difficultés ; car vous n’exceptez pas ceux de ces divers génies qui sont plus conformes à ce que le Spectateur appelle les règles de l’art, de vérité et de vigueur dans leurs peintures.
À quoi servirait le plus beau style et le plus fini sur des pensées informes ou communes ? Les premiers de ces hommes remarquables sont peut-être comme ces mauvais sujets auxquels on pardonne de grandes erreurs en faveur de quelques bons mouvements. C’est toujours l’histoire de l’ouvrage fini comparé à son ébauche — dont j’ai déjà parlé, — du monument qui ne montre que ses grands traits principaux, avant que l’achèvement et le coordonnement de toutes les parties lui aient donné quelque chose de plus arrêté et par conséquent aient circonscrit l’effet sur l’imagination, laquelle se plaît au vague et se répand facilement, et embrasse de vastes objets sur des indications sommaires. Encore, dans l’ébauche du monument, relativement à ce qu’il présentera définitivement, l’imagination ne peut-elle concevoir de choses trop dissemblables avec ce que sera l’objet terminé, tandis que dans les ouvrages des génies à la Pindare, il leur arrive de tomber dans des monstruosités, à côté des plus belles conceptions… Corneille est plein de ces contrastes ; Shakespeare de même… Mozart n’est point ainsi, ni Racine, ni Virgile, ni l’Arioste. L’esprit ressent une joie continue, et, tout en jouissant du spectacle de la passion de Phèdre ou de Didon, il ne peut s’empêcher de savoir gré de ce travail divin qui a poli l’enveloppe que le poète a donnée à ses touchantes pensées. L’auteur a pris la peine qu’il devait prendre pour écarter du chemin qu’il me fait parcourir ou de la perspective qu’il me montre, tous les obstacles qui m’embarrassent ou qui m’offusquent.
Si des génies tels que les Homère et les Shakespeare offrent des côtés si désagréables, que sera-ce des imitateurs de ce genre abandonné et sans précision ? Le Spectateur les tance avec raison, et rien n’est plus détestable ; c’est de tous les genres d’imitation le plus sot et le plus maladroit. Je n’ai pas dit que c’est surtout comme génies originaux que le Spectateur exalte les Homère et les Shakespeare ; ceci serait l’objet d’un autre examen, dans leur comparaison avec les Mozart et les Arioste, qui ne me paraissent nullement manquer d’originalité, bien que leurs ouvrages soient réguliers.
Rien n’est plus dangereux que ces sortes de confusions pour les jeunes esprits, toujours portés à admirer ce qui est gigantesque plus que ce qui est raisonnable. Une manière boursouflée et incorrecte leur paraît le comble du génie, et rien n’est plus facile que l’imitation d’une semblable manière… On ne sait pas assez que les plus grands talents ne font que ce qu’ils peuvent faire ; là où ils sont faibles ou ampoulés, c’est que l’inspiration n’a pu les suivre, ou plutôt qu’ils n’ont pas su la réveiller, et surtout la contenir dans de justes bornes. Au lieu de dominer leur sujet, ils ont été dominés par leur fougue ou par une certaine impuissance de châtier leurs idées. Mozart pourrait dire de lui-même, et il l’eût dit probablement en style moins ampoulé :
Monté sur le char de son improvisation, et semblable à Apollon au plus haut de sa carrière, comme au début ou à la fin, il tient d’une main ferme les rênes de ses coursiers, et dispense partout la lumière.
Voilà ce que les Corneille, emportés par des bonds irréguliers, ne savent pas faire, de sorte qu’ils vous surprennent autant par leurs chutes soudaines que par les élans qui les font gravir de sublimes hauteurs.
Il ne faut pas avoir trop de complaisance, dans les génies singuliers, pour ce qu’on appelle leurs négligences, qu’il faut appeler plutôt leurs lacunes ; ils n’ont pu faire que ce qu’ils ont fait. Ils ont souvent dépensé beaucoup de sueurs sur des passages très faibles ou très choquants. Ce résultat ne semble point rare chez Beethoven, dont les manuscrits sont aussi raturés que ceux de l’Arioste.
Il doit arriver souvent chez ces hommes que les beautés viennent les chercher, sans qu’ils y pensent, et qu’ils passent au contraire un temps considérable à en atténuer l’effet par des redites et des amplifications déplacées.
Jeudi 27 octobre. — Impossibilité de travailler !… Est-ce mauvaise disposition, ou bien l’idée que je pars après-demain ?
Promenades dans le jardin, et surtout station sous les peupliers de Baÿvet ; ces peupliers et surtout les peupliers de Hollande, jaunissant par l’automne, ont pour moi un charme inexprimable. Je me suis étendu à les considérer, se détachant sur le bleu du ciel, à voir leurs feuilles s’enlever au vent et tomber près de moi. Encore un coup, le plaisir qu’ils me faisaient tenait à mes souvenirs et au souvenir des mêmes objets, vus dans des temps où je sentais près de moi des êtres aimés.
Ce sentiment est le complément de toutes les jouissances que peut donner le spectacle de la nature ; je l’éprouvais l’année dernière, à Dieppe, en contemplant la mer : ici de même. Je ne pouvais m’arracher de cette eau transparente sous ces saules, et surtout de la vue du grand peuplier et des peupliers de Hollande.
Contribué, en rentrant au jardin, à achever notre vendange. Le soleil, quoique vif, me remplissait de bien-être.
Je quitte ceci sans répugnance pour le travail et la vie que je vais retrouver à Paris, mais sans lassitude, et sentant à merveille que je pourrais passer aussi bien plus de temps au milieu d’une solitude si paisible et dépourvue de ce qu’on appelle des distractions. Pendant que jetais couché sous ces chers peupliers, j’apercevais au loin, sur la route et au-dessus de la haie de Baÿvet, passer les chapeaux et les figures des élégants traînés dans leurs calèches que je ne voyais pas à cause de la haie, allant à Soisy ou en revenant, et occupés à chercher la distraction chez leurs connaissances réciproques, faire admirer leurs chevaux et leurs voitures et prendre part à l’insipide conversation dont se contentent les gens du monde… Ils sortent de leurs demeures, mais ils ne peuvent se fuir eux-mêmes ; c’est en eux que réside ce dégoût pour tout délassement véritable, et l’implacable paresse, qui les empêche de se créer de véritables plaisirs.
Le soir, je voulais aller chez Barbier ; dans la journée chez Mme Villot et le maire : une délicieuse paresse m’en a empêché… Celle-là est excusable, puisque j’y trouvais du plaisir.
Vendredi 28 octobre. — Ce matin, levé comme à l’ordinaire, mais plein de l’idée que je n’avais à faire que mes paquets. J’ai savouré de nouveau le plaisir de ne rien faire.
Après avoir fait cent tours et regardé mes peintures, je me suis enfoncé dans mon fauteuil, au coin de mon feu et dans ma chambre ; j’ai mis le nez dans les Nouvelles russes[709] ; j’en ai lu deux : le Fataliste et Dombrowski, qui m’ont fait passer des moments délicieux. À part les détails de mœurs que nous ne connaissons pas, je soupçonne qu’elles manquent d’originalité. On croit lire des nouvelles de Mérimée, et comme elles sont modernes, il n’y a pas difficulté à être persuadé que les auteurs les connaissent. Ce genre un peu bâtard fait éprouver un plaisir étrange, qui n’est pas celui qu’on trouve chez les grands auteurs… Ces histoires ont un parfum de réalité[710] qui étonne ; c’est ce sentiment qui a surpris tout le monde, quand sont apparus les romans de Walter Scott ; mais le goût ne peut les accepter comme des ouvrages accomplis.
Lisez les romans de Voltaire, Don Quichotte, Gil-Blas… Vous ne croyez nullement assister à des événements tout à fait réels, comme serait la relation d’un témoin oculaire… Vous sentez la main de l’artiste et vous devez la sentir, de même que vous voyez un cadre à tout tableau. Dans ces ouvrages, au contraire, après la peinture de certains détails qui surprennent par leur apparente naïveté, comme les noms tout particuliers des personnages, des usages insolites, etc., il faut bien en venir à une fable plus ou moins romanesque qui détruit l’illusion. Au lieu de faire une peinture vraie sous les noms de Damon et d’Alceste, vous faites un roman comme tous les romans, qui paraît encore plus tel, à cause de la recherche de l’illusion portée seulement dans des détails secondaires. Tout Walter Scott est ainsi. Cette apparente nouveauté a plus contribué à son succès que toute son imagination, et ce qui vieillit aujourd’hui ses ouvrages et les place au-dessous des fameux que j’ai cités, c’est précisément cet abus de la vérité dans les détails. (Se rattacherait à l’article sur l’imitation, plus haut.)
Paris, samedi 29 octobre. — Parti pour Paris à onze heures par l’omnibus du chemin de fer de Lyon. Trouvé Minoret jusqu’à Draveil.
Dimanche 30 octobre. — Travaillé à retoucher les tableaux qu’on m’a demandés. Les occupations que je trouve ici vont bien interrompre toutes ces écritures ; je le regrette ; elles fixent quelque chose de ce qui passe si vite, de tous ces mouvements de chaque jour dans lesquels on retrouve ensuite des encouragements ou des consolations.
Lundi 31 octobre. — Le pauvre Zimmermann[711] est mort ; j’ai passé chez lui un instant, et n’ai pu rester. J’avais donné rendez-vous à Andrieu et j’étais impatient de retourner à mon travail. Je n’y suis arrivé que vers une heure.
Vendredi 4 novembre. — Toute cette semaine, repris avec beaucoup d’ardeur les parties à corriger ou à achever à l’Hôtel de ville.
Samedi 5 novembre. — Sur le fléau des longs articles. Les hommes qui savent ce qu’ils ont à dire écrivent bien.
— Sur la facilité des femmes à écrire. Voir antérieurement dans ce calepin. Ce serait sur les difficultés supérieures que présente la peinture. Le mot de Chardin et de Titien : Toute la vie pour apprendre… Au reste, les difficultés sont relatives à la constitution particulière des esprits.
Lundi 7 novembre. — Dîné chez Pierret avec Préault. Je crains, pour ce pauvre garçon, qu’on ne le couche en joue pour les filles de la maison.
J’étais déjà fatigué de ma journée.
Mardi 8 novembre. — Je me suis reposé tout ce jour ; je crains mes malaises de l’estomac.
Jeudi 10 novembre. — Voici un savant américain (Moniteur de ce jour) qui, à la suite de sondages entrepris et exécutés dans plusieurs points de la mer, établit que la lune n’influe nullement sur les marées, comme les savants de toutes les écoles se sont accordés pour le croire. Quel scandale ! Je les vois d’ici lever les épaules avec un souverain mépris pour la théorie de ce faux frère, qui vient les déranger dans les assertions et ébranler la foi dans les anciens. Selon l’Américain, le fond de la mer est rempli d’inégalités comme la surface de la terre, ce qui ne surprendra personne apparemment ; mais il ajoute que les volcans sous-marins creusent çà et là de temps en temps d’épouvantables cavernes qui attirent et qui rejettent les eaux, et sont cause des marées. Je ne suis ni pour ni contre la lune, mais la théorie nouvelle me semble bien hasardée. Comment s’expliquer la régularité des marées avec ces cavernes qui sont creusées par des accidents irréguliers, comme sont les explosions de volcans ? Je suis néanmoins bien aise qu’il vienne de temps en temps quelque homme assez hardi pour rompre en visière à ces docteurs si sûrs de doctrines qu’ils n’ont pas inventées, en étant incapables, et qui jurent, les yeux fermés, sur la parole de leur maître.
Il y avait dans le même journal, hier ou avant-hier, une autre bourde bien plus forte à propos de la corruption que doivent engendrer dans les eaux de la mer les cadavres qui y ont trouvé leur tombeau depuis des siècles. Il prétend, si je ne me trompe, que toute cette corruption est partout, que la terre n’est qu’un véritable charnier où les fleurs elles-mêmes naissent de la corruption ; il oublie aussi que, même en lui accordant que la mer, les eaux enfin n’absorbent ou ne transforment point suffisamment les matières corrompues, tous ces corps n’y restent pas plus à l’état de cadavres que la viande chez les bouchers, ou un animal mort dans un bois. La mer est peuplée d’espèces assez voraces et assez nombreuses pour faire disparaître promptement la dépouille des pauvres diables qui laissent leur vie dans les flots. Il explique par la même cause la phosphorescence des eaux de la mer : « On sait, dit-il, que le phosphore est engendré par la corruption. » Il sait cela… et il ne voit pas avec ses petites lunettes d’autre moyen pour la nature de produire cet effet… Nous concluons toujours d’après ce que nous savons, et nous savons fort peu… Et qui lui dit que c’est le phosphore qui produit ces clartés singulières qu’on remarque autour des bateaux et des rames en mouvement ? De ce que le phosphore a une lumière sans chaleur, ce qui est aussi le propre de ces effets sur les flots, quand ils sont troublés dans de certaines conditions, mon savant et tous les savants ont décidé que le phosphore seul pouvait produire un semblable effet. C’est comme s’ils disaient : Les savants se coudoient dans l’antichambre, etc.
Vendredi 11 novembre. — Retourné au conseil ; ma mauvaise disposition se passe un peu.
L’amour est comme ces souverains qui s’endorment dans la prospérité, et je n’entends pas par là qu’il s’éteigne quand ses faveurs sont trop peu disputées, etc.
Lundi 14 novembre. — Quoique souffrant, ou plutôt pour me remettre au grand air, après avoir passé toute la matinée à paresser et à lire les histoires de P… que j’aime beaucoup et qui m’impressionnent dans un certain sens, j’ai été à l’Hôtel de ville vers deux heures, après avoir acheté avec Jenny l’écharpe et le gilet bleu.
J’ai fait presque tout à pied, y compris le retour par le faubourg Saint-Germain, pour acheter des gants ; j’ai acheté la gravure de Piranesi[712], grand intérieur d’église très frappant. J’ai vu encore, en passant à la tour Saint-Jacques, retirer des os en quantité et encore juxtaposés. L’esprit aime ces spectacles et ne peut s’en rassasier. En passant devant la boutique d’Hetzel[713], accroché par Silvestre[714], qui m’a fait entrer.
Avant dîner, Mme Pierret et Marie : c’est le fameux jour de fête !
Le soir, après mon dîner, Riesener est venu et est resté assez tard. Il me conseille de publier mes croquis au moyen de la photographie ; j’avais eu déjà cette pensée, qui serait féconde[715].
Il m’a parlé du sérieux avec lequel le bon Durieu et son ami qui l’aidait dans ses opérations parlent des peines qu’ils se donnent et s’attribuent une grande part de succès dans cesdites opérations ou plutôt dans leur résultat.
Ce n’est qu’en tremblant que Riesener leur demandait si décidément il pouvait sans indiscrétion et sans être accusé de plagiat, se servir de leurs photographies pour en faire des tableaux. J’ai été moi-même témoin chez Pierret, lundi dernier, de la bonhomie avec laquelle il s’applaudissait du succès, en voyant mes exclamations et mon admiration qu’il prenait pour lui-même.
Mardi 15 novembre. — Je suis souffrant de l’estomac depuis huit jours, et je ne fais rien. Ce matin, je vais mieux et je jouis encore ce jour d’une délicieuse paresse au coin démon feu, comme pour m’indemniser du regret de perdre mon temps. Je suis entouré de mes calepins des années précédentes ; plus ils se rapprochent du moment présent et plus j’y vois devenir rare cette plainte éternelle contre l’ennui et le vide que je ressentais autrefois. Si effectivement l’âge me donne plus de gaieté et de tranquillité d’esprit, ce sera pour le coup une véritable compensation des avantages qu’il m’enlève.
Je lisais dans l’agenda de 1849 que le pauvre Chopin, dans une de ces visites que je lui faisais fréquemment alors, et quand sa maladie était déjà affreuse, me disait que sa souffrance l’empêchait de s’intéresser à rien, et à plus forte raison au travail. Je lui dis à ce sujet que l’âge et les agitations du jour ne tarderaient pas à me refroidir aussi. Il me répondit qu’il m’estimait de force à résister. « Vous jouirez, a-t-il dit, de votre talent dans une sorte de sérénité qui est un privilège rare et qui vaut bien la recherche fiévreuse de la réputation. »
Jeudi 17 novembre. — La bonne Alberthe m’a envoyé une place pour la Cenerentola[716]. J’ai passé une soirée vraiment agréable ; j’étais plein d’idées, et la musique, le spectacle y ont aidé.
J’ai remarqué là combien, dans les étoffes de satin, le ton même de l’objet ne se trouve qu’immédiatement à côté du luisant ; de même dans la robe des chevaux.
En présence de cette jolie pièce, de ces passages si fins, de cette musique que je sais par cœur, je voyais l’indifférence sur presque toutes ces figures de gens ennuyés, qui ne viennent là que par ton, ou seulement pour entendre l’Alboni. Le reste est un accessoire, et ils n’y assistent qu’en bâillant. Je jouissais de tout… Je me disais : « C’est pour moi qu’on joue ce soir, je suis seul ici ; un enchanteur a eu la complaisance de placer près de moi jusqu’à des fantômes de spectateurs, pour que l’idée de mon isolement ne nuise pas à mon plaisir ; c’est pour moi qu’on a peint ces décorations et taillé ces habits, et, quant à la musique, je suis seul à l’entendre. »
La réforme du costume s’est étendue jusqu’à supprimer tout ce qui est caricature ingénieuse, inhérente au fond même du sujet. Le costumier se croit exact en donnant à Dandini un costume très ponctuel de grand seigneur du temps de Louis XV ; le prince de même ; vous vous croyez à une pièce de Marivaux. Avec Cendrillon, nous sommes dans le pays des fées. Alidor a un costume noir, d’avoué.
Samedi 19 novembre. — J’ai vu ce matin Fleury[717] et Halévy, puis Gisors,
Je vois ce soir, chez Gihaut, les photographies de la collection Delessert[718], d’après Marc-Antoine[719]. Faut-il absolument admirer éternellement comme parfaites ces images pleines d’incohérences, d’incorrections, qui ne sont pas toutes l’ouvrage du graveur ? Je me rappelle encore la manière désagréable dont j’en ai été affecté, ce printemps, quand je les comparais, à la campagne, à des photographies d’après nature.
J’ai vu le Repas chez Simon, gravure reproduite et très estimée. Rien de plus froid que cette action ! La Madeleine, plantée de profil devant le Christ, lui essuyant à la lettre les pieds avec de grands rubans qui lui pendent de la tête, et que le graveur nous donne pour des cheveux. Rien de l’onction que comporte un tel sujet ! Rien de la fille repentante, de son luxe et de sa beauté mise aux pieds du Christ, qui devrait bien, au moins par son air, lui témoigner quelque reconnaissance, ou du moins qu’il la voit avec indulgence et bonté ; les spectateurs aussi froids, aussi hébétés que ces deux personnages capitaux. Ils sont tellement séparés les uns des autres, sans qu’un spectacle si extraordinaire les rapproche ou les groupe, comme pour les voir de plus près, ou pour se communiquer naturellement ce qu’ils en pensent. Il y en a un, le plus rapproché du Christ, dont le geste est ridicule et sans objet. Il paraît embrasser la table d’un seul de ses bras. Son bras paraît plus large que la table tout entière, et cette incorrection, que rien ne motive dans l’endroit le plus apparent du tableau, augmente la bêtise de tout le reste. Comparez à cette sotte représentation du sujet le plus touchant de l’Évangile, le plus fécond en sentiments tendres et élevés, en contrastes pittoresques ressortant des natures différentes mises en contact, de cette belle créature dans la fleur de la jeunesse et de la santé, de ces vieillards et de ces hommes faits, en présence desquels elle ne craint pas d’humilier sa beauté et de confesser ses erreurs, comparez, dis-je, ce qu’a fait de cela le divin Raphaël avec ce qu’en a fait Rubens. Il n’a manqué aucun trait… La scène se passe chez un homme riche : des serviteurs nombreux entourent la table ; le Christ, à la place la plus apparente, a la sérénité convenable. La Madeleine[720], dans l’effusion de ses sentiments, traîne dans la poussière ses robes de brocart, ses voiles, ses pierreries ; ses cheveux d’or ruisselant sur ses épaules et répandus confusément sur les pieds du Christ, ne sont pas un accessoire vain et sans intérêt. Le vase de parfums est le plus riche qu’il a pu imaginer ; rien n’est trop beau ni trop riche de ce qui doit être mis aux pieds de ce maître de la nature, qui s’est fait un maître indulgent pour nos erreurs et pour notre faiblesse. Et les spectateurs peuvent-ils assister avec indifférence à la vue de cette beauté prosternée et en larmes, de ces épaules, de cette gorge, de ces yeux brillants et doucement élevés ? Ils se parlent, ils se montrent, ils regardent tout cela avec des gestes animés, les uns avec l’air de l’étonnement ou du respect, les autres avec une surprise mêlée de malice. Voilà la nature, et voilà le peintre ! Nous acceptons tout ce que la tradition nous présente comme consacré, nous voyons par les yeux des autres ; les artistes sont pris les premiers et plus dupes que le public moins intelligent, qui se contente de ce que les arts lui présentent dans chaque époque comme du pain du boulanger. Que diriez-vous de ces pieux imbéciles qui copient sottement ces inadvertances du peintre d’Urbin, et les érigent en sublimes beautés ? de ces malheureux qui, n’étant poussés par aucun sentiment, s’attachent aux côtés critiquables ou ridicules du plus grand talent, pour les imiter sans cesse, sans comprendre que ces parties faibles ou négligées sont l’accompagnement regrettable des belles parties qu’ils ne peuvent atteindre ?
Dimanche 20 novembre. — Rubens n’est pas simple, parce qu’il n’est pas travaillé.
J’ai été voir la bonne Alberthe, que j’ai trouvée sans feu, dans sa grande chambre d’alchimiste, et dans une de ces toilettes bizarres, qui la font ressembler à une magicienne. Elle a toujours eu du goût pour cet appareil nécromancien, même dans le temps où sa beauté était sa plus véritable magie. Je me rappelle encore cette chambre tapissée de noir et de symboles funèbres, sa robe de velours noir et ce cachemire rouge roulé autour de sa tête, toutes sortes d’accessoires qui, mêlés à ce cercle d’admirateurs qu’elle semblait tenir à distance, m’avaient passagèrement monté la tête… Où est le pauvre Tony ?… Où est le pauvre Beyle ?… Elle raffole aujourd’hui des tables tournantes : elle m’en a conté des choses incroyables. Les esprits se logent là dedans ; vous forcez à vous répondre à votre gré, tantôt l’esprit de Napoléon, tantôt celui d’Haydn et de tant d’autres ! Je cite les deux qu’elle m’a nommés… Comme tout se perfectionne !… Les tables vont aussi faisant du progrès ! Dans les commencements, elles frappaient un certain nombre de coups, qui voulaient dire oui ou non, ou bien l’âge qu’on avait, ou le quantième du mois où tel événement s’accomplirait. Depuis, on en a fabriqué tout exprès qui ont au centre une aiguille de bois, qui va tour à tour se fixer sur les lettres de l’alphabet tracées en cercle, en les choisissant, bien entendu, avec le plus grand à propos, pour former des phrases d’un profond admirable, en manière d’oracles. On a encore dépassé ce point de leur éducation déjà assez surprenant : on se place sous la main une petite planche à laquelle est adapté un crayon, et en s’appuyant ainsi armé sur la table inspirée, le crayon trace de lui-même des paroles et des discours entiers. Elle m’a parlé de gros manuscrits dont les tables sont les auteurs, et qui feront sans doute la fortune de ces gens assez doués de fluide pour donner à la matière tout cet esprit. On sera ainsi un grand homme à bon marché.
Mardi 22 novembre. — Mal disposé pour le travail. Je suis allé vers trois heures au Musée. Vivement impressionné par les dessins italiens du quinzième siècle et du commencement du seizième siècle. — Tête de religieuse morte ou mourante, de Vanni, dessin de Signorelli : hommes nus. — Petit torse de face : ancienne école florentine. — Dessins de Léonard de Vinci[721].
J’ai remarqué pour la première fois ceux du Carrache, pour les grisailles du palais Farnèse[722] : l’habileté y domine le sentiment ; le faire, la touche l’entraînent malgré lui ; il en sait trop, et n’étudiant plus, il ne découvre plus rien de nouveau et d’intéressant. Voilà l’écueil du progrès dans les arts, et il est inévitable. Toute cette école est de même. Têtes de Christ et autres, du Guide[723], où, malgré l’expression, la grande habileté de crayon est plus surprenante encore que l’expression. Que dire alors de ces écoles d’aujourd’hui, qui ne s’occupent que de cette mensongère habileté, et qui la recherchent ? Dans les Léonard surtout, la touche ne se voit pas, le sentiment seul arrive à l’esprit. Je me rappelle encore le temps qui n’est pas loin où je me querellais sans cesse de ne pouvoir parvenir à cette dextérité dans l’exécution que les écoles habituent malheureusement les meilleurs esprits à regarder comme le dernier terme de l’art. Cette pente à imiter naïvement et par des moyens simples, a toujours été la mienne, et j’enviais au contraire la facilité de pinceau, la touche coquette des Bonington[724] et autres : je cite un homme rempli de sentiment, mais sa main l’entraînait, et c’est ce sacrifice des plus nobles qualités à une malheureuse facilité, qui fait déchoir aujourd’hui ses ouvrages, et les marque d’un cachet de faiblesse, comme ceux des Vanloo.
Il y a de quoi beaucoup réfléchir sur cette visite que j’ai faite hier, et il serait bon de la renouveler de temps en temps.
Mercredi 23 novembre. — Dîné chez Boissard avec Arago et une petite dame Aubernon[725], qui fait de l’esprit et qui en a. Le pauvre Chenavard devait venir ; il est très entrepris de sa maladie de larynx, et inspire des craintes. Boissard, souffrant de névralgie, est triste comme un homme pris au piège.
Jeudi 24 novembre. — Promenade le soir dans la galerie Vivienne, où j’ai vu des photographies chez un libraire. Ce qui m’a attiré, c’est l’Elévation en croix[726] de Rubens, qui m’a beaucoup intéressé : les incorrections, n’étant plus sauvées par le faire et la couleur, paraissent davantage.
La vue ou plutôt le souvenir de mon émotion devant ce chef-d’œuvre m’ont occupé tout le reste de la soirée, d’une manière charmante. Je pense, par forme de contraste, à ces dessins du Carrache, que je voyais avant-hier : j’ai vu des dessins de Rubens pour ce tableau ; certes ils ne sont pas consciencieux, et il s’y montre lui-même plus que le modèle qu’il avait sous les yeux ; mais telle est l’impulsion de cette force secrète, qui est celle des hommes à la Rubens ; le sentiment particulier domine tout et s’impose au spectateur. Ses formes, au premier coup d’œil, sont aussi banales que celles du Carrache, mais elles sont tout autrement significatives… Carrache grand esprit, grand talent, grande habileté, je parle au moins de ce que j’ai vu, mais rien de ce qui transporte et donne des émotions ineffaçables !
Vendredi 25 novembre. — Visite du ministre Fortoul et du préfet, à l’Hôtel de ville.
Le soir, ce terrible Dumas, qui ne lâche pas sa proie, est venu me relancer à minuit, son cahier de papier blanc à la main… Dieu sait ce qu’il va faire des détails[727] que je lui ai donnés sottement ! Je l’aime beaucoup, mais je ne suis pas formé des mêmes éléments, et nous ne recherchons pas le même but. Son public n’est pas le mien ; il y en a un de nous qui est nécessairement un grand fou.
Il me laisse les premiers numéros de son journal, qui est charmant.
Samedi 26 novembre. — J’ai le torticolis ; le temps est sombre ; je me promène dans mon atelier ou je dors.
Fait quelques croquis d’après la suite flamande des Métamorphoses.
A quatre heures été chez Rivet, que j’ai trouvé plus affectueux que jamais. Il me parle avec grand plaisir de la répétition du Christ au tombeau, de Thomas[728].
Le soir, Lucrezia Borgia[729] : je me suis amusé d’un bout à l’autre, encore plus que l’autre jour, à la Cenerentola. Musique, acteurs, décorations, costumes, tout cela m’a intéressé. J’ai fait réparation, dans cette soirée, à l’infortuné Donizetti, mort à présent, et à qui je rends justice, imitant en cela le commun des mortels, hélas ! et même les premiers parmi eux. Ils sont tous injustes pour le talent contemporain. J’ai été ravi du chœur d’hommes en manteau, dans la charmante décoration de l’escalier du jardin au clair de lune. Il y a des réminiscences de Meyerbeer, au milieu de cette élégance italienne, qui se marient très bien au reste. Ravi surtout de l’air qui suit, chanté délicieusement par Mario : autre injustice réparée ; je le trouve charmant aujourd’hui. Cela ressemble à ces amours qui vous prennent tout d’un coup, après des années, pour une personne que vous étiez habitué à voir tous les jours avec indifférence. Voilà la bonne école de Rossini ; il lui a emprunté, parmi les meilleures choses, ces introductions qui mettent le spectateur dans la disposition de l’âme où le veut le musicien. Il lui doit aussi, comme Bellini, et il ne les gâte pas, ces chœurs mystérieux dans le genre de celui que je citais… le chœur des prêtres, dans Sémiramis, etc.
Dimanche 27 novembre. — J’ai été le soir chez la bonne Alberthe ; j’avais à cœur de la remercier du plaisir qu’elle m’a procuré hier soir. Je l’ai encore trouvée seule dans sa grande chambre de magicienne. Je m’attendais, aujourd’hui dimanche, à lui voir le cercle que je trouvais habituellement chez elle, et composé de ce qu’elle appelait ses amis. Depuis qu’elle a changé de demeure, ses amis ont changé d’habitudes ; quelques pas de plus, une petite pente à monter, les a tous découragés… Ils viennent le jour où elle les invite à dîner.
Lundi 28 novembre. — Première représentation de Mauprat[730]. Toutes les pièces de Mme Sand offrent la même composition, ou plutôt la même absence de composition : le début est toujours piquant et promet de l’intérêt ; le milieu de la pièce se traîne dans ce qu’elle croit des développements de caractères et qui ne sont que des moyens d’ouvrager l’action.
Il semble que dans cette pièce, comme dans les autres, à partir du deuxième acte jusqu’à la fin, — et il y en a six ! — la situation ne fait pas un pas ; le caractère indécrottable de son jeune homme à qui on dit sur tous les tons qu’on l’aime, ne sort pas du désespoir, de l’emportement et du non-sens. C’est juste comme dans le Pressoir.
Pauvre femme ! elle lutte contre un obstacle de nature qui lui défend de faire des pièces ; c’est au-dessous des plus minces mélodrames sous ce rapport ; il y a des mots pleins de charme ; c’est là son talent. Ses paysans vertueux sont assommants ; il y en a deux dans Mauprat… Le grand seigneur est également vertueux, la jeune personne irréprochable… le rival du jeune homme, plein de convenance et de modération quand il s’agit d’instrumenter contre son rival. Le jeune homme emporté est lui-même excellent au fond. Il y a un pauvre petit chien qui amène des situations ridicules. Elle manque du tact de la scène, comme de celui de certaines convenances dans ses romans ; elle n’écrit pas pour des Français, quoique en français excellent ; et le public, en fait de goût, n’est pourtant pas bien difficile à présent. C’est comme Dumas qui marche sur tout, qui est toujours débraillé et qui se croit au-dessus de ce que tout le monde est habitué à respecter.
Elle a incontestablement un grand talent, mais elle est avertie, encore moins que la plupart des écrivains, de ce qui lui va le mieux. Suis-je injuste encore ? Je l’aime pourtant, mais il faut dire que ses ouvrages ne dureront pas. Elle manque de goût.
— Revenu à plus d’une heure du matin. Retrouvé là mon vieux Ricourt[731]. Il me parlait et se souvient encore de l’esquisse du Satyre dans les filets[732] : il m’a parlé de ce que j’étais déjà dans ce temps lointain. Il se rappelle l’habit vert[733], les grands cheveux, l’exaltation pour Shakespeare, pour les nouveautés, etc.
— Dîné à l’Hôtel de ville. — Didot m’a emmené chez lui et montré des manuscrits intéressants avec vignettes.
Mercredi 30 novembre. — Dîné chez la princesse Marcellini. Duo de basse et de piano de Mozart, dont le commencement rappelle : Du moment qu’on aime. — Duo idem de Beethoven, celui que je connais déjà et qu’ils ont joué.
Quelle vie que la mienne[734] ! Je faisais cette réflexion en entendant cette belle musique, surtout celle de Mozart qui respire le calme d’une époque ordonnée. Je suis dans cette phase de la vie où le tumulte des passions folles ne se mêle pas aux délicieuses émotions que me donnent les belles choses. Je ne sais ce que c’est que paperasses et occupations rebutantes, qui sont celles de presque tous les humains ; au lieu de penser à des affaires, je ne pense qu’à Rubens ou à Mozart : ma grande affaire pendant huit jours, c’est le souvenir d’un air ou d’un tableau. Je me mets au travail comme les autres courent chez leur maîtresse, et quand je les quitte, je rapporte dans ma solitude ou au milieu des distractions, que je vais chercher, un souvenir charmant, qui ne ressemble guère au plaisir troublé des amants.
J’ai vu chez la princesse le portrait du prince Adam[735] par Delaroche[736] ; on dirait le fantôme du pauvre prince, tant il semble qu’il lui ait tiré tout le sang de ses veines, et tant il lui a allongé la figure. Voilà vraiment, suivant l’expression de Delaroche lui-même, ce qu’on peut appeler de la peinture sérieuse. Je lui parlais un jour des admirables Murillo du maréchal Soult, qu’il voulait bien me laisser admirer ; seulement, disait-il, ce n’est pas de la peinture sérieuse.
Je suis rentré à une heure du matin. Jenny me disait que quand on a entendu de la musique pendant une heure, c’est tout ce qu’on en peut porter. Elle a raison : c’est même beaucoup. Un air ou deux comme le duo de Mozart, et le reste fatigue et donne de l’impatience.
Samedi 1er décembre. — Hercule et Diomède[737], grand paysage. — Adam et Éve[738].
Sur quelques folies. — Sur le progrès. — Opinions modernes.
Mercredi 7 décembre. — Insipide dîner chez Casenave. J’ai revu là les mêmes figures que l’année dernière, à peu près à pareille époque.
Un an de plus change bien les visages à une certaine époque de la vie ! Fould surtout m’a paru avoir été plus vite que les autres ; il a les joues pendantes, l’œil éteint, le poil plus blanc, et ce je ne sais quoi de débraillé et de dépenaillé qui annonce le vieillard. Il était près de moi ; je me suis évertué, par convenance et dans l’impossibilité de trouver un mot à dire à la gouvernante anglaise qui était de l’autre côté, à lui parler de sa collection, des arts, de la guerre d’Orient… J’étais là comme un terme.
En face de moi était Bethmont[739]. C’est un personnage tout plein de manières sucrées de dire les choses. Avec son œil doux, il a arrangé Véron, après dîner, d’une manière assez piquante, mais surtout très méchante et emportant la pièce avec une douceur charmante. On sentait bien, dans cette mielleuse philippique contre le champion de la présidence en 1851, l’ancien membre du gouvernement provisoire qui laissait échapper quelques-unes de ses rancunes secrètes. Il a beaucoup d’un homme d’Église dans son discours, et même dans son attitude : la faconde recherchée de l’avocat[740] se fait jour naturellement dans tout ce qu’il dit, mais avec un certain embarras dans les termes, qui annonce quelque chose de rebelle dans cet esprit, malgré la culture qu’il a dû lui donner et l’exercice du métier de parler, qui a été celui de toute sa vie. Je me rappelle que Vieillard, dans toute sa candeur, me disait en parlant de lui, et par opposition à ses autres collègues fougueux ou intolérants républicains : « Quel homme charmant ! que de douceur ! » Je me rappelle qu’il me déplut tout de suite, quand je le vis autrefois chez le bon M. N…, qui n’y regardait pas de si près : une certaine façon de vous écouter sans rien dire, ou de vous répondre avec réticences, me donna de lui l’idée dans laquelle je me suis confirmé les deux ou trois fois que je l’ai rencontré. Je l’ai trouvé d’une grande sensibilité à la mort du pauvre Wilson[741]. Il m’a semblé qu’il versait de véritables larmes sur son ami… Que conclure de tout ceci ? Que je me suis trompé dans mon jugement… ? Point du tout ! Il est, comme tous les hommes, un composé bizarre et inexplicable de contraires ; c’est ce que les faiseurs de romans et de pièces ne veulent pas comprendre. Leurs hommes sont tout d’une pièce. Il n’en est pas de cette sorte… Il y a dix hommes dans un homme, et souvent ils se montrent tous dans la même heure, à de certains moments.
Je me suis sauvé aussitôt que je l’ai pu, pour m’ôter de ce lieu ennuyeux et pour aller à pied à travers les Champs-Élysées, chez la princesse, où j’espérais avoir un peu de musique et un peu de thé. Je l’ai trouvée attablée au piano avec son professeur K… Justement elle jouait avec lui de sa musique. Le morceau finissait heureusement, et je n’ai pas été mis dans la nécessité de faire même une grimace d’approbation. Elle a joué après, et probablement à mon intention, un morceau de Mozart, à quatre mains, de sa jeunesse. L’adagio superbe. Revenu, bien malgré moi, avec l’ennuyeux K…
Jeudi 8 décembre. — J’étais invité à aller chez Mlle Brohan[742], et, après avoir fait ma promenade, par un froid piquant, mais agréable, après laquelle je devais rentrer pour aller la voir, je suis resté à lire le deuxième article de Dumas sur moi, qui me donne une certaine tournure de héros de roman. Il y a dix ans, j’aurais été l’embrasser pour cette amabilité : dans ce temps-là, je m’occupais beaucoup de l’opinion du beau sexe, opinion que je méprise[743] entièrement aujourd’hui, non sans penser quelquefois avec plaisir à ce temps où tout d’elles me paraissait charmant. Aujourd’hui, je ne leur en reconnais qu’un seul, et il n’est plus à mon usage. La raison, plus encore que l’âge, me tourne vers un autre point. Celui-là est le tyran qui domine tout le reste.
Cette Brohan était bien charmante à ses débuts ! Quels yeux ! quelles dents ! quelle fraîcheur ! Quand je l’ai revue chez Véron, il y a deux ou trois ans, elle avait perdu beaucoup, mais elle avait encore un certain charme. Elle a beaucoup d’esprit, mais elle court un peu après l’effet. Je me rappelle que ce jour-là, en sortant de table, elle m’embrassa sur ce qu’on lui dit ce que j’étais : je crois qu’il était question de son portrait. Houssaye[744], qui était alors son directeur, non pas celui de sa conscience, car il était en même temps son amant, eut tout le temps du dîner une sombre attitude d’amant jaloux fort comique chez un directeur de spectacle, familiarisé, à ce qu’il semble, avec les mœurs de la partie féminine du troupeau déclamant et chantant, croassant ou beuglant, dont il est le berger.
Je n’y ai pas été ce soir, de peur de rencontrer là trop de ces figures compromettantes, qui me feraient fuir aux antipodes.
Vendredi 9 décembre. — La forme de lettres serait la meilleure… On passe d’un sujet à l’autre sans transition ; on n’est pas forcé à des développements. Une lettre peut être aussi courte et aussi longue qu’on veut.
En revenant de l’Hôtel de ville. — Copie du plafond pour Bonnet[745]. — Samson et Dalila[746]. — Ovide[747]. — Olinde et Sophronie. — Clorinde[748]. — Herminie et les bergers[749]… et les autres sujets de la Jérusalem. — Lion Beugniet[750]. Naufrage id.[751]. — Intérieur de Harem (Oran). — Présents de noces (Tanger). Camp mauresque.
Samedi 10 décembre. — Chez Chabrier ce soir. Lefebvre parlait de Jomini. Lire ces deux ouvrages : Napoléon au tribunal d’Alexandre et de César et Grandes opérations militaires. Il loue beaucoup le style de Ségur, dans la campagne de 1812. Lire la bataille de Dresde. Belles choses aussi dans la campagne de France. C’est après cette campagne de Dresde, dans laquelle l’Empereur a été vraiment foudroyant et semblable aux Roland et aux Renaud, tant son coup d’œil ou sa présence enfanta des miracles, c’est après cette bataille, qui devait être décisive, qu’une aile de poulet lui donna une indigestion qui paralysa, avec ses facultés, les mouvements de son armée et amena la défaite de Vandamme.
Le bon amiral, qui était là, a la bonté et la bienveillance peintes sur ses traits. Il me disait que la nuit, quand il se réveillait, il était pris d’un horrible découragement. Cela m’a surpris d’un homme qui n’a pas l’air d’être nerveux, C’est une situation commune à presque tous les hommes. Lefebvre est de même. J’étais arrivé dans un état de misanthropie affreuse que j’ai déposé en entrant là (quoique je ne m’y sois pas grandement diverti), et que j’ai repris tout le long du chemin à mon retour.
Je trouvais charmant d’être détesté de tout le monde et d’être en guerre avec le genre humain. On parlait d’excès de travail ; je disais qu’il n’y avait pas d’excès dans ce genre, ou du moins qu’il ne pouvait nuire, pourvu qu’on fît l’exercice que le corps réclame, et surtout qu’on ne menât pas de front le travail avec le plaisir. On dit à ce propos que Cuvier était mort pour avoir trop travaillé : je n’en crois rien. Il avait l’air si fort ! a dit quelqu’un. Point du tout ! il était très maigre et se couvrait d’habits comme le marquis de Mascarille et le vicomte de Jodelet dans les Précieuses. Il voulait être dans une transpiration continuelle. Ce système n’est pas mauvais ; je commence à tourner à cette habitude de me couvrir extrêmement ; je la crois très salutaire pour moi. Cuvier avait la réputation d’aimer les petites filles et de s’en procurer à tout prix ; cela explique la paralysie et tous les inconvénients auxquels il a succombé, plus que les excès de travail.
J’ai vu Norma. J’ai cru que je m’y ennuierais, et le contraire est arrivé ; cette musique, que je croyais savoir par cœur et dont j’étais fatigué, m’a paru délicieuse. La pièce est courte, autre mérite. Mme Parodi m’a fait plus de plaisir que dans Lucrezia ; c’est peut-être parce que depuis mon journal m’a appris qu’elle était élève de Mme Pasta, dont elle rappelle beaucoup de traits. Le public croit regretter la Grisi et lui refuse sa faveur. Souvent mon applaudissement solitaire s’élevait au milieu de la froideur universelle. Mme Monceaux y était, qui se montrait aussi difficile que les autres. Boissard et sa femme étaient aux avant-scènes. J’ai été les voir un moment.
14 décembre. — Dîné chez Riesener avec Pierret. J’étais invité chez la princesse et j’espérais y aller le soir. Je suis resté rue Bayard. — Le soir, dans l’atelier, où j’ai fait un fusain d’après un torse de la Renaissance, pour un essai du fixatif que Riesener emploie.
Je suis revenu avec Pierret, par la gelée qui s’est déclarée dans l’après-midi et par un clair de lune admirable. Je lui ai rappelé, dans les Champs-Élysées, qu’à cette même place, il y a plus de trente ans, nous revenions ensemble, vers la même heure, de Saint-Germain, où nous avions été voir la mère de Soulier, à pied, s’il vous plaît, et par une gelée intense… Était-ce bien le même Pierret que j’avais sous le bras ? Que de feu dans notre amitié ! que de glace à présent[752] !… Il m’a parlé des magnifiques projets qu’on fait pour les Champs-Élysées. Des pelouses à l’anglaise remplaceront les vieux arbres. Les balustrades de la place ont disparu ; l’obélisque va les suivre pour être mis je ne sais où. Il faut absolument que l’homme s’en aille, pour ne pas assister, lui si fragile, à la ruine de tous les objets contemporains de son passage d’un moment. Voilà que je ne reconnais plus mon ami, parce que trente ans ont passé sur mes sentiments. Si je l’avais perdu il y a quinze ans, je l’eusse regretté éternellement ; mais je n’ai pas encore eu le temps de me dégoûter de la vue des arbres et des monuments que j’ai vus toute ma vie. J’aurais voulu les voir jusqu’à la fin.
Vendredi 16 décembre. — Dîné chez Véron. Il y avait là cinq ou six médecins. La conversation a roulé pour les trois quarts sur les anus, les fistules, pustules et autres détails de la profession qui faisaient promettre, pour le dessert, au moins une petite dissection. Velpeau[753] y était ; il est très spirituel. Le vertueux Nisard[754] était près de moi et un peu dépaysé.
Samedi 17 décembre. — Dîné chez Lebmann avec Visconti[755], que j’aime à revoir, Mercey, Meyerbeer ; je suis allé avec ce dernier chez Buloz.
Dimanche 18 décembre. — Sorti à onze heures et demie.
À l’école des Beaux-Arts, sur l’invitation de ces messieurs : j’arrivai là comme Mathan dans le temple du Seigneur. Trouvé là le bon Moreau qui poursuit sa carrière philanthropique, fonde des prix à l’École et fait le bonheur des paysans de son endroit. Il m’a ramené dans notre quartier.
Passé chez M. Villot, à pied chez la princesse et M. Lefeu, sans trouver personne. Revenu au Musée, où le froid ne m’a pas permis de rester, et vers trois heures chez M. Fould ; je ne l’ai qu’entrevu, il sortait.
Le soir, Guillaume Tell, auprès de Saint-Georges, qui m’a fait perdre quelques morceaux par ses remarques diverses. À travers tout cela, retrouvé plus que jamais les impressions de ce bel ouvrage qu’on ne peut assez admirer.
Mardi 20 décembre. — Robert le soir ; je n’ai pu entendre que les trois premières notes. J’étais très fatigué. J’y ai trouvé encore des mérites nouveaux. Les costumes, renouvelés naturellement après tant de représentations, m’ont beaucoup intéressé.
Jeudi 22 décembre. — Aujourd’hui, dîné chez Moreau et chez Villot le soir. Mme Villot m’a parlé de cette fameuse commission pour l’Exposition générale[756].
Samedi 24 décembre. — Dîné chez Buloz.
Dans la journée, discussion à l’Hôtel de ville sur la question des boulangers. Chaix d’Est-Ange[757] a fait une sortie qui a intéressé tout le monde comme fait un spectacle. Quant à moi, je ne vois là qu’un assez grand talent d’acteur et d’improvisateur, mais je vois toujours l’acteur. Il est rare que toute cette chaleur de commande tienne contre la plus mince argumentation en sens contraire, faite par un homme sans prétention, mais convaincu de ce qu’il dit.
Au dîner de Buloz, Meyerbeer, Cousin et Rémusat[758] ; en somme, amusant. Babinet est venu le soir[759]. Je parlais avec Cousin des découragements qui s’emparent des artistes, non pas quand ils sentent que leur verve diminue, mais quand leur public commence à se lasser d’eux, ce qui arrive tôt ou tard. C’est, m’a-t-il dit, qu’ils n’ont plus le diable au corps, et il a raison. Je disais à Rémusat que je me faisais éveiller avec le jour, et que dans cette saison, à travers le froid et la neige, je courais à mon travail avec ardeur et plaisir. Que c’est beau ! m’a-t-il dit ; que vous êtes heureux !… Et il a grandement raison.
Je suis revenu à pied et suis entré à Saint-Roch à la messe de minuit. Je ne sais si cette foule entassée là, ces lumières, enfin cette espèce de solennité ne mont pas fait paraître plus froides et plus insipides toutes les peintures qui sont là sur les murs… Que le talent est rare ! Que de labeurs dépensés à barbouiller de la toile, et quelles plus belles occasions que ces sujets religieux ! Je ne demandais à tous ces tableaux si patiemment ou même si habilement fabriqués par toutes sortes de mains, et de toutes sortes d’écoles, qu’une touche, qu’une étincelle de sentiment et d’émotion profonde, qu’il me semble que j’y aurais mise presque malgré moi. Dans ce moment, qui avait quelque solennité, ils me semblaient plus mauvais qu’à l’ordinaire ; mais, en revanche, combien une belle chose m’eût ravi ! C’est ce que j’ai éprouvé, toutes les fois qu’une belle peinture était devant mes yeux à l’église, pendant qu’on exécutait de la musique religieuse, qui, elle, n’a pas besoin d’être aussi choisie pour produire de l’effet, la musique s’adressant sans doute à une partie de l’imagination, différente et plus facile à captiver. Je me rappelle avoir vu ainsi, et avec le plus grand plaisir, une copie du Christ de Prud’hon, à Saint-Philippe du Roule ; je crois que c’était pendant l’enterrement de M. de Beauharnais… Jamais, à coup sûr, cette composition, qui est critiquable, ne m’avait paru meilleure. La partie sentimentale semblait se dégager et m’arrivait sur les ailes de la musique. Les anciens ont connu quelque chose d’analogue et l’ont mis en pratique : on dit d’un grand peintre de l’antiquité qu’en montrant ses tableaux il faisait entendre aux spectateurs une musique propre à les mettre dans une situation d’esprit conforme au sujet de la peinture ; ainsi il faisait sonner de la trompette, en montrant la figure d’un soldat armé, etc. Je me rappelle mon enthousiasme, lorsque je peignais à Saint-Denis du Saint-Sacrement et que j’entendais la musique des offices ; le dimanche était doublement un jour de fête ; je faisais toujours ce jour-là une bonne séance[760]. La meilleure tête de mon tableau du Dante a été faite avec une rapidité et un entrain extrêmes, pendant que Pierret me lisait un chant du Dante, que je connaissais déjà, mais auquel il prêtait, par l’accent, une énergie qui m’électrisa. Cette tête est celle de l’homme qui est en face, au fond, et qui cherche à grimper sur la barque, ayant passé son bras par-dessus le bord.
On parlait à table de la couleur locale. Meyerbeer disait avec raison qu’elle tient à un je ne sais quoi qui n’est point l’observation exacte des usages et des coutumes : « Qui en est plus plein que Schiller, a-t-il dit, que Schiller dans son Guillaume Tell ? et cependant il n’a jamais rien vu de la Suisse. » Meyerbeer est maître en cela : les Huguenots, Robert, etc. Cousin ne trouvait pas la moindre couleur locale dans Racine, qu’il n’aime point ; il se figure que Corneille, dont il est engoué, en est plein. Je disais sur Racine ce que je pense et ce qu’on doit en dire, c’est-à-dire qu’il est trop parfait ; que cette perfection et l’absence de lacunes et de disparates lui ôtent le piquant que l’on trouve à des ouvrages pleins de beautés et de défauts à la fois. Il me disait à satiété que ses idées étaient prises partout et n’étaient que des traductions. Il me citait je ne sais combien d’exemplaires d’Euripide ou de Virgile annotés de sa main, de manière à en tirer des vers tout faits… Que de gens ont annoté Euripide et tous les anciens, sans en tirer la moindre parcelle de quoi que ce soit qui ressemble à un vers de Racine ! Mme Sand me disait la même chose : ce sont là de ces curiosités de gens de métier ! La langue d’un grand homme parlée par lui est toujours une belle langue. Autant vaudrait-il dire que Corneille, qui est très beau dans notre langue, aurait été plus beau encore en espagnol ! Les gens de métier critiquent plus finement que les autres, mais ils sont entêtés des choses de métier. Les peintres ne s’inquiètent que de cela. L’intérêt, le sujet, le pittoresque même, disparaissent devant les mérites de l’exécution, j’entends de l’exécution scolastique.
En relisant ce que j’ai dit de Meyerbeer, à propos de la couleur locale, il m’arrive de penser qu’il en est trop épris. Dans les Huguenots, par exemple : la lourdeur croissante de son ouvrage, la bizarrerie des chants vient en grande partie de cette recherche outrée. Il veut être positif, tout en recherchant l’idéal ; il s’est brouillé avec les grâces en cherchant à paraître plus exact et plus savant. Le Prophète, que je ne me rappelle pas, ne l’ayant presque point entendu, doit être un pas nouveau dans cette route. Je n’en ai rien retenu. Dans Guillaume Tell, s’il l’eût composé, il eût voulu, dans le moindre duo, nous faire reconnaître des Suisses et des passions de Suisses. Rossini, lui, a peint à grands traits quelques paysages dans lesquels on sent, si l’on veut, l’air des montagnes, ou plutôt cette mélancolie qui saisit l’âme en présence des grands spectacles de la nature, et sur ce fond, il a jeté des hommes, des passions, la grâce et l’élégance partout. Racine a fait de même. Qu’importe qu’Achille soit Français ! Et qui a vu l’Achille grec ? Qui oserait, autrement qu’en grec, le faire parler comme Homère l’a fait ? « De quelle langue allez-vous vous servir ? demande Pancrace à Sganarelle. — Parbleu ! de celle que j’ai dans la bouche ! » On ne peut parler qu’avec la langue, mais aussi qu’avec l’esprit de son temps. Il faut être compris de ceux qui vous écoutent, et surtout il faut se comprendre soi-même. Faire l’Achille grec ! Eh, bon Dieu ! Homère lui-même l’a-t-il fait ? Il a fait un Achille pour les gens de son temps. Les hommes qui avaient vu le véritable Achille n’étaient plus depuis longtemps. Cet Achille devait ressembler à un Huron plus qu’à celui d’Homère. Ces bœufs et ces moutons que le poète lui fait embrocher de ses propres mains, peut-être les mangeait-il tout crus et assommés par lui. Ce luxe, dont Homère le relève, sortait de son imagination ; ces trépieds, ces tentes, ces vaisseaux, ne sont autre chose que ceux qu’il avait sous les yeux, dans le monde où il vivait. Plaisants vaisseaux, que ceux des Grecs au siège de Troie ! Tout l’ost des Grecs eût capitulé devant la flottille qui sort de Fécamp ou de Dieppe pour aller à la pêche du hareng. Ç’a été la faiblesse de notre temps, chez les poètes et les artistes, de croire qu’ils avaient fait une grande conquête, avec l’invention de la couleur locale. Ce sont les Anglais qui ont ouvert la marche, et nous nous sommes évertués, à leur suite, à donner l’assaut aux chefs-d’œuvre du génie humain.
(Reporter là tout ce qui est plus haut, sur l’invraisemblance des fables de Walter Scott et des romans modernes mis en regard de la recherche de la vérité dans les détails.)
Mardi 27 décembre. — Travaillé peu, et un peu de malaise qui a augmenté à dîner.
La bonne Alberthe m’avait envoyé une stalle le matin. J’ai donc été aux Italiens, et cette sortie, qui me coûtait, m’a fait du bien plutôt que du mal. On donnait la Lucia. L’autre jour, à Lucrezia, je rendais justice à Donizetti ; je me repentais de ma sévérité à son égard. Aujourd’hui, tout cela a paru, à ma courbature et à ma fatigue, bien bruyant, bien peu intéressant. Rien du sujet, ni des passions, excepté peut-être le fameux quintette. L’ornement tient toute la place dans cette musique ; ce ne sont que festons et astragales : je l’appelle de la musique sensuelle, uniquement, qui n’est calculée que pour chatouiller l’oreille un moment.
J’ai rencontré mon ami Chasles au foyer. Il a commencé, avec cette manière mielleuse et raide à la fois qui caractérise cette nature sans franchise, se rabaissant avec une humilité qu’il ne voulait pas même que je crusse réelle. Je lui ai dit qu’il ne fallait dire de soi ni bien ni mal. En effet, si vous en dites du mal, tout le monde vous prend au mot ; si vous en dites trop de bien ou seulement un peu de bien, vous fatiguez tout le monde. Il est sorti de tous ces compliments, et nous avons parlé du théâtre, d’art dramatique, de Racine, de Shakespeare. Il préfère ce dernier à tout, « mais, m’a-t-il dit, c’est moins pour moi un artiste qu’un philosophe. Il ne cherche pas l’unité, le résumé, le type comme les artistes, il prend un caractère : c’est quelque chose qu’il a vu et qu’il étudie, en vous le faisant voir au naturel. » Cette explication me paraît juste. Je lui ai demandé si, avec ses entrées et ses sorties, et tout ce remue-ménage continuel de lieux et de personnages, les pièces de Shakespeare n’étaient point fatigantes même pour un homme qui comprend tout le mérite de son langage. Il en est convenu.
J’ai rencontré Berryer avec le plus grand plaisir, et un peu honteux de l’avoir négligé. Il me témoignait le regret de ne pas me voir, et ce n’étaient pas même de tendres reproches. C’est une nature vraiment riche et sympathique. Il m’a dit que je devais l’aller trouver à la campagne quelquefois ; je l’aime beaucoup.
Je suis sorti avant la fin, très fatigué, et j’ai passé une nuit tout en sueur et en maladie. La matinée était meilleure.
Jeudi 29 décembre. — Première séance à la réunion pour le jury de l’Exposition de 1855. J’y ai vu le pauvre Visconti[761] à deux heures ;… à cinq heures, il n’était plus ! J’ai été désespéré de ce malheur qui intéresse tout le monde, mais qui me prive personnellement de l’homme le plus sympathique que j’aie rencontré depuis longtemps.
Vendredi 30 décembre. — On me disait, à propos de la Vénus, qu’en la regardant, on voyait tout à la fois. Cette expression m’a frappé : c’est là, en effet, la qualité qui doit dominer ; les autres ne doivent venir qu’après.
1854
Sans date. — Fragments d’un dictionnaire, etc. — Petits articles très courts sur les artistes célèbres et en passant ou traitant seulement un point qui les regarde ou d’une qualité propre à eux.
— Le beau implique la réunion de plusieurs qualités : la force toute seule n’est pas la beauté sans la grâce, etc. : en un mot, l’harmonie en serait l’expression la plus large. — Cette panhypocrisiade universelle.
1er janvier. — Tout va si mal : la vertu elle-même est si faible et si chancelante, le talent si journalier, si sujet à se dégrader et à s’abandonner soi-même, que les hommes sont facilement accoutumés à se contenter en tout de l’apparence seulement du talent et de la vertu. Apparence de talent, semblant d’honnêteté : point d’imitation de personne sur aucun point. Vous me le donnez, je le prends ; je n’exige guère, de peur d’être obligé de rendre beaucoup. Il n’y a que sur la civilité qu’ils sont excessifs, parce qu’elle ne coûte rien.
Vous êtes avocat, vous défendez et vous faites triompher le client per fas et nefas, et il n’y a rien à dire, c’est le devoir ! réussir surtout. Avoir défendu le client en pure perte avec tout le talent et la conscience imaginables, fâcheux accident, dont il faut se relever par un succès obtenu, s’il est nécessaire, dans un cas plus douteux, près de juges prévenus, en s’appuyant sur toutes les circonstances préparées ou fortuites qui concourent ordinairement à tous les succès.
Vous êtes l’archevêque de Cavaignac et sa créature ; sa main vous a tiré de l’obscurité du néant. Vous serez l’archevêque de Napoléon, vous le consacrerez comme l’élu d’un grand peuple : la mitre commande. Vous n’êtes plus l’archevêque de Cavaignac, vous êtes l’archevêque de Paris. Vous entonnez le Salvum fac imperatorem avec tranquillité ; vous recevez l’encens d’une manière convenable. Vous ne serez pas sorti de votre devoir, de ceux que demande et dont se contente le public.
Il n’y a pas une voix qui vous crie que vous devez prêter à la critique, pas une voix, celle de votre conscience moins que les autres, qui vous avertisse en secret. Qui donc, si vous ne vous le donnez vous-même, vous donnerait ce charitable avertissement ? Je le dis charitable, dans l’intérêt de votre triste honneur, non dans celui des nécessités de votre position, des nécessités du bien vivre, du paraître. Qui vous le donnerait, cet avertissement que vous n’avez pas reçu comme une inspiration naturelle dans l’exercice d’un ministère et dans les méditations d’une situation qui vous rapproche de la source de toute vertu ? L’attendriez-vous de ceux que vous appelez vos amis, quand vous ne l’avez pas senti en dedans de vous, dans le silence du sanctuaire ? Quoi ! vous approchez le Saint des saints ! vous vivez dans la communion des élus ! vous montez dévotement en chaire et les yeux baissés modestement comme pour interroger les replis de votre cœur, ou bien, les mains et les regards élevés comme pour attester l’auteur des saintes inspirations, vous étalez devant de tristes et faibles humains la corruption de leur nature, vous la leur faites toucher du doigt ! Vous êtes ménager devant eux de ces promesses qui encourageraient, consoleraient leurs aspirations vers le bien ; vous tonnez quelquefois, vous êtes la voix de Dieu lui-même ! mais vous savez bien ce que c’est que cet instrument et quel est cet organe dont il se sert pour faire arriver sa parole jusqu’à ses créatures déshéritées. Oui ! cette voix, en passant par vos lèvres, et je ne dis pas votre cœur, pour arriver à ces cœurs abattus, pour effrayer même les justes, cette voix, dis-je, réveille malgré vous dans vous-même un sentiment importun. Vous ne pouvez avoir aboli, à ce point, dans votre être, le sentiment du juste, qu’il ne se passe en vous un tumulte qui troublera et attristera la sécurité que la vue du monde, comme il est, vous a accoutumé à regarder comme la paix de l’âme. Vous remportez, au milieu de ces flatteurs, de ces corrompus, si attentifs à vous cacher leur corruption et à feindre de ne point s’apercevoir de la vôtre, un fond chagrin, une soucieuse attitude, que vous vous efforcez de faire paraître tranquille pour l’homme de l’habit que vous portez, pour paraître, par le calme de votre visage, aussi élevé au-dessus du commun des hommes, que vous semblez l’être par les insignes sacrés de votre dignité.
4 janvier. — Soirée aux Tuileries. J’en suis revenu plus chagrin que de l’enterrement du pauvre Visconti. La figure de tous ces coquins[762] et de toutes ces coquines, ces âmes de valets sous ces enveloppes brodées, lèvent le cœur.
5 janvier. —
« Ainsi, dans toutes nos résolutions, il faut examiner quel est le parti qui présente le moins d’inconvénients et l’embrasser comme le meilleur, parce qu’on ne trouve jamais rien de parfaitement pur et sans mélange, ou exempt de danger. »
(Machiavel.)
17 janvier. — Les littérateurs font semblant de croire que l’oreille et l’œil jouissent, dans la musique et dans la peinture, comme le palais dans l’action de manger et de boire.
25 janvier. — Ce soir, à la soirée de la princesse Marceilini, S…, en me parlant de Mozart, me dit qu’il avait laissé un petit livre dans lequel il notait tout ce qu’il composait : il y a des jours, des semaines, des mois pendant lesquels il ne fait rien ; quand il s’y remet, c’est prodigieux ; ce que c’est que l’ouvrage d’un seul jour quelquefois !
— Armide arrivant au camp de Godefroi… Sa suite, ardeur des chevaliers.
— Frappement du rocher, pour le ministère d’État.
— Renaud dans la forêt enchantée[763] : les disciples près des arbres.
29 janvier. — L’admirable symphonie que j’avais oubliée. Se rappeler dans l’avant-dernier morceau la gueule de l’enfer entr’ouverte pendant une mesure ou deux.
Le matin, *** est venu m’apprendre, par une pluie affreuse et à travers la crotte, que mon plafond avait fait fiasco hier soir… Le bon cœur ! l’aimable parent !… Comme il m’a trouvé très froid à ses remarques, attendu que je le trouve bon, il s’en est allé sans avoir rempli son but. Il remportait alors l’inquiétude d’avoir par trop compté sur ma bénignité ; sa figure allongée et verdie annonçait la crainte de voir s’envoler les commandes de tableaux et de plafonds.
6 mars. — Commencé à montrer le salon de la Paix, à l’Hôtel de ville, jusqu’au 13 inclusivement[764].
9 mars. — Vu chez le ministre d’État M. Isabey, qui m’a demandé des billets pour le prochain bal de l’Hôtel de ville, pour lui, sa femme et sa fille. — Id., id., pour Riesener et sa femme.
11 mars. — Grande interruption dans ces pauvres notes de tous les jours : j’en suis très attristé ; il me semble que ces brimborions, écrits à la volée, sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu’elle s’écoule. Mon défaut de mémoire me les rend nécessaires ; depuis le commencement de l’année, le travail suivi de l’achèvement de l’Hôtel de ville me donnait trop de distraction ; depuis que j’ai fini, et il y a bientôt un mois, j’ai les yeux en mauvais état, je crains d’écrire et de lire.
Article remarquable sur les Kœnigsmarck[765], par M. Blaze[766], Revue des Deux Mondes (15 octobre 1852 — 15 mai 1853).
Aller chez M. Viardot, la semaine prochaine ; M. Thiers, id.
Billets à Signol, à Larivière[767], à Panseron[768], à M. Pelletier[769], à Dedreux-Dorcy[770].
A. Deschamps[771], qui est venu me voir ces jours-ci, me disait que Félix Bodin[772], que nous avons connu, qui est mort assez jeune et qui était un homme maigre, lui disait qu’un homme de son tempérament était tué inévitablement dans la compagnie habituelle d’un homme gras et robuste : ces natures tirent à elles, au lieu de rendre, contrairement à l’opinion des anciens médecins qui faisaient coucher des vieillards avec de jeunes filles, pensant leur communiquer ainsi un peu de la chaleur et de l’activité d’un jeune sang.
14 mars. — Dîné chez Villot, avec Nadaud[773], Arago, Bixio.
15 mars. — Dîné chez Hippolyte Rodrigues[774] avec Halévy, Boilay, Mirès[775] ; ce dernier, très original, très sensé, très spirituel ; il est bien la preuve que c’est l’esprit qui fait l’homme. Il me disait, sur ce que le peuple, à présent, croit que le bien-être lui est dû, indépendamment de l’esprit et de l’industrie employés à se le procurer, en un mot sur cette rage d’égalité de bonheur qui possède tous ces gens-là et que je déplorais, que c’était un mobile qui venait à son tour et qui avait son temps à faire, comme tous ceux qui ont soulevé les hommes plus ou moins longtemps, les guerres de religion par exemple.
Il disait que, quelque judiciaire qu’on apporte dans les affaires, on avait besoin d’un associé, d’un autre vous-même qui vous éclairât et vous fît quelquefois toucher du doigt la fausseté d’un calcul sur lequel on fondait de l’espérance.
Chez la princesse ensuite, où je ne suis arrivé qu’à onze heures passées. Elle confessait sa mobilité et la facilité de caractère qui la porte à donner toujours raison au dernier qui lui parle.
Mirès disait que l’artiste était une variété du fou. Mais l’artiste n’a pas besoin, comme dans les autres professions, je veux dire à l’endroit même de la profession, de cette présence d’esprit, de cette fixité dans les résolutions, sans lesquelles ni le général d’armée, ni l’administrateur, ni le financier ne sauraient rien faire de bon.
Je pense, le lendemain, qu’une partie de la supériorité de Louis-Napoléon vient sans doute de ce qu’il n’a rien de l’artiste.
20 mars. — Enterrement de la pauvre Mme Delaborde. Quantité de figures que je n’avais pas vues depuis longtemps. Villemain très changé ; M. d’Houdetot méconnaissable. Le plus beau temps du monde : les bourgeons naissants verdoyant sous le soleil de printemps au milieu de cette mort et de cette caducité.
Je suis revenu de l’église à pied, par le pont d’Iéna où j’ai été voir la statue de Préault[776], que j’aurais voulu trouver meilleure ; de là chez Riesener, le long de la rive gauche.
Vu chez Comon la jeune personne, en allant acheter l’Artiste ; de là chez Mercey, qui m’a remis la commande du tableau pour l’Exposition.
Dîné chez Mme de Forget avec Laity[777] et Mme de Querelles, très bonne enfant.
Chez Devinck. Musique : morceau de Bach arrangé par Gounod. Le violon Hermann trop maniéré[778].
21 mars. — Travaillé toute la journée à l’Antée[779] pour Dumas, aux compositions de Chasses de lions[780], etc.
Vers quatre heures, chez le ministre ; revenu à pied ; rencontré l’insupportable Dagnan[781] et le bon Debay qui espère toujours que je traverserai la forêt de Sénart pour aller le voir à Montgeron.
Le soir, M. Lefèvre-Deumier[782] ; j’y ai vu Yvon[783], qui m’a complimenté.
22 mars. — Sur le paysage. — Sur les modes dans les arts. — De l’imitation de l’antique : tout le monde l’a imité. — Sur la composition critique de diverses compositions de grands maîtres : Entrée à Babylone d’Alexandre, par Lebrun. Le faux pittoresque préféré à la convenance, comme dans Lebrun, ou l’insignifiance et la platitude, comme dans le Christ au tombeau de Titien ; sa composition du Couronnement d’épines, de même. Chez Paul Véronèse, l’arrangement est de beaucoup préférable, mais l’intérêt dramatique est nul : qu’il peigne le Christ ou un bourgeois de Venise, ce sont toujours ses robes de chambre, ses fonds bleus, ses petits nègres portant de petits chiens, tout cela, il est vrai, arrangé avec l’harmonie des lignes et de la couleur.
23 mars, — Bal aux Tuileries : même sentiment d’ennui des autres et de moi-même. Cette abjection dorée est la plus triste de toutes.
Sur la sculpture : l’art princeps. — Ces sculpteurs modernes ne font que des pastiches.
La littérature. — Elle est l’art de tout le monde : ou l’apprend sans s’en douter.
Les commissions. — J’ai été frappé à la dernière séance combien il faut consulter les hommes spéciaux. Mémoire sur ce sujet : tout ce qu’elles font est incomplet et surtout incohérent. À cette séance, les artistes votaient ensemble ; ils avaient la raison pour eux ; les autres ne comprennent que confusément ; ils n’ont pas de notions claires.
Ce n’est pas à dire que, si je gouvernais, je remettrais les questions d’art, par exemple, à des commissions d’artistes. Les commissions seraient purement consultatives, et l’homme de mérite qui les présiderait n’en ferait qu’à sa tête après les avoir écoutées. Réunis et seuls du métier, chacun reprend promptement son point de vue étroit ; opposés à des gens tout à fait incapables, les avantages certains et généraux ressortent à leurs yeux, et ils les font ressortir avec succès.
Ceci est contre les républiques. On objecte celles qui ont jeté de l’éclat ; j’en vois la raison dans l’esprit traditionnel qui a survécu à tout, chez ces républiques, dans certains corps chargés du maniement des affaires. Les républiques les plus célèbres sont les aristocratiques. Un noble, comme un plébéien, pourvu qu’il ait du sens, comprendra l’intérêt du pays ; mais le plébéien est un membre d’un corps qui n’est nulle part ; le noble, au contraire, n’est quelque chose que par la tradition et par l’esprit conservateur qui lui rend plus chère encore une patrie à la tête de laquelle le placent ces institutions qu’il a mission de défendre : Venise, Rome, l’Angleterre, etc., sont des exemples. L’esprit national ne se retrouvera dans le peuple que quand il se trouvera directement en face d’intérets nationaux étrangers. C’est comme dans les commissions où les artistes, opposés à des manufacturiers, votent comme un seul homme. Envoyez à un congrès européen un certain nombre de plébéiens anglais, je parle de ceux qui font de l’opposition chez eux, qui sont pour le progrès, pour les changements, ils seront Anglais avant tout vis-à-vis des Allemands, des Français, etc. ; ils soutiendront, sans en retirer une syllabe, les privilèges anglais qui font la force de l’Angleterre, et qu’un instinct secret leur dit être le principe de cette force.
24 mars. — Travaillé à ébaucher les Chasseurs de lions, pour Weill.
À deux heures et demie, séance à la commission de l’Industrie. Discussion sur le règlement concernant l’exposition des ouvrages faits depuis le commencement du siècle. J’ai combattu avec succès, aidé de Mérimée, cette proposition, qui a été écartée. Ingres[784] a été pitoyable ; c’est une cervelle toute de travers ; il ne voit qu’un point… C’est comme dans sa peinture ; pas la moindre logique et point d’imagination : Stratonice, Angélique, le Vœu de Louis XIII, son plafond récent avec sa France et son Monstre.
26 mars. — Concert à Sainte-Cécile. Je n’ai prêté d’attention qu’à la Symphonie héroïque[785]. J’ai trouvé la première partie admirable, l’andante est ce que Beethoven a peut-être fait de plus tragique et de plus sublime, jusqu’à la moitié seulement. Ensuite la Marche du Sacre de Cherubini que j’ai entendue avec plaisir. Quant à Preciosa[786], la chaleur qu’il faisait là, ou une brioche que j’avais mangée, avant de venir, ont paralysé mon âme immortelle, et j’ai dormi presque tout le temps.
Je pensais, en entendant le premier morceau, à la manière dont les musiciens cherchent à établir l’unité dans leurs ouvrages. Le retour des motifs principaux est, en général, celui qu’ils croient le plus efficace : c’est aussi celui qui est le plus à la portée de la médiocrité. Si ce retour est, dans certains cas, l’occasion d’une grande satisfaction pour l’esprit et pour l’oreille, il semble, quand on l’applique trop souvent, un moyen secondaire, ou plutôt un pur artifice. La mémoire est-elle si fugitive qu’on ne puisse établir de relations dans les différentes parties d’un morceau de musique, si on n’affirme en quelque sorte à satiété l’idée principale par de continuelles répétitions ?
Une lettre, un morceau de prose ou de poésie présente une déduction et un ensemble qui ressortent du développement des idées naissant les unes des autres, et pas par la répétition d’une phrase qui sera, si l’on veut, le point capital de la composition.
Les musiciens ressemblent en cela aux prédicateurs qui répètent à satiété et fourrent partout la phrase qui sert de texte à leur discours.
Je me rappelle, dans ce moment, plusieurs airs de Mozart dont la logique et la déduction sont admirables, sans que le motif principal soit répété : l’air Qui l’odio non facunda, le chœur des prêtres de la Flûte enchantée, le trio de la Fenêtre, de Don Juan, le quintette, idem, etc. Ces derniers sont des morceaux de longue haleine, ce qui augmente le mérite. Dans ses symphonies, il répète quelquefois à satiété le motif principal ; peut-être, en cela, se conforme-t-il à des usages établis. Cet art-là me semble plus assujetti que les autres à des habitudes pédantesques de métier, qui donnent une satisfaction aux gens purement musiciens, mais qui fatiguent toujours les auditeurs peu versés dans la curiosité du métier, telle que les fugues, les rentrées savantes, etc.
Ces répétitions du motif me paraissent être occasionnellement, comme je le disais, une source de jouissances, quand elles sont employées à propos, mais elles donnent moins le sentiment de l’unité, qu’elles ne fatiguent quand l’unité ne ressort pas naturellement à l’aide des vrais moyens dont le génie a le secret. L’esprit est si imparfait, si difficile à fixer, que l’homme le plus sensible aux arts éprouve toujours, en présence d’un bel ouvrage, une sorte d’inquiétude, de difficulté d’en jouir complètement, que ne peuvent faire disparaître les petits moyens de produire une unité factice, moyens comme les répétitions des motifs dans la musique, comme la concentration de l’effet dans la peinture, petites et mesquines industries dont le commun des artistes s’empare facilement et qu’il applique de même. Un tableau qui semble devoir satisfaire plus complètement et plus facilement ce besoin d’unité, puisqu’il semble qu’on le voie tout d’une fois, ne le produit pas davantage s’il n’est bien composé, et j’ajoute même que, offrît-il au plus haut degré une grande unité dans son effet, l’âme ne sera pas pour cela complètement satisfaite. Il faut que, dans l’absence de l’ouvrage qui a éveillé en elle des sentiments, elle se recueille dans le souvenir : alors dominera celui de l’unité de l’ouvrage, si cette qualité s’y trouve effectivement. C’est alors que l’esprit saisit l’ensemble de la composition, ou se rend compte des disparates et des lacunes. Ces remarques faites à propos de la musique me font apercevoir plus particulièrement combien les gens de métier sont de pauvres connaisseurs dans l’art qu’ils exercent, s’ils ne joignent à la pratique de cet art une supériorité d’esprit ou une finesse de sentiment, que ne peut donner l’habitude de jouer d’un instrument ou de se servir d’un pinceau. Ils ne connaissent d’un art que l’ornière dans laquelle ils se sont traînés, et les exemples que les écoles mettent en honneur. Jamais ils ne sont frappés des parties originales ; ils sont, au contraire, bien plus disposés à en médire ; en un mot, la partie intellectuelle, ce sentiment-là leur échappe complètement, et comme ils sont malheureusement les juges les plus nombreux, ils peuvent dérouter longtemps le goût public et de même retarder le vrai jugement qu’il faut porter sur les beaux ouvrages. De là, sans doute, cette condescendance des grands talents pour le goût étroit et mesquin qui est, en général, la régie des conservatoires et des ateliers. De là ce retour de moyens prétendus savants qui ne satisfont aucun besoin de l’âme, et qui, par la répétition de banalités convenues, déparent certains chefs-d’œuvre et les marquent promptement d’un cachet de décrépitude.
Les beaux ouvrages ne vieilliraient jamais s’ils n’étaient empreints que d’un sentiment vrai. Le langage des passions, les mouvements du cœur sont toujours les mêmes ; ce qui donne inévitablement ce cachet d’ancienneté, lequel finit quelquefois par effacer les plus grandes beautés, ce sont ces moyens d’effet à la portée de tout le monde, qui florissaient au moment où l’ouvrage a été composé ; ce sont certains ornements accessoires à l’idée et que la mode consacre, qui font ordinairement le succès de la plupart des ouvrages. Ceux qui, par un prodige bien rare, se sont passés de cet accessoire, n’ont été compris que fort tard et fort difficilement, ou par des générations qui étaient devenues insensibles à ces charmes de convention.
Il y a un moule consacré dans lequel on jette les idées bonnes ou mauvaises, et les plus grands talents, les plus originaux, en portent involontairement la trace. Quelle est la musique qui résiste, après un certain nombre d’années, au caractère de vétusté que lui impriment les cadences, les fioritures qui souvent ont fait sa fortune, à son apparition ? Quand l’école moderne d’Italie a substitué des ornements d’un goût qui a semblé nouveau à ceux dont nous avions l’habitude dans la musique de nos pères, cette nouveauté a paru le comble de la distinction ; mais cette impression n’a pas duré autant que la mode dans les vêtements et dans les bâtiments. Elle a eu tout au plus assez de puissance pour nous lasser passagèrement des ouvrages anciens, en les faisant paraître vieux ; mais ce qui a déjà prodigieusement vieilli, ce sont les ornements, c’est la parure indiscrète qu’un magistique (sic) génie ne dédaignait pas d’ajouter à ses heureuses conceptions et dont la foule des imitateurs a fait la substance même des ouvrages dénués d’invention.
Il faut déplorer ici cette triste condition de certaines inventions qui nous charment dans les esprits originaux. Ces agréments mêmes, ces ornements, ajoutés par la main du génie à des idées expressives et profondes, sont presque une nécessité à laquelle il cède naturellement. Ce sont des intervalles, des repos presque nécessaires, qui reposent l’esprit et le conduisent à de nouvelles idées.
Sur les nouvelles sonorités, les combinaisons de Beethoven : elles sont déjà devenues l’héritage ou plutôt le butin des moindres débutants.
27 mars. — Premier acte de la Vestale[787] dans la loge de Mme Barbier. J’ai été frappé, à travers la vétusté, d’un souffle original et qui a dû ressortir bien davantage à l’origine. Je ne sais si Cherubini est un plus grand musicien, mais il ne me donne pas cette impression. Il me semble qu’il est le calque des formes qu’il a trouvées établies : ainsi le Requiem de Mozart serait la règle dont il n’est pas sorti.
En sortant, vu deux actes d’Ulysse[788] qui m’a paru encore affaibli. Cette musique mince ne va pas aux temps héroïques. Le dialogue est bien puéril, et cependant, quand on l’interrompt pour intercaler un morceau de musique, on est dans la situation d’un voyageur qui fait une route insipide, mais qui voudrait n’arrêter qu’au bout de sa carrière ; en un mot, c’est un genre bâtard : bâtard quant au poème par la niaise imitation de mœurs qui ne nous touchent pas, bâtard par cette musique d’opera-comique, et qui certes n’a rien d’antique pour faire chanter des porchers. Mieux aurait valu du plain-chant, puisqu’on était en train d’archaïsme.
4 avril. — De la différence qu’il y a entre la littérature et la peinture relativement à l’effet que peut produire l’ébauche d’une pensée, en un mot de l’impossibilité d’ébaucher en littérature, de manière à peindre quelque chose à l’esprit, et de la force, au contraire, que l’idée peut présenter dans une esquisse ou un croquis primitif. La musique doit être comme la littérature, et je crois que cette différence entre les arts du dessin et les autres tient à ce que les derniers ne développent l’idée que successivement. Quatre traits, au contraire, vont résumer pour l’esprit toute l’impression d’une composition pittoresque.
Même quand le morceau de littérature ou de musique est achevé quant à sa composition générale, qui est supposée devoir donner l’impression pour l’esprit, l’inachèvement des détails sera d’un plus grand inconvénient que dans un marbre ou un tableau ; en un mot, l’a peu près y est insupportable, ou plutôt ce qu’on appelle, en peinture, l’indication, le croquis, y est impossible : or, en peinture, une belle indication, un croquis d’un grand sentiment, peuvent égaler les productions les plus achevées pour l’expression.
7 avril. — Concert de la princesse. J’étais à côté de Mlle Gavard et de son frère ; il faisait une chaleur insupportable et une odeur de rat mort qui l’était de même. Cela a été d’une grande longueur. On a commencé par le plus beau ; quoique cela ait nécessairement gâté le reste, on a du moins goûté tout du long et sans fatigue cette belle symphonie en ut mineur de Mozart ; mon pauvre Chopin[789] a des faiblesses après cela. La bonne princesse s’obstine à jouer ses grands morceaux ; elle y est encouragée par ses musiciens qui ne s’y connaissent point, tout artistes de métier qu’ils sont. Le souffle manque un peu à ces morceaux. Il faut dire que la contexture, l’invention, la perfection, tout est dans Mozart. Barbereau me disait chez Boissard, après ce beau quatuor dont je parle plus loin, qu’il a, plus encore que Haydn, la simplicité et la franchise des idées ; c’est surtout par le souvenir qu’on l’apprécie. Il en met une grande partie sur le compte de la science, sans omettre l’inspiration ; il dit que c’est la science qui fait tirer ainsi partie des idées.
Chenavard me disait, ce jour-là, qu’Haydn lui paraissait avoir le style comique, le style de la comédie ; il s’élève rarement jusqu’au pathétique. Mozart, me disait S…, ainsi qu’Haydn, n’a pas mis la passion dans la symphonie. Ce dernier particulièrement, qui en a tant mis dans son théâtre, ne cherche dans la symphonie qu’une récréation pour l’oreille, récréation intelligente, bien entendu, mais point de ces élans sombres et violents qui sont presque tout Beethoven, lequel n’a jamais pu faire de théâtre[790].
8 avril. — L’homme heureux est celui qui a conquis son bonheur ou le moment de bonheur qu’il ressent actuellement. Le fameux progrès tend à supprimer l’effort entre le désir et son accomplissement : il doit rendre l’homme plus véritablement malheureux. L’homme s’habitue avec cette perspective d’un bonheur facile à atteindre : suppression de la distance, suppression de travail dans tout.
Après avoir supprimé l’espace, mis à bon marché toutes sortes de substances qui servent au luxe et au plaisir d’une génération amollie, il ne reste plus qu’à décider la terre à répandre d’une main plus libérale ses antiques dons, source de notre vie même. Il est plus difficile de régler le cours des saisons que de creuser des montagnes et d’aligner sur des espaces considérables des monceaux de fer, voie expéditive qui rapproche les lieux et ménage le temps. Des philanthropes ont bien imaginé que la mécanique suppléerait quelque jour au caprice du vent et aux difficultés du sol pour donner libéralement au genre humain cette nourriture qu’il n’arrache à la terre qu’avec des sueurs, depuis qu’il a été jeté tout nu sur sa face, et depuis qu’il a renoncé à se procurer une chétive subsistance avec des arcs et des flèches, aux dépens d’autres chétives créatures qui trouvent, elles, sans les mêmes soins, quoique avec peine encore, la nourriture…
9 avril. — Détestable concert à Sainte-Cécile : le fameux finale de Mendelssohn, annoncé par S…, m’a paru un charivari sans idées.
En sortant, été voir Mme Delessert sur son invitation. Marche turque de Beethoven et chœur de D… : médiocres, affectés. Pourquoi ne pas exécuter ces beaux concertos, comme celui que Chopin m’a fait connaître ?
La pauvre princesse nous donnait aussi des choses ennuyeuses dans le même genre ; elle faisait chanter à Mario un air de Chopin et surtout un Chant de mai, qu’il ne faut pas confondre avec celui de 1815… prétentieuse et vague imagination de Meyerbeer.
10 avril. — Dîné chez Mme de Forget avec Mme de Querelles ; bien qu’elle abonde volontiers dans le sens des conversations religieuses, je la trouve avec plaisir ; nous avons beaucoup parlé des tables. Les prêtres y voient l’influence des mauvais esprits.
11 avril. — J’ai fait mes paquets toute la matinée et ai été à deux heures chez Boissard. Divin quatuor de Mozart.
Chenavard nous parlait de Rossini : on le traitait déjà de perrucone, en 1828. Il crève de jalousie pour les succès des moindres musiciens. Le philosophe nous citait le mot de Boileau, déjà très vieux, à Louis Racine : il lui disait qu’il n’avait jamais entendu faire l’éloge du moindre savetier sans se sentir mordu au cœur. Il disait qu’il fallait de l’émulation.
Champrosay, 12 avril. — Parti pour Champrosay. La pluie a commencé juste au moment où nous quittions Paris pour aller à Champrosay. La sécheresse vraiment extraordinaire qui dure depuis six semaines affecte les campagnards.
Ce soir, promenade avec Jenny vers Draveil parla plus belle lune du monde. Le temps est entièrement remis.
J’ai emporté avec moi la fin de l’article de Silvestre[791], qui me concerne. J’en suis très satisfait. Pauvres artistes ! ils périssent si on ne s occupe pas d’eux. Il me met dans la catégorie de ceux qui ont préféré l’opinion de la postérité à celle de leur époque.
Avant dîner, nous avions été avec Jenny voir la fontaine. Baÿvet a fait ébrancher ces beaux saules et ces beaux peupliers que j’admirais tant l’année dernière et qui étaient la grâce de toute cette plaine.
13 avril. — La plus belle matinée du monde et la plus douce impression en ouvrant ma fenêtre. Le sentiment du calme et de la liberté dont je jouis ici est d’une douceur inexprimable. Aussi je laisse venir ma barbe et je suis presque en sabots. Travaillé aux Baigueuses[792] toute la matinée, en interrompant de temps en temps mon travail pour descendre dans le jardin ou dans la campagne.
Vers trois heures, promenade assez courte dans la forêt, en prenant par l’allée du chêne Prieur, revenant vers la grande allée qui croise celle de l’ermitage et revenu enfin par cette dernière, après avoir passé à l’ombre derrière l’enclos. Peu d’idées, mais un certain sentiment de bonheur : satisfaction de moi-même et de mon travail.
Trouvé deux belles plumes d’oiseau de proie.
Le soir, sommeil après dîner et promenade jusqu’à onze heures, par la lune, dans le jardin.
14 avril. — Assez mauvaise disposition toute la matinée. — Travaillé aux Guetteurs de lion[793].
Sorti avant dîner avec Jenny, qui est souffrante et inquiète ; Julie partait le soir pour son pays.
Dans la journée, promenade de temps en temps dans le jardin.
Écrit à Silvestre et à Moreau[794].
15 avril. — Repris la Clorinde. — Composé à l’intention de Dumas l’Hamlet ayant tué Polonius[795].
Vers trois heures, descendu par le plus beau soleil à la rivière pour voir à quel point elle est diminuée par la sécheresse. J’ai parcouru tout le bord avec beaucoup de plaisir ; j’étais poursuivi, en descendant la petite rue pour arriver à la plaine et en revoyant ces petites îles de la rivière, par toutes sortes d’émotions mêlées de douceur et de regrets.
Le soir, promenade avec Jenny sur la route toute poudreuse.
J’écris à Mme de Forget :
« Je vous écris par le plus beau temps possible, qui afflige tout le monde, en commençant par la terre. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu pareille chose en cette saison ; les bons agriculteurs sont aux abois ; l’herbe est sèche dans la forêt, comme dans les plus grandes chaleurs du mois d’août, et les récoltes donnent de l’inquiétude, si ce n’est celle du vin qui viendrait pour nous consoler de l’absence des autres. Pour moi, en particulier, je ne retire que de l’agrément de ce qui cause cette inquiétude, mais j’en ferais volontiers le sacrifice en vue du bien général et des conséquences. Pour ne parler que de l’agrément, les feuilles ne poussent pas, ce qui nuit au paysage et ôte l’ombre qu’on peut très bien regretter, à cause de la chaleur inusitée du soleil. Je travaille à la peinture ; la littérature, en ce moment, ne m’inspire pas.
Je dois vous dire, pour votre édification, que j’ai reçu, avant mon départ, mon diplôme d’académicien d’Amsterdam, orné des armes des Pays-Bas et avec les parafes nécessaires ; seulement il m’est impossible de comprendre un seul mot de ce titre authentique. Il faudra que j’aille en Hollande me le faire lire quelque jour. En attendant, je me promène avec un certain contentement de moi-même, assuré maintenant que je n’ai pas tout à fait perdu mon temps, dans ce monde, puisque j’ai été apprécié par les bons Hollandais.
Je vous voudrais plus souvent des distractions comme celle que je trouve dans ce lieu écarté et champêtre. Le plaisir d’ouvrir le matin sa fenêtre sur la plus agréable vue du monde, rafraîchie par les pleurs de la nuit, et de respirer un air différent de celui que nous font la boue et les ordures de Paris, tout cela fait vivre et ranime l’esprit aussi bien que le corps. Je ne dis pas pour cela qu’il faut tout abandonner pour se jeter dans les bras de la pure nature. Un peu de tout cela, et surtout changer de temps en temps, c’est là le véritable rajeunissement des esprits. »
16 avril. — Ce matin, jour de Pâques, le soleil s’est montré de bonne heure et caché à plusieurs reprises. Le vent a l’air d’être tourné, et le ciel se couvre de nuages. Verrons-nous enfin cesser ce beau temps désolant ? J’écris ceci à huit heures du matin, en faisant des vœux pour être un peu mouillé.
— Ne pas oublier de payer le billet du vendredi saint, renvoyé à Champrosay, à Seghers, en excusant mon retard par ma légitime absence.
17 avril. — Reçu le matin, pendant que je travaillais, une invitation pour le soir à l’Élysée : parti vers quatre heures.
Trouvé dans le chemin de fer une famille, mère, fils, fille, avec des cheveux magnifiques : se rappeler ces effets vraiment charmants dans le jeune homme, dont les cheveux étaient très bruns, et dans le jeune enfant, qui les avait déjà châtains et tournés en boucles les plus capricieuses et pleines de grâce.
Fatigue pour arriver jusque chez moi et ennui profond jusqu’au moment d’aller à cette corvée, dont j’ai rapporté le même sentiment d’amertume et de mépris de moi-même, de me confondre avec tous ces coquins… On avait éclairé le jardin en lanternes de couleur et feux de Bengale, d’un joli effet. Voilà le beau pour ces gens-là ! Une matinée d’avril les laisse indifférents.
Parti le lendemain, sans voir personne. J’ai été au Jardin des Plantes[796] passer une heure à voir les animaux, mais ils étaient paresseux et ne m’offraient pas grand’chose à étudier ; d’ailleurs, la chaleur était excessive.
Revenu avec bonheur et toujours avec cette extase intérieure ; cette jouissance que me donne le sentiment de la liberté dont je jouis et la vue de ces simples objets, si connus de mes yeux et (j’allais dire) de mon cœur, et pourtant si nouveaux chaque fois que je les retrouve en sortant du gouffre empesté qui nous prend le meilleur de nos jours.
20 avril. — La pluie commence sérieusement au milieu de la journée et a l’air de s’établir : les feuilles semblent tressaillir de plaisir.
Peu d’épisodes tous ces jours-ci : un peu de travail, mais toujours beaucoup de tranquillité et de bonheur.
Écrit ce matin à Arago, qui m’avait envoyé du café de Paris ; à Planche[797], dont j’ai trouvé l’article très aimable ; à Buloz, à Mme Villot pour m’excuser, à Mme de Forget, à Chabrier dont j’avais trouvé une invitation.
21 avril. — Travaillé aux Baigneuses[798] et donné une secousse importante au travail, en m’appliquant à finir davantage la femme qui est entièrement dans l’eau.
Peu ou point sorti. En allant acheter des cigares, vers trois heures, j’ai trouvé chez l’épicier le pauvre Quantinet ; j’ai été embarrassé pour lui de le rencontrer. Le pauvre homme, à ce qu’il paraît, est venu se consoler de ses ennuis dans des lieux plutôt propres à les lui rappeler. Il a amené, dit-on, une créature pour l’aider à conjurer ses souvenirs… Il venait hier acheter des épingles.
22 avril. — Mauvaise disposition toute la matinée, occasionnée par un mauvais cigare. Mauvaise besogne, par conséquent ; arrangé ou gâté la Clorinde ; c’est celui-là maintenant qui est en reste. Il faudrait, par un effort héroïque, le remettre à flot.
Sorti vers deux heures et demie avec ma bonne Jenny. Nous avons pris l’allée de l’Ermitage, tout du long ; nous avons rencontré un troupeau de moutons qui m’a intéressé. Quelle sympathie j’éprouve pour les animaux ! Que ces créatures innocentes me touchent ! Quelle variété la nature a mise dans leurs instincts, dans leurs formes que j’étudie sans cesse, et à quel point elle a permis que l’homme devînt le tyran de toute cette création d’êtres animés et vivant de la même vie physique que lui ! Pendant que ces pauvres animaux étaient occupés à paître, la tête collée à la terre, un rustre insouciant les gardait assez indolemment, en attendant que le boucher les reçoive de lui et s’en empare. Un jeune chien tenu en laisse se tenait près du berger et suivait des yeux un autre chien, son frère, plus expérimenté et occupé sans relâche à réunir le troupeau. Il faisait son éducation, toujours au profit de l’homme et de ses besoins. Au bout de l’allée, un paysan tirait brutalement par leur licou deux pauvres chevaux traînant la herse, et la leur faisait promener en tous sens dans une terre desséchée et à travers les sillons ; ces deux bêtes semblaient plus attentives à s’occuper de leur tâche que l’animal en sarrau, lequel ne leur réservait sans doute pour récompense que des coups de fouet.
Le soir, je suis sorti vers la fontaine et j’ai retrouvé Jenny sur la route. Nous avons été jusque chez les Vandeuil, à l’entrée de Soisy.
23 avril. — Avancé le Petit Arabe assis et son cheval près de lui[799]. Repris la Clorinde[800], et je crois l’avoir amenée à un effet entièrement différent qui me ramène à ma première idée, qui m’avait échappé peu à peu. Il arrive malheureusement très souvent que l’exécution ou des difficultés ou des considérations tout à fait secondaires font dévier l’intention[801]. L’idée première, le croquis, qui est en quelque sorte l’œuf ou l’embryon de l’idée, est loin ordinairement d’être complet ; il contient tout si l’on veut, mais il faut dégager ce tout, qui n’est autre chose que la réunion de chaque partie. Ce qui fait précisément de ce croquis l’expression par excellence de l’idée, c’est, non pas la suppression des détails, mais leur complète subordination aux grands traits qui doivent saisir avant tout. La plus grande difficulté consiste donc à retourner dans le tableau à cet effacement des détails, lesquels pourtant sont la composition, la trame même du tableau.
Je ne sais si je me trompe, mais je crois que les plus grands artistes ont eu à lutter grandement contre cette difficulté, la plus sérieuse de toutes. Ici ressort plus que jamais l’inconvénient de donner aux détails, par la grâce ou la coquetterie de l’exécution, un intérêt tel qu’on regrette ensuite mortellement de les sacrifier quand ils nuisent à l’ensemble. C’est ici que les donneurs de touches aisées et spirituelles, les faiseurs de torse et de tête d’expression, trouvent leur confusion dans leur triomphe. Le tableau composé successivement de pièces de rapport, achevées avec soin et placées à côté les unes des autres, paraît un chef-d’œuvre et le comble de l’habileté, tant qu’il n’est pas achevé, c’est-à-dire tant que le champ n’est pas couvert : car finir, pour ces peintres qui finissent chaque détail en le posant sur la toile, c’est avoir couvert cette toile. En présence de ce travail qui marche sans encombre, de ces parties qui paraissent d’autant plus intéressantes que vous n’avez qu’elles à admirer, on est involontairement saisi d’un étonnement peu réfléchi ; mais quand la dernière touche est donnée, quand l’architecte de tout cet entassement de parties séparées a posé le faîte de son édifice bigarré et dit son dernier mot, on ne voit que lacunes ou encombrement, et d’ordonnance nulle part. L’intérêt qu’on a porté à chaque objet s’évanouit dans la confusion ; ce qui semblait une exécution seulement précise et convenable devient la sécheresse même par l’absence générale de sacrifices. Demanderez-vous alors à cette réunion quasi fortuite de parties sans connexion nécessaire cette impression pénétrante et rapide, ce croquis primitif de cette idéale impression que l’artiste est censé avoir entrevu ou fixé dans le premier moment de l’inspiration ? Chez les grands artistes, ce croquis n’est pas un songe, un nuage confus ; il est autre chose qu’une réunion de linéaments à peine saisissables ; les grands artistes seuls partent d’un point fixe, et c’est à cette expression pure qu’il leur est si difficile de revenir dans l’exécution longue ou rapide de l’ouvrage. L’artiste médiocre occupé seulement du métier, y parviendra-t-il à l’aide de ces tours de force de détails qui égarent l’idée, loin de la mettre dans son jour ? Il est incroyable à quel point sont confus les premiers éléments de la composition chez le plus grand nombre des artistes… Comment s’inquiéteraient-ils beaucoup de revenir par l’exécution à cette idée qu’ils n’ont point eue[802] ?
24 avril. — Je professe avant tout ma prédilection pour les ouvrages de courte haleine qui ne fatiguent pas plus le lecteur qu’ils n’ont fatigué l’auteur, etc.
— Menace de gelée, qui s’est réalisée dans la nuit au détriment de ce pauvre pays. Le serrurier me disait ce matin que la commune comprenant Mainville, Draveil et Champrosay faisait souvent pour quatre-vingt mille francs de cerises seulement.
26 avril. — Peu d’entrain. Mauvaise humeur presque toute la journée pour le jour de mes cinquante-six ans. Je les ai depuis ce matin.
27 avril. — Je suis sorti de bonne heure ; cela me réussit à présent, et je travaille facilement l’après-midi après avoir fait de l’exercice le matin, ce qui m’était impossible autrefois.
J’ai pris l’allée de l’Ermitage et, au croisé des deux chemins, le petit sentier autrefois couvert, maintenant en taillis de quatre ou cinq ans, que je me rappelle souvent avoir pris avec Villot. J’y ai vu nombre de pousses de chêne gelées comme la vigne. Ce sentier aboutit au grand chemin herbu qui fait le tour de la forêt. En prenant à gauche, j’ai trouvé presque aussitôt le chemin direct de Mainville à Champrosay, en passant par le chêne d’Antain. On ne peut pas revenir plus directement.
J’ai beaucoup étudié les feuillages des arbres en revenant ; les tilleuls y sont en abondance et développés plus tôt que les chênes. Le principe est plus facile à observer dans ce genre de feuilles.
Revenu agréablement. Cette étude des arbres de ma route m’a aidé à remonter le tableau du Tueur de lions, que j’avais mis hier, au milieu de ma fâcheuse disposition, dans un mauvais état, quoique la veille il fût en bon train. J’ai été pris d’une rage inspiratrice, comme l’autre jour, quand j’ai retravaillé la Clorinde, non pas qu’il y eût des changements à faire, mais le tableau était venu subitement dans cet état languissant et morne, qui n’accuse que le défaut d’ardeur en travaillant. Je plains les gens qui travaillent tranquillement et froidement. Je crois que tout ce qu’ils font ne peut être que froid et tranquille, et ne peut mettre le spectateur que dans un état pire de froideur et de tranquillité. Il y en a qui s’applaudissent de ce sang-froid et de cette absence d’émotion ; ils se figurent qu’ils dominent l’inspiration.
La pluie est arrivée avec abondance ; il a été impossible de sortir le soir, que j’ai passé à dormir et à me promener dans ma maison en faisant des projets. Je roule dans ma tête les deux tableaux de Lions[803] pour l’Exposition ; je pense aussi à l’allégorie du Génie arrivant à la gloire[804].
Sensation délicieuse, en me couchant fort tard, de la fraîcheur du soir, les fenêtres ouvertes, et du chant diamanté du rossignol. S’il était possible de peindre ce chant à l’esprit, au moyen des yeux, je le comparerais à l’éclat que jettent les étoiles, par une belle nuit et à travers les arbres ; ces notes légères ou vives, ou flûtées ou pleines d’une énergie inconcevable dans ce petit gosier, me représentent ces feux, tantôt étincelants, tantôt un peu voilés, semés inégalement comme des diamants immortels dans la voûte profonde de la nuit. La réunion de ces deux émotions, qui est des plus fréquentes dans cette saison, le sentiment de la solitude et de la fraîcheur qui s’y joint, l’odeur des plantes et surtout des forêts qui semble le soir plus intense, sont pour l’âme un de ces festins spirituels auxquels l’imparfaite création la convie rarement.
28 avril. — Ma pensée se porte à mon réveil sur les moments si agréables et si doux à ma mémoire et à mon cœur que j’ai passés près de ma bonne tante[805] à la campagne. Je pense à elle, à Henry, à ce malheureux… que le ménage a perdu pour des sentiments comme ceux-là, si jamais il les a éprouvés, aussi bien qu’il en a fait un portefaix, au lieu d’un artiste. Je lui donne ce nom pour dire qu’il n’est plus adonné qu’à la matière, mais de la manière la plus triste ; il traîne véritablement le plus triste fardeau qu’il soit possible de porter, celui de son ménage et de sa maison à soutenir, et il n’y a plus chez lui une étincelle d’aspiration vers le plaisir de l’esprit ou de son métier ; — mais sa situation d’à présent m’éloigne de mes pensées de ce matin.
Je me disais qu’il y a dix ans maintenant que j’avais été pour la dernière fois à Frépillon[806] ; c’est vers le mois de mai 1844 environ, qu’après être revenu du dernier séjour que j’y avais fait, ce qui avait lieu ordinairement au printemps et à l’automne, je fus voir Mme His[807], qui demeurait à l’Arsenal, et j’y vis ma tante, qui venait déjà pour consulter, J’étais moi-même dans le quartier pour travailler à mon tableau de la rue Saint-Louis[808], que j’achevais. Jenny m’accompagnait. Je ne suis plus retourné depuis à Frépillon. Vers le mois d’août, ma tante est venue se constituer dans la maison de santé du faubourg Saint-Antoine, de laquelle je suis venu à bout de la persuader de se retirer.
En réfléchissant sur la fraîcheur des souvenirs, sur la couleur enchantée qu’ils revêtent dans un passé lointain, j’admirais ce travail involontaire de l’âme qui écarte et supprime, dans le ressouvenir de moments agréables, tout ce qui en diminuait le charme, au moment où on les traversait. Je comparais cette espèce d’idéalisation, car c’en est une, à l’effet des beaux ouvrages de l’imagination. Le grand artiste concentre l’intérêt en supprimant les détails inutiles ou repoussants, ou sots ; sa main puissante dispose et établit, ajoute ou supprime, et en use ainsi sur des objets qui sont siens ; il se meut dans son domaine et vous y donne une fête à son gré ; dans l’ouvrage d’un artiste médiocre, on sent qu’il n’a été maître de rien ; il n’exerce aucune action sur un entassement de matériaux empruntés. Quel ordre établirait-il dans ce travail où tout le domine ? Il ne peut qu’inventer timidement et que copier servilement ; or, au lieu de faire comme l’imagination qui supprime les côtés repoussants, il leur donne un rang égal et quelquefois supérieur par la servilité avec laquelle il copie. Tout est donc confusion et insipidité dans son ouvrage. Que s’il s’y mêle quelque degré d’intérêt et même de charme, à raison du degré d’inspiration personnelle qu’il lui sera donné de mêler à sa compilation, je le comparerai à la vie comme elle est, et à ce mélange de lueurs agréables et de dégoûts qui la composent. De même que dans la composition bigarrée de mon demi-artiste où le mal étouffe le bien, nous ne sentons qu’à peine, dans le courant de la vie, ces instants passagers de bonheur, tant ils sont gâtés par les ennuis de tous les moments.
Un homme peut-il dire qu’il a été heureux dans tel moment de sa vie qu’il trouve charmant par le souvenir ? Il l’est assurément par ce souvenir même, il se rend compte du bonheur qu’il a dû éprouver ; mais dans l’instant de ce prétendu bonheur, se sentait-il vraiment heureux ? Il était comme un homme qui possède une parcelle de terrain dans laquelle est enfoui un trésor dont il n’a pas connaissance. Appellerez-vous riche un tel homme ? pas plus que je n’appelle heureux celui qui lest sans s’en douter, ou sans savoir à quel point il l’est. Le vulgaire trouve heureux le monarque, parce qu’il dispose de tout, de tout ce qui lui manque surtout ; il ne voit pas qu’il est assiégé par des ennuis attachés à sa condition élevée, comme il l’est lui-même dans sa médiocrité. Ces ennuis obscurcissent tous les plaisirs, pour lui comme pour le monarque ; et combien n’en est-il pas qu’il goûte, sans presque le savoir, qui sont inestimables et qui sont interdits, inconnus même des grands qu’il envie ! Ces avantages sont si nombreux, ils sont si certains qu’ils suffisent amplement, je ne dirai pas à consoler, mais à rendre charmée de son lot, cette partie de l’humanité dont la médiocrité est le partage…
Les pures jouissances que je trouve ici, sans parler du peu de goût que j’ai pour les plaisirs des grands, me dispensent d’allonger cette note.
29 avril. — Repris les Baigneuses.
Je comprends mieux, depuis que je suis ici, quoique la végétation soit peu avancée, le principe des arbres. Il faut les modeler dans un reflet coloré comme la chair : le même principe paraît ici encore plus pratique. Il ne faut pas que ce reflet soit complètement un reflet. Quand on finit, on reflète davantage là où cela est nécessaire, et quand on touche par-dessus les clairs ou gris, la transition est moins brusque. Je remarque qu’il faut toujours modeler par masses tournantes, comme seraient des objets qui ne seraient pas composés d’une infinité de petites parties, comme sont les feuilles : mais comme la transparence en est extrême, le ton du reflet joue dans les feuilles un très grand rôle.
Donc observer :
1° Ce ton général qui n’est tout à fait ni reflet ni ombre, ni clair, mais transparent presque partout ;
2° Le bord plus froid et plus sombre, qui marquera le passage de ce reflet au clair, qui doit être indiqué dans l’ébauche ;
3° Les feuilles entièrement dans l’ombre portée de celles qui sont au-dessus, qui n’ont ni reflets ni clairs, et qu’il est mieux d’indiquer après ;
4° Le clair mat qui doit être touché le dernier.
Il faut raisonner toujours ainsi, et surtout tenir compte du côté par où vient le jour. S’il vient de derrière l’arbre, celui-ci sera reflété presque complètement. Il présentera une masse reflétée dans laquelle on verra à peine quelques touches de ton mat ; si le jour, au contraire, vient de derrière le spectateur, c’est-à-dire en face de l’arbre, les branches qui sont de l’autre côté du tronc, au lieu d’être reflétées, feront des masses d’un ton d’ombre uni et tout à fait plat. En somme, plus les tons différents seront mis à plat, plus l’arbre aura de légèreté.
Plus je réfléchis sur la couleur, plus je découvre combien cette demi-teinte reflétée est le principe qui doit dominer, parce que c’est effectivement ce qui donne le vrai ton, le ton qui constitue la valeur, qui compte dans l’objet et le fait exister. La lumière à laquelle, dans les écoles, on nous apprend à attacher une importance égale et qu’on pose sur la toile en même temps que la demi-teinte et que l’ombre, n’est qu’un véritable accident : toute la couleur vraie est là : j’entends celle qui donne le sentiment de l’épaisseur et celui de la différence radicale qui doit distinguer un objet d’un autre.
30 avril. — J’écris à Mme de Forget :
« Me voici encore à la campagne. Je ne puis m’arracher, je ne dirai pas aux ombrages de la forêt, car il y a à présent plus de pluie que de soleil, mais c’est ce qu’on demandait. Ce qui est fort triste, c’est la gelée qui a perdu les vignes de ce pauvre petit endroit et qui risque de compromettre la récolte en fruits. Qui croirait qu’une commune comme celle-ci porte à Paris pour quatre-vingt mille francs de cerises seulement ?
Je resterai encore une huitaine. J’ai l’air d’un Robinson, je suis aussi seul que lui. J’ai jeté sur le papier quelques idées de projets d’articles : malheureusement je n’ai pas ici les matériaux nécessaires pour y travailler autrement que vaguement. J’achève des tableaux qui m’étaient demandés ; surtout je jouis du bonheur de n’être pas dérangé… Vous ne vous doutez pas, vous autres voluptueux, quand, en vous levant le matin, vous trouvez l’air un peu refroidi, qu’il y a çà et là dans le même pays que vous habitez des milliers de malheureux qui sont au désespoir de ce petit froid, qui ne vous coûte tout au plus que la peine de souffler votre feu. Peut-être que ce petit froid nous fera payer encore notre vie aussi cher que l’année dernière ; c’est là que j’attends nos élégants, et c’est ce que Bouchereau saura trop bien nous dire.
Avez-vous vu le drôle de procès que fait Mme veuve Balzac à Dumas, qui veut absolument faire un tombeau de sa façon à son mari, avec les souscriptions du public, bien entendu ? Elle a raison, si elle a effectivement fait ce tombeau ; mais s’il est encore à faire après quatre ans, Dumas a raison de vouloir rendre à son confrère mort, qu’il détestait de son vivant, ce petit honneur qui ne lui coûtera rien.
Voilà le pauvre Lamartine[809] qui prend la plume, pour donner au public enfantin une édition expurgata de ses œuvres. La préface qu’il met en tête du recueil de ces œuvres choisies aurait grand besoin d’être elle-même purgée et surtout abrégée. Elle contient des phrases comme celle-ci : « Plus un écrivain est abondant, plus il a de limon à déposer dans sa course… la pensée de l’homme ne jaillit pas au premier flot ni à tous les flots. Limpide, rapide, incorruptible, digne d’être envasée dans les urnes des siècles pour abreuver le genre humain, la pensée de l’homme le plus favorisé des dons du ciel est un torrent qui coule de plus ou moins haut en se creusant un lit plus ou moins profond dans la mémoire des hommes, etc., mais qui coule avec des écumes, des lies, des sables qu’il faut bien se garder de recueillir avec l’eau du ciel. »
Nous allons voir cette eau du ciel que distille M. de Lamartine dans ses bons jours. Si le style des morceaux qu’il choisit est dans le goût de ce qu’on vient de lire, on pourra trouver, comme il l’avoue lui-même, que le recueil est encore trop volumineux. N’est-il pas étrange qu’un auteur expose et confesse ainsi à tous les yeux qu’il est plein de ce limon, de ce sable dont il parle, qui n’atteste que la précipitation de la composition aussi bien que le mépris du bon public pour lequel il écrit ? Ainsi, dans le but de redonner sa marchandise sous autre forme, il fait lui-même le métier de critique sur ses propres livres, il prendra la peine de nous montrer tout ce qui est mauvais. Il va jusqu’à refaire des passages, il supprime la strophe, il innocente l’image, il corrige le mot. Il est probable que c’est là le dernier livre qu’il se propose de publier ; car qui voudra désormais acheter les autres ? Il est clair que tous les dix ans, il les refera d’une autre manière, en les épurant, bien entendu. »
Paris, 2 mai. — Parti de Champrosay ce jour, à sept heures du matin.
J’étais inquiet au sujet de la lettre de Barbier à propos du conseil de révision ; d’ailleurs, j’avais reçu la lettre d’Albert de Vau, qui lui annonçait un excellent envoi que je craignais de laisser longtemps à la discrétion de mes portiers ; d’ailleurs, pour tout dire, le moment était arrivé. Mes tableaux avaient besoin de se reposer. Je ne restais donc plus qu’en me le reprochant, en considérant tout ce qui me rappelle à Paris.
— Sur le tantôt à Paris, et pendant que je me reposais, arrivent le cousin Delacroix et le cousin Jacob. Enchanté de les voir.
3 mai. — Les deux cousins ont dîné avec moi ; nous sommes restés les coudes sur la table jusqu’à onze heures. J’adore les récits de militaires, et lui, je l’aime beaucoup : il est un type véritable.
— Le matin, dans un beau feu, repris l’esquisse du Combat de lions[810]. J’en ferai peut-être quelque chose.
5 mai. — Comité à neuf heures pour le collège Stanislas.
Il n’y a plus en France, et je dirai ailleurs, d’état intermédiaire : ou Jésuites ou septembriseurs ; il faut subir l’un ou l’autre régime. Cette introduction avouée, sollicitée par l’État, des ecclésiastiques dans l’éducation, est une tendance dans laquelle on ne peut s’arrêter que pour tomber fatalement dans l’extrémité contraire.
7 mai. — Dîné chez Barbier. Dagnan[811] me conte l’histoire de Cabarrus qui, directeur de la banque de Charles III, est chargé par lui de porter en France trois millions pour faire évader Louis XVI au moment de son jugement. Sa maîtresse, la duchesse de Santa-Cruz, lui arrache son secret ; il était entendu avec le Roi qu’il irait seul en France, qu’on ne donnerait de chevaux qu’à lui, qu’il serait signalé, mais qu’il fallait qu’il fût seul. Il consent à emmener la duchesse habillée en domestique. Il est arrêté en route ; impossibilité d’aller plus avant. Il parlemente, s’obstine, bref, on envoie à Madrid ; pendant ce temps qu’il perd, le procès de Louis XVI va son train, et il arrive à Paris pour voir le roi guillotiné.
Caton disait, à la fin de sa vie, qu’il ne se repentait que de deux choses : l’une d’avoir dit un secret à sa femme ; l’autre, d’avoir fait par mer un voyage qu’il pouvait faire par terre. On contait cela à propos du naufrage de l’Ercolano.
8 mai. — Lettre de Mme D… au sujet du projet Stanislas ; lettre de Mme F… transmise par le cousin au sujet du même projet. L’une trouve bon que la ville dépense énormément, introduise les prêtres dans ses affaires, etc., etc., pour que son petit-fils, qui est depuis cinq ans dans ce collège, ne perde pas l’habitude de ses chers professeurs et achève paisiblement son éducation. L’autre désire la consécration de l’établissement pour beaucoup moins, j’en suis sûr ; le directeur aura quelque neveu dont la figure lui plaît.
Dîné au deuxième lundi, et fini par une promenade, au lieu d’aller à l’Opéra voir Guillaume Tell, ce que j’avais projeté ; pour me consoler, je me suis chanté tout le temps intérieurement toute la partition.
9 mai. — Dîné chez Piron, et vu le soir Nina, de M. Coppola[812]. Il est impossible d’imaginer rien de plus insipide.
— J’aime beaucoup Piron : c’est le seul ami que j’aie, comme on peut l’être à notre âge. Il me contait en revenant l’histoire de la Diligence de Lyon[813].
10 mai. — Insipide matinée et mauvaise disposition à l’Hôtel de ville. Discussion dans le Comité pour le projet Stanislas.
En sortant, vu la salle d’Ingres[814]. Les proportions de son plafond sont tout à fait choquantes : il n’a pas calculé la perte que la fuite du plafond occasionne aux figures. Le vide de tout le bas du tableau est insupportable, et ce grand bleu tout uni dans lequel nagent ces chevaux tout nus aussi, avec cet empereur nu et ce char qui est en l’air, font l’effet le plus discordant pour l’esprit comme pour l’œil. Les figures des caissons sont les plus faibles qu’il ait faites : la gaucherie domine toutes les qualités de cet homme. Prétention et gaucherie, avec une certaine suavité de détails qui ont du charme, malgré ou à cause de leur affectation, voilà, je crois, ce qui en restera pour nos neveux.
J’ai été voir mon salon : je n’y ai retrouvé aucune de mes impressions, tout m’y a paru blafard.
Le soir, chez la princesse ; je me suis mis à saigner du nez ; heureusement, cela n’a pas fait scandale. Beau trio de Mozart. Revenu seul par les Champs-Élysées et par un très beau temps.
Rodakowski m’a fait plaisir en exaltant le Massacre, qu’il met au-dessus de tout[815].
J’ai trouvé la place de la Concorde toute bouleversée de nouveau. On parle d’enlever l’Obélisque. Perrier prétendait ce matin qu’il masquait !… On parle de vendre les Champs-Élysées à des spéculateurs ! C’est le palais de l’Industrie qui a mis en goût. Quand nous ressemblerons un peu plus aux Américains, on vendra également le jardin des Tuileries, comme un terrain vague et qui ne sert à rien.
13 mai. — Dauzats venu dans la journée pour me tracer mon Foscari[816]. Resté trop longtemps, j’ai eu la voix fatiguée, et l’imprudence que j’ai faite d’aller chez Chabrier le soir m’a achevé. Extinction de voix, rhume, etc., etc.
20 mai. — Parti à Augerville avec Berryer, Batta[817] et M. Hennequin[818]. Parti triste ; je redeviens jeune pour mes tristesses à propos de tout. L’état de la santé y était pour quelque chose. Enchanté du voyage, surtout à partir d’Étampes ; nous nous sommes mis là en voiture, et nous avons fait nos sept à huit lieues, comme autrefois, au petit trot à travers une campagne un peu poudreuse, grâce à la grande chaleur, mais de cette vraie campagne, qu’on ne trouve pas aux environs de Paris ; cela m’a rappelé de jeunes années et de bons moments : le Berry, la Touraine sont ainsi.
L’arrivée charmante : c’est un séjour arrangé par lui, plein de vieilles choses que j’adore. Je ne connais pas d’impression plus délicieuse que celle d’une vieille maison de campagne ; on ne trouve plus dans les villes la trace des vieilles mœurs : les vieux portraits, les vieilles boiseries, les tourelles, les toits pointus, tout plaît à l’imagination et au cœur, jusqu’à l’odeur qu’on respire dans ces anciennes maisons. On trouve là reléguées de ces images qui ont amusé notre enfance et qui étaient nouvelles alors. Il y a ici une chambre dont les peintures à la détrempe existent encore, qui a été habitée par le grand Condé. Ces peintures sont d’une fraîcheur étonnante ; les dorures rehaussées n’ont point souffert.
Berryer, qui est la bonté et la facilité mêmes, nous a promenés partout. Il a un vivier dans son parc et de l’eau partout ; étables magnifiques avec un taureau superbe. Il faut absolument être loin de Paris pour trouver cela ; je n’ai pas une de ces émotions-là à Champrosay.
Le soir, nous nous sommes mis tous les quatre au coin du feu. Berryer nous contait qu’il était à la première représentation de la Vestale, avec des bottes à revers de soixante-douze francs : c’était alors le dernier goût. Ces malheureuses bottes étaient si étroites que, n’y pouvant tenir et ne goûtant pas du tout la musique, il demanda à des voisins un canif pour les fendre et se mettre à l’aise. Désaugiers était derrière lui ; il lui dit : « Monsieur, vous devez être content de votre cordonnier ; il vous sert (serre) bien. »
21 mai. — L’évêque d’Orléans arrivé l’après-midi, dans sa tournée pour la confirmation. Il est très bien, très distingué et homme d’esprit[819].
Le matin, ma première promenade, seul, par un beau soleil. Je me suis échappé par le pont de pierre, que j’ai atteint non sans avoir très chaud : je suis toujours vêtu très chaudement[820] maintenant, à cause de mon dernier mal de gorge. À ce pont de pierre, petits garçons pêchant je ne sais quoi avec leurs mains, les jambes à l’eau, de l’autre côté du pont où l’eau de la rivière coule sur un lit de cailloux charmants.
Berryer et ces messieurs avaient été à la messe ; j’ai été un peu honteux à leur retour de ne les avoir pas suivis. J’avais été aussi, en suivant la rivière, jusqu’à l’endroit presque où elle sort de la propriété. Remarqué le château, à peu près, de cet endroit, encadré dans les arbres. En revenant, fait un croquis de l’angle et du côté de la cour.
Dans la journée, nous avons été avec des hommes et le furet pour prendre des lapins. Vu les rochers et les pins d’Italie.
L’évêque arrive vers quatre ou cinq heures. Dîner d’ecclésiastiques avec un M. de Rocheplate ou de Rocheville, voisin de campagne de Berryer. J’aime beaucoup cet évêque. Je suis de la nature de la cire ; je me fonds facilement sitôt que j’ai l’esprit échauffé par un spectacle, ou par la présence d’une personne qui a quelque chose d’imposant ou d’intéressant. J’ai parlé du péché originel d’une façon qui a dû donner à ces messieurs une grande idée de mes convictions. La soirée s’est passée ainsi très convenablement.
22 mai. — Avant d’aller à l’église[821], le matin, pour voir la cérémonie de la confirmation, Berryer, dans son cabinet qui précède sa chambre, m’a lu des fragments de manuscrits de son père, où il raconte le premier service que mon père lui a rendu. Mon père se trouvait dans la situation de disposer de tout, sous Turgot : son salon d’attente était rempli de cordons bleus, de grandes dames et de solliciteurs de tous étages. Cette position lui occasionnait une foule d’attaques, à cause, dit Berryer le père, de son austère probité. Il avait commencé par être avocat et regrettait cette profession ; de là tout naturellement le conseil qu’il donne à Berryer de s’y adonner, plutôt que de s’enterrer dans des bureaux. Plus tard, sous la Convention, Berryer, très compromis, est sauvé par lui.
Vu la bibliothèque, qui est tout au haut de la maison
Vers dix heures, on est venu chercher l’évêque en procession. Cette cérémonie m’a beaucoup touché.
Le père et la femme de Berryer sont enterrés dans l’église. L’idée m’est venue de leur faire un Saint Pierre[822] ; c’est le patron de la paroisse, et c’était celui de son père ; ce projet s’en ira peut-être avec mes sentiments catholiques du moment.
Après la cérémonie et l’exhortation de Monseigneur, nous avons assisté à la bénédiction des tombes dans le cimetière : c’est fort beau. L’évêque, tête nue, et dans ses habits, la crosse d’une main, le goupillon de l’autre, marche à grands pas et lance à droite et à gauche l’eau bénite sur les humbles sépultures. La religion est belle ainsi. Les consolations et les conseils que le prélat donnait dans l’église à ses rustiques ouailles, à ces hommes simples, brûlés par les travaux de la campagne et enchaînés à de dures nécessités, allaient à leur véritable adresse. Au retour, il a béni, avant de rentrer, les enfants que les mères lui présentaient.
Déjeuner très nécessaire, à midi et demi ou une heure, pour ces pauvres prêtres à jeun et pour nous-mêmes. A une heure et demie, arrivée de ces dames : point de princesse ! J’en ai été désappointé.
A partir de ce moment, le bon évêque a été un peu négligé pour les arrivantes ; il avait d’ailleurs quelque effroi à rester. Il est parti presque incognito. Son règne était fini.
Promenade dans le parc avec Batta et Hennequin.
23 mai. — Temps diluvial. On nous avait annoncé la princesse[823] pour aujourd’hui, mais le moyen d’y croire avec une pluie affreuse ! Elle est venue pourtant. Elle s’est mise à tout : point de fatigue et de grimace. Ces dames et nous, nous avons fait une grande promenade. La bonne princesse peut-être un peu ennuyée de la tournée du propriétaire. Elle avait très aimablement pris mon bras, et je ne me suis pas ennuyé une minute. C’est un caractère dans le genre du mien ; elle a l’envie de plaire. Elle serait gracieuse avec un bouvier, et elle ne se force point pour se livrer à ce penchant. Ce qui en reste de véritablement bon ou obligeant, le ciel le sait mieux que moi ou quelle-même peut-être… Je suis ainsi ; on est comme on peut.
Berryer, l’autre fois que nous nous promenions (c’était le lundi) en attendant ces dames, assis au bout de l’allée de tilleuls où il a fait un promenoir, me disait qu’il conseillait de la douceur à Villemain dans le jugement qu’il porte sur les hommes et sur leurs passions, dans ce qu’il écrit sur les hommes de notre temps : le point de vue est en raison des passions et des préjugés du moment. Martignac, le plus doux des hommes, voulait, après 1815, faire pendre lui et son père, après le fameux procès qu’ils avaient plaidé tous les deux pour les proscrits[824].
C’est ce même jour, c’est-à-dire le lundi, qu’au lieu de faire une promenade avec ces messieurs, je me suis trouvé vers trois heures avec lui seulement, que nous avons été en bateau et que, m’ayant laissé pour aller s’habiller, je suis revenu rattacher le bateau et l’ai trouvé tout vêtu, attendant ses hôtes (je me trompe encore, je crois que c’est le dimanche, quand il attendait l’évêque).
Ce jour, mardi, excellente musique[825] le soir, de la princesse et de Batta. Je me prends de passion pour ce dernier. J’étais content de voir que la princesse était frappée, je l’ai cru au moins, de sa manière de jouer. Franchomme me paraît froid et compassé en comparaison. La princesse m’a parlé beaucoup de Gounod et du club de Mozaristes dont elle me fait l’honneur de me faire membre. Ce sera pour tous les premiers vendredis de chaque mois. Malheureusement, elle va partir pour Vienne.
24 mai. — Journée un peu décousue ; presque point de promenade : avant déjeuner, du côté du pont de pierre, sans aller jusque-là.
Temps incertain. Pendant que ces dames jouaient à un insipide petit jeu de billard sur le perron, j’ai été me mettre sur mon canapé, où j’ai alternativement lu et dormi. Je lisais la Fille du capitaine, traduit de Pouchkine par ce pauvre Viardot ; c’est dire que ce n’est pas le genre de traduction que je préfère ; ces romans russes se ressemblent tous : ce sont toujours des histoires de petites garnisons sur les frontières de l’Asie. Ces côtés ont tenu une grande place dans l’histoire des Russes, et on voit que les esprits de cette nation y sont sans cesse tournés.
Promenade en bateau avec ces dames et Berryer. Le brave M. de X…, type de jeune mari d’aujourd’hui : il va tout seul en bateau, a sans cesse le cigare à la bouche et ne dit jamais un mot à sa femme ni à personne, si ce n’est pour contredire les timides observations de chacun. Il m’a redressé, avec une superbe aménité et plus d’une fois, sur l’Orient, sur le Maroc, où il a été. Il est possible qu’il connaisse l’Orient, mais il ne connaît pas les femmes : la sienne, qui est la fille de Mme de V…, est très piquante, aussi froide que lui, mais qui le fera probablement passer par des chemins qu’il ne connaît pas, malgré la multitude de ses excursions. Pendant que Batta et la princesse nous jouaient le soir des choses délicieuses, il découpait sans dire mot des morceaux de papier, et il ne s’est pas dérangé une minute de cette occupation.
Sonate de Beethoven entendue la veille, mais surtout une autre, dont je connaissais déjà la partie de piano. Très grand et très rare plaisir.
Au moment de passer à table, Berryer nous contait, à propos de la passion pour les éloges de Chateaubriand et en général des hommes de lettres, que se trouvant un jour chez Michaud[826], il voit arriver M. d’Arlincourt[827], qui venait de faire paraître un de ses fameux ouvrages et qui venait demander à Michaud d’en parler de manière à faire sentir au public tout ce qu’il y avait de profond, de délicat dans cette conception : « Donnez-moi des notes là-dessus », lui dit Michaud ; ce que d’Arlincourt ne manqua pas de faire, en apportant une apologie en règle, qui mettait l’ouvrage et l’auteur dans les nues et en étalait avec une complaisance admirable le sublime de l’ouvrage. Le journaliste inséra tout bonnement le volume de d’Arlincourt, tel qu’il était. A quelques jours de là, Berryer, se trouvant encore chez Michaud, voit arriver d’Arlincourt qui vient remercier son ami de l’article aimable qu’il a inséré, l’assurant de sa reconnaissance pour la manière dont il avait apprécié l’ouvrage.
Berryer m’a conté ou plutôt avoué qu’il était un des trois auteurs de la complainte de Fualdès : il avait pour collaborateurs Désaugiers et Catalan ou Castellan[828].
25 mai. — Ce jour, sorti d’assez bonne heure et fait le petit croquis de la vue du château du côté du canal et du potager[829]. — Promené quelque peu avec M. Hennequin, avant déjeuner ; après déjeuner, à la messe pour l’Ascension.
Je parlais, au retour de la messe, à la princesse de la vocation que je me croyais pour être prédicateur : Berryer nous a parlé de la sienne. Hennequin, avant déjeuner, nie parlait de sa manière au barreau ; d’après ce qu’il m’en a dit, il me semble qu’il me ferait plus d’impression que les autres.
Dans la journée, rejoint le bateau où se trouvaient une partie de ces dames. Revenu en ramant et pris ensuite par le potager. Lu la Fille du capitaine jusqu’au dîner.
Conversation, dans la journée, près du piano, avec la princesse sur le système de Delsarte. Je lui parle de mes idées sur des sujets analogues. Elle préfère son Franchomme à Batta ; je lui dis que je suis sur la dernière impression. Ce qu’elle trouve de large, de carré, de précis chez Franchomme, me paraît quelquefois froideur et sécheresse ; chez Batta, je m’aperçois moins qu’on racle sur du bois : je ne vois pas tant l’artiste. Franchomme est un peu comme ces peintres qui viennent vous dire : « Voyez comme je suis conforme à l’antique, comme cette main est bien la main que j’avais sous les yeux. » Je lui ai comparé à ce propos la copie de Gérard, qui est dans le salon, avec les tableaux des grands maîtres : à savoir que le détail s’y trouve, mais n’attire pas l’attention aux dépens de l’expression.
Le soir, répétition de la sonate de Beethoven que je préfère : elle porte, je crois, le no 1.
Vu deux cahiers du Punch anglais. Tâcher de me le procurer à Paris : il y a des types de caricature d’un dessin très fin.
Remonté me coucher, avant le reste de la société, occupée encore à minuit à jouer.
— Ils croient qu’ils seront plus vrais en luttant avec la nature de vérité littérale ; c’est le contraire qui arrive ; plus elle est littérale, cette imitation, plus elle est plate, plus elle montre combien toute rivalité est impossible. On ne peut espérer d’arriver qu’à des équivalents. Ce n’est pas la chose qu’il faut faire, mais seulement le semblant de la chose : encore est-ce pour l’esprit et non pour l’œil qu’il faut produire cet effet.
26 mai. — Le matin, dans la cour de la ferme où étaient ces dames, pour faire des études sur le fromage, Berryer me disait qu’une chienne qu’il a et qui lui avait été donnée par un voisin, étant retournée aussitôt chez son premier maître, le garde dudit donna à Berryer qui venait la rechercher le moyen de se l’attacher, à savoir d’uriner dans du lait, et de le lui faire boire : l’influence de mâle à femelle et réciproquement, quoique dans des espèces différentes.
Il me disait que s’étant trouvé dans un comité où on discutait la couleur des uniformes, Lamoricière, Bedeau et autres généraux disaient que la durée des habits, au moins comme apparence et conservation en bon état, dépendait de la manière dont les diverses couleurs, parements, revers, etc., s’harmonisaient avec la couleur de l’habit. Ceux qui étaient crus et discordants arrivaient promptement à paraître sales et hors d’usage.
Dessiné cette matinée dans les roches plusieurs pins d’Italie.
En revenant le long de la grande treille, dessiné des peupliers blancs de Hollande, qui font un bel effet, mêlés à d’autres arbres, au bout de cette allée, du côté des rochers.
Dormi dans le jour et achevé la Fille du capitaine.
Ondée effroyable pendant le déjeuner et arrivée de M. de la Ferronays.
Promenade avant le dîner avec ce dernier et ces dames, et revenu par le potager.
Le soir comme à l’ordinaire : la sonate no 1. Couché tard et dormi sur le canapé.
Admiré beaucoup, pendant ma promenade du soir, la vivacité des étoiles et l’effet des arbres sur le ciel, et les réflexions du château dans les fossés.
27 mai. — Départ de la princesse à neuf heures. — Flâné sur le perron avec ces dames qui étaient restées.
Avant déjeuner, dessiné les jeunes chevaux et croquis d’après les figures fantastiques, dans les roches. Je me rappelais en les faisant ce mot de Beyle : « Ne négligez rien de ce qui peut vous faire grand. »
— Essayer de faire du cresson en manière d’épinards.
— Agréable flânerie — après le déjeuner et le départ des Suzanet et de M. de la Ferronays — sur le perron avec ces dames : partie de billard anglais. Elles devaient rester la soirée : tout à coup, elles changent de résolution. Nous dînons à cinq heures un quart, et elles partent à six heures.
Promenade charmante avec Berryer et Hennequin par les bords de la rivière, à gauche le long du potager : à cette heure du jour, tout cela est plus beau que je ne l’ai jamais vu ; je ne puis me lasser de la réflexion placide des arbres et du ciel dans le miroir des eaux. Voilà ce que nous perdons par la mauvaise heure du dîner.
Monté au haut du parc et fait le tour par les murs, jusqu’à un endroit que je ne connaissais pas : salles de verdure avec avenues de tous côtés, etc.
Berryer très intéressant sur la musique des anciens… Sur la partie consacrée, hiératique : l’empereur de la Chine allant tous les ans donner le ton dans certains temples, sur des vases d’un métal particulier. C’était le diapason de l’Empire.
S’il n’est pas satisfait de son intonation en commençant à parler, il ne débrouille pas clairement ses idées, sa parole n’est pas la même.
Je dis que nous ne connaissons rien aux anciens. Nous les défigurons quand nous leur prêtons nos petites manières et nos sentiments modernes. Ils avaient été tout de suite ce qui est essentiel dans tout : le sentiment est le meilleur guide dès l’origine, dans les arts et même dans les sciences. Hippocrate a trouvé tout de suite tout ce qu’il y a de positif dans la médecine. Je me trompe : il a visité l’Égypte, peut-être quelques autres dépôts des connaissances primitives, et en a rapporté ces principes. Se rappeler ce que dit Pariset à ce sujet[830].
Je dis aussi qu’il a plus de mérite, dans un temps de décadence, de revenir à la simplicité et à la nature que n’en out eu les anciens en découvrant ces principes de prime abord, quand tout cela était nouveau.
Grand charme le long du canal. J’ai remarqué l’absence des femmes : leur présence anime une solitude comme celle-ci ; quelque charme qu’on y trouve, on se rappelle où on a été auprès d’elles. Il me parle de Mme de la G…, me disant que l’amitié près d’une bonne femme était bien supérieure au sentiment basé sur d’autres relations.
Dans le courant de la promenade, parlé de Sainte-Beuve avec peu d’estime : il flatte le pauvre pour se faire une petite fortune et se retirer quand il aura ce qu’il lui faut.
Achevé la soirée au coin du feu.
— Beau ton de chair brune très sanguine : jaune de chrome foncé et ton violet de laque brun et blanc.
28 mai. — Parti d’Augerville à midi : la malle m’a pris toute la matinée, ainsi que la messe où j’ai accompagné le bon cousin. Journée magnifique. La campagne me rappelle les plus doux moments ; à Étampes, le soleil, la température, l’aspect des lieux me rappellent des sensations de l’Espagne.
Église Saint-Basile, détails romans dans la façade. Église Saint-Pierre, principale ; crénelée : plan bizarre et inexplicable.
Promenade hors des vieux remparts, beaux arbres. Nous avions une heure à tuer. Arrivé à Paris à cinq heures et demie. Reconduit M. Hennequin.
Couché après mon dîner, ce qui m’a nui pour la journée du lendemain.
29 mai. — Mauvaise journée. Travaillé à peine : promenade solitaire le soir. — Touché quelque peu au Christ sur la mer[831] : impression du sublime et de la lumière.
30 mai. — Repris le tableau de Weill : Tigre attaquant le cheval et l’homme[832]. — Mme de Forget le soir.
31 mai. — Préault venu dans la journée et resté trop longtemps : je l’aime beaucoup. Je voudrais lui être utile[833].
2 juin. — Dîné chez la princesse. — Première soirée des premiers vendredis. Gounod, etc., etc. Il a chanté, d’une manière délicieuse, plusieurs morceaux de Mozart, en faisant ressortir les accompagnements et les parties différentes, à lui seul.
En rentrant très tard par une pluie affreuse, trouvé mon atelier noyé et passé près de deux heures à déménager mes toiles, etc.
Lundi 5 juin. — Chez Mme de Forget le soir ; le jeune d’Ideville[834] me disait que mes tableaux se vendaient très bien : le petit Saint Georges[835], qu’il appelle un Persée, que j’avais vendu à Thomas quatre cents francs, s’est vendu mille deux cents francs en vente publique ; Beugniet lui a demandé la même somme du petit Christ, qu’il a eu pour cinq cents francs ; mais ce sont les Juifs[836] qui profiteront toujours de tout cela.
— Dernière séance du conseil de revision. Vu avec plaisir de belles natures, des remplaçants. On leur trouvait mille défauts ; c’est le contraire pour les autres.
7 juin. — Repris la petite esquisse du Combat du lion.
Le soir à la Vestale ; quoique impatienté par la longueur des entractes, j’ai été très intéressé. La Cruvelli a quelque chose d’antique dans ses gestes, surtout dans la scène du trépied. Elle n’est pas serrée dans ses habits comme les actrices ordinaires dans les costumes grecs ou romains. La musique aussi a du caractère. Je me rappelle que Franchomme souriait quand je mettais cela au-dessus de Cherubini. Il avait peut-être raison, comme facture ; mais je crois que le même opéra traité par le fameux contrapontiste n’aurait pas eu ces élans de passion et cette simplicité, en même temps… Berlioz, à qui j’en parlais, me dit de Spontini que c’était un homme qui avait des lueurs de génie[837].
Dans la journée, à la commission de l’Industrie. On nous avait dérangés pour nous demander quels étaient ceux qui voulaient aller à Londres à l’ouverture du Palais de Cristal. On n’a pu, en présence de ce brave lord Cowley[838], malgré ses invitations pressantes, trouver que deux membres de bonne volonté. Chacun de nous, soumis à un interrogatoire, a décliné la commission. Ces Anglais ont refait là une de leurs merveilles qu’ils accomplissent avec une facilité qui nous étonne, grâce à l’argent qu’ils trouvent à point nommé et à ce sang-froid commercial, dans lequel nous croyons les imiter. Ils triomphent de notre infériorité, laquelle ne cessera que quand nous changerons de caractère. Notre Exposition, notre local sont pitoyables ; mais, encore un coup, nos esprits ne seront jamais portés à ces sortes de choses, où des Américains dépassent déjà des Anglais eux-mêmes, doués qu’ils sont de la même tranquillité et de la même verve dans la pratique[839].
8 juin. — Reçu ce matin, presque en même temps, la nouvelle de la mort de Pierret et de celle de Raisson[840]. Aujourd’hui, on doit enterrer le dernier. Henry vient m’inviter à aller dire adieu à son père. Triste vue ! triste séparation !… Il est mort hier soir en revenant de chez sa fille à Belleville.
A quatre heures, au convoi de Raisson. — Je me suis promené, en attendant, quelque temps, et entré à l’église : affreuse décoration… Le malheureux Raisson a laissé vingt francs, dont il a fallu donner quinze à l’apothicaire. Il gagnait encore quinze mille francs… Quand il lui arrivait une petite somme à la fois, il faisait un voyage pour son plaisir ou arrangeait une partie : c’est ce que m’apprend un de ses amis.
Mon cher Pierret, dont la mort me laisse un tout autre vide, quoique je regrette aussi mon vieux Raisson, laisse sa famille dans une triste situation ; c’est une suite de la vanité de sa femme qui a voulu faire la dame, au lieu de faire un métier et d’en faire faire un à ses filles.
10 juin. — Enterrement du pauvre Pierret.
12 juin. — Dîner du lundi. Delaroche m’a paru assez bon enfant. Tout le monde, excepté Dauzats, a été contre moi pour soutenir que les animaux seuls avaient de l’instinct, et que l’homme n’en a pas. Quoique le terrible Chaix-d’Est-Ange fût dans le parti contraire, j’ai soutenu mon avis avec la chaleur convenable, et depuis, il m’est revenu à l’esprit cent arguments plus forts les uns que les autres, que je n’ai pas dits.
Après, j’avais compté aller voir la Vestale, qu’on devait jouer avec un ballet : malheureusement le ballet était le dernier.
J’ai été voir si Mme Pierret était revenue s’établir à Paris. Elle est toujours à Belleville, commençant son métier de veuve avec le faste nécessaire, quand tout lui commandait d’être ici pour les démarches, pour son fils, etc.
Le bon Piron venu chez moi pendant mon absence, après la lettre tendre que j’avais reçue de lui dans la journée et par laquelle il me demande aimablement d’aller avec lui à Aix, où il doit prendre les eaux. Je suis bien touché de son amitié. Je l’ai connu avant Pierret, et jamais un nuage n’a altéré notre attachement[841].
13 juin. — Dîné chez Monceaux ; l’aimable Mme Gontier a chanté divinement le Messager, de Nadaud, qui est une charmante chose. Il est venu un aveugle, qui est très musicien et qui chante. Il est aveugle de naissance. Quelles singulières idées il doit avoir des choses !
Joui beaucoup de ma promenade au retour par les quais, dont je ne pouvais m’arracher.
14 juin. — Dauzats et Grenier sont venus. Ce dernier ma montré de jolis dessins de Rome.
15 juin. — Dîné chez Poinsot. Je me suis écorché le doigt dans la glace de mon fiacre, et j’ai été obligé de me faire un pansement dans les règles avant dîner.
L’anecdote de Gérard, qui parvient à attirer Marie-Louise sous prétexte de retoucher son portrait. Napoléon, à son retour, lui demande son nom, ce qu’il fait, et lui tourne le dos. En revenant chez lui, c’était un mercredi, Gérard dit : « L’Empereur m’a tourné le dos, il me prend sans doute pour un Cosaque. »
— Ce jour, Andrieu a commencé à Saint-Sulpice[842].
16 juin. — Donné à Haro (pour parqueter) le carton de la Petite Andromède[843]. — Au conseil, où j’avais manqué plusieurs des dernières séances. Ottin[844], que je trouve en revenant, me conte que Simart[845] ayant fait une figure de David, Ingres, qu’il avait fait venir dans son atelier, la lui fait jeter à bas, à cause de son sujet. On ne peut se permettre qu’un sujet grec : faire un David était une monstruosité. Que dirait-il du pauvre Préault, qui fait des Ophélias et autres excentricités anglaises et romantiques ?
Dîné chez Mme de Forget, avec le petit d’Ideville. Joué au billard avec lui.
— Sur la fragilité de la peinture, particulièrement chez les modernes.
17 juin. — Dîné chez Chabrier avec Poinsot, l’amiral Casy[846], d’Audiffret[847], Beauchesne[848], etc. Poinsot me conte à dîner l’anecdote à laquelle il a été présent sur les intentions de Napoléon relativement à la Madeleine, où il dit que son intention était que l’on fît des prières pour les mânes de Louis XVI, à l’occasion du 21 janvier ; qu’il en viendrait là, qu’il leur ferait avaler cela (il entendait les hommes comme Cambacérès, Fouché, etc.) comme une soupe au lait.
D’Audiffret me conte que Lamartine, voulant parler sur la conversion des rentes, va se renseigner auprès le lui. Il en était à ne pas savoir ce que c’est que la rente au pair, c’est-à-dire le premier mot des opérations les plus élémentaires : ce qui ne l’a pas empêché de faire un discours magnifique dont l’Europe a retenti.
Il me parle aussi de l’ignorance de Ledru-Rollin, arrivant au ministère de l’intérieur en 1848 et ignorant les éléments de l’administration qu’il avait attaquée pendant sa carrière d’opposition : il s’imaginait, par exemple, qu’un ministre n’avait qu’à ordonnancer une dépense pour que l’argent fût à sa disposition. Il comptait, par exemple, donner une fête, etc.
18 juin. — A huit heures chez Durieu. Jusqu’à près de cinq heures, nous n’avons fait que poser. Thevelin a déjà fait des croquis autant de fois que Durieu a fait d’épreuves : une minute ou une minute et demie au plus pour chacun.
Huet[849] ma mené chez lui : je m’y suis aperçu que j’avais oublié mes lunettes, et suis revenu, tout courant et fatigué, les reprendre au septième étage de Durieu. Ce pauvre Huet n’a plus le moindre talent : c’est de la peinture de vieillard, et il n’y a plus l’ombre de couleur.
Ferdinand Denis[850]est venu là. On parlait de la découverte d’un faiseur d’or, qui prétend avoir trouvé que les métaux ne sont que des agrégations. Les gens de la Californie lui disaient souvent, en parlant de certains cantons, que l’or n’était pas encore à son point. Denis me conte l’histoire de Léon X envoyant en cadeau à un prétendu faiseur d’or une bourse vide.
Riesener, huit jours après, me dit avoir observé, avec plusieurs paysagistes, un lieu à Trouville où l’on voit les cailloux se former manifestement.
19 juin. — Petits sujets : Deux chevaux se battant[851]. — Cheval montré à des Arabes[852]. — Barbier de Mekinez. — Soudards. — Chevalier.
20 juin. — Dîné chez Morny avec Halévy, Auber, Gozlan[853], que j’ai eu du plaisir à revoir. Il m’a dit qu’au temps de notre comique rivalité, je passais pour le favori et j’étais envié. J’ai vu là Augier, contre lequel j’avais, je ne sais pourquoi, de la prévention[854]. Il est fort aimable, et je suis enchanté de m’être rencontré avec lui. Il y avait là ce grand jeune homme, fils de Mme Lehon, que j’avais vu quinze jours auparavant au conseil de revision, plaidant la cause de sa surdité prétendue pour se dispenser d’acheter un remplaçant, et cela dans l’état de pure nature, c’est-à-dire nu comme la main, en présence de ces conseillers de préfecture et autres composant le conseil.
22 juin. — Terminé les tableaux de l’Arabe à l’affût du lion[855] et des Femmes à la fontaine. — Il faut au moins dix jours pour mettre le siccatif.
23 juin. — Avec Mme de Forget au bois de Boulogne. Vu les nouveaux embellissements, qui sont fort bien : j’ai trouvé un charme infini dans cette soirée et des émanations bocagères très agréables.
24 juin. — Chez Chabrier le soir. — Poinsot m’engage pour jeudi.
Dans la journée, été voir Guillemardet chez les Pierret. Je lui ai écrit, ne l’ayant pas trouvé.
Ensuite chez Mercey, lui montrer mon esquisse : il m’a refroidi par ses observations, dont quelques-unes, du reste, sont fondées.
25 juin. — Chez Durieu. Photographies et dessins d’après le Bohémien.
Dans un intervalle, j’ai été voir à Saint-Sulpice ce qu’Andrieu a tracé. Tout s’ajuste à merveille, et je crois que cela ira fort bien ; le départ est excellent.
J’aime assez de temps en temps ces parties qui me tirent de chez moi : cela dissipe et renouvelle. Voilà, par parenthèse, deux dimanches de suite que j’y vais ; j’y ai déjeuné les deux fois, moi qui ne peux avaler un morceau ordinairement et dans l’habitude de mon atelier. C’est ce que j’ai éprouvé avec surprise pendant mon séjour chez Berryer. La distraction, la conversation, l’esprit mis hors de son ornière habituelle, agissent sur le corps.
26 juin. — Point d’entrain toute cette journée. — Dauzats venu avec M. Bonnet, de Bordeaux.
Je trouve ceci dans un article de Sainte-Beuve sur saint Martin, qui est un résumé des idées de ce dernier sur l’âme : « Selon lui, l’âme humaine, toute déchue et altérée qu’elle est, est le plus grand et le plus invincible témoin de Dieu ; elle est un témoin de Dieu bien autrement parlant que la nature physique, tellement que le vrai athée (s’il y en a) est celui qui méconnaît sa grandeur et en conteste l’immortelle spiritualité : le propre de l’âme de l’homme, tant elle a conservé de royales marques de sa hauteur première, est de ne vivre que d’admiration, et ce besoin d’admiration dans l’homme suppose au-dessus de nous une source inépuisable de cette même admiration qui est notre aliment de première nécessité. »
Il y a donc confiance que ce témoin perpétuel de Dieu, l’âme humaine, gagnera à l’épreuve de la révolution, etc.
27 juin. — Dîné chez Riesener avec Vieillard. — Presque achevé, dans la journée, le Cavalier arabe et le Tigre de Weill. Arnoux[856] venu dans la journée. Il me parle du projet d’exposition de Delamarre[857]. Il dit que le Massacre[858] n’a pas gagné au dévernissage, et je suis presque de son avis, sans avoir vu. Le tableau aura perdu la transparence des ombres comme ils ont fait avec le Véronèse et comme il est presque immanquable que cela arrive toujours. Haro dit qu’il dévernit en lavant et non en frottant au doigt. S’il faisait cela, il aurait vaincu une grande difficulté. En attendant, il m’a gâté les portraits de mes deux frères enfants, par l’oncle Riesener.
28 juin. — Travaillé le matin à l’Arabe et l’enfant à cheval[859]. — Boissard venu. Ensuite Villot ; sa vue m’a fait plaisir. Ils sont tous surpris de tout ce que je fais. Je leur dis qu’au lieu de me promener, comme la plupart des artistes, je passe mon temps dans mon atelier.
Penser à demander à Riesener mon étude d’arbres sur papier. Lui emprunter ses croquis et des études de paysage de Frépillon et autres, pour la fraîcheur du ton. Aussi celle de Valmont pour le sujet des Deux Chevaliers et des Nymphes, de la Jérusalem.
29 juin. — Dîné chez Poinsot.
— Sur la fragilité[860] de la peinture et de tout ce que produisent nos arts. — Sur les tableaux : les toiles, les huiles, les vernis, pendant que les chimistes exaltent le progrès. C’est comme le progrès social, qui consiste à mettre en guerre toutes les classes par les sottes ambitions excitées dans les classes inférieures : moyen de socialité, si l’on veut, mais point de sociabilité. Ces lithographies de Charlet, les mieux faites il y a vingt ans, tombent en poussière. Le progrès a perfectionné, à ce qu’il croit, le papier, et pas un de nos livres, de nos écrits, des actes qui servent à régler nos rapports d’affaires, n’existera dans un demi-siècle. La socialité veut que chacun travaille pour soi et s’inquiète peu des autres. Il faut égayer notre court passage en cette vie et laisser à ceux qui nous suivront à s’en tirer comme ils pourront. Ce qu’on appelait la famille est aujourd’hui un vain mot. La suppression, dans nos mœurs, de la vénération, de la crainte même du père, par la familiarité que permettent les usages, en est le principal dissolvant. Le partage égal achève de dissoudre tous les liens qui unissent les membres d’une famille. Le lieu de la naissance, l’habitation paternelle est aliénée naturellement après la mort du père. On sacrifie, dira-t-on, à d’autres dieux ; le bien de l’humanité est devenu la passion de tous ceux qui ne peuvent vivre avec leurs frères issus du même sang dont ils sont formés. Il y a des entrepreneurs de charité qui nous évitent le souci de bien placer les offrandes que l’on adresse aux malheureux du monde entier qu’on soulage ainsi sans les connaître ni les rencontrer jamais. Ces philanthropes de profession sont tous gras et bien nourris : ils vivent heureux du bien qu’ils sont chargés de répandre. Heureux donc le siècle et tous ces bienfaiteurs qui croient avoir supprimé tous les maux, parce qu’ils en détournent la vue ; plus heureux les adroits dispensateurs de l’universelle charité qui ont résolu le problème de ne se priver de rien, en donnant à tout le monde.
— Chez Boissard à deux heures, pour entendre de la musique. Ils ne possèdent pas encore le Beethoven de la dernière époque.
Je demandais à Barbereau[861] s’il avait pénétré tout à fait les derniers quatuors : il me dit qu’il faut encore une loupe pour tout apercevoir, et peut-être faudra-t-il toujours la loupe. Le principal violon me disait que c’était magnifique, et qu’il y avait toujours des endroits obscurs. Je lui ai dit témérairement que ce qui restait obscur pour tout le monde, et surtout pour les violons, l’avait été sans doute dans l’esprit de son auteur. Cependant ne nous prononçons pas encore ; il faut toujours parier pour le génie.
30 juin. — Décision au conseil de l’affaire du collège Stanislas.
— Dans la journée, vu Villot à son cabinet. Portrait d’un soudard du seizième siècle. Son portrait par Rodakowski. Il tombe dans le défaut de largeur. Il a pris ce pauvre Villot en maigre, ce qui n’était pas le cas.
De là à Saint-Sulpice, qui marche bien. Mon cœur bat plus vite quand je me trouve en présence de grandes murailles à peindre.
Je reviens dans un cabriolet à quatre roues, où, sans mon parapluie, j’aurais été presque noyé. Un orage affreux avec grêle et tonnerre violent qui a duré depuis lors et toute la soirée.
Dîné avec Mme de Forget, chez qui je me trouve à cinq heures pour voir ses dessus de porte, lesquels se sont trouvés hors de dimension, et qu’elle remplace par des portières ; j’y ai achevé la soirée.
1er juillet. — Journée de travail sans interruption. Grand sentiment et délicieux de la solitude et de la tranquillité, du bonheur profond quelles donnent. Il n’est point d’homme plus sociable que moi. Une fois en présence de gens qui me plaisent, même mêlés aux premiers venus, pourvu qu’aucun motif irritant ne m’inspire contre eux de l’aversion, je me sens gagner par le plaisir de me répandre : je prends tous les hommes pour des amis, je vais au-devant de la bienveillance, j’ai le désir de leur plaire, d’être aimé. Cette disposition singulière a dû donner une fausse idée de mon caractère. Rien ne ressemble autant à la fausseté et à la flatterie que cette envie de se mettre bien avec les gens, qui est une pure inclination de nature. J’attribue à ma constitution nerveuse et irritable cette singulière passion pour la solitude, qui semble si fort en opposition avec des dispositions bienveillantes poussées à un degré presque ridicule. Je veux plaire à un ouvrier qui m’apporte un meuble ; je veux renvoyer satisfait l’homme avec lequel le hasard me fait rencontrer, que ce soit un paysan ou un grand seigneur ; et avec l’envie d’être agréable et de bien vivre avec les gens, il y a en moi une fierté presque sotte, qui m’a fait presque toujours éviter de voir les gens qui pouvaient m’être utiles, craignant d’avoir l’air de les flatter. La peur d’être interrompu, quand je suis seul, vient ordinairement, quand je suis chez moi, de ce que je suis occupé de mon affaire, qui est la peinture : je n’en ai pas d’autre qui soit importante. Cette peur, qui me poursuit également quand je me promène seul, est un effet de ce désir même d’être aussi sociable que possible dans la société de mes semblables. Mon tempérament nerveux me fait redouter la fatigue que va m’imposer telle rencontre bienveillante ; je suis comme ce Gascon qui disait, en allant à une action : « Je tremble des périls où va m’exposer mon courage. »
2 juillet. — Voir vendredi Gisors, M. Deumier ; lui parler de l’abbé Coquant pour la permission de travailler le dimanche[862]. Voir Mme de la Grange, Berryer, Poinsot.
Les chevaux que j’ai dessinés dans la prairie chez Berryer avec un prêtre grec assis et une jeune fille ou autre figure.
3 juillet. — Faire, pour l’exposition Delamarre, le Giaour foulant aux pieds de son cheval le pacha[863].
Répétition, par Andrieu, du Christ de Grzimala pour B… — Ma bonne Jenny me disait, au milieu du désordre de mes dessins entassés, dispersés et déclassés, qu’il fallait absolument mettre aux choses le temps qu’elles réclament.
— Sur la photographie pour le Moniteur.
— Beugniet venu pour l’arrangement des dessins et lithographies. Je lui remets dix-huit pastels et quinze lithographies.
4 juillet. — A l’Exposition de 1855, le Justinien[864]. — Je me suis levé avant cinq heures. Quelques idées qui m’étaient venues pour l’article sur le Beau[865], et recouché jusqu’à huit heures ; un certain malaise m’avait saisi. Repris le travail jusqu’à dîner, sans presque cesser, si ce n’est pour dormir quelques minutes. Il fallait faire cet effort généreux pour mettre ce travail en état d’être fini d’ici à deux ou trois jours : c’est un métier de chien.
Après dîner, j’ai fait, peut-être contre mon habitude, la meilleure partie du travail, par un examen d’ensemble, quelques pages écrites avec une certaine verve. J’écris ceci le mercredi matin, et je n’ai pas relu ce que j’ai fait. Je serais curieux de voir si l’état de l’esprit après dîner est, comme je le crois, dans la meilleure situation pour produire. À ce moment où je viens de me lever, fatigué à la vérité par l’excès de travail d’hier, je n’ai pas une idée : le corps et l’esprit ne demandent que du repos.
— Tous ces soirs, promené seul.
5 juillet. — Mauvaise journée. J’ai essayé d’écrire et n’ai rien pu faire.
Sorti à trois heures avec Jenny pour aller voir le logement de la rue du 29 Juillet. Ensuite à Saint-Eustache, voir les peintures de Glaize[866].
En rentrant, mes yeux se portent sur le Loth de Rubens, dont j’ai fait une petite copie. Je suis étonné de la froideur de cette composition et du peu d’intérêt qu’elle présente, si on en excepte le talent de peindre les figures. Véritablement ce n’est qu’à Rembrandt qu’on voit commencer, dans les tableaux, cet accord des accessoires et du sujet principal, qui me paraît à moi une des parties les plus importantes, si ce n’est la plus importante. — On pourrait faire à ce sujet une comparaison entre les maîtres fameux.
6 juillet. — Faire un travail sur l’antique, — sur le faux embellissement : les cartons de Rubens, de la vie d’Achille, les passages d’Homère et les tragiques grecs où l’on entend le cri de la nature. — Vulcain dans sa forge, dans l’Iliade. — Comparaison avec David.
J’ai vu Durieu ce matin, qui m’a parlé des Pierret. Il me dit qu’une démarche de moi auprès de l’Impératrice pourrait quelque chose.
7 juillet. — En revenant du conseil pour aller à Saint-Sulpice, vu l’atelier de Gros, qui est à louer.
Le soir, au bois de Boulogne avec Mme de Forget.
8 juillet. — Recopié des parties de l’article sur le beau et terminé.
M. Trélat[867] venu dans la journée. Le matin, Vigneron.
15 juillet. — Tons du cheval du premier plan dans la Chasse aux lions. — Pour les crins : laque brûlée, Sienne naturelle, Sienne brûlée. — Pour le corps : momie, laque de gaude, chrome foncé. Tous ces tons jouent dans la peinture. — Sabots : terre Cassel, noir pêche, jaune de Naples.
19 juillet. — Andrieu me dit que le temps qu’il faut pour la vigne, c’est le contraire de celui qu’il faut pour le blé : il faut un temps frais et net pour ce dernier ; pour la vigne, il faut le temps étouffant, le mistral, le siroco. — Rapporter ceci à ma réflexion sur les malheurs nécessaires.
Non seulement nous voyons cette apparente contradiction dans la nature, qui semble satisfaire ceux-ci aux dépens de ceux-là, mais nous sommes nous-mêmes pleins de contradictions, de fluctuations, de mouvements en sens divers, qui rendent agréable ou détestable la situation où nous sommes et qui ne change pas, tandis que nous changeons. Nous désirons un certain état de bonheur, qui cesse d’en être un, quand nous l’avons obtenu. Cette situation que nous avons désirée est souvent pire, effectivement, que celle où nous nous trouvons.
L’homme est si bizarre qu’il trouve dans le malheur même des sujets de consolation et presque du plaisir, comme celui, par exemple, de se sentir injustement persécuté et d’avoir en soi la conscience d’un mérite supérieur à sa fortune présente ; mais il lui arrive bien plus souvent de s’ennuyer dans la prospérité et même de s’y trouver très malheureux. Le berger de La Fontaine, devenu premier ministre, entouré dans son poste élevé de jalousie et d’embûches, devait être et se trouvait à plaindre ; il dut éprouver un vif moment de bonheur, quand il reprit ses simples habits de berger et qu’il s’en empara en quelque sorte aux yeux de tous, pour retourner dans les lieux et au milieu de la vie où il goûtait sous ces habits le bonheur le plus vraiment fait pour l’homme, celui d’une vie simple et adonnée au travail.
L’homme ne place presque jamais son bonheur dans les biens réels ; il le met presque toujours dans la vanité, dans le sot plaisir d’attirer sur soi les regards et par conséquent l’envie. Mais, dans cette vaine carrière, il n’en atteint point ordinairement l’objet au moment où il se réjouit de se voir sur un théâtre où il attire les regards, il regarde encore plus haut ; ses désirs montent à mesure qu’il s’élève, il envie lui-même autant qu’il est envié ; quant aux vrais biens, il s’en éloigne toujours davantage : la tranquillité d’esprit, l’indépendance fondée sur des désirs modestes et facilement satisfaits, lui sont interdites. Son temps appartient à tout le monde ; il gaspille sa vie dans de sottes occupations. Pourvu qu’il se sente sous l’hermine et sous la moire, pourvu que le vent de la faveur le pousse et le soutienne, il dévore les ennuis d’une charge, il consume sa vie dans les paperasses, il la donne sans regret aux affaires de tout le monde. Être ministre, être président, situations scabreuses[868] qui ne compromettent pas seulement la tranquillité, mais la réputation, qui mettent un caractère à des épreuves difficiles, qui exposent an naufrage, au milieu d’écueils sans cesse renaissants, une conscience peu assurée d’elle-même.
Le plus grand nombre des hommes se compose de malheureux, qui sont privés des choses les plus nécessaires à la vie. La première de toutes les satisfactions serait pour eux la possibilité de se procurer ce qui leur manque ; le comble du bonheur, d’y joindre ce degré d’aisance et de superflu qui complète la jouissance des facultés physiques et morales.
21 juillet. — Dîné aujourd’hui avec Mme de Forget, qui part demain pour Ems. Mme Lavalette lui disait que les saisons n’étaient plus comme autrefois.
Il faut mettre ceci avec les réflexions du mercredi sur les malheurs nécessaires. Je disais dans ces réflexions que tout doit changer et subir des révolutions autour de l’homme, mais que son esprit changeait aussi et voyait les mêmes objets d’un œil différent. A mesure que son corps se modifie par l’âge et les accidents, il ne sent plus de la même manière. La morosité des vieillards est un effet de ce commencement de destruction de leur machine ; ils ne trouvent plus de saveur ni d’intérêt dans rien. Il leur semble que c’est la nature qui décline et que les éléments vont se confondre, parce qu’ils ne voient plus, ne sentent plus, qu’ils sont offensés par ce qui autrefois leur plaisait.
Il est des accidents qui dans certains pays sont considérés comme d’affreux malheurs, et qui ne font dans d’autres nulle impression. L’opinion place l’homme même et le déshonore dans les choses les plus diverses. Un Arabe ne peut supporter l’idée qu’un étranger ait aperçu, même fortuitement, le visage de sa femme. Une femme arabe mettra son point d’honneur à se cacher soigneusement : elle relèverait volontiers sa robe en découvrant le reste de son corps pour s’en voiler la tête.
Il en est de même des accidents dont on tire des présages heureux ou malheureux. En France et, je crois, chez les peuples européens, c’est un présage des plus funestes pour un cavalier et surtout pour un militaire de monter un cheval dont les quatre pieds sont marqués de blanc : le fameux général Lassalle, qui avait la religion de ce préjugé, n’avait jamais voulu monter un pareil cheval. Le jour qui fut celui de sa mort, après plusieurs augures funestes, qui l’avaient frappé toute la matinée, miroir brisé, pipe cassée, portrait de sa femme brisé également, au moment où il allait la regarder pour la dernière fois, il monte sur un cheval qui n’était pas le sien, et sans prendre garde aux pieds de sa monture. Le cheval avait le funeste signe : c’est monté sur ce cheval qu’il reçoit, peu de moments après, le coup de feu dont il mourut au bout de quelques heures, qui lui fut tiré dans un moment où l’on ne se battait plus, par un Croate, je crois, qui se trouvait au nombre des prisonniers qu’on venait de faire après Wagram… Ces quatre pieds blancs sont, au contraire, une marque et un signe de considération chez les Orientaux, qui ne manquent pas de le mentionner dans les généalogies des chevaux ; j’en vois la preuve dans la pièce authentique certifiée par les anciens du pays qui accompagne l’envoi qu’Abd-el-Kader vient de faire à l’Empereur d’un certain nombre de chevaux de prix. — Je passe sur mille exemples de la sorte.
Combien d’hommes n’ont pas désiré, comme un refuge et comme un bien, cette mort qui est l’objet de l’épouvante universelle et le plus véritablement sans remède de tous les malheurs considérés comme un malheur, et quand même on la regarderait comme un malheur, de manière à en faire un sujet d’affliction de quelque permanence dans l’ordinaire de la vie ! Ne faut-il pas à toute force s’accoutumer à cette solution nécessaire, à cet affranchissement des autres maux dont nous nous plaignons, et qui sont, à juste titre, des maux, puisque nous les sentons, tandis qu’avec la mort, c’est-à-dire avec la fin, il n’y a plus ni conscience ni sentiment ? Nous ne vivons nous-mêmes que de cette multitude innombrable de morts que nous entassons autour de nous. Notre bien-être, c’est-à-dire notre bonheur, ne s’établit que sur ces ruines de la nature vivante que nous sacrifions, non pas seulement à nos besoins, mais souvent à un plaisir passager, tel que celui de la chasse, par exemple, qui est pour la plupart des hommes un simple délassement.
22 juillet. — Emporter à la campagne les Alken. — Casquette légère, brosse à dents. — Circulaire de Bouchereau en juillet 1854.
Dauzats venu dans la journée ; il me parle du projet de changement à la classe des Beaux-Arts.
Arnoux venu ensuite. Il me dit que Corot[869] est très enchanté de mon plafond[870]. Il me cite encore quelques approbations dans ce sens.
23 juillet. — Le roi René auprès du corps de Charles le Téméraire. — Appareil, armures, flambeaux, prêtres, croix, etc.
— Trouver un sujet du même genre avec une femme.
— Roméo et Juliette[871], les parents dans la chambre. — Juliette crue morte.
24 juillet. — Ce qu’auraient été Raphaël et Michel-Ange à notre époque.
28 juillet. — Je pense aux romans de Voltaire, aux tragédies de Racine, à mille et mille chefs-d’œuvre. Comment ! tout cela aura été fait pour que les hommes soient éternellement, à chaque quart de siècle, à demander s’il n’y a pas quelque chose pour les amuser dans les œuvres de l’esprit ! Cette incroyable consommation de chefs-d’œuvre, produits pour cette tourbe humaine, par les plus brillants esprits et les génies les plus sublimes, n’effraye-t-elle pas la partie délicate de cette triste humanité ? Cette soif insatiable de nouveauté ne donnera-t-elle à personne le désir de revoir si, par hasard, ces chefs-d’œuvre vieillis ne seraient pas plus neufs, plus jeunes, que les rapsodies dont se contente notre oisiveté, et qu’elle préfère aux chefs-d’œuvre ? Quoi ! ces miracles d’invention, d’esprit, de bon sens, de gaieté ou de pathétique auront été produits, auront coûté à ces grands esprits des sueurs, des veilles si rarement, hélas ! récompensées par la louange banale du moment qui les a vus naître, pour retomber, après une courte apparition suivie de rares éloges, dans la poussière des bibliothèques et dans l’estime infertile et presque déshonorante de ce qu’on appelle les savants et les antiquaires ! Quoi ! ce seront des pédants de collège qui viendront nous tirer par la manche, pour nous avertir que Racine est simple du moins, que La Fontaine a vu dans la nature autant que Lamartine, que Lesage a peint les hommes comme ils sont, pendant que les coryphées de la civilisation, les hommes qu’on fait ministres ou pasteurs de peuples, de simples pédants qu’ils étaient, parce qu’ils ont eu un quart d’heure d’inspiration à la hauteur des lumières du jour, ce seront les hommes qui feront une littérature, du nouveau, enfin ! Quelle nouveauté !…
29 juillet. — Sur le portrait. — Sur le paysage, comme accompagnement des sujets. Du mépris des modernes pour cet élément d’intérêt. — De l’ignorance où ont été presque tous les grands maîtres de l’effet qu’on pouvait en tirer : Rubens, par exemple, qui faisait très bien le paysage, ne s’inquiétait pas de le mettre en rapport avec ses figures, de manière à les rendre plus frappantes ; je dis frappantes pour l’esprit, car pour l’œil, ses fonds sont calculés en général pour outrer plutôt par le contraste la couleur des figures. Les paysages du Titien, de Rembrandt, du Poussin, sont en général en harmonie avec leurs figures. Chez Rembrandt même — et ceci est la perfection — le fond et les figures ne font qu’un. L’intérêt est partout : vous ne divisez rien, comme dans une belle vue que vous offre la nature et où tout concourt à vous enchanter. Chez Watteau, les arbres sont de pratique : ce sont toujours les mêmes, et des arbres qui rappellent les décorations de théâtre plus que ceux des forêts. Un tableau de Watteau mis à côté d’un Ruysdaël ou d’un Ostade perd beaucoup. Le factice saute aux yeux. Vous vous lassez vite de la convention qu’ils présentent et vous ne pouvez vous détacher des Flamands.
La plupart des maîtres ont pris l’habitude, imitée servilement par les écoles qui les ont suivis, d’exagérer l’obscurité des fonds qu’ils mettent aux portraits ; ils ont pensé ainsi rendre les têtes plus intéressantes, mais cette obscurité des fonds, à côté de figures éclairées comme nous les voyons, ôte à ces portraits le caractère de simplicité qui devrait être le principal. Elle met les objets qu’on veut mettre en relief dans des conditions tout à fait extraordinaires. Est-il naturel, en effet, qu’une figure éclairée se détache sur un fond très obscur, c’est-à-dire non éclairé ? La lumière qui arrive sur la personne ne doit-elle pas logiquement arriver sur le mur ou sur la tapisserie sur laquelle elle se détache ?… A moins de supposer que la figure se détache fortuitement sur une draperie extrêmement foncée, — mais cette condition est fort rare, — ou sur l’entrée d’une caverne ou d’une cave entièrement privée de jour, circonstance encore plus rare, le moyen ne peut paraître que factice.
Ce qui fait le charme principal des portraits, c’est la simplicité. Je ne mets pas au nombre des portraits ceux où on cherche à idéaliser les traits d’un homme célèbre qu’on n’aura pas vu et d’après des images transmises ; l’invention a droit de se mêler à de semblables représentations. Les vrais portraits sont ceux qu’on fait d’après des contemporains : on aime à les voir sur la toile, comme nous les rencontrons autour de nous, quand même ce seraient des personnes illustres. C’est même à l’égard de ces dernières que la vérité complète d’un portrait vous offre plus d’attrait. Notre esprit, quand ils sont loin de notre vue, se plaît à agrandir leur image comme les qualités qui les distinguent ; quand cette image est fixée et qu’elle est sous nos yeux, nous trouvons un charme infini à comparer la réalité à ce que nous nous sommes figuré.
Nous aimons à trouver l’homme à côté ou à la place du héros. L’exagération du fond dans le sens de l’obscurité fait bien ressortir, si l’on veut, un visage très éclairé ; mais cette grande lumière devient presque de la crudité : en un mot, c’est un effet extraordinaire qui est sous nos yeux plutôt qu’un objet naturel. Ces figures détachées si singulièrement ressemblent à des fantômes et à des apparitions plus qu’à des hommes. Cet effet ne se produit que trop de lui-même, par l’effet du rembrunissement des couleurs par le temps. Les couleurs obscures deviennent plus obscures encore en proportion des couleurs claires qui conservent plus d’empire, surtout si les tableaux ont été fréquemment dévernis et revernis. Le vernis s’attache aux parties sombres et ne s’en détache pas facilement ; l’intensité dans les parties noires va donc toujours en s’augmentant ; de sorte qu’un fond qui n’aura présenté, dans la nouveauté de l’ouvrage, qu’une médiocre obscurité, deviendra avec le temps d’une obscurité complète. Nous croyons, en copiant ces Titien, ces Rembrandt, faire les ombres et les clairs dans le rapport où le maître les avait tenus ; nous reproduisons pieusement l’ouvrage ou plutôt l’injure du temps. Ces grands hommes seraient bien douloureusement surpris en retrouvant des croûtes enfumées, au lieu de leurs ouvrages, comme ils les ont faits. Le fond de la Descente de croix de Rubens, qui devait être un ciel très obscur à la vérité, mais tel que le peintre a pu se le figurer dans la représentation de la scène, est devenu tellement noir qu’il est impossible d’y distinguer un seul détail…
On s’étonne quelquefois qu’il ne reste rien de la peinture antique ; il faudrait s’étonner d’en retrouver encore quelques vestiges dans les barbouillages de troisième ordre qui décorent encore les murailles d’Herculanum, lesquels étaient dans des conditions de conservation un peu meilleures, étant exécutés sur les murs et n’étant pas exposés à autant d’accidents que les tableaux des grands maîtres, peints sur des toiles ou sur des panneaux, et que leur mobilité exposait à plus d’accidents. On s’étonnerait moins de leur destruction si l’on réfléchissait que la plupart des tableaux produits depuis la renaissance des arts, c’est-à-dire très récents, sont déjà méconnaissables, et qu’un grand nombre déjà a péri par mille causes. Ces causes vont se multipliant, grâce au progrès de la friponnerie en tous genres, qui falsifie les matières qui entrent dans la composition des couleurs, des huiles, des vernis, grâce à l’industrie, qui substitue, dans les toiles, le coton au chanvre, et des bois de mauvaise qualité aux bois éprouvés que l’on employait autrefois pour les panneaux. Les restaurations maladroites achèvent cette œuvre de destruction. Beaucoup de gens s’imaginent avoir beaucoup fait pour les tableaux quand ils les ont fait restaurer ; ils croient qu’il en est de la peinture comme d’une maison qu’on répare, et qui est toujours une maison, comme tout ce qui est à notre usage que le temps détruit, mais que notre industrie fait encore durer et servir, en le replâtrant, en le réparant de mille manières. Une femme, à la rigueur, peut, grâce à la toilette, cacher quelques rides pour produire une certaine illusion et paraître un peu plus jeune qu’elle n’est ; mais pour les tableaux, c’est autre chose : chaque restauration prétendue est un outrage mille fois plus regrettable que celui du temps ; ce n’est pas un tableau restauré qu’on vous donne, mais un autre tableau, celui du misérable barbouilleur qui s’est substitué à l’auteur du tableau véritable qui disparaît sous les retouches.
Les restaurations dans la sculpture n’ont pas le même inconvénient.
— Sur le gothique neuf.
30 juillet. — Avoir les photographies Durieu pour emporter à Dieppe, ainsi que les croquis d’après Landon[872] et Thévelin. — Têtes photographiées. — Animaux et anatomie.
Il me semble qu’on pourrait se passer d’impression en peignant son sujet à la détrempe, après l’avoir mis aux carreaux. Pour redessiner sur une ébauche aussi grossière, on passerait une colle très légère, mais qui ne serait pas une colle animale. On pourrait essayer le jus d’ail qui donne un vernis et qui doit contenir un gluten, puisqu’il sert à coller très fortement certains objets. On pourrait ainsi retoucher indéfiniment à la détrempe. On pourrait même ébaucher sur une toile serrée avec de la couleur à l’huile comme on fait sur les panneaux, mais ce serait plus long et plus pénible.
1er août. — Commission le matin à la Préfecture de police pour le mobilier du préfet. J’ai revu les appartements du haut, qu’habitait Mme Delessert.
— A Saint-Sulpice. — Trouvé Chenavard en cabriolet, comme je sortais de chez Halévy ; je l’ai ramené chez moi. Il avait l’exaltation d’un homme qui vient de faire un bon déjeuner, ce qu’il a eu la bonté de me dire et qui se voyait ou se sentait de reste ; sa sensibilité était aussi excitée que son imagination, et il m’a fait beaucoup de tendresses qui m’ont plu pour le moins autant que ses systèmes sur l’origine et la fin du monde. Il m’a exposé des idées très ingénieuses là-dessus, et il me promet une carte explicative mise au net. Je lui ai donné un croquis qui est la première idée du Tigre attaquant le cheval, que j’ai fait pour Weill. Je lui en ai promis encore : ils seront en bonnes mains. Il me dit en avoir vu des quantités énormes chez Riesener, à qui j’en savais bien quelques-uns, mais non pas dans les proportions qu’il m’a dites.
— Hier et avant-hier, fait les deux premières séances sur la Chasse aux lions. Je crois que cela marchera vite.
2 août. — Mauvaise journée : c’est la troisième sur le grand tableau. Cependant, au demeurant, avancé encore. Travaillé au coin de droite, le cheval, l’homme et la lionne sautant sur la croupe.
3 août. — Le matin, rendez-vous chez l’abbé Coquant pour lui demander de me laisser travailler le dimanche (à Saint-Sulpice). Impossibilité sur impossibilité. L’Empereur, l’Impératrice, Monseigneur conspirent pour qu’un pauvre peintre comme moi ne commette pas le sacrilège de donner cours, le dimanche comme les autres jours, à des idées qu’il tire du cerveau pour glorifier le Seigneur. J’aimais beaucoup au contraire à travailler de préférence le dimanche dans les églises : la musique des offices m’exaltait beaucoup[873]. J’ai beaucoup fait ainsi à Saint-Denis du Saint-Sacrement.
4 août. — En sortant du conseil, à l’Instruction publique pour M. Ferret ; déjeuné sur la place de l’Hôtel de ville ; lu dans l’Indépendance belge un article sur une traduction de l’Enfer, d’un M. Ratisbonne[874]. C’est la première fois qu’un moderne ose dire son avis sur cet illustre barbare. Il dit que ce poème n’est pas un poème, qu’il n’est point ce qu’Aristote appelle une unité, c’est-à-dire ayant commencement, milieu et fin ; qu’il pourrait y avoir aussi bien dix que vingt, que trente-trois chants ; que l’intérêt n’est nulle part : que ce ne sont qu’épisodes cousus les uns aux autres, étincelants par moments par les sauvages peintures de tourments, souvent plus bizarres que frappantes, sans qu’il y ait gradation dans l’horreur que ces épisodes inspirent, sans que l’invention de ces divers supplices ou de ces punitions soit en rapport avec les crimes des damnés. Ce que l’article ne dit pas, c’est que le traducteur gâte encore, par la bizarrerie du langage, ce que ces imaginations ont de singulier ; il critique toutefois certaines expressions outrées, tout en approuvant le système de traduire pour ainsi dire mot à mot et de se coller sur son auteur qu’il traduit tercet par tercet et vers par vers.
Comment l’auteur ne serait-il pas tout ce qu’il y a de plus baroque avec cette sotte prétention ? Comment joindre à la difficulté de rendre dans une langue si différente par son tour et par son génie, tout imprégnée de notre allure moderne, un vieil auteur à moitié inintelligible, même pour ses compatriotes, concis, elliptique, obscur et s’entendant à peine lui-même ? J’estime déjà que traduire en ne l’entendant que comme le plus grand nombre des traducteurs, c’est-à-dire dans un langage humain et acceptable par les hommes à qui on s’adresse, est une œuvre assez difficile : faire passer dans le génie d’une langue, surtout en exposant les idées d’une époque entièrement différente, est un tour de force que je regarde comme presque inutile à tenter. M. Ratisbonne écorche le français et les oreilles, et il ne rend ni l’esprit, ni l’harmonie, ni par conséquent le vrai sens de son poète. Il faut mettre cela avec les traductions de Viardot et autres qui font du français espagnol en traduisant Cervantes, comme on fait ailleurs du français anglais en traduisant Shakespeare.
5 août. — Que chaque talent original présente dans son cours les mêmes phases que l’art parcourt dans ses évolutions différentes, savoir : timidité et sécheresse au commencement, et largeur ou négligence des détails à la fin. — Le comte Palatiano[875] comparé à mes récentes peintures.
Loi singulière ! Ce qui se produit ici se produit en tout. Je serais conduit à inférer que chaque objet est en lui-même un monde complet. L’homme, a-t-on dit, est un petit monde. Non seulement il est dans son unité un tout complet, avec un ensemble de lois conformes à celles du grand tout, mais une partie même d’un objet est une espèce d’unité complète ; ainsi une branche détachée d’un arbre présente les conditions de l’arbre tout entier. C’est ainsi que le talent d’un homme isolé présente dans la suite de son développement les phases différentes que présente l’histoire de l’art dans lequel il s’exerce (ceci peut encore se rapporter au système de Chenavard sur l’enfance et la vieillesse du monde).
On plante une branche de peuplier, qui devient bientôt un peuplier. Où ai-je vu qu’il y a des animaux, — et cela est probable, — qui, coupés en morceaux, font autant d’être distincts, ayant autant d’existences propres qu’il y a de fragments ? J’ai remarqué souvent, en dessinant des arbres, que telle branche séparée est elle-même un petit arbre : il suffirait, pour le voir ainsi, que les feuilles fussent proportionnées. La nature est singulièrement conséquente avec elle-même : j’ai dessiné à Trouville des fragments de rochers au bord de la mer, dont tous les accidents étaient proportionnés, de manière à donner sur le papier l’idée d’une falaise immense ; il ne manquait qu’un objet propre à établir l’échelle de grandeur. Dans cet instant, j’écris à côté d’une grande fourmilière, formée au pied d’un arbre, moitié par de petits accidents de terrain, moitié par Les travaux patients des fourmis ; ce sont des talus, des parties qui surplombent et forment de petits défilés, dans lesquels passent et repassent les habitants d’un air affairé et comme le petit peuple d’un petit pays, que l’imagination peut grandir dans un instant. Ce qui n’est qu’une taupinière, je le vois à volonté comme une vaste étendue entrecoupée de rocs escarpés, de pentes rapides, grâce à la taille diminuée de ses habitants. Un fragment de charbon de terre ou de silex, ou d’une pierre quelconque, pourra présenter dans une proportion réduite les formes d’immenses rochers.
Je remarque à Dieppe la même chose dans les rochers à fleur d’eau, que la mer recouvre à chaque marée ; j’y voyais des golfes, des bras de mer, des pics sourcilleux suspendus au-dessus des abîmes, des vallées divisant, par leurs sinuosités, toute une contrée présentant les accidents que nous remarquons autour de nous. Il en est de même pour les vagues de la mer, qui sont divisées elles-mêmes en petites vagues, se subdivisant encore et présentant individuellement les mêmes accidents de lumière et le même dessin. Les grandes vagues de certaines mers du Cap, par exemple, dont on dit qu’elles ont quelquefois une demi-lieue de large, sont composées de cette multitude de vagues, dont le plus grand nombre est aussi petit que celles que nous voyons dans le bassin de notre jardin.
— Fuir les méchants, même quand ils sont agréables, instructifs, séduisants. Chose étrange ! un penchant, autant que le hasard aveugle, vous rapproche souvent d’une perverse nature. Il faut combattre ce penchant, puisque l’on ne peut fuir le hasard des rencontres.
Lu dans la Revue un article de Saint-Marc Girardin[876], au sujet de la Lettre sur les spectacles, de Rousseau. Il discute longuement si les spectacles sont dangereux ; je suis de cet avis, mais ils ne le sont pas plus que toutes nos autres distractions. Tout ce que nous imaginons, pour nous tirer du spectacle constant de notre misère et des ennuis qu’engendre notre vie telle qu’elle est, tourne les esprits vers ce qui est plus ou moins défendu par la stricte morale. Vous n’intéressez que par le spectacle des passions et de leurs agitations : ce n’est guère le moyen d’inspirer la résignation et la vertu. Nos arts ne sont qu’allèchements pour la passion. Toutes ces femmes nues dans les tableaux, toutes ces amoureuses dans les romans et dans les pièces, tous ces maris ou ces tuteurs trompés ne sont rien moins que des excitations à la chasteté et à la vie de famille. Rousseau eût été révolté cent fois davantage par le théâtre et le roman modernes. A très peu d’exceptions près, on ne trouvait dans l’un et dans l’autre, autrefois, que des exemples de passions dont le triomphe ou la défaite tournait jusqu’à un certain point au profit de la morale. Le théâtre ne montrait guère le tableau de l’adultère (Phèdre, la Mère coupable). L’amour était une passion contrariée, mais dont la fin était légitime dans nos mœurs. On était à cent lieues de ces excentricités romanesques qui font le thème ordinaire des drames modernes et la pâture des esprits désœuvrés… Quels germes de vertu ou seulement de convenance apparente peuvent laisser dans les cœurs des Antony, des Lélia et tant d’autres parmi lesquels le choix est difficile pour l’exagération d’une part, et pour le cynisme de l’autre ?
11 août. — Rapporté de chez Beugniet huit pastels : il en avait rapporté deux auparavant : les Roses trémières, etc. ; il en a encore huit.
12 août. — Balancer les avantages de la vie chez l’homme qui réfléchit et chez l’homme qui ne réfléchit pas : le gentilhomme campagnard, né au milieu de l’abondance champêtre de ses champs et de son manoir, passant sa vie à chasser et à voir ses voisins, avec celle de l’homme adonné aux distractions modernes, lisant, produisant, vivant d’amour-propre ; ses rares jouissances, celles des belles choses peuvent-elles se comparer ? Malheureusement, il sent à merveille ce qui lui manque : au sein de l’aridité qu’il trouve quelquefois dans son bonheur abstrait, il sent vivement la jouissance que ce serait pour lui de vivre en plein air, dans une famille, dans une vieille maison et un domaine antique, où il a vu ses pères. Par contre, le campagnard qui n’est que cela, jouit grossièrement, s’enivre, vit de commérages, et n’apprécie pas le côté noble et vraiment heureux de son existence.
Contradiction de l’opinion des hommes sur ce qui fait le malheur : chapitre des malheurs nécessaires. Le vrai malheur pour le campagnard, qui n’évite l’ennui après la chasse qu’en allant dormir comme ses chiens, comme pour le philosophe qui soupire après le bonheur des champs, c’est la souffrance, la maladie : ni l’un ni l’autre, alors qu’il est malade, ne se trouve malheureux de la vie qu’il est forcé de mener ; et, qu’il souffre de l’ennui ou de maux véritables ; l’un comme l’autre n’a pas moins une horreur égale de la mort, c’est-à-dire de la fin de cet ennui ou de cette souffrance.
Heureux qui se contente de la surface des choses ! J’admire et j’envie les hommes comme Berryer, qui a l’air de ne rien approfondir. Vous me le donnez, je le prends : ne pesons sur rien. Que de fois j’ai désiré lire dans les cœurs, uniquement pour savoir ce que contenaient de bonheur ces visages satisfaits… comme tous ces fils d’Adam, héritiers des mêmes ennuis que je supporte !
Comment ces Halévy, ces Gautier, ces gens couverts de dettes et d’exigences de famille ou de vanité, ont-ils un air souriant et calme, à travers tous les ennuis ? Ils ne peuvent être heureux qu’en s’étourdissant et en se cachant les écueils au milieu desquels ils conduisent leur barque, souvent en désespérés, et où ils font naufrage quelquefois.
12 août. — L’habitude émousse tous les sentiments : les picotements journaliers de la famille, etc. Mme Sand devrait être heureuse, et je crois qu’elle ne l’est pas.
— Dans le Moniteur d’aujourd’hui, article de Gautier sur les peintures de Cornélius[877]. Descriptions de sujets mythologiques, dans lesquels il y a à prendre.
— J’ai été l’après-midi porter mon tableau des Baigneuses chez Berger. J’ai vu là un tableau de de Kayser, qui est très estimé des amateurs. Le mien, que je méprise assez, — l’ayant fait dans des conditions qui ne me plaisent pas, — m’a paru un chef-d’œuvre.
J’ai été à l’Hôtel de ville, pour l’affaire de Vimont. M. Perrier m’a demandé, avec toute la discrétion qu’on peut mettre à commettre une indiscrétion, de lui donner un dessin, une bagatelle, a-t-il dit, pour avoir un souvenir de vous, de ces choses que vous faites en vous jouant et en pensant à autre chose.
Je me porte mieux, je suis plus allègre tous ces jours derniers, un peu borborygme et travaillé par l’influence. Ce soir, joui, en me promenant, de ce sentiment du retour de la force. Je suis heureux de quitter Paris ; j’ai hâte de le faire pour tirer le plus tôt possible de cet air empesté ma pauvre Jenny.
13 août. — Mannequin chez Lefranc à 350 fr. Savoir s’il en loue et à meilleur compte. Je dirai à Andrieu de s’en informer.
14 août. — Aller, à mon retour, demander à Ferdinand Denis, rue de l’Ouest, 56, l’ouvrage de Bazin, sur Molière.
L’Académie des sciences morales et politiques avait mis au concours, en 1847, la question suivante : Rechercher quelle influence le progrès et le goût du bien-être matériel exercent sur la moralité du peuple. Je trouve ceci dans mon petit agenda de 1847. Je serais curieux de savoir les conclusions qui ont été couronnées par la docte Académie, composée presque exclusivement de ces moralistes que nous connaissons, qui ont fait la révolution de 1830 et celle de 1848 ; ce prix, proposé avant cette dernière, avait sans doute en vue de glorifier ce progrès et ce goût du bien-être qui n’est que trop naturel, à mon avis, et n’a nul besoin d’être encouragé dans les cœurs, d’où il serait plutôt difficile de le déloger. Le beau chef-d’œuvre de découvrir que l’homme, à tous les degrés de l’échelle, désire être mieux qu’il n’est ! Passe encore si on découvrait en même temps un moyen de le rendre satisfait quand il est monté d’un degré ou de plusieurs degrés vers les objets de son ambition.
Cette ambition, malheureusement, est insatiable, et il arrive que celui qui, au milieu d’une vie pauvre, entretenait le ressort de son âme en résistant aux malheurs ou à l’embarras, perd le sentiment du devoir au sein d’une situation qu’il améliore facilement et qu’il veut améliorer sans fin. (Au chapitre du labourage à la mécanique, etc., Girardin, etc.)
17 août. — Parti pour Dieppe à neuf heures du matin. Mille embarras pour s’embarquer, et bonheur délicieux une fois parti.
Je suis à côté d’un grand gaillard qui a l’air d’un Flamand, mais dans une tenue de voyage irréprochable : chapeau de feutre anglais, gants serrés et boutonnés, canne délicieuse. Il lit dédaigneusement un journal et adresse de temps en temps la parole à un homme, en face de lui, proprement vêtu, mais sans recherche, figure assez sérieuse, qui médite de son côté sur le journal et que je prends pour un homme de mérite. Mon gros élégant demande à l’homme de mérite en noir des nouvelles de l’endroit qu’il va habiter. « C’est un trou, dit-il, vous allez périr d’ennui. » Je me dis que c’était un homme difficile à amuser, nouvelle confirmation de sa supériorité.
Après avoir épuisé l’un et l’autre cette lecture qui les empêchait sans doute de jeter les yeux sur toute cette nature au milieu de laquelle nous nous sentions emportés, et dont la vue me remplissait de bonheur, mes deux hommes se mettent à causer. L’homme en noir demande à l’homme en manchettes et à canne ce que devient Un tel, s’il y a longtemps qu’il ne l’a vu. Cet Un tel, c’est un boucher : on raconte en style d’arrière-boutique des anecdotes sur ce boucher. J’apprends alors que le prétendu homme de mérite, savant ou professeur, tient dans un faubourg une boutique de nouveautés, confections, etc. Madame son épouse en tient une petite dans la rue Saint-Honoré ; la conversation s’anime sur le calicot, sur des parties de châles et de cretonne… Mes idées s’éclaircissent tout à coup à leur tour. Je retrouve parfaitement dans les traits et dans la carrure de mon boucher enrichi et mis à la dernière mode un gaillard qui a dû posséder le sang-froid nécessaire pour saigner un veau et détailler de la viande ; les plaisanteries de son interlocuteur et l’expression ignoble de ses petits yeux qui disparaissent dans son rire niais sont en harmonie avec les gestes d’un commis habitué à auner de l’étoffe. Je suis moins surpris du peu d’attention qu’ils ont donné au spectacle des champs… Ils nous quittent l’un et l’autre avant Rouen.
La seconde partie du voyage s’accomplit avec une lenteur extrême ; petite tromperie de MM. les administrateurs, qui nous promettent un trajet direct, et qui, de Rouen à Dieppe, nous arrêtent à chaque pas. La pluie achève le mécontentement. Quand nous arrivons, elle est diluviale. Un de nos compagnons de voiture que j’avais pris en goût me dit qu’il n’y a pas un logement à louer, qu’il arrive tous les jours huit cents personnes.
Longue station au débarcadère, et enfin emmenés par le père Mercier à l’Hôtel du Géant, où nous nous installons ; très bon dîner, petite course à la jetée auparavant.
Je revois avec plaisir tous ces endroits que je connais. Pris par la pluie, je me réfugie dans la cabane du gardien de la jetée, qui est un vieux matelot.
18 août. — Un peu de fainéantise, sommeil sur un canapé, malgré le beau soleil ; pourtant j’avais été faire un tour ; entré même à Saint-Jacques.
Si la vue d’objets nouveaux a pour notre pauvre esprit, si avide de changements, un charme qu’on ne peut nier, il faut avouer aussi que la douceur de retrouver des objets déjà connus est très grande. On se rappelle les plaisirs qu’on y a éprouvés déjà et dont l’imagination augmente le charme à distance.
J’ai de la peine à surmonter cette langueur et ce vide qui me pèsent, quand je n’ai pas encore pris mes habitudes dans un lieu où j’arrive. Les seuls plaisirs que je trouve ici dans ces premiers jours sont uniquement de revoir un lieu que j’aime et où je me suis trouvé heureux. Mon bonheur d’autrefois me semble plus grand que celui d’aujourd’hui. Le défaut d’occupations capables de m’intéresser en dehors de la vue des objets qui m’environnent et malgré leur intérêt pour moi, en est la cause.
J’ai remarqué, comme je ne l’avais point fait jusqu’ici, la vérité des expressions dans le Saint Sépulcre qui est à Saint-Jacques. Je ne sais où j’ai écrit ces jours-ci que cette vue me confirmait aussi cette idée de Chenavard, à savoir, que le christianisme aime le pittoresque. La peinture s’allie mieux que la sculpture avec ses pompes et s’accorde plus intimement avec les sentiments chrétiens.
Dîné encore ce jour à l’Hôtel du Géant et trouvé notre logement sur le port. La vue qu’on a de la fenêtre me transporte, et je crois faire une excellente affaire en le payant cent vingt francs pour un mois.
19 août. — Installation dans le logement qui présente mille inconvénients : nous le croyons horrible et insupportable, et nous finissons par nous y habituer. Les plus petits événements de ma vie présentent, comme ce qui m’est arrivé de plus important, les mêmes phases et les mêmes accidents. Un projet se présente avec toutes les séductions : à peine embarqué, mille contrariétés surgissent qui semblent devoir tout arrêter et rendre tout détestable. La volonté ou le hasard fait que les difficultés s’aplanissent et que la situation devient tolérable d’abord et quelquefois excellente. Chaque homme a-t-il sa destinée réellement écrite et tracée, comme il a sa figure et son tempérament ? Quant à moi, et jusqu’ici, je n’hésite pas à en être convaincu. Je suis un homme très heureux au demeurant, et il a toujours fallu acheter chaque avantage par quelque combat. J’ai recueilli par là quelques faveurs du destin, accordées à la vérité d’une main avare, mais présentant aussi quelque chose de plus certain ; c’est comme ces arbres qui croissent dans de maigres terrains où ils poussent lentement et difficilement, et dont les branches sont tordues et noueuses, grâce à cette difficulté d’exister ; le bois de ces arbres passe pour être plus dur que celui de ces beaux arbres venus en peu de temps dans une terre abondante, et dont les troncs droits et lisses semblent avoir crû sans peine.
La destinée de ma pauvre Jenny offre une fixité semblable (elle ne s’est jamais démentie), mais qui n’est guère en harmonie avec celle qu’eussent méritée ses vertus. Jamais plus noble et plus ferme nature ne fut mise à des épreuves plus cruelles. Que le ciel au moins lui donne maintenant des jours heureux et moins de cruelles souffrances pour le prix de cette noble misère supportée d’un front si serein et pour des motifs si généreux ! Est-ce que les lois morales n’auraient pas le privilège, comme les lois qui ne regardent que le physique, d’être invariables ?
23 août. — Je crois que c’est ce matin que j’ai été avec Jenny, à qui ces promenades font du bien, courir le long des falaises, du côté des bains ; c’est là que j’ai remarqué ces rochers à fleur d’eau et que j’ai eu beaucoup de plaisir à voir la marée les envahir.
Vers quatre heures, promenade du côté du Pollet avec Jenny. Nous sommes entrés dans la nouvelle église. Elle est complètement sur un modèle italien que les architectes affectionnent dans ce moment. Elle présente la nudité la plus complète ; ces gens-là prennent pour une austère simplicité ce qui n’est que barbare chez les inventeurs de ce type d’architecture qui conviendrait peut-être à des protestants, qui ont horreur de la pompe romaine ; mais ces grands murs tout nus et ces jours ménagés, qui distillent à peine un peu de lumière dans ce pays où il fait sombre pendant les trois quarts de l’année, ne conviennent guère au culte catholique. Je ne peux assez me récrier sur la sottise des architectes, et je n’excepte ici personne sur ce point. Chacun des caprices que la mode a consacrés à son tour dans chaque siècle devient sacramentel pour eux. Il semble que ceux-là seulement qui les ont précédés étaient des hommes doués de la liberté d’inventer ce qui leur plaît pour orner leurs demeures. Ils s’interdisent de produire autre chose que ce qu’ils trouvent ailleurs tout fait et approuvé par les livres. Les castors inventeront une nouvelle manière de faire leurs maisons avant qu’un architecte se permette un nouveau mode et un nouveau style dans son art, lequel, par parenthèse, est le plus conventionnel de tous, et celui qui, par conséquent, admet le plus le caprice et le changement.
24 août. — Aujourd’hui, loué enfin un roman de Dumas, pour sortir de l’ennui que me donne l’absence d’occupation. Tous les jours précédents, promenades, dessins d’après les photographies de Durieu.
Trouvé aujourd’hui, avant dîner, en revenant du Pollet, le pauvre cheval étendu par terre et que je croyais mort. Il était à la vérité mourant[878].
25 août. — Le soir chez Mme Scheppard, que j’avais rencontrée il y a cinq ou six jours ; elle partait, ainsi que sa fille, pour aller entendre les chansonnettes de Levassor, quelle appelait un concert[879]. J’ai résisté à son invitation de l’accompagner et ai été promener, sur la jetée et dans l’obscurité, la toilette dont j’avais fait les frais contre mon ordinaire depuis que je suis ici et qui était à son intention.
Dans la promenade de ce matin, étudié longuement la mer. Le soleil étant derrière moi, la face des vagues qui se dressait devant moi était jaune, et celle qui regardait le fond réfléchissait le ciel. Des ombres de nuages ont couru sur tout cela et ont produit des effets charmants : dans le fond, à l’endroit où la mer était bleue et verte, les ombres paraissaient comme violettes ; un ton violet et doré s’étendait aussi sur les parties plus rapprochées quand l’ombre les couvrait. Les vagues étaient comme d’agate. Dans ces parties ombrées, on retrouvait le même rapport de vagues jaunes, regardant le côté du soleil, et de parties bleues et métalliques réfléchissant le ciel. Lettre à Mme de F… et qui a du rapport avec ce que j’ai écrit le 12 août courant.
« Je vous écris bien tard ; j’ai été ballotté de logement en logement, avant de me fixer ; enfin, me voici sur le quai Duquesne, en pleine marine ! Je vois le port et les collines du côté d’Arqués : c’est une vue charmante, et dont la variété donne des distractions continuelles, quand on ne sort pas. Je suis ici, comme à mon ordinaire, ne voyant personne, évitant de me trouver là où je puis rencontrer des gens ennuyeux. J’en ai trouvé deux ou trois en débarquant ; nous nous sommes promis, juré même de nous voir tous les jours ; mais comme je ne mets jamais le pied dans l’établissement, qui est le rendez-vous de tout le monde, il y a de grandes chances que je ne les rencontrerai pas. J’ai eu recours à ma ressource ordinaire, pour bannir l’ennui des moments où je ne sais que faire : j’ai loué un roman de Dumas, et avec cela j’oublie quelquefois d’aller voir la mer. Elle est superbe depuis hier : les vents vont commencer à souffler, et nous aurons de belles vagues. Je vous plains d’avoir déjà fini vos excursions, moi qui suis au commencement des miennes ; mais Paris vous plaît plus qu’à moi. Hors de Paris, je me sens plus homme ; à Paris, je ne suis qu’un monsieur. On n’y trouve que des messieurs et des dames, c’est-à-dire des poupées ; ici, je vois des matelots, des laboureurs, des soldats, des marchands de poisson.
La grande toilette de ces dames, toutes à la dernière mode, contraste avec les grosses bottes des pêcheurs du Pollet et les robes courtes des Normandes, qui ne manquent pas d’un certain charme, malgré leurs coiffures, qui ressemblent à des bonnets de coton.
Je fais une cuisine excellente. J’ai trouvé dans mon logement un fourneau dans le genre du vôtre, et j’ai pris une passion pour tout ce qui sort de ce fourneau. Quant au poisson et aux huîtres, aux tourteaux et aux homards, ils sont incomparables. Vous ne mangez à Paris que le rebut en comparaison. Je me vautre, comme vous le voyez, dans la matière ; il n’est point jusqu’au cidre que je ne trouve excellent. Je bâille quelquefois de n’avoir rien à faire de suivi. Les petits dessins que je fais principalement ne suffisent point pour m’occuper l’esprit[880] ; alors je reprends mon roman, ou je vais à la jetée voir entrer et sortir les bateaux.
Voilà la vie que je vais mener encore quelque temps ; je ferai sans doute quelques excursions aux environs, mais mon quartier général sera toujours sur le quai Duquesne. Il faut conjurer comme on peut les fantômes de cette diable de vie qu’on nous a donnée, je ne sais pourquoi, et qui devient amère si facilement, quand on ne présente pas à l’ennui et aux ennuis un front d’acier. Il faut agiter, en un mot, ce corps et cet esprit, qui se rongent l’un l’autre dans la stagnation, dans une indolence qui n’est plus que de la torpeur. Il faut absolument passer du repos au travail, et réciproquement ; ils paraissent alors également agréables et salutaires. Le malheureux accablé de travaux rigoureux et qui travaille sans relâche est sans doute horriblement malheureux, mais celui qui est obligé de s’amuser toujours ne trouve pas dans ses distractions le bonheur ni même la tranquillité ; il sent qu’il combat cet ennui qui le prend aux cheveux ; le fantôme se place toujours à côté de la distraction et se montre par-dessus son épaule. Ne croyez pas, chère amie, que parce que je travaille à mes heures, je sois exempt des atteintes de ce terrible ennemi : ma conviction est qu’avec une certaine tournure d’esprit, il faudrait une énergie inconcevable pour ne pas s’ennuyer, et savoir se tirer, à force de volonté, de cette langueur où nous tombons à chaque instant. Le plaisir que je trouve dans ce moment même à m’étendre avec vous sur ce sentiment est une preuve que je saisis avidement, quand j’en ai la force, les occasions de m’occuper l’esprit, même pour parler de cet ennui que je cherche à conjurer. J’ai, toute ma vie, trouvé le temps trop long. J’attribue, pour une bonne partie, cette disposition au plaisir que j’ai presque toujours trouvée dans le travail lui-même ; les plaisirs vrais ou prétendus qui lui succédaient ne faisaient peut-être pas un assez grand contraste avec la fatigue que me donnait le travail, fatigue qui est très durement éprouvée par la plupart des hommes. Je me figure à merveille la jouissance que trouve dans le repos cette foule d’hommes que nous voyons accablés de travaux rebutants ; et je ne parle pas seulement des pauvres gens qui travaillent pour le pain de chaque jour : je parle aussi de ces avocats, de ces hommes de bureau, noyés dans les paperasses et occupés sans cesse d’affaires fastidieuses on qui ne les concernent pas. Il est vrai que la plupart de ces gens-là ne sont guère tourmentés par l’imagination ; ils trouvent même dans leurs machinales occupations une manière comme une autre de remplir leurs heures. Plus ils sont bêtes, moins ils sont malheureux.
Je finis en me consolant avec ce dernier axiome, que c’est à force d’avoir de l’esprit que je m’ennuie, non pas à présent au moins et en vous écrivant ; je viens au contraire de passer une demi-heure agréable en m’adressant à vous, chère amie, et en vous parlant à ma manière de ce sujet qui intéresse tout le monde. Ces idées, à leur tour, vous feront peut-être passer cinq minutes avec quelque plaisir, quand vous les lirez, surtout en souvenir de la véritable affection que je vous porte. »
26 août. — Tous les matins, je vais sur la plage ou
vers les rochers à fleur d’eau, quand la marée est
basse. Un de ces jours, fatigué beaucoup en m’avançant
jusqu’au sable où de pauvres femmes ramassaient
des équilles, en creusant avec une sorte de trident.
Dans la journée, reçu une lettre du cousin Delacroix que j’ai ajourné au 20 septembre et qui attend une réponse. Également une lettre de mon cher Rivet, qui me parle d’aller passer quelque temps avec sa famille au bord de la mer et me donnant des informations. Il me dit dans sa lettre beaucoup de choses qui m’ont touché et flatté.
Le soir, en me promenant sur la plage, rencontré Chenavard[881] que je n’attendais guère là. Sa vue m’a fait plaisir, et sa conversation m’est d’une grande ressource. Il m’accompagne jusque chez Mme Scheppard, où j’allais passer la soirée et où je me suis ennuyé excessivement.
En sortant vers dix heures et demie, j’ai été jusqu’à la Douane, sur le quai, pour secouer toute cette insipidité. J’ai vu là ces bateaux à vapeur anglais dont la forme est si mesquine. Grande indignation contre ces races qui ne connaissent plus qu’une chose : aller vite ; qu’elles aillent donc au diable et plus vite encore avec leurs machines et tous leurs perfectionnements, qui font de l’homme une autre machine !
27 août. — On devait lancer à midi un grand navire qu’on appelle un clipper… Voici encore une invention américaine pour aller plus vite ! Toujours plus vite ! Quand on aura mis des voyageurs logés commodément dans un canon, de manière que ce canon les envoie aussi vite que des boulets dans toutes les directions où il leur plaira d’aller, la civilisation aura fait un grand pas sans doute. Nous marchons vers cet heureux temps, qui aura supprimé l’espace, mais qui n’aura pas supprimé l’ennui, attendu la nécessité toujours croissante de remplir les heures dont les allées et venues occupaient au moins une partie.
Je devais retrouver Chenavard pour assister à ce spectacle, dont j’ai joui parfaitement, et qui est beau à voir ; je n’ai retrouvé mon compagnon qu’ensuite. Nous nous sommes promenés ; assis sur l’herbe au bord de la mer : beaucoup de conversations très bonnes et très intéressantes sur la politique et sur la peinture. Enfin la fatigue m’a pris et je suis rentré assez tard.
Après mon dîner, pris d’ennui… J’ai été du côté où l’on avait arrimé le fameux clipper, dans le dernier bassin, afin de le mater et de le gréer. On y faisait un banquet sous une tente. On a du y boire à la santé des Américains et de la vitesse, dont on aurait dû mettre la statue à la proue du bâtiment.
Rencontré sur un autre bâtiment un petit mousse qui baragouinait le breton ; j’ai pensé à Jenny et au plaisir quelle aurait de rencontrer un compatriote.
Ensuite, vers une foire qui se tenait au delà, mais qui n’a fait que renforcer mon ennui. En revenant par le même chemin, j’ai retrouvé mes dîneurs, qui en étaient au café et qui le prenaient en fumant et en disant sans doute de fort belles choses sur le progrès.
Lundi 28 août. — Rendez-vous avec Chenavard, sur la plage à une heure, pour le mener voir mes croquis. Il semble toujours estimer moins le talent des grands maîtres, à proportion de la décadence au milieu de laquelle ils vivent ; c’est le contraire qui devrait être et qu’il faudra dire. Peut-être est-il vrai qu’au milieu de l’indifférence générale, le talent ne porte pas tous ses fruits ; il est convenu que pour avoir fait le peu que j’ai produit, il a fallu déployer mille fois plus d’énergie que ces Raphaël et ces Rubens, qui n’avaient qu’à se montrer au monde surpris, et préparé cependant à l’admiration, pour être comblés d’encouragements et d’applaudissements.
Nous sortons ensemble ; il me mène par les chemins verdoyants qui sont au revers de la falaise, du côté du château. Je rentre pour dîner et le quitte au Puits salé.
Le soir, vue magnifique de l’autre côté, au Pollet, par la mer basse. Je suis resté longtemps au bout de la jetée. J’avais été happé, en rentrant pour dîner, par le jeune Gassies, qui m’apprend que Mme Manceau est à Dieppe. Il me promet de ne pas trahir ma sauvagerie, en donnant mon adresse. Le hasard l’avait mis au-dessus de moi ; nous étions là depuis dix jours, sans nous rencontrer.
— C’est le matin que j’ai retrouvé Chenavard, qui m’a conseillé d’aller voir Guérin[882], pour lui parler de la maladie de Jenny.
Mardi 29 août. — Le matin, resté quelque temps au grand soleil sur la plage, à voir les baigneurs. Je suis rentré pour travailler. J’ai fait un dessin d’après Thevelin et deux ou trois croquis, moitié de souvenir, de ce que j’avais vu le matin.
A deux heures chez Guérin avec Jenny. J’en suis fort content, et je crois qu’il a l’espoir de faire beaucoup pour elle.
En sortant, vu avec elle le château, qui m’a fort intéressé. La vue de la mer unie comme une glace et dans son immensité, qui réduisait à rien la plage et la ville de Dieppe, m’a causé le plus grand plaisir.
Je voulais le soir rencontrer Chenavard pour le remercier ; j’ai rôdé sur la plage inutilement par un temps de brouillard assez malsain et dans un demi-ennui plus malsain encore pour moi.
30 août. — Matinée délicieuse. Je suis sorti seul, pendant que la pauvre Jenny prenait médecine par ordonnance de Guérin, et je suis monté derrière le château. Chemin tortueux, petit quinconce de hêtres, sur une montée à la normande. Je me suis établi dans un champ qui venait d’être moissonné, pour faire une vue du château et de toute cette campagne, non pas que la vue fût intéressante, mais pour conserver un souvenir de ce délicieux moment. L’odeur des champs, du blé coupé, le chant des oiseaux, la pureté de l’air, m’ont mis dans un de ces états qui ne peuvent rappeler autre chose que les jeunes années où l’âme s’ouvre si facilement à ces impressions si charmantes que je crois, à l’heure qu’il est, me persuader que je suis heureux du souvenir seul de mon bonheur passé en semblables circonstances.
En redescendant, fait un autre croquis de grands arbres autour d’une ferme, et du chemin, à l’endroit où je m’étais arrêté avec Chenavard.
(Je crois que c’est ce jour-ci que j’ai passé longuement la soirée avec Chenavard. — Michel-Ange, etc. Il m’a parlé de ses relations avec certain vieux conventionnel : Barrère lui écrivant de ne pas le revoir, etc.)
31 août. — J’ai voulu renouveler mes sensations d’hier, mais en tournant d’un autre côté ; je voulais voir absolument ce que c’était que cette campagne que j’ai en face de mes fenêtres, au delà du Pollet. Je suis monté bravement par la grande route qui mène à Eu, mais le soleil m’a forcé à capituler ; j’ai pris à gauche ; j’ai vu le cimetière et suis redescendu presque grillé.
Le soir, conversation sans fin avec Chenavard sur la plage et le long des rues. Il m’a parlé de la difficulté que Michel-Ange avait souvent à travailler, et il m’a cité ce mot de lui : Benedetto Varchi[883] lui dit : « Signor Buonarotti, avete il cervello di Giove » ; il aurait répondu : « Si vuole il martello di Vulcano per farne uscire qualche cosa. » Il avait brûlé, à une certaine époque, une grande quantité d’études et de croquis, pour ne pas laisser de traces de la peine que lui avaient donnée ses ouvrages qu’il retournait de mille manières, comme un homme qui fait des vers. Il sculptait souvent d’après des dessins ; sa sculpture témoigne de ce procédé. Il disait que la bonne sculpture était celle qui ne ressemblait pas à la peinture, et que la bonne peinture, au contraire, était celle qui ressemblait à de la sculpture.
— C’est aujourd’hui que Chenavard m’a reparlé de son fameux système de décadence. Il tranche trop absolument. Il lui manque aussi d’estimer à leur juste valeur toutes les qualités estimables. Bien qu’il dise que les gens d’il y a deux cents ans ne valent pas ceux d’il y a trois cents ans, et que ceux d’aujourd’hui ne valent pas ceux d’il y a cinquante ou cent ans, je crois que Gros, David, Prud’hon, Géricault, Charlet sont des hommes admirables comme les Titien et les Raphaël ; je crois aussi que j’ai fait de certains morceaux qui ne seraient pas méprisés de ces messieurs, et que j’ai eu de certaines inventions qu’ils n’ont pas eues.
1er septembre. — Le matin et hier, levé de bonne heure, et été sur le galet avec Jenny.
Travaillé dans la journée. Dessiné de ma fenêtre, avant dîner, des bateaux[884].
Le soir, j’ai décliné Chenavard. J’avais l’esprit fatigué de sa diatribe d’hier soir. Il pratique naïvement ou sciemment l’énervation des esprits comme un chirurgien pratique la taille et la saignée… Ce qui est beau est beau, n’importe dans quel temps, n’importe pour qui ; puisque nous sommes deux à admirer Charlet[885] et Géricault, cela prouve d’abord qu’ils sont admirables, ensuite qu’ils peuvent trouver des admirateurs. Je mourrai en admirant ce qui mérite de l’être, et si je suis le dernier de mon espèce, je me dirai qu’après la nuit qui me suivra sur l’hémisphère que j’habite, le jour se refera encore quelque part, et que l’homme ayant toujours un cœur et un esprit, il jouira encore et toujours par ces deux côtés.
Le soir, revenu derrière le château ; j’ai pris un sentier qui monte à gauche ; j’ai trouvé une vue magnifique de la ville et du château. Il faisait obscur. Je me suis promis de revenir et de faire ici quelques dessins.
Je suis rentré par le plus beau clair de lune, en faisant le tour des bassins. Observé beaucoup le gréement des navires.
2 septembre. — Les savants[886] ne font autre chose, après tout, que trouver dans la nature ce qui y est. La personnalité du savant est absente de son œuvre ; il en est tout autrement de l’artiste. C’est le cachet qu’il imprime à son ouvrage qui en fait une œuvre d’artiste, c’est-à-dire d’inventeur. Le savant découvre les éléments des choses, si on veut, et l’artiste, avec des éléments sans valeur là où ils sont, compose, invente un tout, crée, en un mot ; il frappe l’imagination des hommes par le spectacle de ses créations, et d’une manière particulière. Il résume, il rend claires pour le commun des hommes qui ne voit et ne sent que vaguement en présence de la nature, les sensations que les choses éveillent en nous.
3 septembre. — Le matin de bonne heure, à la jetée pour voir sortir les bateaux. Je reprends mon chemin pour aller revoir la vue de derrière le château. Je rencontre Chenavard près des bains et reste avec lui au soleil, sur la plage, pendant trois ou quatre heures.
Je rencontre Velpeau, puis après Dumas fils.
Le soir, promené à la jetée, pour laquelle je reprends du goût. J’étais en train d’être seul et n’ai point été chercher Chenavard.
Avant dîner, promenade délicieuse d’une heure au cours Bourbon. Ce petit ruisseau à droite, avec ses roseaux et ses herbes, la vue magnifique de la plaine et des collines, les grands arbres dont les feuilles s’agitent continuellement, tout cela pénétrant et délicieux.
A la jetée le matin. J’ai vu appareiller deux bricks, dont un nantais. Cela m’a beaucoup intéressé au point de vue de l’étude. Je fais un cours complet de vergues, de poulies, etc., afin de comprendre comme tout cela s’ajuste ; cela ne me servira probablement à rien, mais j’ai toujours désiré comprendre cette mécanique, et je ne trouve rien d’ailleurs de plus pittoresque. Mes observations, quoique superficielles, m’ont conduit à voir combien sont grossiers encore tous ces moyens, quelle lourdeur et quelle inefficacité la plupart du temps dans toute cette mâture ; jusqu’à la vapeur, qui change tout, cet art n’a pas fait un pas depuis deux cents ans. Les deux pauvres navires sortis du port à grand renfort de halage de toute espèce, sont parvenus au dehors, mais sans pouvoir faire un pas. Je les ai dessinés d’abord dans l’état d’immobilité où ils se trouvaient et les ai quittés, de guerre lasse, toujours dans la même situation.
Le libraire m’apprend que les deux derniers volumes de Bragelonne, qui vont continuer par malheur à l’endroit le plus intéressant, lui manquent, et qu’il se propose de les faire venir de Paris. Voici une des tribulations de Dieppe que j’éprouvais encore il y a deux ans en lisant l’histoire de Balsamo. J’ai pris le Provincial à Paris, de Balzac : c’est à lever le cœur ; cela ne peint que les petits détails de l’existence des roués de 1840 à 1847 : détails de coulisse ; ce que c’est qu’un rat, l’histoire du châle Sélim vendu à une Anglaise. Dans une très fameuse préface, l’éditeur met Balzac à côté de Molière, en disant que de son temps, il eût fait les Femmes savantes et le Misanthrope, et que Molière eût fait de notre temps la Comédie humaine. Ce qui lui paraît faire de Balzac un homme à part dans notre temps, c’est qu’au contraire de la plupart des écrivains de ce temps-ci, ses ouvrages portaient le cachet de la durée ; et il nous dit cela en tête de cette rapsodie où il n’est question que des petits mots de l’argot du jour et de toutes ces variétés de figures méprisables, affublées du petit travers du moment, figures et moment dont l’histoire ne gardera pas même de mémoire.
Autre promenade aussi charmante au cours Bourbon avant dîner. Passé le petit pont et été jusqu’au pied des collines dégarnies qui prolongent le Pollet. Admiré toute cette nature et étudié encore dans l’arrière-port les mâtures des navires.
Le soir, à la jetée ; je suis descendu, au clair de lune, m’asseoir sur le galet tout auprès de la mer.
6 septembre. — Le matin, abandonné la jetée pour monter à gauche derrière le château ; suivi jusqu’au cimetière ; auparavant, délicieuse sensation au haut du ravin qu’on avait franchi l’autre jour ; petit sentier remontant de l’autre côté, éclairé par les rayons du matin et s’enfonçant sous l’ombre des hêtres. Entré dans le cimetière, moins repoussant que l’affreux Père-Lachaise, moins niais, moins compassé, moins bourgeois… Tombes oubliées entières sous l’herbe, touffes de rosiers et de clématites embaumant l’air dans ce séjour de la mort ; du reste, solitude parfaite, dernière conformité avec l’objet du lieu et la fin nécessaire de ce qui s’y trouve, c’est-à-dire le silence et l’oubli.
Trouvé, en traversant une grande route, une autre route couverte à la normande, allant à Louval, je crois, qui m’a enchanté : cours de fermes, murailles de simple terre à droite et à gauche, surmontées d’arbres d’un vert sombre et vigoureux. Fleurs, légumes, bétail, dans ces joyeuses retraites ; enfin, tout ce qui charme dans la nature et dans ce qui fait l’homme. Retour moins agréable, grande route poudreuse.
Après le déjeuner, Chenavard venu ; je l’ai emmené voir appareiller le Mariani[887]. Il me dit, ce qui est vrai, que les hommes de talent, chez les modernes, et il parle depuis Jésus-Christ, doivent être plats comme les Delaroche[888], ou biscornus et incomplets. Michel-Ange n’a eu qu’un moment, il s’est répété ensuite ; peu d’idées, par conséquent, mais une force que sans doute personne n’a égalée. Il a créé des types : son Père éternel, ses Diables, son Moïse, et cependant il ne peut faire une tête, même il les abandonne ; c’est par là que pèchent les modernes : Puget et mille autres. Chez les anciens, au contraire, que de types : ce Jupiter, ce Bacchus, cet Hercule, etc. !
Revenu, par une chaleur affreuse, sur le quai, et réellement très abattu et fatigué de ce second excès, après celui du matin. J’étais surmené.
Ce qui caractérise le maître, suivant lui, à propos de Meissonier, c’est, dans le tableau, la vue de ce qui est essentiel, auquel il faut arriver absolument. Le simple talent ne pense qu’aux détails : Ingres, David, etc.
7 septembre. — Sorti de bonne heure avec Jenny, qui va se baigner. Ne trouvant pas d’intérêt à la mer, je gagne le cours Bourbon, que je trouve aussi charmant à cette heure matinale.
En revenant par l’église Saint-Jacques, je vois l’affiche qui annonce pour ce jour même la messe chantée par les chanteurs montagnards ; je m’y trouve exactement, et en ai éprouvé autant de surprise que de plaisir.
Ce sont des paysans, tous des Pyrénées, des voix magnifiques ; on ne voit ni papier de musique, ni batteurs de mesure ; cependant il paraît qu’il y a un de ces hommes en cheveux gris qui est assis et qui probablement les dirige. Ils chantent sans accompagnement. Je n’ai pu m’empêcher, à la sortie, de les suivre et de faire compliment à l’un d’eux. Ils ont, en général, des figures sérieuses. Les enfants m’ont touché. La voix de l’enfant-homme est bien autrement pénétrante que celle des femmes que j’ai toujours trouvée criarde et peu expressive ; il y a ensuite dans ce naïf artiste de huit ou dix ans quelque chose de presque sacré ; ces voix pures s’élevant à Dieu, d’un corps qui est à peine un corps, et d’une âme qui n’a point encore été souillée, doivent être portées tout droit au pied de son trône et parler à sa toute bonté pour notre faiblesse et nos tristes passions.
C’était un spectacle fort touchant pour un simple homme comme moi que celui de ces jeunes gens et de ces enfants sous des habits pauvres et uniformes, formant un cercle, et chantant sans musique écrite et en se regardant. J’ai regretté quelquefois l’absence d’accompagnement. C’était un peu la faute de la musique, belle d’ailleurs et portant le cachet de l’élégance italienne, mais offrant des morceaux trop longs et trop compliqués pour ce chant sans accompagnement, et ces artistes si simples, qui semblaient chanter par inspiration. Au demeurant, une très grande impression et qui m’a rappelé complètement celle des chanteurs de Lucca della Robbia, jusqu’au costume, qui se composait pour tous d’une blouse bleue serrée d’une ceinture. Ces pauvres gens ont chanté à l’Établissement, dans de vrais concerts. Je regretterais de les y voir chantant des airs à la mode et aussi endimanchés sans doute que la damnable musique moderne qu’il faut aux modernes de ces lieux-là.
Rentré après la messe ; fait, dans une mauvaise disposition causée par un maudit cigare, une petite aquarelle inachevée du port rempli d’une eau verte. Contraste, sur cette eau, des navires très noirs, des drapeaux rouges, etc.
Lu la triste Eugénie Grandet : ces ouvrages-là ne supportent guère l’épreuve du temps ; le gâchis, l’inexpérience, qui n’est autre chose que l’imperfection incurable du talent de l’auteur, mettra tout cela dans les rebuts des siècles. Point de mesure, point d’ensemble, point de proportion.
Retourné avant dîner au cours Rourbon, dont je ne puis me lasser : la vue qui est au bout, surtout en prolongeant la promenade jusqu’au pied de la montagne, est ravissante. J’avais envoyé Jenny et Julie au spectacle. La jetée n’était pas tenable à cause du vent, et la mer ne m’offrait point d’intérêt, sauf la grandeur des proportions que donne à la jetée, au sable de la plage, le retrait de la mer.
J’ai été retrouver Chenavard ; nous avons fui la plage à cause du vent, et nous avons été par les rues sur le quai du dernier bassin, où nous sommes restés au clair de la lune jusqu’à onze heures.
Il m’a montré de la sensibilité et de l’estime. Il est malheureux ; il sent qu’il a gaspillé ses facultés. La vie est une viande creuse qui, dans la prétendue connaissance de l’homme, ne lui a pas donné plus de résignation au sujet des maux inévitables, des contradictions et des imperfections de notre nature. Il me semble toujours que cette qualité de philosophe implique, avec l’habitude de réfléchir plus attentivement sur l’homme et sur la vie, celle de prendre les choses comme elles sont, et de diriger vers le bien ou le mieux possible cette vie et nos passions. Eh bien, non ! Tous ces songeurs sont agités comme les autres ; il semble que la contemplation de l’esprit de l’homme, plus digne de pitié que d’admiration, leur ôte cette sérénité qui est souvent le partage de ceux qui se sont attelés à une œuvre plus pratique et à mon avis plus digne d’efforts. J’ai demandé à ce malheureux digne d’estime, pourquoi il était à Dieppe, pourquoi il avait été en Italie et en Allemagne, et pourquoi il y était retourné. Que fuyait-il et qu’allait-il chercher dans toutes ces agitations ? Un esprit porté au doute ne peut que douter davantage, après avoir tout vu.
Il me trouve heureux, et il a raison, et je me trouve bien plus heureux encore, depuis que j’ai vu sa misère. La désolante doctrine sur la décadence nécessaire des arts est peut-être vraie, mais il faut s’interdire même d’y penser.
Il faut faire comme Roland qui jette à la mer, pour l’ensevelir à jamais dans ses abîmes, l’arme à feu, la terrible invention du perfide duc de Hollande ; il faut dérober à la connaissance des hommes ces vérités contestables, qui ne peuvent que les rendre plus malheureux ou plus lâches dans la poursuite du bien. Un homme vit dans son siècle et fait bien de parler à ses contemporains un langage qu’ils puissent comprendre et qui puisse les toucher. Il le fait d’ailleurs en puisant en lui-même son principal attrait sur les imaginations. Ce qui fixe l’attention dans ses ouvrages n’est pas la conformité avec les idées de son temps : cet avantage, si c’en est un, se retrouve dans tous les hommes médiocres, qui pullulent dans chaque siècle et qui courent après la faveur en flattant misérablement le goût du moment ; c’est en se servant de la langue de ses contemporains qu’il doit, en quelque sorte, leur enseigner des choses que n’exprimait pas cette langue, et si sa réputation mérite de durer, c’est qu’il aura été un exemple vivant du goût dans un temps où le goût était méconnu.
Je disais à Chenavard, le jour que nous avons causé sur la jetée de bois, que le goût était ce qui classait les talents. Ce qui fait la supériorité de La Fontaine, de Molière, de Racine, de l’Arioste, sur des Corneille, sur des Shakespeare, sur des Michel-Ange, c’est le goût. Reste à savoir, je n’en disconviens pas, si la force, si l’originalité poussées à un certain degré n’emportent pas, malgré tout, l’admiration. Mais ici revient la possibilité de la discussion et des inclinations particulières.
J’adore Rubens, Michel-Ange, etc., et je disais pourtant à Cousin que je croyais que le défaut de Racine était sa perfection même ; on ne le trouvait pas si beau parce qu’effectivement il est trop beau. Un objet parfaitement beau comporte une parfaite simplicité qui, au premier moment, ne cause pas l’émotion que l’on ressent en présence de choses gigantesques, dans lesquelles la disproportion même est un élément de beauté. Ces sortes d’objets, dans la nature ou dans l’art, seraient-ils effectivement plus beaux ? Non, sans doute, mais ils peuvent impressionner davantage. Qui osera dire que Corneille est plus beau, parce qu’il est plein de bavardages emphatiques et oiseux ; que Rubens est plus beau, parce qu’il offre des parties grossières et négligées ? il faut dire que chez les hommes de cette famille, il y a des parties si fortes que l’on ne pense pas aux défauts et que l’esprit s’y habitue ; mais ne dites pas que Racine ou Mozart sont plus plats, parce que ces mêmes beautés sont partout, qu’elles forment la trame, le tissu même de l’ouvrage. J’ai dit ailleurs que les hommes sublimes remplis d’excentricité étaient comme ces mauvais sujets dont les femmes raffolent : ce sont autant d’enfants prodigues, auxquels on sait gré de certains retours généreux au milieu de leurs déportements. Que dire de l’Arioste, qui est toute perfection, qui réunit tous les tons, toutes les images, le gai, le tragique, le convenable, le tendre ? Mais je m’arrête.
8 septembre. — Un ouvrage parfait, me disait Mérimée, ne devrait pas comporter de notes. Je suis tenté de dire qu’un écrit vraiment écrit et surtout déduit et pensé ne comporte pas même d’alinéas. Si les pensées sont conséquentes, si le style s’enchaîne, il ne comporte point de repos jusqu’à ce que la pensée, qui fait le fond du sujet, soit complètement développée. Montaigne est un illustre exemple de cette nécessité du génie dans ce cas particulier.
Commencé très bien cette journée, c’est-à-dire avec le désir de faire quelque chose ; j’ai écrit sur ce livre jusqu’à onze heures. J’étais fatigué de mes courses de la veille et de mes conversations avec Chenavard. J’ai un grand besoin de repos, et le travail d’esprit m’a reposé effectivement.
Après le déjeuner, je me suis mis avec une ardeur extrême à dessiner les chevaux qui passaient attelés à quatre à des charrettes et dont l’attelage est très pittoresque. Ensuite, j’ai dessiné, en grand, tout l’avant du navire[889] qui est sous la fenêtre. L’esprit rafraîchi par le travail communique à tout l’être un sentiment de bonheur.
C’est dans cette disposition que j’ai été à la jetée et ensuite revenu par le bord de la mer et été au cours Bourbon pour mon dîner avec Chenavard. J’ai cru que nous ferions un bon dîner d’abord, et ensuite que ce dîner serait gai. Le dîner a été détestable, et les lugubres prédictions de mon convive n’en ont pas égayé la durée.
Je crois que la fatalité qui entraîne, selon lui, les choses, s’attache aussi à la possibilité d’une liaison entre nous. Un jour, je suis porté vers lui… le lendemain, ses côtés antipathiques me reviennent. Il me parle des malheurs domestiques de ce pauvre fou de Boissard. Il me dit que Leibnitz ne quittait pas sa table de travail, et souvent dormait et mangeait sans quitter sa chaise. Il m’apprend, contre l’opinion générale, que Fénelon écrivait avec une facilité merveilleuse, et que le Télémaque a été fait en trois mois. Il compare Rousseau à Rembrandt, comparaison qui ne me paraît pas juste.
Je le quitte à dix heures au Puits salé et vais jusqu’à la jetée pour secouer un peu cette obsession. Je vois entrer un beau brick, par la lune et une mer suffisamment agitée. C’est un beau spectacle. Je l’ai suivi, en revenant sur mes pas : la lune était en face et donnait de superbes effets dans l’eau et en détachant la masse et les agrès des bâtiments.
En sortant de chez le traiteur, admiré également au clair de lune les arbres et le fond des montagnes.
Mon diable de compagnon n’exalte jamais que ce qui est hors de notre portée. Kant, Platon, voilà des hommes ! ce sont presque des dieux ! Si je nomme un moderne auquel nous touchions du doigt, il le déshabille à l’instant, me fait toucher ses plaies et ne laisse rien debout… Il n’est pas admiratif, dit-il, et il paraît. Il est intéressant et il repousse. La parfaite vertu ou la parfaite bonne foi peuvent-elles repousser ? Une âme délicate peut-elle loger dans une enveloppe sordide ? S’il prend un dessin pour l’examiner, il le manie, il le retourne sans ménagement, pose ses doigts sur le papier, comme s’il s’agissait du premier objet venu.
Je crois qu’il y a une affectation dans cette espèce de dédain de ce qui demande à être ménagé ; l’âme orgueilleuse et révoltée intérieurement de ce cynique se fait jour, malgré lui, dans ce mépris apparent de la délicatesse commune ; cet esprit a reçu quelque profonde blessure : peut-être ne pouvant se souffrir dans le sentiment de son impuissance, cherche-t-il à se donner le change en ne trouvant qu’impuissance partout ? Il a toutes sortes de talents, et tout cela est mort ; il compose, il dessine, on lui rend froidement justice : c’est tout ce qu’on peut faire. On est étonné dans sa conversation de tout ce qu’il sait et de tout ce qu’il semble ajouter aux idées des autres. Il n’aime pas la peinture, et il en convient. Que n’écrit-il, que ne rédige-t-il ? Il se croit capable de le faire et y a réussi, dit-il, quelquefois ; mais il avoue qu’il lui faut prendre trop de peine pour exprimer ses idées. Cette excuse trahit sa faiblesse. Que ne fait-il comme son admirable Rousseau ? Celui-là avait incontestablement quelque chose à dire, et il l’a dit très bien, malgré la difficulté qu’il trouvait à le faire, et dont il tire presque vanité.
Ai-je écrit ceci sous une impression plus mauvaise qu’à l’ordinaire ? Nullement, car il me plaît ; je l’aime presque et voudrais le trouver plus aimable ; mais j’en suis toujours revenu aux idées que j’exprime ici.
9 septembre. — Mauvaise journée, suite du détestable dîner d’hier, J’ai essayé toute cette matinée de combattre cette mauvaise disposition en travaillant, en écrivant sur ce livre.
Sorti au milieu de la journée pour voir appareiller deux navires, dont l’un était resté longtemps sous ma fenêtre pour se charger de chaux. Revenu très souffrant. Je me suis couché à trois ou quatre heures et suis resté au lit jusqu’au lendemain onze heures.
— Il faut être friand de ce que vous faites.
— Bâtiment espagnol pris par des pirates américains.
10 septembre. — Trouvé Isabey, sa femme et sa fille à la jetée.
Je lis dans des extraits de Dumas : « Les dernières années de Machiavel s’écoulèrent dans la solitude et dans le chagrin. Retiré dans le village de San-Gasciano, il s’entretenait une grande partie de la journée avec des bûcherons, ou jouait au trictrac avec son hôte. Enfin, le 22 juin 1527, il s’éteignit tristement, et l’indépendance italienne expira avec lui. »
11 septembre. — Journée de peu d’intérêt. Je tiens un livre de Dumas, intitulé la Villa Palmier, dans lequel il n’est point question, jusqu’au deuxième volume, de cette villa, mais d’un salmis historique et anecdotique sur Florence.
Le soir, sorti seul vers l’arrière-bassin ; admiré le derrière du château, plus simple à cette heure, et le soleil couché, et plus grand que je ne l’avais encore trouvé. Cette silhouette est magnifique.
12 septembre. — Le matin, à la jetée : la mer toujours basse et peu intéressante.
J’ai remarqué un joli sujet de tableau : c’est un canot apportant sur la plage le poisson d’un petit bateau qu’on voyait au loin ; les hommes amenés à terre sur les épaules de ceux qui avaient mis leurs jambes à l’eau et qui apportaient aussi les paniers remplis de poisson à des femmes. Le canot tiré sur le sable et repoussé ensuite par deux ou trois petits mousses ; les rames en l’air ; le soleil du matin sur tout cela.
Chenavard venu vers onze heures à la maison. Il me dit que les Pensées de Pascal sont faites péniblement et couvertes de ratures.
Acheté le matin le vase russe, qui fuyait. J’ai été le changer vers quatre heures, et me promener. La chaleur m’a forcé de rentrer.
Le soir, parti tard ; nous n’avions dîné qu’à six heures, à cause d’un dérangement dans le fameux fourneau. Pris par la grande rue, vu avec plaisir les boutiques comme je ne les regarde pas à Paris. Tout m’amusait.
Dans le quartier de Saint-Remy, voyant la porte ouverte, je suis entré et ai joui du spectacle le plus grandiose, celui de l’église sombre et élevée, éclairée par une demi-douzaine de chandelles fumeuses placées çà et là. Je demande aux adversaires du vague de me produire une sensation qu’on puisse comparer à celle-là avec de la précision et des lignes bien définies. Si on classe les sentiments divers par ordre de noblesse, comme le fait Chenavard, on pourra à son gré se décider pour un dessin d’architecture ou pour un dessin de Rembrandt.
Sorti de là enchanté ; désolé de la difficulté de rendre, sans prendre sur nature, non pas le sentiment, mais les lignes et perspectives compliquées, projections d’ombres, etc., qui faisaient de ce que j’ai vu le plus magnifique tableau.
Pris par les bains, la plage. Écho lointain de l’ignoble musique de l’établissement, pendant que la lune se levait de l’autre côté. Je suis resté sur la plage pendant plus d’une heure, ravi de ma soirée paisible et de la tranquillité qu’elle communiquait à mes esprits.
J’ai été rejoindre Jenny à la jetée vers dix heures.
Chenavard me raconte l’histoire de Papety[890], au club des Versaillais… Un de ces messieurs monte à la tribune et dit avec l’accent du terroir et d’une voix de tonnerre : « Citoyens ! » Après un moment de silence, il répète encore son : « Citoyens ! » et après une nouvelle pause, et regardant son auditoire : « Citoyens ! je ne sais plus ce que je voulais vous dire », et il se retire. Un voisin de Papety s’adresse à lui et lui dit d’un air pénétré : « C’est bien heureux que nous soyons ici en famille ! »
13 septembre. — Entré le soir dans Saint-Remy une seconde fois.
14 septembre. — Je m’obstine sottement à sortir le matin, et je m’en trouve toujours mal.
Vu Isabey à la jetée. Il me parle de la cherté des voyages par la vapeur et m’explique l’hélice. Il vient avec moi jusqu’à la plage, où j’espérais rencontrer Chenavard.
Pluie et rentré chez moi, où je suis resté à lire et à dormir jusqu’à deux heures et demie.
A la jetée, où la mer était très belle ; mais pluie affreuse.
Après dîner, entré à Saint-Jacques, où il y avait une cérémonie. Le prêtre en chaire lisait les divers moments de la Passion avec réflexions ; il était interrompu à temps égaux par un cantique entonné par les chantres et répété par tout le monde. Le curé, avec la croix et ses chantres, s’agenouillait et priait à chaque station. Il a donné à baiser à la fin à tout le monde la patène ou le crucifix. — On ferait un joli tableau de ce dernier moment, pris de derrière l’autel.
Il y avait, dans ce que disait ce prêtre en chaire, avec sa voix traînante, et avec aussi peu de chaleur que s’il eût répété une leçon, bon nombre de choses dont on peut faire son profit. Il disait, entre autres choses, qu’il était toujours temps d’abandonner la mauvaise voie pour prendre la bonne, etc.
Effets magnifiques dans cette église peu éclairée, mais je préfère Saint-Remy, où je suis retourné un instant, quand la pluie affreuse, qui n’avait pas cessé pendant que j’étais à l’église, eut cessé.
— De l’utilité qu’on peut retirer de ses amis : tel est, je crois, le titre de l’un des traités de Plutarque. Un courtisan ou seulement un homme du monde occupé à se pousser et à faire sa carrière, ne s’informerait sans doute pas de ce que le bon Plutarque a entendu faire dans son traité. Pour ces hommes-là il n’y a qu’une manière de tirer parti de ses amis : c’est d’abord de les avoir puissants et ensuite de les faire intriguer pour soi ou de s’accrocher à leur fortune. Qu’importe l’estime qu’ils peuvent mériter en dehors de cela ? Qu’importe celle qu’on peut concevoir de soi-même, d’être accueilli et aimé par des hommes d’une grande vertu et d’un grand caractère ? C’est cependant à ce genre d’utilité qu’il faut de toute sa force s’attacher dans toute espèce de liaison. La fréquentation des honnêtes gens non seulement nous confirme dans les sentiments de droiture, mais nous apprend à ne point estimer les biens qu’on n’acquiert qu’en s’écartant de la stricte délicatesse. On apprend ainsi à ne négliger aucun des devoirs essentiels.
15 septembre. — David disait à cet homme qui le fatiguait d’une conversation sur les procédés, les manières, etc., de toutes sortes : « J’ai su tout cela quand je ne savais encore rien. »
Chenavard venu chez moi pendant que je dessine des bateaux[891], et presque aussitôt Isabey… Singulier rapprochement que celui de ces deux hommes. J’ai continué mon dessin pour être plus à mon aise.
En sortant avec le premier des deux, et pendant qu’il m’expliquait son système de Paris port de mer, les soldats faisant l’exercice à feu ont attiré mon attention, et je me sais gré d’avoir un moment déserté la conversation de mon compagnon pour aller voir ces malheureux.
Je n’avais jamais conçu de la profession de soldat l’idée que j’en ai prise dans ce moment. C’est celui d’un mépris mêlé d’indignation pour les brutes qui ont appelé un art celui d’égorger, et d’une profonde pitié pour ces moutons habillés en loups, dont le métier, comme dit si bien Voltaire, est de tuer et d’être tués pour gagner leur vie. Cette opération machinale de charger une arme, de lancer cette foudre terrible qui éclate entre leurs mains, sans qu’ils aient l’air de se douter de ce qu’ils font, forme un triste spectacle pour un cœur qui n’est pas tout à fait de pierre. Il eût révolté d’une autre façon des hommes comme Alexandre et César, si on leur eût dit que ces automates, abaissant méthodiquement leur fusil et les déchargeant au hasard, sont des gens qui se battent… Où est la force, où est l’adresse dans ce stupide jeu ? la force, le courage, pour attaquer, presser, défaire un farouche ennemi, l’adresse pour se préserver soi-même de ses coups ? Quoi ! vous venez vous planter devant un autre animal tout aussi intimidé que vous, et à distance raisonnable, vous vous envoyez philosophiquement des balles de plomb et de fer, sans aucune défense contre ces coups qui vous sont renvoyés, et vous persuadez à votre troupeau à plumets et à épaulettes que c’est là se couvrir de gloire ! Cette malheureuse profession est faussée dans son principal objet. L’héroïsme consiste à approcher l’ennemi, de manière que le courage personnel serve à quelque chose. Recevoir passivement les coups de l’artillerie est le fait du lâche aussi bien que du brave ; celui-ci s’indigne d’être traité comme un mur ou un bastion de terre ; il n’a pas plus de mérite que la foule des peureux qui, près de lui, attendent la mort ou la fin d’une action qui doit les délivrer de la crainte. Cette masse intimidée qui envoie et reçoit les coups de fusil devient ainsi, par un renversement de rôles, la seule force des armées modernes ; c’est par sa masse qu’elle opère. Le courage des hommes d’action devient presque inutile. Il se glace au contraire dans cette humiliante situation ; que faire de cette colère qui s’empare naturellement d’un cœur impétueux, lorsqu’il voit tomber près de lui son compagnon, lorsque le son des trompettes et le bruit de l’artillerie l’excitent à la vengeance ?
Je regrette de ne pouvoir me faire une idée nette de ce qu’on appelle une charge de cavalerie. J’ai toujours entendu citer cette sorte de mouvement comme une espèce de plaisanterie, dans laquelle les rôles sont fixés pour ainsi dire à l’avance, c’est-à-dire que si l’infanterie, ou le corps sur lequel on charge paraît trop résolu, on ne fait en quelque sorte que le simulacre de l’attaque ; on garde son courage pour une meilleure occasion ou pour des ennemis moins disposés à la résistance.
La vue de ces feux de peloton, de ces feux de deux rangs, dont les coups précipités ne peuvent avoir de certitude, m’a semblé un mauvais moyen de nuire à l’ennemi, sans parler, comme je le disais, de l’inutilité où on laisse le courage et la vigueur. Il me semble que des tirailleurs, réunis en petits pelotons seulement, exercés au tir, mais en même temps à se réunir promptement pour attaquer de près avec impétuosité, auraient plus d’effet que ces murailles de chair, qui renvoient au hasard et de loin des coups précipités et sans justesse. On leur substituera immanquablement, à ces derniers, des machines dont l’action sera plus calculée et plus meurtrière ; déjà une foule d’inventions se pressent d’écraser en quelques minutes un corps entier, d’asphyxier en un clin d’œil braves et poltrons. Tous ces moyens ne feront qu’annihiler de plus en plus la bravoure personnelle et métamorphoser tout à fait le métier de soldat en celui de mécanicien. Pour utiliser, au contraire, le courage individuel, il faudrait de véritables corps d’élite, non pas choisis sur des hommes de belle apparence, comme on fait d’ordinaire, mais parmi les courages les plus éprouvés. L’attaque brusque et à la baïonnette d’un tel corps au milieu de cette mousqueterie à distance, serait, je crois, d’un effet prodigieux.
— Étrange chose que la peinture, qui nous plaît par la ressemblance des objets qui ne sauraient nous plaire[892] !
16 septembre. — A midi, parti pour Arques par un charmant soleil, rafraîchi par un vent agréable. Beauté de la campagne et des collines à droite, couvertes d’arbres et d’habitations. Grande chaleur, une fois arrivés.
J’ai fait un croquis de l’église, dont j’avais conservé un très joli souvenir. Je n’étais pas très bien disposé, et les ruines du château m’ont laissé froid.
Le retour a été le plus agréable moment : la route s’était embellie encore au soleil couchant. Indescriptible sensation de plaisir de ce soleil, de cette verdure, de ces prairies, de ces troupeaux. Il était six heures et demie quand nous avons été de retour.
17 septembre. — Chenavard venu vers onze heures. Il m’a parlé avec confiance, du moins je le pense, de sa situation d’esprit, du contraste de l’estime qu’il pense qu’on lui refuse et du mérite qu’il pense avoir et que je lui reconnais véritablement. Il se sait peu aimé ; on lui reproche son excessive sévérité pour les autres, en le voyant donner peu de preuves de talent et d’activité. Cette défiance, ce découragement qu’il confesse, me paraissent, comme à lui, la cause de son peu de succès : il est le premier à abandonner sa cause. Comment intéresserait-il au même degré que des esprits doués aussi d’élévation, mais en même temps de l’énergie qu’on puise dans le désir et l’assurance d’arriver au premier rang ? Il ne trouve pas que Géricault soit un maître ; il lui trouve quelque chose de noué. C’est un jeune homme très brillant, et il ne croit pas qu’il eût été rien de plus. Il donne de bonnes raisons tirées de l’insignifiance comme tableau, de la prédominance de la pose, du détail, quoique traité avec force.
(Je relis ce qui concerne ici Géricault[893], six mois après, c’est-à-dire le 24 mars 1855, pendant l’état de langueur où je me trouve avant l’Exposition ; hier, j’ai revu des lithographies de Géricault, chevaux, lion même, etc., tout cela est froid, malgré la supériorité avec laquelle les détails sont traités ; mais il n’y a jamais d’ensemble en rien. Il n’y a pas un de ces chevaux qui n’ait des parties qui grimacent, ou trop petites ou mal attachées ; jamais un fond qui ait le moindre rapport avec le sujet.)
Je rencontre avant dîner Mme Manceau, qui m’offre de me mener demain voir la forêt d’Arqués.
Dîné assez tristement. Dédommagé sur la plage par un soleil couchant dans des bandes de nuages rouges et dorés sinistrement, se réfléchissant dans la mer, sombre partout où ce reflet ne se portait pas. Je suis resté plus d’une demi-heure immobile sur le sable et touchant aux vagues, sans me lasser de leur fureur, de leur retour, de cette écume, de ces cailloux roulants.
Ensuite sur la jetée, où il faisait un vent du diable. Rôdé dans les rues après avoir pris du thé et couché à dix heures.
18 septembre. — J’ai passé une partie de la nuit sans dormir, et l’état où je me trouvais n’avait rien de désagréable. La puissance de l’esprit est incroyable la nuit. J’ai pensé à la conversation d’hier sur l’esprit et la matière.
Dieu a mis l’esprit dans le monde comme une des forces nécessaires. Il n’est pas tout, comme le disent ces fameux idéalistes et platoniciens ; il y est comme l’électricité, comme toutes les forces impondérables qui agissent sur la matière.
Je suis composé de matière et d’esprit : ces deux éléments ne peuvent périr.
J’ai écrit toute la matinée des brouillons faisant suite à mes réflexions qui sont ici sur l’état militaire. Sorti allègrement. Vu à la jetée de fort belles vagues. J’ai trouvé là, je crois, Isabey.
A une heure, chez Mme Manceau. Elle m’a mené dans sa voiture par Arques, la forêt et Saint-Martin l’Église. Très beau temps, mais assez froid, et la nécessité de soutenir la conversation devenue fatigante. J’ai moins joui de toutes les belles choses que j’ai vues. Magnifique vallée dans le genre de celle de Valmont, et plus grande au sortir de la forêt. Cette forêt très originale ; ce sont des hêtres, pour la plupart, qui forment des colonnades sur des fonds sombres. Il est fâcheux que ce ne soit pas plus près.
Le soir, trouvé Chenavard à sept heures. Il m’a mené chez lui, pour reprendre les photographies que je lui ai prêtées. Toujours sur la prééminence de la littérature, pour laquelle il tient bon. Aussi sur la métaphysique. Il me dit que je suis de la famille des Napoléon…, des gens qui ne voient qu’idéologies dans ceux qui ne sont pas des hommes d’action.
Conversation sur le style. Il croit que c’est quelque chose à retrancher de la manière commune. Il me croit partial. Il m’avait raconté sur la plage des anecdotes sur Voltaire, son évasion de Berlin, etc. Il me quitte le soir, prévoyant qu’il partira le lendemain.
19 septembre. — Chenavard devait être parti aujourd’hui, si je ne le voyais dans la journée. Il n’est pas content de sa santé.
Assez bonne journée, en somme, dont je ne me rappelle pas les détails[894].
20 septembre. — Nous avons été à Eu. Rien n’égale mon ravissement pendant une ou deux heures, en partant ; je jouis des moindres détails de la nature, comme dans la première jeunesse. J’écrivais à travers les cahots ce qui me venait.
Eu ne m’a pas causé de sensations agréables, si ce n’est, avant d’aller visiter l’église, un sentiment de liberté, de bien-être.
Tombeaux des comtes d’Eu. Pièces d’artillerie au-dessus du banc d’œuvre.
Visité le château. Impossible d’exprimer mon aversion de cet affreux goût : peinture, architecture, ornements, jusqu’aux bornes qui sont dans la cour, tout cela est affreux ; le pauvre jardin est comme le reste. La vue du château sur cette église restaurée, si froide, si nue ; l’entrée étroite, entre l’église et les communs, révolte les convenances et le sens commun. Que Dieu pardonne au pauvre roi, homme si admirable d’ailleurs, ses prédilections en matière d’art ! Tout respire ici Fontaine, l’Institut, Picot, etc.
Tréport m’a paru bien triste ; il est devenu plus coquet, et il y a perdu. Une grande vilaine caserne régulière, des forts élevés sur le rivage où il n’y a rien à défendre, la nudité de tout cela, la misérable vie que doivent mener là ces baigneurs, des hommes graves réduits à grimper à l’église et à en redescendre, des élégantes portant la mode du Tréport, c’est-à-dire des vestes rouge écarlate, voilà ce que présente le pauvre lieu pour attirer. On a construit sur la plage des maisons dont la recherche outrée contraste avec la pauvreté de l’endroit : galeries vitrées, petits boulingrins, etc.
Dîné sur le quai, chez un M. Letraistre, qui méritait bien son nom, par le mauvais dîner qu’il m’a fait payer très cher.
Monté, après dîner, à l’église ; on a, avant d’y entrer, une belle vue.
Querelle avec le cocher avant de partir ; il ne se souvenait plus, à ce qu’il disait, des conditions.
Retour dans l’obscurité, la pluie et quelques désagréments. J’ai revu Dieppe comme on revoit sa patrie.
— Remarqué dans les caveaux que la coiffure d’une des comtesses d’Eu est la même que celle des femmes du Tréport, sauf les perles et l’étoffe : c’est une espèce de callot, mais très gracieux. Le costume des femmes, au Tréport, est charmant : simple corsage, jupe double ; on en voit une en dessous, au bas ; manches de la chemise larges jusqu’au coude.
21 septembre. — Resté assez tard à la maison et dessiné de ma fenêtre les bateaux qui entraient et sortaient.
A ma sortie, vers une heure, dessiné le bateau qu’on flambait de l’autre côté du pont[895], et promené avec un vif sentiment de plaisir. Il semble qu’on passerait sa vie dans cette douce oisiveté. Avant dîner, dessiné à Saint-Jacques, de derrière l’autel. Après dîner, pris par les bassins jusqu’au château, dont la vue prise par derrière, qui m’avait paru superbe, ne m’a rien dit du tout. A la vérité, le ciel n’était peut-être pas tout à fait le même. Promené sur la plage en attendant le moment d’aller chez Mme Manceau qui venait de partir pour aller au spectacle. De là, à Saint-Remy et à Saint-Jacques.
— Le monde n’a pas été fait pour l’homme.
L’homme domine la nature et en est dominé. Il est le seul qui non seulement lui résiste, mais en surmonte les lois, et qui étende son empire par sa volonté et son activité. Mais que la création ait été faite pour lui, c’est une question qui est loin d’être évidente. Tout ce qu’il édifie est éphémère comme lui ; le temps renverse les édifices, comble les canaux, anéantit les connaissances et jusqu’au nom des nations. Où est Carthage ? où est Ninive ?
Les générations, dira-t-on, recueillent l’héritage des générations précédentes. À ce compte-là, la perfection ou le perfectionnement n’aurait pas de bornes. Il s’en faut beaucoup que l’homme reçoive intact le dépôt des connaissances que les siècles voient s’accumuler ; s’il perfectionne certaines inventions, pour d’autres, il reste fort en arrière des inventeurs ; un grand nombre de ces inventions sont perdues. Ce qu’il gagne d’un côté, il le perd de l’autre.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien certains perfectionnements prétendus ont nui à la moralité ou même au bien-être. Telle invention, en supprimant ou en diminuant le travail et l’effort, a diminué la dose de patience à endurer les maux et l’énergie pour les surmonter qu’il est donné à notre nature de déployer. Tel autre perfectionnement, en augmentant le luxe et un bien-être apparent, a exercé une influence funeste sur la santé des générations, sur leur valeur physique, et a entraîné également une décadence morale. L’homme emprunte à la nature des poisons, tels que le tabac et l’opium, pour s’en faire des instruments de grossiers plaisirs. Il en est puni par la perte de son énergie et par l’abrutissement. Des nations entières sont devenues des espèces d’ilotes par l’usage immodéré de ces stimulants et par celui des liqueurs fortes.
Arrivées à un certain degré de civilisation, les nations voient s’affaiblir surtout les notions de vertu et de valeur. L’amollissement général, qui est probablement le produit du progrès des jouissances, entraîne une décadence rapide, l’oubli de ce qui était la tradition conservatrice, le point d’honneur national. C’est dans une semblable situation qu’il est difficile de résister à la conquête. Il se trouve toujours quelque peuple affamé à son tour de jouissances, ou tout à fait barbare, ou ayant encore conservé quelque valeur et quelque esprit d’entreprise, pour profiter des dépouilles des peuples dégénérés. Cette catastrophe, facilement prévue, devient quelquefois une sorte de rajeunissement pour le peuple conquis. C’est un orage qui purifie l’air, après l’avoir troublé ; de nouveaux germes semblent apportés par cet ouragan dans ce sol épuisé ; une nouvelle civilisation va peut-être en sortir, mais il faudra des siècles pour y voir refleurir les arts paisibles destinés à adoucir les mœurs et à les corrompre de nouveau, pour amener ces éternelles alternatives de grandeur et de misère dans lesquelles n’apparaît pas moins la faiblesse de l’homme, aussi bien que la singulière puissance de son génie.
22 septembre. — Dessiné quelques bateaux qui rentraient et été à la jetée, où la mer était très belle, et où j’ai vu entrer et sortir nombre de barques, un joli yacht anglais, une goélette, etc.
Revenu tard et dormi après déjeuner. Petite aquarelle avant dîner d’un brick anglais et de barques envasées devant le Pollet, en face de mes fenêtres. Après dîner, promené sur la jetée par la mer basse. J’y étais presque toujours seul.
Chez Manceau ensuite. Commérages insipides ; envie furieuse de m’en aller. Air charmant de Solié, du Secret[896], chanté par la maîtresse de la maison. Cet air était chanté dans l’opera par Martin[897].
Cette nuit, je retourne dans ma tête le Cogito, ergo sum, de Descartes.
23 septembre. — Sur le silence et les arts silencieux. — Le silence impose toujours : les sots eux-mêmes lui emprunteraient souvent un air respectable. Dans les affaires, dans les relations de toute espèce, les hommes assez sages pour l’observer à propos lui doivent beaucoup. Rien n’est plus difficile que cette retenue pour ceux que l’imagination domine, pour les esprits subtils, qui voient facilement toutes les faces des choses et qui résistent avec plus de peine à exprimer ce qui se passe en eux : propositions jetées témérairement, promesses imprudentes faites sans réflexion, mots piquants hasardés sur des personnages plus ou moins dangereux et redoutables, confidences faites par entraînement et souvent au premier venu ; l’énumération serait longue des inconvénients et des dangers qui résultent des indiscrétions de toutes sortes.
On n’a qu’à gagner au contraire en écoutant. Ce que vous vouliez dire à votre interlocuteur, vous le savez, vous en êtes plein ; ce qu’il a à vous dire, vous l’ignorez sans doute : ou il vous apprendra quelque chose de nouveau pour vous, ou il vous rappellera quelque chose que vous avez oublié.
Mais comment résister à donner de son esprit une idée avantageuse à un homme surpris et charmé, en apparence, de vous entendre ? Les sots sont bien plus facilement entraînés à ce vain plaisir de s’écouter eux-mêmes en parlant aux autres ; incapables de profiter d’une conversation instructive et substantielle, ils pensent moins à instruire leur interlocuteur qu’à l’éblouir ; ils sortent satisfaits d’un entretien dans lequel ils n’ont recueilli, pour prix de l’ennui qu’ils ont causé, que le mépris des hommes de bon sens. La taciturnité chez un sot serait déjà un signe d’esprit.
J’avoue ma prédilection pour les arts silencieux[898], pour ces choses muettes dont Poussin disait qu’il faisait profession. La parole est indiscrète ; elle vient vous chercher, sollicite l’attention et éveille en même temps la discussion. La peinture et la sculpture semblent plus sérieuses : il faut aller à elles. Le livre, au contraire, est importun ; il vous suit, vous le trouvez partout. Il faut tourner les feuillets, suivre les raisonnements de l’auteur et aller jusqu’au bout de l’ouvrage pour le juger. Combien n’a-t-on pas regretté souvent l’attention qu’il a fallu prêter à un livre médiocre pour un petit nombre d’idées répandues çà et là et qu’il faut démêler ! La lecture d’un livre qui n’est pas tout à fait frivole est un travail : il cause au moins une certaine fatigue ; l’homme qui écrit semble prêter le collet à la critique. Il discute et on peut discuter avec lui.
L’ouvrage du peintre et du sculpteur est tout d’une pièce comme les ouvrages de la nature. L’auteur n’y est point présent, et n’est point en commerce avec vous, comme l’écrivain ou l’orateur. Il offre une réalité tangible en quelque sorte, qui est pourtant pleine de mystère. Votre attention n’est pas prise pour dupe ; les bonnes parties sautent aux yeux en un moment ; si la médiocrité de l’ouvrage est insupportable, vous en avez bien vite détourné la vue, tandis que celle d’un chef-d’œuvre vous arrête malgré vous, fixe dans une contemplation à laquelle rien ne vous convie qu’un charme invincible. Ce charme muet opère avec la même force, et semble s’accroître toutes les fois que vous y jetez les yeux.
Il n’en est pas tout à fait ainsi d’un livre. Les beautés n’en sont pas assez détachées pour exciter constamment le même plaisir. Elles se lient trop à toutes les parties qui, à cause de l’enchaînement et des transitions, ne peuvent offrir le même intérêt. Si la lecture d’un bon livre éveille nos idées, et c’est une des premières conditions d’une semblable lecture, nous les mêlons involontairement à celles de l’auteur ; ses images ne peuvent être si frappantes que nous ne fassions nous-mêmes un tableau à notre manière à côté de celui qu’il nous présente. Rien ne le prouve mieux que le peu de penchant qui nous entraîne vers les ouvrages de longue haleine. Une ode, une fable présentera les mérites d’un tableau qu’on embrasse tout d’un coup. Quelle est la tragédie qui ne lasse ? À bien plus forte raison un ouvrage comme l’Émile ou l’Esprit des lois.
— Resté toute la matinée dans une mauvaise disposition. Acheté les tableaux et des ivoireries. Rentré à la maison, où je me suis mis sur mon lit.
Retourné à Saint-Remy, que j’ai dessiné, quoique j’eusse oublié mes lunettes.
Dîné à six heures ; la nuit vient à cette heure. Le soir, erré et promené.
26 septembre. — Parti de Dieppe. — Le matin j’ai été faire mes adieux à la jetée ; j’ai fait un croquis de la vue de la plage et du château. Le temps était magnifique et la mer calme et azurée.
Je retrouve au chemin de fer Chenavard, qui était resté à Dieppe tout ce temps-là, malade ou occupé, me croyant, disait-il, parti.
Arrivé à cinq heures. — Paris me cause toujours la même antipathie.
27 septembre. — Passé la journée à commencer un rangement dans les dessins et gravures.
28 septembre. — En regardant ce matin le petit Saint Sébastien[899] sur papier au pastel, comparé à des pastels empâtés et sur papier sombre, j’ai été frappé de l’énorme différence pour la lumière et la légèreté. En comparant également la peinture flamande à la peinture vénitienne, il est facile d’apprécier sa légèreté.
Demander en temps et lieu à M. Ledoux une recommandation pour aller à Alfort étudier les chevaux.
30 septembre. — Article dans le Moniteur du 12 octobre sur des Chasses au lion ; c’est le second. Rechercher le premier.
1er octobre. — Ce jour, dimanche 1er octobre, j’ai été voir Durieu pour parler de la pétition des Pierret.
J’y trouve M. Charton le père[900], qui me conseille, quand j’irai de Milan à Venise[901], de m’arrêter un jour à Vérone, un jour à Vicence, un jour à Padoue, et de ne voir Venise qu’ensuite. C’est de Gênes qu’il me conseille de prendre, par Lucques, une espèce de voiture de poste pour aller à Pise, Sienne, etc. ; il parle avec grands éloges des paysages.
— Barbotte me conte qu’on peut féconder la vigne au moyen d’abeilles, qu’on porte auprès, quand la pluie a détrempé le pollen. Il me dit qu’à Lima il ne pleut jamais ; aussi tout y est aride.
— Chenavard me dit, à propos de mes idées sur la peinture, que je donne l’exemple et le précepte, et admirablement, dit-il. Il admire beaucoup, au Luxembourg, certaines peintures qui lui paraissent faire ressortir la platitude des autres… « Je me demande quelquefois, dit-il encore, s’il sait bien lui-même tout ce qu’il met dans ces ouvrages-là[902]. »
2 octobre. — A Saint-Sulpice de bonne heure. Travaillé à redessiner l’Héliodore renversé.
Été à pied porter la lettre de remerciements au préfet de police, ensuite aux canaux, et rentré.
A cinq heures et demie, trouvé à la Rotonde Varcollier et dîné ensemble chez Véry. Le vin y était plus mauvais qu’à Dieppe. Restés ensemble au café de la Rotonde, nous promenant dans le jardin, etc. Il m’avait conduit chez l’opticien.
— V… est aimable pour moi, et je suis touché de son empressement. Malheureusement, ce que j’appelais l’amitié est une passion que je ne ressens plus au même degré, et il est surtout bien tard pour la faire renaître. Excepté un seul être au monde qui fait véritablement battre mon cœur, le reste me fatigue vite et ne laisse pas de traces.
3 octobre. — A Sémiramis, le soir, avec Mme de Forget.
Remis ce matin à M. Pothey, graveur sur bois, le dessin sur papier végétal du Christ au tombeau, de Saint-Denis du Saint-Sacrement.
4 octobre. — J’ai compris de bonne heure combien une certaine fortune[903] est indispensable à un homme qui est dans ma position. Il serait aussi fâcheux pour moi d’en avoir une très considérable qu’il le serait d’en manquer tout à fait. La dignité, le respect de son caractère ne vont qu’avec un certain degré d’aisance. Voilà ce que j’apprécie et qui est absolument nécessaire, bien plus que les petites commodités que donne une petite richesse. Ce qui vient tout de suite après cette nécessité de l’indépendance, c’est la tranquillité d’esprit, c’est d’être affranchi de ces troubles et de ces démarches ignobles, qu’entraînent les embarras d’argent. Il faut beaucoup de prudence pour arriver à cet état nécessaire et pour s’y maintenir ; il faut avoir sans cesse devant les yeux la nécessité de ce calme, de cette absence des soucis matériels, qui permet d’être tout entier à des tentatives élevées, et qui empêche l’âme et l’esprit de se dégrader.
Ces réflexions résultent de ma conversation de ce soir avec ***, qui est venu me voir après mon dîner, et de ce qu’il m’a rapporté de la situation des Pierret. La sienne ne me paraît pas, dans l’avenir et peut-être maintenant, beaucoup meilleure. Il a été un fou toute sa vie ; il y a un fonds de bon sens dans son esprit, et il en a toujours manqué dans sa conduite.
Ce bon sens si rare me sert de transition pour parler de ma visite de ce matin à Chenavard. En voilà encore un qui est ou qui semble rempli de sens, quand il parle, quand il démontre, quand il compare ou qu’il déduit. Ses compositions d’une part, et ses prédilections de l’autre, donnent un démenti à cette sagesse. Il aime Michel-Ange, il aime Rousseau : ces talents et quelques autres très imposants sont de ceux qui sont surtout très admirés des jeunes gens. Les hommes à la Racine, à la Voltaire, sont admirés des esprits mûrs, et le sont toujours davantage.
Je ne peux attribuer cette différence dans l’estime qu’on en fait à différents âges, qu’au défaut de raison qu’on remarque chez ces auteurs boursouflés, à côté de leurs grandes qualités. Il y a chez Rousseau quelque chose qui n’est pas naturel, qui sent l’effort et qui accuse un esprit dans lequel se combattent le faux et le vrai. Je soutiens qu’un vrai grand homme ne contient pas une parcelle de faux : le faux, le mauvais goût, l’absence de vraie logique, ce sont mêmes choses.
Chenavard m’a montré à l’appui de ses théories, et pour justifier les intentions de sa composition du Déluge[904], un immense carton de toutes les gravures qu’il a pu se procurer d’après Michel-Ange. Il m’a confirmé dans mon sentiment au lieu de m’en détourner. Je lui ai dit que le Jugement dernier, par exemple, ne me disait rien du tout. Je n’y vois que des détails frappants, frappants comme un coup de poing qu’on reçoit ; mais l’intérêt, l’unité, l’enchaînement de tout cela est absent. Son Christ en croix ne me donne aucune des idées qu’un pareil sujet doit exciter ; ses sujets de la Bible de même.
Titien, voilà un homme qui est fait pour être goûté par les gens qui vieillissent ; j’avoue que je ne l’appréciais nullement dans le temps où j’admirais beaucoup Michel-Ange et lord Byron[905]. Ce n’est, à ce que je crois, ni par la profondeur de ses expressions, ni par une grande intelligence du sujet qu’il vous touche, mais par sa simplicité et par l’absence d’affectation. Les qualités du peintre sont portées chez lui au plus haut point : ce qu’il fait est fait ; les yeux regardent et sont animés du feu de la vie. La vie et la raison sont partout. Rubens est tout autre avec un tout autre tour d’imagination, mais il peint véritablement des hommes. Ils ne sont tous deux hors de mesure que quand ils imitent Michel-Ange et qu’ils veulent se donner un prétendu grandiose qui n’est que de l’enflure et dans laquelle les vraies qualités se noient ordinairement.
La prétention de Chenavard pour son cher Michel-Ange est qu’il a peint l’homme avant tout, et je dis qu’il n’a peint que des muscles, des poses dans lesquelles même la science, contre l’opinion commune, ne domine nullement. Le dernier des antiques est infiniment plus savant que tout l’œuvre de Michel-Ange. Il n’a connu aucun des sentiments, aucune des passions de l’homme. Il semble qu’en faisant un bras et une jambe, il ne pense qu’à ce bras et à cette jambe, pas le moins du monde à son rapport, je ne dirai pas seulement avec l’action du tableau, mais avec celle du personnage auquel il fait le membre…
Il faut convenir que certains morceaux traités ainsi et avec cette prédilection exclusive sont faits pour passionner à eux seuls. C’est là son grand mérite : il met du grand et du terrible même dans un membre isolé. Puget[906], avec un caractère différent, a en cela une analogie avec lui. Vous resterez une journée à contempler un bras de Puget, et ce bras fait partie d’une statue médiocre en somme. Quelle est la raison secrète de ce genre d’admiration ? C’est ce que je ne me charge pas d’expliquer.
Nous avons parlé des règles de la composition. Je lui ai dit qu’une absolue vérité pouvait donner l’impression contraire à la vérité, au moins à cette vérité relative que l’art doit se proposer ; et en y pensant bien, l’exagération qui fait ressortir à propos les parties importantes et qui doivent frapper est toute logique ; il faut, là, conduire l’esprit. Dans le sujet de Mirabeau[907] à la protestation de Versailles, je lui ai dit que Mirabeau et l’Assemblée devaient être d’un côté et l’envoyé du Roi tout seul de l’autre. Son dessin, qui montre des groupes agencés et balancés, des poses variées, des hommes causant entre eux d’une manière naturelle et comme il a pu arriver dans cette circonstance, est bien disposé pour l’œil et suivant les règles matérielles de la composition ; mais l’esprit n’y voit nullement l’Assemblée nationale protestant contre l’injonction de M. de Brézé. Cette émotion qui anime toute une assemblée comme elle animerait un seul homme, doit être exprimée absolument. La raison veut que Mirabeau soit à leur tête et que les autres se pressent derrière lui, attentifs à ce qui se passe : tous les esprits, comme celui du spectateur, sont fixés sur l’événement. Sans doute, au moment où le fait a eu lieu, Mirabeau ne s’est pas trouvé à point nommé placé comme au milieu du tableau ; la venue de M. de Brézé n’a peut-être pas été annoncée de manière à trouver l’Assemblée réunie en un seul groupe pour le recevoir et en quelque sorte pour lui faire tête ; mais le peintre ne peut exprimer autrement cette idée de résistance : l’isolement du personnage de Brézé est indispensable. Il est venu, sans aucun doute, avec des suivants et des estafiers, mais il doit s’avancer seul et les laisser à distance. Chenavard commet l’incroyable faute de les faire arriver d’un côté, tandis que Brézé arrive de l’autre et se trouve confondu avec ses adversaires. Dans cette scène si caractéristique où le trône est d’une part et le peuple de l’autre, il place au hasard Mirabeau du côté où se voit le trône, sur lequel, autre inconvenance, montent des ouvriers pour décrocher les draperies. Il fallait que le trône fût aussi isolé, aussi abandonné qu’il l’était alors moralement par tout le monde et par l’opinion, et surtout il fallait que l’Assemblée lui fît face.
5 octobre. — Redemander à Riesener une gravure de Clélie que je lui ai prêtée il y a plusieurs années. Passé la journée sans sortir qu’après dîner et après avoir dormi.
Se sentir enseveli dans les papiers qui parlent, je veux dire les dessins, les ébauches, les souvenirs ; lire deux actes de Britannicus, en s’étonnant chaque fois davantage de ce comble de perfection ; l’espoir, je n’ose dire la certitude, de n’être pas dérangé ; un peu ou beaucoup de travail, mais surtout la sécurité dans la solitude, voilà un bonheur qui, dans beaucoup de moments, paraît supérieur à tous les autres. On jouit alors complètement de soi ; rien ne vous presse, rien ne vous sollicite de tout ce qui est en dehors d’un cercle studieux où, satisfait de peu, je veux dire peu de ce qui plaît à la foule, mais aspirant, au contraire, à ce qu’il y a de plus grand par la contemplation intérieure ou par la vue des chefs-d’œuvre de tous les temps, je ne me sens ni accablé du poids des heures, ni effrayé de leur rapidité. C’est une volupté de l’esprit, un mélange délicieux de calme et d’ardeur que les passions ne peuvent donner.
(Rapporter ceci à ce que je dis à Ems sur la nécessité de jouir de soi avant tout.)
7 octobre. — Je ne sais si j’ai parlé de ma séance aux Italiens avec Mme de Forget, mardi, à Sémiramis. Les fioritures et le remplissage font du tort à ce magnifique luxe d’imagination que Rossini prodigue partout. Ce sont des décorations incomparables peintes sur du papier : la trame laisse voir des parties remplies au hasard, ce qui affaiblit l’impression.
Champrosay, 8 octobre. — Parti pour Champrosay à onze heures. Mme Barbier m’invite à dîner. Je n’y vais que le soir ; j’y trouve V… et D…, que je vois avec plaisir. Ils repartent presque aussitôt. Arrivée à Champrosay toujours délicieuse, par le plus beau temps du monde.
9 octobre. — Pluie ; dîné chez Barbier avec Rodakowsky. Au moment de sortir de table, arrivent, à pied et crottés, Bixio et Villot. Séance détestable à table. Tout ce monde, dont étaient Mme Bixio et sa fille, repartant une heure après par un temps horrible.
10 octobre. — Le soir chez Mme Barbier, où on a été fort gai, en compensation de l’algarade d’hier. Dans le jour, travaillé et fait des peintures de souvenir de la grosse clématite de Soisy et de la vue de Fromont.
11 octobre. — Beaucoup de travail, qui m’empêche d’écrire ici.
Le soir, je ne suis pas sorti. J’ai dormi après mon dîner, et me suis promené à la maison.
12 octobre. — Travaillé toute la journée jusqu’à trois heures passées avec frénésie. Je ne pouvais m’en détacher. J’ai avancé la grisaille du Marocain qui monte à cheval[908], le Combat du lion et du tigre[909], la petite Femme d’Alger avec un lévrier[910], et mis de la couleur sur le carton de l’Hamlet et Polonius à terre[911].
La promenade, après un pareil temps de travail, est vraiment délicieuse. Le temps est toujours très beau. Il faut décidément, le matin, que je ne jouisse de la campagne que de mes fenêtres ; la moindre sortie me dissipe et me condamne à l’ennui le reste de la journée, par la difficulté de retrouver de l’entrain pour le travail ensuite.
Je suis descendu jusqu’à la rivière et ai été revoir la vue de Trousseau que j’avais faite sur le carton : cela n’était point du tout semblable. Le paysage qu’il me faut n’est pas le paysage absolument vrai ; et cette absolue vérité est-elle encore dans les paysagistes qui ont fait vrai, mais qui sont restés classés comme de grands artistes ? Rien n’égale, à ce qu’il semble, la vérité des Flamands ; mais combien n’y a-t-il pas de l’homme dans l’œuvre de cette école ! Les peintres qui reproduisent tout simplement leurs études dans leurs tableaux ne donneront jamais au spectateur un vif sentiment de la nature. Le spectateur est ému, parce qu’il voit la nature par souvenir, en même temps qu’il voit votre tableau. Il faut que votre tableau soit déjà orné, idéalisé, pour que l’idéal, que le souvenir fourre, bon gré, malgré, dans la mémoire que nous conservons de toutes choses, ne vous trouve pas inférieur à ce qu’il croit être la représentation de la nature.
— Ce jour, fameux chapon à l’ail qui eût fait reculer une compagnie de grenadiers anglais.
Le soir, promené avec Jenny. La vue des étoiles brillant à travers les arbres m’a donné l’idée de faire un tableau où on verrait cet effet si poétique, mais difficile en peinture à cause de l’obscurité du tout :
Fuite en Égypte. Saint Joseph conduisant l’âne et éclairant un petit gué avec une lanterne ; cette faible lumière suffirait pour le contraste.
Ou bien les Bergers allant adorer le Christ dans l’étable, qu’on verrait dans le lointain tout ouverte.
Ou la Caravane qui amène les Rois mages.
— Conversation avec J. L…, en réponse à l’assertion de Chenavard, qui trouve que les talents valent moins dans un temps qui ne vaut guère. Ce que j’aurais été du temps de Raphaël, je le suis aujourd’hui. Ce qu’est Chenavard aujourd’hui, c’est-à-dire ébloui par le gigantesque de Michel-Ange, il l’eût été, à coup sûr, de son temps. Rubens est tout aussi Rubens pour être venu cent ans plus tard que les immortels d’Italie ; si quelqu’un est Rubens aujourd’hui ou tout autre, il ne l’est que davantage. Il orne son siècle à lui tout seul, au lieu de contribuer à son éclat en compagnie d’autres talents. Quant au succès du moment, il peut être douteux ; quant au nombre des approbateurs, il peut être borné ; mais tel admirateur perdu dans la foule est tout aussi ému que ceux qui ont accueilli Raphaël et Michel-Ange. Ce qui est fait pour des hommes trouvera toujours des hommes pour y mettre le prix.
Je sais bien que Chenavard, toujours entêté de son fameux style, n’admet pas que la supériorité puisse se trouver dans tous les genres. Le beau qui convient à tel siècle lui paraîtra un beau de qualité inférieure ; mais en lui passant même cette idée, pense-t-il qu’un homme vraiment supérieur ne portera dans quelque genre que ce soit assez de force, assez de nouveauté pour faire de toute espèce de genre un genre supérieur, comme il l’est lui-même à ce qui l’entoure ?
15 octobre. — Dîné chez Barbier avec Dagnan, les Marseillais Pastré, Pascal, Genty de Bussy, etc.[912], Villot aussi.
Dagnan raconte l’histoire du duel du maréchal Maison, quand il n’était que garçon tapissier, et qui a probablement décidé de sa vocation militaire.
Tous les jours se passent à travailler le matin.
J’aurai presque entièrement fait les trois tableaux que j’avais apportés en projet, les toiles encore fraîches. J’avais le Christ dormant pendant la tempête, Combat de lion et de tigre, Marocain montant à cheval ; en outre, avancé le Polonius et l’Hamlet (sur carton), une Odalisque, d’après un daguerréotype et que j’ai apportée ébauchée.
Je m’impose, et cela me réussit, de ne rien finir que l’effet et le ton soient complètement trouvés, allant toujours, redessinant et corrigeant, et le tout au gré de mon sentiment du moment ; et au fait, y a-t-il rien de plus sot que d’aller autrement ?… Mon sentiment d’hier peut-il me guider aujourd’hui ? J’ignore la manière des autres. Celle-là seule est faite pour moi. Quand tout a été conduit de la sorte, le fini n’est rien, surtout quand on a des tons qui rentrent tout de suite dans ceux déjà trouvés. Sans cela l’exécution perdrait sa franchise, et l’on gâterait la vivacité des touches de sentiment qui ne semblent alors presque pas modifiées.
Avant de repeindre, il faut enlever les épaisseurs.
17 octobre. — Ton de la mer dans le Christ dormant sur les eaux : terre d’ombre naturelle, bleu de Prusse, un peu de chrome clair. — Bleu de Prusse et terre de Sienne naturelle très foncée à côté de laque et blanc donne par le mélange un violet essentiel. — Sienne naturelle et chrome foncé.
19 octobre. — Pour conserver le raisin : Le cueillir par un temps sec, le placer dans des paniers sans le froisser, le transporter dans une chambre au midi, et on le range avec précaution en isolant les grappes sur une légère couche de paille ; une fois placé, il ne faut pas le toucher pour le servir. Les fenêtres garnies de persiennes et non de volets ; toujours tenir fermé pour demi-lumière ; ne pas ouvrir les fenêtres.
21 octobre. — Les rôles de Racine sont presque tous parfaits. Il a pensé à tout, n’a point fait de remplissages : Burrhus, premier rôle s’il en fut ; Narcisse de même ; Britannicus, le naïf, l’ardent, l’imprudent Britannicus ; Junie, si aimante, mais délicate, prudente au milieu de toute sa tendresse, mais prudente seulement pour son amant. Je passe sous silence Néron et Agrippine, parce que, au théâtre, avec deux rôles comme ceux-là, avec un seul quand il est rempli par un acteur passable, on sort content ; on croit qu’on a vu une pièce de Racine, même quand on a laissé passer sans les remarquer, à travers le débit des mauvais auteurs, toutes ces nuances, qui sont cependant tout Racine.
Il y a des pièces où le personnage principal, celui qui est le pivot de la pièce, est sacrifié et donné toujours à des subalternes. Est-il un personnage comparable à celui d’Agamemnon ? L’ambition, la tendresse, ses attitudes devant sa femme, enfin ses agitations perpétuelles, qu’on ne peut imputer pourtant à une faiblesse de sentiment, qui lui ôterait l’estime du spectateur, mais à la situation la mieux faite pour mettre à l’épreuve un grand caractère. Je ne dis pas que le rôle d’Achille, que prend ordinairement le coryphée du théâtre, soit inférieur à celui d’Agamemnon ; il est ce qu’il doit être, mais ce n’est pas celui-là qui fait l’intérêt de la pièce. Clytemnestre, Achille, Iphigénie, tous personnages frappants par la passion, par leur situation dans la pièce, mais qui sont en quelque sorte des instruments pour agir sur Agamemnon, qui le poussent, le pressent dans des sens divers.
Combien y a-t-il de gens qui réfléchissent à tout cela dans un spectacle ?… et à ceux qui sont capables de réfléchir, je demanderai si c’est le jeu des acteurs qui les a portés à se rendre compte de ces impressions diverses ?
22 octobre. — Travaillé un peu à l’Odalisque d’après le daguerréotype, sans beaucoup d’entrain.
Le soir chez Barbier ; Villot y était. Nous ne nous sommes pas dit une parole.
Augerville, 23 octobre. — Parti à sept heures moins un quart. Pluie. — Voyagé dans l’omnibus jusqu’à Villeneuve en face d’un ecclésiastique de la plus belle figure, un peu dans le genre de Cottereau. — Attendu pour le convoi.
Arrivé à Fontainebleau par la pluie et trouvé le cabriolet attelé. Route à travers la forêt, qui eût été plus agréable sans le froid, dont je ne pouvais me garantir malgré mes précautions.
Arrivé vers une heure à Augerville. Personne n’était là ; j’ai été trouver Berryer et ces dames dans le parc.
Il y a peu de monde ; cela met moins d’entrain. La princesse n’y est pas, Mme de la Grange non plus, Mme de Suzannet non plus ; cela fait beaucoup de charme de moins. L’ami de Berryer, Richomme[913], est un bonhomme très amusant.
Le soir, jetais très fatigué et suis monté après la musique. Petits morceaux de Batta, de sa composition, très gracieux.
Berryer nous conte à dîner sa visite au fameux Dugas, d’Amiens, pour lui commander un pâté. Il le trouve dans son cabinet, dans une robe de chambre à grands ramages et avec la gravité convenable, tirant de son tiroir les assaisonnements de ses pâtés, qu’il distribuait à ses garçons et à ses fils chargés aussi de la confection, et graduant les doses à raison de la proportion du pâté ou du lieu où on devait l’employer. Il s’informait aussi du moment où on devait manger le pâté.
C’était à dîner ; on parlait beaucoup de cuisine, et je disais qu’elle dégénérait. Berryer citait à ce propos la préface de Carême attestant, de cette décadence qu’il déplore, les mânes de l’immortel Lavoypiere son maître. Cet illustre artiste avait été choisi par Murat, pour le suivre à Naples, quand il fut fait roi. Le grand Lavoypiere se récria sur la barbarie du pays où il arrivait : « On me donne deux batteries, grands dieux ! deux batteries pour faire la cuisine d’un roi ! »
J’ai oublié de mentionner que l’illustre Dugas, l’homme aux pâtés d’Amiens, avait cru devoir emporter dans la tombe le secret de ses doses. Il en avait déshérité ses fils : ceci est le trait de caractère de l’artiste, de l’homme inspiré. Le grand Dugas eût tué ses disciples ignorants, de peur de voir compromettre la réputation des produits auxquels son nom avait donné la célébrité.
Il nous conte l’histoire de ce garçon menuisier, qui allait travailler chez X…, lequel était très habile sur le violon. Cet homme enthousiasmé ne se lassait pas de l’entendre et lui montrait le désir d’en apprendre autant. L’artiste le fait venir à ses moments perdus, le dimanche, quand il peut, et lui fait faire des exercices. Au bout d’un certain temps le menuisier, trouvant l’apprentissage un peu long, lui dit : « Monsieur, je ne suis qu’un pauvre homme, et ne puis mettre à cela autant de temps qu’un monsieur tel que vous. Soyez assez bon pour m’apprendre tout de suite le mot fin. »
24 octobre. — Couru dans le parc par un très beau temps et sorti seul avec bonheur aussitôt ma toilette faite. Je vais par le canal et les treilles jusqu’aux rochers ; charmant souvenir de courts moments que j’y ai passés. Je me trouve encore trop jeune et tout surpris et presque attristé de mon émotion… Je dessine quelques-unes des figures fantastiques de rochers[914].
Berryer, au déjeuner, nous parle de Beugnot[915]. Il lui disait un jour, à propos de je ne sais quelle affaire, qu’il avait manqué de caractère à cette occasion : « Du caractère ! lui dit Beugnot, mais je n’en ai jamais eu ; je n’ai pas le moindre caractère ; si j’en avais eu autant qu’on m’accorde d’esprit, j’aurais soulevé des montagnes. »
Sorti avec ces dames, Batta et Richomme. A déjeuner, ce dernier très amusant avec le docteur Aublé, de Malesherbes.
Berryer rappelle aussi ce mot de Pescatore, disant que ses serres l’ennuient et qu’il a envie de prendre le goût des tableaux.
27 octobre. — J’écris à Mme de F…[916].
Promenade hors du parc avec le docteur Aublé, Richomme et Mme de C***. Moulin, chemin couvert en montant, et retour dans un endroit charmant mêlé de bois et de roches.
— Mme Berryer, la belle-fille, veut faire maigre, malgré la dispense de l’évêque d’Orléans pour tout son diocèse. Elle ressemble au paysan qui, au milieu d’un prône qui avait arraché des larmes à tout le monde, était resté indifférent et dit aux gens qui lui reprochaient sa froideur, qu’il n’était pas de la paroisse.
Je dis à ce propos qu’abstraction faite de tout sentiment particulier, je trouvais le protestantisme une absurdité. Berryer me dit que Thiers avait dit précisément la même chose au prince de Wurtemberg… « Vous êtes contre la tradition du genre humain, contre le résumé de toutes les philosophies, et qui contient tout, etc. »
Berryer nous lit le soir des proverbes.
29 octobre. — À Malesherbes avec ces dames : petit château de Rouville, à un monsieur d’Aboville. Très beau pin maritime dans les rochers.
Berryer nous conte l’histoire de Henri IV égaré dans les environs, en revenant de chez sa maîtresse, Henriette d’Entragues, qu’il était venu voir de Fontainebleau. Il était seul, et, entrant dans une espèce de cabaret, il s’attable et demande qu’on lui fasse venir le bon drille de l’endroit pour causer avec lui. On lui amène un homme nommé Gaillard, que le Roi fait asseoir en face de lui. « Quelle est la différence d’un gaillard à un paillard ? » lui dit-il. « M’est avis, dit l’autre, qu’il y a entre eux la largeur de cette table. »
Il écrit à M. de X***, qui avait perdu un œil dans une bataille à côté de lui : « Borgne, nous nous battons après-demain ; trouve-toi à tel endroit avec ta compagnie, et gare les Quinze-Vingts ! »
L’anecdote de Napoléon allant au mariage de Maret[917] à Saint-Cloud ou à Versailles. Il avait Talleyrand dans sa voiture ; il lui dit que sa jeunesse avait fini à Saint-Jean d’Acre ; il voulait dire, sans doute, sa confiance en son étoile. Les Anglais, disait-il, l’avaient arrêté là, comme il était en train d’aller à Constantinople. « Au reste, dit-il, ce qu’on m’a empêché défaire par le Midi, peut-être un jour le ferai-je par le Nord. » Talleyrand, surpris, écrivait quelques jours après à une vieille femme de l’ancien régime très connue : « Je ne sais si cet homme est fou (c’était encore au commencement du consulat) ; voilà ce qu’il m’a dit l’autre jour. »
Cette lettre tomba plus tard dans les mains de Pozzo ; c’était au moment de la campagne de 1812. Pozzo, qui allait partout cherchant des ennemis à Napoléon, va jusqu’au Divan. Comme la Turquie était en guerre avec la Russie, et au moment où une armée russe s’avançait, il montre la lettre, et vient à bout de faire conclure entre les deux empires le traité qui permit à la Russie de porter toutes ses forces contre la France.
— Revenu ce jour par de très beaux sites, entre autres le puits singulier qu’on voit extérieurement. Je regrette bien de n’avoir pas fait un croquis.
Rochers sur le devant, etc., comme aussi un couvert d’arbres où je me suis rappelé Norma.
30 octobre. — Temps magnifique depuis trois jours. — Dans la journée, promenade avec ces dames, Berryer et le jeune M. de Quéru, par cet admirable temps et avec un grand sentiment de plaisir. Le clair de lune est magnifique après dîner ; je n’en jouis qu’à moitié, à cause du cher Richomme qui n’a rien de romantique, mais qui est un bonhomme qui me plaît comme cela. Nous avons le soir avec nous M. de Lanrenceau, qui était arrivé avec sa femme pour dîner.
Mme de C…, fort à son avantage au dîner : je tiens mon cœur à deux mains en sa présence, mais seulement quand elle a sa grande toilette et qu’elle montre ses bras et ses épaules ; je redeviens très raisonnable dans la journée, quand elle a sa robe du matin. Elle est venue ce matin voir les peintures de ma chambre et m’a sans façon mené voir celles de la sienne, en me faisant passer par le cabinet de toilette. Ce qui me rassure sur ma sagesse, c’est que j’ai pensé que ce cabinet de toilette et cette chambre avaient vu dans d’autres moments la piquante M…, qui n’a ni ces bras ni cette gorge que je soupçonne, mais qui me plaît par le je ne sais quoi, par l’esprit, par la malice des yeux, par tout ce qui fait qu’on se souvient.
— La grand’mère de M. de Kerdrel lui disant au moment où, après avoir été élu en 1848, il allait siéger à Paris : « Mon fils, vous allez aux États, défendez bien les intérêts de la Bretagne. »
La grand’mère ou la mère de M. de Corbière, à qui on faisait compliment de ce que son fils était ministre : « Mon Dieu ! la révolution n’est donc pas finie, puisque Pierrot est ministre ? »
— Les cygnes qui vont visiter leurs petits.
— Partition d’Olette. Partition des Nozze… tout cela charmant.
31 octobre. — Après dîner, Berryer nous conte l’histoire de son grand-oncle Varroquier.
Envoyé par son père avec son frère cadet pour étudier chez le procureur, ou quelque chose d’approchant, comme ils étaient un jour sur le Cours-la-Reine, la duchesse de Berry vint à passer. Sur sa bonne mine, qui était remarquable, la princesse leur envoie un valet de pied pour leur dire qu’elle désirait lui parler. On le fait monter en voiture, et il disparaît pendant quarante-huit heures, au bout desquelles il reparaît pourvu d’un bon emploi dans la finance dans quelque province. Les deux frères mènent joyeuse vie et se carrent dans leur poste jusqu’à la mort de la duchesse, qui fut assez prompte.
Voilà mes hommes renvoyés ; mais au lieu de retourner au pays, accoutumés à un certain genre de vie, et dans l’âge des entreprises, ils font argent de leurs meubles, de tout ce qu’ils peuvent, et s’en vont mener à peu près la même vie en Italie, à Rome ou à Naples. Quand vient le moment où il n’y avait plus d’argent, ils s’imaginent de se donner à eux-mêmes un brevet de médecin et de faire des pilules qu’ils s’en vont vendant le long de leur voyage par retour.
Revenus, de guerre lasse, au giron paternel, ils furent traités de bonne sorte, de libertins, de débauchés. Cependant le père s’apaisa, et ils reprirent l’un et l’autre je ne sais quelle manière de vivre dans leur petit endroit. Le père, un jour, leur demanda des détails sur le fameux carnaval de Venise, pensant qu’on ne pouvait avoir été en Italie sans pouvoir en donner des nouvelles. Nos deux voyageurs avouent qu’ils n’en avaient rien vu, attendu qu’ils n’avaient point été à Venise, à la grande surprise du père Varroquier.
Sur cette idée, leur tête s’enflamme de nouveau, et, lassés de la vie bourgeoise, après avoir obtenu d’une tante quelque argent, ils s’embarquent de nouveau et retournent en Italie, où le cadet mourut je ne sais comment.
C’est le grand-oncle lui-même qui raconta depuis à Berryer, âgé de seize ans, au moment où il allait à Paris, toute cette bonne histoire.
— Le temps est magnifique ; je suis dehors presque toute la journée. Je me suis presque endormi sur un banc, pendant que M. de Laurençot contait à Richomme et à moi ses idées sur la révolution de 1848 et ses portraits des hommes de ce temps-là.
Promenade avec Mlle Vaufreland et Mme de L…, dans le parc et le potager.
Agréable soirée. Berryer nous lit l’École des bourgeois.
1er novembre. — Remonté le matin avant déjeuner dans le parc un moment. On devait déjeuner un peu plus tôt pour aller à la messe. J’ai rencontré là Mme de C…, descendue je ne sais pourquoi.
Un peu de bateau dans la journée ; elles s’écoulent doucement, mais franchement ; c’est trop d’abandon de tout exercice d’imagination. Qu’est-ce donc, grand Dieu ! que la vie de ces gens qui vivent toujours comme je le fais dans ce moment-ci ! Tous ces élégants, toutes ces femmelettes, ne font pas autre chose que se traîner d’un temps à l’autre en ne faisant rien ou en ne s’occupant de rien.
Promenade avec Richomme à la fin de la journée, pendant les vêpres, dont nous sommes dispensés ; puis avec lui et Cadignan.
Le soir, billard, le fameux mistigri, etc.
— Je suis de mauvaise humeur contre moi-même.
— M. de Gadillan me parle longuement d’une affaire que Berryer doit plaider pour des domestiques auxquels leur maître a légué sa fortune ; ce jeune homme, qui travaille avec lui continuellement et lui prépare ses affaires, me le fait voir bien plus grand encore que je ne le croyais. Il me parle de son désintéressement, de son mépris de ce qui est en dessous de lui. Il ne veut pas aller à Orléans ni je ne sais où, plaider pour M. Jouvin, gantier, qui ne lui demande que quelques instants de son talent et lui offre dix mille francs pour cela.
2 novembre. — J’ai été bien frappé de la messe des Morts, de tout ce qu’il y a dans la religion pour l’imagination, et en même temps combien elle s’adresse au sens intime de l’homme.
Beati mites, beati pacifici : quelle doctrine a jamais fait ainsi, de la douceur, de la résignation, de la simple vertu, l’objet unique de l’homme sur la terre !
Beati pauperes spiritu : le Christ promet le ciel aux pauvres d’esprit, c’est-à-dire aux simples. Cette parole est moins faite pour abaisser l’orgueil dans lequel se complaît l’esprit humain quand il se considère, que pour montrer que la simplicité du cœur l’emporte sur les lumières.
3 novembre. — Pluie ; le temps se remet le soir. Promenade, après déjeuner, sous les pins, avec Richomme et L… Berryer vient nous joindre avant dîner.
Avant dîner, promenade avec Mlle de Vaufreland, Berryer, Richomme ; allées du haut, sapins, etc.
Le mistigri a occupé une partie de la soirée… Je suis effrayé de la difficulté de fixer mon attention sur des bagatelles comme celles-là : j’ai l’air d’un imbécile.
L’air du Comte Ory me roule sans cesse dans la tête. Je l’ai étudié au piano ; maintenant je ne puis m’en distraire.
Arrêté le départ, dans la journée, avec Berryer, pour mardi.
4 novembre. — Je pense en me levant à l’impossibilité de faire la moindre chose dans la situation où je suis. La solitude seule, et la sécurité dans la solitude, permettent d’entreprendre et d’achever.
Champrosay, 7 novembre. — Parti d’Augerville à neuf heures et demie.
Été d’abord à Étampes avec ces trois dames ; d’Étampes à Juvisy avec Mme de C…
J’étais à Champrosay avant trois heures. Ma bonne Jenny m’attendait au chemin de fer. J’ai été attristé de lui voir mauvaise mine. Elle est mieux que je ne pensais ; elle avait été inquiète de n’avoir pas de lettre depuis longtemps.
Le soir, j’ai été voir ces dames : Mme Barbier est malade, et j’ai passé la soirée à causer très amicalement avec Mme Villot.
Les mouvements qu’excite en moi toute cette distraction ne sont pas de la nature que je voudrais. Pour un solitaire qui veut rester tel, il s’y mêle encore un élément dangereux. La jeunesse peut se partager entre toutes les émotions : le trésor se resserre avec l’âge ; la muse est alors une maîtresse exigeante ; elle vous abandonne à la moindre infidélité.
8 novembre. — Fatigué de mon voyage et de mes petites émotions d’hier. Souffrant toute la journée : mauvaise disposition de corps et d’esprit. Agitation ou torpeur, sont-ce là les conditions inévitables ? Non, si je me rappelle mille moments de ma vie depuis quelques années que je me suis tiré du tourbillon. Dans maintes occasions j’ai savouré avec bonheur le sentiment de liberté et de possession de moi-même, qui doit être le seul bien où je doive aspirer.
9 novembre. — J’ai prolongé mon séjour un peu plus que je ne voulais auprès du cousin, dont l’amabilité ne s’est pas ralentie. J’avais aussi dans cet agréable lieu une aimable société qui n’a pas laissé de place à l’ennui ; mais j’éprouve qu’une si agréable oisiveté est dangereuse pour un homme qui veut se retirer du monde. Quand il faut retourner au travail et à la tranquillité, on ne se trouve plus le même, on ne rentre plus avec la même facilité dans l’ornière de tous les jours.
17 novembre. — Il faut considérer la terre de Sienne brûlée comme un orangé primitif. Son mélange avec le bleu de Prusse et blanc donne un gris qui est très fin. — Laque jaune et terre de Sienne brûlée ôte à la terre de Sienne brûlée seule sa crudité et lui donne un brillant incomparable. — Excellent pour réchauffer des chairs préparées trop grises.
Paris, 21 novembre. — Dîné chez la princesse, que j’ai revue pour la première fois depuis son voyage ; délicieuse musique et aimable personne.
Depuis un jour ou deux, repris le tableau de la Chasse aux lions. Je vais le mettre, je crois, en bonne voie.
— Éviter le noir ; produire les tons obscurs par des tons francs et transparents : ou laque, ou cobalt, ou laque jaune, ou terre de Sienne naturelle ou brûlée. Dans le cheval café au lait, je me suis bien trouvé, après l’avoir trop éclairci, d’avoir repris les ombres, notamment avec des tons verts et prononcés. Se rappeler cet exemple.
25 novembre. — Mes journées se passent à travailler ; je suis heureux de m’enterrer dans l’étude. Heureuses, heureuses distractions ! douce tranquillité que les passions ne peuvent donner ! Je manque malheureusement toutes mes affaires : je ne peux écrire une lettre ni faire une visite.
Je n’ai pas encore vu ces dames d’Augerville, et le moment se passe.
Avant dîner, chez Mme de la Grange : c’est une aimable personne, pleine de l’envie d’être bonne et agréable. Ensuite dîné chez Chabrier ; je me suis peu diverti ; des lampes assassines, des bougies partout.
X… venu le soir de Saint-Cloud pour y retourner : quatre ou cinq mois ont beaucoup changé mon ami. C’est un homme qui a beaucoup perdu à se trouver dans la sphère où il est comme égaré, eu égard à ses opinions tranchées, au moins à celles dont il faisait parade.
Mme Chabrier me parle de la vie que mène Poinsot : rentré le soir vers minuit, — il sort presque tous les soirs, — il se déshabille et reste jusqu’à près de trois heures du matin sans se coucher, à penser et à se reposer. Il mange ensuite et va au lit immédiatement. Ne sonne son déjeuner que vers dix ou onze heures, reste chez lui sans recevoir jusque vers deux heures ; va à ses affaires. Dîne entre sept et huit heures, quand il dîne chez lui, et va dans le monde ensuite. Vieillard prétend qu’il n’a jamais beaucoup travaillé.
27 novembre. — Dîné avec Chenavard et Boissard. C’est toujours le même homme qui vous attire et vous repousse. Ce bon Boissard, en revenant, me disait qu’il le pratiquait depuis plus longtemps que moi et qu’il l’avait toujours trouvé tel.
Dans la journée chez Level, sculpteur, rue de Varennes. J’ai gelé l’allée et le retour et attendu sa venue dans son atelier, en tête-à-tête avec une péronnelle qui m’a montré ses œuvres. Pauvre sculpteur ! Pauvre Napoléon ! pauvre Charlemagne ! que ceux qui sortent du ciseau de ce bas Normand, qui a une barbe longue et fourchue comme celle du Moïse de son confrère Michel-Ange !
— Anecdotes de Chenavard sur les hommes du temps de Louis XIV.
1er décembre. — Chez Halévy après le conseil.
Le soir, retourné chez lui. Sa femme va mieux. Ils doivent être bien heureux.
Longue conversation avec Mme Doux sur la peinture. Elle doit venir voir mon atelier mercredi et particulièrement ma palette.
19 décembre. — Dîné chez Mme de la Grange avec
Berryer, la princesse. Mme de X… venue le soir :
robe noire, rubans verts, qui lui seyaient à merveille.
Grande conversation sur les sujets les plus délicats
avec M… — Situation bizarre, au demeurant très
amusante et propre à passer le temps.
La Peinture au château de Chantilly. École française, par F.-A. Gruyer, membre de l’Institut. Un volume in-4o orné de 40 héliogravures. 428 fr.
Chantilly. Les Portraits de Carmontelle, par F.-A. Gruyer, membre de l’Institut. Un volume in-4o sur papier de cuve accompagné de 40 héliogravures exécutées, d’après les originaux, par Braun-Clément et Cie. 320 fr.
Les Peintures de la collection Chauchard, par Jean Guiffrey. Ouvrage de grand luxe numéroté, contenant 80 reproductions en héliogravure de la maison Braun-Clément et Cie, sur cuve d’Arches 800 fr.
Les Maîtres d’autrefois : Belgique-Hollande, par Fromentin. Un volume in-16 20 fr.
Ingres, sa vie, ses travaux, sa doctrine, d’après les notes manuscrites et les lettres du maître, par le vicomte Henri Delaborde. Ouvrage orné d’un portrait gravé par Morse. Un volume in-8o cavalier 25 fr.
Une vie romantique, Hector Berlioz, par Adolphe Boschot. Un volume in-16 12 fr.
Graphique d’histoire de l’art. Antiquité, Moyen âge, Renaissance et temps modernes, par Joseph Gauthier. In-8° avec 0(37 figures 20 fr.
Traité de composition décorative, par Joseph Gauthier. In-8° illustré. Prix 32 fr.
Dix leçons de composition décorative, par Joseph Gauthier. In-8° illustré 32 fr.
Petit précis d’histoire de l’ornement. I. L’Antiquité. Les Arts orientaux, par Joseph Gauthier. In-8 e écu double couronne illustré 12 fr.
Nouvelle anatomie artistique du corps humain, par le docteur Paul Righer, de l’Institut :
I. Cours pratique. Éléments d’anatomie. L’Homme. In-8° écu. 50 planches et 29 figures. 16 e mille 20 fr.
II. Cours supérieur. Morphologie. La Femme. In-8° écu. 61 planches et 61 figures dans le texte comprenant ensemble plus de 500 dessins ou gravures. 4 e mille 48 fr.
III. Cours supérieur (suite). Physiologie. Altitudes et mouvements. In-8° écu. 64 planches et 125 figures dans le texte 32 fr.
IV. Cours supérieur (suite) Le Nu dans l’art. Égypte, Chaldée, Assyrie. Prix 64 fr.
Nouvelle anatomie artistique. Les Animaux : I. Le Cheval. Un volume in-8o avec 18 planches et nombreuses figures. : 12 fr.
Jeanne d’Arc, par Maurice Boutet de Monvel. Illustré en couleurs. Cartonné. Prix 40 fr.
Watteau. Un grand maître du dix-huitième siècle, par Louis Gillet. Un volume in-8o écu sur papier de fil 15 fr.
Histoire de l’Académie de France à Rome, par Henri Lapauze. Deux forts volumes in-8o 160 fr.
- ↑ Eugène Delacroix était venu passer ses vacances au Louroux, près de Louans, dans l’arrondissement de Loches, en Touraine, chez son frère aîné le général Charles Delacroix, ancien aide de camp du prince Eugène, qui avait hérité de cette propriété de famille.
- ↑ A propos de cette « Lisette » qui occupait l’attention du jeune peintre, Delacroix écrivait à son ami Pierret, le 18 août 1822 : « Je t’écris à une toise et demie de distance de la plus charmante Lisette que tu puisses imaginer. Que les beautés de la ville sont loin de cela ! Ces bras fermes et colorés par le grand air sont purs comme du bronze ; toute cette tournure est d’une chasseresse antique. Dis à notre ami Félix (Guillemardet) que malgré son antipathie pour les bas bleus, je crois qu’il rendrait les armes à Lisette. Et, du reste, ce n’est pas la seule ; toutes ces paysannes me paraissent superbes. Elles ont des têtes et des formes de Raphaël, et sont bien loin de cette fadeur blafarde de nos Parisiennes. Mais, hélas ! malgré quelques larcins, mes affaires ont bien de la peine à avancer auprès de ma Zerlina ! Sœvus amor. » (Corresp., t. I. p. 89.)
- ↑ Félix Guillemardet, un des amis les plus intimes de Delacroix. Son nom revient presque à chaque page, au commencement de ce journal.
- ↑ Le Dante et Virgile, exposé au Salon de 1822, a été au Luxembourg et est maintenant au Louvre. Il fut acheté par l’État 1,200 francs, Delacroix fut mis en relation avec le comte de Forbin, alors directeur général des Musées royaux, pour la vente de ce tableau. Il lui écrivait à ce propos : « Je désirerais en avoir 2,400 fr. Si cependant vous trouviez ma demande exagérée, je m’en rapporte entièrement à ce que vous jugerez convenable et possible en cette circonstance. J’ai trop à me louer de votre active bonté pour récuser votre propre jugement sur le prix d’un ouvrage que vous voulez bien voir avec intérêt et que vous avez distingué de la foule. » (Corresp., t. I, p. 87.)
- ↑ Cette idée l’a poursuivi longtemps et à plusieurs reprises. Dès 1819,
dans une lettre à Pierret, le malheur du Tasse le passionne.
Voici les différents tableaux qu’il fit sur ce sujet :
En 1824, il compose le premier qu’il finit et signe en 1825 pour M. Formé. Il l’exposa au Salon de 1839 et à l’Exposition universelle de 1855. Vente Dumas fils, 1865, 14,000 fr. ; vente Khalil-Bey, 1868, 16,500 fr. ; vente Carlin, 1872, 40,000 fr.
Un dessin, signé et daté 1825, parut à l’Exposition posthume de Delacroix, au boulevard des Italiens.
En 1827, il reprend le même sujet en changeant la composition ; ce tableau a été refusé au Salon de 1839. (V. Catalogue illustré Robaut.) - ↑ Avec sa fougue ordinaire, Delacroix s’était tout d’abord pris de passion pour la chasse. « Je me plais beaucoup à chasser. Quand j’entends le chien aboyer, mon cœur palpite avec force, et je cours après mes timides proies avec une ardeur de guerrier qui franchit les palissades et s’élance au carnage… Rien qu’en voyant tomber un oisillon, on se sent ému et triomphant comme celui qui découvre dans l’instant que sa maîtresse l’aime. » Mais cet enthousiasme dura peu. L’année suivante (1819), il écrivait : « Décidément la chasse ne me convient pas… Il faut se traîner et avec soi une arme lourde et incommode à porter à travers les ronces… Il s’agit d’avoir pendant des heures qui n’en finissent pas l’esprit dirigé vers un objet qui est d’apercevoir le gibier. » Mais le découragement du chasseur n’éteint pas la flamme de l’artiste : « Il y a bien à tout cela des compensations telles que l’occasion saisie, le soleil levant et le plaisir enfin de voir des arbres, des fleurs et des plaines riantes au lieu d’une ville malpropre et pavée. » (Corresp., t. 1, p. 17 et 40.)
- ↑ Victoire Œben, femme de Charles Delacroix, était la fille de l’ébéniste
Œben, qualifié de fameux dans les catalogues des grandes ventes
du siècle dernier.
Eugène Delacroix n’avait que quinze ans quand il perdit sa mère. Il ne parlait d’elle qu’avec une tendre et pieuse admiration : « J’ai perdu ma mère sans la payer de ce qu’elle a souffert pour moi et de sa tendresse pour moi. » (Corresp., t. I, p 46.) - ↑ Philarète Chastes, le brillant et inconsistant journaliste, le collaborateur fécond des Débats, de la Revue des Deux Mondes et de la Revue de Paris, avait été le condisciple de Delacroix au lycée Louis-le-Grand. Il nous a laissé du peintre, dans ses Mémoires, cette rapide esquisse : « J’étais au lycée avec ce garçon olivâtre de front, à l’œil qui fulgurait, à la face mobile, aux joues creusées de bonne heure, à la bouche délicatement moqueuse. Il était mince, élégant de taille, et ses cheveux noirs abondants et crépus trahissaient une éclosion méridionale… Au lycée, Eugène Delacroix couvrait ses cahiers de dessins et de bonshommes. Le vrai talent est chose tellement innée et spontanée, que dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait tous les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects, avec une obstination semblable à de la fureur. » (Mémoires de Philarète Chastes, t. I, p. 329.)
- ↑ Dès les premières années de son développement, Delacroix consacrait à la lecture tout le temps que ses travaux lui laissaient libre. Dans une lettre à Pierret du 30 août 1822, il écrivait : « Je n’ai jamais autant qu’à présent éprouvé de vifs élans à la lecture des bonnes choses ; une bonne page me fait pour plusieurs jours une compagnie délicieuse. » (Corresp., t. I, p. 90.)
- ↑ Henri-François Riesener, peintre miniaturiste, élève de Hersent
et de David, était fils de Jean-Henri Riesener, l’ébéniste célèbre par ses
beaux meubles en marqueterie. Il eut lui-même un fils, Léon Riesener,
cousin germain par conséquent d’Eugène Delacroix, peintre d’histoire,
auquel Delacroix laissa par testament sa maison de campagne de Champrosay
avec ses dépendances et les meubles qui la garnissaient.
Riesener encouragea son neveu Eugène Delacroix à ses débuts. Ce fut lui qui lui conseilla l’atelier de Guérin. - ↑ Henri Hugues était un cousin de Delacroix ; son nom reparaîtra à maintes reprises dans le cours du Journal. Il existe de lui un très beau portrait peint par Delacroix, dans la manière flamande, mais ébauché seulement par parties. Ce portrait appartient actuellement à madame Léon Riesener ; il avait été offert par son mari au Louvre, qui, nous ne savons pour quelle raison, le refusa.
- ↑ Dans le volume tiré à un petit nombre d’exemplaires et qui contient les œuvres critiques d’Eugène Delacroix, on trouve ce fragment extrait du cahier manuscrit dont nous avons parlé plus haut : « J’idolâtrais le talent de Gros, qui est encore pour moi, à l’heure où je vous écris, et après tout ce que j’ai vu, un des plus notables de l’histoire de la peinture. Le hasard me fit rencontrer Gros qui, apprenant que j’étais l’auteur du tableau en question (Dante et Virgile), me fit avec une chaleur incroyable des compliments qui, pour la vie, m’ont rendu insensible à toute flatterie. Il finit par me dire, après m’en avoir fait ressortir tous les mérites, que c’était du Rubens châtié. Pour lui qui adorait Rubens, et qui avait été élevé à l’école sévère de David, c’était le plus grand des éloges… » Eugène Delacroix, Sa vie et ses œuvres, Jules Claye, 1865, p. 52.)
- ↑ Voir Introduction, p. vi et vii.
- ↑ Delacroix fait allusion à une opération cruelle que son père dut subir et durant laquelle il montra une énergie stoïque : c’était une opération de « sarcocèle », d’autant plus redoutable qu’à cette époque on ne la pratiquait que très rarement. Une plaquette, aujourd’hui presque introuvable, contient le récit de cette tentative chirurgicale. Nous avons pu mettre la main sur un exemplaire et nous en avons transcrit le titre : Opération de sarcocèle, faite le 27 fructidor an V, au citoyen Charles Delacroix, ex-ministre des relations extérieures, ministre plénipotentiaire de la République française près celle Batave, par le citoyen A.-B. Imbert-Delonnes, officier de santé… Publié par ordre du Gouvernement, à Paris, à l’Imprimerie de la République. Frimaire an VI.
- ↑ Sa sœur Henriette Delacroix, plus âgée que lui de vingt ans, avait
épousé M. de Verninac Saint-Maur, ambassadeur de France à Constantinople.
Cette lettre a trait à des difficultés qui s’étaient élevées entre Charles, Eugène et M. de Verninac au sujet de leurs droits respectifs dans la succession de leur mère. - ↑ Piron était un des amis les plus intimes de Delacroix. Il fut administrateur des Postes, et à raison de son entente des affaires, Delacroix devait l’instituer son légataire universel et le charger de l’exécution de ses dernières volontés. Ce fut par ses soins que se trouvèrent réunies en un volume tiré à un petit nombre d’exemplaires et publié chez J. Claye, sous le titre : Eugène Delacroix, sa vie et ses œuvres, les œuvres critiques de Delacroix, parues à la Revue des Deux Mondes, à l’Artiste et à la Revue de Paris
- ↑ Il nous paraît utile de rappeler, au début de ce Journal, les lien
d’étroite affection qui unissaient Eugène Delacroix à Pierret. La lecture du
premier volume de la correspondance a pu édifier sur ce point les fervents
du maître ; c’est ainsi que la plupart des lettres de l’année 1832, pendant
laquelle Delacroix fit son voyage au Maroc, sont adressées à l’ami
qui avait été son camarade d’enfance ; tout ce qui présente un caractère
de confidence et d’intimité, le récit de ses premières amours, de ses
tentatives d’artiste, de ses déboires et des luttes qu’il soutient, il l’adresse
à Pierret.
Pierret était le secrétaire de Baour-Lormian, et Delacroix, dans maints passages de sa correspondance, parle avec émotion de cette intimité : « Oui, j’en suis sûr, lui écrit-il, en 1818, la grande amitié est comme le grand génie, le souvenir d’une grande et forte amitié est comme celui des grands ouvrages des génies… Quelle vie ce doit être que celle de deux poètes qui s’aimeraient comme nous nous aimons ! »
Pierret mourut en 1854. - ↑ Il s’agit ici du général Delacroix, qui avait vingt ans de plus que le peintre. Ce passage serait incompréhensible, si l’on n’y ajoutait, en manière d’éclaircissement, que l’artiste fait allusion à une liaison douteuse, qu’il jugeait regrettable et peu digne de son frère.
- ↑ Probablement Édouard Guillemardet, frère de Félix Guillemardet.
- ↑ Champion, camarade d’atelier de Delacroix, resté inconnu. Il ne devait pourtant pas être sans valeur comme peintre, car nous trouvons dans les notes de Léon Riesener sur son cousin ce passage : « Delacroix m’a parlé de l’influence qu’un certain Champion avait eue sur le talent de Géricault lui-même et sur tous les élèves de l’atelier Guérin. »
- ↑ Soulier fut, avec Pierret et Félix Guillemardet, l’ami le plus intime de Delacroix. Il le connaissait depuis 1816 et correspondait assidûment avec lui. Ils avaient fait de la peinture ensemble, ou plutôt de timides essais. M. Burty reproduit dans une note placée au bas de la première lettre de Delacroix à Soulier, cette indication biographique donnée par Soulier lui-même : « Mes soirées étaient consacrées à réunir quelques jeunes gens dans mon humble chambrette, la plus haute de la place Vendôme, à l’hôtel du Domaine extraordinaire, où j’étais surnuméraire et secrétaire de l’intendant, le marquis de la Maisonfort. Horace Raisson était dans mon bureau au secrétariat, et ce fut lui qui m’amena Eugène Delacroix. » Il resta en relations suivies avec Delacroix jusqu’à la mort du peintre : une lettre de 1862, adressée par Delacroix à Soulier, montre ce qu’étaient leurs relations : « Je pense, lui écrit Delacroix déjà gravement malade, aux moments heureux où nous nous sommes connus et à ceux où nous avons joui si pleinement de la société l’un de l’autre. »
- ↑ Fedel, architecte de grand mérite. « C’était un homme très actif, très passionné en faveur de toute la jeunesse romantique et qui se faisait le lien vivant, le trait d’union empressé, chaleureux, dévoué, des artistes entre eux et des artistes avec les amateurs. » (Ernest Chesneau, Peintres et sculpteurs romantiques, p. 82.)
- ↑ Georges Rouget, né en 1784, mort en 1869, élève de David, qu’il aida même, dit-on, dans l’exécution de quelques-uns de ses grands tableaux. Il avait débuté au Salon de 1812. Son œuvre assez importante se compose principalement de grandes compositions historiques et de portraits. En 1849, il posa, en même temps que Delacroix, sa candidature à l’Académie des beaux-arts pour succéder à Garnier. Ce fut Léon Cogniet qui fut élu.
- ↑ Peintre et sculpteur, né à Nantes, en 1804, Debay remporta le grand prix de peinture en 1824. L’opinion de Delacroix sur lui semble s’être modifiée avec le temps, car il écrit en 1857 : « Quoique j’eusse désigné dans ma pensée un candidat que j’aurais désiré que l’on choisît, je n’en aurais pas moins fait tous mes efforts pour que l’on rendit à M. Debay une justice provisoire, en le plaçant avantageusement sur les listes. Son mérite comme sculpteur et les qualités qui distinguent son caractère l’auront, je n’en doute pas, mis en évidence. » (Corresp., t. II, p. 118.)
- ↑ Dans tout le cours de son Journal, Delacroix note à la suite de ses lectures tous les sujets qui l’intéressent. Beaucoup de ces sujets n’ont jamais été traités par lui.
- ↑ C’est le sujet du tableau « Les Natchez » commencé à cette époque et qui ne parut qu’au Salon de 1835. Il fut mis en loterie à Lyon au profit d’une œuvre de bienfaisance en 1838. (V. Catalogue Robaut, no 108.)
- ↑ Vers 1820, Delacroix avait établi son atelier, 22, rue de la Planche, aujourd’hui rue de Varenne. Il ne quitta cet atelier qu’en octobre 1823, pour s’installer rue Jacob.
- ↑ Charles Pascot, négociant, puis intendant de la duchesse de Bourbon, avait épousé Adélaïde-Denise Œben, sœur cadette de la mère d’Eugène Delacroix.
- ↑ Tancrède, opéra italien de Rossini.
- ↑ On sait quelle admiration Delacroix professait pour le génie de Mozart. Cette reprise des Noces le préoccupait, et il l’attendait avec impatience, car le 30 août 1822, il écrivait à Pierret : « Dis-moi si tu sais qui fait le rôle de la comtesse dans les Nozze di Figaro que l’on joue à présent, depuis que Mme Mainvielle n’y est plus. » M. Burty ajoute en note : « Les Nozze furent données du 27 juillet au 14 septembre, quatre fois avec cette distribution : Almaviva, Levasseur ; Figaro, Pellegrini ; Bartolo, Profeti ; Bazilio, Deville ; Antonio, Auletta ; Comtessa, Bonini ; Suzanna, Naldi ; Cherubino, Cinti ; Marcelina, Goria ; Barberina, Blangy. » (Corresp., t. I, p. 91.)
- ↑ Ces préoccupations amoureuses le hantaient depuis sa première jeunesse. On pourrait rapprocher ce passage d’un fragment de lettre adressée à Pierret le 21 février 1821 : « Je suis malheureux, je n’ai point d’amour. Ce tourment délicieux manque à mon bonheur. Je n’ai que de vains rêves qui m’agitent et ne satisfont rien du tout. J’étais si heureux de souffrir en aimant ! Il y avait je ne sais quoi de piquant jusque dans ma jalousie, et mon indifférence actuelle n’est qu’une vie de cadavre. » (Corresp., t. I, p. 75.)
- ↑ Son neveu, Charles de Verninac, fils unique de sa sœur Henriette,
fut envoyé comme consul en Amérique et mourut en cinquantaine à
New-York, en 1834, des suites de la fièvre jaune qu’il avait contractée à
Vera-Cruz, à son retour de Valparaiso.
Charles de Verninac ressemblait à sa mère, qui était très belle et d’une grande distinction. Eugène Delacroix, au contraire, était d’une constitution délicate, et cet état de santé qui a commencé par de longues fièvres, en 1820, a beaucoup influé sur l’ensemble de ses idées pendant le cours de sa vie. - ↑ Ce tableau fut, en effet, exposé à la Société des Amis des arts et au Salon de 1827. Il fut acheté par le duc de Fitz-James et passa en Angleterre. (Voir le Catalogue Robaut.)
- ↑ « … Que ces Italiens me plaisent ! Je me consume à écouter leur belle musique et à dévorer des yeux leurs délicieuses actrices. Nous avons une espèce de Ronzi à ce théâtre, qui est venue fort à propos remplacer la nôtre, cette chère petite folle que j’ai bien regrettée, c’est Mme Pasta. Il faut la voir pour se figurer sa beauté, sa noblesse et son jeu admirable. » (Corresp., t. I, p. 86.)
- ↑ Roméo e Giuletta, opéra italien de Zingarelli.
- ↑ Lopez ou Lopès, peintre, demeuré inconnu. On trouve mentionné dans les catalogues des Salons de 1833 et 1835 le nom d’un Lopès, élève de …, qui doit être le même que le peintre en question, ami de jeunesse de Delacroix.
- ↑ Jean-Baptiste Mauzaisse, peintre de portraits et lithographe, élève de Vincent, né en 1784, mort en 1844.
- ↑ Delacroix, dans sa jeunesse, écrivait son journal d’une manière intermittente. Le décousu de sa vie, ses préoccupations d’art, un labeur incessant et concentré absorbaient ses loisirs et sa pensée. De là des lacunes fréquentes dans les notes qui se rapportent à cette période.
- ↑ Delacroix a retracé d’autre part, dans le cahier manuscrit dont nous avons déjà parlé, le caractère de ses relations avec Géricault : « Quoiqu’il me reçût avec familiarité, la différence d’âge et mon admiration pour lui me placèrent, à son égard, dans la situation d’un élève. Il avait été chez le même maître que moi, et, au moment où je commençais, je l’avais déjà vu, lancé et célèbre, faire à l’atelier quelques études. Il me permit d’aller voir sa Méduse pendant qu’il l’exécutait dans son atelier bizarre près des Ternes. L’impression que j’en reçus fut si vive qu’en sortant je revins toujours courant et comme un fou jusqu’à la rue de la Planche que j’habitais alors. » (Eugène Delacroix, Sa vie et ses œuvres, p. 61.)
- ↑ Il s’agit ici des quatre Anglais, les frères Fielding, Théodore, Copley, Thalès et Nathan, tous artistes, aquarellistes de talent. Le plus célèbre est Copley. Ce fut Thalès Fielding qui se lia le plus intimement avec Delacroix, pendant un séjour qu’il fit à Paris en 1823. M. Léon Riesener, dans ses notes sur Delacroix, donne des détails assez piquants sur la communauté d’existence des deux artistes : « Pour faire du café le matin, on ajoutait de l’eau et un peu de café sur le marc de la veille, dans l’unique bouilloire, jusqu’à ce qu’on fût forcé de la vider. De temps en temps on avait un gigot en provision, dans l’armoire, auquel on coupait des tranches pour les rôtir dans la cheminée. Mais un jour les deux amis, partageant ce déjeuner, se fâchèrent. Fielding disait très sérieusement qu’il descendait du roi Bruce. Delacroix l’appelait « Sire ». Mais Fielding ne pouvait sur ce sujet admettre la plaisanterie et se fâcha pour toujours. » (Corresp., t. I, p. 23.)
- ↑ François Taurel, peintre de marines, né à Toulon en 1787, mort à Paris en 1832.
- ↑ Le tableau dont parle ici Delacroix est sans doute resté inachevé,
car il ne se retrouve pas dans l’œuvre du maître et ne figure pas au catalogue
Robaut.
Sous ce même titre, Prud’hon exposa au Salon de l’an VI une gravure célèbre, dont la composition dramatique peut avoir tenté l’imagination toujours en éveil de Delacroix. Phrosine et Melidor est également le titre d’un opéra-comique en trois actes, de Méhul, dont le poème fort médiocre est d’Arnault, et qui fut représenté pour la première fois en 1794. Il se peut qu’après avoir vu jouer cette pièce, Delacroix ait songé à en tirer un sujet de tableau.
En l’absence de tout document, il est impossible de se prononcer entre ces deux hypothèses. - ↑ Peintre de portraits, né à Bourges en 1797, élève de Guérin. Ce fut à l’atelier de Guérin que Delacroix se lia avec Champmartin.
- ↑ Ici apparaît pour la première fois l’idée de ce tableau, il fut
exposé au Salon de 1824, acheté par l’État 6,000 francs ; il reparut à
l’Exposition universelle de 1855. Il appartient maintenant au Musée du
Louvre.
Le tableau était déjà achevé et déposé au Louvre, où se faisaient alors les Expositions annuelles de peinture, quand Delacroix vit des paysages de Constable qui le frappèrent ; en quelques jours il reprit son tableau et le transforma complètement. En 1847, il rappelle, dans son Journal, l’influence qu’a eue sur lui le paysagiste anglais. « Constable dit que la supériorité du vert de ses prairies tient à ce qu’il est un composé d’une multitude de verts différents. Ce qui donne le défaut d’intensité et de vie à la verdure du commun des paysagistes, c’est qu’ils la font d’une teinte uniforme. Ce qu’il dit ici du vert des prairies peut s’appliquer à tous les autres tons. »
On dit qu’en 1847 Delacroix retoucha à nouveau son tableau, prétendant que les tons avaient poussé au jaune. (Voir le Catalogue Robaut.) - ↑ Émilie Robert était son modèle favori qui posa pour le torse de la femme traînée par le giaour à la queue de son cheval dans le Massacre de Scio.
- ↑ Peintre, camarade d’atelier de Delacroix, demeuré inconnu.
- ↑ L’admiration de Delacroix pour Constable se maintint égale dans tout le cours de sa carrière. Dans une très belle lettre sur l’école anglaise de peinture, adressée à Th. Silvestre, et datée de 1858, l’artiste écrivait : « Constable, homme admirable, est une des gloires anglaises. Je vous en ai déjà parlé et de l’impression qu’il m’avait produite au moment où je peignais le Massacre de Scio. Lui et Turner sont de véritables réformateurs. Ils sont sortis de l’ornière des paysagistes anciens. Notre école, qui abonde maintenant en hommes de talent dans ce genre, a grandement profité de leur exemple. Géricault était revenu tout étourdi de l’un des grands paysages qu’il nous a envoyés. » (Corresp., t. II, p. 193.)
- ↑ Le Journal marque suffisamment l’intérêt qu’il prenait à cette composition
du Tasse. Dès 1819 il écrivait à Pierret : « N’est-ce pas que cette
vie du Tasse est bien intéressante ? Que cet homme a dû être malheureux !
Qu’on est rempli d’indignation contre ces indignes protecteurs
qui l’opprimaient sous le prétexte de le garantir contre ses ennemis, et
qui le privaient de ses chers manuscrits !… On pleure sur lui. On s’agite
sur sa chaise en lisant cette vie : les yeux deviennent menaçants, les
dents se serrent de colère ! » (Corresp., t. I, p. 42.)
Voir le Catalogue Robaut, no 88. - ↑ Frédéric Leblond fut un des intimes de Delacroix. Il était assidu aux réunions d’amis en compagnie desquels le peintre se reposait du labeur de la journée. Dans une longue lettre, curieuse en ce qu’il y raconte sa dernière visite au grand artiste mourant, Frédéric Leblond vante la solidité d’affection de Delacroix ; cette lettre fut publiée dans l’Artiste, et nous en détachons le passage suivant : « Ceux qui n’ont connu Eugène Delacroix que par ses grands travaux ne peuvent l’apprécier qu’à moitié. Il fallait vivre dans son intimité pour savoir les trésors de son cœur et de son esprit… C’est cette nature, si forte, si riche, et en même temps si simple et si naïve, qui a fait de lui l’homme le plus honnête, l’esprit le plus charmant, le cœur le plus généreux. Tu n’as pas oublié qu’en 1848 (nous n’étions pas riches alors), Delacroix, après avoir dîné gaiement avec nous, voulait nous forcer à prendre la moitié de son dernier billet de mille francs : « Qu’est-ce que cela en face de la Révolution et de l’éternité ? » (L’Artiste, 1864, p. 121.)
- ↑ Camarade d’atelier de Delacroix. Dans sa correspondance, Delacroix le traite assez rudement. À Soulier il écrit en 1821, lui reprochant de ne pas lui envoyer d’aquarelles de Florence où il se trouvait alors : « Vous en promettez, vous en annoncez à Perpignan, qui n’est qu’un profane, qu’un Welche en peinture », et dans une autre lettre au même Soulier, il écrit : « Ce Perpignan, il faut le confesser, est un grand vandale et un homme sans cérémonie. » (Corresp., t. I, p. 71 et 80.)
- ↑ Dans sa Correspondance, Delacroix parle à maintes reprises de la Saint-Sylvestre, qui, par une joyeuse habitude de jeunesse, était pour lui l’occasion d’une réunion intime avec ses camarades de la première heure, Félix Guillemardet et Pierret. M. Ph. Burty nous raconte qu’on la fêtait à tour de rôle chez l’un des trois amis ; on mangeait, on buvait, on s’embrassait à minuit. Dans une lettre à Pierret, datée de 1820, Delacroix s’écrie : « Là, à la lumière de la chandelle tout unie, on s’établit sur une table où l’on s’appuie les coudes et on boit et mange beaucoup pour avoir de ce bon esprit d’homme échauffé ! C’est là la gaieté, et que la note est vraie ! Ah ! que les potentats et les grands politiques sont à plaindre de n’avoir pas de Saint-Sylvestre ! » (Corresp., t. I, p. 54.)
- ↑ Lelièvre, peintre de portraits, demeuré inconnu. Il faisait partie avec Charlet, Chenavard, Comairas, d’un petit cercle intime, aux réunions duquel Delacroix se rendit fréquemment par la suite. Aux beaux jours, on se donnait volontiers rendez-vous chez lui, dans sa petite maison de l’île Séguin, à Sèvres, afin de peindre en pleine nature. (V. Chesneau, Peintres et sculpteurs romantiques, p. 81.)
- ↑ M. Coutan, l’amateur, dont parle ici Delacroix, a légué au Louvre un grand nombre de tableaux et de dessins de sa collection.
- ↑ Géricault allait succomber aux suites d’un accident de cheval. Il est facile de comprendre la tristesse qui envahissait Delacroix en présence de cette carrière brisée à trente-deux ans, si l’on songe que Géricault était, par la hardiesse de son génie et la fougue de son tempérament, le peintre de l’époque qui le mieux se rapprochait de Delacroix, si l’on songe encore que Delacroix avait fréquenté assidûment son atelier, suivi les progrès du fameux Naufrage de la Méduse, si l’on réfléchit enfin que Géricault avait été un des rares artistes sympathiques aux débuts de Delacroix ! Il n’est donc pas surprenant qu’à ces différents titres l’admiration du jeune peintre se manifeste sans réserves pour le talent de Géricault. Plus tard, avec la culture grandissante et le développement du sens critique, Delacroix apportera des restrictions à ses premiers enthousiasmes ; les dernières années du Journal, notamment l’année 1854, apparaissent singulièrement révélatrices sur la transformation de son jugement à l’égard de Géricault.
- ↑ Tout ce passage est extrait d’un petit cahier, qui porte cette seule mention : Fin 1823 et commencement 1824.
- ↑ Cette question du Beau inspira à Delacroix une de ses plus remarquables études critiques qui parut dans la Revue des Deux Mondes du 15 juillet 1854. Elle fait partie du volume des écrits du maître sous ce titre : Variations du Beau. Le sujet était éminemment favorable pour un esprit de l’envergure de Delacroix. C’est à propos de cet écrit que M. Paul Mantz dit très justement : « Il n’y faut pas voir un traité ex professo, mais une simple causerie sur un problème dont la solution a peut-être trop occupé les rêveurs. Sans prendre la peine de formuler rigoureusement sa pensée, sans attaquer de front le principe platonicien de l’absolu, l’auteur admet pour le Beau la multiplicité des formes. Il s’irrite contre ceux qui prétendent que l’antiquité a par avance monopolisé l’idéal et donné partout le modèle suprême. L’esthétique de Delacroix est donc essentiellement compréhensive et libérale. Il accepte l’art tout entier, et son idéal est assez vaste pour concilier Phidias et Rembrandt. Il n’y a là aucune confusion malsaine. Delacroix partait de ce principe que le style consiste dans l’expression originale des qualités propres à chaque maître… » (Paul Mantz, Revue française, 1er octobre 1864.)
- ↑ Sans doute un camarade du lycée Louis-le-Grand où Delacroix avait fait ses études.
- ↑ « Au milieu de mes occupations dissipantes quand je me rappelle quelques beaux vers, quand je me rappelle quelque sublime peinture, mon esprit s’indigne et foule aux pieds la vaine pâture du commun des hommes. » (Corresp., t. I, p. 19.)
- ↑ Probablement Abel Dimier, sculpteur, né en 1794.
- ↑ Restaurant du Palais-Royal, qui eut son heure de réputation avant la Révolution, jusqu’en 1793, et reprit ensuite sa vogue sous l’Empire et la Restauration.
- ↑ Sans aucun doute le général Charles Jacquinot, cousin germain de
Delacroix.
Son frère, le colonel Nicolas Jacquinot, devint sénateur sous l’Empire. - ↑ Zuchelli, chanteur du théâtre Italien, qui débuta le 20 octobre 1822 dans le rôle de Pharaon de Moïse en Égypte, opéra de Rossini.
- ↑ a et b Voir le Catalogue Robaut, no 54.
- ↑ Berryer était parent de Delacroix, petit-cousin, croyons-nous. Il est probable que c’est à ce titre que le général Jacquinot avait prié Delacroix de le mettre en relation avec le célèbre avocat. Bien qu’il y eût peu de points communs entre Delacroix et Berryer, lequel n’était nullement artiste, malgré sa curiosité des choses d’art, Delacroix allait souvent à Augerville, et il résulte de sa correspondance qu’il ne s’y déplaisait pas. Ses séjours dans la propriété de Berryer étaient autant de repos pour lui. Dans les dernières années du journal, il se montrera assez sévère pour l’esprit de son illustre parent, auquel il reprochera d’être éminemment superficiel. (V. Souvenus de M. Jaubert. Ce livre contient de très intéressants détails sur Delacroix, Berryer et la société d’Augerville.)
- ↑ Delacroix fait ici allusion, comme nous l’avons déjà dit dans notre étude, à l’un des fragments les plus fougueux de son Massacre de Scio au sujet duquel Th. Gautier écrivait : « Ces scènes horribles, dont nul ménagement académique ne dissimule la hideur, ce dessin fiévreux et convulsif, cette couleur violente, cette furie de brosse soulevaient l’indignation des classiques, et enthousiasmaient les jeunes peintres par leur hardiesse étrange et leur nouveauté que rien ne faisait pressentir. » Ce fut après le Massacre de Scio que M. de La Rochefoucauld, alors directeur des Beaux-Arts, fit appeler Delacroix pour lui recommander de « destiner d’après la bosse ».
- ↑ Cette idée de mémoire sur la peinture le poursuivit toute sa vie ;
elle se transforma par la suite en dictionnaire où chaque terme d’art est
expliqué et commenté par des exemples pris sur les maîtres.
Après plusieurs essais, il met enfin, en 1857, son idée à exécution. Le dimanche 11 janvier, il commence « un Essai d’un dictionnaire des Beaux-Arts, extrait d’un dictionnaire philosophique des Beaux-Arts ». - ↑ Il s’agit très probablement ici de Jean-Henri Dufresne, peintre, né à Étampes en 1788. Dufresne avait d’abord été magistrat à l’époque des Cent-jours ; mais ayant perdu sa place au retour des Bourbons, il se mit à l’étude des arts et exposa quelques paysages au Salon. Il publia également plusieurs livres d’éducation et de morale.
- ↑ Dans le cahier manuscrit dont nous avons déjà parlé, Delacroix
donne sur la mort de Géricault des détails qu’il nous a paru intéressant
de reproduire ici :
« Il faut placer au nombre des plus grands malheurs que les arts ont pu éprouver de notre temps la mort de l’admirable Géricault. Il a gaspillé sa jeunesse, il était extrême en tout : il n’aimait à monter que des chevaux entiers et choisissait les plus fougueux. Je l’ai vu plusieurs fois au moment où il montait à cheval : il ne pouvait presque le faire que par surprise ; à peine en selle, il était emporté par sa monture. Un jour que je dînais avec lui et son père, il nous quitte avant le dessert pour aller au bois de Boulogne. Il part comme un éclair, n’ayant pas le temps de se retourner pour nous dire bonsoir, et moi de me remettre à table avec le bon vieillard. Au bout de dix minutes, nous entendons un grand bruit : il revenait au galop, il lui manquait une des basques de son habit : son cheval l’avait serré je ne sais où et lui avait fait perdre cet accompagnement nécessaire. Un accident de ce genre fut la cause déterminante de sa mort. Depuis plusieurs années déjà, les accidents, suites de la fougue qu’il portait en amour comme en tout, avaient horriblement compromis sa santé : il ne se privait pas pour cela tout à fait du plaisir de monter à cheval. Un jour, dans une promenade à Montmartre, son cheval l’emporte et le jette à terre. Le malheur voulut qu’il portât par terre ou contre une pierre à l’endroit de la boucle absente de son pantalon où se trouvait un bourrelet qu’il avait formé pour y suppléer.
Cet accident lui causa une déviation dans l’une des vertèbres, laquelle n’occasionna pendant un temps assez long que des douleurs qui ne furent pas un avertissement suffisant du danger. Biot et Dupuytren s’en aperçurent quand le mal était déjà presque sans remède : il fut condamné à rester couché, et moins d’un an après il mourut, le 28 janvier 1824. »(Eugène Delacroix, sa vie et ses œuvres.)
- ↑ Ce devait être quelque guinguette de la banlieue où les jeunes artistes aimaient à aller festoyer. Plus tard, en 1850, écrivant à Soulier, Delacroix rappelle ces parties de jeunesse : « Où sont les dîners chez la mère Tautin, à travers les neiges, en compagnie des voleurs et des commis aux barrières ! » (Corresp., t. II, p. 45.)
- ↑ On trouve ici l’idée première de cette illustration de Faust que Delacroix exécuta par la suite en dix-sept lithographies admirables d’originalité et de verve. Les gravures du Faust dont il est question ici sont vraisemblablement les douze planches du célèbre artiste allemand Pierre de Cornelius qui datent de 1810.
- ↑ Un des traits caractéristiques de la nature de Delacroix, à l’époque de sa première jeunesse, fut ce besoin de distractions, cette recherche du plaisir. Il obtenait d’ailleurs de réels succès, si l’on en croit ceux qui l’ont connu, plutôt comme homme du monde que comme artiste. Baudelaire, à qui Delacroix avait fait la confidence de ses préoccupations mondaines, note très justement qu’elles disparurent avec l’âge, et qu’un seul besoin impérieux les remplaça, l’amour du travail.
- ↑ Cette pièce de Goethe a souvent inspiré Delacroix. Voici les différentes
œuvres que cite le Catalogue Robaut :
Année 1828, Selbitz blessé (IIIe acte de Gœtz) : 1° dessin à la mine de plomb, ayant appartenu à M. Riesener ; 2° aquarelle, vendue 65 francs, en 1874 (vente Jacques Léman).
À diverses reprises, de 1836 à 1843, Delacroix travaille à une suite de lithographies : 1° Frère Martin serrant la main de fer de Gœtz (acte I, scène II) ; 2° Weislingen attaqué par les gens de Gœtz (acte I, scène II) ; 3° Weislingen prisonnier de Gœtz (acte I, scène IV) ; 4° Gœtz écrit ses mémoires (acte IV, scène V) ; 5° Gœtz blessé recueilli par les Bohémiens ; 6° Adélaïde donne le poison au jeune page (acte V, scène VIII) ; 7° Weislingen mourant (acte V, scène X).
Vers 1836, il fait une nouvelle série de dessins : 1° George affublé d’une armure, plume et encre de Chine (acte I, scène II); 2° L’Évêque et Adélaïde jouant aux échecs, même planche (acte II, scène I) ; 3° Adélaïde congédiant Weislingen, mine de plomb (acte II, scène VI) ; 4° Lerse, aquarelle (acte II, scène VI ; acte III, scène VI) ; 5° Gœtz et les paysans, mine de plomb (acte V, scène V); 6° Adélaïde donne le poison au jeune page (mine de plomb et lavis).
Il reprend encore le drame de Gœthe, vers 1843, il fait une série de gravures sur bois pour le Magasin pittoresque : 1° Frère Martin et Gœtz ; 2° Gœtz blessé ; 3° Gœtz écrivant ses mémoires ; 4° Mort de Gœtz.
En 1850, deux toiles : l’une, Weislingen enlevé par les gens de Gœtz ; l’autre, Gœtz recueilli par les Bohémiens. - ↑ Cicéri, peintre décorateur, né en 1782 ; encore enfant il dirigea l’orchestre du théâtre Séraphin et entra à dix-sept ans au Conservatoire. Obligé de renoncer à la carrière dramatique par un accident qui le rendit boiteux, il étudia le dessin sous la direction de l’architecte Bellange et la peinture de décors dans les ateliers de l’Opéra dont il fut bientôt nommé décorateur en chef. Il avait été chargé des décorations ornementales de la bibliothèque du Palais-Bourbon.
- ↑ Henri Scheffer, peintre français, frère d’Ary Scheffer, né en 1798. Il fut élève de Guérin, et ce fut à l’atelier de Guérin que Delacroix fit sans doute sa connaissance. Il débuta au Salon de 1824, comme peintre d’histoire ; il a cultivé aussi d’autres genres et fait des portraits
- ↑ Cette observation nous paraît intéressante à rapprocher d’un autre passage du journal, dans lequel Delacroix fait la remarque, toujours à propos de musique, que la société des gens du monde, leurs conversations, et la légèreté qu’ils apportent dans tout ce qui touche aux choses d’art, constituent le milieu le plus déplorable pour en jouir.
- ↑ Les Aventuriers, ou le Naufrage, mélodrame à spectacle, en trois actes, en prose, de MM. Léopold Chandezon et Antony Béraud, représenté pour la première fois à l’Ambigu-Goinique le 7 février 1824, avec un succès complet et mérité.
- ↑ Thomas Otway, poète dramatique anglais, né en 1651, mort en 1685. Acteur et soldat tour à tour, dissipé et besogneux, il eut la vie irrégulière et la fin prématurée de la plupart des poètes dramatiques du temps d’Élisabeth. Il écrivit des tragédies et des comédies, dont quelques-unes sont imitées de Racine et de Molière. Les principales sont Aleibiade, Caïus Marius, Titus et Bérénice, d’après Racine ; les Fourberies de Scapin, d’après Molière ; une Venise sauvée, inspirée d’une nouvelle historique de Saint-Réal.
- ↑ Ary Scheffer.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 283.
- ↑ S’agit-il ici de Henri Jacob, lithographe, né en 1781, qui fut dessinateur du prince Eugène et qui ouvrit un atelier à Paris sous la Restauration, ou simplement de l’un des cousins germains de Delacroix, Charles, Léon et Zacharie Jacob ? Il est difficile de le deviner en lisant ce passage.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 75.
- ↑ Éditeur d’estampes, très connu à cette époque.
- ↑ Delacroix, très préoccupé dès cette époque, comme il le fut toute sa vie, d’étudier la nature sur le vif, soucieux ayant tout de vérité et de vie, faisait de nombreuses études de chevaux. Il rencontrait au manège un certain nombre de jeunes gens dont les noms reviennent à maintes reprises dans les premières années de ce journal.
- ↑ Menjaud était un acteur célèbre de l’époque. Il se livra d’abord à la peinture, puis entra au Conservatoire. Il joua avec Talma et Mlle Mars. Il occupa les premiers rôles dans Turcaret, le Misanthrope, Don Juan.
- ↑ Probablement la petite aquarelle mentionnée au Catalogue Robaut, no 211.
- ↑ Vittoria Colonna, marquise de Pescara, célèbre par sa beauté, ses vertus et son talent de poète. On connaît d’elle deux portraits célèbres, l’un de Sébastien del Piombo, l’autre du Mutien (Muziano), élève du Titien (Tiziano). Il y a ici évidemment une confusion dans l’esprit de Delacroix entre le Mutien et le Titien.
- ↑ Lamey, cousin de Delacroix, devint président de cour à Strasbourg.
- ↑ Dès sa vingtième année, Delacroix avait compris, comme tous les
hommes supérieurs, que la véritable instruction n’est pas celle que l’on
reçoit de ses maîtres, mais bien celle que l’on se donne à soi-même. Dans
une lettre très curieuse, adressée à Pierret en 1818, il écrivait : « Il faut
cet hiver nous voir bien souvent, lire de bonnes choses. Je suis tout
surpris de me voir pleurer sur du latin. La lecture des anciens nous
retrempe et nous attendrit : ils sont si vrais, si purs, si entrants dans
nos pensées ! »
A propos d’Horace, il dit autre part : « Horace est à mon avis le plus grand médecin de l’âme, celui qui vous relève le mieux, qui vous attache le mieux à la vie dans certaines circonstances, et qui vous apprend le plus à mépriser dans d’autres. » (Corresp., t. I, p. 15 et 24.) - ↑ Le premier Diorama fut établi en 1822, rue Samson, derrière le Château-d’Eau.
- ↑ Ces questions d’hygiène favorable au travail intellectuel préoccupaient Delacroix. Baudelaire, qui le fréquentait dans l’intimité, nous le montre saisissant sa palette « après un déjeuner plus léger que celui d’un Arabe ». Dans la seconde partie de sa vie il eut cruellement à souffrir de lourdeurs d’estomac, et ce fut sans doute cette raison qui l’amena à modifier son hygiène : il déjeunait à peine et ne prenait qu’un fort repas, celui du soir.
- ↑ Il est intéressant de rapprocher cette appréciation sur Charlet formulée en 1824, de l’article que Delacroix lui consacra, après sa mort, en 1862, dans la Revue des Deux Mondes. « Son talent n’avait point eu d’aurore, il est arrivé tout armé, pourvu de ce don d’imaginer et d’exécuter qui fait les grands artistes. Il a même cela de remarquable que la première période de son talent est celle où ce talent est le plus magistral. Dans les sujets aussi simples et, ce qu’il y a de plus difficile, dans la représentation de scènes vulgaires dont les modèles sont sous nos yeux, Charlet a le secret d’unir la grandeur et le naturel. » (Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1862.)
- ↑ Italiana in Algeri, opéra italien de Rossini.
- ↑ Charles Demeulemeester, graveur belge, élève de Bervic, né Bruges en 1771, mort en 1836. Il avait fait à Rome en 1806 des copies à l’aquarelle des Loges du Vatican, et s’était ensuite entièrement consacré à les reproduire par la gravure. Il laissa cette œuvre immense inachevée. C’est évidemment à ce travail considérable que Delacroix fait allusion.
- ↑ Le duc d’Orléans, qui manifesta toujours un goût très vif pour les arts, s’était constitué le protecteur des artistes de son temps. Il entretint notamment avec Decamps et Delacroix des relations assez suivies ; à la différence de Louis-Philippe, le Prince avait pour le talent de Delacroix une admiration toute particulière : il venait à l’atelier du maître et suivait ses travaux. Deux des plus belles toiles de Delacroix, le Meurtre de l’évêque de Liège et la Noce juive au Maroc, furent achetées par le duc d’Orléans ; la première avait été même composée spécialement pour lui. Enfin, si l’on feuillette attentivement les catalogues des ventes de la maison d’Orléans, on voit que de nombreuses œuvres du maître figurèrent dans la galerie du fils aîné de Louis-Philippe. (Voir Catalogue Robaut, passim.)
- ↑ Jean-Hector Schnetz, peintre, né à Versailles en 1787, mort en 1870, élève de David, de Gros et de Gérard. Il fut directeur de l’Académie de France à Rome.
- ↑ Charles Steuben, peintre d’histoire et portraitiste, né à Manheim. Delacroix le connut à l’atelier de Gérard, chez lequel Steuben se présenta muni de lettres de recommandation de Schiller et de Mme de Staël. Il fut élève de Prud’hon et débuta au Salon de 1812. Il peignit pour les galeries de Versailles les Batailles de Tours, de Poitiers, de Waterloo. Il exécuta aussi les portraits des rois de France Charles II, Louis II, Eudes, Charles IV, Lothaire, Louis V, Hugues-Capet, et pour le Louvre, la Bataille d’Ivry.
- ↑ La Panhypocrisiade, de Népomucène Lemercier, poème satirique en seize chants, singulier ramassis de scènes sans liaison, mais dont quelques-unes sont fort belles.
- ↑ On voit ici la première idée d’une composition qui devait être une de ses plus belles œuvres, connue sous ces noms : Melmoth ou Intérieur d’un couvent de Dominicains à Madrid, ou l’Amende honorable. Cette composition lui fut inspirée par la salle du Palais de justice de Rouen. Nous extrayons à ce sujet d’une biographie de Corot, publiée par M. Robaut, un passage marquant la profondeur de l’impression que le paysagiste avait éprouvée en voyant le tableau de Delacroix : « Nous étions assis sur l’un des bancs qui font le tour de la salle des Pas perdus ; il était là, silencieux depuis un moment, les yeux levés sur les hautes voûtes en bois sculptés, quand tout à coup il s’écria : Quel homme ! quel homme ! Il revoyait dans sa pensée le tableau de l’Amende honorable que nous avions admiré ensemble quelques jours auparavant… » On sait que les deux artistes avaient l’un pour l’autre une vive admiration.
- ↑ Don Quichotte dans sa librairie. (Voir Catalogue Robaut, no 138.)
- ↑ Achille ou Eugène Devéria, car Delacroix était également lié avec les deux frères.
- ↑ Delacroix ne considérait pas comme sérieux ses premiers essais, remontant à 1817 : mais on sait que plus tard il devint un maître du dessin lithographique.
- ↑ Une des raisons qui sans doute contribuèrent le plus à la rédaction du Journal, du moins dans les premiers temps de la carrière artistique de Delacroix, fut le manque de mémoire dont il se plaint à plusieurs reprises et auquel ce passage fait allusion ; et puis, de même qu’il croyait à la nécessité d’une hygiène physique rigoureuse pour favoriser le travail de l’esprit, il était intimement convaincu de l’utilité d’une hygiène mentale journalière comportant des obligations strictes et des exercices réguliers. Ces principes de conduite ne contribuèrent pas peu à l’admirable fécondité dont il donna l’exemple.
- ↑ Comairas avait peint des études vraiment remarquables ; il possédait également quelques œuvres d’anciens maîtres.
- ↑ Tableau de Girodet, exposé au Salon de 1810, et qui se trouvait alors au Luxembourg. Le tableau est actuellement au musée de Versailles. Le musée du Luxembourg conserve dans ses archives un curieux pastel qui a servi d’étude pour ce tableau ; il représente un Hussard luttant contre un Mameluk.
- ↑ Probablement Roger délivrant Angélique, qui figura au Salon de 1819 et se trouve actuellement au musée du Louvre.
- ↑ Dante et Virgile.
- ↑ Massacre de Scio.
- ↑ Drolling, peintre d’histoire, né en 1786, mort en 1851, élève de David, prix de Rome en 1810.
- ↑ Portrait-étude d’Élisabeth Salter, modèle connu de l’époque.
- ↑ Il ressort clairement de ce passage que Delacroix avait posé lui-même dans l’atelier de Géricault pour une figure d’homme placée sur le devant du radeau de la Méduse, la tête penchée en avant et les bras étendus. Il existe même un dessin à la mine de plomb in-4o qui a précédé la peinture (voir Catalogue Robaut, no 9). Mais Delacroix fait évidemment allusion ici à la tête d’étude, bien plus grande que nature, qui a passé à la vente P. Andrieu, et que possède aujourd’hui le musée de Rouen.
- ↑ Marcos Botzaris, l’un des héros de la Grèce moderne, qui contribua à l’insurrection de 1820. Il se signala dans de nombreux combats et s’enferma dans les murs de Missolonghi ; cette place étant près de se rendre, il s’efforça de la sauver par un acte de dévouement semblable à celui de Léonidas ; il pénétra de nuit avec trois cents hommes dans le camp des Turcs ; mais il fut atteint d’une balle à la tête et mourut à Carpenitza (1823). (Voir Catalogue Robaut, nos 1407 et 1408.)
- ↑ Ces conseils d’hygiène mentale, qui reviennent à chaque page du Journal et au sujet desquels nous avons insisté dans notre étude, Delacroix ne se contentait point de se les prodiguer à lui-même ; il aimait à en donner de semblables à ses amis. C’est ainsi qu’il écrivait à Pierret : « Lutte avec courage contre tes malheurs et ne laisse perdre aucune parcelle de ce temps qui ne sera pas ingrat et t’apportera plus tôt que tu ne penses le fruit de tes sueurs. Quand tu auras conquis par ta force la douce indépendance, comme tu l’aimeras mieux toi-même ! » (Corresp., t. I, p. 51.)
- ↑ Joseph-Louis Leborne, peintre, né à Versailles en 1796. Il se livra à la fois à la peinture de paysage, à la peinture historique et à la lithographie ; il exposa fréquemment jusqu’en 1840.
- ↑ Henri Decaisne, peintre, né à Bruxelles en 1779, mort en 1852,
élève de David, Gros et Girodet, fit surtout des tableaux d’histoire.
En 1824, il s’occupait spécialement de lithochromie avec son frère Joseph Decaisne, également peintre, puis botaniste distingué, qui devint membre de l’Institut. - ↑ Probablement un album. (Voir Catalogue de la vente Coutan, 1889, no 211.)
- ↑ Deloches, peintre, resté inconnu, contemporain de Delacroix.
- ↑ Planat, peintre de portraits, né en 1792, mort en 1866. Delacroix écrivait à propos de lui à Soulier : « Je suis bien charmé d’apprendre que tu aies trouvé Planat à Florence. C’était un fort bon garçon. Il avait au collège un grand amour pour le dessin et y réussissait fort bien. Il doit bien faire à présent. Tu ne me dis pas s’il a jeté son bonnet par-dessus les murs et s’il est peintre tout à fait, ou bien s’il a encore comme toi un pied dans quelque petit bout de chaîne. » (Corresp., t. I, p. 76.)
- ↑ Dans le cours du Journal, on trouvera indiqué plus d’un projet de voyage que l’artiste ne réalisa jamais. Il est important de noter qu’il ne visita pas les musées d’Italie. En 1821, il écrivait à Soulier, alors installé à Florence : « Dieu, quel pays ! Comment, vous avez des ciels comme cela ? Des montagnes comme cela ? Je ne plaisante pas, ce diable de dessin m’avait tourné la tête, et j’avais déjà fait une foule de plans superbes pour aller manger mon petit revenu dans la Toscane, auprès de toi, mon cher ami. Mais ne parlons pas de tout cela. Je n’aurai jamais la force de prendre une résolution, et je pourrirai toute ma vie où le ciel m’a jeté en commençant. » (Corresp., t. I, p. 78.)
- ↑ Alexandre Batton, compositeur et pianiste, né à Paris le 2 janvier 1797, mort le 15 octobre 1855, élève de Gliérubini, prix de Rome en 1816.
- ↑ Marochetti, sculpteur français né à Turin en 1805 de parents naturalisés Français, mort en 1867. Son œuvre est importante et lui valut de nombreuses récompenses. Il fut notamment chargé d’exécuter un des bas-reliefs de l’Arc de triomphe de l’Étoile.
- ↑ Antoine Allier, sculpteur français, qui siégea plus tard comme député aux Assemblées législatives de 1839 à 1851. Il exécuta un grand nombre de compositions, de bustes et de statues, qui furent exposés au Salon, de 1822 à 1835. Delacroix fait sans doute allusion ici à sa figure intitulée : Jeune marin expirant.
- ↑ William Godwin. Économiste et romancier anglais, né en 1756, mort en 1836. Après quelques années de travaux, il devint du coup célèbre par la publication de deux ouvrages : un traité de politique sociale et un roman. Le premier, intitulé Recherches touchant la justice politique et son influence sur la vertu et le bonheur gêneral, parut en 1793. Dans cet ouvrage, Godwin a la prétention de réformer la société d’après des données rationnelles tirées de la philosophie du dix-huitième siècle et de l’esprit de la Révolution française. Son roman, Caleb Williams, fut inspiré par un même sentiment d’indignation contre les vices de la société qui l’entourait. Sa fille épousa le poète Shelley, et il est probable que les idées de Godwin ne furent pas étrangères aux tendances révolutionnaires et rénovatrices de l’auteur des Cenci.
- ↑ Les idées de Delacroix sur l’amitié s’étaient modifiées avec l’expérience de la vie. Nous rapprocherons simplement de cette remarque un court fragment d’une lettre écrite à Pierret en 1820 : « Sainte amitié, amitié divine, excellent cœur ! Non, je ne suis pas digne de toi. Tu m’enveloppes de ton amitié, je suis ton vaincu, ton captif. Bon ami, c’est toi qui sais aimer. Je n’ai jamais aimé un homme comme toi, mais ton cœur, j’en suis sûr, sera inépuisable. » (Corr., t. I, p. 52.)
- ↑ Cette toile a été au Salon de 1827, puis aux Expositions universelles de 1855 et de 1878. Appartient à l’église Saint-Paul Saint-Louis, rue Saint-Antoine. (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ Le maître doit faire allusion a la composition classée à l’année 1826, qui a été précédée d’études d’aquarelles et de pastels divers. La composition définitive est le fameux tableau du Christ au jardin des Oliviers, qui se trouve à l’église Saint-Paul-Saint-Louis. La commande lui était venue de la préfecture de la Seine. C’est pourquoi Delacroix baptisa le tableau « Anges du préfet ».
- ↑ Claude-Étienne Savary, voyageur et orientaliste, né en 1750, mort en 1788. On a de lui Lettres sur L’Égypte (1784-1789, 3 vol. in-8o), livre aux descriptions pittoresques, au style brillant, qui eut un très vif succès ; Lettres sur la Grèce (1788, in-8o), livre intéressant, mais resté inachevé, etc., etc.
- ↑ Cette traduction est en vers avec le texte en regard et un discours sur Dante, etc. (1 vol. in-8o.)
- ↑ Quatremère de Quincy, archéologue, né en 1755, mort en 1849. On le destinait au barreau, mais il se sentait poussé par une irrésistible vocation vers l’étude de l’architecture, de la sculpture et surtout de l’art antique. Il abandonna le droit et voyagea en Italie. La Révolution interrompit ses études ; il fut député à l’Assemblée législative, puis fit partie du conseil des Cinq-Cents. Il laissa de nombreux ouvrages d’esthétique, notamment cette Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, dont parle Delacroix.
- ↑ C’est là, sous les ombrages de ce jardin du Luxembourg où, en 1824, Delacroix éprouvait ces sentiments de bien-être et de liberté, que se dresse aujourd’hui le monument élevé à la mémoire et à la gloire du maître par ses fidèles admirateurs.
- ↑ Pinelli, célèbre peintre et graveur italien, né à Rome en 1781, mort en 1835. Il gravait surtout à merveille à l’eau-forte, et on a de lui, en ce genre, des œuvres d’une touche pleine de vivacité, de force et d’éclat.
- ↑ Du Fresnoy, amateur de l’époque.
- ↑ Ces émotions de nature, dont on trouve ici les premières traces, devaient jouer un grand rôle dans le développement sentimental et artistique de Delacroix. Il nous parait intéressant d’insister sur ce point, d’autant mieux qu’une des plus belles pages de son Journal, une des plus accomplies comme forme littéraire, et qui se trouve dans un cahier de l’année 1854, lui fut inspirée par une impression analogue à celle que nous voyons notée ici.
- ↑ Dans la correspondance du maître comme dans son journal, on trouve les traces de son noble désintéressement, de son culte passionné pour l’art : « Nous vivons, mon bon ami, dans un temps de découragement, écrit-il à Félix Guillemardet en 1821. Il faut de la vertu pour y faire un Dieu du Beau uniquement. Eh bien, plus on le déserte, plus je l’adore. Je finirai par croire qu’il n’y a au monde de vrai que nos illusions. » (Corresp., t. I, p 73.)
- ↑ Delacroix veut sans doute parler d’un recueil élégiaque, les Tristes, que M. de Belmontet fit paraître en 1824.
- ↑ Ferdinand Paër, compositeur et pianiste, aujourd’hui bien oublié, jouissait à cette époque d’une grande réputation. Il naquit à Parme, en 1774, et mourut en 1839. À quatorze ans, il fit représenter à Venise l’opéra de Circé. Il séjourna à Padoue, Milan, Florence, Naples, Rome et Bologne, et y composa de nombreux ouvrages avec cette facilité qui caractérisait les musiciens de l’École italienne. Emmené en France, en 1806, par Napoléon, il dirigea à plusieurs reprises le Théâtre-Italien. Ses principaux ouvrages sont : la Clémence de Titus, Cinna, Idoménée, la Griselda, l’Oriflamme, la Prise de Jéricho. En 1838, Delacroix, qui se présentait à l’Institut, écrivait à Alfred de Musset : « Avez-vous la possibilité de me faire recommander à Paër, pour l’élection prochaine à l’Institut ? Si cela ne vous engage pas trop, ni ne vous dérange, je vous demanderai le même service que l’année dernière ; mais surtout ne vous gênez pas, si vos rapports ne sont plus les mêmes. » (Corresp., t. I, p. 235.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1493.
- ↑ Delacroix a repris plusieurs fois ce sujet. En voici les principales
variantes. Le tableau dont il est ici question parut au Salon de 1827. Il
a appartenu à Alexandre Dumas père, et aujourd’hui appartient à
M. Mailler. (Voir Catalogue Moreau.)
Une lithographie différant absolument du premier tableau parut aussi vers 1827. Une nouvelle toile, datée de 1835, fut exposée au Salon de 1835, à l’Exposition universelle de 1855 et à celle du Pavillon de Flore, 1878. — Vente Gollot, 1850, achetée 1,600 francs ; vente Laurent Richard, 1878, retirée à 27,000 francs ; appartient maintenant au baron Gérard. Une troisième toile fut signée en 1856. (Voir Catalogue Robaut, nos 202, 203, 600, 601 et 1293.) - ↑ Ce M. Rivière était un ami intime de Delacroix ; car, dans une lettre à Pierret datée de Londres en 1825, il dit : « Si tu vois M. Rivière, pour qui tu sais que nous avons tous deux beaucoup d’amitié, dis-lui mille choses de ma part et que ses jugements sur ce pays-ci sont bien justes pour moi. » (Corresp., t. I, p. 104.)
- ↑ Duponchel, ancien directeur de l’Opéra, né à Paris vers 1795, mort en 1868. Deux fois il dirigea l’Académie de musique, de 1835 à 1843, puis de 1847 à 1849. Delacroix l’avait connu à Londres en 1825, et il écrivait à Pierret : « Il est pour moi la boussole de la mode, comme on peut penser. » (Corresp., t. I, p. 106.)
- ↑ Bothwell, drame en cinq actes, en prose, par M. A. Empis, représenté pour la première fois sur le Théâtre-Français, le 23 juin 1824.
- ↑ Manque dans le manuscrit.
- ↑ Sans doute le docteur Joseph Bailly, né en 1779, mort en 1832, qui fit les campagnes du Consulat et de l’Empire, et publia des ouvrages appréciés.
- ↑ La suite manque dans le manuscrit.
- ↑ Cette idée de lutte qu’on retrouvera, d’ailleurs, à maintes reprises dans son Journal, n’était que le corollaire, la conséquence de l’opinion que professait le maître sur la méchanceté naturelle de l’homme : « Je me souviens fort bien, disait-il parfois, que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du devoir ne s’acquiert que très lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment et par l’exercice progressif de la raison que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle. » (Baudelaire, L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix. — Art romantique.)
- ↑ Jean-Nicolas Laugier, graveur français, qui attacha son nom à la reproduction d’un grand nombre d’œuvres des principaux peintres de cette époque, David, Gros, Prud’hon, Gérard, Coignet, etc.
- ↑ Esther Mombelli, cantatrice italienne, qui obtint de 1823 à 1826 un immense succès au Théâtre-Italien ; elle épousa le comte Gritti en 1827 et renonça ensuite définitivement au théâtre.
- ↑ Pierre de Portugal, tragédie en cinq actes et en vers, de Lucien
Arnault, représentée pour la première fois au Théâtre-Français le 21 octobre
1823.
Les Plaideurs sans procès, comédie en trois actes et en vers, d’Étienne, représentée pour la première fois au Théâtre-Français le 29 octobre 1821. - ↑ Mayer, peintre, demeuré inconnu. Delacroix écrivait de Londres en 1825 : « J’ai rencontré Mayer qui gagne de l’argent, beaucoup, avec des portrait». » (Corresp., t. I, p. 106.)
- ↑ Frépillon, près Saint-Leu-Taverny. C’est là que Riesener, l’oncle de Delacroix, passait l’été.
- ↑ Dans une note de la Correspondance de Delacroix, M. Burty
écrit : « Ce M. Auguste, — c’est ainsi que le désignaient toujours ses
contemporains, — avait obtenu le second grand prix de sculpture et
était pari pour Rome en même temps que Ingres. Il devint un riche
dilettante, qui mettait ses collections d’armes et de costumes orientaux
à la disposition des artistes romantiques. Il signala le premier à Géricault
et à Delacroix l’intérêt capital des marbres du Parthénon,
recueillis par lord Elgin et exhibés à Londres. »
(V. le livre de M. Ernest Chesneau : Peintres et statuaires romantiques, p. 70 à 73.) - ↑ Haydon, peintre anglais, né en 1786, mort en 1846. Il fut l’élève de Fuessli. Il a laissé de curieux Mémoires.
- ↑ Il s’agit ici de la célèbre collection de sculptures en marbre que lord Elgin rapporta d’Athènes en 1814 et qui fut déposée au British Museum.
- ↑ Comte de Forbin, peintre et archéologue français, né en 1777, mort en 1841. Il fut élève de David. Nommé sous la Restauration directeur des Musées nationaux, il réorganisa le musée du Louvre, dépouillé pendant l’invasion d’un grand nombre de ses chefs-d’œuvre ; il l’enrichit notamment de l’Enlèvement des Sabines et du Naufrage de la Méduse.
- ↑ Granet, peintre, né à Aix en 1775. Il fut protégé durant toute sa carrière par le comte de Forbin, aux tableaux duquel il collabora, dit-on.
- ↑ Gassies, peintre, né à Bordeaux en 1786, mort en 1831, élève de Vincent et de David. Il fit de la peinture d’histoire, de marines et de paysage.
- ↑ D’Houdetot, administrateur et homme politique, né en 1778, mort en 1859. Il cultiva avec un certain succès la peinture, qu’il avait apprise sous Regnault et Louis David, et devint en 1841 membre libre de l’Académie des Beaux-Arts.
- ↑ L’opinion flatteuse de Gérard avait été très sensible à Delacroix. Gérard avait été frappé des débuts du jeune peintre ; on lui prête ce mot : « C’est un homme qui court sur les toits. » Mais, comme dit Baudelaire, « pour courir sur les toits, il faut avoir la tête solide », et cette apparente critique n’était en réalité que le voile dont il couvrait l’étonnement que lui avaient inspiré ses admirables débuts. En 1837, Delacroix posa sa candidature au fauteuil de Gérard : « Je vous prie, écrivait-il au président, de vouloir bien faire agréer, par la classe des Beaux-Arts, ma candidature à la place vacante dans son sein par la mort de M. Gérard. En mettant sous ses yeux les titres sur lesquels je pourrais fonder mes prétentions à l’honneur que je sollicite, je ne puis me dissimuler leur peu d’importance, surtout dans cette occasion où la perte d’un maître aussi éminent que M. Gérard-laisse dans l’École française un vide qui ne sera pas comblé de longtemps. » (Corresp. t. I, p. 215.)
- ↑ Le journal subit ici une interruption de plusieurs années, soit que
Delacroix eût alors cessé de prendre ses notes journalières, soit que les
petits cahiers où il inscrivait ses impressions aient disparu ; cette dernière
hypothèse nous paraît la plus vraisemblable.
Sur cette période de sa vie (1825-1832) il n’a été retrouvé, en fait de document intime, qu’un petit album rouge que Delacroix portait sur lui dans son voyage en Angleterre (1826) et qui contient des croquis de paysages.
On y lit aussi ces courtes réflexions inspirées par la vie et la mort de lord Byron, pour qui Delacroix eut toujours une admiration passionnée. L’idée qu’il exprime sur le malheur réservé aux grands hommes lui tenait au cœur, car il l’a développée à plusieurs reprises ; il remarque quelque part que « les grands hommes ont une vie plus traversée et plus misérable que les autres ». - ↑ Cet article parut dans la Revue de Paris en 1830. Delacroix avait inscrit en tête de son étude ce fragment des poésies du grand artiste qui peint si exactement la hauteur et la fierté d’âme qu’il admirait en lui par-dessus toutes choses : « J’ai du moins cette joie, au milieu de mes chagrins, que personne ne lit sur mon visage ni mes ennuis ni mes désirs. Je ne crains pas plus l’envie que je ne prise les vaines louanges de la foule ignorante… et je marche solitaire dans les routes non frayées. »
- ↑ John Burnet, graveur et peintre anglais, né en 1784, mort en 1862 ; auteur d’un grand nombre de planches remarquables.
- ↑ Le reste manque dans le manuscrit.
- ↑ Delacroix fit ce voyage au Maroc en compagnie du comte de Mornay, ambassadeur de France près l’empereur Muley-Abd-Ehr-Rhaman. Dans sa correspondance, il décrit ainsi son arrivée à Tanger : « A neuf heures, nous avons jeté l’ancre devant Tanger. J’ai joui avec bien du plaisir de l’aspect de cette ville africaine. Ç’a été bien autre chose, quand, après les signaux d’usage, le consul est arrivé à bord dans un canot qui était monté par une vingtaine de marabouts noirs, jaunes, verts, qui se sont mis à grimper comme des chats dans tout le bâtiment et ont osé se mêler à nous. Je ne pouvais détacher mes yeux de ces singuliers visiteurs. » {Corresp., t. I, p. 173.)
- ↑ Il nous parait indispensable, pour expliquer le décousu de ces notes
rapides sur le Maroc, d’indiquer de quelle manière Delacroix les prenait.
Le petit cahier dans lequel elles se trouvent et qui fut légué à M. le professeur
Charcot par M. Burty, contient, en regard de presque toutes, des
croquis et des esquisses qui en sont pour ainsi dire l’illustration, si
bien qu’elles forment un tout en quelque sorte inséparable.
Le soin minutieux avec lequel Delacroix note les moindres détails du voyage, costumes, paysages, physionomies, attitudes, montre à quel degré l’artiste poussait cet esprit d’observation pénétrante qu’on retrouve dans son œuvre. - ↑ Sidi Taieb Bias ou Biaz, Marocain, administrateur de la douane de Tanger, et chargé par le gouvernement du Maroc de traiter avec le comte de Mornay.
- ↑ « Les Juives sont admirables, écrivait Delacroix à Pierret, le 25 janvier ; je crains qu’il ne soit difficile d’en faire autre chose que de les peindre : ce sont des perles d’Eden. » (Corresp., t. I, p. 174.)
- ↑ A propos des paysages si nouveaux pour lui et des traits de mœurs qui le frappaient, l’artiste écrivait, toujours à Pierret : « Je viens de parcourir la ville, je suis tout étourdi de tout ce que j’ai vu. Je ne veux pas laisser partir le courrier, qui va tout à l’heure à Gibraltar, sans te faire part de mon étonnement de toutes les choses que j’ai vues. « (Corresp., t. I, p. 174.)
- ↑ Ce qui suit semble avoir été écrit le soir d’une promenade dans la campagne.
- ↑ Cette scène, qui avait vivement frappé l’imagination de Delacroix et dont on retrouve la description dans la Correspondance (t. I, p. 176), a sans doute inspiré le tableau connu sous le nom de Rencontre de cavaliers maures, qui fut refusé au Salon de 1834. Le catalogue Robaut en donne la description suivante : « Les chevaux se heurtent, et l’un d’eux se dresse sous le choc en même temps que sous l’effort de son cavalier pour l’arrêter. Dans ce mouvement la puissante silhouette du cheval bai brun s’enlève sur un fond de collines qu’éclairent les fumées d’un combat et les clartés opalines d’un ciel gris très doux où passent des bleus de turquoise. Sur ce premier groupe se découpe le profil allongé, élégant du cheval gris-blanc, dont le poil soyeux et fin laisse passer comme des lueurs roses la transparence de la peau. Le geste des cavaliers, celui surtout de l’homme dont on n’aperçoit que la tête et le poing, est d’une audace de vérité extraordinaire, dont on ne retrouve l’exemple que dans Rubens, et c’est à Rubens aussi que fait penser l’éclatante variété des rouges que Delacroix s’est plu à multiplier dans cette précieuse composition, étincelante et joyeuse comme l’œuvre d’un peintre coloriste, vivante comme l’œuvre d’un grand dessinateur du mouvement, solide et forte comme l’œuvre d’un maître statuaire. » (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ M. de Laporte était alors consul général de France au Maroc.
- ↑ La plupart des dessins indiqués dans le journal se retrouvent dans l’album d’aquarelles que le maître offrit au comte de Mornay, au retour du voyage, aquarelles qui, mises en vente le 19 mars 1877, produisirent un total de 17,235 francs. (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ Delacroix ressentait la plus vive admiration pour les maîtres hollandais. Le souvenir de Gérard Dow, évoqué par une scène marocaine, est curieux à noter ici.
- ↑ Ce groupe inspira sans doute une aquarelle qui figura au Salon de 1833 sous ce titre : Une famille juive.
- ↑ Delacroix se plaint dans la Correspondance de la difficulté qu’il éprouve à dessiner d’après nature : « Je m’insinue petit à petit dans les façons du pays, de manière à arriver à dessiner à mon aise bien de ces figures de Mores. Leurs préjugés sont très grands contre le bel art de la peinture, mais quelques pièces d’argent, par-ci par-là, arrangent leurs scrupules. » Il écrit encore de Mequinez, le 2 avril : « Je vous ai mandé dans ma première lettre que nous avions eu l’audience de l’empereur. À partir de ce moment nous étions censés avoir la permission de nous promener par la ville ; mais c’est une permission dont moi seul j’ai profité entre mes compagnons de voyage, attendu que l’habit et la figure de chrétien sont en antipathie à ces gens-ci, au point qu’il faut toujours être escorté de soldats, ce qui n’a pas empêché deux ou trois querelles qui pouvaient être fort désagréables à cause de notre position d’envoyés. » (Corresp., t. I, p. 175 et 184.)
- ↑ M. Hay, consul général et chargé d’affaires d’Angleterre.
- ↑ Cette scène inspira à Delacroix l’admirable toile qui figure au musée du Louvre sous le titre : Noce juive dans le Maroc. Voici le texte explicatif fourni par Delacroix au livret du Salon de 1841 : « Les Maures et les Juifs sont confondus. La mariée est enfermée dans les appartements intérieurs, tandis qu’on se réjouit dans le reste de la maison. Des Maures de distinction donnent de l’argent pour des musiciens qui jouent de leurs instruments et chantent sans discontinuer le jour et la nuit ; les femmes sont les seules qui prennent part à la danse, ce qu’elles font tour à tour, et aux applaudissements de l’assemblée. » Ce tableau avait été commandé au maître par le marquis Maison, qui n’en fut pas satisfait et trouva trop élevé le prix Je 2,000 francs que Delacroix lui en demandait. Il fut acheté 1,500 francs par le duc d’Orléans, qui le donna au musée du Luxembourg. De là il passa au Louvre. (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ « Nous partons après-demain pour Mequinez, où est l’empereur, écrit Delacroix à Fr. Villot ; il nous fera toutes sortes de galanteries mauresques pour notre réception, courses de chevaux, coups de fusil, etc. La saison nous favorise, nous avons craint les pluies, mais il paraît que le plus fort est passé. » (Corresp., t. I, p. 179.)
- ↑ Il s’agit ici de ces fantasias qui ont tenté le pinceau de tous les peintres qui visitèrent l’Orient. Cette première scène lui inspira une aquarelle qui devait figurer à la vente Mornay. Le catalogue Robaut la décrit ainsi : « Au premier plan, un peloton de cavaliers lancés au galop, à demi enveloppés de fumée ; celui du milieu sur un cheval gris brandit son fusil ; au second plan à droite, la porte de la ville avec d’autres cavaliers ; au fond, des montagnes d’un bleu léger. »
- ↑ L’armée portugaise, qui, en 1758, venait à la conquête du Maroc sous les ordres de son roi, le chevaleresque Sébastien, livra en effet bataille à Abd-el-Melek dans cette plaine connue sous le nom d’Alcaçarquivir. Sébastien y perdit la bataille et la vie.
- ↑ Le paysage de la rivière Sébou inspira une toile exposée au Salon de 1859, ainsi décrite dans le catalogue Robaut : « Six Marocains se baignent à l’un des tournants du fleuve peu profond. Au premier plan à gauche débouche un cavalier qui va faire rafraîchir son cheval. Tout auprès un baigneur étendu se repose. Sur l’autre rive, un cheval conduit par la bride a déjà le pied dans l’eau. »
- ↑ « Notre entrée ici à Méquinez a été d’une beauté extrême, et c’est un plaisir qu’on peut fort bien souhaiter de n’éprouver qu’une fois dans sa vie. Tout ce qui nous est arrivé ce jour-là n’était que le couiplément de ce à quoi nous avait préparé la route. A chaque instant on rencontrait de nouvelles tribus armées qui faisaient une dépense de poudre effroyable, pour fêter notre arrivée. » (Corresp., t. I, p. 180.)
- ↑ Dans une lettre à Pierret du 23 mars, Delacroix décrit ainsi l’audience de l’Empereur : « Il nous a accordé une faveur qu’il n’accorda jamais à personne, celle de visiter ses appartements intérieurs, jardins, etc… Tout cela est on ne peut plus curieux. Il reçoit son monde à cheval, lui seul, toute sa garde pied à terre. Il sort brusquement d’une porte et vient à vous avec un parasol derrière lui. Il est assez bel homme. Il ressemble beaucoup à notre roi : de plus la barbe et plus de jeunesse. Il a de quarante-cinq à cinquante ans. » (Corresp., t. I, p. 183.)
- ↑ La Réception de l’empereur Abd-Ehr-Rhaman est une des plus
belles toiles de Delacroix : elle se trouve au musée de Toulouse. — À
propos des audaces de coloriste qui effrayaient le public au Salon
de 1845, Baudelaire écrivait : « Voilà le tableau dont nous voulions
parler tout à l’heure, quand nous affirmions que M. Delacroix avait
progressé dans la science de l’harmonie. En effet, déploya-t-on
jamais en aucun temps une pareille coquetterie musicale ? Véronèse
fut-il jamais plus féerique ? Vit-on jamais chanter sur une toile de
plus capricieuses mélodies ? Un plus prodigieux accord de tons nouveaux,
inconnus, délicats, charmants ? Nous en appelons à la bonne
foi de quiconque connaît son vieux Louvre. Qu’on cite un tableau de
grand coloriste où la couleur ait autant d’esprit que dans celui de
M. Delacroix. Nous savons que nous serons compris d’un petit
nombre, mais cela nous suffit. Ce tableau est si harmonieux malgré la splendeur de tons qu’il en est gris comme la nature, gris comme
l’atmosphère de l’été, quand le soleil étend comme un crépuscule de
poussière tremblante sur chaque objet. Aussi ne l’aperçoit-on pas du
premier coup : ses voisins l’assomment. La composition est excellente,
elle a quelque chose d’inattendu, parce qu’elle est vraie et naturelle. »
— P. S. « On dit qu’il y a des éloges qui compromettent, et que mieux vaut un sage ennemi… Nous ne croyons pas, nous, qu’on puisse compromettre le génie en l’expliquant. » - ↑ Tableau exposé au Salon de 1847.
- ↑ Delacroix avait senti que toute la poésie intime, tout le charme mystérieux de l’existence orientale résidait dans ces deux parties de la maison moresque : le patio ou cour intérieure et la terrasse : aussi s’efforçait-il, malgré les difficultés que crée la jalousie des musulmans, d’y pénétrer pour y peindre : « J’ai passé la plupart du temps dans un ennui extrême, écrit-il de Méquinez le 2 avril, à cause qu’il m’était impossible de dessiner ostensiblement d’après nature, même une masure. Même de marcher sur la terrasse, vous expose à des pierres ou à des coups de fusil. La jalousie des Mores est extrême, et c’est sur les terrasses que les femmes vont ordinairement prendre le frais ou se voir entre elles. » (Corresp., t. I, p. 185.)
- ↑ « Je ne vous parle pas de toutes les choses curieuses que je vois. Cela finit par sembler naturel à un Parisien logé dans un palais moresque, garni de faïences et de mosaïques. Voici un trait du pays : hier, le premier ministre qui traite avec Mornay, a envoyé demander une feuille de papier pour nous donner la réponse de l’empereur. » (Corresp., t. I, p. 185.)
- ↑ Antoine-Jérôme Desgranrjes, interprète du Roi, accompagnait en cette qualité le comte de Mornay dans son ambassade.
- ↑ Aquarelle. De l’année 1839 date un tableau variante. Le catalogue Robaut le décrit ainsi : « La grande tente au centre est rayée bleu et blanc ; le pavillon français flotte au-dessus. Au second plan une foule ; des montagnes dans le fond. »
- ↑ Delacroix écrivait à Pierret le 29 février, peu de temps après son arrivée : « Imagine, mon ami, ce que c’est que de voir, couchés au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des savates, des personnages consulaires, des Catons, des Brutus, auxquels il ne manque même pas l’air dédaigneux que devaient avoir les maîtres du monde ; ces gens-ci ne possèdent qu’une couverture dans laquelle ils marchent, dorment, et sont enterrés, et ils ont l’air aussi satisfait que Cicéron devait l’être de sa chaise curule. Je te le dis, vous ne pourrez jamais croire à ce que je rapporterai, parce que ce sera bien loin de la vérité et de la noblesse de ces natures. L’antique n’a rien de plus beau. » (Corresp., t. I, p. 178.) Delacroix parlant de l’Afrique, un jour, disait à Th. Silvestre qui l’a rapporté dans son livre : les Artistes vivants : « L’aspect de cette contrée restera toujours dans mes yeux ; les hommes de cette forte race s’agiteront toujours, tant que je vivrai, dans ma mémoire. C’est en eux que j’ai vraiment retrouvé la beauté antique. »
- ↑ De tous les maîtres de l’École espagnole, Goya paraît être celui qui le frappa le plus. De secrets rapports de tempérament existaient entre ces deux maîtres si essentiellement modernes : Goya et Delacroix : un même amour de la couleur, un même sens du côté dramatique de la vie, une même fougue de composition. Les admirables eaux-fortes du peintre espagnol l’attiraient par-dessus tout ; il y retrouvait, idéalisée par le génie fantaisiste du grand artiste, l’image de ces mœurs si exceptionnelles, à propos desquelles il écrivait : « Ç’a été une des sensations de plaisir les plus vives que celle de me trouver, sortant de France, transporté, sans avoir touché terre ailleurs, dans ce pays pittoresque ; de voir leurs maisons, ces manteaux que portent les plus grands gueux et jusrqu’aux enfants des mendiants. Tout Goya palpitait autour de moi. » (Corresp., t. I, p. 172.)
- ↑ Delacroix écrivait à Pierret, au moment de son retour d’Espagne : « J’ai retrouvé en Espagne tout ce que j’avais laissé chez les Mores. Rien n’y est changé que la religion ; le fanatisme, du reste, y est le même… Des églises et toute une civilisation comme il y a trois cents ans. » (Corresp., t. I, p. 180.)
- ↑ Delacroix fait ici allusion à sa toute première jeunesse, avant le commencement de ses études au lycée Louis-le-Grand : c’est là un ordre de souvenirs qui ne revient pas fréquemment dans le journal. Il est rare qu’il se reporte à ses années de première jeunesse, surtout à ses années de collège qui conservent un si grand charme pour certains, mais qui semblent lui avoir été pénibles.
- ↑ La Chartreuse de Séville inspira à Delacroix trois dessins et une composition. Le premier de ces dessins représente une cour de cloître, au bas de laquelle il écrivit : « Chartreuse de Séville, 25 mars : vendredi. » Le second et le troisième représentent l’intérieur de deux salles du même couvent. — Delacroix y remarqua en outre un religieux, assis dans une stalle en bois sculpté, qui le frappa par son attitude béate, car non seulement il en fit un dessin, mais encore il s’en inspira et donna la même pose au « fils de Christophe Colomb malade au couvent de Sainte-Marie de Robida ». (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ Pierre Cevallos, homme d’État espagnol, né en 1764, mort en 1840, fut un des agents les plus actifs de la junte espagnole et contribua puissamment à soutenir la résistance contre Napoléon dans la Péninsule. Après avoir joui d’une grande influence à la cour de Ferdinand VII, il semble résulter de ce passage qu’il s’était retiré à la fin de sa vie dans le couvent de Saint-Jérôme, à Séville.
- ↑ Torrigiani, sculpteur florentin, contemporain de Michel-Ange, né en 1472, mort en 1522 à Séville. La statue de saint Jérôme, que mentionne ici Delacroix, est une œuvre des plus remarquables, qui se trouve actuellement au musée de Séville.
- ↑ La maison de Pilate est un des plus beaux exemplaires et des mieux conservés du style moresque qui soient à Séville.
- ↑ Ces notes ont été vraisemblablement prises à Valmont, au mois de septembre 1834.
- ↑ On trouve ici l’idée première de l’une des trois peintures décoratives que Delacroix exécuta cette même année à Valmont. Ces fresques, Léda, Anacréon, Bacchus occupent des dessus de porte dans le corridor du premier étage de la propriété de M. Bornot. (Voir Catalogue Robaut, nos 384 et 545.)
- ↑ Sur le manuscrit on ne peut distinguer le nom, qui a été soigneusement biffé à l’encre après coup.
- ↑ Ce procédé est fort ancien : Léonard de Vinci, Albert Dürer et tant d’autres s’en sont servis eux-mêmes très souvent. Voici en quoi il consiste : on prend un crayon gras, et on ferme un œil en tenant l’autre ouvert contre une planchette mobile et fixe à volonté, trouée à diverses hauteurs, et placée à une certaine distance d’une vitre. A travers l’ouverture, on regarde la partie du paysage que l’on a devant soi et on n’a plus qu’à calquer les lignes telles qu’on les voit à travers la vitre. Au lieu d’un crayon gras, qu’on ne connaissait peut-être pas jadis, on pouvait se servir d’une plume et d’encre.
- ↑ Ici le même nom aussi soigneusement biffé.
- ↑ Delacroix écrivait de Londres en 1825 : « J’ai été chez M. Wilkie, et je ne l’apprécie que depuis ce moment. Ses tableaux achevés m’avaient déplu, et dans le fait ses ébauches et ses esquisses sont au-dessus de tous les éloges. Comme tous les peintres de tous les âges et de tous les pays, il gâte régulièrement ce qu’il fait de beau. » — Et encore : « J’ai vu chez Wilkie une esquisse de Knox le puritain prêchant devant Marie Stuart. Je ne peux t’exprimer combien c’est beau, mais je crains qu’il ne la gâte ; c’est une manie fatale. » (Corresp. t. I, p. 100 et 103.)
- ↑ La suite manque dans le manuscrit.
- ↑ Cette question de la ligne, du rôle de la ligne et de la couleur se trouvera reprise et longuement développée dans les dernières années du journal : on y pourra voir, comme un plaidoyer en faveur de son art, une défense de toute son œuvre.
- ↑ Percier, architecte, né à Paris en 1764, mort en 1838, et Fontaine, architecte, né à Paris en 1762, mort en 1853. Tous deux étaient élèves de Peyre, l’architecte du Roi, et remportèrent le grand prix de Rome. C’est en Italie que commença entre les deux artistes cette intimité profonde qui les réunit pour ainsi dire en une seule personnalité.
- ↑ A rapprocher de ce passage celui où il dit : « Montaigne écrit à bâtons rompus ; ce sont les ouvrages les plus intéressants. »
- ↑ Delacroix revint sur cette idée dans un éloquent article publié cette même année 1844 dans les Beaux-Arts, à propos du groupe d’Andromède, de Puget. « Nous reviendrons à l’objet principal de cette note, à l’Andromède qui subit un martyre dont souffrent tous les amis des arts, puisqu’elle doit périr et disparaître finalement… Le grand sculpteur, harcelé de son vivant par les envieuses passions des artistes ses rivaux, méconnu et délaissé par les grands et les ministres, sera-t-il encore longtemps poursuivi dans ses ouvrages dont le nombre est si borné à Paris ? »
- ↑ Émeric-David, archéologue et critique, né en 1755, mort en 1839, s’est fait une place très haute dans l’histoire de l’art français.
- ↑ Pietro Berettini, dit Pietro de Cortone, peintre italien, né en 1596, mort en 1669. On voit de lui au Louvre la Réconciliation de Jacob et d’Esaü, la Nativité de la Vierge, et Sainte Catherine.
- ↑ Francesco Sotimena, peintre italien, né en 1657, mort en 1747. Le musée du Louvre possède de cet artiste un Héliodore chasse du temple, et Adam et Eve épiés par Satan.
- ↑ Charles-Nicolas Cochin, dessinateur et graveur de grand mérite, né en 1715, mort en 1790. Il écrivit sur les arts différents mémoires et des ouvrages appréciés qui dénotent chez cet artiste un rare esprit critique et une précision de jugement remarquable.
- ↑ Ces sensations et ces sentiments d’un véritable artiste en présence
de la nature, ce dédain pour les peintres qui, préoccupés surtout d’une
exécution habile et savante, ne peuvent s’émouvoir et restent toujours
froids, se retrouvent exactement dans un fragment inédit d’une très
curieuse lettre écrite en 1853 par un paysagiste de grand mérite, ami de
Delacroix, Constant Dutilleux :
« Paysagistes !… Qu’a de commun votre occupation avec l’émotion que j’éprouve ? Admire qui veut votre ligne, votre coup de brosse, votre habileté, si c’est ma tête et mon esprit que vous voulez occuper, je vous l’accorde : Bravo ! cela est parfaitement fait. Je ne chercherai même point d’où cela vient ; je ne constaterai pas même la paternité. Je regarde bien de la mosaïque, pourquoi ne jetterais-je point les yeux sur ce que vous faites ? « … Toute belle facture a son mérite, qu’elle s’applique à un meuble ou à une pierre précieuse ; quant à mon cœur, à mon âme, à ce qui fait l’essence et le fond de mon être, rien, rien pour vous. Je conserve ce précieux trésor pour la nature d’abord, et ensuite pour ceux qui, comme moi, l’auront contemplée avec la vraie béatitude et qui, tout bonnement et naïvement, auront répété quelques phrases, quelques mots qu’ils auront pu lire et épeler dans ce grand livre qu’on ne peut ouvrir qu’avec son cœur… »
On voit qu’une même flamme animait alors les artistes de cette période si brillante de l’École française.
- ↑ Ce tableau était un des cinq envois que Delacroix fit au Salon de 1845. (Voir Catalogue Robaut, no 927.) À ce propos, il écrivit au critique Thoré, qui avait été un de ses premiers et de ses plus fervents admirateurs, ce curieux billet : « J’ai envoyé, cher monsieur, cinq tableaux… Mettons-nous en prière à présent, pour que messieurs du jury laissent passer mon bagage. Je crois qu’il serait bon de n’y pas faire allusion d’avance, de peur que par mauvaise humeur ils ne réalisent cette crainte. » (Corresp., t. I, p. 301.)
- ↑ Étienne Pivert de Senancour, écrivain moraliste né à Paris en 1770, mort en 1846. Rêveur sans illusions, athée et fataliste, il écrivit un certain nombre d’ouvrages, fruits de ses tristes méditations et de son esprit chagrin. Obermann avait été publié pour la première fois en 1804. Une deuxième édition parut en 1833, avec une préface de Sainte-Beuve, et une troisième un peu plus tard avec une préface de George Sand, à laquelle Delacroix fait ici allusion. Voici, d’ailleurs, comment Sainte-Beuve appréciait le talent de Senancour : « C’est à la fois un psychologiste ardent, un lamentable élégiaque des douleurs humaines et un peintre magnifique de la réalité. »
- ↑ Ce tableau, la Mort de Sardanapale, exécuté en 1844, n’est que la réduction sans variante du tableau peint en 1827. (Voir Catalogue Robaut, no 791.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 60.
- ↑ Le génie de Victor Hugo était peu sympathique à Delacroix. Plus loin, dans son Journal, il porte un jugement sévère, qui pourrait même paraître injuste, sur le style du poète. Victor Hugo, d’ailleurs, ne l’aimait pas davantage. Il ne pouvait supporter que l’opinion publique, qui plus tard « devait faire à Delacroix une gloire parallèle à la sienne », accouplât leurs deux noms. Il appelait ses créations féminines des grenouilles, et si l’on s’en rapporte à une très curieuse plaquette intitulée : Victor Hugo en Zélande, publiée par Charles Hugo, on y verra que le poète reconnaissait au peintre « toutes les qualités, moins une, la beauté. » La vérité est qu’ils étaient de génie trop dissemblable pour pouvoir se comprendre, et que les critiques du temps, en unissant leurs noms, commettaient une de ces grossières erreurs dont ils étaient coutumiers. « M. Victor Hugo, disait Raudelaire, est un grand poète sculptural qui a l’œil fermé à la spiritualité. » Rien ne peut mieux que cette brève observation faire toucher du doigt la cause de l’incompréhension de Victor Hugo en ce qui concerne les femmes de Delacroix !
- ↑ Lewis, romancier anglais, né à Londres, en 1773, mort en 1818. Il fut l’ami de Walter Scott, dont il encouragea les débuts, et de Byron, à qui il fit connaître la littérature allemande. Son plus célèbre roman, le Moine, est une œuvre de jeunesse où il a entassé tout ce que pouvaient lui suggérer une imagination exaltée et maladive, l’effervescence de l’âge et la lecture des ballades allemandes, des romans mystérieux, fantastiques, effrayants, alors à la mode. Comme poète, Lewis déploya un talent exquis de versification dans des Ballades imitées de Burger.
- ↑ Eugène Delacroix mit plus tard à profit cette même idée pour l’un des tympans décoratifs de l’Hôtel de ville : Hercule ramène Alceste du fond des enfers. (Voir Catalogue Robaut, no 1161.)
- ↑ Roman de George Sand qui parut en 1846.
- ↑ Boissard était le maître du salon où avaient lien les séances du « Club des Haschischins », salon dans lequel Théophile Gautier rencontra pour la première fois Baudelaire, et où Balzac se trouvant invité refusa d’absorber la dangereuse substance. Dans la délicieuse préface des Fleurs du mal, Gautier parle ainsi de Boissard : « C’était un garçon des mieux doués que Boissard ; il avait l’intelligence la plus ouverte ; il comprenait la peinture, la poésie et la musique également bien ; mais chez lui peut-être, le dilettante nuisait à l’artiste ; l’admiration lui prenait trop de temps, il s’épuisait en enthousiasmes ; nul doute que si la nécessité l’eût contraint de sa main de fer, il n’eût été un peintre excellent. Le succès qu’obtint au Salon son épisode de la Retraite de Russie en est le sûr garant. Mais, sans abandonner la peinture, il se laissa distraire par d’autres arts ; il jouait du violon, organisait des quatuors, déchiffrait Bach, Beethoven, Meyerbeer et Mendelssohn, apprenait des langues, écrivait de la critique et faisait des sonnets charmants… Comme Baudelaire, amoureux des sensations rares, fussent-elles dangereuses, il voulut connaître ces « Paradis artificiels », qui plus tard vous font payer si cher leurs menteuses extases, et l’abus du haschich dut altérer sans doute cette santé si robuste et si florissant*. » (Préface des Fleurs du mal, p. 6 et 7.)
- ↑ Ici paraît pour la première fois le nom du pays où Delacroix avait sa campagne, aux environs de Paris, près de Draveil. Ce nom reparaîtra à chaque instant dans les années postérieures de son journal. Il y goûta de douces émotions de nature, si l’on en croit certaines notes de ce journal, et pourtant il écrivait au sujet du pays, en 1862 : « Champrosay est un village d’opéra-comique. On n’y voit que des élégantes ou des paysans qui ont l’air d’avoir fait leurs toilettes dans la coulisse ; la nature elle-même y semble fardée ; je suis offusqué de tous ces jardinets et de ces petites maisons arrangées par des Parisiens. Aussi, quand je m’y trouve, je me sens plus attiré par mon atelier que par les distractions du lieu. » (Corresp., t. II, p. 317.)
- ↑ Frédéric Villot, peintre, né à Liège. Il fut l’un des premiers amis de Delacroix et resta lié avec lui jusqu’à la fin de sa vie. Il se distingua surtout comme aquafortiste. Il fut conservateur du Musée du Louvre, dont le catalogue fut fait sous sa direction.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 748, 749.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 127.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 104.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 182 et additions.
- ↑ Roché, architecte, à qui Delacroix avait confié l’exécution des tombeaux de sa famille, notamment le monument qu’il éleva à son frère le général Delacroix, mort en 1845. C’est en reconnaissance de ses soins que Delacroix lui fit hommage du tableau dont il est question ici. (Voir Catalogue Robaut, no 1019.) « Comme, au dernier Salon, j’avais exposé un Lion, qui avait généralement fait plaisir, j’ai pensé à vous envoyer une espèce de pendant à ce tableau. » (Corresp., t. I, p. 328 et 329. — Lettre à M. Roché).
- ↑ Alphonse-Henri de Gisors, architecte, né en 1796, mort en 1866, élève de Percier. Il a exécuté notamment le remaniement du palais et du jardin du Luxembourg.
- ↑ Alphonse Masson, graveur. On lui doit plusieurs portraits de Delacroix. Ce fut lui qui fut chargé par le maître de graver à l’eau-forte le Massacre de Scio. Il a gravé aussi un Lion. (Voir Catalogue Robaut, no 985.)
- ↑ Adolphe-Pierre Leleux, peintre de genre, né à Paris en 1812 : il fit de la peinture sans autre guide que lui-même. Il commença par faire de la gravure, de la lithographie et des vignettes, pressé qu’il était par le besoin ; puis, après plusieurs années de luttes, exposa au Salon de 1835 Un voyageur, aquarelle qui fut remarquée. Il voyagea en Bretagne, d’où il rapporta des études de nature et de mœurs ; puis dans les Pyrénées aragonaises. Les événements de 1848 jetèrent Leleux dans une voie nouvelle : il donna le Mot d’ordre, scène de juin 1848 ; la Sortie, autre scène de Juin ; Une patrouille de nuit à cheval, scène de Février. Certains critiques ont voulu faire de lui un des chefs de l’École réaliste en peinture, à cause de son exactitude à reproduire la nature.
- ↑ Alexandre Vimont, peintre, qui exposa aux Salons de 1846, de 1850 et de 1861.
- ↑ Mort de Valentin, toile datée de 1847. Salon de 1848, Exposition universelle de 1855. Vente Collot, 1852, 4,750 francs, à Mme M. Cottier, qui en a légué la nue propriété au Musée du Louvre. (Voir Catalogue Robaut, no 1008.
- ↑ Sans doute Agnès de Méranie, qui fut représentée à l’Odéon en décembre 1846, et dont le succès ne répondit pas aux espérances fondées sur l’auteur de Lucrèce.
- ↑ « Je travaille maintenant à mon petit Christ au jardin des Oliviers, que je fais au pastel et que je prierai Mme Roché d’accepter en souvenir de ses bontés. » (Corresp., t. I, p. 329.) Voir Catalogue Robaut, nos 178 et 999.
- ↑ Georges Duval, vaudevilliste français et auteur de plusieurs ouvrages sur la Révolution.
- ↑ Robert Bruce, opéra en trois actes, de Rossini, représenté à l’Opéra pour la première fois le 30 décembre 1846.
- ↑ Mme Cavé, artiste, née à Paris vers 1810 ; elle étudia l’aquarelle avec Camille Roqueplan, et exposa aux Salons de 1835 et 1886. Elle avait épousé le peintre Clément Boulanger, sous la direction duquel elle aborda la peinture de genre. Veuve en 1842, elle épousa, quelques années après, François Cavé, qui fut chef de la division des Beaux-Arts. En dehors des Salons, elle se fit connaître par une Méthode de dessin sans maître, qui parut en 1853, et qui eut l’honneur de fixer l’attention de Delacroix. Le peintre fit sur cette méthode un rapport qui fut publié par le Moniteur officiel et reproduit par les journaux d’Art. Il écrivait à ce propos en 1861 : « Je suis persuadé que la simplicité de cette méthode porterait la conviction dans tous les esprits, abrégerait beaucoup nos travaux et amènerait une décision plus prompte. » Les écrits de Mme Cavé l’avaient assez frappé pour qu’à plusieurs reprises dans son Journal, on trouve des réflexions sur la technique de la peinture qui lui avaient été suggérées par elle. « Voilà la première méthode de dessin qui enseigne quelque chose » : tel était le début de l’article de Delacroix sur Mme Cavé.
- ↑ Au moment où une chapelle de Saint-Sulpice fut donnée à Delacroix pour la décorer, on parlait encore de lui confier le mur du transept de l’église. Ce projet fut abandonné, et la chapelle des Anges livrée à Delacroix, qui commença son travail en 1859 et ne le termina qu’en 1861.
- ↑ Soutman, peintre et graveur hollandais, né en 1580, mort en 1653, élève de Rubens.
- ↑ Amateur dont la vente eut lieu le 7 décembre 1871.
- ↑ Marchand de tableaux et de couleurs.
- ↑ Laurent Jan était un des journalistes les plus spirituels de cette époque.
- ↑ Il s’agit ici d’une variante du tableau : Femmes d’Alger, qui fut exposé au Salon de 1834 et qui appartient au Musée du Louvre. Le tableau dont il est question ici, et qui est mentionné au catalogue Robaut sous le titre : Femmes d’Alger dans leur intérieur, fut envoyé par Delacroix au Salon de 1849. La disposition des bras de la négresse n’est pas tout à fait la même que dans le tableau du Louvre. Il fait maintenant partie de la galerie Bruyas au Musée de Montpellier.
- ↑ Manuel Garcia, musicien français, fils du célèbre chanteur Manuel Garcia. Formé par son père à l’enseignement du chant, il s’y consacra lui-même exclusivement, et fut attaché vers 1835 au Conservatoire de Paris. Ses sœurs, Marie et Pauline Garcia, se sont toutes deux rendues célèbres comme cantatrices, la première (morte en 1836 à Bruxelles) sous le nom de Mme Malibran, la seconde sous le nom de Mme Viardot.
- ↑ Giuseppe Naldi, chanteur italien, né en 1765, mort en 1820 à
Paris. Après de grands succès en Angleterre, il débuta en 1819 sur la
scène des Italiens, à Paris ; mais l’année suivante un terrible accident
vint mettre fin à sa carrière. Une marmite de récente invention, et dont
la soupape avait été trop fortement fixée, éclata en morceaux dans une
expérience, et Naldi, atteint par les débris, fut tué net.
Sa fille et son élève, Mlle Naldi, avait débuté également en 1819 au théâtre Italien et partagé la vogue de la Pasta. Elle quitta la scène en 1823 pour épouser le comte de Sparre, et depuis cette époque elle ne s’est plus fait entendre que dans les salons.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 468.
- ↑ Delacroix avait connu la comtesse Marliani chez George Sand. Son mari, le comte Marliani, compositeur et professeur de chant, fit représenter au théâtre Italien plusieurs opéras, notamment le Bravo.
- ↑ Anselme Petetin, administrateur et publiciste. Il fut successivement préfet et directeur de l’Imprimerie nationale.
- ↑ Edmond Hédouin, peintre et graveur, élève de Célestin Nanteuil et de Paul Delaroche. Il s’est surtout consacré au paysage et aux sujets de genre. Il fut chargé d’exécuter les peintures décoratives dans la galerie des fêtes au Palais-Royal.
- ↑ Voir le Catalogue Robaut, no 170.
- ↑ Ami de Delacroix.
- ↑ Gaultron, peintre, élève de Delacroix.
Delacroix avait ouvert, en 1838, un atelier rue Neuve-Guillemin, où il réunissait ses élèves. En 1846, l’atelier avait été transféré de l’autre côté de la Seine, rue Neuve-Breda. - ↑ Louis Müller, peintre, né en 1815, élève de Gros et de Coignet. Il remplaça Hippolyte Flandrin à l’Institut en 1864.
- ↑ Le nom de Couture (1815-1879) paraît ici pour la première fois, mais on l’y retrouvera plus loin. L’extrême suffisance du peintre des Romains de la décadence, qui le poussa à abandonner plusieurs fois le pinceau pour la plume, le servit bien mal en ce qui concerne Delacroix, et il écrivit sur lui en 1867 un article que nous nous dispenserons de qualifier, mais à propos duquel M. Paul Mantz a dit très justement qu’il « dépassait les limites du comique ordinaire ». Nous recommandons particulièrement aux curieux d’art, et à tous ceux qui voudraient se convaincre du danger que court un spécialiste à sortir du domaine de sa spécialité, cet article trop peu connu dans lequel il est dit à propos d’Eugène Delacroix : « Intelligent et insuffisant tout ensemble, la médiocrité de son faire lui constitue une fausse originalité… Là où beaucoup de gens croient voir des créations nouvelles, moi, je ne vois que des efforts malheureux. » [Revue libérale, 10 avril 1867, p. 70 et 76.) L’article est de 1867, postérieur par conséquent aux magnifiques études dans lesquelles les Baudelaire, les Saint-Victor, les Gautier avaient proclamé le génie de Delacroix. Couture a-t-il voulu se singulariser ? Nous hésitons à croire qu’il ait réellement pensé ce qu’il a écrit !…
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1015.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1034.
- ↑ « Le baron Charles Rivet, qui de nos jours a attaché son nom à la fondation de la troisième république, demeura un des fidèles amis de cœur de Delacroix. Celui-ci, dans un premier testament que lui fit déchirer sa gouvernante, Jenny Le Guillou, l’avait désigné comme son légataire universel. C’était un homme de grand sens et de mœurs aimables. Il avait été plus que camarade d’atelier de Bonington : il l’avait obligé avec infiniment de délicatesse dans son année de début et de gêne. « (Note de Ph. Burty dans la Correspondance de Delacroix, t. I, p. 127.)
- ↑ Cet article sur Prud’hon, qui avait paru dans la Revue des Deux Mondes du 1er novembre 1846, est un des plus intéressants du volume qui contient les écrits de Delacroix. (Eugène Delacroix, Sa vie et ses œuvres.)
- ↑ Le comte L. Clément de Ris, critique d’art, auteur d’ouvrages appréciés, qui devint conservateur du Musée de Versailles
- ↑ Ces voussures se trouvent au plafond d’une grande salle des Pas perdus, au palais du Corps législatif.
- ↑ Les peintures décoratives de la bibliothèque du Palais-Bourbon
furent commencées par E. Delacroix en 1838 et terminées en 1847.
Elles se composent de deux hémicycles et de cinq coupoles divisées chacune
en quatre pendentifs. Les deux hémicycles sont peints sur le mur
enduit d’une préparation à la cire ; ils représentent : le premier, Orphée apportant la civilisation a la Grèce (côté de la cour du Palais-Bourbon) ;
le second, Attila ramenant la barbarie sur l’Italie ravagée (côté
de la Seine). Les coupoles sont peintes à l’huile sur toile marouflée sur
enduit ; chaque coupole se compose de quatre pendentifs et comprend
par conséquent quatre sujets, que le maître a choisis dans un même
ordre d’idées : 1o la Poésie ; 2o la Théologie ; 3o la Législation ; 4o la
Philosophie ; 5o les Sciences. Enfin, à l’intersection desdits pendentifs,
se trouvent de grands mascarons, que Delacroix a imaginés d’après des
types rencontrés un peu partout sur son passage, et principalement
parmi les travailleurs des champs.
Première coupole : 1o Alexandre et les poèmes d’Homère ; 2o L’éducation d’Achille ; 3o Ovide chez les Barbares ; 4o Hésiode et la Muse.
Deuxième coupole : 1o Adam et Ève ; 2o La captivité à Babylone ; 3o La mort de saint Jean-Baptiste ; 4o La drachme du tribut.
Troisième coupole : 1o Numa et Égérie ; 2o Lycurgue consulte la Pythie ; 3o Démosthène harangue les flots de la mer ; 4o Cicéron accuse Verrès.
Quatrième coupole : 1o Hérodote interroge les traditions des Mages ; 2o Les bergers chaldéens inventeurs de l’astronomie ; 3o Sénèque se fait ouvrir les veines ; 4o Socrate et son démon.
Cinquième coupole : 1o La mort de Pline l’Ancien ; 2o Aristote décrit les animaux que lui envoie Alexandre ; 3o Hippocrate refuse les présents du roi de Perse ; 4o Archimède tué par le soldat.
Pour bien juger de toute cette suite de peintures décoratives, il est absolument utile de circuler sur la galerie saillante qui contourne cette magnifique salle. Delacroix avait déjà exécuté des peintures décoratives au Palais-Bourbon, en 1833, par l’entremise de M. Thiers ; il fut chargé de décorer le Salon du Roi qu’il acheva en cinq ans et qui lui fut payé la modeste somme de 30,000 francs. (Voir Catalogue Robaut, nos 892 à 917.) - ↑ Il s’agit probablement ici de M. Eudore Soulié, qui appartenait à l’administration des Musées, et qui mourut conservateur du Musée de Versailles.
- ↑ Petite-cousine de Delacroix.
- ↑ Balthazar Graciait, Jésuite espagnol, né en 1584, mort en 1658, est l’auteur d’un certain nombre d’œuvres littéraires, notamment un Traité de rhétorique et des allégories pleines de métaphores.
- ↑ Amelot de la Houssaye, né en 1634, mort en 1706, s’est fait connaître par quelques traductions estimées, notamment celle du Prince, de Machiavel.
- ↑ M. Niel, bibliothécaire au ministère de l’intérieur, était un homme des plus distingués, très brillant causeur, d’un esprit très fin et très délicat, et grand amateur de crayons du seizième siècle. Il publia avec son propre texte le beau recueil de Portraits historiques, d’après les crayons de Dumoustier, Clouet et autres, gravés par Riffaut.
- ↑ Le texte exact du Neveu de Rameau vient d’être publié récemment par MM. Monval et Thoinan, qui ont retrouvé le manuscrit original, écrit de la main même de Diderot.
- ↑ Planet, de Toulouse, peintre, élève de Delacroix. M. Lassalle-Bordes
prétend que Planet fit dans l’atelier de Delacroix les quatre pendentifs
suivants, qui font partie de la décoration de la voûte de la bibliothèque, à la Chambre des députés : Aristote décrit les animaux que lui
envoie Alexandre ; Lycurgue consulte la Pythie ; Démosthène harangue
les flots de la mer ; La drachme du tribut. (Correspondance, t. II. p. ix.)
Cette assertion de M. Lassalle-Bordes ne doit être accueillie, croyons-nous, qu’avec une extrême réserve, car son témoignage, en maintes circonstances, n’a pas rencontré partout un crédit absolu. Néanmoins, en admettant qu’il ne se soit point trompé en ce qui concerne Planet, on doit affirmer hardiment que ce dernier n’aurait, en tout cas, exécuté que des agrandissements des esquisses arrêtées du maître, et l’on sait combien d’études dessinées sur nature et autres accompagnaient ces peintures de moindre dimension qu’il remettait à ses élèves préparateurs, en ayant soin de ne rien livrer sans avoir donné lui-même les dernières touches portant bien la marque de sa maîtrise. - ↑ Probablement Joseph-Nicolas-Robert Fleury, dit Robert-Fleury.
Le diable d’enfant dont il est question ici doit être son fils, Tony
Robert-Fleury.
D’autre part, Delacroix veut peut-être parler de Léon Fleury, un paysagiste qui eut son heure de célébrité et dont il y a quelques études au château de Compiègne et dans divers musées (180-1858). - ↑ Grand hémicycle d’Orphée.
- ↑ Jean-François Demay, peintre, né en 1798, qui exposa aux divers Salons de 18-27 à 1846.
- ↑ Haussoullier, peintre et graveur, élève de Delaroche.
- ↑ En 1847, Don Juan était chanté au théâtre Italien par Lablache, Tagliafico, Coletti, Mario, Mme Grisi, Persiani et Corburi.
- ↑ Il ne peut être ici question, comme on pourrait le supposer, de Clésinger, car ce n’est qu’au mois de mai suivant que furent officiellement annoncées les fiançailles de Mlle Solange, fille de Mme Sand, avec le célèbre sculpteur. (Voir infra, p. 305 et 307.)
- ↑ Grand hémicycle d’Orphée.
- ↑ Sans doute Planet.
- ↑ Cette toile admirable appartient à M. le duc d’Aumale. Th. Gautier en donnait la description suivante : « Le doge Foscari est obligé d’assister à la lecture de la sentence de son fils, Jacques Foscari, torturé et banni pour de prétendues intelligences avec les ennemis de la République… Le doge, coiffé de son bonnet à cornes, vêtu de sa robe de brocart d’or, est assis sur son trône au premier plan, accablé de douleur sous sa contenance stoïque. Jacques Foscari, dont le bourreau vient de torturer les membres, lui jette un suprême adieu et tend ses mains brisées aux baisers de sa femme. La scène est disposée de la façon la plus dramatique dans une de ces belles architectures que Delacroix sait si bien construire et auxquelles il donne la profondeur d’un décor. »
- ↑ Toile de 1m,60 × 1m,30, datée de 1848, exposée au Salon la même aunée et à l’Exposition universelle de 1855. Ce tableau fut peint à l’origine pour le comte de Geloës, qui l’acheta 2,000 francs. Vente Faure, 1873 : 60,000 francs. Une variante du même tableau fut vendue à la vente Laurent Richard, 1873 : 29,100 francs. (Voir Catalogue Robaut, no 1034 et 1035.)
- ↑ Ce Christ porte la date de 1839.
- ↑ « Sans idéal, il n’y a ni peintre, ni dessin, ni couleur ; et ce qu’il y a de, pis que d’en manquer, c’est d’avoir cet idéal d’emprunt que ces gens-là vont apprendre à l’école et qui ferait prendre en haine les modèles. » (Correspondance, t. II, p. 19.)
- ↑ Comte de Mornay.
- ↑ Collectionneur ; il fut propriétaire de la Barque de don Juan. (Voir Catalogue Robaut, no 707.) Mme Moreau a donné ce tableau au Musée du Louvre après la mort de son mari.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1044.
- ↑ Auguste-Joseph Franchomme, violoncelliste, né à Lille en 1809. Cet artiste des plus distingués et l’un des noms les plus considérés de l’école française, a fondé, avec l’illustre violoniste Alard, des matinées de quatuors dans lesquelles la musique classique était exécutée avec une étonnante perfection.
- ↑ Asseline, secrétaire des commandements des princes d’Orléans.
- ↑ Le duc de Montpensier, qui, en effet, était logé et recevait à Vincennes.
- ↑ Jadin, paysagiste, né à Paris en 1805, fut élève de Hersent et s’attacha, dès ses débuts, aux sujets de chasse et à la peinture de nature morte. Il fréquenta plus tard l’atelier d’Abel de Pujol, et aborda le paysage. Il voyagea en Italie en 1835, et peignit à son retour un grand nombre de toiles pour la galerie du duc d’Orléans.
- ↑ Charles His, publiciste, né en 1772, mort en 1851. D’abord attaché à la rédaction du Moniteur, puis proscrit, il se fit soldat après le 13 vendémiaire. En 1811, il entra à la direction de la librairie, où il resta attaché jusqu’en 1848.
- ↑ Louis Boulanger (1806-1867). peintre, élève de A. Deveria.
- ↑ Octave Penguilly L’Haridon (1811-1872), peintre, élève de Charlet, exposa au Salon de 1847 Le tripot qu’on a revu au Musée du Luxembourg. Ancien élève de l’École Polytechnique, officier d’artillerie distingué, il fut nommé en 1854 conservateur du Musée d’artillerie, dont il rédigea le Catalogue.
- ↑ Salon de 1848. Appartient au Musée de Tours. (Voir Catalogue Robaut, no 1044.)
- ↑ Auguste Préault, statuaire, élève de David d’Angers.
- ↑ Le baron de Mareste, ami de jeunesse de Stendhal, et plus tard de Mérimée. C’était un homme aimable, très répandu dans les salons.
- ↑ Claire-Hippolyte-Josèphe Legris de la Tude, dite Mlle Clairon, célèbre tragédienne, née en 1723, morte en 1803.
- ↑ Eugène Pelletan, écrivain et homme politique, né en 1813, mort en 1884. Il débuta dans la littérature en 1837 par des articles critiques dans différents journaux et devint bientôt rédacteur de la Presse. Là, sous le pseudonyme d’Un inconnu, il publia sur la philosophie, l’histoire, la poésie, les arts, des articles qui furent très remarqués à cette époque.
- ↑ Philarète Chasles.
- ↑ Adrien Dauzats, peintre, né à Bordeaux en 1803, mort en 1868 : il fit de l’aquarelle et de la lithographie, et fut un des artistes attachés par le baron Taylor à la grande publication des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. Il entreprit alors dans le midi de la France une série d’excursions artistiques qui l’ont conduit plus tard en Espagne, en Portugal, en Égypte, en Orient. Il peignit surtout des paysages, ainsi que des sujets de genre et d’intérieur.
- ↑ Émile Lassalle, peintre, élève de Delacroix. Il faisait partie des élèves que Delacroix avait réunis dans son atelier de la rue Neuve-Guillemin. Il se distingua surtout comme lithographe ; il exécuta une grande lithographie d’après la Médée de Delacroix. « C’est un homme que j’aime beaucoup, écrivait Delacroix à propos de lui, et qui avait entrepris avec beaucoup d’ardeur cet ouvrage… Je pense que, comme moi, vous serez surpris de certaines parties, où le caractère est très bien rendu. »
- ↑ Arnoux, peintre et homme de lettres, a rendu compte, à plusieurs reprises, et dans des termes élogieux, des expositions de Delacroix. Celui-ci, de son côté, le recommanda chaleureusement en 1858 à M. Michaux, chef des services d’art à la Ville : « Je prends la liberté de vous recommander M. Arnoux, dont les travaux sur les arts sont bien connus, et qui a entrepris des études sur les monuments de Paris, leurs tableaux et leurs statues… J’ai compté sur votre extrême complaisance pour aider le travail remarquable d’un homme de talent pour qui j’ai beaucoup d’affection. » (Correspondance, t. II, p. 135. Note de Burty.)
- ↑ François Buloz, directeur de la Revue des Deux Mondes.
- ↑ Un des élèves de Delacroix qui fréquentaient son atelier transporté depuis 1846 de l’autre côté de la Seine, rue Neuve-Breda.
- ↑ D’après Rubens. (Voir Catalogne Robaut, no 736.)
- ↑ Sans doute l’achèvement des travaux du tombeau de son frère, le général Delacroix.
- ↑ Ce tableau fut peint à l’origine pour le comte de Geloës.
- ↑ Alexandre Colin, peintre d’histoire, élève de Girodet-Trioson, né en 1798, mort en 1875. Le portrait de Delacroix qui figure en tête de ce volume fut exécuté par Alexandre Colin vers 1827 ou 1830.
- ↑ Bornot, cousin de Delacroix, qui, à la mort de M. Bataille, devint propriétaire de l’abbaye de Valmout, aux environs de Fécamp. Delacroix y fit de nombreuses études et notamment de délicieuses aquarelles ; il y a même reconstitué des vitraux anciens de sa composition, en rapprochant des débris trouvés en décombres.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 920 et 921.
- ↑ La Sibylle au rameau d’or fut envoyée par Delacroix au Salon de 1845. « Cette Sibylle avait les yeux ardents, la bouche hautaine, le geste noble, la souple allure de mademoiselle Rachel, que Delacroix admirait passionnément. » (Voir Catalogue Robaut, no 918.)
- ↑ Les Puritains d’Écosse, opéra de Bellini, représenté au théâtre Italien en 1835. Ce fut le dernier ouvrage de Bellini.
- ↑ La Revue des Deux Mondes.
- ↑ M. Roché habitait à Bordeaux.
- ↑ Georges Onslow, compositeur français, né en 1784, mort en 1852, auteur de symphonies et de musique de chambre.
- ↑ M. Delessert était alors préfet de police.
- ↑ L’auteur de la Vestale était né en 1779. Sa santé était en 1847 déjà fort ébranlée. Il mourut le 24 janvier 1851.
- ↑ Colet, compositeur, professeur au Conservatoire.
- ↑ L’opinion de Delacroix sur Decamps paraît avoir varié. En 1862, il écrivait à M. Moreau : « Depuis que j’ai eu le plaisir de vous voir, la figure de Decamps a grandi dans mon estime. Après l’exposition des ouvrages en partie ébauchés qui ont formé sa dernière vente, j’ai été véritablement enthousiasmé par plusieurs de ces compositions. »
- ↑ Le baron Larrey, agrégé de l’École de médecine de Paris, était alors chirurgien en chef de l’hôpital du Gros-Caillou.
- ↑ Sans doute Charles-Louis-Jules David, helléniste et administrateur, fils du célèbre peintre Louis David.
- ↑ La coupole d’Orphée, à la Chambre des députés.
- ↑ Delacroix avait pour le génie de Chopin une admiration enthousiaste. Chaque fois que le nom du musicien revient dans le Journal, c’est toujours avec les épithètes les plus louangeuses. Il le fréquentait assidûment, et l’un de ses plus grands plaisirs était de l’entendre exécuter soit ses propres œuvres, soit la musique de Beethoven. Dans le livre si brillant et si curieux comme style qu’il consacra à la mémoire du célèbre artiste, après avoir décrit l’assemblée composée de H. Heine, Meyerbeer, Ad. Nourrit, Hiller, Nimceviez, G. Sand, Liszt s’exprime ainsi sur Delacroix : « Eugène Delacroix restait silencieux et absorbé devant les apparitions qui remplissaient l’air, et dont nous croyions entendre les frôlements. Se demandait-il quelle palette, quels pinceaux, quelle toile il aurait à prendre pour leur donner la vie de son art ? Se demandait-il si c’est une toile filée par Arachné, un pinceau fait des cils d’une fée, et une palette couverte des vapeurs de l’arc-en-ciel qu’il lui faudrait découvrir ? » La mort prématurée de Chopin causa à Delacroix une tristesse profonde, dont on trouve la trace dans sa Correspondance et dans son Journal.
- ↑ Gaspard-Jean Lacroix, peintre de paysage, élève de Corot, né à Turin en 1810.
- ↑ Mlle Mars mourut en effet le 20 mars 1847.
- ↑ Charles Lefebvre, peintre, élève de Gros et d’Abel de Pujol.
- ↑ Amateur belge.
- ↑ Othello, toile de 0m,50 × 0m,60, qui parut au Salon de 1849. — Vente M. J…, 1852 : 510 francs ; 1858 : 730 francs. — Vente Arosa, 1858 : 1,300 francs. — Vente Marmontel, 1868 : 12,000 francs. (Voir Catalogue Robaut, no 1079.)
- ↑ Armand Bertin, directeur du Journal des Débats depuis 1841, date de la mort de son père.
- ↑ M. Barbier était le beau-père de Frédéric Villot, qui fut, nous l’avons déjà dit, un des amis les plus intimes de Delacroix.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1077.
- ↑ Il matrimonio segreto, opéra bouffe en deux actos, de Cimarosa. — Nabuchodonosor. ou, par abréviation, Nabucho, opéra de Verdi. — Othello, opéra de Rossini.
- ↑ L’article auquel Delacroix fait allusion parut dans la Presse du
1er avril 1847. Théophile Gautier s’y exprimait ainsi : « Quelle variété,
quel talent toujours original et renouvelé sans cesse ; comme il est bien,
sans tomber dans le détail des circonstances, l’expression et le résumé de
son temps ! Comme toutes les passions, tous les rêves, toutes les fièvres
qui ont agité ce siècle ont traversé sa tête et fait battre son cœur ! Personne
n’a fait de la peinture plus véritablement moderne qu’Eugène
Delacroix… C’est là un artiste dans la force du mot ! Il est l’égal des
plus grands de ce temps-ci, et pourrait les combattre chacun dans sa
spécialité. »
Théophile Gautier avait toujours été le fidèle et l’ardent défenseur du génie de Delacroix. Il l’avait soutenu alors que tous ou presque tous l’attaquaient. Peut-être le peintre ne sut-il pas assez de gré au critique de ce que celui-ci avait fait pour lui ; plus tard ses relations avec Gautier se refroidiront ; il lui reprochera de n’être pas assez « philosophe » dans sa critique et de faire des tableaux lui-même, à propos des tableaux dont il parle. Si nous en croyons les personnes dignes de foi qui les ont connus tous deux et les ont observés dans leurs rapports, il faudrait attribuer ce refroidissement à l’horreur que Delacroix professait pour le genre bohème et débraillé, dont Théophile Gautier avait été l’un des plus illustres champions. - ↑ Francis-Alphonse Wey, littérateur français, né en 1812. Comme écrivain et comme philologue, il occupa une place importante parmi les littérateurs de cette époque.
- ↑ Baron Denon (1747-1825), graveur, fut directeur général des musées impériaux et membre de l’Institut.
- ↑ Hippolyte Maindron, sculpteur, né en 1801, élève de David d’Angers. Il appartient au petit groupe des sculpteurs romantiques dont les représentants les plus connus sont Barye, Préault, Antonin Moyne.
- ↑ Alfred Arago, artiste peintre, second fils de François Arago, né en 1816. Il devint inspecteur général des Beaux-Arts.
- ↑ Léonore, opéra en trois actes, de Beethoven, qui, réduit en deux actes, prit le titre définitif de Fidelio.
- ↑ Il s’agit ici sans doute de cette Mme Alberte de Rubempré. qui fut une des femmes les plus brillantes des salons de la Restauration, que Stendhal désigne sous le nom de Mme Azur dans ses Souvenirs d’égotisme, qu’il aima, dit-il, « d’un amour frénétique », et au sujet de laquelle il écrivait, ce qui n’était pas un médiocre éloge sous sa plume : « C’est une des Françaises les moins poupées que j’aie rencontrées. » (Stendhal, Souvenirs d’égotisme, p. 14, 15.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1353.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 830 et 881.
- ↑ Le livre des Emblèmes (Symbolicæ questiones, Bononiæ, 1555), par Achille Bocchi, littérateur italien, né en 1488, mort en 1562, à Bologne.
- ↑ Barroilhet, le célèbre chanteur, qui remporta tant de succès sur les scènes italiennes et à l’Opéra, était un amateur de tableaux modernes ; on l’a vu réunir et vendre à plusieurs reprises des collections importantes. Delacroix a peint une étude d’après cet artiste en costume turc, tout en rouge et en pied. (Voir Catalogue Robaut, no 173.)
- ↑ Portrait de Joséphine assise sur le gazon du parterre de la Malmaison.
- ↑ Carrier, peintre miniaturiste (1800-1875), l’un des exécuteurs testamentaires de Delacroix.
- ↑ Le comte Grzimala était un amateur distingué, très épris du talent de Delacroix. Il se rendit acquéreur de plusieurs de ses œuvres.
- ↑ Le comte de Geloës se rendit en effet acquéreur du beau tableau Le Christ au tombeau, qui porte la date de 1848.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1034.
- ↑ Souty, marchand de couleurs, de toiles et de cadres.
- ↑ Cottreau ou Cottereau, favori de la petite cour d’Arenenberg, était un peintre de second ordre ; mais le prince président le nomma inspecteur général des Beaux-Arts, poste qu’il remplit jusqu’à sa mort. Il eut pour successeur Alfred Arago.
- ↑ Martin-Delestre (1823-1858) n’exposa que sous le nom de Delestre.
- ↑ Solange était la fille de Mme Sand.
- ↑ Stanislas Laugier, chirurgien, né en 1798, mort en 1872. Professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine, membre de l’Académie de médecine, de la Société de chirurgie et de l’Académie des sciences. Laugier était un savant fort estimé.
- ↑ On connaît de Delacroix une Jeune femme qui se peigne ; derrière la toilette, Méphisto. (Voir Catalogue Robaut, no 1165.)
- ↑ Peut-être un marchand de curiosités.
- ↑ Gaspard-Jean Lacroix.
- ↑ Aubry, marchand de tableaux.
- ↑ Nicolas-Auguste Bataille, cousin de Delacroix, ancien officier d’état-major, propriétaire de l’abbaye de Valmont, qu’il légua en mourant à M. Bornot.
- ↑ Antoine-Denis Chaudet, statuaire et peintre, né en 1763, mort en 1810. Il avait étudié en Italie les chefs-d’œuvre de l’antiquité et de la Renaissance, et devint un des artistes les plus éminents de la nouvelle école, dont David était le chef. Il fut membre de l’Académie des beaux-arts.
- ↑ Jacques Gamelin, peintre, né en 1739 à Garcassonne, mort en 1803. Grand prix de peinture, élève de l’École de Rome, il devint professeur à l’Académie de Toulouse.
- ↑ Les Romains de la décadence furent exposés au Salon de 1847 et valurent à l’artiste une médaille de première classe et la croix de la Légion d’honneur.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1010.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 996.
- ↑ Émile-Aubert Lessore, peintre paysagiste, qui exposa à Paris de 1831 (2e médaille) à 1869. Il passa les dernières années de sa vie en Angleterre, où il travailla beaucoup à décorer des vases pour les grands porcelainiers de Londres.
- ↑ Boileux, magistral et jurisconsulte, qui était alors juge au tribunal Blois.
- ↑ Louis Ménard, critique d’art, et frère du peintre René Ménard, est mort professeur à l’école des Arts décoratifs.
- ↑ Le comte Eustache Tyszkiewiez, archéologue polonais, et l’un des plus célèbres antiquaires de notre époque, acheta en effet ce tableau qui avait figuré au Salon de 1847 avec les Musiciens juifs. (Voir Catalogue Robaut, no 1010.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 691.
- ↑ On retrouvera de nombreuses fois, dans le cours du Journal, le nom de Jenny ou Jeanne Le Guillou. Elle était la gouvernante de Delacroix. M. Burty a écrit à propos d’elle : « C’était une paysanne des environs de Brest, douée d’instincts délicats. Quelquefois, dans l’atelier, elle disait spontanément, en face d’un croquis ou d’une peinture : Monsieur, je trouve cela très bien. Cette Jenny s’y connaît, s’écriait Delacroix ravi ! Eh bien, je vous le donne. Et il écrivait son nom au revers. De là à renouveler l’anecdote de la servante de Molière, la distance est grande. Malheureusement, vers la fin, malade, soupçonneuse, elle fît le vide autour de son maître, qui ne pouvait se passer de ses soins. » (Correspondance, t. I, p. v. Note de Burty.)
- ↑ Varcollier, alors chef de la division des beaux-arts à la préfecture de la Seine.
- ↑ François Cave, inspecteur des beaux-arts, qui avait épousé Mme Élisabeth Blavot, veuve de Clément Boulanger. (Voir supra, p. 240 et 241.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 462.
- ↑ Hémicycle d’Attila, partie de droite.
- ↑ Au premier plan de l’hémicycle d’Attila.
- ↑ Ronconi, célèbre baryton italien, qui obtint de grands succès à Londres et à Paris, et qui fut nommé en 1848 directeur du théâtre Italien.
- ↑ Delacroix l’avait vendu 1,200 francs à M. Tesse, qui le revendit peu après 3,000 francs.
- ↑ Saint-Marcel, un des élèves de Delacroix, qui fréquentait son atelier. Né vers 1815, mort vers 1890, à Fontainebleau. Saint-Marcel fut un très remarquable dessinateur et peintre paysagiste. Delacroix lui a emprunté parfois des études de figures d’après nature pour les dessiner à son tour suivant son propre sentiment.
- ↑ Baron de Triqueti, peintre et sculpteur, né en 1802, mort en 1874. Son œuvre est importante et remarquable.
- ↑ Le quai du Cours-la-Reine.
- ↑ Le cousin Delacroix habitait à Ante, près Sainte-Menchould. Il est l’auteur de divers ouvrages de poésie.
- ↑ Toile exposée au Salon de 1847. Appartient au duc d’Aumale. (Voir Catalogue Robaut, nos 492 et 105.)
- ↑ M. de Cailleux, ancien directeur des Musées. C’est lui qui, après avoir vu l’esquisse des Croisés à Constantinople, s’efforça de faire comprendre à Delacroix que le Roi désirait un tableau « qui n’eût pas l’air d’être un Delacroix ». (Notes de Riesener. Voir Introduction à la Correspondance, p. xxiii.)
- ↑ Toile de 0m,51 × 0m,65, exposée au Salon de 1848. Appartient à Mme Delessert. Une variante est datée de 1858 (toile de 0m,62 × 0m,50.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, passim.
- ↑ L’esquisse (0m,45 × 0m,37) est de l’année 1838. Le tableau est
de la même année (2m,60 × lm,65). Il fut exposé au Salon de 1838 et à
l’Exposition universelle de 1855. Appartient au Musée de Lille.
Une nouvelle toile fut achevée en 1860, et fut exposée à la vente posthume de Delacroix. - ↑ Pierre Leroux.
- ↑ Il est difficile de savoir si Delacroix veut parler ici de Joseph-Bonaventure Laurens, littérateur et compositeur français, né en 1801, ou de son jeune frère Jules Laurens, peintre lithographe et graveur, né à Carpentras en 1825 ; car le compositeur s’occupait beaucoup de peinture, et le peintre, de musique. Jules Laurens, qui était entré en 1844 à l’École des beaux-arts, se fixa ensuite définitivement à Carpentras.
- ↑ Cournault fut un des légataires de Delacroix.
- ↑ Hémicycle d’Attila.
- ↑ Voir même sujet, Catalogue Robaut, no 789.
- ↑ Delacroix fait sans doute allusion ici au tableau de Rubens qui se trouve à la Pinacothèque de Munich et qui est connu sous le nom d’Enlèvement des filles de Leucippe.
- ↑ Delacroix avait écrit lui-même à l’encre sur le bois du châssis de ce tableau : Lélia dans la caverne du moine, devant le corps de son amant (George Sand). (Voir Catalogue Robaut, n os 1032, 1033.)
- ↑ Jacquand, peintre, né à Lyon en 1805. Il fit d’abord de la peinture historique, puis se livra à la peinture de genre et exécuta de nombreux tableaux, commandés par la liste civile ou acquis par les amateurs.
- ↑ M. Gavet, agent de change, a épousé la fille aînée de M. Bornot.
- ↑ Ce tableau ne fut terminé qu’en 1859. Il fut caricaturé par Cham, et acheté par le Musée d’Arras 4,000 francs. (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ Les notes relatives à 1848 n’ont malheureusement pas été retrouvées.
- ↑ Toile exposée au Salon de 1831 et à l’Exposition universelle de 1855. Appartient au Musée du Louvre.
- ↑ Les relations de l’artiste et du critique n’avaient pas toujours été excellentes. Charles Blanc avait été long à admettre le dessin de Delacroix. À la fin pourtant il s’était rendu ; les admirables peintures décoratives du Palais-Bourbon avaient triomphé de sa mauvaise grâce, si bien qu’il écrivait à propos d’elles : « Sur toutes ces compositions plane le génie d’un incomparable coloriste : le destin, le choix des formes et des draperies, l’intervention des accessoires, la place que chaque objet devra occuper sur le théâtre du tableau, tout cela est subordonné au triomphe de la couleur. » Et encore ceci : « Du reste, le dessin de Delacroix n’est pas ce que l’on croit généralement et ce que nous avions cru nous-même. » (Journal le Temps du 5 mai 1881.)
- ↑ Le nom de George Sand revient assez souvent dans le cours du Journal ; les relations entre elle et Delacroix furent assez suivies pour qu’il paraisse intéressant de rappeler ici le jugement qu’elle portait sur Delacroix dans une lettre au critique Th. Silvestre : « Il y a vingt ans que je suis liée avec lui, et par conséquent heureuse de pouvoir dire qu’on doit le louer sans réserve, parce que rien dans la vie de l’homme n’est au-dessous de la mission si largement remplie du maître ; et je n’ai probablement rien à vous apprendre sur la constante noblesse de son caractère et l’honorable fidélité de ses amitiés. Il jouit également des diverses faces du Beau par les côtés multiples de son intelligence. Delacroix, vous pouvez l’affirmer, est un artiste complet. Il goûte, il comprend la musique d’une manière si supérieure, qu’il eût été probablement un grand musicien, s’il n’eût pas choisi d’être un grand peintre. Il n’est pas moins bon juge en littérature, et peu d’esprits sont aussi ornés et aussi nets que le sien. Si son bras et sa vue venaient à se fatiguer, il pourrait encore dicter, dans une très belle forme, des pages qui manquent à l’histoire de l’art, et qui resteraient comme des archives à consulter pour tous les artistes de l’avenir. » (Th. Silvestre, Les artistes vivants.)
- ↑ Italiana in Algeri, opéra de Rossini. — L’Elisire d’amore, opéra de Donizetti.
- ↑ Tous les artistes connaissent les études que Baudelaire écrivit à différentes reprises sur Delacroix. Parmi ceux qui ont parlé du maître, nul mieux que Baudelaire n’était préparé à le faire, grâce à l’intuition pénétrante de son esprit critique, à son admirable sens de la modernité, surtout à cette universelle compréhension artistique, qui le rendait apte à juger toutes manifestations originales et nouvelles de Beauté. Le Salon de 1845, l’Exposition de 1846, l’Exposition universelle de 1855, lui furent autant d’occasions d’expliquer au public le génie de Delacroix. Mais ce fut surtout le Salon de 1859 qui lui inspira d’éloquentes pages sur le grand peintre. Ce Salon fut pour Delacroix, suivant l’expression de M. Burty, un véritable Waterloo, et Baudelaire lutta d’autant plus ardemment pour proclamer le génie de l’artiste que celui-ci était plus contesté. Aussi Delacroix lui écrivit-il à la suite de son article : « Comment vous remercier dignement pour cette nouvelle preuve de votre amitié ? Vous venez à mon secours au moment où je me vois houspillé et vilipendé par un assez bon nombre de critiques sérieux ou soi-disant tels… Ayant eu le bonheur de vous plaire, je me console de leurs réprimandes. Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts ; vous me faites rougir tout en me plaisant beaucoup : nous sommes faits comme cela. » (Corresp., t. II, p. 218.) Après la mort du maître, Baudelaire fît paraître une étude intitulée : L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix, dans laquelle il réunit ses souvenirs personnels et les présenta au public sous cette forme originale et séduisante dont il avait le secret.
- ↑ Marchand de tableaux.
- ↑ J.-B. Antoine Lassus, architecte, né à Paris en 1807, mort en 1857, collaborateur de Viollet-le-Duc, et inspecteur des édifices religieux de la Seine.
- ↑ Vicomte de Valon, littérateur français, mort en 1851.
- ↑ Édouard Bocher, administrateur et homme politique que les électeurs du Calvados envoyèrent en 1849 à l’Assemblée législative.
- ↑ Armand Manast était alors président de l’Assemblée constituante, et Léon Faucher ministre de l’intérieur.
- ↑ Louis Poinsot (1777-1859), géomètre, membre de l’Académie des sciences, ancien pair de France. Il est célèbre par ses découvertes scientifiques et ses importants travaux.
- ↑ Laurent-Joseph Pelletier, paysagiste, né en 1810. Son œuvre est considérable et dénote un incontestable talent. Il a beaucoup travaillé dans la forêt de Fontainebleau.
- ↑ Chenavard devait être par la suite un des plus intimes amis de Delacroix, un de ceux avec lesquels il « aimait à s’expatrier en de longues causeries ». Si sévèrement qu’il ait pu le juger comme producteur, et l’on conçoit que les théories abstruses du peintre-philosophe aient été souvent en opposition avec les idées de Delacroix, il est une chose qu’il lui a toujours reconnue, c’est l’érudition profonde, l’amour des idées, par quoi il se différenciait si nettement de la plupart des peintres.
- ↑ Nous nous sommes expliqué dans notre étude sur l’opinion de Delacroix à l’égard de Paul Delaroche.
- ↑ Claude-Marie Dubufe, peintre, né à Paris en 1789, mort en 1864, élève de David. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, ses œuvres eurent une vogue prodigieuse. C’est au Salon de 1849 qu’il exposa une République dont il est question ici.
- ↑ Delacroix appréciait le talent de Meissonier. On lui prête ce mot : « De nous tous, c’est encore lui qui est le plus sûr de vivre. » Baudelaire s’étonnait, au contraire, de ce jugement, et se demandait comment il se pouvait faire que « l’auteur de si grandes choses jalousât presque celui qui n’excellait que dans les petites ».
- ↑ Il est difficile de savoir exactement à quel tableau Delacroix fait ici allusion, car il fît en ces années 1847, 1848 et 1849 de nombreuses variantes de ce sujet. (Voir Catalogue Robaut, nos 1017, 1055.)
- ↑ Sans doute le Labourage nivernais.
- ↑ Marc-Aurèle mourant, exposé au Salon de 1845. La ville de Lyon acheta ce tableau à Delacroix en 1858 seulement et le paya 4,000 francs. (Voir Catalogue Robaut, no 924.) Cependant le catalogue du Musée de Lyon porte la mention : « Don du gouvernement. »
- ↑ Racine Gaultier, dit Prudent, pianiste et compositeur français, né en 1817, mort en 1863. Il fut un très remarquable virtuose.
- ↑ Louis-Charles-Auguste Couder, peintre d’histoire, né en 1790, mort en 1873, élève de Regnault et de David. En 1838, il se présenta à l’Institut en concurrence avec Delacroix et fut élu le 28 décembre.
- ↑ C’est ainsi que les sculpteurs opèrent pour construire leurs maquettes ou esquisses. Il n’est pas étonnant que les dessinateurs et les peintres aient employé ce procédé, qui doit remonter à la plus haute antiquité.
- ↑ En 1849, Delacroix exécuta, en effet, quatre magnifiques compositions représentant des fleurs et qui figurèrent à la vente posthume de son atelier. (Voir Correspondance, t. II, p. 13, 14 et 15.)
- ↑ Genre de plantes de la famille des liliacées, originaire d’Afrique et remarquable par la beauté de ses fleurs d’un bleu d’azur.
- ↑ Habeneck, violoniste, né en 1781, mort en 1849. Virtuose remarquable, chef d’orchestre hors ligne, il dirigea longtemps les orchestres de l’Opéra et du Conservatoire, et contribua à rendre populaires en France les œuvres de Beethoven.
- ↑ Weill, Lefebvre, Thomas, Bouquet, étaient des marchands de tableaux. La vente de ces onze tableaux ou esquisses, qui mesurent, en moyenne, 0m,40× 0m,50, rapporta à Delacroix la somme totale de deux mille francs ! (Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ Frédéric Bourgeois de Mercey, peintre et écrivain, né en 1808, mort en 1860. A la suite de débuts heureux comme paysagiste, il entra, en 1840, comme chef de bureau des beaux-arts, au ministère de l’intérieur, et succéda, en 1853, au comte d’Houdetot, comme membre libre de l’Académie des beaux-arts. Cette même année, il devint, au ministère d’État, directeur des beaux-arts.
- ↑ Le docteur Véron, le fondateur de la Revue de Paris, l’ancien directeur de l’Académie de musique, l’auteur des Mémoires d’un bourgeois de Paris, où l’on retrouve une foule de détails intimes sur Delacroix.
- ↑ Marchand de couleurs et de tableaux.
- ↑ Louis Cabat, peintre, et l’un des bons paysagistes de notre époque.
- ↑ Édouard Bertin, fils de Bertin l’aîné, frère d’Armand Bertin, né en 1797, mort en 1871. Élève de Girodet-Trioson, il devint un paysagiste distingué. Mais, en 1854, à la mort de son frère Armand, il abandonna la peinture pour se consacrer entièrement à la direction du Journal des Débats.
- ↑ Barbès, qui avait pris une part active à l’insurrection du 15 mai 1848 contre la représentation nationale, avait été arrêté et traduit avec ses coaccusés devant la haute cour de Bourges, sous l’inculpation de complot tendant au renversement du gouvernement républicain. Devant la cour, Barbès parla à diverses reprises non pour se défendre, mais sur les faits généraux de la cause. Il fut condamné, le 2 avril 1849, à une détention perpétuelle.
- ↑ Le général Cavaignac avait dû se démettre du pouvoir à la suite de l’élection du 10 décembre 1848 qui avait appelé le prince Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République. Il jouissait cependant encore à Paris d’une immense popularité.
- ↑ Charles Blanc était alors à la tête de l’administration des beaux-arts.
- ↑ Beau-père de M. Thiers.
- ↑ Alard, violoniste distingué, né en 1815. Il fut l’élève d’Habeneck et professeur au Conservatoire.
- ↑ Alkan, musicien et compositeur, né à Paris en 1813. Il a publié de nombreux morceaux.
- ↑ Amaury Duval, peintre, né en 1808, élève d’Ingres. Il exécuta un certain nombre de peintures murales, notamment dans la chapelle de la Vierge à Saint-Germain l’Auxerrois, etc.
- ↑ Victor-Louis Mottez, peintre, élève d’Ingres et de Picot, exécuta un grand nombre de fresques à Saint-Germain l’Auxerrois, à Saint-Séverin et à Saint-Sulpice.
- ↑ Victor Orsel, peintre, élève de Guérin, qu’il suivit à l’École française de Rome, où l’étude des chefs-d’œuvre de la Renaissance lui inspira le goût de la fresque. Il fut, par la suite, chargé de décorer la chapelle de la Vierge à Notre-Dame de Lorette.
- ↑ Duban, architecte, né à Paris en 1797. De 1824 à 1829, il séjourna en Italie, et se livra à l’étude de l’antique et de la Renaissance. De retour en France, il fut chargé en 1834 de continuer le palais des Beaux-Arts, commencé par Debret, et reprit l’édifice sur un plan complètement nouveau. Après la révolution de Février, il devint architecte du Louvre. Il exécuta la restauration de la façade extérieure, dite « la Galerie du Bord de l’eau », et termina en quatre ans, au milieu des remaniements qui lui furent successivement demandés, la galerie d’Apollon, le Salon carré, la salle des Sept-Cheminées, les jardins et les grilles, plus tard déplacées, de la cour et de la grande façade, enfin tous les détails d’ornementation intérieure qu’il avait longtemps étudiés et préparés. En 1854, il se démit de son titre d’architecte du Louvre.
- ↑ Le docteur Cabarrus, célèbre médecin de l’époque.
- ↑ Eugène Poujade, diplomate et littérateur. Il occupa en Orient des postes importants et publia de nombreux articles dans la Revue des Deux Mondes.
- ↑ Mathieu de la Redorte, homme politique, ami de M. Thiers.
- ↑ L’Assemblée constituante devait en effet se dissoudre pour céder la place à l’Assemblée législative à la fin du mois de mai 1849.
- ↑ La célèbre cantatrice, chez laquelle Delacroix fréquentait assidûment, ne contribua pas peu à l’éducation musicale du maître. Elle fit naître et développa en lui l’amour de la musique de Glück, et l’on verra dans la suite du Journal quelle admiration le peintre ressentit pour le talent de cette grande artiste.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 772.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1297.
- ↑ Louis-Eugine Cœdès, peintre, né en 1810, mort en 1868. Il exposa au Salon de 1861.
- ↑ Sujet tiré d’une ballade écossaise, de Burns. (Voir Catalogue Robaut, nos 136 et 197.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1166, 1167.
- ↑ Toile de 0m,67 × 0m,48. Fait partie de la Galerie Bruyas, au Musée de Montpellier. (Voir Catalogue Robaut, no 1066.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1074.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1168.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 772.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1063.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1172.
- ↑ Toile de 0m,41 × 0m,32. Exposée au Salon de 1850-51. — Elle fut caricaturée par Cham. Donnée à Théophile Gautier. Vente Gautier, 1873 : 7,000 francs. (Voir Catalogue Robaut, no 1171.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1238.
- ↑ Duriez, parent de Delacroix.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 754, 1176, 1177, 1178 et autres.
- ↑ Louis Peisse, littérateur, né à Aix en 1802. fut d’abord conservateur des objets d’art au Mont-de-piété de Paris, puis conservateur du Musée des études à l’École des Beaux-Arts. Il a publié des articles de critique et de philosophie dans le Producteur, le National, la Revue des Deux Mondes, les Salons de 1841 à 1844, dans ce dernier recueil. La lettre en question, qui figure dans la Correspondance (t. II, p. 18), contient des remerciements au critique pour un article élogieux que celui-ci avait fait paraître dans le Constitutionnel après le Salon de 1849.
- ↑ Baron de Meneval, né en 1778, mort en 1850. Ancien secrétaire du premier Consul, et plus tard de l’Empereur ; il accompagna Napoléon dans ses campagnes, fut nommé baron et maître des requêtes au conseil d’État. Il vécut dans la retraite à partir de la seconde Restauration, et se consacra à la publication des souvenirs historiques sur l’Empire.
- ↑ Mme de Mirbel, née en 1796, morte en 1849. Élève d’Augustin, elle devint, sous sa direction, un des plus remarquables peintres en miniature de ce temps. On lui doit un grand nombre de portraits excellents, notamment Charles X, le duc de Fitz-James, le comte Demidoff, Louis-Philippe, le duc d’Orléans, le comte de Paris, Émile de Girardin, etc. Elle avait sérieusement encouragé Delacroix à ses débuts : « Mme de Mirbel est excellente pour moi et me pousse », écrivait-il à Soulier en 1828. (Corresp., t. 1, p. 121.)
- ↑ Victor Baltard, architecte, né en 1805, mort en 1874, grand prix d’architecture, directeur des travaux de Paris et du département de la Seine, membre de l’Institut. Il a construit un grand nombre d’édifices et de monuments parisiens, et a dirigé les travaux de restauration et de décoration dans plusieurs églises de Paris, notamment Saint-Germain des Prés, Saint-Eustache, Saint-Severin, Saint-Étienne du Mont, Saint-Sulpice, etc.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1184.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1227.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 714
- ↑ L’émotion de Delacroix s’explique facilement, car c’est là, à l’abbaye de Valmont, que le maître avait passé les meilleurs moments de sa jeunesse. Son cousin, M. Bataille, officier d’état-major, attaché à la personne du prince Eugène, à la suite duquel il fit les campagnes d’Italie et de Pologne, de 1811 à 1813, était propriétaire de cette ancienne abbaye, qui avait été bâtie pour huit moines bénédictins, et qui touchait aux ruines d’une église beaucoup plus ancienne. M. Bataille avait réparé les ruines et l’habitation, puis il avait planté un parc à l’entour. A sa mort, Valmont était devenue la propriété de M. Bornot, cousin de M. Bataille et de Delacroix.
- ↑ Delacroix exécuta à l’abbaye de Valmont des fresques. Elles furent peintes en 1834. À ce propos, il écrivait à Villot : « Le cousin m’a fait préparer un petit morceau de mur avec les couleurs convenables, et j’ai fait en quelques heures un petit sujet dans ce genre assez nouveau pour moi, mais dont je crois que je pourrais tirer parti, si l’occasion s’en présentait… J’avoue que je serai singulièrement ragaillardi par un essai dans ce genre, si je pouvais le faire sérieusement et en grand.» (Voir Correspondance, t. I, p. 203 et 204.)
- ↑ Anne-Françoise Delacroix, qui épousa Louis-Cyr Bornot, était la grand’tante d’Eugène Delacroix. Celui-ci avait fait le portrait de sa vieille parente, en 1818, quand il n’avait pas encore vingt ans. (Voir Catalogue Robaut, no 1460.)
- ↑ Saint-Pierre en Port.
- ↑ Madame Laporte, veuve de l’ancien consul de France à Tanger.
- ↑ Zimmerman, compositeur et pianiste distingué, né à Paris en 1785, mort en 1853. Il fut longtemps professeur de piano au Conservatoire.
- ↑ L’Arsace et Isménie, petit roman oriental de Montesquieu, où l’affabulation romanesque se trouve entremêlée de considérations politiques, et qui fait partie des œuvres posthumes de l’écrivain.
- ↑ Le cousin Bataille.
- ↑ Lorenzo Ghiberti, sculpteur et architecte, né à Florence en 1378, mort vers 1455.
- ↑ La peinture n’est pas connue, mais on cite deux dessins. (Voir Catalogue Robaut, nos 727, 728.)
- ↑ M. et Mme Bornot avaient six enfants : un fils, M. Camille Bornot, et cinq filles qui en se mariant devinrent : Mmes Gavet, Lambert, Porlier, Pierre Legrand et Journé.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 543 et 544.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1246.
- ↑ Marchand de tableaux.
- ↑ Gauard, éditeur des Galeries historiques de Versailles.
- ↑ La princesse Marcellini Czartoriska.
- ↑ Théodore Gudin, peintre de paysages et de marines, né à Paris en 1802, mort en 1880. Il fut élève de Girodet, qu’il quitta pour l’atelier de Géricault et pour celui de Delacroix.
- ↑ Il ne paraît point que les relations aient été très suivies entre Stendhal et Delacroix. Stendhal en 1824 avait écrit un « Salon » dans le Journal de Paris et des départements, Salon qui fut réimprimé dans les Mélanges d’art et de littérature. Il n’avait pas été perspicace en ce qui touche le talent du peintre, car il y déclarait qu’il ne pouvait admirer ni l’auteur ni l’ouvrage ; il parlait des Massacres de Scio. Pourtant il le rapproche de Tintoret, ce qui n’est point un médiocre compliment, et il conclut en disant : « M. Delacroix a toujours cette immense supériorité sur tous les auteurs de grands tableaux qui tapissent les grands salons, qu’au moins le public s’est beaucoup occupé de ses ouvrages. »
- ↑ Pour l’inauguration de la chapelle, Delacroix envoya une invitation datée du 29 juin 1861. Il expose ainsi les sujets de la décoration :
« M. Delacroix vous prie de vouloir bien lui faire l’honneur de visiter les travaux qu’il vient de terminer, dans la chapelle des Saints-Anges, à Saint-Sulpice. Ces travaux seront visibles au moyen de cette lettre, depuis le mercredi 21 juin jusqu’au 3 août inclusivement, de une à cinq heures de l’après-midi. Première chapelle à droite en entrant par le grand portail.
Plafond. L’archange saint Michel terrassant le démon.
Tableau de droite. Héliodore chassé du temple. S’étant présenté avec ses gardes pour en enlever les trésors, il est tout à coup renversé par un cavalier mystérieux : en même temps, deux envoyés célestes se précipitent sur lui et le battent de verges avec furie, jusqu’à ce qu’il soit rejeté hors de l’enceinte sacrée.
Tableau de gauche. La lutte de Jacob avec l’anqe. Jacob accompagne les troupeaux et autres présents à l’aide desquels il espère fléchir la colère de son frère Ésaü. Un étranger se présente qui arrête ses pas et engage avec lui une lutte opiniâtre, laquelle ne se termine qu’au moment où Jacob, touché au nerf de la cuisse par son adversaire, se trouve réduit à l’impuissance. Cette lutte est regardée par les Livres saints comme un emblème des épreuves que Dieu envoie quelquefois à ses élus. »(Voir Corresp., t. II, p. 200 et 201.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1341.
- ↑ Cuvillier-Fleury, littérateur, né en 1802, mort en 1887. Il fut le précepteur du duc d’Aumale, et écrivit de nombreux articles au Journal des Débats. En 1860, il entra à l’Académie française.
- ↑ Auguste Desportes, poète et auteur dramatique, né en 1797, mort en 1866.
- ↑ Alexandre Bixio (1808-1865), savant et homme politique. Il prit une part active à la révolution de Juillet. En 1831, il fonda avec Buloz la Revue des Deux Mondes. Il fut rédacteur au National et l’un des principaux écrivains de l’opposition libérale. En 1848, il devint ministre de l’agriculture.
- ↑ C’est sous ce titre que Delacroix désignait, dans la conversation, une de ses Baigneuses. À propos de ce tableau, M. Robaut écrit : « La jeune femme a la tête ceinte d’un ruban bleu qui flotte sur son dos ; elle s’appuie sur un banc de verdure où sont déposés des vêtements qui éclatent en tons blancs et rouges. »
- ↑ J.-B. Isabey, célèbre peintre miniaturiste français, né en 1767, mort en 1855. Ses portraits le montrent comme un dessinateur des plus remarquables. Sous le Directoire, sous l’Empire et sous la Restauration, il jouit de la faveur du public et fut successivement directeur de l’atelier des peintres à la manufacture de Sèvres et conservateur adjoint des Musées royaux.
- ↑ Roger de Piles (1635-1709), peintre et écrivain, auteur d’un Abrégé de la vie des peintres.
- ↑ Delacroix portera plus loin un jugement sur Rousseau. Il est intéressant de noter ici l’opinion de Rousseau sur Delacroix ; on la trouve dans une très curieuse lettre du paysagiste, publiée par M. Burty dans son volume Maîtres et petits maîtres. Cette lettre contient un parallèle entre Ingres et Delacroix, et conclut ainsi : « Faut-il vous dire que je préfère Delacroix avec ses exagérations, ses fautes, ses chutes visibles, parce qu’il ne tient à rien qu’à lui, parce qu’il représente l’esprit, le temps, le verbe de son temps ? Maladif et trop nerveux peut-être, parce que son art souffre avec nous, parce que dans ses lamentations exagérées et ses triomphes retentissants, il y a toujours le souffle de la poitrine et son cri, son mal et le nôtre. Nous ne sommes plus au temps des Olympiens comme Raphaël, Véronèse et Rubens, et l’art de Delacroix est puissant comme une voix de l’Enfer du Dante. » (Ph. Burty, Maîtres et petits maîtres, p. 157.)
- ↑ Eugène Durieu, administrateur et écrivain, né en 1800. Entré au ministère de l’intérieur, il devint en 1847 inspecteur général des établissements d’utilité publique. Chargé, après la révolution de Février, de la direction générale de l’administration des cultes, il institua une commission des arts et édifices religieux, et créa le service des architectes diocésains pour la conservation des monuments affectés au culte.
- ↑ Léon Vaudoyer, architecte, né le 7 juin 1803, mort en 1872. Il déploya un remarquable talent pratique dans la restauration des vieux monuments historiques, et fut nommé, en 1868, membre de l’Académie des beaux-arts.
- ↑ Dans son charmant livre intitulé Souvenirs, Mme Jaubert a écrit d’intéressantes notes sur Delacroix et ses séjours à Augerville chez Berryer : « Delacroix, aimable, séduisant, d’une politesse exquise, sans aucune exigence, jouissait pleinement à Augerville d’une sorte de vacance qu’il s’accordait. » Elle y raconte une anecdote très intéressante sur les rapports de Delacroix avec la princesse Belgiojoso.
- ↑ Jules Laurens peintre et lithographe, né en 1825, élève de Paul Delaroche. En 1847, il fut chargé par le gouvernement d’accompagner Hommaire de Hell, envoyé en mission en Turquie, en Perse, en Asie Mineure, et il dessina pendant ce voyage des sites, des types, des costumes qui étaient encore peu connus. Il a publié en 1854 la relation de ce voyage.
- ↑ Fortoul, qui devait, l’année suivante, recevoir du Président le portefeuille de la marine, était alors député à l’Assemblée législative.
- ↑ Delacroix fait sans doute allusion à un grand et magnifique dessin qui appartient à Mme Andrieu, la veuve du peintre élève de Delacroix. Il représente la première idée du maître, et certaines parties de la composition, notamment les parties basses, diffèrent sensiblement de l’exécution définitive.
- ↑ Delsarte, artiste lyrique et musicien de haute valeur, se consacra surtout à l’enseignement de son art, et contribua par ses efforts à répandue dans le public le goût de la musique ancienne.
- ↑ Joseph Darcier, acteur, chanteur et compositeur, né en 1820.
- ↑ Piscatory, homme politique et diplomate, né en 1799, mort en 1870. Il joua un rôle assez important sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Il fut envoyé comme ministre plénipotentiaire en Grèce en 1844 et comme ambassadeur quelques années après en Espagne. Sous le second Empire, il rentra définitivement dans la vie privée.
- ↑ Émile Lafont, peintre de sujets religieux.
- ↑ Ici paraît pour la première fois le nom du peintre Pierre Andrieu, qui fut le collaborateur assidu de Delacroix, après avoir été son élève. Il eut sa part dans ses principaux travaux décoratifs, notamment dans la galerie d’Apollon du Louvre et la chapelle de Saint-Sulpice. Après sa mort, il fut chargé de la restauration du plafond de la galerie d’Apollon et de la coupole de la bibliothèque du Luxembourg. Andrieu s’était assimilé si complètement la manière de Delacroix que Th. Gautier écrivait à propos de lui : « Les dessous de ses chefs-d’œuvre n’ont pas de secret pour lui. Ses personnages se meuvent naturellement… comme ceux de Delacroix ; ils ont les mêmes types, les mêmes allures, le même goût d’ajustement. Si ce ne sont pas des frères, ce sont au moins des cousins germains, et après quelques heures de retouche, le maître volontiers les signerait. » C’était à la fois faire l’éloge et la critique du talent d’Andrieu. La vénération de l’élève pour le maître revêtait le caractère d’une véritable religion : il conserva pendant près de trente années les copies du Journal que nous publions aujourd’hui, sans permettre qu’on y portât la main, malgré les propositions qui lui furent faites.
- ↑ Le général Ledru des Essarts, frère du naturaliste Pierre Ledru, fit toutes les campagnes de la Révolution et de l’Empire. En 1836, Louis-Philippe le nomma pair de France. Il mourut à Champrosay en 1844.
- ↑ Georges Villot, fils de son ami Frédéric Villot.
- ↑ Mme Barbier était la belle-mère de Frédéric Villot.
- ↑ Toile de 0m,60 × 0m,40. Galerie Bruyas, au Musée de Montpellier. (Voir Catalogue Robaut, no 1184.)
- ↑ Le général Lamoricière était alors député à l’Assemblée législative et combattait avec le général Cavaignac la politique du Prince Président, dont il entrevoyait les projets.
- ↑ Adrien de Jussieu avait, en 1826, remplacé son père, Joseph de Jussieu, dans la chaire de botanique au Muséum.
- ↑ Il est question ici du plafond de la galerie d’Apollon du Louvre.
Apollon vainqueur du serpent Python : tel est le titre définitif de la
composition. Toile 8m × 7m,50. M. Robaut, dans son Catalogue, écrit
que le prix fut d’abord fixé à 18,000 francs, et que l’architecte Duban fit
de son propre mouvement élever la somme à 24,000 francs. Voici en
quels termes Delacroix décrit le sujet de sa décoration :
« Le dieu, monté sur son char, a déjà lancé une partie de ses traits ; Diane, sa sœur, volant à sa suite, lui présente son carquois. Déjà percé par les flèches du dieu de la chaleur et de la vie, le monstre sanglant se tord en exhalant dans une vapeur enflammée les restes de sa vie et de sa rage impuissante. Les eaux du déluge commencent à tarir et déposent sur les sommets des montagnes ou entraînent avec elles les cadavres des hommes et des animaux. Les dieux se sont indignés de voir la terre abandonnée à des monstres difformes, produits impurs du limon ; ils se sont armés comme Apollon. Minerve, Mercure s’élancent pour les exterminer, en attendant que la sagesse éternelle repeuple la solitude de l’univers ; Hercule les écrase de sa massue, Vulcain, le dieu du feu, chasse devant lui la nuit et les vapeurs impures, tandis que Borée et les Zéphyrs sèchent les eaux de leur souffle et achèvent de dissiper les nuages. Les nymphes des fleuves et des rivières ont retrouvé leur lit de roseaux et leur urne encore souillée par la fange et les débris. Des divinités plus timides contemplent à l’écart ce combat des dieux et des éléments. Cependant, du haut des cieux, la Victoire descend pour couronner Apollon vainqueur, et Iris, la messagère des dieux, déploie dans les airs son écharpe, symbole du triomphe de la lumière sur les ténèbres et sur la révolte des eaux. »
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1347.
- ↑ C’est l’expression même que Gros avait appliquée au talent de Delacroix, en 1822, à propos du Dante et Virgile. Le rapprochement nous a paru curieux à noter.
- ↑ Les plus beaux de ces vitraux ont été faits d’après les cartons de trois artistes flamands : Frans Floris, Van Orley et Van Thulden.
- ↑ François-Joseph Navez, peintre belge né en 1787, mort en 1869. Élève de David, il conquit en Belgique une grande réputation et devint successivement directeur de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, premier professeur de peinture à cette Académie, membre de l’Académie royale de Belgique et correspondant de l’Institut de France.
- ↑ Lucas de Leyde, peintre et graveur hollandais (1494-1533).
- ↑ Rappelons que Fromentin, comparant les deux Musées de Bruxelles et d’Anvers, écrivait à ce propos, en jugeant l’œuvre de Rubens : « Si j’écrivais l’histoire de Rubens, ce n’est point ici (à Bruxelles) que j’en écrirais le premier chapitre : j’irais saisir Rubens à ses origines, dans ses tableaux antérieurs à 1609 ; ou bien je choisirais une heure décisive, et c’est d’Anvers que j’examinerais cette carrière si directe, où l’on aperçoit à peine les ondulations d’un esprit qui se développe en largeur, agrandit ses voies, jamais les incertitudes et les démentis d’un esprit qui se cherche. » (Les Maîtres d’autrefois, p. 39.) Et plus loin il ajoute : « Admire-t-on toujours ? Pas toujours. Reste-t-on froid ? Presque jamais. »
- ↑ Delacroix a traité plusieurs fois le même sujet (voir Catalogue Robaut, nos 1377-1379), et chaque fois sa composition rappelle beaucoup celle du maitre flamand, dont il fit une peinture. (Voir même Catalogue, no 1941.)
- ↑ Depuis quelques années, le Musée a été encore transporté dans un nouvel édifice spacieux et bien aménagé.
- ↑ « Rien des années, écrit Fromentin, séparent l’Assomption de la Vierge des deux toiles dramatiques de Saint Liévin et du Christ montant au Calvaire. » Il parle de « la main puissante, effrénée ou raffinée qui peignait à la même heure le Martyre de saint Liévin, les Mages du Musée d’Anvers, ou le Saint Georges de l’église Saint-Jacques ». (Fromentin, les Maîtres d’autrefois, p. 40, 41.)
- ↑ Théodore Van Thulden, peintre et graveur flamand (1607-1676).
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 106 et 140.
- ↑ Delacroix écrit à Soulier : « Mes mauvais moments ont été dans les promenades à l’usage des promeneurs, parce que j’y rencontrais des faces fardées, habillées, bourgeoises ou aristocratiques, tous mannequins. » (Correspondance, t. II, p. 52.)
- ↑ « … A peine dans les champs, au milieu des paysans, des bœufs, de quelque chose de naturel enfin, je rentrais dans la possession de moi-même, je jouissais de la vie. » (Correspondance, t. II, p. 52.)
- ↑ Cet article sur l’enseignement du dessin parut dans la Revue des Deux Mondes, du 15 septembre 1850. Delacroix l’avait écrit à propos du livre de Mme Élisabeth Cavé : Le dessin sans maître.
- ↑ Horace Raisson (1798-1854), homme de lettres et journaliste, a été un des collaborateurs de Balzac. C’était un des plus anciens camarades de Delacroix, qui l’avait connu vers 1816. (Voir Catalogue Robaut, nos 62, 63, 192, 1469.)
- ↑ « Ce qu’il y a de vraiment extraordinaire dans ce tableau, grâce aux circonstances qui me permettent de le voir de près et d’en saisir le travail aussi nettement que si Rubens l’exécutait devant moi, c’est qu’il a l’art de livrer tous ses secrets, et qu’en définitive il étonne à peu près autant que s’il n’en livrait aucun. Je vous ai déjà dit cela de Rubens, avant que cette nouvelle preuve me fût donnée. » (Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, p. 61.)
- ↑ Ferdinand de Braekeleer, peintre belge, né en 1792, un des plus brillants représentants de l’école belge contemporaine. M. de Braekeleer était alors conservateur du Musée d’Anvers.
- ↑ Galerie d’Apollon.
- ↑ Henri Leys, peintre belge, né en 1815, mort en 1869, élève de Ferdinand de Braekeleer, son beau-frère. Son œuvre est considérable et des plus remarquables.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1118.
- ↑ Il s’agit ici de Bazin, historien, né en 1797, mort en 1850, auteur d’ouvrages historiques estimés, notamment une Histoire de France sous Louis XIII et sous le cardinal Mazarin, qui obtint le prix Gobert.
- ↑ Apollon vainqueur du serpent Python.
- ↑ Jean-Guillaume Schirmer, peintre allemand, né en 1807, mort en 1863. Il est, à vrai dire, le fondateur de l’école de paysage de Dusseldorf. En 1854, il fut appelé à la direction de l’école des beaux-arts de Carlsruhe.
- ↑ Saint-René Taillandier, littérateur, né en 1817, mort en 1879. D’abord professeur de littérature, puis collaborateur très actif de la Revue des Deux Mondes, il obtint en 1863 la chaire d’éloquence française à la Faculté de Paris et fut nommé en 1873 membre de l’Académie française.
- ↑ François Bonvin, peintre, né en 1817, mort en 1887. Bonvin peut être considéré comme un des meilleurs peintres de genre de notre époque.
- ↑ Jules-Claude Ziegler, peintre, né en 1804, mort en 1856. Élève d’Ingres, il débuta au Salon de 1832 par des tableaux qui commencèrent sa réputation. Il est l’auteur de la peinture qui décore la grande coupole de la Madeleine. Ziegler tient une place distinguée parmi les peintres de la première moitié de notre siècle.
- ↑ Baron Wappers, peintre belge, né à Anvers en 1803, mort en 1874. Il mérite d’être cité parmi les principaux peintres d’histoire de ce temps.
- ↑ Voir Supplément au Catalogue Robaut, no 309.
- ↑ Sans doute le grand orateur Dupin, dit Dupîn aîné, qui fut successivement avocat, procureur général et président de l’Assemblée législative en 1849.
- ↑ Desgranges avait fait en 1832 le voyage au Maroc avec Delacroix et le comte de Mornay, en qualité d’interprète.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 785.
- ↑ Ce tableau, qui est aujourd’hui au Musée de Bordeaux, fut peint pour un concours dans lequel la victoire resta au peintre Court. On reprochait à Delacroix de n’avoir pas, selon la tradition, découvert la tête du président de l’Assemblée. (Voir Cat. Robaut, no 353.) Ce fut après cet échec et probablement encore sous l’impression pénible qu’il avait conservée de cette injustice qu’Eugène Delacroix écrivit à Achille Ricourt, alors directeur de l’Artiste, la très belle lettre sur les concours, dans laquelle on lit ceci : « Je n’ai fait que glisser, au commencement de cet article, sur la difficulté de trouver des juges éclairés et impartiaux ; je n’ai parlé ni des brigues ni des complaisances, et je n’ai pas assez appuyé, comme vous l’avez vu sans doute, sur l’impossibilité d’obtenir des jugements équitables. Cette matière est affligeante autant que féconde ; je laisse à votre sagacité, Monsieur le rédacteur, à votre connaissance des mœurs et de la faiblesse de notre nature, à creuser ce triste sujet, à éclairer, si vous en avez le courage, les manœuvres de l’envie et de cette avidité nécessiteuse qui se précipite dans les concours comme à une curée. » (Corresp., t. I, p. 159.)
- ↑ Adam Mickiewicz, poète polonais (1798-1855). Les œuvres de Mickiewicz se distinguent par une grande variété de sujets et il inspirations.
- ↑ Toutes les observations techniques présentées ici par le maître sur le Python, la Vénus, la Nymphe, la Minerve, la Junon, se réfèrent à la célèbre composition : Apollon vainqueur du serpent Python, qui décore le plafond de la galerie d’Apollon au Louvre. Nous avons donné dans le précédent volume la description littéraire faite par lui-même, de l’œuvre qui devait le plus contribuer à sa gloire.
- ↑ Delacroix fait ici allusion au tableau de Daniel dans la fosse aux lions qui est de 1849 et appartient à la galerie Bruyas de Montpellier. Les hommes de Daniel sont les deux personnages dont la tête et le haut du buste se détachent sur l’ouverture de la fosse et qui regardent épouvantés la scène biblique. Dans une variante de ce même sujet, datée de 1853, ils ont été remplacés par un aigle qui plane. Cette année, qui fut celle où il exposa l’Ugolin, il se présentait à l’Institut, qui lui préférait L. Cogniet. (Voir Catalogue Robaut, nos 1066 et 1213.)
- ↑ C’était une de ses Baigneuses que Delacroix désignait sous ce titre. « La jeune femme a la tête cernée d’un ruban bleu, qui flotte sur son dos : elle s’appuie sur un banc de verdure, où sont déposés des vêtements qui éclatent en tons blancs et rouges. Les eaux sont d’un bleu intense. » (V. Catalogue Robaut.)
- ↑ Cette inauguration précéda de quatre mois seulement l’inauguration du plafond de la galerie d’Apollon, pour laquelle il lança des invitations ainsi rédigées : « M. Delacroix a l’honneur de vous inviter à visiter la peinture qu’il vient de terminer dans la galerie d’Apollon au Louvre. Vous voudrez bien vous y présenter les jeudi 16 et vendredi 17 octobre, depuis onze heures jusqu’à trois heures. » Cette cérémonie attira, comme bien on pense, une foule d’artistes et de curieux ; le spectacle de la salle ainsi animée devait inspirer au caricaturiste Daumier une de ses plus chaudes et de ses plus brillantes peintures, dans la manière du Voleur d’ânes et de l’Amateur d’estampes, que les artistes ont admirés à l’Exposition des caricaturistes.
- ↑ Les idées d’Eugène Delacroix sur Poussin devaient être reprises et développées deux ans plus tard dans une série d’articles qui parurent au Moniteur les 26, 28, 30 juin 1853. Il s’y montre moins sévère pour le Poussin que dans le fragment du Journal, puisqu’il écrit ceci en manière de conclusion : « Indiquer le nom de ces admirables compositions, c’est rappeler à la mémoire de tout le monde ce charme, cette grandeur, cette simplicité dont elles sont remplies et qui rendent toute description languissante. Il en est ainsi de ces bacchanales, de ces allégories dans lesquelles il excellait et qu’on ne peut comparer qu’à ces mêmes sujets, quand ils sont traités par les anciens. »
- ↑ A propos de ce parallèle sur lequel nous nous sommes expliqué dans la préface, il nous paraît intéressant de renvoyer à l’étude sur Raphaël, qui fut un des premiers travaux littéraires d’Eugène Delacroix et qui parut à la Revue de Paris en 1830. On y verra une nouvelle preuve de ce que nous disions dans cette préface, à savoir que « les points de vue se modifient avec l’âge, et que les qualités qui semblent prépondérantes au début d’une carrière prennent souvent une importance moindre à l’époque de la maturité ».
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 727 et 728.
- ↑ Chapelle des Saints Anges, à Saint-Sulpice. (Voir Catalogue Robaut, no 1338 et nos 1343 à 1345.)
- ↑ Penguilly L’Haridon.
- ↑ Emmanuel Fremiet, sculpteur animalier, né en 1824, neveu et élève de Rude. De tempérament fort différent de celui de Rude, il ne put rester longtemps dans son atelier. Il devint, avec Mène et Gain, un des rivaux de Barye.
- ↑ Voir ce que nous avons dit dans notre Étude sur la constante et inébranlable admiration de Delacroix pour le génie de Rubens. Dans sa lettre sur les concours dont nous parlons plus haut, Delacroix écrivait : « Une idée ridicule s’offre à moi. Je me figure le grand Rubens étendu sur le lit de fer d’un concours. Je me le figure se rapetissant dans le cadre d’un programme qui l’étouffé, retranchant des formes gigantesques, de belles exagérations, tout le luxe de sa manière. »
- ↑ Il semble que, dans les relations très assidues de George Sand avec Delacroix, celle-ci ait fait toutes les avances ; non que Delacroix ne ressentit pour elle une réelle sympathie, il ne pouvait demeurer insensible à la franchise et à la bonhomie de sa nature ; ce qu’il prisait infiniment moins, c’était son talent et surtout ses théories humanitaires, qui avaient le don de l’exaspérer. Nous avons longuement insisté sur les convictions philosophiques du maître touchant la question du progrès : George Sand demeurait toujours à ses yeux la vivante incarnation de ces théories. Quant à George Sand, son admiration pour Delacroix fut toujours sans réserve, comme son amitié.
- ↑ Marchand de tableaux.
- ↑ Émile Perrin, qui était alors directeur de l’Opéra-Comique, avait
étudié la peinture dans les ateliers de Gros et de Delaroche ; il avait
également écrit des articles de critique artistique. Il devint par la suite
directeur de l’Opéra, puis, en 1870, administrateur général du Théâtre-Français.
Le comte de Morny avait donné le 22 janvier 1852 sa démission de ministre de l’intérieur ; il ne fut nommé qu’en 1854 président du Corps législatif.
Delangle venait d’être nommé procureur général à la Cour de cassation, en remplacement de Dupin.
Romieu, homme de lettres et administrateur. Il était alors directeur général des beaux-arts.
Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1801-1875), auteur dramatique, un des plus féconds librettistes de cette époque.
Boilay, publiciste et administrateur ; c’était un protégé de M. Thiers ; il fut rédacteur au Constitutionnel. - ↑ Hippolyte Lecomte, peintre, né en 1781, mort en 1855. Il devint le beau-frère d’Horace Vernet et, grâce à lui, fut chargé de nombreuses commandes.
- ↑ Mocquart, homme politique et littérateur. Il était alors secrétaire intime et chef du cabinet de l’Empereur.
- ↑ Mustapha était un des modèles favoris de Géricault.
- ↑ Les entrevues étaient devenues aigres-douces entre Eugène Delacroix et M. Thiers. On conçoit en effet par quels côtés le tempérament de l’homme politique devait déplaire à l’artiste. Quant au fameux article écrit par M. Thiers publiciste, lors des débuts de Delacroix, et que l’on a traité de prophétique, Th. Silvestre fait observer assez justement qu’il n’est qu’une « paraphrase prudhommesque de l’opinion du baron Gérard, de l’aveu de M. Thiers lui-même, qui dit à la fin de son article : L’opinion que j’exprime ici est celle d’un des grands maîtres de l’école. » Th. Silvestre ajoute que M. Thiers loue dans la même page Drolling, Dubufe, Destouches et Delacroix.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1023.
- ↑ « Le voyageur est couché à terre demi-nu ; le Samaritain, vêtu d’un manteau rouge, se penche vers lui, tandis que son cheval broute l’herbe derrière eux : au fond, le prêtre qui passe sans s’arrêter. » (H. de la Madelène, Eugène Delacroix à l’Exposition du boulevard des Italiens.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1118 et 1119.
- ↑ Devinck, industriel, ancien président du tribunal de commerce, membre du conseil municipal de Paris.
- ↑ Delacroix était, parait-il, très fier de sa fonction de conseiller municipal. C’était là une de ces faiblesses communes à presque tous les grands hommes, et qui les poussent à chercher une application de leurs hautes facultés, en dehors du domaine où elles s’exercent naturellement. Mme Riesener, aux souvenirs de laquelle nous avons fait appel, nous racontait qu’il prenait cette fonction très au sérieux, et qu’il lui avait dit le jour de sa nomination : « Je vais donc être de ceux auxquels on demande quelque chose. » Pourtant le passage du Journal ne laisse aucun doute sur l’estime médiocre en laquelle il tenait la majorité de ses collègues.
- ↑ Théophile-Jules Pelouze, chimiste, membre de l’Institut. On lui doit un grand nombre de mémoires et un Traité de chimie générale analytique très apprécié.
- ↑ Alexandre Thierry (1803-1858), chirurgien et ancien directeur des hôpitaux.
- ↑ Mme Anaïs Ségalas, un des plus célèbres bas bleus du temps, auteur de contes enfantins et de petits ouvrages humoristiques.
- ↑ Charles Nodier avait été nommé en 1823 bibliothécaire de l’Arsenal. Son salon devint alors le rendez-vous de tout le monde littéraire et artistique. « Là, dit J. Janin, il recevait tous ceux qui tenaient honorablement une plume, un burin, une palette, un ébauchoir. »
- ↑ Balzac, nous l’avons déjà fait observer dans notre Étude, était antipathique à Delacroix. L’artiste ne lui pardonna jamais ce je ne sais quoi de décousu et de débraillé qui caractérisait sa personne. Delacroix n’avait pas su discerner — et ce fut une de ses rares incompréhensions — l’admirable puissance de génie que dissimulait mal son absence de goût. Et pourtant on trouve à maintes reprises, dans le Journal, des fragments détachés, des citations tirées des œuvres de Balzac, notamment tout le passage sur les artistes et les conditions de production, une des maîtresses pages de la Cousine Bette. Nous pensons que la personnalité encombrante et souvent arrogante de Balzac ne contribua pas médiocrement à écarter de lui Delacroix, car il écrivait à Pierret en 1842, de Nohant, où il se trouvait installé chez Mme Sand : « Nous attendions Balzac qui n’est pas venu, et je n’en suis pas fâché. C’est un bavard qui eût rompu cet accord de nonchalance dans lequel je me berce avec grand plaisir. » (Corresp., t. I, p. 262.)
- ↑ Lehmann, peintre, né à Kiel en 1814. Élève d’Ingres, il imita la manière de son maître, et fit de nombreux portraits précisément dans la société où fréquentait Delacroix. Il exécuta aussi des peintures murales. Le tableau au projet duquel Delacroix fait ici allusion pourrait bien être le Rêve, qui parut au Salon de 1852. Lehmann avait exécuté des compositions décoratives pour la salle des Fêtes de l’Hôtel de ville, et à ce propos M. Robaut, dans son Catalogue, remarque très justement que « la ville a dépensé quatre-vingt mille francs pour faire graver les compositions peintes dans la salle des Fêtes par Lehmann, et qu’elle n’a pas affecta un centime à la reproduction de l’œuvre de Delacroix ».
- ↑ L’opéra de Weber.
- ↑ Delsarte, artiste lyrique et compositeur, qui quitta tout jeune l’Opéra-Comique pour se consacrer à l’enseignement de son art. Il ne se fit plus entendre dès lors que dans les concerts et dans les salons.
- ↑ Delacroix veut probablement parler de son frère Charles Delacroix, qui mourut à Bordeaux le 30 décembre 1845, loin de tous les siens.
- ↑ Il s’agit ici d’Ambroise Firmin-Didot, de la célèbre maison des éditeurs Didot, qui fut éditeur, écrivain, et fit partie du conseil municipal, où il eut un rôle assez important.
- ↑ Il ne paraît pas que Delacroix ait été plus favorable aux tableaux de la jeunesse ou de la maturité qu’à ceux de la vieillesse de David, car du Maroc il écrivait à Villot en 1832 : « Les héros de David et compagnie feraient une triste figure avec leurs membres couleur de rose auprès de ces fils du soleil. » Et à Thoré, en 1840 : « Vous signalez fort bien que, particulièrement dans la question du dessin, on ne veut en peinture que le dessin du sculpteur, et cette erreur, sur laquelle a vécu toute l’école de David, est encore toute-puissante. »
- ↑ Maurice Sand, le fils de George Sand, et Lambert, avaient fait tous deux partie de l’atelier que Delacroix avait ouvert rue Neuve-Guillemin. M. Burty cite parmi les élèves qui s’y rendaient : Joly Grangedor, Desbordes-Valmore, Saint-Marcel, Maurice Sand, Andrieu, Eugène Lambert, Lassalle, Gautheron, Leygue, Th. Véron, Ferrussac.
- ↑ Delacroix fait allusion aux onze compositions sur la Vie d’Hercule qui décoraient les tympans du salon de la Paix à l’Hôtel de ville : Hercule à sa naissance recueilli par Junon et Minerve, Hercule entre le vice et la vertu, Hercule écorche le lion de Némée, Hercule rapporte sur ses épaules le sanglier d’Érymanthe, Hercule vainqueur d’Htppolyte, Hercule délivre Hésione, Hercule tue le centaure Nessus, Hercule enchaîne Nérée, Hercule étouffe Antée, Hercule ramène Alceste du fond des enfers, Hercule au pied des colonnes. (Voir Catalogue Robaut, nos 1152 à 1162.)
- ↑ Mme Herbelin, peintre. Elle était nièce du peintre Belloc, qui fut son professeur. Sur le conseil de Delacroix, elle fit de la miniature, et, y ayant acquis une réputation, s’y consacra exclusivement.
- ↑ Pérignon fit partie de l’administration des Beaux-Arts, en qualité de directeur du Musée de Dijon. Il était en relations assez intimes avec Delacroix, puisqu’il fut l’un des exécuteurs testamentaires du maître.
- ↑ Delacroix avait une vive admiration pour le talent de Rachel. Dans sa composition de la Mort de saint Jean-Baptiste, il s’était inspiré de ses traits pour peindre son Hérodiade. Dans la Sibylle au rameau d’or, tableau de 1845, il songea à la grande actrice, qui venait souvent dans son atelier. (Voir Catalogue Robaut, no 918.)
- ↑ Si l’on en croit Philarète Chasles, le talent d’Alfred de Musset
était antipathique à Delacroix : « C’est un poète qui n’a pas de couleur,
me dit-il un jour ; il manie sa plume comme un burin : avec elle il fait des entailles dans le cœur de l’homme et le tue en y faisant
couler le corrosif de son aine empoisonnée. Moi, j’aime mieux les plaies
béantes et la couleur vive du sang. » (Mémoires de Ph. Chasles, t. I,
p. 331, cités par Burty, Correspondance de Delacroix, t. II, p. 68.)
Il est intéressant d’indiquer comme contre-partie l’opinion de Musset sur Delacroix. A l’époque où l’Hamlet était refusé par le jury, Musset protestait en ces termes dans la Revue des Deux Mondes : « Il semble que tant de sévérité n’est juste qu’autant qu’elle est impartiale, et comment croire qu’elle le soit, lorsqu’on voit de combien de croûtes le Musée est rempli ! » Quelques années auparavant, Alfred de Musset écrivait à son frère : « J’ai rencontré Eugène Delacroix une fois en sortant du spectacle : nous avons causé peinture en pleine rue, de sa porte à la mienne et de ma porte à la sienne, jusqu’à deux heures du matin. Nous ne pouvions pas nous séparer. » (Maurice Tourneux, Eugène Delacroix devant ses contemporains.) - ↑ Nous nous sommes efforcé de préciser les relations de Delacroix avec Géricault dans le premier tome du Journal. Nous avons indiqué les motifs du culte qu’il lui avait voué à ses débuts. En insistant dans notre Étude sur le changement que le temps avait apporté à certaines des opinions du maître, nous avons omis, peut-être à tort, de ne pas mentionner Géricault. Les lecteurs constateront en effet, dans une année postérieure, que Delacroix se range à l’avis de Chenavard qui fait une critique sévère de l’auteur du Naufrage de la Méduse.
- ↑ Aujourd’hui au Musée du Louvre. (Voir Catalogue Robaut, no 840.)
- ↑ Les principes d’esthétique de l’architecte Baltard, qui dirigeait la décoration de Saint-Germain des Prés, le rapprochaient de Flandrin, pour lequel personne n’ignore que Delacroix professait la plus profonde des antipathies.
- ↑ Le Juif errant, opéra en cinq actes, paroles de Scribe et Saint-Georges, musique d’Halévy.
- ↑ Goubaux, auteur dramatique, collaborateur de Dumas père, de Legouvé et d’Eugène Sue. Il dirigeait une institution qui devint le collège Chaptal.
- ↑ Saint-Prix, acteur célèbre, né en 1759, mort en 1834.
- ↑ Roehn (1799-1864), peintre, élève de Gros et auteur d’un grand nombre de tableaux de genre.
- ↑ Tous ces chênes, arbres séculaires de la forêt de Sénart, devinrent pour Delacroix le sujet de croquis plus ou moins arrêtés dont on retrouve la trace dans son œuvre.
- ↑ Soisy-sous-Étiolles, canton de Corbeil.
- ↑ Berzélius, savant suédois dont le nom est écrit autrement sur la couverture du carnet d’où ces notes sont extraites : Berzebilardinovoquentius.
- ↑ Il s’agit de sa gouvernante Jenny et de la servante.
- ↑ Jules Janin, tout en faisant des réserves sur le talent de Delacroix, avait pris sa défense à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’il protesta longuement dans les premières années contre l’exclusion qui frappait chaque année Delacroix et Préault.
- ↑ Le docteur Blache était un médecin célèbre de l’époque.
- ↑ Eugène Durieu, administrateur et écrivain, chargé, après la révolution de Février, de la direction générale de l’administration des cultes ; il institua une commission des arts et édifices religieux, et créa le service des architectes diocésains pour la conservation des monuments affectés au culte.
- ↑ Jean-Pierre Dantan, statuaire et caricaturiste, dit Dantan jeune.
- ↑ C’est la première fois qu’une épithète louangeuse pour Dumas parait dans ce Journal. On lira plus loin les jugements les plus sévères sur l’œuvre du romancier.
- ↑ Delacroix évoque ici des souvenirs d’enfance et de jeunesse. À ce propos, M. Riesener dit dans ses notes : « A Valmont, en Normandie, nous avons passé quelques vacances. Tantôt il était tout feu pour le travail, et faisait des aquarelles délicieuses qui ont été vues à sa vente ; tantôt, ne pouvant s’y mettre, il se mettait à mouler avec passion des figurines qui ornent les tombeaux des moines d’Estouteville, fondateurs de l’abbaye de Valmont. »
- ↑ Possoz, ancien maire de Passy, membre du conseil municipal de Paris.
- ↑ L’église Saint-Ouen, de Rouen.
- ↑ Voir notre Étude, p. xi, xii. À rapprocher du fragment de Baudelaire : « Sans doute il avait beaucoup aimé la femme aux heures agitées de sa jeunesse. Qui n’a pas trop sacrifié à cette idole redoutable ? Et qui ne sait que ce sont justement ceux qui l’ont le mieux servie qui s’en plaignent le plus ? Mais longtemps déjà avant sa fin, il avait exclu la femme de sa vie. Musulman, il ne l’eût peut-être pas chassée de la mosquée, mais il se fût étonné de l’y voir entrer, ne comprenant pas bien quelle sorte de conversation elle peut tenir avec Allah. » (Baudelaire, L’Art romantique. L’Œuvre et la vie d’Eugène Delacroix.)
- ↑ C’étaient les prodromes de cette maladie de larynx qui devait s’aggraver sous l’influence du tabac et l’emporter dix ans plus tard. Il avait toujours été extrêmement délicat de la gorge, et dans ses Souvenirs, Mme Jaubert, qui le rencontrait chez Berryer à Augerville, rapporte que cette excessive délicatesse le condamnait à des accoutrements souvent bizarres.
- ↑ Beauvallet avait débuté à la Comédie-Française le 3 septembre 1830 dans Hamlet, tragédie de Ducis. Le lendemain, M. Charles Maurice écrivait dans le Courrier des théâtres : « Le premier début de M. Beauvallet a été hier des plus insignifiants ; il n’y a rien chez cet acteur qui puisse justifier les prétentions qu’annonce cette tentative. »
- ↑ M. Berger était alors préfet de la Seine. Il ne quitta ce poste qu’en 1853, lorsqu’il fut nommé sénateur.
- ↑ On sait que toute cette salle (salon de la Paix) a été complètement brûlée dans l’incendie du 24 mai 1871.
- ↑ Le docteur Cazenave, qui soignait alors Delacroix.
- ↑ Pierre Legros, sculpteur, né à Paris (1656-1719). Il a passé presque toute sa vie en Italie. Il a pourtant travaillé pour le Louvre ainsi que pour le palais et le parc de Versailles.
- ↑ C’est un retour à l’idée que nous notions dans notre Étude et dont nous nous servions pour justifier la publication du Journal : « Pourquoi ne pas faire un petit recueil d’idées détachées qui me viennent de temps en temps toutes moulées, et auxquelles il serait difficile d’en coudre d’autres ? Faut-il absolument faire un livre dans toutes les règles ? Montaigne écrit à bâtons rompus… Ce sont les ouvrages les plus intéressants. » (Voir t, p. iv, v.)
- ↑ La décoration du Salon de la Paix, à l’Hôtel de ville, se composait de : 1° un plafond circulaire, 2° huit caissons, 3° onze tympans. Le sujet du plafond était : La Paix consolant les hommes et ramenant l’abondance. Ceux des caissons et des tympans étaient des sujets se référant à la mythologie antique : Vénus, Bacchus couché sous une treille, Mars enchaîné, Mercure, dieu du commerce, La Muse Clio, Neptune apaisant les flots, etc.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 852 à 855 et 902.
- ↑ Sur des notes volantes dans un Agenda portant la date 1852.
- ↑ La seule Fiancée d’Abydos était en 1874 vendue 32,050 francs. (Voir Catalogue Robaut, nos 772-773.)
- ↑ Cette superbe toile est au Musée de Bruxelles. (Voir Catalogue Robaut, no 1110.)
- ↑ La première composition de la Mise au tombeau, ou Christ du comte de Geloës, atteignit à la vente Faure, en 1873, le chiffre de 60,000 francs. Cette répétition est d’un bien moindre format. (Voir Catalogue Robaut, nos 1034 et 1037.)
- ↑ Ce tableau fut vendu 17,500 francs en 1877. (Voir Catalogue Robaut, no 1213.)
- ↑ « Le portrait de M. Rruyas, qui fut connu des Parisiens seulement à l’Exposition posthume de l’œuvre de Delacroix, avait été commencé en mai 1853. M. Rruyas, avec l’aide de Th. Silvestre, avait rédigé un catalogue raisonné et illustré de sa collection de peintures modernes. »
(Voir Catalogue Robaut.)
- ↑ Le docteur Armand Trousseau était un des médecins les plus distingués de l’époque. Il avait siégé en 1848 comme député à l’Assemblée constituante. Homme du monde par excellence, passionné pour les arts, causeur plein d’esprit, il était très recherché dans les salons.
- ↑ On remarquera que plus loin Delacroix énonce une idée à peu près opposée à celle-ci.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1942.
- ↑ Confidence rapportée par Baudelaire à qui Delacroix l’avait faite : « Autrefois, dans ma jeunesse, je ne pouvais me mettre au travail que quand j’avais la promesse d’un plaisir pour le soir, musique, bal, ou n’importe quel autre divertissement. Mais aujourd’hui je ne suis plus semblable aux écoliers, je puis travailler sans cesse et sans aucun espoir de récompense. » (Art romantique. L’Œuvre et la vie d’Eugène Delacroix.)
- ↑ Le comte de Lasteyrie, archéologue et homme politique, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, s’était fait connaître par des travaux d’archéologie et de critique d’art. Il avait écrit des articles sur Delacroix au journal le Siècle.
- ↑ Nous avons pu, grâce au précieux travail de M. Maurice Tourneux, Delacroix devant ses contemporains, suivre, année par année, les jugements portés par le célèbre adversaire du maître sur ses différentes expositions. En 1822, il écrivait à propos du Dante et Virgile : « La force convient à l’étude. M. Delacroix l’indique par son tableau du Dante et Virgile ; ce tableau n’en est pas un ; c’est, comme on le dit en style d’atelier, une vraie tartouillade. » En 1855, réunissant ses articles parus dans le Journal des Débats, après avoir dit quelques mots des débuts du jeune homme de talent auquel il n’avait cessé de prodiguer ses conseils, il recommençait « le procès intenté depuis trente ans à l’École moderne ». (V. le livre de M. Tourneux.)
- ↑ Sémiramis, opéra en deux actes, de Rossini.
- ↑ Nous avons déjà noté que le baron Rivet avait été un ami de jeunesse
et un camarade d’atelier de Delacroix et de Bonington. M. Tourneux
dit à propos de lui : « Il avait écrit sur le premier de ces deux grande
artistes un article très important qui fut présenté à la Revue des Deux Mondes, mais non inséré, et c’est grand dommage, car on y eût trouvé
des renseignements bien précieux sur les débuts, les théories et les
procédés de travail du maître. »
Ce que M. Tourneux ne dit pas, et ce que nous pouvons ajouter, c’est que l’article du baron Rivet avait été précisément composé à l’occasion du Journal que nous offrons intégralement au public, dont il avait eu la bonne fortune de détenir quelques fragments en copie. Reconnaissons qu’il a fallu tout un étrange concours de circonstances pour que l’œuvre posthume du plus illustre de nos peintres ne se trouvât livrée à la publicité que trente années après sa mort. - ↑ Il s’agit probablement ici d’une répétition avec variantes du tableau qui porte la date de 1839. (Voir Catalogue Robaut, no 698.)
- ↑ La Cruvelli (baronne Vigier) était une cantatrice célèbre. Ses débuts, selon Delacroix, semblent être passés inaperçus. Si l’on interroge ses biographes, il est facile de constater en effet qu’à la différence de ses illustres rivales, les Grisi, les Pisaroni, ses débuts n’eurent aucun éclat.
- ↑ Le 14 avril 1853, Delacroix écrivait à M. Moreau père : « Eh bien, oui, cher ami, c’est vraiment à n’y pas croire, et pour ma part je n’y comprends rien. Il semble maintenant que mes peintures soient une nouveauté récemment découverte, que les amateurs vont m’enrichir après m’avoir méprisé. » Dans une précédente note, et à propos de toiles vendues par le maître à des marchands ou à des amateurs, nous avons fait quelques rapprochements de chiffres qui par eux-mêmes sont assez éloquents. Delacroix ne s’en montrait pourtant pas mécontent. Il n’était pas exigeant à ce point de vue. Souvent dans sa correspondance il demande à l’amateur qui désire une de ses œuvres d’en fixer lui-même le prix. A cinquante-cinq ans, après trente années de production ininterrompue, c’est un sentiment de surprise qu’il éprouve à constater que le succès lui vient !
- ↑ Henri Rodakowski, peintre polonais, né à Lemberg. Il fut élève de Léon Cogniet. Il envoya au Salon de 1852 un beau portrait de Dembinski, qui lui valut une première médaille. Il exposa ensuite le portrait de sa mère en 1853 et celui de Frédéric Villot en 1855.
- ↑ Delacroix rencontrait assez souvent Th. Gautier chez Riesener et ne se montrait pas toujours à son égard aussi courtois qu’on aurait pu le penser. Nous tenons de Mme Riesener le détail suivant : un soir, Gautier demanda à Delacroix de lui prêter un costume oriental, dont il l’avait vu revêtu à un bal costumé, et le peintre refusa net en termes qui jetèrent un froid parmi les assistants. Nous nous sommes déjà expliqué sur la cause probable de la froideur de Delacroix.
- ↑ Cette admirable toile a figuré récemment à l’Exposition des Cent chefs-d’œuvre, à la salle Petit, avec la Fiancée d’Abydos. Le prix en question était deux mille francs. (Voir Catalogue Robaut, no 1192.)
- ↑ Achille Fould, homme d’État et financier, ministre de Napoléon III. Il fut élu en 1857 membre de l’Académie des beaux-arts.
- ↑ Ce fut pour le Moniteur que Delacroix écrivit le grand article sur le Poussin qui parut dans les nos des 26, 29, 30 juin 1853.
- ↑ En ce qui touche l’opinion de Delacroix sur Courbet et le réalisme, nous nous sommes expliqué dans notre Étude (voir t. I, p. xxx, xxxi). Voici ce que le maître écrivait dans un des albums de son Journal : « Eh ! réaliste maudit, voudrais-tu par hasard me produire une illusion, telle que je me figure que j’assiste en réalité au spectacle que tu prétends m’offrir ? C’est la cruelle réalité des objets que je fuis, quand je me réfugie dans la sphère des créations de l’Art. » Et plus loin : « Il existe un peintre allemand nommé Denner, qui s’est évertué à rendre dans ses portraits les petits détails de la peau et les poils de la barbe : ses ouvrages sont recherchés et ont leurs fanatiques. Véritablement ils sont médiocres et ne produisent point l’effet de la nature. On objectera peut-être que c’est qu’il manquait de génie ; mais le génie même n’est que le don de généraliser et de choisir. » Baudelaire a merveilleusement commenté les causes de l’antipathie d’Eugène Delacroix pour l’art de Courbet.
- ↑ Le tableau auquel Delacroix fait allusion est celui qui figura au Salon de 1853 sous ce titre : Demoiselles de village. Ce sont deux baigneuses, l’une debout, vue de dos, l’autre assise sur l’herbe. Chenavard raconte que Delécluze disait de cette dernière : « Cette créature est telle, qu’un crocodile n’en voudrait pas pour la manger. »
- ↑ Cette Fileuse figurait à l’Exposition universelle de 1889.
- ↑ Il nous paraît au moins curieux de rapprocher du jugement de Delacroix celui de Baudelaire sur le même Millet : « M. Millet cherche particulièrement le style : il ne s’en cache pas ; il en fait montre et gloire. Mais une partie du ridicule que j’attribuais aux élèves de M. Ingres s’attache à lui. Le style lui porte malheur. Ses paysans sont des pédants qui ont d’eux-mêmes une trop haute opinion. Ils étalent une manière d’abrutissement sombre et fatal qui me donne l’envie de les haïr. » (Curiosités esthétiques. Salon de 1859. Le paysage.)
- ↑ Germain Thibaut, ancien président de la chambre de commerce, membre du conseil municipal de Paris.
- ↑ On sait en quelle estime Delacroix tenait les œuvres de Decamps. Il prononce quelque part dans son Journal le mot génie en parlant d’un de ses tableaux. Il avait d’autant plus de mérite à conserver l’impartialité que Decamps, dans un certain genre, était son rival tout indiqué, celui dont le nom venait naturellement à la bouche des ennemis de Delacroix, quand ils voulaient lui opposer un artiste s’étant inspiré de l’Orient. C’est ainsi que les Goncourt, par exemple, dans une plaquette tirée à l’occasion de l’Exposition de 1855, traitent Delacroix de « coloriste puissant, mais à qui a été refusée la qualité suprême des coloristes : l’harmonie ». Puis ils entonnent un hymne en l’honneur de Decamps.
- ↑ Delacroix semble ici se reporter par le souvenir à ses premières impressions de 1825, époque de son voyage à Londres, lorsque, après avoir vu Lawrence, il écrivait à Pierret : « C’est la fleur de la politesse et un véritable peintre de grands seigneurs… J’ai vu chez lui de très beaux dessins de grands maîtres, et des peintures de lui, ébauches, dessins même, admirables. On n’a jamais fait les yeux, des femmes surtout, comme Lawrence, et ces bouches entrouvertes d’un charme parfait. Il est inimitable. » (Corresp., t. I, p. 108-109.)
- ↑ Jean-Baptiste Oudry (1686-1765), célèbre peintre d’animaux.
- ↑ Reynolds (1728-1792), un des peintres les plus justement renommée de l’école anglaise, comme Lawrence, Gainsborough et Wilkie. Outre ses Discours sur les arts, que cite Delacroix, il a écrit des Remarques sur les œuvres des peintres allemands et flamands.
- ↑ Fortoul, littérateur et homme politique ; collaborateur de la Revue de Paris et de la Revue des Deux Mondes. Il fut ministre de la marine en 1851 et ministre de l’instruction publique après le coup d’État.
- ↑ L’exposition dont parle ici Delacroix précéda une vente de trente et un tableaux et dessins, faite par l’auteur personnellement, et qui produisit environ 75,000 francs. Le Josué fut vendu 8,500 francs, le Job, 7,020 francs. (Voir Théoph. Silvestre, Artistes vivants.)
- ↑ Paul Chevandier de Valdrôme, peintre paysagiste, élève de Marilhat et de Cabat, auteur d’ouvrages estimés, qui lui valurent plusieurs médailles aux Salons.
- ↑ M. Bruyas est représenté assis dans un fauteuil et vu jusqu’à mi-corps. Ce portrait figure à la galerie Bruyas, à Montpellier.
- ↑ La suite manque dans le manuscrit.
- ↑ Il s’agit du peintre Eugène Lamy, connu surtout comme dessinateur et aquarelliste. Il paraît avoir été très cher à Delacroix, à cause de l’analogie que présentait son talent délicat et distingué avec celui de Bonington, qui avait été le camarade de jeunesse du maître.
- ↑ D’après le Catalogue Robaut (voir nos 1214-1220), il existe six ou sept peintures différentes sur ce même sujet. La couleur générale de l’œuvre et sa signification demeurent toujours identiques ; elles diffèrent simplement par le groupement des personnages ou par la dimension de la barque par rapport au cadre.
- ↑ Ce Chevigné était un médiocre rimeur qui s’était fait une réputation de salon.
- ↑ Sur les projets de voyage en Italie, voir notre Étude, p. xlv et xlvi.
- ↑ Mariette Lablache, fille du célèbre chanteur du Théâtre-Italien, est devenue par son mariage baronne de Caters.
- ↑ Feuillet de Conches (1798-1887), chef du protocole au ministère des affaires étrangères, introducteur des ambassadeurs, écrivain distingué, auteur de livres appréciés, notamment les Causeries d’un curieux.
- ↑ Les relations furent toujours excellentes entre Sainte-Beuve et Delacroix. En 1862, le peintre écrivait au critique : « Que je vous remercie du plaisir que m’a causé le souvenir si flatteur que vous me donnez dans votre excellent article sur ce brave Delécluze, auquel vous faites trop d’honneur en le touchant de votre plume délicate ! » Dans une étude sur Léopold Robert du 21 août 1854, Sainte-Beuve écrivait : « Il y a eu des peintres excellents écrivains ; sans remonter plus haut, sir Josué Reynolds et M. Eugène Delacroix, ces brillants coloristes par le pinceau, sont d’ingénieux et d’habiles écrivains avec la plume. »
- ↑ Delacroix, tout comme Balzac, appréciait, à une époque où il était complètement méconnu, pour ne pas dire inconnu, le rare talent de Stendhal. Dans une curieuse note qui fait partie d’une étude du peintre sur le Jugement dernier de Michel-Ange, étude qui parut dans la Revue des Deux Mondes du 1er août 1837, Delacroix vante la magnifique description du Jugement faite par M. de Stendhal : « C’est un morceau de génie, l’un des plus poétiques et des plus frappants que j’aie lus. » (Maurice Tourneux, Eugène Delacroix devant ses contemporains.)
- ↑ Sur les rapports de Delacroix avec Mérimée, nous empruntons au livre de M. Tourneux l’indication suivante : il renvoie à un petit volume publié chez Charavay, Prosper Mérimée, ses portraits, ses dessins, sa bibliothèque (1879). « La seconde partie de ce travail est le développement d’un article paru dans l’Art du 14 novembre 1875, sous le titre de : Prosper Mérimée, ami d’Eugène Delacroix ; ses dessins et ses aquarelles. L’article de l’Art était orné du fac-similé d’une feuille de croquis de Delacroix appartenant à M. Burty, d’un billet de Mérimée à Delacroix. »
- ↑ Le comte de Nieuwerkerke avait succédé à Romieu à la direction des Beaux-Arts. « Il ne se signala pas, dit Burty, par une sympathie marquée pour le génie de Delacroix. Le gothique et tout ce qui lui ressemble, c’est-à-dire l’imitation alambiquée et pédante des maîtres, étaient en faveur. » [Corresp., t. II, p. 100. Note de Burty.)
- ↑ L’Empereur, jusqu’à son mariage, chargea la princesse Mathiluc, sa cousine, de présider les cérémonies officielles. D’ailleurs, les goûts, les aptitudes, les sympathies de la princesse pour les arts et les artistes la désignaient naturellement pour occuper cette place d’honneur.
- ↑ Toujours l’article sur le Poussin que lui avait demandé le Moniteur.
- ↑ Cette conviction du maître se réfère exactement à celle que nous indiquions dans notre Étude et qu’il formulait ainsi lui-même : « La connaissance du devoir ne s’acquiert que très lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment et par l’exercice progressif de la raison que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle. » (Voir t. I, p. ix, x.)
- ↑ A propos de cette difficulté d’écrire, qu’il constate à certains endroits de son Journal, il nous a paru intéressant de citer une page de Baudelaire qui est en même temps une appréciation définitive du talent et des défauts d’Eugène Delacroix comme écrivain : « Si sages, si sensés et si nets de tons et d’intention que nous apparaissent les fragments littéraires du grand peintre, il serait absurde de croire qu’ils furent écrits facilement et avec la certitude d’allure de son pinceau. Autant il était sûr d’écrire ce qu’il pensait sur une toile, autant il était préoccupé de ne pouvoir peindre sa pensée sur le papier. « La plume, disait-il souvent, n’est pas mon outil : je sens que je pense juste, mais le besoin de l’ordre auquel je suis contraint d’obéir, m’effraye. Croiriez-vous que la nécessité d’écrire une page me donne la migraine ? » C’est par cette gêne, résultant du manque d’habitude, que peuvent être expliquées certaines locutions un peu usées, un peu poncif, empire même, qui échappent trop souvent à cette plume naturellement distinguée. » (Baudelaire, L’Art romantique. L’Œuvre et la vie d’Eugène Delacroix.)
- ↑ Extrait d’un album de dessins.
- ↑ Dans son article sur Michel-Ange, Delacroix écrivait : « Il ne faut pas être étonné du mépris des artistes médiocres pour ce sauvage génie… Ils ne peuvent s’empêcher de haïr ce style terrible, qui les subjugue malgré eux ; ils s’en prennent à lui du sentiment profond de leur impuissance et se rejettent alors sur les incorrections et les bizarreries, fruits de son caprice. »
- ↑ Ce sujet avait déjà inspiré à Delacroix un tableau peint en 1831 : Charles-Quint au monastère de Saint-Just, dont il existe plusieurs variantes. (V. Catalogue Robaut, nos 354, 453, 654, 695 et 1565.)
- ↑ Madame Parchappe, femme du général Parchappe (1787-1866), qui fit toutes les campagnes du premier Empire et plus tard servit en Afrique, de 1839 à 1841. Il était alors député au Corps législatif.
- ↑ Édouard Dubufe (1820-1883) exposait au Salon de 1853 les portraits de l’impératrice Eugénie, de la comtesse de Montebello et de la baronne de Hauteserve, qui obtenaient un grand succès mondain ; mais la critique et les artistes se montraient sévères pour cette peinture fade et maniérée.
- ↑ Émile de Girardin avait été compris, après le 2 décembre, dans une liste des représentants expulsés du territoire français et avait obtenu, deux mois après son bannissement, de reparaître en France.
- ↑ Le Vieux Caporal, drame en cinq actes, de Dumanoir et d’Ennery, fut représenté pour la première fois le 9 mai 1853 sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, sous la direction de Marc Fournier. Antoine Simon, le principal rôle, fut une des plus belles créations de Frédérick Lemaître. Son jeu muet, l’éloquence de son geste, lui valurent un véritable triomphe.
- ↑ Dans l’Histoire du romantisme de Gautier, on lit à propos de Frédérick Lemaître : « C’est toujours un noble et beau spectacle que de voir ce grand acteur, le seul qui chez nous rappelle Garrick, Kemble, Macready, et surtout Kean, faire trembler de son vaste souffle shakespearien les frêles portants des coulisses des scènes du boulevard. »
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1745.
- ↑ Louis Peisse, dont le nom a déjà paru dans le premier volume du Journal, écrivait à propos du Salon de 1853, et dans l’article auquel le maître fait allusion : « M. Delacroix est encore, après trente ans de travaux, un talent si contesté, sinon pour les artistes, du moins pour le public, qu’on ne peut se risquer à louer ses œuvres sans quelques précautions ou explications. Il faut évidemment, pour goûter sa peinture, une préparation, une habitude, qui, à ce qu’il paraît, ne s’acquiert pas toujours vite. Elle est comme certains mets de haut goût, qu’on n’arrive à apprécier qu’après bien des efforts, mais dont on est ensuite très friand. » (Constitutionnel, 31 mai 1853.)
- ↑ Delacroix, comme presque tous les esprits supérieurs, estimait plus la simple et franche ignorance des âmes naïves que l’insuffisante et prétentieuse instruction des gens du monde. « Un jour, écrit Baudelaire, un dimanche, j’ai aperçu Delacroix au Louvre, en compagnie de sa vieille servante, celle qui l’a si dévotement soigné et servi pendant trente ans, et lui, l’élégant, le raffiné, l’érudit, ne dédaignait pas de montrer et d’expliquer les mystères de la sculpture assyrienne à cette excellente femme, qui l’écoutait d’ailleurs avec une naïve application. »
- ↑ Puisque le nom d’Alphonse Karr se trouve ici prononcé, nous
pouvons rapporter l’anecdote touchant Delacroix qui est transcrite
dans ses Guêpes : « Voici ce qu’on raconte de M. Eugène Delacroix et
de l’architecte de la Chambre des députés : M. Delacroix est allé le trouver et lui a dit : Je ne peux pas peindre sur votre plafond. (C’était
lors des travaux décoratifs du Palais-Bourbon.) Il ne tient à rien ; cela
ne durera pas trois ans ! — Qu’est-ce que cela vous fait, pourvu qu’on
vous paye ?… M. Delacroix n’a pas cru devoir adopter ces principes
d’art moderne, et a fait recrépir le plafond à ses frais. »
Nous avons interrogé des personnes dignes de toute confiance sur l’exactitude du fait : il est, paraît-il, absolument authentique. - ↑ Ces initiales dissimulent si peu les noms de Pierret et de Riesener, qu’il n’y a, semble-t-il, aucune indiscrétion à les marquer. Nous rappelons à ce propos ce que nous avons dit dans notre Étude sur le sentiment d’amitié chez les hommes supérieurs en général, et chez Delacroix en particulier. (Voir t. I, p. xiii, xiv.)
- ↑ Le Bourreau des crânes, vaudeville en trois actes, de Lafargue et Siraudin.
- ↑ Il existe de nombreuses variantes de ce sujet dans l’œuvre du maître. D’après le Catalogue Robaut, il n’y a, se référant à la date du Journal, qu’une « toile — 0 m. 74 c. × 0 m. 60 c. — exposée au boulevard des Italiens en 1860. Elle appartenait alors à M. Davin. » M. Robaut ajoute, observation que confirme le Journal du maître : « En cette année 1853, Delacroix ne peint guère que des sujets religieux. »
- ↑ Delacroix veut parler du comte de Géloës, d’Amsterdam. (Voir Catalogue Robaut, no 1034.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1219.
- ↑ Émile Signol, peintre, né en 1804, élève de Gros, auteur de la Femme adultère. En 1849, il se présenta à l’Institut en même temps que Delacroix, mais il n’a été élu membre de l’Académie des beaux-arts qu’en 1860. Il est mort récemment.
- ↑ Delacroix s’était déjà présenté quatre fois à l’Institut, et la dernière fois, en 1849, on lui avait préféré Léon Cogniet. Sa lettre de candidature en 1849 est curieuse. Après avoir énuméré les principales compositions qu’il a exécutées : Dante et Virgile, Massacres de Scio, le Christ au jardin des Oliviers, la Justice de Trajan, l’Entrée des croisés à Constantinople, Médée, les décorations du Luxembourg, du Palais-Bourbon, de la salle du Trône, l’Évêque de Liège, Marino Faliero, les Femmes d’Alger, il ajoutait ces quelques lignes, qui se passent aisément de commentaires : « C’est pour la quatrième fois que j’ai l’honneur de me présenter aux suffrages de l’Académie. Cette insistance et le désir très naturel de faire partie d’un corps illustre suffiront-ils pour faire excuser l’infériorité de quelques-unes des productions que j’ai mentionnées ? J’éprouve une juste défiance en approchant d’une réunion qui représente les traditions et les principes éternels qui ont été ceux du grand goût chez tous les artistes célèbres. »
- ↑ C’était un des principaux personnages au centre du plafond de l’Hôtel de ville.
- ↑ Voir tome I, p. xxviii, xxix, xxx.
- ↑ Ce sont les Mémoires d’un bourgeois de Paris. Dans un chapitre intitulé : La Peinture et la Musique sous la Restauration, le docteur Véron, qui avait été le condisciple de Delacroix, a donné une sorte d’autobiographie du grand peintre, d’après les notes dont il est question ici.
- ↑ Le compositeur Adolphe Adam (1803-1856).
- ↑ Delacroix fait allusion au tableau connu sous le nom du Marché aux chevaux, qui fut exposé au Salon de 1853.
- ↑ Portrait de Mme Rodakowski, mère du peintre.
- ↑ Ziem obtint cependant une médaille de première classe avec cette Vue de Venise, qui a pris place au Musée du Luxembourg.
- ↑ Jalabert, peintre, élève de Delaroche. Théophile Gautier écrivait à propos de lui : « Le talent de cet artiste a quelque chose de tendre et de délicat, de féminin qui charme et vous empêche de lui désirer plus de force. Ce n’est pas qu’il ne puisse s’élever à la vigueur lorsqu’il le veut, mais sa vraie nature est la grâce. »
- ↑ Robert-Fleur y avait succédé, en 1850, à Granet comme membre de l’Académie des beaux-arts.
- ↑ Delacroix était lié avec Édouard Thierry, qui avait écrit des Salons successifs assez favorables au peintre.
- ↑ Cette toile fut exécutée en 1854. « Elle était en 1875 chez le peintre Daubigny, qui l’avait payée de cinq à six mille francs. » (V. Catalogue Robaut, no 1238.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1313 et 1404.
- ↑ Lefuel était alors architecte du château de Fontainebleau. Après la mort de Visconti, en 1854, il fut chargé d’achever le nouveau Louvre.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1214 à 1220.
- ↑ Malgré ses relations mondaines avec Halévy, Delacroix conservait toute sa liberté d’appréciation à son égard. Nous avons cité dans notre Étude le fragment de lettre dans lequel Delacroix donne son opinion sur la Juive. Il y félicite le chanteur Nourrit d’avoir « répandu de l’intérêt sur une pièce comme la Juive qui en a grand besoin, au milieu de ce ramassis de friperies qui est si étranger à l’art ».
- ↑ Ce tableau est connu sous le nom d’Éducation de la Vierge. L’idée première lui en vint à Nohant chez George Sand, et sa correspondance relate les circonstances dans lesquelles il le fit. (Voir Catalogue Robaut, no 1193.)
- ↑ Le Christ sur le lac de Génézareth. (Voir Catalogue Robaut, no 1214 à 1220.)
- ↑ Nous trouvons dans un fragment d’album publié dans le livre de M. Piron le passage suivant : « Le titre de dictionnaire est bien ambitieux pour un ouvrage sorti de la tête d’une seule personne et n’embrassant naturellement que ce qu’il est possible à un homme d’embrasser de connaissances ; si l’on ajoute à cela que ses connaissances sont loin d’être complètes et sont même très insuffisantes en ce qui touche un nombre considérable d’objets importants qui ressortent de la matière traitée. » (Eugène Delacroix, sa vie et son œuvre.}
- ↑ Commune de Ris-Orangis, près de Corbeil.
- ↑ Le général de division Parchappe avait fait les campagnes du premier Empire, puis les campagnes d’Afrique de 1839 à 1841. Mis à la retraite en 1851, il s’était fait nommer député au Corps législatif.
- ↑ Il s’agit ici des lamentables restaurations que M. Villot fit subir à certaines toiles du Musée du Louvre.
- ↑ Nous avons tenté dans notre Étude de résumer les idées du maître sur ce point intéressant d’esthétique. Ce passage et tout ce qui suit constituent l’un des morceaux les plus importants sur lesquels nous nous soyons appuyé.
- ↑ Francis Petit, l’expert bien connu, qui figure au testament de Delacroix.
- ↑ On sait que Delacroix laissa par testament à Jenny Le Guillou une somme de cinquante mille francs, en outre de ce qui serait à sa convenance dans son mobilier, et du beau portrait qu’elle-même légua à sa mort au Musée du Louvre.
- ↑ Mémoires d’un bourgeois de Paris.
- ↑ George Sand.
- ↑ Ce jugement dans lequel Delacroix réunit Véron, Dumas et George Sand, rappelle un fragment d’étude de Barbey d’Aurevilly sur George Sand, où il parle de cette littérature dont elle a fait métier et marchandise. Nul passage dans le Journal du maître ne nous semble mieux venir à l’appui de ce que nous avons dit dans notre Étude à propos de ses appréciations sur les contemporains.
- ↑ Pécourt, peintre demeuré obscur.
- ↑ Rubens est certainement celui de tous les peintres qu’il a le plus constamment vanté.
- ↑ Voir l’étude qu’il consacra à ce maître. Elle fut publiée dans le Plutarque français et réunie aux autres fragments critiques dans le volume de M. Piron, déjà cité.
- ↑ François Arago venait de mourir le 2 octobre 1853. En mentionnant les Arago, Delacroix vent parler ici de ses deux tils, Emmanuel et Alfred Arago, et de ses deux frères survivants, Jacques et Étienne Arago.
- ↑ Les Nouvelles russes, de Nicolas Gogol, avaient été en 1845 traduites et publiées par M. L. Viardot.
- ↑ Il est intéressant de remarquer ici comment Delacroix a su, d’un mot caractéristique, définir et analyser cette littérature russe qui faisait alors une timide apparition et qui allait soulever vingt ans plus tard un si grand mouvement de curiosité.
- ↑ Zimmermann (1785-1853), compositeur, élève de Boïeldieu, fut de 1816 à 1848, professeur de piano au Conservatoire.
- ↑ Piranesi, graveur italien (1720-1778), qui a exécuté au burin ou à l’eau-forte un grand nombre de planches qu’on a réunies sous le nom d’Antiquités romaines.
- ↑ Hetzel, libraire et littérateur, qui sous le nom de Stahl a écrit une série de charmants ouvrages pour la jeunesse. Hetzel avait pris une part importante aux événements de 1848 et occupé le poste de secrétaire général du pouvoir exécutif dans le gouvernement provisoire. Exilé après le coup d’État, il s’était retiré à Bruxelles, d’où il ne rentra en France qu’en 1859.
- ↑ Théophile Silvestre, publiciste (1823-1876), a collaboré à beaucoup de journaux, notamment le Figaro, le Nain jaune, le Constitutionnel, le Pays, l’Éclair, etc. Son principal ouvrage, l’Histoire des artistes vivants, est un des volumes les plus intéressants écrits sur l’art. Parmi les autres publications de Théophile Silvestre, on peut encore citer Eugène Delacroix (documents nouveaux), Pierre-Paul Rubens, etc. Son dernier ouvrage est le Catalogue du Musée de Montpellier (collection Bruyas), dont le premier volume seul a paru.
- ↑ Ce vœu du peintre a été réalisé en partie par M. Alfred Robaut, qui, au moment de la vente des dessins originaux d’Eugène Delacroix, publia plus de soixante-dix croquis, dessins et fac-similé autographiés, pris dans l’œuvre du maître. Cette publication, malheureusement incomplète, fut accueillie par les amateurs avec une faveur marquée, et il est regrettable qu’un concours plus effectif n’ait pas permis de terminer l’œuvre si bien commencée.
- ↑ Opéra de Rossini.
- ↑ Robert-Fleury.
- ↑ M. Delessert était un collectionneur qui possédait entre autres toiles du maître le délicieux tableau des Adieux de Roméo et Juliette, celui que Gautier décrit ainsi : « Roméo et Juliette sur le balcon, dans les froides clartés du matin, se tiennent religieusement embrassés par le milieu du corps. Dans cette étreinte violente de l’adieu, Juliette, les mains posées sur les épaules de son amant, rejette la tête en arrière, comme pour respirer, ou par un mouvement d’orgueil et de passion joyeuse… Les vapeurs violacées du crépuscule enveloppent cette scène. » La Mort de Lara lui appartenait également. (Voir Catalogue Robaut, nos 939 et 1006.)
- ↑ Marc-Antoine Raimondi (1475-1530), le plus célèbre graveur de la Renaissance italienne.
- ↑ La poétique figure de la Madeleine tenta à plusieurs reprises le pinceau de Delacroix ; en 1845, il peignit une Madeleine en prière, au sujet de laquelle Baudelaire écrivait : « Ce tableau démontre une vérité soupçonnée depuis longtemps, c’est que M. Delacroix est plus fort que jamais, et dans une voie sans cesse renaissante, c’est-à-dire qu’il est plus harmoniste que jamais… M. Delacroix est décidément le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes. Il restera toujours un peu contesté, juste autant qu’il faut pour ajouter quelques éclairs à son auréole. Et tant mieux ! il a le droit d’être toujours jeune, car il ne nous a pas trompés, lui, il ne nous a pas menti, comme quelques idoles ingrates que nous avons portées dans nos panthéons. » (Voir Catalogue Robaut, nos 920 et 921.)
- ↑ Francesco Vanni (1563-1609). Voir le Catalogue des dessins du Louvre, no 362. — Luca Signorelli (1440)-1525). Voir le Catalogue des dessins du Louvre, nos 340, 343, 347. — Inconnu XVe siècle. Voir le Catalogue des dessins du Louvre, nos 419. — Léonard de Vinci (1452-1519). Voir le Catalogue des dessins du Louvre, nos 383 à 394.
- ↑ Annibal Carrache (1560-1609). Voir le Catalogue des dessins du Louvre, nos 153, 157, 158, 161, 165, 166, etc.
- ↑ Guido Reni, dit le Guide (1575-1642). Voir le Catalogue des dessins du Louvre, nos 291, 294, 297.
- ↑ Pour avoir une idée précise de l’opinion d’Eugène Delacroix sur Bonington, il importe de relire la très belle lettre du peintre à Thoré qui porte la date du 30 novembre 1861. Elle contient une courte biographie de l’artiste qui avait été le camarade d’atelier de Delacroix. Nous en extrayons le passage suivant : « Je ne pouvais me lasser d’admirer sa merveilleuse entente de l’effet et la facilité de son exécution ; non qu’il se contentât promptement. Au contraire, il refaisait fréquemment des morceaux entièrement achevés et qui nous paraissaient merveilleux ; mais son habileté était telle qu’il retrouvait à l’instant sous sa brosse de nouveaux effets aussi charmants que les premiers. Il tirait parti de toutes sortes de détails qu’il avait trouvés chez des maîtres et les rajustait avec adresse dans sa composition. » (Corresp., t. II, p. 278, 279.)
- ↑ Le salon de cette petite dame Aubernon allait devenir rapidement le rendez-vous de tout le monde artistique et littéraire ; il est encore aujourd’hui fort recherché des hommes de lettres et des artistes.
- ↑ Voir suprà, t. II, p. 28.
- ↑ Ces détails sont probablement des détails biographiques pour les Mémoires de Dumas, qui contiennent sur Eugène Delacroix ce fragment auquel il convient de rendre justice pour son indépendance d’allure : « Delacroix, avec son Massacre de Scio, autour duquel se groupaient pour discuter, les peintres de tous les partis, Delacroix qui en peinture, comme Hugo en littérature, ne devait avoir que des fanatiques aveugles ou des détracteurs obstinés, Delacroix qui était déjà connu par son Dante traversant le Styx et qui devait toute la vie conserver ce privilège rare pour un artiste, de réveiller à chaque œuvre nouvelle les haines et les admirations : Delacroix, homme d’esprit, de science et d’imagination qui n’a qu’un travers, c’est de vouloir obstinément être le collègue de M. Picot et de M. Abel de Pujol, et qui par bonheur, nous l’espérons du moins, ne le sera pas. »
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1035-1037.
- ↑ Opéra de Donizetti.
- ↑ Le roman de Mauprat avait été l’un des plus grands succès de George Sand, un de ceux qui avaient le plus contribué à rendre son nom populaire. Transporté à la scène, dans un drame en six actes, il fut joué à l’Odéon ; mais la pièce n’eut pas le succès du livre.
- ↑ Ricourt, fondateur du journal l’Artiste, qu’il dirigea longtemps. Il avait su réunir autour de lui les plus éminents des écrivains de l’époque. Ce journal avait alors un caractère romantique très accusé. Ricourt mourut en 1865. Delacroix était très lié avec lui et lui adressa la lettre sur les Concours que nous avons citée plus haut, et qui compte parmi les plus originales et les plus intéressantes de la correspondance.
- ↑ Probablement une des compositions du début de l’Artiste. Nous n’en avons pas trouvé trace dans le Catalogue Robaut.
- ↑ Allusion au gilet vert qui servit pour son portrait du Louvre.
- ↑ Ce passage est à rapprocher du fragment de l’année 1824 : « Quelle sera ma destinée ? Sans fortune et sans disposition propre à rien acquérir. »
- ↑ Le prince Adam Czartoryski.
- ↑ « Le seul homme dont le nom eût puissance pour arracher quelques gros mots à cette bouche aristocratique, était P. Delaroche. » {Baudelaire, sur Delacroix.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1274.
- ↑ Il s’agit probablement de la toile qui porte le no 853 du Catalogue Robaut, et que le maître donna ultérieurement à M. de Jolly.
- ↑ Eugène Bethmont, avocat et homme politique né en 1804, mort en 1860. Il fut un des membres les plus brillants des assemblées politiques.
- ↑ Delacroix avait horreur de ce genre d’esprit qu’on rencontre surtout chez ceux qui par métier touchent à toutes choses sans pouvoir insister sur aucune. L’avocat, avec sa facilité d’élocution, son éloquence toujours prête, lui apparaissait comme un être superficiel et inconsistant. Ainsi, même à propos de Berryer, pour lequel il éprouvait, on le sait, une vive affection, il écrivait : « Heureux qui se contente de la surface des choses. J’admire et j’aime les hommes comme Berryer qui a l’air de ne rien approfondir. » Il faudrait être aveugle pour ne pas démêler la pointe de critique qui se dissimule mal sous cette admiration.
- ↑ Daniel Wilson, père de M. Daniel Wilson et de Mme Pelouze. Il acheta autrefois à Delacroix son tableau : La Mort de Sardanaple. (Voir Catalogue Robaut, no 198.)
- ↑ Augustine Brohan avait débuté en 1841, à seize ans, à la Comédie-Française, avec un immense succès. Elle devint sociétaire l’année suivante. Son talent, sa grâce et son esprit lui assurèrent une situation exceptionnellement brillante.
- ↑ Voici une anecdote intéressante rapportée par Baudelaire, et qui mérite d’être rapprochée de ce passage : « Je me souviens qu’une fois dans un lieu public, comme je lui montrais le visage d’une femme d’une originale beauté et d’un caractère mélancolique, il voulut bien en goûter la beauté, mais me dit, avec son petit rire, pour répondre au reste : « Comment voulez-vous qu’une femme puisse être mélancolique ? » insinuant sans doute par là que pour connaître le sentiment de la mélancolie, il manque à la femme certaine chose essentielle. »
- ↑ Arsène Houssaye était alors administrateur de la Comédie-Française.
- ↑ Plafond de la galerie d’Apollon.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1238.
- ↑ Ce sujet d’Ovide, qu’il avait déjà traité pour la décoration de la
Bibliothèque du Palais-Bourbon, devait lui inspirer un de ses chefs-d’œuvres
de l’Exposition de 1859. Voici en quels termes il en parle :
M. Moreau avait demandé à Delacroix un tableau pour M. Fould. Delacroix
lui écrit le 11 mars 1856 : « Je m’étais occupé tout de suite de
chercher des sujets pour répondre au désir que vous m’avez si aimablement
exprimé de la part de M. Fould. Après avoir hésité quelque
temps, je me suis rappelé une esquisse que j’ai traitée, il y a un
an environ , dans le projet d’en faire un tableau. Je crois le sujet
assez favorable, avec figures, animaux, paysages. C’est Ovide exilé
chez les Scythes, auquel les naïfs habitants apportent des fruits, du
laitage. »
Ce tableau appartient aujourd’hui à Mme Sourdeval. (Voir rrCatalogue Robaut, no 1376.) - ↑ Il s’agit du tableau d’Olinde et Sophronie, qui a figuré récemment l’Exposition des Cent chefs-d’œuvre, chez Petit. La description fournie par Delacroix est la suivante : « Olinde et Sophronie. Clorinde, arrivant au secours de Sarrasins assiégés dans Jérusalem, délivre de la mort deux jeunes amants condamnés au bûcher par le tyran Aladin. » (Jérusalem délivrée.) (Voir Catalogue Robaut, no 1290.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1384.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1249.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1214 et 1220.
- ↑ Ce passage, qui nous avait échappé au moment d’écrire notre Étude, vient encore à l’appui de ce que nous avons dit sur le sentiment d’amitié chez Delacroix, et contribue à détruire la légende qu’on s’était plu à former.
- ↑ Le docteur Velpeau était un des plus célèbres chirurgiens de l’époque.
- ↑ M. Nisard, pour qui la critique ne pouvait avoir de mystères, déclarait dans un Salon daté de 1833, au National, où il remplaçait le critique Peisse, que « M. Delacvoix n’avait pas un ouvrage sérieux ».
- ↑ Visconti, architecte, dont l’œuvre principale fut la réunion du Louvre aux Tuileries. Il paraît que Delacroix l’estimait davantage que ses confrères Lefuel et Baltard. (Voir suprà, t. II, p. 229.)
- ↑ L’Exposition de 1855.
- ↑ Chaix d’Est-Ange, célèbre avocat et homme politique. Son goût pour les arts et ses fréquentes relations avec les artistes sont connus.
- ↑ Le comte Charles de Rémusat (1797-1875), écrivain et homme politique. De 1830 à 1852 il fit partie de toutes les assemblées délibérantes, et devint ministre de l’intérieur en 1840. Sous l’Empire, il resta complètement étranger aux affaires publiques et reprit ses travaux philosophiques, faisant paraître des ouvrages et publiant des études dans la Revue des Deux Mondes. En 1846, il avait succédé à Royer-Collard comme membre de l’Académie française.
- ↑ Jacques Babinet (1794-1872), mathématicien, membre de l’Académie des sciences depuis 1840, auteur d’un grand nombre de travaux qui embrassent diverses parties de l’astronomie, de la physique et de la météorologie. Il a publié de nombreux articles scientifiques à la Revue des Deux Mondes et au Journal des Débats.
- ↑ Il éprouva cette même émotion à l’église Saint-Sulpice, en peignant le dimanche, au son des orgues. Mais, comme on le verra plus loin, les autorités ecclésiastiques et administratives lui refusèrent l’autorisation de travailler le dimanche pendant les offices.
- ↑ Visconti mourut sans avoir achevé l’œuvre capitale de sa carrière d’architecte, la réunion du Louvre aux Tuileries. Mais son nom n’en reste pas moins attaché à ce magnifique travail. Il avait été, au mois d’août précédent, nommé membre de l’Institut.
- ↑ Voir notre Étude, p. xvi et xvii.
- ↑ Toile qui fut adjugée cent sept francs à Andrieu, qui la céda à la duchesse Colonna. « Nous pensions, dit le Catalogue Robant, que cette esquisse était entrée dans le legs fait au musée cantonal de Fribourg par Mme la duchesse Colonna… Le conservateur de ce musée, que nous avons consulté à ce sujet, nous a détrompés. »
- ↑ Dans l’intervalle du 29 janvier au 6 mars, Delacroix avait fait exécuter par le peintre Andrieu des retouches aux peintures du salon de la Paix à l’Hôtel de ville, ainsi qu’il résulte de cette lettre : « Ayez la bonté de refaire un ciel plus clair, à la Muse par exemple, pas trop uni, mais éclairci de manière à faire bien à la lumière. Faites-en autant à la Minerve et, si vous voulez, à la Vénus. Je ne ferai que perdre ma journée en allant seulement pour cela, que vous pouvez faire parfaitement, et je ne serai pas en train de faire quoi que ce soit avant d’avoir revu aux lumières. » (Corresp., t. II, p. 98.)
- ↑ Épisode de l’histoire du Hanovre.
- ↑ Blaze de Bury, qui était le beau-frère de Buloz, fit pendant de longues années paraître de nombreux articles de critique littéraire et musicale à la Revue des Deux Mondes.
- ↑ Larivière, peintre, élève de Guérin, de Girodet et de Gros, avait été un des derniers concurrents de Delacroix à l’Institut.
- ↑ Panseron (1795-1859), compositeur, auteur d’un grand nombre de morceaux de musique religieuse.
- ↑ Pelletier occupait un poste important au ministère d’État. C’était un protégé de M. Fould.
- ↑ Dedreux-Dorcy, peintre, qui fit un portrait de Delacroix en 1831.
- ↑ Antony Deschamps de Saint-Amand, poète et littérateur (1808-1869). Outre un grand nombre d’œuvres poétiques, A. Deschamps a publié des articles dans la Revue de Paris et le Journal des Débats.
- ↑ Félix Bodin, publiciste et historien (1795-1837). C’est sous ses auspices que M. Thiers, alors inconnu, commença son Histoire de la Révolution française. Félix Bodin devint membre de la Chambre des députés après la révolution de 1830.
- ↑ Gustave Nadaud (1820-1893), compositeur et chansonnier, qui avait déjà, en 1849 et 1852, publié deux recueils de ses chansons.
- ↑ Hippolyte Rodrigues, financier et littérateur, occupait depuis 1840 une charge d’agent de change qu’il abandonna en 1875 pour se consacrer exclusivement aux études de critique et d’histoire religieuse. Il était le beau-père d’Halévy.
- ↑ Mirés, célèbre financier de l’époque, était alors à la tête d’une série de vastes opérations financières et jouissait dans le monde d’une influence considérable.
- ↑ Le Cavalier gaulois.
- ↑ Laity, ancien lieutenant d’artillerie, qui avait pris parti avec sa troupe pour le prince Louis-Napoléon lors de l’échauffourée de Strasbourg, où il se trouvait alors en garnison. Traduit devant la cour d’assises et acquitté, il donna sa démission. À l’avènement de Louis-Napoléon à la présidence de la République, il reprit du service dans l’armée, mais il donna de nouveau sa démission après le coup d’État. En 1854, il fut nomme préfet, et devint sénateur en 1857.
- ↑ Adolphe Hermant, dit Hermann, né à Douai en 1822, élève du Conservatoire de Paris, violoniste distingué.
- ↑ Hercule étouffant Antée. (Voir Catalogue Robaut, no 1139.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1230, 1242, 1278, 1349, 1350.
- ↑ Isidore Dagnan, paysagiste, qui exposa de 1819 à 1868.
- ↑ Lefèvre-Deumier (1797-1857), littérateur et poète, auteur de
tragédies romantiques écrites sous l’influence de Byron. En 1830, il prit
part à l’insurrection de Pologne, puis, de retour en France, se maria et
recueillit par héritage une immense fortune. Il devint, en 1852, bibliothécaire
des Tuileries.
Sa femme, née Roulleaux-Dugage, s’est adonnée à la sculpture ; elle exposait cette même année 1853 un buste de Mgr Sibour qui lui valut une médaille. - ↑ Adolphe Yvon, peintre, élève de Delaroche, qui n’avait jusqu’alors exposé que des portraits et des scènes bibliques ou de genre. Il n’aborda le genre historique et militaire qu’au Salon de 1853, en peignant l’épisode du Premier consul descendant le mont Saint-Bernard, pour le château de Compiègne.
- ↑ Voir notre Étude sur les rapports d’Ingres avec Delacroix. À propos
du plafond d’Ingres qui avait contribué à la décoration de l’Hôtel de
ville, voici ce que Delacroix écrivait à un critique d’art : « Je ne sais si
mon illustre confrère en plafond sera aussi satisfait de votre appréciation
que je le suis pour ma part. Je suis entièrement de votre avis, à
savoir que les camées ne sont pas faits pour être mis en peinture, et
qu’il faut que chaque chose soit à sa place. » M. Burty ajoute en
note : « L’illustre confrère en plafond, c’était Ingres, et les camées,
c’était l’apothéose de Napoléon. » (Corresp., t. II, p. 110-111.)
Burty aurait pu ajouter que si Delacroix prononce le mot camée, c’est que Ingres, pour l’Apothéose d’Homère, n’avait fait qu’agrandir une composition connue comme camée. - ↑ Rappelons qu’il qualifiait de divine la symphonie en la.
- ↑ Opéra de Weber.
- ↑ Tragédie lyrique de Spontini, qui avait été représentée pour la première fois à l’Académie impériale de musique le 11 décembre 1807 ; elle fut reprise à l’Opéra le 16 mars 1854, avec Roger, Obin, Bonnehée, Mlles Poinsot et Sophie Cruvelli. Cette reprise n’obtint pas le succès qu’on avait espéré.
- ↑ Ulysse, tragédie en trois actes et en vers, mêlée de chœurs, par Ponsard, qui fut représentée pour la première fois au Théâtre-Français le 18 juin 1852.
- ↑ C’est, croyons-nous, le seul passage du Journal où l’on trouve une restriction sur le génie de Chopin. En 1842, il écrivait à Pierret : « J’ai des tête-à-tête à perte de vue avec Chopin, que j’aime beaucoup et qui est un homme de distinction rare : c’est le plus vrai artiste que j’aie rencontré. Il est de ceux en petit nombre qu’on peut admirer et estimer. » {Corresp., t. I, p. 262-263.)
- ↑ Delacroix oubliait Fidelio.
- ↑ Théophile Silvestre fut certainement avec Thoré et Baudelaire le
critique qui écrivit les articles les plus judicieux et les plus impartiaux
sur l’œuvre d’Eugène Delacroix. Il s’agissait ici de la notice d’après
nature publiée par Silvestre, qui fut réimprimée ensuite dans l’Histoire
des artistes vivants français et étrangers.
Après avoir lu cet article, Delacroix écrivait au critique : « J’ai grandement à vous remercier d’une appréciation si favorable : c’est de l’apothéose de mon vivant. Malgré mon respect pour la postérité, je ne puis m’empêcher d’être fort reconnaissant d’un aussi aimable contemporain que vous. Veuillez à votre tour ne point considérer comme une flatterie banale les compliments que je vous adresse ici sur la valeur que vous y montrez : c’est un art de dire ce que vous voulez et d’exprimer les nuances, qui est fort rare dans ce temps-ci, quoique ce soit là une de ses grandes prétentions. " (Corresp., t. II, p. 111-112.) - ↑ Toile qui appartient à M. Rischoffsheim. Vendue une première fois 570 francs en 1864, elle atteignait 7,800 francs en 1868. « C’est, dit M. Robaut, un ravissant tableau de chevalet que ne dépare aucune négligence ; il est d’une touche preste, vive, habile : les figures sont traitées avec une grande délicatesse, et le paysage est d’une exécution très soignée. » (Voir Catalogue Robaut, no 1246.)
- ↑ Ce tableau n’a été terminé qu’en 1859. (Voir Catalogue Robaut, no 1019.)
- ↑ Il s’agit ici de M. Moreau, père de M. Adolphe Moreau-Nélaton,
le collectionneur qui fit aussi de la critique d’art et dressa le premier
inventaire des tableaux du maître en 1873.
La lettre écrite par Delacroix à Moreau est celle que nous avons citée plus haut, dans laquelle il parle de son « illustre confrère en plafond » Ingres. - ↑ Ce tableau fut exposé au Salon de 1859. (Voir Catalogue Robaut, no 589.)
- ↑ Delacroix allait souvent au Jardin des Plantes faire des études d’animaux. Dans une note de sa correspondance, M. Burty dit à propos du sculpteur Barye : « Ils avaient fait en compagnie, m’a dit M. Delacroix, des études au crayon ou à l’encre, de lions, de lionnes, de tigres, dans une superbe ménagerie qui s’était établie à la foire de Saint-Cloud, et aussi des études d’écorché, d’après une lionne morte au Jardin des Plantes. » (Corresp., t. I, p. 131.)
- ↑ Gustave Planche fut un des critiques qui suivirent depuis l’origine l’effort créateur de Delacroix : il l’accompagna de sa sympathie et parla de son œuvre dans de nombreux Salons. C’est ainsi que dans un Salon de 1837 « qui est un véritable acte d’accusation contre le jury, il énumère les tableaux refusés de Delacroix et déclare qu’il en parlera comme s’ils avaient été exposés ». (Maurice Tourneux.)
- ↑ Ce tableau figure dans le Catalogue Robaut sous le no 1240, et avec le titre : Femmes turques au bain. À la vente John Saulnier, en 1886, il a été vendu 15,500 francs.
- ↑ Variante du no 1046 du Catalogue Robaut.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1290.
- ↑ Ces questions d’exécution de l’œuvre le préoccupent toujours davantage à mesure qu’il avance dans la vie. Les dernières années du Journal sont pleines de réflexions du même ordre.
- ↑ Sur l’insuffisance des spécialistes, ou plutôt sur l’opinion du maître touchant ce point, voir notre Étude, page xxvii.
- ↑ L’un d’eux est sans doute le tableau de Lions qui figure au Musée de Bordeaux, et dont toute la partie supérieure a été détruite dans un incendie du Musée. (Voir Catalogue Robaut, nos 1242 et 1278.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 727, 728.
- ↑ Madame Riesener
- ↑ Delacroix, dans sa jeunesse, allait souvent à Frépillon, chez son oncle Riesener.
- ↑ Madame Charles His. (Voir suprà, t. I, p. 271.)
- ↑ Le Christ au jardin des Oliviers. (Voir Catalogue Robaut, no 176.)
- ↑ Le tempérament poétique de Lamartine plaisait médiocrement à Delacroix, lequel d’ailleurs avait peine à oublier une ridicule méprise qui fit que le poète lui attribua innocemment un jour de misérables peintures d’un nommé Vinchon, et l’accabla d’éloges à leur propos.
- ↑ « Ce tableau peint en 1854, acheté 10,000 francs par l’État, et donné par lui à la ville de Bordeaux, a été à peu près complètement détruit en 1870, dans l’un des incendies successifs de la mairie de Bordeaux, où se trouvait installé le Musée. » (Catalogue Robaut, no 1242.) Il en reste une esquisse qui fut achetée par M. Riesener et qui appartient aujourd’hui à M. Chéramy. Mme Riesener possède également une toile analogue sur le même sujet.
- ↑ Isidore Dagnan (1794-1873), paysagiste de mérite.
- ↑ Nina, ou La folle par amour, opéra représenté au Théâtre-Italien, le 6 mai 1854. Mme Alboni chantait le rôle de Nina.
- ↑ Ce fut l’origine du célèbre mélodrame : le Courrier de Lyon.
- ↑ C’est la salle de l’Hôtel de ville que décora Ingres, et au sujet de laquelle nous avons déjà vu un jugement sévère de Delacroix.
- ↑ Le Massacre de Scio.
- ↑ C’est la première indication de la célèbre et admirable composition que les amateurs ont vue pour la dernière fois à l’exposition des œuvres de Delacroix à l’École des Beaux-Arts. A la vente Faure, elle atteignit 79,500 francs. Elle appartient maintenant au duc d’Aumale. (Voir Catalogue Robaut, no 1272.)
- ↑ Alexandre Batta, célèbre violoncelliste, qui pendant vingt ans a donné un grand nombre de concerts, suivis avec beaucoup d’intérêt par les amateurs.
- ↑ Amédée Hennequin était le fils d’un avocat célèbre, ami de Berryer. À ce titre, il faisait partie du groupe des intimes d’Augerville Dans ses Souvenirs, Mme Jaubert le mentionne assez brièvement.
- ↑ Mgr Dupanloup.
- ↑ « Delacroix, aimable, séduisant, d’une politesse exquise, sans aucune exigence, jouissait pleinement à Augerville d’une sorte de vacance qu’il s’accordait. Il se prêtait à toutes les distractions : très empressé aux promenades, à cette seule condition qu’il lui fût accordé le temps de se costumer. Irait-on en bateau, à pied, ou en voiture ? Aussitôt la décision prise, il s’éclipsait, puis reparaissait, ayant combiné ses vêtements pour affronter soit la mer de glace, le soleil du désert ou le vent de la montagne. Cette manœuvre nous divertissait, ayant découvert, par une de ces trahisons du séjour à la campagne, que sur son lit demeuraient étalés des gilets, des cache-nez, des coiffures, numérotés et correspondant aux degrés du thermomètre. Nous ignorions alors de quelle déplorable délicatesse de larynx il était affligé. »
(Souvenirs de Mme Jaubert, p. 36.)
- ↑ Berryer était très pieux et aimait la pompe des cérémonies catholiques. Ce trait de sa nature répond bien d’ailleurs au jugement que Delacroix porte sur son esprit.
- ↑ Il est probable que ce Saint Pierre ne fut jamais exécuté.
- ↑ La princesse Marcellini Czartoryska.
- ↑ Les procès du Maréchal Ney.
- ↑ Mme Jaubert décrit ainsi le salon de Berryer à Augerville : « Accoudé sur une table basse, notre grand peintre caressait de sa main pâle et nerveuse une abondante et sombre chevelure, à reflets bleuâtres comme de l’acier bronzé. Son regard, à la fois voilé et lointain, semblait atteindre la pensée du compositeur, tandis que le puissant orateur, l’œil humide, sa large poitrine oppressée, troublé par l’étrange harmonie des accords plaintifs, demeurait immobile. »
- ↑ Joseph Michaud, dit Michaud aîné, littérateur, auteur de l’Histoire des Croisades, directeur de la Quotidienne et grand ami de Berryer.
- ↑ Vicomte d’Arlincourt, poète et romancier médiocre, né en 1789, mort en 1856.
- ↑ L’auteur de la fameuse complainte de Fualdès fut en effet un dentiste, homme de beaucoup d’esprit, nommé Catalan. La collaboration de Berryer et de Désaugiers était inconnue, mais on a attribué à M. Dupin la paternité de certains couplets.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1772.
- ↑ Étienne Pariset (1770-1847), médecin et littérateur, connu surtout par ses recherches sur les maladies épidémiques.
- ↑ Il y a de nombreuses études de Christ en l’année 1853. Nous n’en avons point trouvé à cette date de l’année 1854.
- ↑ Théophile Silvestre dit à propos de ces études de félins : « Après avoir beaucoup étudié d’après nature au Jardin des Plantes, Delacroix s’était mis à faire, de mémoire, plus d’animaux au coin de son feu que devant les fosses et les cages des bètes. Il tirait des lions et des tigres de son chat. » (Voir Catalogue Robaut, no 1853.)
- ↑ On trouve en effet dans la correspondance de Delacroix plusieurs lettres de recommandation en faveur de Préault. Il recommande Préault en 1860 pour un travail à l'église Saint-Paul Saint-Louis. Delacroix ne pouvait oublier que Préault avait pendant plusieurs années été refusé, comme lui aux expositions : l’injustice et l’aveuglement des jurys les avaient rapprochés.
- ↑ Henri-Amédée le Lorgne, comte d’Ideville (1830-1887). Il débuta dans la diplomatie, puis entra, en 1870, dans l’administration, qu’il quitta bientôt, pour s’adonner exclusivement à la littérature.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1241.
- ↑ Nous recommandons tout particulièrement aux lecteurs qui voudront être pleinement édifiés sur ce qu’avance Delacroix, de parcourir le Catalogue Robaut, qui donne, chaque fois que le renseignement a pu être obtenu, le prix d’achat des tableaux, et les différents chiffres qu’ils ont atteints dans les ventes successives. Lors de la disparition de Millet, on a été pris d’une belle crise d’indignation contre les marchands de tableaux, en songeant aux bénéfices qu’ils avaient réalisés avec les œuvres de ce maître. On pourrait faire, et tout aussi justement, les mêmes observations au sujet d’Eugène Delacroix. Plusieurs passages du Journal sont d’ailleurs pleinement significatifs. N’est-ce pas l’histoire de presque tous les grands peintres ?
- ↑ Berlioz partageait à l’égard de Spontini, pour sa Vestale, l’admiration de R. Wagner, qui écrivait : « Spontini, lui, il est mort, et avec lui une noble et grande période artistique, digne d’un profond respect, est tout entière et visiblement descendue au tombeau : elle et lui n’appartiennent plus à la vie, mais… uniquement à l’histoire de l’Art. Inclinons-nous profondément et respectueusement devant le cercueil du créateur de la Vestale, de Fernand Cortez et d’Olympie. »
- ↑ Lord Cowley, diplomate anglais, né en 1804. En 1852, il était ambassadeur d’Angleterre à Paris. Il contribua à établir sur des bases durables l’alliance de l’Angleterre avec la France.
- ↑ Le succès de l’Exposition universelle de 1889 aurait sans doute modifié la manière de voir de Delacroix sur ce point.
- ↑ Horace Raisson avait connu Delacroix en 1816 et était resté lié avec lui depuis cette époque. Homme de lettres et journaliste, Raisson avait été collaborateur de Balzac. Delacroix parait avoir eu au début de leurs relations peu de sympathie pour lui, car il écrit en 1821 : « Raisson n’est point changé : il est menteur et suffisant comme devant. Ce sera toujours, dans la peau d’un badaud, le plus Gascon que je connaisse. » Il fit de lui en 1820 un portrait à l’aquarelle qui appartient à M. Robaut. (Voir Catalogue Robaut, no 1469.)
- ↑ Dans la préface mise en tête du recueil des articles d’Eugène Delacroix, M. Piron écrit ceci : « Il aimait tant ses amis qu’il n’aimait pas les voir se marier. Il ne pouvait pas souffrir qu’une femme vint se placer entre lui et eux. Car, nous disait-il, quand je vais dîner chez toi, il faut encore que la chose plaise à ta femme… »
- ↑ Il s’agit de la décoration de la chapelle des Saints-Anges, à propos de laquelle le maître écrivait à Andrieu le 24 avril 1854 : « Il y aurait imprudence à travailler sur un mur qui vient d’être imprimé. L’opération qu’on a faite est excellente, car l’ancienne impression était si épaisse qu’il n’y avait aucune adhérence avec le mur ; on a tout gratté et on en a mis une très légère, après avoir mis de nouveau de l’huile bouillante. Je ne crois pas qu’il soit possible de reprendre avant six semaines au moins. » (Corresp., t. II, p. 101.)
- ↑ Voir le Catalogue Robaut, nos 1001 et 1002.
- ↑ Ottin, sculpteur, né en 1811, élève de David d’Angers, obtint le prix de sculpture dans le concours de 1836. Il est l’auteur d’un grand nombre d’œuvres appréciées.
- ↑ Simart, sculpteur (1806-1857), élève de Dupaty et de Pradier. Grand prix de Rome, il partit pour l’Italie. Ingres, alors directeur de l’école, lui fît le plus sympathique accueil et lui prodigua ses conseils. C’est sans doute à Rome, à la villa Médicis, que se passa la scène que raconte ici Ottin.
- ↑ L’amiral Casy (1787-1862). Engagé comme mousse, il gagna successivement tous ses grades dans la marine, devint en 1848 représentant à la Constituante, occupa un moment le ministère de la marine, puis, en 1853, fut nommé sénateur.
- ↑ Charles-Louis d’Audiffret, économiste et homme politique, né à Paris en 1787. Il rendit de grands services dans l’administration des finances, fut président de la Cour des comptes, pair de France, puis sénateur en 1852.
- ↑ Alcide-Hyacinthe du Bois de Beauchesne (1804-1873), littérateur, auteur d’ouvrages historiques estimés. Il fut, sous la Restauration, chef de cabinet au département des Beaux-Arts, et, sous le second Empire, chef de section aux Archives.
- ↑ Il nous parait assez curieux de rapprocher ce passage qui contient l’opinion sincère de Delacroix, d’une lettre qu’il écrivait à ce même artiste le 24 avril 1855 : « Je crois vous faire quelque plaisir en vous parlant de celui que m’ont fait vos tableaux à l’Exposition. Votre grande inondation est un chef-d’œuvre : elle pulvérise la recherche des petits effets à la mode… » C’est dans des circonstances comme celle-ci que le Journal est intéressant. Il ne peut pourtant y avoir confusion de personnes : il s’agit bien de Paul Huet, le paysagiste romantique, celui au sujet duquel Th. Gautier écrivait : « Nul n’a saisi comme lui la physionomie générale d’un site et n’en a fait ressortir avec autant d’intelligence l’expression, heureuse ou mélancolique. »
- ↑ Ferdinand Denis, voyageur et littérateur, qui parcourut l’Amérique méridionale pendant plusieurs années et publia un grand nombre d’ouvrages sur les sujets les plus variés. Il devint plus tard conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
- ↑ En 1860, il devait peindre un tableau sur ce sujet. Le Catalogue Robaut le décrit ainsi : « Trois Arabes couchés à terre sur des couvertures sont réveillés en sursaut par deux chevaux, un blanc et un brun, qui se sont détachés et se mordent avec acharnement. Les deux bêtes affolées s’enlacent dans un choc furieux et forment un groupe d’une ampleur superbe. »
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 664, aux Additions, p. 490.
- ↑ Léon Gozlan, romancier, auteur dramatique et publiciste.
- ↑ Émile Augier avait déjà conquis à cette époque une grande situation dans le monde des lettres. Cependant le succès de la Ciguë, de Gabrielle, de l’Aventurière, de Philiberte, n’avait point encore mis Augier au rang qu’il devait occuper plus tard avec le Gendre de M. Poirier, le Mariage d’Olympe, les Effrontés, le Fils de Giboyer, etc.
- ↑ Il existe sur ce sujet : 1° une toile qui appartient à M. Dubuisson ; 2° un dessin a la mine de plomb qui est au Musée du Louvre ; 3° un croquis à la plume qui est à M. Robaut.
- ↑ Arnoux, critique d’art qui allait écrire dans la Patrie, après l’Exposition universelle de 1855, cette page enthousiaste : « Le voilà qui triomphe enfin, l’éternel lutteur, le grand discuté ! Il a fallu que le jury des nations vînt nous dire que, lui aussi, il était de la famille des Artistes-Rois. Regardez ses œuvres qui étincellent. » (La Patrie, 16 novembre 1855.)
- ↑ Delamarre, journaliste et député (1796-1870). Il était devenu en 1844 propriétaire de la Patrie. Le journal prit sous sa direction un grand essor et devint le centre d’une série d’opérations économiques et financières auxquelles doit se rattacher probablement le projet d’exposition dont parle ici Delacroix.
- ↑ Massacre de Scio.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1237, aux Additions, p. 497.
- ↑ Baudelaire écrit à ce sujet : « Une des grandes préoccupations de notre peintre dans ses dernières années était le jugement de la postérité et la solidité incertaine de ses œuvres. Tantôt son imagination si sensible s’enflammait à l’idée d’une gloire immortelle, tantôt il parlait amèrement de la fragilité des toiles et des couleurs… Cette friabilité de l’œuvre peinte, comparée avec la solidité de l’œuvre imprimée, était un de ses thèmes habituels de conversation. » (Art romantique. L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix.)
- ↑ Barbereau, compositeur (1799-1879). Grand prix de Rome, il devint chef d’orchestre du Théâtre-Italien, et dirigea en 1854 et 1855 l’orchestre de la société de Sainte-Cécile.
- ↑ A la chapelle des Saints-Anges, à Saint-Sulpice.
- ↑ Ce tableau est une variante de la célèbre toile de 1835, Combat du Giaour et du Pacha. (Voir Catalogue Robaut, no 1293.) A la vente Secrétan, à Londres, en 1889, il a été adjugé 33,000 francs.
- ↑ Delacroix se proposait d’envoyer à l’Exposition de 1855 le Justinien qu’il avait peint en 1826. Ce tableau, qui décora un des grands panneaux de la salle des séances de l’ancien conseil d’État, fut brûlé dans l’incendie de ce palais en 1871. (Voir Catalogue Robaut, no 153.)
- ↑ L’article sur le Beau parut dans la Revue des Deux Mondes du 15 juillet 1854.
- ↑ Auguste-Barthélemy Glaize, né en 1812, peintre, élève des frères Devéria.
- ↑ Le docteur Ulysse Trélat (1795-1879), médecin des plus distingués, qui prit une part active aux événements de 1830, puis de 1848 ; il devint, sous la République, ministre des travaux publics. Sous l’Empire il renonça à la vie politique et reprit ses fonctions de médecin à la Salpêtrière.
- ↑ Delacroix écrivait en 1824 : « Quelles grâces ne dois-je pas au ciel de ne faire aucun de ces métiers de charlatan qui en imposent au genre humain ! Au moins je puis en rire ! »
- ↑ Nous nous sommes expliqué dans le premier volume sur les rapports de Corot avec Delacroix.
- ↑ Plafond d’Apollon.
- ↑ Sur les compositions de Roméo et Juliette, le Catalogue Robaut nous donne les indications suivantes : « A l’Exposition universelle de 1855, Delacroix avait exposé les deux seuls tableaux que lui ait inspirés le Drame d’amour de Shakespeare : les Adieux du Salon de 1846 et la Scène des tombeaux des Capulets. » (Voir aussi Catalogue Robaut, nos 939 et 940.)
- ↑ Paul Landon (1760-1826), peintre et littérateur, doit surtout sa réputation aux nombreux ouvrages qu’il a publiés sur les Beaux-Arts et qui sont encore aujourd’hui consultés avec fruit.
- ↑ Delacroix rencontra, paraît-il, la plus grande difficulté à obtenir la permission de travailler le dimanche dans la chapelle des Saints-Anges. Ce ne fut qu’après de nombreuses démarches qu’il y fut autorisé.
- ↑ M. Louis Ratisbonne, qui fut le secrétaire et l’ami d’Alfred de Vigny, était attaché à la rédaction du Journal des Débats. En 1852. il avait entrepris de traduire en vers la Divine Comédie de Dante. La première partie, l’Enfer, obtint en 1854 un prix Montyon à l’Académie française.
- ↑ Delacroix fait ici allusion à une ancienne peinture de lui, datant de 1826 : le Portrait du comte Palatiano.
- ↑ Saint-Marc Girardin (1801-1873) était alors membre du conseil de l’instruction publique, professeur à la Sorbonne, et membre de l’Académie française depuis 1844.
- ↑ Cet article de Th. Gautier est probablement celui qui se trouve dans le volume de l’Art moderne et qui contient cette appréciation sur Cornélius : « Pierre de Cornélius peut être considéré comme le chef de l’école allemande, ou, pour parler d’une manière plus exacte, du cycle des peintres attirés et fixés à Munich par la munificence éclairée du roi Louis. Quelques-uns ne sont pas ses élèves, mais tous ont plus ou moins subi son influence et marché dans la voie qu’il avait ouverte. Il a exercé sur cette génération d’artistes une autorité pareille à celle de M. Ingres sur ses nombreux disciples : c’est un génie absolu, dominateur, et par cela même très propre à faire une révolution en peinture ; il a, sur les différentes directions de l’art, des systèmes arrêtés, des principes inflexibles contre lesquels il n’admet pas de discussion, et, s’il se trompe, c’est savamment, et d’après une esthétique particulière. »
- ↑ Delacroix a fait un croquis à la mine de plomb de ce vieux cheval. (Voir Catalogue Robaut, no 1205.)
- ↑ Levassor, le célèbre comique du Palais-Royal, faisait de fréquentes tournées en province, où il débitait des chansonnettes, des scènes comiques de son répertoire.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1268, un croquis pris par Delacroix de sa fenêtre, à Dieppe.
- ↑ A propos des relations de Delacroix et Chenavard, Baudelaire écrivait : « Chenavard était pour Delacroix une rare ressource. C’était vraiment plaisir de les voir s’agiter dans une lutte innocente ; la parole de l’un marchait pesamment, comme un éléphant en grand appareil de guerre, la parole de l’autre vibrant comme un fleuret, également aiguë et flexible. » (L’art romantique. L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix.)
- ↑ Jules Guérin (1801-1886), chirurgien distingué, auteur de nombreux mémoires qui lui valurent, en 1857, le grand prix de chirurgie à l’Académie des sciences. Il fut aussi un des fondateurs de la presse médicale de Paris et collabora à l’ancien National. Il était membre de l’Académie de médecine.
- ↑ Benedetto Varchi (1502-1562), historien et poète florentin, auteur d’une histoire des révolutions de Florence.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1270-1271.
- ↑ Delacroix publia une étude sur Charlet qui parut à la Revue des Deux Mondes (1er juillet 1862). Elle débute ainsi : « Je voudrais à ma faible voix plus de force et d’autorité pour entretenir dignement le public français de quelques admirables contemporains qui font sa gloire, sans qu’il en soit suffisamment informé. Charlet est à la tête de ces hommes rares qui ne me paraissent pas avoir été mis à la place que la postérité leur réserve sans doute. »
- ↑ La partialité et l’injustice de Delacroix à l’égard des savants se sont déjà manifestées à maintes reprises dans le Journal : la chose est d’autant plus surprenante que nous nous étions habitués à envisager les idées générales du maître comme supérieures à celles que nous trouvons exprimées ici. (Voir sur ce point la Vie de M. Frédéric-Thomas Graindorge, de H. Taine.)
- ↑ Delacroix, dans ses promenades quotidiennes à la jetée de Dieppe, étudiait sans relâche la mâture, les poulies, les cordages des navires. L’idée lui vint de mettre à profit ces observations dans un tableau où la mer jouerait un rôle. Il s’en ouvrit à Chenavard : « Tout cela, disait-il, n’a pas dû changer depuis les âges les plus reculés ; Jésus-Christ, après tant d’autres, a vu tout cela ; aussi vais-je le peindre endormi dans sa barque pendant la tempête. » Ce propos, que nous tenons de M. Chenavard lui-même, montre l’idée qui a inspiré à Delacroix ce sujet qu’il a repris maintes fois avec de nombreuses variantes.
- ↑ Dans un autre passage du Journal, Delacroix compare la peinture de Delaroche à celle d’un « amateur qui n’a aucune exécution comme peintre ».
- ↑ Ces dessins sont indiqués dans le Catalogue Robaut à l’année 1854. M. Robaut relève à côté des croquis les mots suivants : « Mer tranquille, vue de face, semblable aux sillons des champs, lorsqu’on a coupé l’herbe et qu’on l’a posée sur le dos des sillons. Le ton de la demi-teinte de la mer, jaune transparent verdâtre, comme de l’huile ; taches bleuâtres comme de l’étain avec l’aspect métallique et luisant. C’est la réflexion du ciel dans les flaques d’eau ; les bords sont très brillants et argentés, et le milieu est bleuâtre ; ou bien les bords sont bleu étain et le milieu couleur de sable. Ces tons couleur de sable se voient souvent dans la mer. Le sable du bord de la mer toujours plus foncé que celui qui est un peu plus éloigné, parce qu’il est plus mouillé. »
- ↑ Papety (1815-1849), peintre, élève de Cogniet. En 1836, il obtint le grand prix de peinture et partit pour Rome. Ses premières œuvres, très remarquées, faisaient présager pour l’artiste un brillant avenir. La mort le frappa à trente-quatre ans, en plein talent et au moment où il allait écrire l’histoire de l’art byzantin, d’après des notes et des documents archéologiques rapportés d’Orient.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1271.
- ↑ C’est la phrase de Pascal : « Quelle vanité que la peinture, qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont on n’admire pas les originaux ! » Chenavard l’avait sans doute citée dans une de leurs discussions littéraires et artistiques, et Delacroix la copie ici de mémoire.
- ↑ Il est particulièrement intéressant de rapprocher ce passage sur Géricault des précédentes appréciations de Delacroix.
- ↑ Delacroix est loin de citer dans son Journal tous les croquis qu’il faisait journellement. Ce même jour, 19 septembre, il a dessiné des bateaux avec un soin minutieux. Ces dessins sont datés et appartiennent à M. Robaut.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1269.
- ↑ Solié (1755-1812), compositeur et chanteur, auteur d’un grand nombre d’opéras et d’ariettes fort estimés à cette époque. Le Secret fut représenté à l’Opéra-Comique en 1796.
- ↑ Jean-Blaise Martin (1768-1837), chanteur, qui pendant quarante ans fit la gloire de l’Opéra-Comique et prêta le concours de son talent aux ouvrages qui y furent représentés.
- ↑ Se reporter à ses fréquentes comparaisons entre les différents arts.
- ↑ Delacroix devait, en 1858, faire un tableau sur ce même sujet.
- ↑ Édouard Charton (1807-1890), littérateur et homme politique, qui fonda successivement le Magasin pittoresque et le Tour du monde.
- ↑ Delacroix n’a jamais réalisé ce projet.
- ↑ Cette observation caractéristique nous rappelle le propos qu’un amateur lança un jour à Corot, en le voyant dans le feu de l’exécution d’un tableau : « Tenez ! vous ne savez pas ce que vous y mettez ! » Corot se retourne un instant, puis reprend son travail en murmurant : « Il a peut-être raison ! »
- ↑ Nous nous sommes appliqué dans notre Étude à faire ressortir l’analogie qui existait entre certaines faces de son esprit et les faces correspondantes de l’esprit de Stendhal, notamment en ce qui touche ce que nous avons appelé les principes directeurs de la vie. N’est-il pas intéressant de constater ici encore cette analogie et de rapprocher de ce fragment du Journal le passage suivant de Stendhal : « L’homme d’esprit doit s’appliquer à acquérir ce qui lui est strictement nécessaire pour ne dépendre de personne ; mais si, cette sûreté obtenue, il perd son temps à augmenter sa fortune, c’est un misérable. »
- ↑ Le Déluge était le premier des quarante tableaux représentant l’Histoire de l’humanité, où Chenavard voulait développer la succession chronologique des principales phases de la civilisation. Ces quarante peintures murales étaient destinées au Panthéon, dont Chenavard avait conçu une décoration grandiose. Ce projet ne fut pas réalisé.
- ↑ Se reporter aux premières années du Journal.
- ↑ Voir l’étude sur Puget que nous avons déjà indiquée, et la Correspondance, t. I, p. 201, et t. II, p. 254.
- ↑ En 1831, le gouvernement de Juillet avait mis au concours : Mirabeau répondant au marquis de Dreux-Brézé. Delacroix et Chenavard exécutèrent chacun une composition sur ce sujet. L’œuvre de Delacroix a figuré à l’Exposition universelle de 1889. A propos de cette toile, H. de la Madelène écrivait : « Comme les poètes, Delacroix devine. On ne peut même concevoir que les choses aient pu se passer autrement qu’il ne les a peintes. Le marquis de Dreux-Brézé, signifiant aux gens du tiers la volonté du Roi, n’a pu avoir une autre attitude que celle que l’artiste lui prête en face de la foudroyante apostrophe de Mirabeau. » (Voir Catalogue Robaut, no 360.)
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1076.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, nos 1304 à 1307.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 1045.
- ↑ Voir Catalogue Robaut, no 589 et 766.
- ↑ Genty de Bussy, administrateur et homme politique, devint conseiller d’État, et siégea à la Chambre des députés de 1842 à 1848, époque où il rentra dans la vie privée et fut mis en disponibilité.
- ↑ Mme Jaubert donne sur Richomme les détails suivants : « L’intérieur de Berryer paraîtrait incomplet si l’on n’y retrouvait la figure de son fidèle Richomme, qui avait débuté dans la même étude d’avoué que lui, tous deux clercs et compagnons de plaisir… Une déraison pleine de comique, des lueurs de bon sens et de sensibilité, une gaieté inaltérable avec un grain de malice, tel était l’hôte admis au foyer de Berryer, sans que jamais il pût sentir que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. »
- ↑ Surtout les rochers qui donnaient l’illusion de figures humaines, aux mouvements les plus contorsionnés. Il a trouvé, dans ces croquis, l’inspiration de plusieurs sujets.
- ↑ Jacques-Claude Beugnot (1761-1835), ancien député constitutionnel à la Législative, emprisonné sous la Terreur ; préfet de la Seine-Inférieure après le 18 brumaire, puis conseiller d’État et administrateur du grand-duché de Berg, sous l’Empire ; se rallia aux Bourbons, devint ministre sous la Restauration et fut élevé à la pairie en 1830. Il est l’auteur du mot fameux, attribué au comte d’Artois revenant à Paris : « Il n’y a rien de changé en France, il n’y a qu’un Français de plus. »
- ↑ Voir cette lettre de Delacroix à la Correspondance, t. ii, p. 115.
- ↑ Maret, qui reçut plus tard le titre de duc de Bassano, était alors secrétaire général du Premier Consul.
