Hellé/08
VIII
Un importun ayant retenu mon oncle, je le précédai chez madame Marboy. Elle m’avait priée de venir de bonne heure. Ma présence lui donnait l’illusion de la maternité et, près d’elle, aisément, j’oubliais que j’étais une étrangère.
— Comment, fit-elle en m’apercevant, vous inaugurez pour nous cette belle robe ? Deviendriez-vous coquette, sage Hellé ? Vous allez ravager le cœur poétique de Maurice, le cœur farouche de Genesvrier et le cœur doctoral de monsieur Gérard. Regardez-vous un peu.
Entre deux appliques de bronze doré qui brillaient haut comme un double bouquet de petites flammes, un miroir ovale me renvoya mon image, et l’apparition, vêtue de satin nacre et de mousseline floconneuse, m’étonna comme celle d’une sœur divine.
Je regardai ce visage dont la grâce sévère ne s’était pas attendrie encore et voluptueusement modelée sous les lèvres de l’amour, ce front uni, ces bandeaux d’un blond presque châtain qui se dorait dans la lumière, ces sourcils droits, ces larges yeux vert de mer, cette bouche finement ciselée par l’ironie, mais que l’enthousiasme faisait frémir, ce cou ferme, ces épaules vigoureuses, cette poitrine qui semblait destinée au repos d’un demi-dieu.
J’étais belle, je le savais, et je considérais ma beauté non comme un trésor qu’on peut exploiter pour de bas intérêts, mais comme un don précieux qui porte avec soi une joie sereine.
— Vous êtes rayonnante, Hellé ! dit encore madame Marboy, avec une nuance d’affectueuse inquiétude. Il ne vous est arrivé rien d’extraordinaire, mon enfant ?
— Absolument rien, chère madame.
Elle parut rassurée.
— Je vous ai placée entre monsieur Clairmont et mon neveu. Vous connaissez Maurice. Quant à Genesvrier, il ne vous parlera guère, car votre parure l’intimidera. Cependant, je crois que vous ne vous ennuierez point.
— J’en suis très sûre. Monsieur Clairmont me plaît beaucoup.
— C’est un charmeur, dit madame Marboy avec un sourire. Sa mère, qui est morte l’an dernier, était ma meilleure amie, et je ne puis vous dire à quel point elle aimait Maurice. Elle souhaitait le marier et, certes, chez la baronne de Nébriant, — leur cousine, une femme à la mode que tout Paris connaît, — les beaux partis ne manquaient point. Mais la folie du voyage monte au cerveau de Maurice. Il part… Quand reviendra-t-il ? lui-même n’en sait rien. Un caprice peut l’entraîner en Asie, aux Indes, au Japon. Et la poésie de Maurice lui ressemble. Elle est ardente, légère, impatiente comme lui. L’austère Genesvrier déclare, non sans quelque dédain, que c’est une muse folle qui souffle dans un clairon d’or.
Je devinai dans ce Genesvrier un ennemi des Muses. Il ne me déplaisait point que celle de Maurice fût une céleste folle, au verbe sonore et harmonieux, à la chevelure dénouée. Les poètes, à travers mes lectures, m’apparaissaient comme d’éternels enfants, ivres d’un délire sacré, à qui toute indulgence est due. Que Maurice Clairmont s’en allât combattre pour la divine Hellas, cela suffisait à me ranger de son parti. J’exprimai nettement cette opinion.
— Je suis un peu de votre avis, répondit madame Marboy. Mais ne soyez pas trop sévère pour Antoine. Peut-être vous intéressera-t-il beaucoup. C’est un homme d’une haute intelligence, d’une haute moralité, égaré malheureusement dans les utopies humanitaires. Il est né dans une famille riche et devrait porter le titre de marquis. Eh bien, ma chère enfant, il a fait cette belle folie de rejeter titre et fortune. Pourquoi ? Il n’a jamais daigné me l’expliquer tout à fait. Il n’est pas expansif, mon neveu Antoine. Il écrit dans une revue philosophique, sociologique, etc. Je suis trop bourgeoise pour comprendre sa littérature.
Le timbre retentit deux fois, et mon oncle parut, suivi de près par les Gérard. La conversation ne fut plus qu’un échange de politesses jusqu’au moment où Maurice Clairmont fut annoncé.
Madame Marboy le présenta à mon oncle, puis il vint s’asseoir près de moi. Ses yeux exprimaient une admiration qui me fut délicieuse, et je compris, dès les premières paroles, qu’il était heureux de me revoir.
Sept heures et demie sonnaient quand M. Genesvrier fit son entrée. J’entendis qu’il s’excusait de son retard ; mais, toute aux discours de Clairmont, je regardai à peine le nouvel arrivant. Presque aussitôt mon oncle offrit son bras à madame Gérard et nous passâmes dans la salle à manger.

Le voyage de Maurice fournit la matière de l’entretien pendant tout le repas. Le jeune homme parlait avec une grâce aisée et brillante qui révélait le poète et faisait paraître bien lourde l’éloquence professorale de M. Gérard. J’étais sensible à la musique du verbe autant qu’à la beauté de la forme, et, la nouveauté de mon plaisir m’empêchant de le discuter, je ne m’avisai point que cet art de décrire et d’évoquer ne servait pas l’idée originale, et que le magicien nous enchantait par une transfiguration habile du lieu commun. La personne de Maurice Clairmont s’adaptait admirablement au type du poète aventureux qui depuis Byron, émeut les imaginations adolescentes. Ce n’était plus la fine ironie parisienne, ni la correction du mondain, ni la componction du savant… C’était je ne sais quoi de jeune, d’ardent, d’heureux, où l’on sentait l’impatience de vivre et la certitude de triompher ; des yeux si beaux qu’ils semblaient créés pour refléter des spectacles de beauté éternelle, une voix où vibraient tous les timbres du bronze et de l’or. À peine, en causant avec Maurice, pouvais-je atténuer par une réserve apprise l’extrême plaisir que j’éprouvais à l’entendre, à le regarder. Aucun sentiment de coquetterie, pas même le confus émoi sensuel qui se mêle aux émotions de ce genre, ne troublait la pure qualité de ce plaisir, comparable à la joie de l’artiste qui admire dans son modèle un type accompli d’humanité.
Antoine Genesvrier, placé à ma droite, n’attirait point mon attention. Nous échangions seulement des paroles de politesse. Comme on rentrait au salon, je le vis en face pour la première fois.
En tout autre circonstance, ce que j’avais appris de sa vie et de son caractère m’eût intéressée passionnément, mais un charme plus fort me détournait de cet homme, dont les trente-cinq ans déjà trop marqués, la haute taille, la carrure puissante, les grands traits sombres sous une masse de cheveux bruns, qui grisonnaient vers les tempes, étaient peu faits pour séduire une jeune fille.
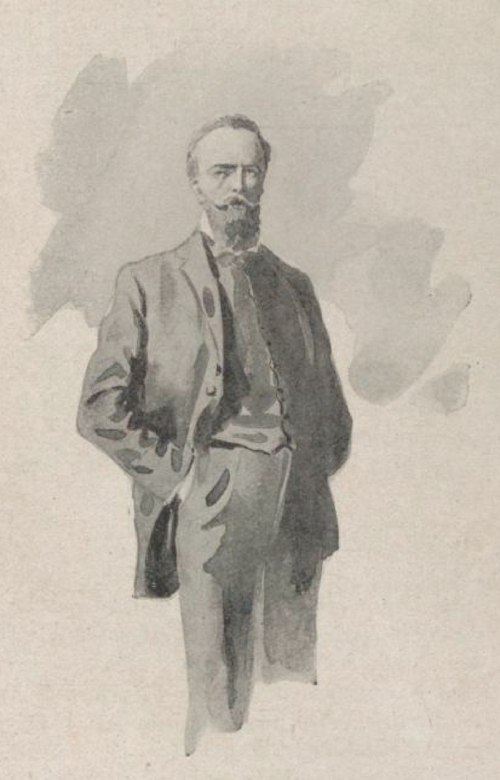
Madame Gérard, qui venait de négocier quatre mariages à la fois, entretenait madame Marboy de ses démarches, de la reconnaissance qu’elle inspirait aux huit familles des jeunes fiancés. Ma vieille amie écoutait avec un sourire d’indulgence résignée, tout en défripant les dentelles qui garnissaient sa robe de soie grise. Genesvrier entretenait mon oncle et M. Gérard.
Maurice Clairmont s’était assis près de moi.
— Je vais partir dans quelques jours, disait-il, et peut-être ne reviendrai-je pas avant deux longues années. J’emporterai, avec l’espérance de vous retrouver, le regret de ne vous avoir pas connue davantage. Les salons sont pleins de figures banales, et c’est une bonne fortune de rencontrer des gens tels que votre oncle et vous.
— Nous ne sommes pas des mondains… À peine suis-je allée huit ou dix fois à des réceptions qui se ressemblent toutes avec une désolante identité. Je suis une provinciale, monsieur, une campagnarde. Je ne me plais que dans mon vieux pavillon de la rue Palatine ou à la Châtaigneraie.
— Madame Marboy m’a parlé de votre vie. Je sais que vous aimez l’étude et la solitude… Goût singulier pour une personne de votre âge et de votre figure. Je n’ai jamais pu me soumettre à cette discipline intellectuelle qui marque notre jeune visage d’une précoce gravité. Je suis un être de caprice et d’impulsion… Et tenez, — ajouta-t-il avec une inflexion de voix qui me parut étrange, — au moment de partir pour cette Grèce qui me séduit, je ne sais quelle fantaisie peut me prendre…
— D’aller ailleurs ?
— Ou de rester.
Il reprit rêveusement :
— Je vaincrai cette fantaisie, ayant engagé ma parole… Il y a aussi l’intérêt de mon drame que je dois achever là-bas… Mais je suis ainsi fait…
— Il faut partir ! dis-je, car la poésie de ce voyage ajoutait je ne sais quel charme au caractère de Clairmont.
Il me regarda avec une curiosité que mon absolue inexpérience de l’homme m’empêcha de remarquer sur-le-champ.
— Vraiment, vous me conseillez de partir… même si Paris m’offrait un nouvel attrait… un attrait irrésistible ?
— Je ne sais, dis-je avec candeur, quel attrait peut vous offrir Paris ; mais, si j’étais homme, je ne balancerais pas, quand, à trois jours de voyage, je saurais trouver les Cyclades, la mer des Néréides, et peut-être la gloire de chasser le Turc de la terre des dieux.
— Allons ! fit-il en riant, je vois qu’il me faudra chasser le Turc, comme vous dites, sous peine de me déshonorer à vos yeux. Mais si loin que j’aille et si délicieuses que soient les îles, et si bleue la mer, et si tenaces les Turcs, je reviendrai, je reviendrai, mademoiselle.
— Et vous nous rapporterez un beau drame ?
— Je tâcherai… Et vous, mademoiselle, que ferez-vous, d’ici là ?
— Je travaillerai avec mon oncle ; j’irai passer les étés à la Châtaigneraie…
— Deux ans, c’est long.
— Croyez-vous ? Les années vont vite. Il me semble que je suis née d’hier, et pourtant ma vie s’est écoulée sans aventures, sans incidents, entre mon oncle et ma vieille bonne Babette.
— Vous n’aviez même pas de compagnes ?
— Et je n’en souhaitais point. Les jeunes filles ne m’aiment guère, parce que je leur ressemble peu et que nous n’avons aucun goût commun.
— Mais quand je serai de retour, peut-être des événements imprévus auront-ils bouleversé votre existence. Une Psyché inconnue s’éveille en nous, vers vingt ans… N’importe ! je vous devrai un souvenir exquis, mademoiselle, et je penserai à vous sous les myrtes et les oliviers… Et puis, après tout, vous avez raison… Deux ans passent vite.
Il répéta, après un silence :
— Je reviendrai.
Quand nous prîmes congé, vers minuit, mon oncle pria Clairmont de venir dîner un mercredi chez nous, rue Palatine. Je compris, aux paroles d’adieu de Genesvrier, qu’une invitation identique avait précédé celle-là.