De Pékin à Paris : la Corée, l’Amour et la Sibérie/Texte entier
DE PÉKIN À PARIS[1],
orsqu’en
1875 je
quittai Pékin
pour la première
fois après un
séjour de plus
de six années
consécutives
dans l’Extrême-Orient,
ma curiosité
était déjà
excitée par cet
immense empire
des Tsars
sur lequel on
savait si peu, du moins
en ce qui concernait la
parie est des monts Ourals.
Ces courses folles, au
galop de trois ou quatre chevaux
emportés, à travers steppes,
forêts, montagnes, sur
des routes à peine tracées et où les œuvres d’art consistent
en quelques troncs d’arbres jetés en travers d’un
torrent, les loups, les brigands et même les privations,
tout cela m’attirait invinciblement.
La Faculté vint se mettre en travers de mes aspirations vagabondes. Je souffrais de terribles accès d’une lièvre contractée, probablement en 1869 en Cochinchine, à l’époque où notre belle colonie, si salubre maintenant, était un foyer perpétuel de toutes les épidémies. Non seulement le voyage par la Sibérie me fut interdit, mais même celui par le Japon et les États-Unis. Je cédai, tout en me promettant bien de suivre ces deux itinéraires plus tard, et je partis mélancoliquement par Suez. En 1882, avec ma femme alors, je traversai le Japon et le nord des États-Unis pour rentrer également en France.
Maintenant, il y a huit années que nous n’avons quitté Pékin, mon congé vient enfin de m’être accordé, et j’en ai besoin, car je suis encore une fois assez souffrant. Faudra-t-il renoncer de nouveau à ce voyage rêvé et pour lequel nous sommes si bien préparés ? Nous avons appris quelques mots de russe, nos bagages, réduits à leur plus simple expression, n’ont nullement prévu le séjour à bord d’un paquebot. Ils doivent pouvoir tenir avec nous dans l’intérieur d’une voiture. J’ai en poche une forte lettre de crédit de M. Startseff, de Tien-Tsin, sur les principales villes, de Vladivostok à Saint-Pétersbourg, et j’ai, outre mon passeport régulier de la légation de France, une lettre officielle de Son Excellence le comte Cassini, ministre de Russie à Pékin, pour toutes les hautes autorités de l’Empire. On m’a souvent dit en cours de route : « Avec cette lettre vous irez partout, tout vous sera ouvert ». Les faits ont justifié le dire, et si notre voyage s’est effectué dans d’aussi bonnes conditions et nous a laissé d’aussi excellents souvenirs, c’est à l’extrême amabilité de nos amis russes qué nous le devons et en particulier à M. le comte Cassini.
Nous emmenons un domestique chinois. Il se nomme Hane et est avec nous depuis une douzaine d’années. C’est un homme tranquille, qui paraît dévoué, et dont les services nous seront précieux en route. Il a quarante-deux ans ; ce n’est pas précisément un Adonis, et pourtant on nous prédit qu’il nous sera difficile de l’arracher à tous les bras qui s’ouvriront sur son passage, même en cours de voyage, mais nous espérons bien que les ennuis qu’il pourra nous causer seront amplement compensés par l’agrément de son service. C’est encore un point sur lequel nous nous félicitons d’avoir suivi notre inspiration, en dépit des pronostics de nos amis.

Pour aller de Pékin à Saint-Pétersbourg, la route la plus courte est sans contredit celle qui traverse les plaines de la Mongolie, le désert de Gobi, et par Ourga et Kiakhta conduit au lac Baïkal. Mais cette route ne nous tente en aucune façon. J’ai traversé, en février 1871, l’extrémité nord-est du grand désert de Gobi, et il y a trois ans nous avons été passer un certain nombre de jours dans les plaines de la Mongolie : nous avons vu les Mongols chez eux, nous avons vécu sous leur tente. Rien de nouveau ne nous attire donc de ce côté, et depuis longtemps nous avons résolu de passer par Vladivostok et l’Amour. C’est un détour de plus de 5 000 kilomètres : qu’est-ce que cela sur la distance qui sépare Pékin de Paris ? J’ai deux années de congé, je puis bien rester quarante jours de plus en route.
I
De Pékin à Tien-Tsin.
17 mai 1892. — Pékin est à cent et quelques kilomètres par terre de Tien-Tsin, point où commence la navigation à vapeur. Franchir cette distance, qui paraît insignifiante, est toujours une assez grosse affaire, surtout si l’on a des bagages. En été, le moyen le plus pratique est de faire transporter tous ses colis sur des brouettes jusqu’à T’oung-Tcho, situé à 23 kilomètres des portes de la capitale, sur le fleuve Peï-Ho, qui traverse Tien-Tsin. Par cette voie La distance est double, mais on trouve à T’oung-Tcho des embarcations pontées dans lesquelles on a un confort relatif.


Le Peï-Ho est à une trentaine de mètres au-dessous du niveau de Pékin. Un canal y conduit, alimenté par les sources qui sortent des dépendances du Palais d’Été. C’est par ce canal que nous devons nous rendre à T’oung-Tcho, où un entrepreneur s’est chargé de transporter nos bagages et de nous préparer deux bateaux. Six écluses ou plutôt six barrages en planches superposées dont les deux extrémités glissent dans des rainures en pierre, servent à maintenir les eaux à un certain niveau. Elles ne livrent pas passage aux bateaux : voyageurs et cargaison sont par conséquent soumis à six transbordements successifs.

Partis à 3 heures de notre maison de la rue de la Farine-Sèche dans notre voiture chinoise, nous traversons bientôt, à la porte Tch’i-Houa, la muraille qui entoure Pékin, et arrivons au canal, où nous prenons un premier bateau qui sera, comme tous les autres, tiré à la cordelle par un homme ou par un âne. Presque tous les bateliers, jusqu’au Peï-Ho, sont musulmans.

Les musulmans sont très nombreux en Chine : il y en a dans toutes les provinces. Ce sont généralement des gens énergiques. Ils ont pris à Pékin le monopole de la boucherie, celui des grands transports de ville à ville. Dans les hameaux que traversent les grandes routes, presque toutes les auberges sont tenues par des mahométans, Il y a donc en Chine de nombreuses mosquées. Une d’elles, très propre, se trouve à la quatrième écluse ; un vieillard est assis sur la berge ; je le reconnais, car il y a deux années il dirigeait encore notre bateau. Maintenant il a cent ans ! Il est sourd, presque aveugle. C’est probablement la dernière fois que nous le voyons.
À 7 heures, nous sommes devant le fameux pont de Pa-Li-Tch’ao, plus connu en Europe sous le nom de Palikao, près duquel le général Montauban remporta, en 1860, une grande victoire qui lui valut le titre de comte de Palikao.
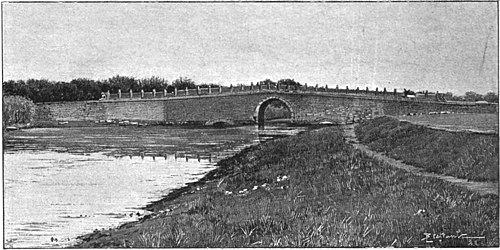
Nous avons croisé de nombreux bateaux chargés de cuivre et de plomb, en saumons. Ce cuivre va servir à faire de petites sapèques, qui sont la monnaie courante du pays et dont il faut, suivant le cours, de 500 à 600 pour faire un franc. Avec le plomb on recouvrira d’une lame mince, pour empêcher les infiltrations de la pluie, les chevrons du T’ai-Ho-Tiene[7] dans le palais impérial, et du grand sanctuaire dans le temple du Ciel.
Ces deux pavillons ont été incendiés, le premier par accident, le second par la foudre, il y a deux ans, et l’on est en train de les reconstruire.
L’eau est peu profonde. Comme il n’y a, pour ainsi dire, pas de courant, et que le canal est Le déversoir des immondices de la capitale, le fond en est couvert d’un énorme dépôt de vase qu’il est pour le moment nécessaire d’enlever. Les travaux commenceront à la huitième lune (vers septembre) et dureront deux mois. Ils coûteront, me dit-on, 15 millions de francs ! On ne parle pas des épidémies que ce travail engendrera.
À 7 heures 40 nous sommes à T’oung-Tcho. Devant nous se dresse une tour haute d’une centaine de pieds. Elle indique, paraît-il, la différence de niveau entre cette ville et Pékin. Son sommet serait sur le même plan que les assises de pierre sur lesquelles sont construites les murailles de [a capitale.
Cependant personne n’est là à nous attendre. J’avais pourtant en la précaution d’envoyer deux domestiques avec les bagages : ils seront probablement restés à bord à les garder ; du moins c’est ce qu’ils diront. Il nous faut donc chercher nos deux bateaux au milieu des trois ou quatre cents qui sont amarrés à la berge, sur une longueur de plus d’un kilomètre. Je suis bien que l’entrepreneur de transports m’a promis de faire flotter le drapeau français à la poupe de mes deux barques, mais la nuit commence à tomber et le pavillon tricolore ne se montre pas. Bref, il est 9 heures quand nous montons à bord, et nous n’avons pas dîné.
Nous sommes environnés d’odeurs horribles, et, malgré une longue habitude des miasmes de Pékin, nous ne pouvons plus y tenir. Je donne l’ordre de lever l’ancre, ce que je n’obtiens qu’après de fortes menaces. On voulait attendre l’apparition de la lune. J’ai beau dire que je veux fuir ces odeurs, les bateliers, qu’elles n’incommodent pas, ont la plus grande répugnance à marcher dans l’obscurité.
C’est le moment des adieux, j’ai versé à l’entrepreneur les 35 piastres promises pour ses services, et l’un des deux domestiques qui ont accompagné les bagages jusqu’ici repart pour Pékin. C’est un très vieux serviteur. Cocher de fiacre avant d’entrer à mon service, il m’avait conduit dans sa voiture pour la première fois en 1870. Il pleure comme une Madeleine en faisant toutes les génuflexions d’usage, et en nous souhaitant le traditionnel : I lou p’ing ane ! « Bon voyage ! » L’autre nous accompagnera jusqu’à Tien-Tsin. Il se nomme Wang-Cheu.

Nous travaillons pendant une heure à nous frayer un passage au milieu des bateaux qui encombrent la rivière, et allons mouiller à l’extrémité du port, en attendant a lune. Au bout de quelques minutes, tout le monde dort à bord. À 2 heures le croissant brille, je réveille les bateliers, et nous partons.
18 mai. — Je cherche des yeux les pavillons français promis. Ils flottent bien à l’arrière, ils sont bien tricolores ; le bleu, le blanc et Le rouge ne laissent rien à désirer sous le rapport des couleurs : mais, au lieu d’être mis côte à côte, verticalement, ils sont superposés horizontalement. J’ai quelque peine à les faire placer dans l’ordre voulu.
La chaleur est accablante. Impossible de mettre la main sur le thermomètre si bien monté que nous avons fait venir de Paris en prévision de notre voyage. L’aurions-nous oublié au dernier moment dans la rue de la Farine-Sèche ? Il serait pourtant intéressant de savoir quelle température il fait ici au mois de mai et quelle température nous aurons en juin à Vladivostok. Aussi notre joie est-elle grande de le retrouver dans la boîte de mon appareil photographique. Il marque 30 degrés centigrades. Je le mets sur une malle à côté de moi : en très peu de temps, il monte à 34 degrés.
Depuis une heure ou deux, une chose m’intrigue : le second bateau qui porte mes caisses à destination de Paris par Suez a l’air fort grand, et cependant je vois plusieurs colis en plein air sur le pont. Profitant d’un moment où, par suite de la force du vent, nous sommes obligés de nous amarrer contre la rive, je vais faire une pote inspection. Qu’est-ce que je vois ? Dans la partie couverte du bateau, le salon, si je puis donner ce nom à un pareil réduit, une demi-douzaine de Chinois étaient étendus presque nus, leur éventail la main, naturellement, et avaient pris la place de mes colis, qui alors devaient rester dehors, exposés au soleil, à la pluie. C’étaient des passagers que mon batelier avait admis pour augmenter ses recettes, Je me fâchai tout rouge et menaçai de déposer lesdits passagers sur la berge, si mes bagages n’étaient pas réintégrés sur-le-champ dans le salon, à l’abri des intempéries. Ce fut fait à la minute. Seulement, à partir de ce moment, il fut de plus en plus difficile de faire naviguer mes deux barques de conserve.
Vers 5 heures nous avons fait le quart de la route. Notre second bateau a été depuis longtemps perdu de vue, et nous sommes obligés de l’attendre. Il arrive enfin, mais le vent est tellement fort que nous n’avançons qu’avec peine. La poussière est aveuglante. Bien que nous descendions le courant, nous sommes obligés d’aller à la cordelle, et il est probable qu’il en sera ainsi toute la nuit. Le jour baisse, et peu à peu d’autres bateaux se joignent à nous. Ils viennent se mettre sous mon égide, car les bateliers ne veulent marcher la nuit qu’en nombreuse compagnie : ils ont peur d’être attaqués. Par suite des inondations d’il y a deux ans, la misère est affreuse dans les campagnes ; les paysans, ruinés et affamés, se réunissent par bandes et dévalisent toutes les embarcations dont le personnel n’est pas assez nombreux pour leur résister.
Les bateliers ont bien travaillé. Il est 9 heures, la nuit est noire, j’autorise le repos jusqu’au lever de la lune. À 1 heure, branle-bas. Le vent, toujours violent, nous est contraire.
Vers midi, le thermomètre marque 37 degrés dans la cabine. Nous avançons toujours avec peine, et il serait facile de suivre nos bateaux en se promenant sur la berge. Nous essayons, mais le vent est si fort qu’il faut y renoncer. Maintenir nos chapeaux sur nos têtes est un vrai travail. Pourquoi ne nous sommes-nous pas munis de casquettes ? C’est un grave oubli, que nous nous empresserons de réparer à la première occasion.
En revanche, je trouve que nous avons encore trop de bagages pour traverser la Sibérie, et, réduisant ma garde-robe au strict nécessaire, je donne à Wang-Cheu une foule d’objets, pantalons, habits, etc., que je présume devoir nous embarrasser, et qui le plongent dans le ravissement, malgré son chagrin de nous voir partir. Son chagrin ! Je n’y crois guère : perdre ses maîtres à condition d’hériter de leurs vieux habits, Wang-Cheu le ferait tous les jours.
Cependant, par suite des détours du Peï-Ho, la brise nous est devenue favorable. Nos hommes se disposent à dresser le mât, qui, par vent contraire, est généralement couché sur le rouf, lorsqu’ils s’aperçoivent qu’il leur manque une pièce de bois, de forme et de dimension spéciales, absolument indispensable pour fixer le mât au fond du bateau. Me mettre en colère n’aurait servi à rien ; je me contente de leur rappeler qu’ils ont beaucoup de proverbes fort sages qu’ils devraient toujours mettre en pratique, entre autres celui-ci : « N’attends pas d’avoir soif pour creuser un puits ». Ils se mettent à rire. Mais il n’en faut pas moins fendre, scier et ajuster la pièce de bois nécessaire. Total, une heure de perdue.
J’en profite pour prendre une vue de mes bateaux. Ce n’est pas une petite affaire. Je m’imagine à chaque instant voir mon appareil emporté par le vent, qui fraîchit de plus en plus.

Nous repartons enfin, et marchons avec rapidité et difficulté au milieu des nombreux bancs de sable que le manque d’eau rend encore plus difficiles à éviter. Plusieurs fois nous nous échouons. Il faut alors serrer la voile et essayer de nous renflouer avec les gaffes ; lorsque celles-ci sont impuissantes, les bateliers sautent dans l’eau et nous dégagent en soulevant alternativement l’avant et l’arrière du bateau.
On perd des heures à ce manège.
Cependant le vent redouble et nous marchons presque à sec de toile avec une rapidité vertigineuse. Bientôt la tempête est terrible. Continuer à avancer serait de la folie. Heureusement nous côtoyons pour le moment une berge un peu plus haute que le rouf de nos bateaux et qui est justement perpendiculaire à la direction du vent. C’est un asile que nous sommes heureux de trouver. Nous nous y amarrons solidement, mais non sans des craintes sérieuses d’accident. La poussière est telle, qu’on ne peut voir à trois pas.

Des rafales soulèvent notre rouf, que nous nous attendons à chaque minute à voir emporter. Ce serait infailliblement arrivé si heureusement la berge n’avait pas sensiblement surplombé.
Personne ne dormit à bord cette nuit-là, pendant laquelle, par surcroît, j’étais particulièrement souffrant.
Vers 3 heures le vent diminua beaucoup ; mais comme maintenant il était contraire, il fallut tirer à la cordelle.
20 mai. — Enfin, à 11 heures 30, nous arrivons au pont de bateaux qui se trouve à l’entrée de Tien-T’sin, du côté de Pékin. La concession européenne est située à l’autre extrémité la ville, que le fleuve contourne C’est un trajet long et ennuyeux. Nous abandonnons donc à la garde de Hane et de Wang-Cheu nos barques, qui n’arriveront que dans deux heures, et, montant dans deux génerikchas ou pousse-pousse, nous pénétrons dans les rues populeuses de Tien-Tsin. À midi nous déjeunions à l’hôtel du Globe, situé sur le quai même.
À 2 heures, ne voyant pas arriver nos bateaux, je vais faire quelques visites.
Une des premières fut pour M. Vahovitch, consul par intérim de Russie, avec lequel j’avais toujours été en excellentes relations à Pékin. Il s’empressa de viser mon passeport, formalité indispensable sans laquelle il m’eût été impossible non seulement de traverser l’empire russe, mais même d’y pénétrer ; puis il me promit d’écrire à son frère, employé dans la grande maison Gheveleff, de Vladivostok.
Vers 5 heures, rentrant à l’hôtel, je trouve Hane tout en émoi. Il n’était arrivé qu’avec un seul bateau. Voici ce qui s’était passé.
Notre batelier, qui avait déjà augmenté ses profits par le transport d’une demi-douzaine au moins de passagers, avait encore une autre corde à son arc : la contrebande.
Les Européens jouissent, en Chine, de certaines immunités. Leurs bagages ne sont presque jamais visités, parce qu’à Pékin, à part deux magasins qui ne devraient servir qu’à leur approvisionnement exclusif, les Européens n’ont pas Le droit de faire du commerce. Or chaque ville a son octroi, et je me demande quels sont les objets sur lesquels aucun droit n’est prélevé par les mandarins grands et petits ou leurs satellites.
Mon batelier, transportant des bagages appartenant à un étranger, et certain par Cela même d’échapper à la visite des employés de l’octroi, avait pris à bord un certain nombre de paniers ou de sacs de petits pois.
Un « petit bout de cosse échappé par malheur » avait paru suspect au mandarin, qui, après inspection des colis, flairant quelque supercherie et par suite une bonne aubaine, avait arrêté l’embarcation. Comme je trouvais que le batelier dépassait véritablement les bornes, je me contentai de faire réclamer mes bagages par l’administration des douanes maritimes, en abandonnant le fraudeur à la merci des employés de l’octroi : il a dû être sérieusement pressuré.
Ces faits ne sont du reste pas rares. Le directeur général des douanes lui-même, venant de Hong-Kong, ne vit-il pas saisir, en arrivant à Changhaï, ses bagages dans lesquels son domestique avait caché je ne sais combien de livres d’opium !
Le soir nous dînions chez M. Detring, directeur de la douane, conseiller intime du puissant vice-roi Li-Houng-Tchang, que je connais depuis vingt-trois ans. Il nous servit une alose, Le fait, dira-t-on, n’a rien de remarquable. Et cependant quel plaisir ne nous fit pas cette modeste alose, à nous qui arrivions de Pékin, où le poisson de mer est presque inconnu !
II
De Tien-Tsin à Changhaï.
Le lendemain 21 mai, après avoir réglé mes affaires : caisses à expédier à Paris, passeport, banque, fournisseurs, etc., et pris congé de tous nos amis, qui à l’unanimité nous ont déclarés fous, nous allons, à 10 heures du soir, prendre possession de nos cabines à bord du Lien-Ching, en partance pour Changhaï.
22 mai, — 3 heures du man, départ. Nous sommes à 110 kilomètres de la mer, Nous commençons à descendre le Peï-Ho, particulièrement dangereux pour la navigation à cause de son peu de largeur, de son peu de profondeur, de ses coudes à angle aigu.
À 8 heures et demie du soir, nous passons devant les forts de Takou, qui, à l’heure actuelle, disent les gens du métier, rendent impossible l’entrée du Peï-Ho aux navires ennemis. À 9 heures et demie, nous franchissons la barre. Le temps est superbe, et la mer, unie comme une glace, rassure les cœurs les moins solides. Le lendemain, à 5 heures du soir, nous arrivions à Tché-Fou.
23 mai. — On nous annonce qu’un petit vapeur, l’Owari Maru, partira dans trois jours pour Fou-Sane, en Corée, où il correspondra avec le grand bateau pour Vladivostok. Il est tout peut, commandé par un Japonais. Ni la nourriture, ni les cabines n’en sont vantées. Nous avons peu envie de profiter de l’occasion. Et puis, je crois d’ailleurs qu’il n’y aurait pour nous aucune économie de temps.
Nous ne descendons pas à terre, et à 6 heures nous repartons. Après avoir doublé le cap Chantoung, nous rencontrons une forte houle du sud, et comme malheureusement notre steamer ne contient aucune cargaison, ayant débarqué à Tché-Fou six cents sacs de petits pois, tout son chargement (ceux de mon batelier s’y trouvaient peut-être), nous flottons comme un bouchon. Il y avait bien à l’avant et à l’arrière des caisses à eau pouvant contenir 400 à 500 tonnes, mais on avait laissé celle de l’avant vide, se contentant de mettre dans celle de l’arrière assez d’eau pour que l’hélice eût son action entière. On allait vite, mais on était secoué. La compagnie y trouvait son compte de toutes les façons : économie de temps et économie sur la nourriture des passagers. Marie et moi paraissons seuls à table.
25 mai. — Nous passons devant l’endroit où, en novembre 1870, le 13 je crois, le steamer anglais Lismore, sur lequel je me trouvais, fit naufrage à deux heures du matin. Puis voici les forts de Woosung, devant lesquels sont mouillés des navires de guerre chinois. Il fait nuit lorsque nous arrivons à Changhaï.
Des génerikchas se disputent la faveur de nous conduire. Les élus partent comme des flèches, puis, arrivés devant le pont qui sépare les concessions anglaise et française, ils nous déposent à terre et refusent d’aller plus loin. Leur certificat n’est valable que pour les concessions anglaise et américaine. De mesquines rivalités empêchent les différentes municipalités de s’entendre sur toutes ces minimes questions de détail, et c’est le public qui en souffre.
Heureusement, le Grand Hôtel des Colonies, renommé dans tout l’Orient, n’est qu’à deux pas, et nous y trouvons, comme d’habitude, de belles chambres bien aérées et une cuisine française des plus soignées.
26 mai. — Ma première visite est pour le docteur Jamieson, une célébrité de l’Extrême-Orient, aussi aimable homme qu’excellent médecin, qui, après m’avoir examiné sur toutes les coutures, me dit qu’il ne voit aucun inconvénient à ce que je poursuive l’exécution de nos projets, si nous y tenons absolument. Je suis heureux d’avoir suivi ses conseils.

III
De Changhaï à Fou-Sane.
27 mai. — À 10 heures nous sommes à bord du Kobe-Maru, et en route pour le Japon. Parmi les passagers nous trouvons immédiatement des amis, M. Mignard, lieutenant de vaisseau en retraite, M. Startseff, de Tien-Tsin, etc.
Ce dernier est, dit-on, un des Européens les plus riches de Chine. On prétend que la plus grande partie du thé de qualité supérieure consommé en Russie passe par ses mains. Il a donc des correspondants dans tout l’empire. C’est lui, comme je l’ai dit, qi a bien voulu me donner la lettre de crédit nécessaire pour notre voyage. J’ajouterai que M. Startseff a été nommé officier de la Légion d’honneur pour services rendus pendant l’expédition du Tonkin.
Il a acheté dernièrement l’île Poutiatine, à côté de Vladivostok, et est pour le moment en route pour sa propriété. Nous serons donc ensemble pendant une douzaine de jours.
À bord se trouve également l’amiral Humann et son aide de camp, M. Gauchet, L’amiral va rejoindre son escadre à Nagasaki. Il se montre fort aimable pour nous, et c’est lui qui clôt la liste des personnes qui ont déclaré notre voyage une pure folie.
Nous sommes sur un bateau luxueux et très en faveur auprès des voyageurs sur cette ligne, où la concurrence est cependant fort grande. Le capitaine est un Anglais. Et à ce propos, qu’il me soit permis de constater un fait que je déplore. Pendant plus d’un quart de siècle passé dans l’Extrême-Orient, j’ai connu beaucoup de capitaines, de mécaniciens et d’officiers sur les bateaux chinois et japonais ; j’ai vu des Anglais, des Américains, des Allemands, des Danois, mais jamais le moindre Français : pas plus du reste que parmi les pilotes, en dehors de nos possessions.
Le Kobe-Maru est une vraie arche de Noé. Un cochon se prélasse en liberté sur l’avant ; deux terriers viennent jouer avec tout le monde. Mais le favori, c’est « Billy ».
Billy est un chevreuil que six années de séjour à bord, où chacun le gâte à l’envi, ont doué d’un majestueux embonpoint. On le voit partout. Il monte et descend avec la plus grande facilité ces sortes d’échelles qu’on est convenu d’appeler des escaliers. Si vous montrez à Billy un morceau de pain, il vous salue deux fois, puis attend la récompense de ses politesses. S’il vous voit mettre le pain dans votre poche, il y fourrera son museau, soyez-en sûr, et ce sera souvent tant pis pour la poche, car Billy est gourmand et son museau est gros.
Le 29 au matin nous arrivons, après une très belle traversée, à Nagasaki, l’un des plus beaux, sinon le plus beau port du monde.

Le Tokio-Maru, qui doit nous porter à Vladivostok, est mouillé à 200 brasses de nous. Je m’’empresse d’aller y retenir une cabine, et d’y transporter nos bagages, puis, comme il ne doit lever l’ancre qu’à 6 heures, nous voulons nous promener encore une fois dans les environs toujours si frais, si verts, si pittoresques, de Nagasaki, où nous venons cependant pour la troisième fois, sans jamais nous lasser d’admirer.
La rade est un grand amphithéâtre oblong ; les montagnes qui l’entourent sont élevées et couvertes d’arbres et de verdure. Çà et là une construction gracieuse à demi cachée dans le feuillage, partout des sources et de petits ruisseaux. Dans le fond, du côté opposé à l’entrée, la ville avec ses temples entourés de sapins. À droite sont les maisons construites à l’européenne.

C’est là que M. Mignard nous a donné rendez-vous pour aller déjeuner dans la campagne.
Nous avions demandé à M. Startseff de nous accompagner, mais il ne le pouvait pas. Avant son départ de Tien-Tsin il avait acheté un petit steamer d’une vingtaine de tonneaux pour faire le service de son île à Vladivostok, et, après quelques réparations nécessaires, ce steamer avait quitté Tien-Tsin le même jour que nous. Étant donnée sa petitesse, il devait suivre les côtes et chercher un abri au moindre coup de vent. On nous avait proposé de prendre passage à bord. Nous avions refusé cette offre peu rassurante. En somme, M. Startseff était inquiet. Il voulait télégraphier à Fou-Sane pour savoir si son bateau y avait touché. Le soir, il reçut une réponse satisfaisante.

Nous partons en file indienne, suivis de Hane, chacun dans un génerikcha tiré par deux hommes.
Nous traversons d’abord la ville, si pittoresque avec toutes ses boutiques diverses, dont la devanture est ainsi faite, que de notre voiture le regard peut plonger jusqu’au fond. Et l’on peut examiner à plaisir, car tout est joli et surtout tout est de la plus exquise propreté.
Les rues sont très animées ; nous allons d’un trot rapide, malgré la foule qui les sillonne. Nos hommes ne cessent de pousser des cris, afin que les passants s’écartent pour nous laisser la voie libre. C’est à peine si les mousmés, toujours si gracieuses, même lorsqu’elles ne sont pas jolies, ce qui est généralement le cas, tournent la tête pour nous regarder. L’Européen n’est plus un objet de curiosité dans les grandes villes.
Tout à coup mon génerikcha s’arrête et un colloque s’engage entre mes deux coulis et ceux d’un véhicule qui vient en sens inverse, Au bout d’un instant, je commençais déjà à m’impatienter, nous repartons, mais j’ai changé d’attelage.
Je suis le plus lourd de la bande, et j’étais tombé sur les hommes les moins vigoureux. Ils se sont vite rendu compte de la difficulté de la tâche qui leur est échue. Il faut escalader la montagne, puis la redescendre, et ce soir il faudra recommencer la même opération dans l’autre sens. Ne se sentant pas à la hauteur de la situation, ils ont préféré renoncer au salaire, considérable pour eux, que devait leur rapporter notre excursion en dehors de la ville.
J’ai maintenant deux solides coursiers, qui ne tardent pas à rejoindre le gros de la caravane.
Au détour d’une rue, nous nous arrêtons pour laisser passer deux femmes. La première, une jeune fille, conduit à l’aide d’un bâton une malheureuse créature dont l’aspect est bien ce que j’ai vu de plus horrible. Elle n’a plus de nez, plus d’yeux, plus de lèvres. Sa figure se compose d’une peau percée de trois trous. Ceux des yeux n’existent pas. Celui de la bouche, parfaitement rond et de la grosseur d’une noisette, est au-dessous, naturellement, de ceux des narines, de la grosseur d’un pois. Cette infortunée est évidemment tombée la figure dans le feu.
Mais ce lugubre spectacle est bientôt remplacé par d’autres plus attrayants. Sur les toits flottent des drapeaux, aux formes et aux couleurs les plus bizarres et les plus inattendues. Ici, c’est un oiseau aux ailes déployées ; plus loin, un serpent, un dragon, un poisson énorme, de plusieurs mètres de long. Le vent s’engouffre dans sa large gueule ouverte et, lui traversant tout le corps, le maintient gonflé dans toute sa longueur, dans une position horizontale. Ses ondulations gracieuses le font ressembler à un animal vivant.
Il fait chaud, et peu à peu les coulis qui nous traînent ont modifié leur costume. Dans les villes, ils sont aujourd’hui tenus à une certaine décence, et par les plus grandes chaleurs ils portent une sorte de veste en toile très légère. Mais dès qu’ils sont dans la campagne, ils s’empressent de se mettre le torse à nu. Heureux quand ils bornent là le déshabillé de leur costume, car souvent on en rencontre dont tout le vêtement consiste en une paire de sandales en paille tressée et une bande de toile roulée en corde qui a jusqu’à présent suffi à la décence japonaise.
Il est vrai que, pour atténuer leur nudité, ils ont eu, jusqu’à ces dernières années, recours au tatouage. J’ai vu des gens couverts de dessins multicolores au point de ne laisser à aucune partie de leur corps, en dehors de la figure, la couleur naturelle de la peau.
Se faire tatouer était même devenu très à la mode parmi les Européens, il y a quelques années, dans l’empire du Soleil Levant. Il avait suffi pour cela de l’exemple d’un prince européen de sang royal, qui, à ce que l’on raconte, de retour d’un voyage au Japon, portait sur son corps toute une chasse au renard. Seigneurs et valets à cheval, armés de flèches et de lances, sont à la suite des chiens. On Les voit traverser montagnes, torrents, plaines, forêts ! Mais, heureusement pour maître renard, un refuge s’offre à ses yeux ; il y pénètre. Plus de la moitié de son corps a disparu dans l’asile qu’il a trouvé : il était temps, car les chiens ne sont qu’à quelques pas.
Je n’ai pas été appelé, je dois l’avouer, à contempler ce chef-d’œuvre, mais, faisant un jour une pleine eau avec un officier de la suite de ce prince, quelle ne fut pas ma surprise de le voir transformé en aquarium ! Tous les poissons de la création semblaient s’être donné rendez-vous sur son corps. Il y en avait de toutes les couleurs qui se jouaient au milieu des plantes aquatiques les plus diverses,
La route est ravissante : partout de la verdure, des fleurs, de l’eau qui murmure sous le feuillage et finit par former un ruisseau qui alimente plusieurs moulins successifs, tous placés dans des sites pittoresques. Nous traversons un bois de bambous. Ce sont des bambous comestibles : on en mange les jeunes pousses, mets aussi apprécié des Japonais que des Chinois. Ces bambous, hauts d’une dizaine de mètres, forment, avec leurs têtes entrelacées qui se rejoignent des deux côtés de la route, un long tunnel de verdure.
Maintenant nous descendons la montagne : un cortège vient en sens inverse. Nous distinguons sur les côtés des agents de police, sérieux sous leur uniforme à l’européenne. Au centre, des hommes et des femmes que l’on conduit à la ville, chargés de chaînes. Sont-ce des criminels ou simplement des gens qui ont un procès ? C’est le premier convoi de prisonniers que nous croisions. Nous en verrons bien d’autres en Sibérie.
Une maison de thé est sur le bord de la route. Nos coulis ruisselants de sueur s’y arrêtent pour s’éponger, prendre du thé et causer un peu.
Le génerikcha est un moyen de locomotion charmant quand on voyage seul. On peut admirer à son aise, modérer ou presser l’allure de son coursier par de simples paroles, au besoin faire avec lui un petit bout de causette. Mais quand on est plusieurs, la conversation est impossible entre voyageurs. On marche comme les canards, en file indienne. Il faut attendre un arrêt dans une maison de thé pour se communiquer ses impressions.
Nous faisons le tour de celle-ci, un peu pour passer le temps et nous dégourdir les jambes, car elle n’a rien de bien remarquable. Un chien européen, probablement perdu par son maître, vient en remuant la queue se faire caresser. La pauvre bête a reconnu des compatriotes.
Une jeune fille apporte à Marie des fraises des bois dans une assiette en feuilles. « Ce sont, dit-elle, les premières fraises de l’année. » À Changhaï, à l’Hôtel des Colonies, on nous avait également servi les premières fraises de l’année. On nous en offrira en Corée, puis, bien plus tard, sur les bords du lac Baïkal, et toujours avec cette dénomination de primeur, également exacte partout où on nous la donne.
En effet, plus nous montons vers le nord, plus la végétation est en retard. À Nikolaïevsk nous verrons dans un mois d’ici des framboisiers sauvages, et c’est à peine s’ils auront des feuilles.
Elles n’ont pas grand goût, ces fraises, et sont tout juste mûres, elles sont présentées d’une façon si avenante ! Nous les payons généreusement.
À midi nous arrivons à Mogué, sur le bord de la mer. Le rivage est couvert de bateaux de pêche, tirés avec Le plus grand soin sur le sable. C’est aujourd’hui fête et les pêcheurs et reposent où du moins ne travaillent pas. Ils font des joutes, des régates. Nous voyons des embarcations bondées de monde se poursuivre, mais sans grand entrain. Nous verrons mieux en Corée.

Mignard s’était chargé du déjeuner. Il fouille le garde-manger de l’auberge, découvre quelques langoustes et nous promet une mayonnaise soignée. Hélas ! il ne peut trouver d’autre huile que celle qui sert à alimenter les lampes, et dont les indigènes, de même que les Chinois, sont très friands. Ils La nomment huile odorante, nous lui donnerions volontiers le nom contraire : question de goût.
Comme cuisiniers, les Japonais sont loin de valoir les Chinois. Mignard le sait et nous quitte sous prétexte d’aller aider la cuisinière. Il est fort gai, Mignard, et à en juger par les éclats de rire que l’on entend partir de la cuisine, je crains bien que le déjeuner ne soit pas préparé avec assez de sérieux.
Enfin nous nous mettons à table. Tout est très propre, les mousmés qui nous servent sont avenantes, le paysage est ravissant, qu’importe le reste ! C’est égal, si jamais je voyage encore avec Mignard, il ne s’occupera de la cuisine que lorsque la cuisinière sera du même sexe que lui.
Nous rentrons à Nagasaki par le même chemin, et à 5 heures 1/2 nous sommes à bord du Tokio-Maru. Le capitaine est sur le pont et nous affirme que nous patirons à 6 heures. Il avait compté sans l’inexactitude orientale.
À 6 heures, il n’avait pas encore ses papiers. À 7 heures, il se promenait sur le pont, murmurant des paroles probablement fort dures pour ceux qui les retenaient, À 8 heures, nous étions tous au même diapason. À 9 heures, c’était un concert d’imprécations contre la compagnie, lorsqu’une embarcation accoste. Un tout petit bonhomme, coiffé d’une casquette à galons d’or, monte d’un air enjoué, remet les papiers au capitaine, et, avec cet accent particulier qu’ont les Japonais quand ils parlent une langue étrangère, s’en va en nous souhaitant en anglais une bonne traversée,
Notre colère s’était évanouie : deux minutes après, nous étions en route.
Le Tokio-Maru est beaucoup moins luxueux que le Kobe-Maru, mais par un gros temps c’est sur lui que je préférerais me trouver. Il est moins large et doit mieux tenir la mer. Il ne jauge que 1360 tonneaux.
Le capitaine Kenderdine, qui le commande, est un homme très doux. Dans ce voyage, il à avec lui ses deux petites filles, qui vont prendre un peu l’air de la mer. Mais comme il faut quelqu’un pour avoir soin d’elles et que les règlements japonais n’autorisent pas les femmes des officiers à monter sur le bateau que commande leur mari, le capitaine a emmené sa belle-mère. L’aimable dame nous annonce elle-même la chose très gaîment et ajoute que cela ne doit pas nous effrayer, car elle est dans les meilleurs termes avec son gendre, avec lequel elle a déjà fait de nombreuses traversées.
Ces déclarations faites avec humour brisent la glace des premiers moments, et nous commençons une vie de famille qui va durer une dizaine de jours.
Avec M. Startseff et nous, il n’y a, comme passagers, qu’une dame russe allant à Vladivostok.
Cependant M. Startseff n’a pas perdu son temps à Nagasaki, il a fait des acquisitions pour son île. Il nous montre entre autres choses un ravissant petit coq blanc et sa poule. Il a payé les deux bêtes dix piastres. C’est un prix énorme, mais quand il s’agit de meubler ou de peupler l’île Poutiatine, rien n’est trop beau, rien n’est trop cher. Il a également acheté deux serins, un mâle et une femelle. Je me demande si le climat ne sera pas trop rude pour ces deux exilés des îles Canaries.
Cependant nous arrivons à la sortie de la rade. Nous passons à gauche de ce fameux rocher de Papenberg, du haut duquel un grand nombre de catholiques furent précipités dans les flots lors des persécutions religieuses au Japon.
La nuit est splendide ; la mer, d’un calme absolu, est couverte de milliers de petites lumières qui se confondraient avec les étoiles dont le ciel est parsemé, si une large bande noire, découpée à sa partie supérieure, ne vouait les séparer et nous indiquer les montagnes qui nous entourent. Ce sont les lanternes des barques de pêche. À minuit nous en voyons encore.
30 mai. — Nous nous réveillons dans les eaux de la Corée, devant la passe qui conduit à Fou-Sane. Cette passe est d’un accès difficile et dangereux. Par gros temps et par brouillard il est téméraire de s’y aventurer. À midi nous sommes à l’ancre dans la rade.
Trois ports seulement, en Corée, sont ouverts au commerce étranger. Ce sont d’abord Tchemulpo, sur la côte ouest, à une quarantaine de kilomètres de Séoul, la capitale du royaume. Puis, sur la côte est, Fou-Sane au sud et Yuen-Sane au nord.
Les douanes y sont régies par des Européens détachés du service des douanes maritimes chinoises et nommés par sir Robert Hart, sous la direction duquel les deux services se trouvent.
Presque tout le commerce extérieur est entre les mains des Japonais et des Chinois sur la côte ouest, et des Japonais seulement sur la côte est.
La poudre d’or, les fourrures, de légers tissus de soie, une sorte de papier très solide, qui remplace en Chine les carreaux de vitres, et surtout la racine de ginseng, que les Chinois considèrent comme fa panacée et payent presque au poids de l’or, sont les principaux produits d’exportation de la Corée.
IV
Fou-Sane.
L’arrivée d’un vapeur à Fou-Sane est un événement. C’est à peine s’il en vient deux par semaine. Aussi voyons-nous bientôt paraître à bord le sous-directeur de la douane. Il est désireux d’avoir des nouvelles du monde extra-fousanien, et d’acheter au maître d’hôtel du Tokio-Maru quelques provisions fraîches.
Nous le connaissions de longue date. C’est Le fils du poète norvégien Björnson. Il est enchanté de retrouver des amis et nous offre de nous faire les honneurs de la ville. Nous acceptons à dîner pour le soir, et descendons tous à terre.
Fou-Sane possède une concession japonaise, sur laquelle se trouvent le consulat de l’empire du Soleil Levant, la douane, les bureaux et magasins de la compagnie Nippon Yuecsan Kaisha, à laquelle appartient le Tokio-Maru, et un assez grand nombre de boutiques de toutes sortes.
La concession est beaucoup moins propre et beaucoup moins pittoresque que les villes japonaises. Les maisons sont cependant plus larges qu’à Nagasaki.
Björnson nous conduit d’abord chez lui. Sa maison n’est pas grande, mais elle est très bien arrangée. On y sent l’homme qui doit vivre en ermite. Sous un hangar, dans un coin sombre, est perché un énorme grand-duc, attaché par la patte. C’est l’heure de son repas. On lui apporte deux gros rats vivants. Il les saisit par la tête et les avale d’un seul coup, sans même se donner la peine de les tuer. Il paraît que dans une heure ou deux il se débarrassera des poils et de la peau. Nous n’attendons pas cette seconde partie de l’opération.
La concession est adossée à une colline assez élevée, couverte de beaux arbres, mais dont l’accès est interdit aux promeneurs. Une barrière en bois l’entoure. Au sommet est un petit temple. Contentons-nous, comme tout le monde, de faire Le tour de ce lieu sacré.
Nous traversons d’abord le marché aux poissons. Sur de longues cordes sèchent au soleil des queues et des ailerons ou nageoires de requin. Il y en a une telle quantité que nous nous imaginons voir le produit de la pêche d’au moins une année. Mais quelle n’est pas notre stupéfaction, en arrivant au bord de l’eau, de trouver étendus sur le rivage et privés de leur queue et de leurs nageoires plus de deux cents requins, tout frais, rapportés la nuit dernière par les pêcheurs rentrant avec la marée !
Une pareille abondance de ces mangeurs d’hommes nous donne une idée du danger que l’on court en se risquant, même à proximité des rivages, en eau trop profonde. Et nous, qui si souvent nous sommes baignés pleine mer sur les côtes de Chine, du Japon et de Corée ! Je me promets bien de ne plus recommencer.
Quelques-uns de ces requins ont près de trois mètres.
De temps en temps, des Coréens arrivent avec des perches en bambou, achètent un de ces squales, pour presque rien, et l’emportent à deux ou quatre, suivant sa grosseur. Ils vont le saler et s’en nourrir. Je ne les envie pas. Car, si les ailerons sont un mets fort recherché, et, ma foi très bon, lorsqu’ils sont accommodés par un cuisinier chinois, la chair elle-même répand une odeur d’urine absolument repoussante. J’ai pour principe de goûter à tout et j’avais essayé du requin sur les côtes de Bornéo en 1869. Dans mes voyages j’ai mangé bien des choses extraordinaires, mais rien d’aussi répugnant.

Si le requin est la terreur des mers qui baignent les côtes, le tigre n’est pas moins à redouter dans l’intérieur du pays, surtout à mesure que l’on s’avance vers le nord, où on le dit très commun. Beaucoup plus grand que celui des Indes et de Cochinchine, il possède une fourrure bien plus épaisse et plus longue, dont il a besoin pendant les froids de l’hiver.
Chaque province doit fournir tous les ans au roi de Corée un certain nombre de peaux. C’est aux gouverneurs à se les procurer peu à peu, et lorsque arrive l’époque de les envoyer à la capitale, s’il leur en manque quelques-unes, en peu de jours ils les obtiennent. Voici de quelle façon.
Ils choisissent un pic élevé, en forme de pain de sucre et bien dénudé à la partie supérieure. Puis ils ordonnent à mille ou quinze cents soldats, armés du traditionnel fusil à mèche et d’un gong en cuivre, de cerner la montagne et d’en faire l’escalade méthodiquement, en frappant sur leur gong. Ils sont toujours sûrs de lever au moins un ou deux tigres, qui, effrayés par le bruit des gongs, se dirigent vers le sommet de la montagne, et qui, arrivés à la partie dénudée, avant de s’y engager cherchent à rebrousser chemin. Mais le cercle des chasseurs s’est rétréci, le bruit des gongs est plus épouvantable que jamais, et le ou les tigres finissent par gagner la plus haute partie du pie, où ils sont le point de mure de tous les soldats, qui, à un signal donné, font une décharge générale.
Le fusil coréen est le même que celui des Chinois. Il est à mèche et se charge par la gueule. On verse d’abord la poudre, puis on met la balle. Aucune bourre, ni entre la poudre et la balle, ni sur la balle. En sorte qu’il faut toujours maintenir le fusil la gueule en l’air ; autrement la charge tomberait à terre avec autant de facilité qu’elle est entrée dans le canon. Un bassinet placé sur le côté contient un peu de poudre mouillée sur laquelle vient s’appuyer le feu d’une mèche serrée dans un levier mobile, que l’on fait manœuvrer avec l’index de la main droite. On conçoit qu’il soit difficile à un seul homme, ou même à plusieurs, d’affronter avec de pareilles armes le terrible fauve. Les gouverneurs ont l’armée sous leurs ordres et ils s’en servent.
Le tigre disparaîtra peu à peu de la Corée, à mesure que le pays se civilisera. Le requin sera, lui, bien difficile à détruire. Il a l’immensité de l’océan pour vivre et se reproduire : le marché de Fou-Sane en fournira toujours aux amateurs une égale quantité.
Cependant, nous nous dirigeons vers la grande rue, où se trouvent les magasins japonais : nous entrons, sur la recommandation de Björnson, dans la boutique d’un confiseur renommé, pour acheter quelques sucreries pour les dames. Tout à coup M. Startseff avise deux armoires en bois blanc, qui servent à l’artiste à mettre son sucre à l’abri des mouches. Elles n’ont rien de remarquable, mais il n’y a pas d’armoires à Poutiatine : cela suffit pour que notre ami songe à s’en rendre acquéreur. Il a quelque difficulté à faire comprendre au confiseur ébahi que c’est le contenant qu’il veut acheter et non le contenu. Tout s’arrange : les armoires partiront avec nous sur le Tokio-Maru, en compagnie d’une foule d’ustensiles de ménage récoltés à toutes les escales. Car c’est en effet un ménage qu’il monte sur une très grande échelle.
Comme nous devons rester quarante-huit heures à Fou-Sane, nous remettons à demain notre promenade : il commence à se faire tard, et Björnson ne veut pas faire attendre son cuisinier.
Après un fort bon dîner, dans lequel nous nous félicitons de voir que le requin ne figure pas, nous rentrons à bord dans l’embarcation de la douane par une mer splendide, tandis qu’à terre de nombreuses lanternes aux couleurs variées simulent une illumination en notre honneur.
C’est aujourd’hui le 5 de la cinquième lune, c’est-à-dire l’une des trois plus grandes fêtes de l’année pour les Annamites, les Chinois et les Coréens. On doit régler tous ses comptes, payer toutes ses dettes, recouvrer toutes ses créances… si c’est possible ! Les rues sont donc très animées, même la nuit, car on à jusqu’à minuit pour payer, et les monts-de-piété très affairés. Les règlements de compte ne se font pas toujours sans de violentes discussions, étant donné surtout que bon nombre de créanciers et de débiteurs ont, selon la coutume, bien mangé et surtout bien bu.
Sur la rade, il y a eu des sortes de régates. Des embarcations indigènes passaient et repassaient devant le Tokio-Maru deux à deux, luttant de vitesse. Nos officiers, bons juges en la matière, prétendaient qu’elles faisaient au moins douze milles à l’heure. Elles étaient bondées d’hommes complètement nus, accroupis dans le fond du bateau, chacun tenant à deux mains une pagaie à une seule palette, battant l’eau avec ensemble et régularité, en poussant des cris sauvages, tandis qu’à l’arrière, le capitaine, debout, le corps penché en avant, frappait à coups redoublés sur un énorme gong en cuivre pour leur donner le mouvement.
Nous avons également observé toute la journée deux ou trois grandes jonques de pêche qui ont croisé dans la rade. Nous les avons vues aller faire escale devant les différents villages dont nous apercevons les huttes rondes de tous les côtés. À mesure que la nuit approchait et devenait plus sombre, ces jonques se sont éclairées, des lanternes aux couleurs voyantes ont été suspendues aux cordages sans aucune symétrie. Sillonnant la rade en tous sens, ces trois bateaux semblent s’être donné rendez-vous autour du Tokio-Maru. Nous entendons des gémissements plaintifs partir de ces pseudo-gondoles. Ou nous explique que ce sont des chants. C’est lugubre ; du reste, les gondoliers sont absolument ivres. Ils ont fait des libations à toutes les escales, et ils comptent sans doute sur nous pour la bonne bouche, car ils nous demandent de l’eau-de-vie. Nous refusons d’accéder à leur prière ; alors ils nous menacent et poussent des cris qui ne nous émeuvent guère. Je jette un coup d’œil dans l’un des bateaux, qui s’était fait une sorte de rouf en nattes. C’est répugnant. Des êtres absolument nus sont entassés les uns sur les autres, dans la position où l’ivresse les a fait tomber, tandis qu’à côté, ceux qui peuvent encore remuer hurlent pour avoir de l’eau-de-vie, en agitant lourdement les bras. Notre capitaine se contente d’ordonner de tenir ces bateaux à distance, puis nous allons nous coucher. Il est plus de minuit quand les cris cessent, c’est-à-dire quand tout le monde est ivre mort, car les bateaux sont toujours là ; personne n’est capable de les diriger. Mais la mer est splendide. Même en Corée, il y a un bon Dieu pour les ivrognes.
(La suite à la prochaine livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[14],
IV
Fou-Sane (suite).
l fait un temps superbe,
nous retournons à terre
dans la matinée. Il y a
beaucoup de monde
dans les rues et dans
les magasins ; les fêtes
sont terminées et chacun
s’est remis au
travail.
Les Coréens aiment les vêtements de couleurs très claires. Les mandarins portent de la soie légère, généralement bleu tendre. Mais comme ils se croiraient déshonorés de se servir de leurs dix doigts pour autre chose que pour écrire, ils conservent leurs habits assez propres. Il n’en est pas de même des gens du peuple, qui sont habillés invariablement de toile blanche, quel que soit leur métier, et qui ne changent guère de vêtements que quand ceux qu’ils portent les quittent. Il est inutile, je crois, d’insister sur l’aspect que présentent la plupart des Coréens qui n’ont pas l’honneur d’appartenir à la classe aristocratique des lettrés.

C’est la forme du chapeau, en crin noir tressé, qui indique le rang social : celui des mandarins est un tronc de cône, celui des simples particuliers une demi-sphère. Une autre coiffure assez originale est celle que portent les hommes en deuil de leur père ou de leur mère. Elle consiste en une vaste cloche en fin bambou, recouverte de papier huilé. Cette cloche peut avoir jusqu’à 50 centimètres de profondeur et 80 de largeur. Au cou est attachée une petite pièce de toile carrée, de la grandeur de nos mouchoirs, munie, aux deux angles d’en bas, de deux baguettes en bois. Le Coréen en grand deuil ne doit pas laisser voir sa figure pendant trois ans, et lorsqu’il rencontre quelqu’un, il doit s’empresser de saisir de chaque main une des baguettes et de relever le carré de toile à la hauteur de ses yeux.

Les Coréens sont, en général, d’assez beaux hommes, aux traits réguliers, à la figure énergique. Leurs cheveux sont noirs ; ils doivent les porter séparés par une raie sur le milieu de la tête et tressés en une longue natte qui pend par derrière comme chez les jeunes filles en Chine, jusqu’à leur mariage. Après cette cérémonie, les cheveux sont relevés en chignon sur Le sommet de la tête.

Nous arrivons devant une auberge et nous entrons pour la visiter. Il faut nous baisser pour passer par porte. À l’intérieur tout est sordide. La terre battue est jonchée de débris de toutes sortes, et une odeur fétide se dégage de ce taudis. La moitié de la chambre est occupée par un poêle horizontal sur lequel les voyageurs s’étendront pour la nuit, pressés comme des sardines.

Deux femmes se trouvent dans un petit réduit séparé : probablement l’épouse et la fille du patron de l’établissement. Elles portent le costume d’intérieur des femmes du peuple. J’ignore s’il est le même pour les grandes dames. Ce costume se compose d’une jupe assez ample dont l’étoffe est simplement froncée à la partie supérieure et fixée à une ceinture très large qui vient s’arrêter au-dessous des seins, puis d’une courte casaque à manches qui couvre les épaules et s’arrête à un pouce au-dessous des aisselles. Il existe donc autour du corps une bande d’une vingtaine de centimètres complètement à nu : bande qui peut permettre à certaines femmes de se montrer fières de ce que probablement beaucoup d’autres seraient désireuses de couvrir. Toutefois, quand elles sortent, les femmes coréennes sont plus vêtues. Celles de la classe aisée portent un long voile blanc qui cache même en partie la figure.
Dans notre promenade, nous en rencontrons cinq : elles s’arrêtent et paraissent au moins aussi intéressées par notre présence que nous par la leur. La route est solitaire, de gros arbres nous protègent contre les regards indiscrets, ou du moins nous le croyons et nous nous admirons mutuellement. Elles sont habillées de toile blanche des pieds à la tête, et propres, ce qui est extraordinaire. Peut-être ont-elles changé de vêtements hier, à cause de la fête. Elles ne sont ni jolies ni gracieuses, mais au moins ne semblent-elles pas farouches.

Tout à coup un grognement terrible suivi d’imprécations vient les tirer de leur extase. Elles reprennent leur route, en pressant le pas, serrées Les unes contre les autres, suivies de près par leur seigneur et maître qui vient d’apparaître et les chasse devant lui, ne cessant de les invectiver. Pauvres créatures ! J’espère qu’elles n’auront pas été trop sévèrement châtiées pour avoir cédé à un mouvement de curiosité bien naturel à des femmes qui sortent peut-être trois fois par an de chez elles.
Nous allons rendre visite à M. Hunt, directeur de la douane, et à sa femme. Leur maison est située à une certaine distance de la concession, sur une colline. De leur véranda on à une vue ravissante, mais ils m’ont l’air bien exposés aux typhons, si fréquents dans ces parages. En sortant de chez eux, pour regagner le bord, nous rencontrons encore cinq femmes coréennes. J’ai mon appareil et je voudrais les photographier. Nous nous arrêtons pour parlementer, trois prennent immédiatement la fuite ; les deux autres, plus courageuses, nous écoutent et, après quelques hésitations, consentent à ce que nous demandons, mais à une condition : elles n’ont jamais vu d’intérieur européen, on leur fera visiter la maison de M. Hunt. Celui-ci, qui est avec nous et qui parle très bien le coréen, y consent de grand cœur. Les deux femmes me regardent avec une certaine inquiétude préparer mon appareil. Il est évident qu’elles ne sont qu’à demi rassurées ; pour se donner du courage elles se tiennent par la main. Quelques hommes arrivent. Pour ne pas effrayer les femmes, je les laisse se mettre à côté d’elles. Quand je leur dis que tout est fini, elles poussent un soupir de soulagement et paraissent étonnées d’en être quittes à si bon marché ; elles nous regardent d’un air méfiant, et c’est seulement quand on les fait entrer dans la maison qu’elles commencent à se convaincre qu’en ne s’est pas moqué d’elles.

Avoir pu parvenir à photographier des femmes en Corée était une chance inespérée, et je rentre à bord très satisfait de mon excursion. Le temps devient désagréable et nous ne pouvons plus songer à aller à terre. Nous pêchons à la ligne sans grand résultat. Quatre lamproies plus allongées et encore plus hideuses à voir que celles d’Europe sont notre seul butin.
Enfin le 1er juin nous faisons nos adieux à MM. Hunt et Björnson, et à 10 heures du soir nous quittons Fou-Sane. Il a fait évidemment un temps abominable hier, car la houle est assez forte, malgré le calme de l’air.
V
De Fou-Sane à Vladivostok.
2 juin. — La mer est moins agitée ; nous suivons les côtes de la Corée sans les perdre de vue. C’est à peine si nous apercevons quelques bateaux de pêche. Mais en revanche nous voyons quantité de souffleurs et de baleines. Une de ces dernières suit la même direction que nous, semblant lutter de vitesse avec le Tokio-Maru, puis soudain elle passe à une cinquantaine de mètres à l’avant, le corps presque hors de l’eau, et disparaît. Elle pouvait avoir une quinzaine de mètres de longueur.
Nous marchons doucement. Inutile de nous presser et d’arriver dans la nuit à Yuene-Sane, notre prochaine escale.
Le 3, vers 5 heures du matin, nous étions devant cette admirable baie de Port Lazareff dans laquelle Les plus gros cuirassés trouveraient un mouillage parfait et un abri sûr. Cette rade immense serait, paraît-il, très facile à défendre contre les attaques de flottes ennemies. Elle offre en outre l’énorme avantage d’être libre de glace toute l’année. C’est pour cela qu’on prête généralement aux Russes l’idée de s’emparer de Port Lazareff : la chose est en effet bien tentante.
Ce n’est certes pas la Corée qui pourrait opposer la moindre résistance à sa puissante voisine. La valeur militaire de ses troupes, du reste peu nombreuses, ne paraît pas bien redoutable. Quant aux sentiments de la population, je m’imagine que dans le nord du royaume ils sont plutôt favorables que contraires à la Russie, et cela pour plusieurs raisons. La Corée, malgré sa réputation de pauvreté, est un pays riche, fertile, mais dont la population, dure à la fatigue, est minée par deux choses : les exactions des mandarins, d’une part, et Le discrédit attaché aux travaux manuels de l’autre. L’ouvrier coréen qui travaille dans son pays n’est jamais sûr de recevoir la totalité de sa paye, et s’il la reçoit, il aura à en verser une bonne partie aux mandarins petits et grands, sous une forme ou sous une autre. Il sera en outre considéré avec mépris par tout ce qui tient un pinceau, la plume de l’Extrême-Orient.
Au contraire, dans le gouvernement de Vladivostok les Coréens sont bien traités, bien payés pour leur labeur. Aussi en voit-on un grand nombre dans la ville, occupés au chargement et déchargement des navires, au transport des marchandises dans les rues et à tous les travaux de portefaix. Nous en avons rencontré jusque dans les environs de Tchita, la capitale de la Transbaïkalie, habillés à la russe, vivant au milieu des Cosaques et semblant presque avoir renoncé à leur nationalité.
À 6 heures, nous mouillons dans la rade de Yuene-Sane, qui se trouve à l’entrée de la baie de Port Lazareff, à une assez grande distance du rivage. Je profite de l’embarcation de la douane pour descendre à terre, M. Startseff m’accompagne. Il est anxieux d’avoir des nouvelles de son bateau : il en reçoit de bonnes.

Le directeur de la douane est un Suédois, Oisen, que je connais depuis de nombreuses années. Naturellement nous devons déjeuner et dîner chez lui. J’accepte avec plaisir, et pendant que M. Startseff m’entraîne pour fouiller les boutiques, Oisen se dirige vers le Tokio-Maru pour aller chercher Mme Vapereau. Le vent est fort ; il souffle du large, et la mer est agitée. Les deux passagers, un peu mouillés par les embruns, sont heureux de sentir la terre sous leurs pieds.
La maison du directeur de la douane est la dernière du village ; plus loin ce sont des cultures, puis des montagnes élevées.
Le pays est, paraît-il, infesté de tigres, et la nuit on ne sort jamais sans lanterne. Le terrible animal visite souvent les habitations. Il rôde autour des étables, des maisons, et malheur aux gens, aux bestiaux qui ne sont pas bien enfermés. Oisen m’a assuré avoir entendu à plusieurs reprises le tigre, la nuit, sous sa véranda, renifler et gratter à sa porte. On trouvait le matin la trace de ses pas. Pendant la journée il ne s’aventure pas dans la ville. Nous pouvons donc, sans crainte de le voir apparaître, nous mettre à table, car on annonce que le déjeuner est servi.
Les huîtres de Yuene-Sane sont très renommées. Il n’y a pas d’r dans le mois, mais on nous assure que, dans ces pays très froids, les huîtres se mangent en toute saison. Nous nous risquons et nous nous en trouvons fort bien. Elles ne valent pas cependant nos marennes où nos cancales. J’en dirai autant des poissons, qui dans l’Extrême-Orient sont bien inférieurs à ceux d’Europe.
Pendant l’été, Oisen tire ses provisions de Vladivostok. Mais lorsque la navigation cesse, à l’hiver, il lui faut vivre sur le pays et manger du poulet deux fois par jour !
Séoul, la capitale de la Corée, est à 150 kilomètres, c’est-à-dire à six jours de marche. Si l’on met aussi longtemps à franchir cette petite distance, c’est parce que par peur du tigre, on s’arrête dès que le jour baisse.
Nous allons nous promener dans la direction du village coréen. Je prends mon appareil, qu’un indigène consent à porter sur un crochet dans le genre de ceux de nos commissionnaires.
Une hutte isolée se trouve sur notre route, trois hommes sont à la porte. Consentiront-ils à ne pas bouger ? J’avais appris autrefois la langue coréenne, pensant que lorsque le pays, alors fermé aux étrangers leur serait ouvert, cette connaissance pourrait mètre utile. Mais il y a près de quinze ans de cela. Je rassemble mes souvenirs, les Coréens sont surpris d’entendre un Européen parler leur langue, cela les intéresse, et tout s’arrange.

Le pays paraît fertile et est assez animé. Çà et là une case solitaire, pus un village qui ressemble à une agglomération d’énormes ruches d’abeilles. Au fond et pas bien loin, de hautes montagnes.
C’est la seconde fois que nous venons en Corée. Il y a quelques années, nous avons deux fois fait escale à Tchemulpo. Malheureusement une épidémie terrible de choléra décimait à ce moment la population. De plus c’était au milieu de la saison des pluies, les communications étaient difficiles, et à notre grand regret il nous fut impossible de pousser jusqu’à Séoul. Un matin je fis cependant une longue promenade à cheval, et ce que je vis du pays me fit regretter de ne pas en voir davantage.
À 11 heures nous rentrons à bord, après avoir mangé chez Oisen des fraises dont il était très fier : « Les premières fraises de l’année », annonça-t-il ! À minuit nous partons par un temps splendide. La mer est calme, le ciel étoilé, et nous disons adieu à la Corée.
Dimanche, 6 juin. — C’est vers 6 heures du matin que nous devons arriver à Vladivostok. Les officiers du Tokio-Maru qui, en bons Anglais, détestent cordialement les Russes et tout ce qui est russe, ne nous en ont pas moins recommandé d’être sur le pont de bonne heure, pour ne pas manquer l’entrée de la rade : ce doit donc être bien beau ! Avant l’heure indiquée, je suis sur la passerelle. Il fait un froid très vif. Du reste, à mesure que nous montions vers le nord, nous avions été obligés de modifier successivement notre costume.
Bientôt les côtes se dessinent, nous apercevons une ombre à l’est. C’est l’île Poutiatine, la nouvelle acquisition de M. Startseff. Elle a 28 kilomètres de tour. Il se propose d’y faire de l’élevage. Il a fait venir à grands frais de tous les pays du monde toutes les choses susceptibles de vivre ou de croître dans son royaume : vaches et chevaux de Russie, arbres à fruits des États-Unis, etc. Mais il compte surtout sur les moutons qui lui arrivent de Mongolie.
Le mouton ne vit ni en Corée ni au Japon. On a essayé à bien des reprises de l’y acclimater. M. Starseff prétend qu’une certaine herbe qui croît dans ces contrées, mais dont son île est exempte, les empoisonne, qu’il a d’ailleurs, depuis un an, une trentaine de moutons qui sont en parfait état.
Il est certain que si le mouton peut vivre à Poutiatine, ce sera pour son propriétaire une source de revenus considérables. Nous en avons mangé pour la dernière fois en quittant Changhaï. On en importe bien au Japon, mais en si petit nombre que c’est un objet de luxe, et nous n’en mangerons plus que par hasard, dans un mois d’ici, quand nous nous rapprocherons de la Mongolie.
Les amis de M. Startseff sont loin d’avoir son enthousiasme. D’après eux, cette île ne peut être pour lui qu’une distraction l’aidant à employer les loisirs que lui laisse son commerce du thé. Il a payé Poutiatine une quinzaine de mille francs au gouvernement russe, il y en dépensera deux ou trois cent mille, mais n’y fera rien de pratique à cause des brouillards, si fréquents au sud de Vladivostok et pour ainsi dire perpétuels entre Vladivostok et Nikolaïevsk.
M. Startseff n’est pas de cet avis. Il considère qu’il a fait un bon placement et qu’il travaille dans ce moment-ci pour ses enfants. Sa propriété a au moins ce grand avantage d’être une île, c’est-à-dire d’être à peu près à l’abri des nombreux échappés du bagne, qui sont souvent la terreur de la terre ferme dans ces parages.
Les Russes sont très fiers de la rade de Vladivostok. Ils lui donnent le nom de Corne-d’Or. Est-ce en souvenir de Constantinople ?

Si étranger que l’on soit à l’art militaire, on se convainc aisément que, pour peu qu’il soit défendu, Vladivostok est imprenable par la mer, et que s’il n’était pas bloqué par les glaces pendant quatre mois de l’année, il serait facile d’en faire un des plus beaux ports de guerre du monde.
La rade représente en effet une sorte de corne ou de croissant fermé à une extrémité et adossé à une montagne élevée. On pénètre par l’autre pointe, qui forme une passe étroite devant laquelle se trouve la grande île Russe qui la masque complètement.
Quel admirable point de vue et quel merveilleux changement de décor ! On suit le détroit qui conduit à la pointe ouverte. À droite est la terre ferme, à gauche l’île Russe. On s’imagine être dans une énorme rivière qui s’étend à perte de vue. L’île est couverte d’arbres, Çà et là des tentes réunies révèlent la présence de nombreux soldats. Elle est très élevée au-dessus du niveau de la mer : c’est une vraie montagne. Au sommet, je crois distinguer des travaux indiquant la présence de forts, et l’on m’assure que ces forts existent. Sur l’île et sur la terre ferme, qui est moins élevée, la végétation est luxuriante. Juin est, pour ces parages, le printemps dans toute sa force. On dirait que les végétaux savent qu’ils n’ont que peu de temps à vivre et qu’ils en profitent.

Tout à coup, sur la droite, apparaît une ouverture de quelques centaines de mètres. C’est l’entrée de la Corne-d’Or : Nous y pénétrons, et notre regard embrasse en un instant la plus grande partie de la rade. Vladivostok est devant nous, au fond, en amphithéâtre, sur le flanc de la montagne, que les maisons ne couvrent qu’en partie. À gauche, un plateau assez élevé, entièrement dénudé, et surmonté de grands bâtiments à l’aspect sévère et triste. Ce sont les casernes. À droite, des magasins, des entrepôts de charbon. À mesure que nous avançons, l’autre partie de la Corne se découvre, et nous apercevons dans le fond le dock flottant construit depuis peu d’années.
Cependant, avant d’aller à notre mouillage, il faut attendre la visite de la Santé, Nous arrivons du Japon et de la Corée, pays où le choléra existe presque en permanence, nous sommes à bon droit suspects. Ce n’est que le commencement des ennuis que le choléra nous causera. Ces ennuis n’ont cessé qu’à Paris, où, je ne sais combien de temps après notre arrivée, nous étions encore sous la surveillance de la police et obligés d’aller, tous les trois jours, déclarer à la mairie que nous n’étions pas encore morts.
Le Tokio-Maru est bientôt entouré d’une multitude d’embarcations conduites presque toutes par des Chinois de la province du Chane-Toung, qui, de même que les Japonais et les Coréens, arrivent dès l’ouverture de la navigation pour ne s’en aller qu’à la fermeture. L’hiver, Vladivostok est mort. La glace atteint jusqu’à un mètre d’épaisseur dans la rade. Il neige rarement, mais un vent de nord-ouest très violent provoque une sécheresse extrême, fort agaçante pour les nerfs. Les habitants ne sortent de chez eux que quand ils y sont forcés. Du reste, leurs maisons sont admirablement installées pour le froid. De grands poêles, la plupart du temps en maçonnerie et ayant une face ou un angle sur quatre pièces, entretiennent une chaleur uniforme dans toute la maison. De doubles vitres aux fenêtres, qui souvent sont clouées, offrent une barrière infranchissable au froid du dehors. Aussi jamais les chambres ne sont-elles aérées. Les Russes doivent être d’une autre constitution que la nôtre, et leurs poumons se contenter de moins d’oxygène que ceux des Européens de l’Occident. Une des choses qui n’ont été le plus désagréables dans tout le voyage, c’est le manque d’air dans certaines maisons.
C’est au plus fort de l’été que nous avons traversé la Sibérie. Dans Les plus petits villages, les plus pauvres demeures étaient presque toutes ornées de fleurs superbes, de fleurs que nous considérons comme des plantes de serres chaudes fort difficiles à conserver, venant du Japon ou des tropiques : palmiers, caoutchoucs, gloxinias, etc. Toutes ces plantes adossées aux vitres font un rempart qui empêche d’ouvrir la fenêtre. Dans beaucoup de maisons, l’air ne peut se renouveler que par la porte, quand quelqu’un entre ou sort.
C’est aujourd’hui la Pentecôte, d’après notre calendrier, mais d’après celui des Russes, c’est la « Troïtza », que notre dictionnaire traduit par Trinité. Dans tous les cas, c’est un « Praznik », jour de fête, et les jours de Praznik sont chose fort sérieuse pour le voyageur, comme on le verra plus tard. Ils servent bien souvent à vous faire manquer de chevaux, à vous procurer un cocher ivre, si vous ne voulez pas vous contenter d’un enfant pour conduire votre tarantass, enfin à vous faire payer quatre roubles ce qui n’en vaut qu’un.
Tous les navires sont pavoisés et couverts de branches de feuillage. Il y en a jusqu’en haut des mâts, jusqu’au bout des vergues, dans les cordages, dans les embarcations ; c’est fort joli. En ville, tous les magasins sont fermés. C’est ce qui explique l’affluence de monde autour du Tokio-Maru et sans doute aussi le retard de la Santé à venir nous autoriser à débarquer.
Bientôt il devient impossible d’empêcher l’invasion. Nos officiers ont beau prévenir que nous sommes des pestiférés, que tous ceux qui mettront le pied à bord seront obligés de partager notre quarantaine, rien n’y fait. Notre pont se couvre de visiteurs. On a dit que personne ne descendrait, mais je vois que la consigne n’est pas faite pour tout le monde, car des gens nous quittent qu’on ne songe pas à inquiéter. Fermons les veux, ils portent un uniforme.
Enfin tout est en règle, et nous sommes libres d’aller à terre. C’est maintenant que vont commencer les vraies difficultés du voyage. Nous sommes à l’extrémité est de l’ancien continent, et nos parents, notre patrie, nos amis sont à l’extrémité ouest, et c’est là qu’il s’agit d’arriver.
Certainement, dans les grandes villes nous trouverons des gens parlant le français, l’anglais et l’allemand. Mais en cours de route, dans les villages, il ne faut compter que sur le peu de russe que nous connaissons, et sous ce rapport notre bagage n’est pas bien lourd. Tout cela, nous le savions depuis longtemps : on nous dit sur le Tokio-Maru : « Revenez avec nous ! » Cette proposition nous fait sourire. Nous sommes partis avec la ferme intention de traverser la Sibérie, et nous la traverserons,
Le capitaine Kenderdine nous prévient qu’à Vladivostok il n’y a pas d’hôtel acceptable, mais que nous pouvons rester à bord jusqu’au départ du Tokio-Maru, à raison de trois dollars par jour pour le logement : la chose est prévue par la Compagnie, qui a elle-même fixé le prix de la pension.
M. Startseff est à terre depuis longtemps. Vieil ami de M. Cheveleff, le plus grand négociant de Vladivostok, chez lequel sa chambre est préparée, il a promis de le prévenir de notre arrivée. Nous sommes nous-mêmes recommandés, par nos amis de la légation de Russie à Pékin, à M. Cheveleff, chez qui je dois trouver les premiers fonds pour continuer notre route.
Cependant, un jeune homme monte à bord et parle à un officier, qui me désigne de la main. Il s’avance vers moi et m’adresse la parole en russe. Je réponds en français et la conversation commence. Son français est à la hauteur de mon russe : tout ira bien. Au bout d’un quart d’heure de petit nègre dans les deux langues, je sais que je suis en présence de M. Vahovitch, frère du consul de Russie à Tien-Tsin, qu’il est envoyé par M. Cheveleff, chez lequel il est employé, pour nous inviter à déjeuner, et qu’il viendra à midi se mettre à notre disposition pour nous conduire à terre.
Voilà un bon début et qui promet. À l’heure dite, nous sommes prêts et foulons enfin pour la première fois le sol du plus grand empire du monde
VI
Vladivostok.
On ne peut imaginer un homme d’aspect plus avenant que M. Cheveleff. Petit de taille, plutôt fort, toujours en mouvement, la figure épanouie, il nous reçoit avec la plus grande amabilité. Il s’exprime très correctement en anglais. Mme Cheveleff, sauf en ce qui concerne l’amabilité, est tout le contraire de son mari : grande, élancée et très calme. Elle aussi parle anglais, m’a dit Marie plus tard, mais seulement quand elles sont en tête-à-tête.
Nous discutons immédiatement nos plans. Deux routes s’ouvrent devant nous pour aller gagner Habarovka, capitale de [a province, par où nous devons nécessairement passer. La première par mer, jusqu’à Nikolaïevsk, point de départ des bateaux qui remontent l’Amour d’abord, puis la Chilka jusqu’à Stretinsk, où la navigation cesse et où le trajet par terre commence.
La seconde, plus compliquée, plus fatigante, bien que beaucoup moins longue, consiste en un voyage d’une centaine de verstes, d’abord sur un vapeur de grandeur moyenne, par mer, jusqu’à l’embouchure du Souifoune, puis sur un steamer tout petit qui remonte le Souifoune jusqu’à Razdolnoï. Là, la navigation cesse provisoirement. Il faut franchir en voiture les 160 et quelques kilomètres qui séparent Razdolnoï de Kamiene-Rybalow, où l’on prend de nouveau un steamer qui traverse le lac Kanka, puis descend l’Oussouri jusqu’à Habarovka, point où l’Oussouri se jette dans l’Amour, c’est-à-dire à 470 kilomètres de Kamiene-Rybalow.
D’après M. Cheveleff, ces 160 kilomètres en voiture seront très pénibles, car la route a été rendue abominable par les dernières pluies. Dieu sait ce qu’il faut penser d’une route que les Russes déclarent abominable ! De plus, elle est dangereuse en ce moment.
Pour les travaux du chemin de fer, on a fait venir cinq ou six cents forçats de l’île de Saghaline, la Nouvelle-Calédonie russe. Nombre d’entre eux se sont échappés et ont gagné les forêts, attaquant et massacrant sans pitié tous ceux qu’ils rencontrent. En outre, on ne peut songer à acheter un tarantass pour une si petite distance, car un tarantass est chose fort chère si l’on en veut un bon, et plus les routes sont mauvaises, plus il est nécessaire qu’il soit solide. Il faudra donc jouer à chaque station de poste, c’est-à-dire tous les 20 kilomètres à peu près, une voiture nouvelle, soit téléga, soit perékladnoï, instruments de supplice dont je parlerai ultérieurement, faire ainsi à chaque station un transbordement de bagages, risquer, par un petit retard bien probable, étant donné notre peu de pratique de la langue russe, de manquer le bateau de l’Oussouri qui ne part qu’une fois par semaine, et par suite celui de Habarovka, pour remonter jusqu’à Stretinsk.
M. Cheveleff nous conseille donc le premier itinéraire. Malheureusement la navigation n’est pas encore ouverte à l’embouchure de l’Amour. La mer est toujours gelée dans la Manche de Tartarie, détroit formé par l’île de Saghaline et le continent. Il faut attendre la débâcle, qui ne peut tarder. Il y a dans le port deux ou trois vapeurs prêts à partir pour Nikolaïevsk dès qu’on croira la mer libre.
Il est nécessaire de réfléchir un peu à tout cela avant de prendre une décision. Mais en attendant, comme il nous faudra inévitablement acheter un tarantass à Stretinsk pour gagner Tomsk, qui en est distant d’à peu près 3 000 verstes (la verste est de 1 067 mètres), il me conseille de ne pas lésiner sur le prix. Rien n’est cher comme une voiture en mauvais état. Il faut constamment la réparer, c’est-à-dire être à la merci d’un forgeron ou d’un menuisier de village qui profite de ce qu’il est seul de son métier, à trois lieues à la ronde, pour vous écorcher vif ; sans parler des délais et de la crainte continuelle de rester en plant entre deux stations. Bref, il m’offre de télégraphier à son agent à Stretinsk de m’acheter le meilleur tarantass qu’il pourra se procurer d’ici un mois, sans fixer de prix. J’ai confiance, j’accepte, et je m’en suis bien souvent félicité dans la suite.
M. Cheveleff met son équipage à notre disposition pour visiter la ville, C’est la première fois que nous nous trouvons dans une voiture attelée à la russe, et cela nous intéresse.
Un cheval est dans les brancards : il ne doit jamais quitter le trot. Un autre qui marche de front avec lui et semble en liberté ne doit jamais quitter le galop. Il a la tête en dehors et au niveau de ses genoux. On dirait qu’il a pris le mors aux dents. Deux traits légers, attachés à l’essieu, et une courroie d’un mètre cinquante, fixée d’un côté au brancard et de l’autre à l’anneau de la bride, le maintiennent à côté de son compagnon.
Vladivostok ne gagne pas à être visité en détail. Les rues, qui ne sont qu’une succession de montées et de descentes, suivant le flanc de la montagne sans s’inquiéter des accidents de terrain, sont mal entretenues. Des flaques d’eau les émaillent, et la boue qui les environne indique que ces flaques sont là depuis longtemps. La voirie laisse beaucoup à désirer. Nulle part on ne s’est mis en frais d’architecture.
Les maisons sont disséminées, la plupart construites en bois et peintes des couleurs les plus variées. Les casernes sont en briques rouges, mais véritablement d’une trop grande simplicité. L’église avec ses clochetons ressemble à toutes les églises russes que nous avons vues ensuite. Aucune animation dans les rues.
Je ne puis m’empêcher de comparer Vladivostok à Hong-Kong, qui est également construit sur le flanc de la montagne, et j’ai le regret de constater que Vladivostok ne soutient pas la comparaison. Cette impression est conforme au témoignage même de hauts fonctionnaires russes qui donnent pour excuse la jeunesse relative de la ville. J’espère comme eux qu’ils sauront tirer parti, tant au point de vue du beau et du pittoresque qu’au point de vue militaire, de l’admirable situation qu’ils ont entre les mains. Mais ils ont beaucoup à faire : d’abord amener de l’eau en quantité suffisante pour la consommation ; puis surtout s’occuper des rues, qui sont dans un état d’abandon lamentable.
Un autre sujet de regrets pour nous est l’aspect de ces montagnes dénudées, autrefois couvertes d’arbres splendides que la prévoyance des chefs aurait dû disputer à la paresse des subordonnés. Il en est de même dans toute la Sibérie. Un village se fonde au milieu d’une forêt ; les habitants qui ont besoin de bois pour construire leurs maisons, pour se chauffer, abattent tout ce qui est sous leur main. Le déboisement fait la tache d’huile, et souvent on se demande comment les gens sont allés s’établir au milieu d’un désert. Le désert, c’est eux-mêmes qui l’ont fait. Il existe, au bord de la mer, un jardin public, dernier débris des antiques forêts, conservé maintenant avec un soin jaloux. C’est ce qu’il y a de plus beau dans Vladivostok, dont le nom veut dire « Souveraine de l’Orient » et dont on pourrait si facilement faire la « Perle de l’Orient ».
Près du quai, à côté du jardin, se dresse un arc de triomphe en l’honneur de la visite du Tsarevitch. Les habitants de Vladivostok en sont très fiers et le proclament le plus beau de tous ceux qui ont été élevés sur le passage du futur empereur. En Sibérie, chaque ville, chaque grand village à le sien, et chacun m’a été montré par les gens du pays comme le plus beau. Je ne sais à qui décerner le prix. Respectons les illusions de tous.
Nous rentrons. L’heure du dîner est arrivée et nous passons dans la salle à manger. M. Cheveleff prend place au bout d’une immense table préparée pour une vingtaine de personnes. Je suis à sa droite et M. Startseff à sa gauche, puis viennent une demi-douzaine de messieurs. Mon voisin est un homme d’un certain âge, il me fait de grandes politesses, mais sans jamais m’adresser la parole. Évidemment il se méfie de mon russe. Je regrette de ne pouvoir causer avec lui, car il est très sympathique. En face du maître de la maison est sa sœur, Mme Sakina, femme charmante, qui fait tous ses efforts pour augmenter nos connaissances dans sa langue. À côté d’elle, Marie, puis Mme Cheveleff ; à sa gauche, d’autres dames. Bref, nous sommes partagés en deux camps : côté des hommes, côté des dames.
Contre le mur, parallèlement à la able, est une grande console, chargée des hors-d’œuvre les plus divers : au milieu un magnifique saumon frais, puis jambon, saucissons variés, viandes froides, etc. C’est la zakouska, prélude inévitable de tout repas russe. Chacun se lève, son assiette et sa fourchette à la main, et revient prendre sa place avec une montagne de provisions. Invités à faire comme tout le monde, nous allons à la console et nous prenons une petite tranche de saumon et du caviar. On s’étonne de notre modération, mais nous comptons sur le dîner et nous ne voulons pas avoir l’air d’affamés. Fatale erreur dans laquelle nous nous sommes bien promis de ne plus retomber. Cette zakouska, que l’on fait précéder d’un verre de vodka, ou eau-de-vie, constitue la partie importante du repas. Ensuite vient la soupe, un plat de viande et un plat sucré. Quand on est prévenu, c’est plus que suffisant, mais il faut l’être.
6 juin. — À 500 mètres de nous est mouillé le Pamyat-Azowa, ce magnifique cuirassé que l’on devait admirer l’année suivante à Toulon pendant les fêtes franco-russes. Le commandant en chef de l’escadre de l’Extrême-Orient, l’amiral Tyrtotf, est à bord. J’avais eu l’honneur de lui être présenté à Pékin et de dîner avec lui chez le comte Cassini, ministre de Russie. Il m’avait promis de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour nous faciliter le voyage, tout en nous disant : « Quand je vais en Europe, moi, je prends les Messageries maritimes ».
Le capitaine Kenderdine eut l’amabilité de mettre à ma disposition une de ses embarcations pour me permettre de me présenter dignement devant l’amiral. Celui-ci me reçut avec la plus grande cordialité. Il attendait ma visite, et je lui remis le portrait du comte Cassim, que ce dernier m’avait chargé de lui apporter. Lui aussi me conseille de renoncer à l’idée de partir par l’Oussouri ; il me confirme les craintes de M. Cheveleff au sujet des attaques possibles de forçats échappés du bagne, et me promet, si nous nous décidons à passer par Nikolaïevsk, de nous donner des lettres pressantes de recommandation pour le chef de la police, M. Picard, homme fort aimable et qui parle français. Il fait en outre briller à mes yeux la perspective de visiter l’île de Saghaline, la Nouvelle-Calédonie russe. Cela me décide, nous aurons de plus le plaisir de remonter l’Amour dans toute sa longueur, de partir de la mer d’Okhotsk pour arriver à l’océan Atlantique. Il est bien évident que les routes sont encore moins sûres que d’habitude, et que les autorités n’ont pas envie de voir se renouveler l’accident, si présent à la mémoire de tous : un officier de la Marine française assassiné aux portes mêmes de Vladivostok par des forçats échappés, des Brodiagues, comme on les nomme en russe.
M. Cheveleff nous emmène de l’autre côté de la rade faire une promenade dans les bois, à la recherche du muguet. Depuis notre arrivée nous voyons partout du muguet, et par bottes énormes, entre les mains de tous les promeneurs. L’air en est embaumé, et puis nous n’en avons pas vu depuis huit ans. Il est beaucoup plus beau, plus vigoureux et, je crois, plus odorant que celui d’Europe.
M. Cheveletf a de l’autre côté de la rade un dépôt de charbon, et un de ses employés, M. Kousinoff, y vit avec sa femme et ses filles. Mais leur solitude n’est que relative, car nous trouvons dans le salon onze dames en train de prendre le thé. Ce sont des amies qui sont venues passer l’après-midi à la campagne.
C’est ici que nous avons vu pour la première fois combien un ou une Russe peut absorber de thé et manger de gâteaux sans perdre son appétit pour les repas. Le thé russe est si bon, si bien fait, qu’on se laisse toujours tenter. On n’y met généralement pas de lait, mais une mince tranche de citron. Il se prend dans de grands verres et non dans de petites tasses. Un seul de ces verres nous suffit encore, et l’on s’en étonne. Dans deux mois, hélas ! les jours de famine, on aurait pu nous en voir prendre comme eux quatre et cinq de suite. La zakouska avec toutes ses salaisons a évidemment pour but de réveiller l’estomac, que tous ces litres de liquide doivent forcément engourdir.
Presque toutes les dames fument. Des cigarettes sont sur la table dans une boîte, mais aucune n’en prend, car chaque fumeur, homme ou femme, a dans sa poche son petit étui à papiros, c’est-à-dire à cigarettes.
La réputation du tabac russe n’est plus à faire. Mais ce que l’on ne sait peut-être pas, c’est qu’en Russie il y a au moins autant de crus de tabac qu’il y a de crus de vin en France. Chacun a adopté une marque et une forme de cigarettes qu’il fume à l’exclusion des autres. Il y en a de grosses comme des cigares et de minces comme des allumettes.
Chacun fabrique les siennes. On trouve partout les tubes en papier munis d’un petit carton pour le côté à mettre dans la bouche, à raison de six kopeks le paquet de cent. Ces tubes sont fermés du côté opposé au petit carton. On met un paquet sur la table, l’ouverture en l’air, et l’on frotte du tabac bien sec qui pénètre peu à peu et que l’on tasse avec un petit morceau de bois jusqu’à hauteur voulue. Un léger tampon d’ouate empêche le tabac de s’échapper. Il faut un quart d’heure pour faire cent cigarettes,
Le tabac eu Russie est à très bon marché : pour deux ou trois roubles la livre on en a d’excellent. Or pour le moment le rouble vaut à peu près 2 fr. 60. Il y a 100 kopeks dans un rouble : les droits sur le tabac sont donc insignifiants, et, étant donné le nombre des fumeurs, si le Tsar mettait un impôt sérieux sur cette consommation de luxe, il aurait bien vite les sommes nécessaires à la construction du grand Transsibérien.
Nous rencontrons des marins en permission, Ils sont chargés de bottes de muguet, qu’ils m’offrent à 5 kopeks la pièce. J’en prends deux superbes. En arrivant à bord je m’aperçois que tout le monde a eu la même idée. Le salon en est embaumé ! Il faut avoir soin d’ouvrir une claire-voie pour que nous ne soyons pas asphyxiés pendant la nuit.
Le soi chez M. Cheveleff, mêmes places à table ; mon voisin est toujours silencieux, mais aujourd’hui nous avons fait honneur à la zakouska.
Je parle d’essence de muguet. Cela suffit pour lancer M. Startseff sur une nouvelle piste. Son île est remplie de muguet, il va en faire de l’essence. Puis-je lui donner une recette ? Je lui donne celle de l’eau de fleur d’oranger : il traitera ses muguets par le même procédé ! S’il réussit, je prends un brevet !
7 juin. — Je déjeune chez l’amiral Tyrtoff, à bord du Pamyat-Asowa, avec tout son état-major. Le médecin en chef de l’escadre fait des études sur le fusil Lebel, dont il possède un exemplaire. Il me montre trois plaques, l’une en cuivre, de 0 m. 014, l’autre en acier de 0 m. 006, et la troisième en plomb, sur lesquelles il a tiré. Les résultats sont prodigieux. Il a également tiré sur des chevaux morts, pour étudier les blessures produites par la balle,
L’amiral va chercher Marie pour visiter le cuirassé, chose toujours fort intéressante, même pour les profanes. Cette exquise propreté, cette discipline, cette énorme quantité d’hommes dans un si petit espace où tous sont occupés comme les abeilles d’une ruche, ces monstres en acier qu’une seule main peut faire mouvoir, monter, descendre, basculer, tout vous impressionne.
L’amiral Tyrtoff nous conduit partout : il est fier de son bateau et il a raison. C’est le Parnyat-Azowa qui a eu l’honneur de porter le Tsarevitch dans son voyage par mer d’Europe à Vladivostok. Il a été aménagé en vue de son auguste passager, c’est-à-dire avec luxe et confort.
Pendant le lunch qui suit la visite, la musique de l’amiral donne un concert. Nous entendons successivement des airs russes et des airs français, Il me semble que les musiciens sont plus nombreux qu’on ne les voit généralement sur les navires, et ont été choisis avec grand soin : probablement encore à cause du Tsarevitch.
Le Pamyat-Azowa fait de fréquents exercices de torpilles dans la rade. Rentrés à bord du Tokio-Maru, nous avons la chance d’assister à un de ces exercices. Rien n’est intéressant comme de suivre des yeux le petit flotteur que traîne une embarcation à vapeur à grande vitesse. Un bruit d’air comprimé qui s’échappe retentit, et l’on voit la torpille s’élancer des flancs du cuirassé et se diriger rapidement vers le flotteur.
Je trouve curieux de photographier le Pamyat-Azowa au moment où la torpille quitte le bord.

Je n’ai pas encore parlé du chemin de fer qui doit un jour relier Vladivostok à Brest, parce que malheureusement je n’ai presque rien à en dire, ou plutôt j’aurais trop à dire. En principe, le chemin de fer est décidé. Il a été annoncé, et les travaux ont été commencés. J’ai raconté plus haut que pour ces travaux on avait amené des forçats de l’île de Saghaline. Il fallait bien montrer à l’héritier de l’Empire que les choses étaient en bonne voie. On en fit onze verstes, puis, comme les forçats s’évadaient en grand nombre et que leurs méfaits terrifiaient Le pays, on les réintégra dans le bagne.
Le Tsarevitch put voir le chemin de fer, put même faire onze verstes en wagon, en juin 1891. Mais s’il revenait maintenant, en juin 1892, il trouverait les mêmes onze verstes ni plus ni moins, et les chantiers en moins bon état qu’il y a un an : c’est tout.
Voilà ce que chacun nous dit ici, en le déplorant. Il est certain que la ligne de Vladivostok à l’Oussouri s’impose, et que le jour où on s’y mettra sérieusement, elle sera facile à terminer en peu de temps. Mais ce ne sera qu’une bien petite amorce. Le chemin de fer a été un de nos grands sujets de conversation pendant le voyage. Nous arrivions de la tête de ligne, et on nous interrogeait avec intérêt sur l’état des travaux, que l’on croyait en général beaucoup plus avancés.
Quant à l’itinéraire que suivra la voie, on en est encore, en Sibérie, dans la plus profonde ignorance, De nombreux projets sont à l’étude, mais rien n’est jusqu’à présent décidé, à ce que l’on m’affirme. D’abord, il y a la question financière. Les six cents millions qui devaient servir à la construction du Transsibérien ont été employés à soulager les misères causées par la famine. De hauts personnages m’ont raconté qu’une société française aurait proposé de construire la ligne à ses frais, si on voulait lui concéder la propriété, de chaque côté de la voie, d’une bande d’une verste de terrain, où elle exploiterait à son gré toutes les richesses du sol. Cette condition n’aurait pas été acceptée.
Le Transsibérien est donc encore un peu trop dans les nuages pour qu’il soit nécessaire de nous y arrêter beaucoup. Des amorces cependant seront faites, comme celles de Vladivostok à l’Oussouri. Quant à la ligne entre Tchita et Irkoustsk, qui doit contourner l’extrémité sud du lac Baïkal, j’espère vivre assez pour apprendre qu’elle est terminée ; c’est tout ce que je puis dire[23].
On me donne le conseil de faire traduire en russe mon passeport français, qui cependant porte le visa du consulat de Tien-Tsin. On me dit qu’en Sibérie ma langue est peu connue et qu’une traduction certifiée conforme me sera d’une grande utilité. Va pour la traduction. Quand vous arrivez dans un hôtel, votre passeport vous est immédiatement demandé, et est sur-le-champ envoyé à la police, qui ne vous le rend qu’au moment même de votre départ,
À ce propos, je me demande pourquoi les autorités françaises ont choisi pour le passeport le plus abominable papier que la France puisse produire. C’est une pièce que l’on doit pouvoir mettre dans son portefeuille, et pour cela il faut la plier en huit. Or avant mon départ de Pékin les plis présentaient déjà de larges fentes. Je laisse à penser dans quel état il est arrivé à Paris : tous les bureaux de police de l’empire russe lui ont mis des charnières en papier gommé.
On nous annonce que le Vladimir, vapeur de 600 à 700 tonneaux, partira dans la nuit pour Nikolaïevsk. Mais on ajoute qu’outre son chargement il y aura à bord 600 Cosaques qui rentrent en Russie, ayant fini leur temps de service dans l’Extrême-Orient. La perspective d’une si nombreuse société sur un petit bateau n’a rien de gai. Nous savons que la Manche de Tartarie n’est pas encore libre, et le Vladimir ne part que parce qu’il compte sur une débâcle probable, mais non assurée : la durée de [a traversée est incertaine. Ajoutez à cela que la navigation est pénible et même dangereuse dans ces parages, où les brouillards durent quelquefois des semaines entières. Mais nous ne voyageons pas pour avoir toutes nos aises.
Nous prendrons donc le Vladimir, si aucune autre occasion ne se présente.
Chez M. Cheveleff, nous apprenons que le Vladivostok partira également demain pour Nikolaïevsk. C’est un bon bateau, de la même grandeur que le Vladimir ; il n’aura pas 600 Cosaques passagers : nous faisons immédiatement transporter nos bagages.

9 juin. — Nous assistons au départ de M. Startseff pour Poutiatine. Son petit steamer est encombré : d’abord lui, puis le personnel du bateau, des domestiques chinois, deux jardiniers, des ouvriers de différents métiers, des caisses à n’en plus finir, les fameuses armoires de Fou-Sane, les serins, les poules, un magnifique étalon qui lui arrive de Russie, etc. Il attend un troupeau de vaches et un autre de juments dont le télégraphe lui a annoncé le passage récent à Irkoutsk. Bon succès à notre colon. Il a été si aimable pour nous, qu’il nous est impossible de ne pas nous intéresser à ses travaux. Nous tâcherons d’aller lui rendre visite quelque jour.
Le Vladivostok doit part à 2 heures. J’ai le temps d’aller faire une visite d’adieu à l’amiral Tyrtoff, qui me dit avoir télégraphié à M. Picard. Puis nous allons déjeuner chez M. Cheveleff, pour prendre congé. Avant de nous mettre à table, je dis quelques mots à haute voix en français à Marie. Mon voisin, le muet sympathique, se tourne vers moi comme mû par un ressort : « Comment, monsieur, vous savez le français ? Et vous le parlez sans aucun accent, ce qui est bien rare chez un Anglais. » Je m’empresse de le tirer d’erreur. « Ah ! que de temps perdu ! Voici la quatrième fois que je suis à table à côté de vous », etc. Nous nous sommes rattrapés, et il paraissait tout heureux de parler français… avec un Français. Sa méprise était bien naturelle. Toutes les fois que nous allions chez M. et Mme Cheveleff, nous ne parlions qu’anglais, par politesse pour nos hôtes, qui ne comprennent que cette langue étrangère, absolument indispensable à quiconque a des relations commerciales avec les grandes maisons du Japon et de la Chine.
On nous avait dit que l’anglais nous serait d’un grand secours pendant notre voyage. C’était une grosse erreur. Après avoir quitté Vladivostok, il ne nous a servi qu’une seule fois, à Irkoutsk, au cours d’une visite qu’est venu nous faire un marchand de bibles : un Anglais, cela va sans dire.
Par contre, j’ai eu maintes fois l’occasion de parler allemand. Car non seulement j’ai rencontré des officiers auxquels cette langue était familière, mais aussi bon nombre d’Israélites. Il y a de ces derniers dans toutes les villes. À mon arrivée en France, mon allemand, que j’avais laissé de côté depuis plus de vingt-cinq ans, m’était en partie revenu.
Il existe en Russie une coutume assez curieuse. Quand on part pour un voyage, quand on quitte pour longtemps ses amis, lorsque arrive l’heure de la séparation, tout le monde doit s’asseoir pendant une minute, et causer de la pluie et du beau temps. Puis on se lève, on se dit adieu et l’on se sépare.
Dans l’hospitalière et patriarcale demeure de M. Cheveleff, on n’a garde de manquer à cette touchante coutume, et au moment où nous nous déclarons prêts à partir pour le Vladivostok, nos hôtes nous prient très aimablement de prendre une dernière fois avec eux quelques instants de repos. Chacun s’assied donc, nous échangeons quelques paroles banales n’ayant aucun rapport avec les idées de voyage. Quelques minutes après, nous avions quitté la terre ferme.
VII
De Vladivostok à Saghaline.
Il est 6 heures et demie lorsque nous levons l’ancre. Le pont est encombré de charbon et de marchandises, ce qui rend la promenade difficile. De plus notre steamer est mal chargé, il penche beaucoup sur bâbord. Je n’aimerais pas cela du tout s’il survenait du mauvais temps. Il fait très froid, nous avons mis de gros pardessus d’hiver afin de jouir une dernière fois du beau tableau que présentent la Corne-d’Or et son entrée. Vers 7 heures et demie, nous sommes devant le phare qui est à l’extrémité nord-est de l’île Russe. La nuit est tout à fait tombée quand nous passons à côté de Poutiatine, il est impossible de rien distinguer.
10 juin. — Notre steamer s’est relevé à bâbord. On n’a brûlé toute la nuit que le charbon de ce côté. L’air est vif, mais l’atmosphère est pure. On nous avait prédit quatre jours de brouillard sur quatre jours de traversée : jouissons du répit que le ciel nous accorde. Nous suivons la côte de la Sibérie, nous maintenant à une distance d’à peu près vingt milles.
Le Vladivostok appartient à la flotte russe dite « volontaire », dont la formation remonte au traité de Berlin. La Russie, pouvant craindre, à cette époque, des complications avec l’Angleterre, acheta aux États-Unis trois paquebots susceptibles d’être aménagés en croiseurs, l’Europa, l’Asia, l’Africa. Une souscription nationale permit bientôt d’acheter où déconstruire cinq nouveaux navires. Cette flotte, bien que propriété privée, dépend du ministère de la marine, qui fournit le personnel naviguant, pris dans les cadres d’activité. Les officiers ne peuvent obtenir d’avancement de grade, mais ils trouvent une compensation dans les appointements,
La flotte volontaire reçoit une subvention annuelle de 600 000 roubles, lorsque ses navires ont accompli ensemble un parcours de 141 000 milles marins. Elle est chargée, en temps de paix, du transport du personnel et du matériel de l’État entre Odessa, Vladivostok et Saghaline. Elle se composera bientôt exclusivement de douze navires absolument neufs, aménagés spécialement pour leur double rôle militaire et commercial, filant de 17 à 18 nœuds et armés de canons de 15 centimètres.
Le Vladivostok a également eu l’honneur de porter le Tsarevitch dans son excursion sur le Yang-tsé-kiang : aussi possède-t-il un piano. La cabine aménagée pour le prince a été conservée. Ce n’est pas à nous qu’elle est échue, mais à M. Bieule, gouverneur par intérim de l’île de Saghaline, qui va rejoindre son poste avec sa femme. Il est accompagné de son frère et de trois employés. Tous, de même que les officiers du bord, sont en uniforme. Les uns et les autres parlent très bien français, et se montrent fort aimables à notre égard.
Dans toute l’étendue de l’empire, la casquette plate joue un grand rôle, sauf peut-être à Saint-Pétersbourg. C’est presque la seule coiffure admise. Un homme en chapeau produit à peu près le même effet qu’un individu en casquette sur un boulevard de Paris. J’en ai bien une, achetée au Japon, mais elle est molle et n’a pas la forme voulue. Je l’ai amèrement regretté toutes les fois que j’ai eu à faire des visites officielles.
Les employés, civils ou militaires, portent au-dessus de la visière une petite cocarde en métal, ovale pour les premiers et ronde pour les autres.
Le Vladivostok fait un service rude. C’est lui qui est chargé d’aller au Kamtchatka et dans la mer d’Okhotsk ravitailler les postes. Il revient avec un chargement de fourrures précieuses, loutres, zibelines et autres. Le commerce des loutres est un monopole de l’État, et il est presque impossible à un simple particulier de s’en procurer. C’est à Pétropavlovsk, sur la côte sud-est de la presqu’île de Kamtchatka, qu’est le centre des affaires. C’est à que l’on vient s’approvisionner de tout. Mais l’argent est rarement employé dans les transactions, qui s’opèrent au moyen d’échanges. On donne, par exemple, un bidon de pétrole pour une peau de zibeline ; de même qu’en Mongolie on achète un mouton pour une poignée de feuilles de thé. Les indigènes sont fort paresseux. Ils ne travaillent que quand ils ne peuvent pas faire autrement. Le poisson pullule dans ces parages, et ils ne se livrent pour ainsi dire pas à la pêche.
La cuisine du Vladivostok est très soignée. Les zakouskas sont délicieuses. Elles se composent de caviar exquis, de harengs à la saumure, de sardines fumées à l’huile, de poissons salés et crus, de cèpes conservés dans le sel, etc., toutes choses propres à exciter l’appétit. On nous sert du vin de Crimée fort bon.
Vers 5 heures du soir, un brouillard intense apparaît à l’horizon. Il avance vers nous avec vitesse. Nous prenons nos précautions, car nous nous attendons à un coup de vent. Il arrive en effet très fort du nord, accompagné d’une grosse pluie, et cesse au bout de dix minutes.
12 juin. — À midi, il ne fait que 6 degrés au-dessus de zéro. Vers Je soir, nous voyons des albatros. Ces gigantesques oiseaux me rappellent le cap de Bonne-Espérance et mon premier voyage en Chine, en 1869, sur un navire à voiles de 340 tonnes, la Belle Justine. Puis voici des phoques : on dirait de loin des hommes à la nage ; enfin une très grosse baleine.
Dans la nuit, Le brouillard nous enveloppe. Vers 9 heures nous savons que nous sommes près de terre, mais il nous est impossible de voir le phare. Nous sifflons, tirons le canon, faisons machine en arrière, en avant. Personne ne peut dormir à bord.
Le matin le brouillard se dissipe, et à 9 heures et demie nous mouillons devant Alexandrevsk, capitale de Saghaline.

À peu de distance de l’endroit où nous avons jeté l’ancre, trois énormes rochers pointus émergent des flots. Ils sont en ligne et assez éloignés du rivage. C’est un écueil fort dangereux pour les navires. On a donné à ce récit le nom des « Trois Frères ».
(La suite à la prochaine livraison.)

DE PÉKIN À PARIS[26],
VIII
Saghaline.
uel contraste
avec le Japon
où nous étions il
n’y a pas vingt
jours ! Où est cette
verdure luxuriante ?
Où sont
ces fleurs qui
émaillaient les
champs ?
Ici tout sent l’hiver, qui finit à peine, et tout indique la rudesse du climat. Dans le fond, les montagnes qui entourent la ville et dont la hauteur n’est cependant pas considérable, sont encore couvertes de neige. Elles viennent se terminer vers le sud-ouest par une pente douce qui descend dans la mer, formant une pointe sur laquelle se trouve un phare.
Ce n’est pas à Alexandrevsk que les navires faisaient primitivement escale, mais à une petite distance au sud, à Doui, où se trouvent les mines de charbon, dans lesquelles les travailleurs sont tous des forçats d’une certaine catégorie.
Il n’y a pas ici de rade ; par conséquent, aucune protection pour les navires en cas de mauvais temps. Une première jetée en gros madriers s’avance directement dans la mer. Elle a 30 mètres de large sur 100 de long. C’est plutôt une sorte de pont sous les arches duquel les embarcations peuvent passer. Une seconde jetée, placée perpendiculairement à la première, est munie d’escaliers ; c’est le débarcadère, en forme de T.
Comme les eaux sont peu profondes, bien que le Vladivostok soit d’un faible tonnage, nous sommes mouillés à deux verstes du rivage. Bientôt nous voyons deux petits steamers quitter le débarcadère et se diriger vers nous. Ils traînent à la remorque des chalands pour prendre les marchandises. Dans le premier, nous apercevons nombre d’uniformes. Ce sont les autorité civiles et militaires qui viennent au-devant du nouveau gouverneur, pour le féliciter de son mariage et de son avancement. Il y a en effet une année que M. Bieule a quitté Alexandrevsk, secrétaire du gouverneur et garçon. Avant de nous séparer, je prends un groupe des passagers et de l’état-major du Vladivostok. Mon petit chapeau fait tache au milieu des brillantes casquettes. Il faut commencer à m’y habituer.

Cependant les deux vapeurs accostent, et bientôt sur le pont ce ne sont qu’accolades et longs baisers sur les lèvres. Je n’ai jamais vu de gens s’embrasser comme les Russes. Ils s’étreignent, et l’on dirait à certains moments qu’ils cherchent mutuellement à s’arracher la langue avec les dents. En plus d’une occasion, je fus moi-même victime de cette effusion démonstrative. Car résister aurait été une offense d’autant plus remarquée que les baisers offerts venaient de plus haut et que partout où nous nous trouvions nous étions l’objet de la curiosité bienveillante de ceux qui nous entouraient.
Je remarque avec la plus vive satisfaction que parmi les visiteurs qui montent à bord, se trouve un homme en costume de « pékin ». Il est bien mis, élégant même, et surtout très bien fait de sa personne. Mais pas la moindre casquette : un petit chapeau melon, comme le mien. Me voilà presque réconcilié avec ma garde-robe. Je n’en suis pas moins un peu désappointé de voir qu’il n’a point de part à la distribution, cependant fort libérale, de baisers sur les lèvres. Un officier du bord me prit à part et me raconta l’histoire de ce personnage.
Il se nomme X***. C’était autrefois un des officiers les plus séduisants et les plus sympathiques de la garde impériale, à Saint-Pétersbourg. Il devait même épouser la fille d’un général fort en vue, de son pays, à laquelle il était fiancé. Malheureusement, peu scrupuleux, esclave de ses passions et doué d’une fortune médiocre, il en arriva très vite à vivre d’expédients. Il était en rapports depuis longtemps déjà avec un vieux prêteur sur gages qui finit par le traiter beaucoup plus en ami qu’en client, en dépit de la méfiance ordinaire aux gens de cette sorte.
Or, un jour qu’ils se trouvaient seuls, tous les deux, chez cet émule de Gobseck, notre officier, persuadé que les soupçons ne s’arrêteraient pas sur lui, assassina tout simplement le vieillard. La servante, entrant sur ces entrefaites, partagea immédiatement le sort de la victime. Ce drame est en tous points la mise en action de Crime et Châtiment de Dostoïewski.
Ce qu’il y a de curieux, c’est que, séduit par les manières élégantes et aimables de l’officier, le préteur, qui était sans héritiers directs, avait laissé un testament dans lequel il l’instituait son légataire universel.
Arrêté et jugé, le coupable fut condamné à dix ans de travaux forcés seulement, et envoyé à Saghaline pour purger sa condamnation. Maintenant, sa peine est finie, mais il est interné dans l’île et doit y terminer ses jours. Il fait un petit commerce et a épousé une sage-femme fort honnête, me dit-on, qui est venue d’elle-même à Saghaline pour soigner les malades. Sic transit gloria mundi ! Malgré l’éclat de ses aventures, X*** est assez bien vu à Alexandrevsk, et nombre de personnes lui ont donné la main en ma présence.
L’île de Saghaline est une longue bande de terre, située entre le 45e et le 55e degré de latitude. Elle mesure donc un millier de kilomètres entre son extrémité nord, dans la mer d’Okhotsk, et son extrémité sud, au détroit de La Pérouse. La partie septentrionale est très froide et les cultures sont impossibles au-dessus du 50e degré. Le midi est tempéré et les légumes y viennent assez bien.
Outre ses mines de charbon, on prétend que Saghaline possède des sources de pétrole, et par le Vladimir, qui est parti vingt-quatre heures avant nous, M. Cheveleff a envoyé un ingénieur chargé d’y faire des sondages et de voir si les nappes souterraines sont assez importantes pour être exploitées avec succès.
Le pays est couvert de forêts, dans lesquelles le pin domine. Ceux que nous voyons ne sont pas beaux. Serrés les uns contre les autres, ils forment des fourrés impénétrables. La population est de 20 000 habitants, en chiffres ronds. Sur ce nombre il faut compter les forçats, dont beaucoup sont mariés, et qui, avec leurs femmes et leurs enfants, forment un total de 16 000 âmes.
Deux grands pays, la Chine au nord et le Japon au sud, prétendaient avoir des droits sur Saghaline.

En effet, les Ghiliaks, sujets et tributaires de l’empire chinois, avaient pénétré par le nord de l’île, traversant la Manche de Tartarie, et fondé quelques établissements de pêcheurs. Les Aïnos, anciens aborigènes des grandes îles du Japon, successivement refoulés, étaient venus chercher un refuge dans la partie méridionale. Aïnos et Ghiliaks ont entre eux une grande affinité ; ils ont, en partie, les mêmes coutumes, et leurs habitations diffèrent peu ; mais, d’un caractère plus sauvage et se tenant plus à l’écart, les Aïnos ont mieux conservé leur primitive originalité.


La suzeraineté de la Chine et du Japon n’était nullement effective. Aucun des deux empires ne retrait le moindre profit d’une possession que du reste jamais aucun mandarin n’allait visiter. Le nord devint donc russe sans grande difficulté, à la suite de la rectification de frontières qui étendit les limites de l’empire des Tsars jusqu’à Vladivostok. Le sud fut cédé par le Japon comme compensation pour le meurtre d’un Cosaque de l’escorte du général Mouravieff à Yeddo.
Il n’y a qu’une dizaine d’années que Saghaline a été choisi comme lieu de déportation. On n’y envoie plus, m’a-t-on affirmé à maintes reprises, aucun condamné politique. C’est surtout l’assassinat qui y conduit. Tous les ans, deux grands bateaux de la flotte volontaire partent d’Odessa avec une cargaison de forçats. Le premier, au printemps, ne contient que des hommes ; le second emporte, outre les hommes, un grand nombre de femmes. Mais toutes celles-ci ne sont pas des criminelles. Il y a beaucoup d’épouses qui s’expatrient avec leurs enfants, pour partager le sort de leur mari.
La plupart des forçats sont des condamnés à temps. Leur peine finie, ils sont cantonnés pendant six années dans un district qu’il leur est interdit de quitter, et où ils restent sous la surveillance de la haute police. On leur donne des terres, des bestiaux, des instruments. Ils ont de plus quelques économies, car même durant leur temps de peine ils ont un assez joli salaire, dont un dixième seulement leur est remis pendant qu’ils sont au bagne. Ils trouvent le reste quand leur condamnation est purgée. Au bout de six ans, ils sont libres d’aller où ils veulent dans Saghaline, et souvent même de quitter l’île.
Les évasions sont très fréquentes, surtout au commencement de l’été, c’est-à-dire à peu près à l’époque où nous nous trouvons. Les moins entreprenants gagnent les forêts et y vivent misérablement de ce qu’ils peuvent y trouver, jusqu’aux approches de l’hiver, époque à laquelle ils reviennent d’eux-mêmes se livrer. D’autres plus hardis, et c’est le plus grand nombre, veulent revoir la patrie. Ils savent que le continent n’est pas très éloigné à l’ouest et se risquent sur les choses les plus invraisemblables pour y arriver. Ce matin même, six de ces malheureux ont réunit quelques troncs d’arbres avec des liens en bouleau et, profitant du brouillard, se sont aventurés sur la Manche de Tartarie. Nous voyons un petit vapeur partir à leur recherche.
Ceux qui parviennent à échapper, d’abord aux agents lancés à leur poursuite, puis aux flots de la mer, atteignent le continent, commencent alors une odyssée dont le récit devrait arrêter les autres forçats tentés de suivre leur exemple. Mais il n’en est rien.
Leur objectif, c’est leur village, là-bas, là-bas, dans l’ouest. À combien de verstes ? Ils ne s’en doutent pas. Ils marcheront jusqu’à ce qu’ils arrivent, toujours dans la même direction, parallèlement à la route, évitant les villes et les hameaux, vivant de ce qu’ils peuvent trouver dans les forêts. Les gens isolés, les femmes surtout, ont tout à craindre d’eux. Quelquefois ils se réunissent en bande et attaquent les tarantass. Quatre d’entre eux se précipitent à la tête des chevaux, puis deux de chaque côté de la voiture, et deux autres montant derrière, armés de bâtons courts, assomment les infortunés voyageurs, auxquels ils coupent immédiatement la gorge, pour plus de sûreté. Presque jamais le cocher n’est tué, ni même blessé. C’est chez ces bandits un principe, car, sachant qu’il ne lui sera pas fait de mal, le cocher se sauve sans chercher à défendre ceux qu’il est chargé de conduire.
De même, dans les villages, jamais ils ne commettent de déprédations. Sur l’appui extérieur des fenêtres, les habitants placent le soir du pain, du lait, que les forçats évadés vont prendre pour réparer leurs forces. Ils comptent sur ces provisions, et c’est une sorte de redevance au moyen de laquelle les villageois achètent la sécurité dans leurs maisons. Ils n’ignorent pas qu’à la moindre déprédation tous les habitants du hameau organiseraient sur-le-champ une battue dans laquelle ils seraient infailliblement massacrés, et que si par miracle ils échappaient à cette battue, ils n’échapperaient pas à la justice sommaire de leurs compagnons, qui les égorgeraient impitoyablement pour avoir violé le pacte tacite existant entre eux et les paysans, et exposé les évadés à ne plus trouver ces provisions sans lesquelles leur long voyage ne pourrait s’effectuer.
Les tigres, les ours, les panthères, les loups, en tuent un grand nombre. D’autres meurent d’épuisement, de froid, se noient en traversant les rivières, sont assassinés par leurs confrères, tués par les villageois ou les voyageurs. Cependant quelques-uns parviennent à franchir les milliers de kilomètres qui séparent Saghaline de leur pays. Ils arrivent après trois ou quatre années de marche, de dangers de toutes sortes, dans leur village, où ils sont le plus généralement repris et réexpédiés à Saghaline. C’est sur eux qu’il faut avoir le plus les yeux ouverts, car ils ne pensent qu’à une chose : se sauver de nouveau.
Les chalands sont le long du bord. Ils viennent chercher les marchandises et nous apporter du charbon. Il y a sur chacun d’eux une douzaine de forçats pour les manœuvres, pour aider à l’embarquement et au débarquement. Ils sont tous très chaudement vêtus. Je n’ai jamais vu pareille collection de mines patibulaires. Beaucoup d’entre eux ont tout un côté de la tête rasé : ce sont les plus dangereux, ceux qui ont déjà tenté de s’évader. Généralement leur figure est énergique et leur regard sombre.
D’autres possèdent une longue barbe inculte, une mine bestiale. L’un d’eux monte à bord, chargé d’un fardeau. C’est un véritable colosse : on se sent instinctivement porté à reculer quand il passe. Quelques nez crochus indiquent une origine sémitique.
Sur chaque chaland se trouve un seul Cosaque, sabre au côté et revolver à la ceinture. Pas le moindre fouet, le moindre bâton. Nous avons certes vu beaucoup de forçats dans notre long voyage et jamais nous n’avons été témoins d’un acte sérieux de brutalité.
Sur les bateaux à vapeur également, rien que des forçats ou des libérés n’ayant pas encore terminé leur temps d’internement ; mais ils sont choisis parmi les plus intelligents et les plus soumis. Il en est de même, à terre, des cochers et des serviteurs : leur apparence ne décèle nullement leur position sociale, ils ont tous l’air d’honnêtes ouvriers. Sur Les bateaux à vapeur je ne vois aucun Cosaque ni garde-chiourme.
Cependant le préfet d’Alexandrevsk, M. Taskine, me propose de visiter la ville. Il met à ma disposition son propre drojki et donne ordre au cocher, forçat naturellement, de me conduire chez lui après m’avoir fait voir les environs.
Sur la jetée, qui forme débarcadère, se trouvent des rails et des wagonnets pour le transport des marchandises jusqu’à la ville ; qui n’est qu’à une verste environ. De nombreux forçats conduits par des Cosaques armés chargent, déchargent et traînent ces wagons. Quelques-uns ont les pieds entravés. Hane constate avec horreur que parmi ces criminels se trouvent deux de ses compatriotes : il en est tant soit peu humilié. Tous les forçats que l’on rencontre ne manquent jamais d’ôter leur chapeau et de saluer.
Mon drojki file comme le vent. Évidemment le cocher veut me montrer son savoir-faire. Bientôt ses chevaux s’emballent, et ce n’est qu’à l’entrée de la ville qu’il parvient à Les reprendre en mains.
Alexandrevsk est peu étendu. C’est une ville qui se fonde ; l’église même est loin d’être terminée. Les maisons sont peu nombreuses, mais spacieuses et bien aménagées. Autour de la ville sont des habitations beaucoup plus petites où vivent les forçats libérés encore soumis à l’internement. On y trouve aussi les femmes et les enfants qui sont venus à Saghaline partager l’exil de leur père forçat.
Cependant nous arrivons chez M. Taskine, qui me présente à sa femme. Mme Taskine, comme son mari, parle admirablement notre langue. Elle est ici depuis trois ans. C’est une charmante blonde, au teint de lait, sur l’esprit de laquelle ni la monotonie d’une vie forcément peu accidentée, ni cet entourage un peu effrayant de malfaiteurs plus ou moins séquestrés et dont un grand nombre même sont fibres, n’ont paru avoir la moindre influence fâcheuse. Elle est fort gaie et paraît enchantée de voir un étranger, chose rare à Alexandrevsk ! Elle attendait le Vladivostok avec impatience ; car Mme Bieule a dans ses caisses un chapeau pour elle, et ce n’est pas une petite affaire que l’arrivée d’un chapeau dans ces contrées où les modistes manquent ! Le bagne, pour le moment, n’en possède aucune.
Tout en prenant le thé et les gâteaux, je lui demande quelles peuvent être ses distractions et comment se passent ici les longues soirées de ces longs hivers, L’été, elle monte à cheval avec son mari. L’hiver on reste forcément à la maison. Quatre ou cinq fois seulement, il y a un bal, où le nombre des danseurs est très restreint. Tous les autres soirs, on se réunit pour jouer au vint, variété du whist. En Russie les hommes sont très joueurs ; mais, d’après ce que j’ai entendu dire, les femmes ne leur cèdent en rien.
Je demande à visiter le bagne, et M. Taskine veut bien m’y conduire lui-même. Je ne pouvais avoir un meilleur cicerone. En quelques minutes nous y arrivons. C’est une importante construction en troncs d’arbres superposés horizontalement, comme presque toutes les constructions non seulement de Saghaline, mais de Sibérie. Les pierres, la chaux, la brique, sont des choses dont on semble avoir ignoré jusqu’ici L’existence.
Ces murailles en bois ne me paraissent pas un obstacle très sérieux pour les gens décidés à s’évader. Du reste la surveillance n’a pas l’air de s’exercer d’une façon très active, et il y a pour cela plusieurs raisons. On compte d’abord sur la situation géographique de l’île, sur l’immensité de l’océan Pacifique à l’est, et à l’ouest sur ces solitudes presque sans bornes, rendues plus terribles et plus désertes encore par la rigueur du climat, que doit traverser le forçat parvenu à gagner le continent. Puis, sur dix qui s’échappent, neuf périssent d’une façon ou d’une autre. C’est donc plutôt un débarras dont il n’y a pas lieu de gémir outre mesure ; car, comme il n’y a pas à Saghaline de déportés politiques, celui qui parvient à s’échapper n’est, aux yeux de l’administration, qu’un criminel sans conséquence pour l’Empire.
De là le peu de diligence que l’on montre généralement en Sibérie pour arrêter les vagabonds. C’est un fait admis de tout le monde dans les pays que nous avons traversés, que les autorités prennent en somme assez peu de précautions pour prévenir les évasions des condamnés de droit commun, et ne font rien pour reprendre les évadés. Patience ! nous verrons plus loin les résultats de ce beau système.
Les cours du bagne sont spacieuses. Au milieu de l’une d’elles est le pavillon dans lequel sont enfermés les dangereux, les indisciplinés, ceux qui ont déjà une ou plusieurs évasions ou tentatives d’évasion à leur actif. Un long couloir entre la chambrée et la muraille extérieure forme un chemin de ronde dans lequel des sentinelles montent la garde, car c’est bientôt l’heure du repas et les forçats sont de retour du travail.
Une porte à triple et quadruple verrou est au milieu du chemin de ronde. On l’ouvre, et j’entre le premier, suivi de M. Taskine et du geôlier.
Jamais je n’oublierai cette minute, La salle dans laquelle nous avons pénétré est carrée. En face de la porte, des fenêtres assez larges laissent passer beaucoup de lumière. Non seulement ces fenêtres sont fermées, mais je ne vois même aucun moyen de les ouvrir. Un énorme poêle qui s’allume de l’extérieur donne encore un peu de chaleur. On le chauffe toutes les nuits, et nous sommes dans la seconde moitié de juin. Un grand lit de camp en planches, adossé aux murs et en plan incliné, fait le tour de la pièce.
Au premier moment, j’ai de la peine à respirer. Je ne suis pas encore habitué à cette chaleur sèche des poêles russes dans une chambre de grandeur moyenne, bien que très élevée d’étage, mais hermétiquement close, dans laquelle quarante-deux êtres humains ont respiré pendant une heure. Je me demande avec horreur combien il doit rester d’air respirable quand arrive le matin, après les longues nuits d’hiver ! Comment ces infortunés n’étouffent-ils pas ? Question d’habitude et de tempérament, peut-être.
À notre vue, tous se lèvent, et un morne silence s’établit. La vue de ces malheureux m’oppresse tout aussi bien que le manque d’air. J’oublie que chacun d’eux a au moins un assassinat à se reprocher, pour ne penser qu’à l’horreur de leur condition. Je finis cependant par adresser quelques questions à M. Taskine, en français bien entendu, et les regards se portent sur moi ; ils expriment la curiosité.
Tous ces hommes sont chaudement vêtus. Beaucoup ont la tête rasée d’un seul côté. Tous ont les pieds entravés, et quelques-uns les mains. J’apprends que plusieurs d’entre eux ont travaillé au chemin de fer de Vladivostok. Peut-être ont-ils pris part aux assassinats qui ont terrifié le pays.
Cependant le geôlier qui nous accompagne se plaint en russe de quelques hommes, qui aussitôt s’avancent et répondent vivement. Leur regard est loin d’être celui de la soumission ; on dirait plutôt celui de la révolte. M. Taskine leur impose silence. Ils se taisent enfin, probablement devant des menaces que je n’ai pas comprises, mais ils ont l’aspect hargneux du lion dans sa cage, qui grince des dents devant la cravache du dompteur, sur lequel il n’ose s’élancer.
Nous allons ensuite visiter d’autres dortoirs. Ils ressemblent à celui que nous venons de voir, très élevés d’étage et très bien éclairés, mais ils sont plus spacieux. Ils contiennent la nuit soixante forçats.
Les dortoirs sont propres et bien tenus. Il en est de même de la salle d’infirmerie. Nous n’y trouvons qu’une quinzaine de gens indisposés, ou plutôt de fainéants qui ont réussi à se faire dispenser de la corvée. Un bâtiment spécial est affecté aux maladies graves.
Comme dans tous les pénitenciers, il y a des cachots noirs. Construits en madriers superposés, ils sont tous placés côte à côte, et la crainte des punitions est l’unique chose qui puisse empêcher les conversations de s’établir entre les prisonniers.
Un seul est habité pour le moment. Nous le faisons ouvrir et nous voyons apparaître un homme barbu à la figure repoussante. Ses yeux hagards supportent difficilement la lumière, à laquelle ils ne sont plus habitués, depuis quarante-huit heures qu’il est enfermé dans cette boîte carrée. Il a volé un de ses camarades et de ce fait est puni de trois jours de cachot.
Dans chaque dortoir j’ai remarqué sur une table, à l’entrée, un certain nombre de bouteilles de lait, du pain blanc, des verres. Ce sont, paraît-il, de petites douceurs que le règlement permet aux forçats de s’offrir avec le dixième de leur salaire journalier, qui leur est remis quotidiennement. Le vin (ou plutôt la vodka) est formellement interdit. Néanmoins il en entre toujours quelque peu, malgré les châtiments sévères qu’encourent ceux qui désobéissent.
Non loin des cachots est une chambre entièrement nue. Dans un coin, adossé au mur, je vois un faisceau de branches flexibles de coudrier de 1 m. 50 de long ; à côté on me montre une large planche de la hauteur d’un homme. L’une des extrémités est coupée en équerre et munie de deux trous carrés, l’autre est en demmi-lune. Sur chacun des côtés, deux échancrures se faisant face. Il est évident que je suis en présence d’un instrument de répression. Les baguettes de coudrier dispensent mon guide de longs commentaires.
Cette planche sert à attacher le patient ; dans les deux trous s’enfoncent ses pieds, dans la demi-lune son menton. Les échancrures sont pour fixer les cordes qui le maintiennent immobile, et on le passe aux verges.
Une tentative d’évasion est punie de cinquante coups. C’est ce châtiment qui attend chacun des six malheureux évadés ce malin, si on parvient à les reprendre.
Les cuisines sont spacieuses et, pour la propreté, feraient honneur à n’importe quel chef en Europe. On y voit plusieurs énormes chaudrons en cuivre, qui servent à préparer le repas pour les neuf cents forçats que contient pour le moment le bagne.
Le dîner est prêt, on m’offre d’y goûter. Le chef plonge dans une des énormes marmites une énorme cuiller à pot, et me verse dans une assiette une large portion de l’unique mets qui compose le menu. C’est une soupe au poisson salé dans laquelle la chair même du poisson est émiettée par la cuisson : c’est loin d’être mauvais.
Dans la boulangerie, grande animation. On travaille du matin au soir à la fabrication du pain. Car, comme je l’ai dit plus haut, il n’y a pas moins, pour le moment, de neuf cents forçats, et à chaque forçat on donne trois livres et demie de pain en été et quatre livres en hiver. Ce qui fait un total de plus de trois mille livres par jour. Rien-ne se fait à la machine, les ouvriers doivent donc être nombreux : les uns pétrissent, les autres cuisent, d’autres rangent le pain qui sort du four sur de grandes étagères à claire-voie, pour le laisser rassir. Ce pain, fabriqué avec d’excellente farine de seigle, serait trop indigeste s’il était mangé frais.

Il y a donc constamment sur les étagères plus de six mille livres de pain, la provision du jour faite la veille et celle du lendemain qui ne cesse d’arriver. La boulangerie rivalise de propreté avec la cuisine. Les hommes eux-mêmes ont un air convenable.
Dans une salle, certains sont occupés à couper et à peser dans des balances la portion qui doit revenir à chacun. Plusieurs centaines de parts sont déjà faites. On me prie d’en prendre une au hasard, d’en vérifier le poids et d’y goûter. Je m’empresse de le faire : il y a bien trois livres et demie. Quant à la qualité, je dois déclarer que ce pain était le mieux pétri, le mieux levé, le mieux cuit, en somme de beaucoup le meilleur de tous les pains de seigle que nous ayons mangés pendant notre voyage.
Au moment où nous sortons de la boulangerie, je vois, réunis au milieu de la cour, les forçats dangereux que nous sommes allés visiter. Un piquet de Cosaques les entoure. On va faire l’appel, puis les conduire sur la route aux différents travaux auxquels ils sont employés.
Je demande à faire leur photographie : on me le permet de très bonne grâce. Ces malheureux eux-mêmes se prêtent volontiers à mon désir. C’est pour eux une distraction, un répit de quelques minutes. Bientôt, sur un ordre donné, ils quittent l’enceinte du bagne. Nous les avons rencontrés plus tard sur la route, en train de travailler, mais sans conviction.

Tout ce dont on se sert dans l’île est fabriqué par les forçats. À une certaine distance en dehors de la ville, sont des ateliers de menuiserie, de serrurerie, etc. ; les nombreux ouvriers qui y travaillent ont l’air d’honnêtes artisans des faubourgs d’une grande cité. À voir ces ateliers en rase campagne, sans aucune clôture, on ne dirait jamais qu’on se trouve dans un bagne et qu’on a des forçats devant soi.
Certains d’entre eux sont de véritables artistes en ébénisterie. J’ai vu chez M. Taskine et dans les ateliers de magnifiques meubles, tables, buffets, secrétaires, en bois verni du pays, du plus bel effet. On utilise surtout, pour faire du placage, les excroissances qui se produisent sur certaines essences de bois blanc à la suite de maladies parasitaires. Ce bois rappelle beaucoup le thuya, mais avec une plus grande variété de dessins. J’ai rapporté une petite boîte fabriquée par le meilleur ouvrier ébéniste du bagne avec l’excroissance en question.
En somme, de ma visite dans l’île Saghaline, lieu de détention des pires criminels que produise la Russie, il ressort que ces criminels sont traités avec la plus grande humanité, et que ceux qui, au lieu de se révolter contre le juste arrêt qui les a condamnés, cherchent à racheter leur passé par la soumission et par une conduite irréprochable, trouvent aide et encouragement auprès des autorités russes et finissent par mener une vie relativement libre et heureuse.
Ma visite n’était ni annoncée ni attendue, et toutes les portes m’ont été ouvertes sans la moindre hésitation, sans qu’il ait été besoin de le demander. Ce que j’ai vu est donc bien ce qui existe habituellement, car même si l’on avait été prévenu de mon arrivée, il eût fallu des mois pour organiser les choses sur le pied sur lequel on me les a montrées.
On a souvent accusé les Russes de barbarie et d’inhumanité dans le traitement de leurs prisonniers en Sibérie. Je suis heureux de déclarer que rien de ce que j’ai vu ne justifie, à l’heure actuelle, cette accusation.
Saghaline est le lieu le plus important de déportation de tout l’empire. C’est également le point le plus éloigné de la capitale et le moins sujet à être contrôlé par les voyageurs ou des inspecteurs arrivant à l’improviste. C’est donc, par conséquent aussi, le lieu où l’arbitraire pourrait s’exercer avec le plus d’impunité. Pourquoi serait-ce, au contraire, le seul où l’on ne traitât pas les prisonniers comme des bêtes fauves ? On m’objectera les chaînes que quelques-uns portent : mais ce sont des incorrigibles, et du reste il n’y a pas si longtemps que tous les forçats en portaient chez nous, incorrigibles ou repentants. Les verges n’existent-elles pas encore dans la marine anglaise sous le nom de cat o’ nine tails, et bien autrement terribles ?
Un voyageur anglais, M. de Windit, a fait il y a quelques années le voyage de Pékin en Europe, mais par la Mongolie. C’est donc un peu avant le lac Baïkal que nous sommes arrivés à la route qu’il a suivie. Il a fait une étude spéciale des prisons dans les grandes villes de la Sibérie occidentale qui se trouvent sur le parcours. Il restait à examiner si la réhabilitation qu’il faisait des prisons sibériennes à l’ouest du lac Baïkal était exacte pour l’est, dans ces pays beaucoup moins habités, beaucoup plus sauvages, entièrement en dehors de l’itinéraire des touristes, et c’est ce que j’ai fait.
Je retourne à bord. Les nouvelles sont bonnes. Un télégramme est arrivé, annonçant que le nord de la Manche de Tartarie, dans laquelle nous sommes, est enfin libre de glaces. La débâcle a eu lieu la nuit dernière. Nous pouvons donc maintenant remonter d’Alexandrevsk jusqu’à Nikolaïevsk. Mais nous ne pouvons le faire sans pilote, et les pilotes sont tous dans la baie de Castries, à… Alexandrevsk. Un autre Alexandrevsk, car les Russes ont, comme les Anglais, la déplorable habitude de donner le nom de leurs souverains à tout. Je ne sais combien j’ai vu dans mes voyages de villes de Victoria, de Victoria Peak, Victoria Park. De même la Russie compte plusieurs Nikolaïevsk et un plus grand nombre encore d’Alexandrevsk. Il y a donc deux de ces derniers à quelques dizaines de milles de distance, l’un sur la côte de Saghaline, où nous sommes, l’autre sur la côte de Sibérie, où nous serons demain. C’est gênant pour la correspondance.
En attendant le départ, nous pêchons à la ligne, et en deux heures nous prenons une cinquantaine de turbots de moyenne dimension : le plus gros ne pesait pas plus de trois livres. Une belle morue est également parmi les victimes. Quel régal pour tout le monde !
IX
De Saghaline à Nikolaïevsk.
Sept heures sonnent, nous partons. Il est impossible de rêver un ciel plus pur, une mer plus unie. Marie a hérité de l’élégante et confortable cabine du Tsarevitch.
Nous sommes maintenant presque arrivés aux jours les plus longs de l’année. Dix heures arrivent et c’est à peine si le crépuscule commence. Je ne puis me résoudre à imiter les autres et à gagner ma cabine. Couvert d’un chaud pardessus de fourrure, je reste sur le pont, malgré la fraîcheur de l’air : le thermomètre doit être au-dessous de zéro.
Effrayés par le bruit de l’hélice, de nombreux phoques cherchent à s’écarter de notre route. Je les vois fuir devant le Vladivostok, laissant un long sillage qui les fait ressembler à d’immenses serpents. Puis, se sentant gagnés de vitesse, ils plongent pour reparaître à quelques centaines de mètres plus loin.
Le soleil est couché depuis longtemps, mais la lueur qu’il projette embrase une partie du ciel, et donne à la mer l’aspect miroitant d’une glace.
Elle reste toujours aussi vive cette lueur. On sent que le disque qui la produit ne s’est pas enfoncé bien profondément sous l’horizon. Je la suis des yeux pendant qu’elle décrit autour de nous sa demi-circonférence. Nous marchons vers l’ouest : elle était donc droit devant nous il y a deux heures. Il est minuit, elle est au nord, sur notre droite, donnant encore assez de lumière pour me permettre de lire. Dans peu d’instants elle sera derrière nous, mais elle aura changé de nom : elle s’appellera aube et non plus crépuscule.
14 juin. — À 2 heures nous sommes dans la baie de Castries. C’est une sorte de cirque à falaises élevées, couvertes d’arbres de moyenne grandeur. On ne voit aucune habitation. Seul, un phare d’importance ordinaire se dresse à l’entrée de la rade. Pourtant, derrière ces falaises, se trouve Alexandrevsk, station de poste et de télégraphe, d’où part le câble qui relie l’île de Saghaline au continent. Nous ne sommes, en ligne droite, qu’à une centaine de kilomètres de l’Amour.
C’est ici que nous devons prendre le pilote qui nous conduira à Nikolaïevsk. Mais celui-ci n’a pas l’air de vouloir se presser. Nous avons beau siffler et resiffler pour l’appeler, rien ne décèle à terre la présence d’êtres humains, rien ne bouge ; et si le phare n’était pas devant nos yeux, ce serait à croire que nous nous sommes trompés de mouillage.
Avant-hier la baie était très animée, Il n’y avait pas moins de quatre vapeurs à l’ancre. L’un d’eux, un navire de guerre, attendait la débâcle pour aller poser les nombreuses bouées sans lesquelles la barre de l’Amour serait impossible à franchir. Ces bouées sont relevées chaque année, au commencement de l’hiver. Enfin à 7 heures tout est en règle, et nous reprenons notre route vers le nord sous la conduite d’un pilote. Le nôtre, comme tous ses confrères, est un ancien quartier-maître de la marine de guerre russe, qui a passé des examens spéciaux et se montre très fier des fonctions officielles qu’il remplit. Il reçoit un traitement fixe du gouvernement, et régulièrement on ne lui doit rien, mais il est d’usage de le rémunérer de ses services, suivant le tonnage du navire qu’il est chargé de conduire. Pour le Vladivostok, il reçoit une somme de 100 roubles, au retour à la baie de Castries. Il est toujours accompagné d’un élève pilote.
La mer a perdu depuis quelque temps sa belle couleur verte ; elle est d’un brun clair. Des bandes innombrables d’oies, de canards et de sarcelles que notre arrivée met en fuite, la sillonnent dans tous les sens. Nous longeons la côte, et c’est à peine si nous apercevons de temps en temps quelques traces de la présence de l’homme. Le pays est montagneux, très boisé, mais les arbres me paraissent malingres. Dans une petite anse, nous apercevons d’énormes blocs de glace, restes de la débâcle d’avant-hier.
Cependant la mer va toujours en se rétrécissant et la navigation devient difficile. Tantôt nous longeons la côte, tantôt nous nous en écartons suivant les caprices du chenal, qui est très étroit.
Tous les jours, matin et soir, on prend à bord la température de l’eau de la mer. Depuis le Japon nous n’avons cessé de marcher vers le nord, et le thermomètre n’a cessé de descendre. Hier encore il n’indiquait que + 6 degrés Réaumur. Aujourd’hui il est remonté à + 8, La raison en est simple : nous sommes dans les eaux de l’Amour, sensiblement plus chaudes que celles de la mer. Un marin puise avec un seau le long du bord une petite quantité d’eau : elle est douce, exempte de sel. On m’assure que le long de Saghaline elle est plus froide et salée.
Ces rencontres de courants de températures différentes sont la cause des brouillards dont on nous avait si fort menacés à notre départ de Vladivostok. Un grand courant d’eau chaude, le Gulf-Stream du Pacifique, venant en effet de l’équateur, passe entre le Japon et la Corée et entre dans la mer d’Okhotsk par le détroit de La Pérouse. Un autre courant, mais froid celui-là, venant de cette même mer d’Okhotsk, se divise en deux en arrivant à l’île de Saghaline, et une partie pénètre dans la Manche de Tartarie. C’est sa rencontre avec l’Amour et avec Le courant du sud au détroit de La Pérouse, qui fait de la Manche de Tartarie un véritable nid à brouillards. Or aux caps Mouravieff et Lazareff le détroit n’a plus, m’a-t-on affirmé, qu’une largeur de 2 milles marins. Les bancs indiqués sur la carte, comme recouverts de 80 ou 90 centimètres d’eau, sont maintenant à sec, et l’on y voit même une certaine végétation. Un projet serait à l’étude, pour empêcher la formation des brouillards en fermant par une digue les deux milles de mer libre qui restent au cap Mouravieff et en arrêtant ainsi le courant froid venant du nord.
Après le cap Lazareff, la mer s’élargit de nouveau, mais elle n’a toujours pas de profondeur. Nous ne calons qu’une dizaine de pieds et nous sommes obligés d’aller avec une extrême circonspection, suivant avec soin le chenal indiqué par les bouées, et bien souvent un bruit, rappelant celui que fait une scie circulaire, accompagné d’un ralentissement marqué, nous prouve que notre quille racle le fond de la mer. C’est une sensation particulièrement désagréable. Enfin la dernière bouée est devant nous. Encore une centaine de mètres et c’est fini.
Soudain le bruit de scie recommence, nous nous sentons portés en avant, comme dans un train en marche dont on serre les freins, puis arrêt complet. Nous sommes sur un banc. Nous perdons une heure à nous dégager et à trouver le chenal, que la bouée, placée hier, indique du côté opposé où il se trouve.
Nous avons franchi la barre. Le courant est très fort, et un vent violent, venant en sens contraire, soulève des vagues relativement élevées pour le peu de profondeur de l’eau. Pour la première fois depuis Vladivostok nous apercevons quelques voiles à l’horizon. Ce sont des bateaux pêcheurs ghiliaks qui se dirigent vers Nikolaïevsk, venant de la pleine mer.
Puis, tout à fait sur le rivage, apparaissent des habitations. C’est un village indigène. Nous sommes assez près de terre pour voir ce qui s’y passe, et il fait encore assez clair, bien que le soleil ait disparu.
Quelques bateaux sont tirés sur le sable. Les maisons, il y en à quatre ou cinq seulement, sont construites sur pilotis. Tout a l’air misérable. On se demande comment les malheureux habitants peuvent résister aux froids rigoureux de l’hiver dans ces abris en bois mince, qui ressemblent à de grandes cages avec des grilles à la place de murs. La population entière est dehors à nous regarder. Presque tous les enfants ont les jambes nues : on grelotte rien qu’à les voir.
Nous passons assez près des habitations pour faire aboyer les chiens et tenter un gamin, qui nous lance une pierre. Mais il avait mal calculé sa distance : sa pierre tombe à moitié chemin. Est-ce là le genre de réception qui nous attend sur l’Amour, dans lequel nous sommes enfin ? Ce village est à l’extrémité du cap Prongue, qui marque l’entrée du grand fleuve, et maintenant nous pénétrons dans le continent. Nous matchons vers l’ouest : c’est la direction de la patrie.
L’embouchure de l’Amour offre un spectacle majestueux. Le fleuve a plus de 13 kilomètres de largeur. Les berges sont élevées, et immédiatement derrière elles commencent les montagnes. De même qu’à Saghaline, on sent que l’hiver vient à peine de finir, car on voit de tous Les côtés de larges plaques de neige sur le flanc des collines et sur Les pics élevés. Où sont les 37 degrés que marquait le thermomètre dans l’intérieur de notre barque sur le Peï-Ho ? Il fait cependant moins froid et la végétation paraît moins maigre qu’à Alexandrevsk. Est-ce dû à l’influence du fleuve, dont les eaux sont chaudes relativement au courant froid qui entoure la grande île ?
Les montagnes n’offrent plus cette teinte uniforme d’un vert très foncé. Çà et là de longues bandes d’un ton plus clair semblent indiquer un sol plus riche planté d’essences différentes. Une chose cependant frappe les regards : toutes les montagnes qui nous environnent sont dénudées au sommet, à partir de la même élévation au-dessus du niveau de la mer. Les forêts cessent tout à coup pour faire place à une herbe fort maigre qui seule parvient à vivre à cette altitude. Sur trois points, les forêts qui couvrent les montagnes sont en feu. C’est un spectacle que nous aurons bien souvent dans la suite. Nous verrons des kilomètres et des kilomètres encore de terrains, autrefois couverts d’arbres, dévastés par l’incendie.
Les eaux de l’Amour ont une teinte étrange, et les Chinois, qui choisissent généralement pour les rivières et les montagnes un nom rappelant une de leurs particularités, ont donné à ce fleuve celui de « Fleuve du Dragon noir ». En effet, on dirait que nous naviguons sur du jus de réglisse. Des bouées placées de distance en distance dans le milieu du courant, et des constructions triangulaires, peintes en blanc, élevées par les soins de l’amirauté sur la rive ou sur le flanc des collines, nous indiquent le chenal.
Mais il commence à se faire tard, et souvent, lorsque nous longeons le bord, une montagne se trouve entre la lueur crépuseulaire et nous. Notre pilote déclare qu’il ne veut pas prendre la responsabilité de nous conduire jusqu’à Nikolaïevsk dans l’obscurité. Il est 11 heures, nous mouillons, et cependant nous n’avons plus que 4 milles à faire.
15 juin. — Nous devions partir à 3 heures du matin, le brouillard nous en empêche : on ne voit pas à cinq mètres devant soi. À 9 heures cependant, nous mouillons devant la ville, à côté des quatre vapeurs qui ont quitté Castries un jour avant nous.
Bientôt le salon est envahi par des visiteurs, et notre commandant nous apprend au bout de quelques minutes que le meilleur des bateaux qui remontent l’Amour, le Mouravieff Amoursky, celui sur lequel le Tsarevitch a fait le voyage de Habarovka à Stretinsk, quittera Nikolaïevsk après-demain, vendredi ; qu’il possède quatre cabines dont deux bonnes, et que l’une de ces dernières a été retenue pour nous par les soins de l’agent de M. Cheveleff.
Il ajoute qu’en attendant le départ du Mouravieff Amoursky, ce que nous avons de mieux à faire est de rester à bord du Vladivostok. Nous acceptons son offre aimable, et nous le remercions vivement.
X
Nikolaïevsk
Fondé en 1850, Nikolaïevsk est situé sur la rive gauche de l’Amour. C’était autrefois le grand port de guerre et de commerce de la Russie dans l’Extrême-Orient. Mais on conçoit l’insuffisance d’une place dont l’accès n’est libre que du milieu de juin à la fin de septembre, et depuis la fondation de Vladivostok, Nikolaïevsk n’a cessé de décliner.
Il y existe encore cependant une garnison assez importante, et des forts pour protéger l’entrée de l’Amour pendant les trois ou quatre mois où elle est possible. Quant aux maisons de commerce, elles sont peu nombreuses et consistent surtout en agences des compagnies de navigation.
Du pont de notre navire même, nous nous rendons parfaitement compte que la ville est en partie abandonnée. Car les rues perpendiculaires au fleuve sont de véritables prairies, l’herbe y croît à plaisir et des troupeaux de vaches y paissent en toute liberté. L’église est peinte en vert. C’est une couleur que l’on semble aimer beaucoup en Sibérie pour les édifices religieux.
À 200 ou 300 mètres de nous est un petit port avec des jetées en bois et des hangars. C’est dans ce port que se trouvent les bateaux qui remontent l’Amour. Sur le sable, à droite, on nous montre une construction informe que l’on nous dit être la barge sur laquelle a descendu le fleuve le général Mouravieff, dont nous retrouverons à chaque pas le souvenir.

De l’autre côté du fleuve, dont la largeur n’est plus ici que de 3 kilomètres, est une montagne abrupte, inhabitée, entièrement couverte d’arbres et dont le pied baigne dans l’eau.
Deux ou trois petits steamers sont employés à amener les chalands. Si l’on veut aller à terre, on peut prendre passage sur l’un d’eux, à raison de trois roubles par personne pour l’aller et de trois autres roubles pour le retour, ce qui me paraît tant soit peu excessif. Autrement, on peut prendre les bateaux ghiliaks, quand il y en a, car ils ne sont pas nombreux autour des steamers ; le passage ne coûte qu’un demi-rouble.
Les bateaux ghiliaks sont de deux sortes : les plus petits, de simples troncs d’arbres creusés, les plus grands composés de trois larges planches : une formant le fond est placée à plat ; les deux autres formant les côtés sont munies de chevilles à la partie supérieure.
Les rames, très courtes, sont des pagaies à une seule palette. Un trou placé à une certaine distance de la poignée permet de les fixer au bord du bateau, au moyen des chevilles.

À l’inverse du monde entier qui fait concorder les mouvements de gauche avec ceux de droite, afin de donner une impulsion plus vive au bateau par un effort simultané des deux bras, les Ghiliaks manœuvrent les rames alternativement, c’est-à-dire que celle de gauche sort de l’eau au moment où celle de droite y entre. Qu’il y ait un ou plusieurs rameurs, le procédé ne varie pas.
À tous les bateaux, grands et petits, s’adaptent également des voiles curieuses. Il y en a deux ; elles sont carrées et d’égale grandeur, fixées à un mât unique placé au centre. Par vent arrière, quand les voiles sont déployées, on dirait un gigantesque papillon. Ces embarcations ne m’inspirent aucune confiance, et cependant tout le monde m’affirme qu’elles sont absolument sans danger et qu’il n’arrive jamais d’accident.
Les Ghiliaks sont repoussants d’aspect. D’une saleté sans nom, habillés généralement de peaux de bêtes, et même, affirme-t-on, de peaux de poisson, ils ne sacrifient au luxe que sur un point : hommes et femmes portent jusqu’à deux ou trois paires de grandes boucles d’oreilles. L’agriculture leur est inconnue. Chasser et pêcher, ils n’ont point d’autre occupation. L’ours est leur dieu ou plutôt leur intermédiaire entre le ciel et la terre. Aussi chaque village en élève-t-il plusieurs jusqu’à un certain âge. Puis, quand arrive le jour de leur grande fête nationale, les Ghiliaks choisissent un de ces animaux réunissant toutes les conditions voulues de croissance et autres, le chargent de liens et le promènent de maison en maison. Tous les habitants viennent l’un après l’autre lui donner leurs commissions pour le ciel, et quand personne n’a plus aucune recommandation à lui faire, ils se précipitent sur lui, le tuent à coups de flèches, de lances et de harpons, et se partagent sa chair.

Ces cérémonies sont également pratiquées par les Aïnos. J’en ai trouvé les dessins dans un ouvrage japonais que M. Collin de Plancy, qui a été chargé d’affaires au Japon, a bien voulu mettre à ma disposition.

Les Ghiliaks élèvent une grande quantité de chiens pour le traînage en hiver. On n’en voit pas moins de trente ou quarante devant chaque yourte ou hutte. Vers le soir ils se mettent à hurler comme des loups. On les nourrit avec de la truite saumonée qui, du 15 juin à la fin de juillet, pénètre dans l’Amour par millions, mais jusqu’à une distance d’environ 300 kilomètres seulement de l’embouchure. Chaque yourte en fait sécher de trente à quarante mille tous les ans. Il en faut deux ou trois par jour et par chien. Seulement, comme ces truites sont simplement séchées et non pas salées, les vers s’y mettent très vite et consomment la plus grande partie de la provision.
À peine la truite a-t-elle disparu que le saumon se montre. La pêche commence dans les environs du 15 août. Elle dure un mois. C’est, paraît-il, un spectacle tout à fait remarquable et qui donne à Nikolaïevsk, le grand centre des pêcheries, une animation extraordinaire.
Le saumon pèse rarement moins de 8 livres et plus de 25. Dans les premiers jours il vaut de 5 à 6 roubles le cent, mais bientôt après il se donne pour un rouble, car, à cette époque, tout poisson qui n’a pas été préparé et salé dans les vingt-quatre heures est bon à jeter.
Pour donner une idée de l’importance de la pêche du saumon, voici, d’après un de nos compatriotes, M. Eugène Ninaud, qui habite la Sibérie depuis une vingtaine d’années et s’est occupé de la salaison et de la vente du poisson à Nikolaïevsk, les chiffres que fournit de ce chef la statistique du port pour l’exportation annuelle :
| Pour | Vladivostok |
50 000 | pouds |
Blagovechtehensk |
100 000 | » | |
Habarovka |
10 000 | » | |
| Pour | nourrir les déportés de Saghaline |
40 000 | » |
Total |
200 000 | pouds |
On sait que le poud vaut 16 kilogrammes.
De plus chaque habitant conserve 400 ou 500 saumons pour sa consommation personnelle, ou pour vendre au détail ; les Ghiliaks, dont, en somme, c’est la seule nourriture, en font sécher plusieurs milliers par famille.
Sur tout le cours de l’Amour le saumon est traqué. Celui qui à réussi à franchir les terribles barrages de Nikolaïevsk aura à redouter, d’abord les Ghiliaks et les paysans russes de chaque village, puis les Goldes, Les Orotchones, les Mandchous, les Cosaques, les Manegris, enfin tous les riverains dont cette proie facile entretient la paresse.
« Si Je vous disais, ajoute M. Ninaud dans la lettre dont j’extrais ces documents, le nombre de millions de saumons pêchés annuellement dans l’Amour d’après mes calculs, vous ne voudriez pas me croire. Et pourtant je ne puis avoir la prétention d’être exactement informé de tout ce qui a été pris. »
Quand il passe à Nikolaïevsk, le saumon est magnifique, gras, argenté. Plus il remonte, plus il est maigre et de vilain aspect. À Blagovechtchensk, c’est-à-dire à près de 2 500 kilomètres de la mer, il est tout tacheté de vert, de gris, de noir, de brun, il lui est poussé des dents énormes, sa maigreur est extrême, et sa chair a perdu toute sa saveur.
On le trouve dans tous les affluents de l’Amour sur la rive droite, mais jamais il ne pénètre dans les affluents de la rive gauche. De même que jamais on ne le voit dans le grand fleuve au-dessus de l’embouchure de la rivière Kara qui arrose la Mandchourie. Il pénètre dans cette rivière et remonte jusqu’à sa source, où il devient la proie des tribus manegris qui l’attendent, et des bêtes sauvages qui le trouvent à sec sur les rives, car à cette époque les eaux baissent de plusieurs centimètres par jour.
Aucun saumon ne redescend l’Amour, et M. Ninaud donne comme preuve de ce fait qu’une fois le passage terminé complètement, jamais de mémoire d’homme un seul de ces poissons n’a été pris dans le grand fleuve, où cependant la pêche est très active, même pendant l’hiver.
Une des particularités, non seulement de Nikolaïevsk, mais de l’Amour jusqu’à une très grande distance de son embouchure, c’est que tous les matins invariablement, à 10 heures, un très fort vent d’est se met à souffler. Le soir, à 7 heures, il tombe, et les nuits sont calmes. À mesure que l’on s’éloigne de la mer, ce vent diminue et de durée et d’intensité, cependant il se fait sentir jusqu’à Blagovechtchensk. Ici, il souffle avec violence, et produit des vagues véritablement effrayantes quand on se trouve dans un de ces bateaux ghiliaks, réputés insubmersibles, ou même dans une des embarcations du Vladivostok. Ajoutez à cela que le courant est terrible. Nous voulons pêcher, et nous jetons à plusieurs reprises une ligne le long du bord : elle est entraînée et ne touche pas le fond malgré le plomb dont nous augmentons successivement le poids jusqu’à concurrence de sept livres. Il faut donc renoncer à prendre nous-mêmes du poisson. On nous promet pour le soir du caviar frais.
Il y a bien longtemps que nos amis russes nous ont parlé de ce mets délicieux que seule leur patrie peut produire, et qui doit être mangé absolument frais. Ce sont des œufs de poisson, retirés du ventre de l’animal encore vivant s’il se peut, nettoyés avec un petit balai pour enlever les filaments et séparer les grains, et servis tels quels, c’est-à-dire crus, aussi vite que possible.
De même que certaines personnes ajoutent aux huîtres du citron, du poivre, voire même des échalotes hachées, de même le caviar se mange sur du pain, le plus souvent au naturel et quelquefois avec addition de sel, de citron ou même d’oignon.
Sur l’un des bateaux ghiliaks qui viennent le long du bord nous apporter des provisions et peut-être ce fameux caviar, je vois un chien à longs poils qu’on me dit être un chien de traîneau. J’en ai déjà vu à Saghaline.
Le traîneau est le grand, presque l’unique moyen de locomotion pendant l’hiver. On y attelle des chevaux, des rennes, des chiens. On en voit de tous les côtés, sous les hangars et même sur les toits des maisons. Ils paraissent assez rudimentaires. Malheureusement nous sommes en été et nous ne pouvons les voir fonctionner. Ils frappent par leur légèreté.

Les traîneaux sont à peu près les mêmes dans toute la Sibérie, et n’ont guère varié de forme, probablement, depuis l’époque où l’on s’est imaginé de se servir de chiens pour les tirer. N’ayant pu les photographier, je donne ici la reproduction d’une gravure contenue dans un ouvrage bien curieux, que j’ai vu à la bibliothèque de Tomsk, et que j’ai pu me procurer à Paris. En voici le titre complet :
Ainsi donc un Français a traversé toute la Sibérie, est allé du Pacifique à l’Atlantique, il y a plus d’un siècle, et ce Français porte un nom justement célèbre. J’ai suivi à peu près son itinéraire, à partir d’Irkoutsk, de l’autre côté du lac Baïkal, et je suis on ne peut plus heureux de pouvoir lire ce qu’il écrivait sur ces pays extraordinaires, cent ans avant mol.
N’est-il pas remarquable que M. de Lesseps qui, en entreprenant ce grand voyage, était considéré par tout le monde à bord de la Boussole et de l’Astrolabe comme s’exposant aux plus grands dangers, et était pleuré d’avance par les amis qu’il quittait, soit justement le seul des hommes sous les ordres de l’amiral de la Pérouse qui revit sa patrie ?
Un des fonctionnaires russes dont M. de Lesseps eut le plus à se louer fut le général de division Arsenieff. N’est-il pas aussi singulier que ce soit également à un général de division Arsenieff que nous soyons redevables en grande partie du succès de notre voyage ?
(La suite à la prochaine livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[35],
Nikolaïevsk (suite).
e commandant Kruger nous conduit à terre. Nous
allons d’abord visiter notre cabine sur le Mouravieff Amourski.
Elle est à l’avant, dans la cale, et
est éclairée par un hublot qui se trouve à une cinquantaine
de centimètres au-dessus de l’eau. Elle est assez
spacieuse, mais complètement dépourvue de lits et, par
conséquent, de draps, de couvertures, d’oreillers et de
matelas. Le mobilier se compose d’une table et de deux
banquettes analogues à celles de nos wagons. C’est
peu ; mais comme nous étions prévenus, nous avons
apporté le plus nécessaire de ce qui manque.

Nous croisons sur le pont deux messieurs à l’air fort distingué, qui, avec cette affabilité russe dont tout bon fils d’Albion aurait été scandalisé, nous adressent la parole dans notre langue. L’un d’eux est en uniforme : c’est le général de division Arsenielf, venu, il y a quelques jours, de Habarovka, la capitale des provinces de l’Amour, pour inspecter la garnison et les forts de Nikolaïevsk. Il doit prendre passage sur le Mouravieff Amourski, pour retourner à Habarovka avec tout son état-major. Nous aurons donc à bord nombreuse et agréable compagnie. L’autre est Le comte Lutzaw, directeur général des douanes.
Ces messieurs nous préviennent que notre arrivée fait l’objet de toutes les conversations et qu’on se mettra aux portes pour nous voir passer. Ils ont raison, car dans notre promenade dans les rues de la ville nous sommes l’objet de la curiosité publique, mais d’une curiosité discrète. Les distractions sont rares ici !
Nous allons rendre visite à M. Picard, chef de la police. Deux grandes rues parallèles au fleuve traversent la ville dans toute sa longueur. Partout ce ne sont que maisons abandonnées. L’herbe, les broussailles, témoignent du déclin de Nikolaïevsk. Le palais des anciens gouverneurs, car il n’y a plus maintenant ici de si hauts fonctionnaires, est dans un état lamentable. Construit en bois, naturellement, il laisse pénétrer le jour et l’eau du ciel de tous les côtés. Les fenêtres, les portes, ont été condamnées au moyen de planches cloutées en diagonale, à l’extérieur. Mais combien y a-t-il de temps de cela ? Toutes les lignes ont perdu leur aplomb ; les balustrades en bois qui entourent le jardin sont inclinées dans tous les sens.
Nombreuses sont les maisons qui présentent le même aspect. Quelques-unes, qui paraissaient devoir être très importantes, n’ont pas même été terminées : on a simplement abandonné les travaux sans s’inquiéter des matériaux employés, et l’on est parti.
Nikolaïevsk a l’air, non pas d’une ville en ruines à la suite d’une invasion ou d’un cataclysme, mais d’une ville pestiférée dont les habitants ont fui, et qu’une malédiction condamne à un abandon éternel.
M. Picard se montre fort aimable, et nous offre l’hospitalité chez lui. N’ayant plus à rester ici que vingt-quatre heures et nous trouvant très bien à bord, nous ne voulons pas lui causer de dérangement.
Dans son cabinet de travail, dont la porte donnant sur le salon était ouverte, je vois assis devant un bureau un monsieur en uniforme. Il paraît adresser des questions à un homme hirsute qui se tient debout devant lui. La vue de cet individu me fit mettre la conversation sur la sécurité du pays. M. Picard nous dit avec emphase que Nikolaïevsk est une sorte de succursale du Paradis, que tous les habitants sans exception sont de petits saints, et que l’on pourrait, sans crainte d’autre chose que d’un rhume, dormir les fenêtres ouvertes.
Nous prenons congé de lui. Mais à peine sommes-nous dans la rue que le commandant est pris d’un fou rire. « Avez-vous remarqué, dit-il, ce qui se passait dans la chambre à côté, pendant que le chef de la police nous vantait les bonnes mœurs de ses administrés ? Le procureur de l’Empereur était en train de procéder à l’interrogatoire d’un individu. Il s’agissait d’une tentative d’empoisonnement d’un de ces vertueux habitants du pays sur son conjoint. »
Assez égayés par cette petite aventure, nous continuons notre promenade et faisons le tour de la ville. Nous passons devant le cimetière, où la présence de nombreuses tombes témoigne de l’ancienne splendeur de Nikolaïevsk. Puis, comme l’heure s’avance, nous rentrons à bord pour dîner. Le caviar frais est sur la table. Nous le trouvons fade : il est fait avec des œufs d’esturgeon. Combien il est loin de valoir celui que nous mangerons sur l’Obi et enfin sur la Volga, qui est fabriqué avec des œufs de sterlet exclusivement ! Le caviar ne se transporte pas. Mangé à Nijni-Novgorod, au moment où il vient d’être préparé, c’est un mets délicieux. Transporté à Moscou, c’est-à-dire au bout de vingt-quatre heures, il a beaucoup perdu de sa saveur.
16 juin. — On commence à décharger le Vladivostok. Pour cela on prend des soldats, qui sont heureux d’ajouter un supplément à leur solde. Mais ils sont bien maladroits : on voit que ce n’est pas leur métier.
Le soir, après dîner, promenade à terre. Nous rencontrons, comme hier, dans la rue, tout le high-life : le général Arsenieff, le comte Lutzaw, M. Picard, etc.
Tout au bout de la ville est la maison de poste. Le commandant veut nous montrer ce que c’est qu’un tarantass ; nous entrons. Le maître est absent, nous cherchons nous-mêmes. Dans les remises, pas de voitures ; dans les écuries, pas de chevaux. Au moment où nous sortons, nous voyons arriver le maître de poste ; il a l’air entre deux vins. Est-ce un avant-goût de ce qui nous attend au delà de Stretinsk ?
Voici la forêt qui commence : la forêt pour ainsi dire sans fin, que nous traverserons d’abord en bateau, puis en tarantass, forêt que nous ne verrons finir qu’après avoir franchi des milliers de kilomètres.
Nous suivons la route. Elle est bordée et même couverte par des immondices dont les habitants ne se donnent pas la peine de se servir pour la culture. Si la latitude est trop élevée, le climat trop rude pour permettre de cultiver la terre avec succès, pourquoi ne pas transporter toutes ces immondices dans l’Amour, qui n’est qu’à deux pas et qui se chargerait de les conduire à la mer, ou, s’il y a quelque inconvénient à cela, tout au moins les déposer dans un endroit désert ? ce n’est pas ce qui manque dans les environs. Mais, encore une fois, Nikolaïevsk est une ville morte : paix à sa cendre !
Nous cherchons des muguets, ils n’ont même pas encore de boutons. Nous trouvons des fleurs que nous ne connaissons pas, une sorte de rhododendron blanc répandant une forte odeur de térébenthine. Combien nous sommes désolés de n’avoir pas assez étudié la botanique ! Toutefois le sol est jonché de plantes de connaissance, noisetiers, framboisiers sauvages, puis une sorte de violette extraordinaire. Elle est pâle, sans odeur, au bout d’une tige extrêmement allongée.
Tout à coup nous entendons au fond des bois une fanfare joyeuse qui nous attire à l’entrée d’une vaste clairière, où un certain nombre de Cosaques, avec leurs femmes, boivent et dansent aux accords de trois ou quatre instruments de cuivre. Derrière eux, l’Amour roule ses eaux noires au pied de la montagne boisée qui s’élève sur l’autre rive.
À quelques pas de là, sous un hangar, deux hommes sont en train de faire des briques : où et à quoi peuvent-elles servir ? nous n’en avons vu jusqu’à présent nulle part dans les constructions. Celles qui ne sont pas encore cuites sont couvertes avec des nattes, car le temps devient menaçant. Il faut même songer à rentrer à bord, si nous ne voulons pas essuyer une bourrasque.
Nous examinons la barge du général Mouravieff. Elle est formée de troncs d’arbres superposés horizontalement et ressemble à une maison sibérienne dont un côté, celui de l’avant, au lieu d’être perpendiculaire aux deux autres, ferait avec eux deux angles obtus, quelque chose en somme comme une énorme guérite renversée. La toiture en planches qui la recouvre a bien pu abriter le glorieux général, car elle est en triste état. Quant à la barge elle-même, je doute que les Sibériens la considèrent comme une relique précieuse, à voir l’usage qu’on en fait extérieurement. L’intérieur a été transformé en une sorte de bouge par quelque déshérité de la fortune.

17 juin. — À 9 heures, je vais porter les bagages dans notre nouveau logement. Il faut d’abord passer en douane. Cette formalité est assez vite remplie. Je suis un personnage d’importance : on m’a vu causer familièrement avec les plus hautes autorités ! On se borne donc à me demander si j’ai des cigares. Or je ne fume que la cigarette, et encore je viens d’acheter mon tabac à Nikolaïevsk.
Des Ghiliaks sont assis en rond sur le sable : une femme garde un enfant dans son berceau. Est-ce parce qu’ils sont dans un milieu civilisé ou parce qu’il fait très chaud aujourd’hui ? ils ont quitté leurs habits de fourrures et portent des vêtements en toile européenne.

Je m’apprête à monter dans une de leurs barques pour aller à bord chercher Marie, lorsqu’on m’apprend qu’un de ces fameux bateaux réputés insubmersibles vient de couler, entraînant quatre malheureux indigènes, qui n’ont pas reparu. Le fleuve est en effet très agité, les vagues énormes ; il serait souverainement ridicule de risquer de se noyer, sans aucune raison, à Nikolaïevsk. Je prends donc le petit remorqueur.

En nous attendant, Hane s’occupe à ranger notre cabine. Il met nos matelas cambodgiens sur les banquettes, étale dessus les couvertures et nos imperméables du Club alpin, et voilà le lit fait. Puis il tire de la malle le nécessaire de toilette, la cuvette en caoutchouc, objet précieux, s’il en fut, dans ces sortes de voyages, etc.
Quand coucherons-nous dans des draps, maintenant ? Pas avant Moscou, probablement, c’est-à-dire dans une cinquantaine de jours : mais cela rentre dans les choses prévues.
Cependant l’heure du départ arrive, et les adieux sont finis. Nous avons serré une dernière fois la main de ce brave commandant Kruger, devenu un ami pour nous, et nous parlons. Au moment où nous passons devant le Vladivostok, les officiers sont sur le pont, nous envoyant des saluts multipliés.
Ce n’est pas sans un serrement de cœur que j’ai lu dans un journal, quelques mois après, la nouvelle de la perte du Vladivostok, sur lequel nous ne comptions que des amis. J’espère qu’eux, au moins, ont réussi à se sauver.
XI
De Nikolaïevsk à Habarovka.
La Compagnie à laquelle appartient le Mouravieff Amourski est russe, mais c’est avec des capitaux anglais qu’elle a été fondée. Elle reçoit tous les ans du gouvernement une subvention de 1 800 000 roubles en or, subvention autrefois plus considérable. Elle fait le service des dépêches ; elle a trois départs par mais de Nikolaïevsk à Stretinsk, et vice versa ; le trajet pour remonter le fleuve est de vingt et un jours, la descente est plus rapide. C’est en outre elle qui est chargée du service hebdomadaire sur l’Oussouri entre Kamyene-Rybalow et Habarovka.
Parmi Les passagers de première, au nombre de neuf, il faut citer Le général de brigade Kakourine, qui accompagne son chef hiérarchique, le général Arsenieff, puis des officiers et un médecin.
Je suis surpris en outre de voir un homme d’une cinquantaine d’années, complètement rasé, ayant tout à fait le costume et l’aspect d’un bon gros et gras chanoine parisien. C’est l’abbé Radzichevski. Il est chargé, et il est seul, des intérêts catholiques dans toutes les provinces de l’Amour et de la Transbaïkalie. Voilà une bien grande paroisse, la plus grande du monde, probablement. Heureux, parmi ses ouailles, qui peut se flatter de le voir une fois chaque année ! Il est du reste excessivement discret dans l’exercice de ses devoirs, car pendant les dix jours que nous avons passés ensemble je ne l’ai pas vu une seule fois lire son bréviaire en public. Il est le titulaire d’une des quatre cabines.
Nous ne sommes pas en route depuis un quart d’heure que déjà les tables de jeu sont installées et que le vint commence. Le Mouravieff Amourski est le plus grand et le meilleur bateau de la ligne, entre Nikolaïevsk et Blagovechtchensk. Il a moins de 60 mètres de longueur ; mais comme ses roues sont placées de chaque côté, cela augmente sa largeur et donne de la place pour la chambre du capitaine, des officiers, la cuisine, l’office, le lavabo commun, etc.
À l’avant sur Le pont est le salon, qui servira également de dortoir. Il est entouré intérieurement de banquettes fixes et d’une seule pièce. Sur lesdites banquettes, chaque passager a étalé sa couverture pliée, et à une des extrémités placé sa valise et son oreiller, contre lesquels les pieds du voisin viendront s’appuyer, et ainsi de suite. La portion de banquette dévolue à chacun dépend du nombre de passagers. Pour le moment ils ne sont qu’une demi-douzaine, ils pourront donc s’étendre.
Le salon est propre et luxueux : cimaises, moulures du plafond, encadrements des fenêtres et des panneaux, sont à triple et quadruple étage. Le tout, en orme, découpé et verni.
Les passagers de secondes ont à l’arrière une installation semblable, mais beaucoup moins luxueuse. C’est à peine s’il y fait clair. Et puis, quelle odeur ! Est-ce jamais aéré ?
Les passagers de troisième sont partout, dans tous les coins ; les privilégiés, dans la partie couverte qui se trouve entre le salon, la machine, la cuisine, etc. À l’arrière, c’est un fouillis indescriptible d’hommes, de femmes et d’enfants, dont chacun s’occupe de ses petites affaires, comme s’il était seul dans sa chambre.
Sur le rouf de l’arrière ont pris place 120 des soldats arrivés par le Vladimir. Beaucoup d’entre eux ont femme et enfants qui les accompagnent. Quelques-uns emportent leur fusil de munition, dont ils se sont rendus acquéreurs moyennant la modique somme de soixante kopeks. C’est un moyen pour le gouvernement de se défaire des anciennes armes que les progrès de la science ont rendues insuffisantes. De retour dans son village, le soldat en fera une arme de chasse. Son passage sur les bateaux est payé par l’État.
Autour de la machine est empilé le bois de chauffe. C’est un combustible désagréable à tous égards pour les steamers. D’abord, il tient une place énorme. Nous en brûlons une quarantaine de stères par jour, et nous ne pouvons en avoir à bord pour plus de quatorze heures de marche. Il faut donc nous arrêter fréquemment pour renouveler notre provision. À cet effet, de distance en distance, des dépôts sont préparés ; le bois, scié à la longueur voulue, est entassé sur la berge. En une heure de temps, nos soldats ont refait Les piles à côté de la machine. Ils reçoivent pour ce travail une gratification à laquelle ils ne sont pas insensibles.

Le chauffage au bois a encore l’insupportable inconvénient de produire une grande quantité d’étincelles qui tombent en pluie de feu sur le pont et sur les malheureux passagers, sans distinction de classe : c’est une question de direction du vent. Sur le Mouravieff, qui a des parties couvertes, nous pouvons encore nous mettre à l’abri. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet.
Le prix du billet sur les bateaux de l’Amour, de l’Obi et de la Volga, comme aussi sur le Vladivostok, ne comprend pas la nourriture. Tous les passagers, à quelque classe qu’ils appartiennent, peuvent à leur gré prendre leur part de la table d’hôte, servie deux fois par jour, à raison de 1 rouble 75 kopeks par tête. Ce prix donne en outre droit au thé à discrétion, avec pain, le matin et à 4 heures de l’après-midi.
Quelques passagers de deuxième prennent seulement le potage. C’est un prix à débattre. Mais tous ceux de troisième et la plupart de ceux de seconde se nourrissent eux-mêmes. Ils ont des provisions, c’est-à-dire du pain de seigle et du saumon fumé qu’ils mangent cru. Quelques épicuriens ont du saucisson, des biscuits. Tout le monde a droit à l’eau bouillante, et chacun peut aller remplir sa théière à la cuisine, de 8 heures du matin à 10 heures du soir.
Nous avons quelques provisions, mais nous les réservons pour les cas de famine. Le mieux est donc de nous inscrire à la table d’hôte. J’obtiens également que Hane soit nourri pour un rouble par jour et qu’il couche en travers de la porte de notre cabine. Au moins il sera à l’abri s’il pleut.
Cependant nous marchons avec rapidité. Le fleuve n’a jamais moins de 2 kilomètres de large et souvent le triple. Dans les endroits resserrés, le courant est violent. Le paysage se déroule sous nos yeux, très accidenté. Les montagnes succèdent aux montagnes, toutes couvertes d’arbres, de pins surtout, et généralement elles sont élevées, sur la rive droite principalement.
Nous ne sommes pas encore très éloignés de Nikolaïevsk lorsque sur une falaise déserte de la rive gauche nous apercevons une Croix solitaire. L’abbé Radzichevski nous explique qu’à cet endroit un missionnaire français a été assassiné par les Ghiliaks, en 1837, puis transporté dans le village que nous voyons à une petite distance et mangé par les habitants. Ce village se nomme Vaïte. C’est le point le plus au nord que nous atteignions dans cette partie du voyage. Nous sommes à plus de 53 degrés de latitude.
L’Amour qui, jusqu’à présent, nous avait conduits de l’est à l’ouest, va maintenant nous faire descendre vers le sud-ouest pendant plus de 1 200 kilomètres, jusqu’au 48 degré, pour remonter encore, 1 200 à 1 300 kilomètres plus loin, au 53e degré.
À Vaïte, la route de poste de Nikolaïevsk à Habarovka, qui, avait jusqu’à présent suivi la rive gauche, passe sur la rive droite pour ne plus l’abandonner.
Quelques verstes plus loin, les montagnes qui bordaient l’Amour s’éloignent, et c’est à peine si nous les distinguons encore dans le crépuscule qui commence. Les bords, on ne les voit presque plus, tellement le pays est plat, et tellement ici le fleuve est large et majestueux. Les eaux coulent cependant avec rapidité, car le remous décrit par places des circonférences énormes. De temps à autre, des poissons d’une grosseur invraisemblable sautent hors de l’eau.
À 11 heures nous nous arrêtons devant un fort village, nommé Tyr, pour renouveler notre provision de bois. Nous n’en repartons qu’à 2 heures du matin.
Notre premier repas à bord nous donne la mesure des talents du maître queux : ils ne sont pas très remarquables. Heureusement, pour commencer, il y a une zakouska, maigre mais suffisante, et qui n’est pas comprise dans le prix de la table d’hôte.
Il y a des rites à observer pour la zakouska, rites dont notre gargotier tire un sérieux profit. On avale d’abord un verre de vodka, puis on mange une très petite tartine de caviar conservé, de fromage ou d’une salaison quelconque. Une seconde tartine, une troisième ou plus doivent être précédées d’un nombre égal de verres de vodka. On a ensuite à payer autant de fois quinze kopeks que l’on a ingurgité de verres de cette eau-de-vie. Comme, par hygiène et par goût, nous nous abstenons de la partie liquide de la zakouska, nous comptons par tartines.
Le dîner, à midi, se compose d’une soupe, très souvent aux choux, le fameux chtchi des Russes, dans laquelle nage une tranche de bœuf qui a la prétention d’être du bouilli, mais qu’en réalité il est impossible de manger, tellement il est dur. Ensuite vient un plat, viande ou poisson, puis une compote assez bonne de fruits secs, figues, raisins, pruneaux, ou un entremets sucré. Le soir, un plat de viande entouré de pommes de terre compose à lui tout seul le menu.
Comme quantité, c’est suffisant. Comme qualité, ce serait passable, si notre gargotier n’avait la manie de mettre dans toutes les sauces de la crème, dont les Russes raffolent. Moi qui ne puis souffrir le lait, je suis souvent obligé de manger mon pain sec. Crème dans la soupe, crème sur le poisson, crème sur les rôtis. Trop de crème !
Nous trouvons à bord d’assez bon vin de Crimée, dont le prix varie suivant la marque. Celui que nous prenons, le meilleur marché, coûte un rouble et demi la bouteille. Il se nomme Lafite. Sur la carte nous trouvons, pour ces vins de Crimée, tous les noms des grands crus français : Margaux, Lafite, Pomard, etc., qui, bien qu’agréables à boire, n’ont aucune espèce de rapport comme goût avec les vins dont ils usurpent les nobles titres. Il y en a qui coûtent jusqu’à 4 roubles. Quant aux véritables marques françaises, il aurait fallu une fortune pour les payer.
Parmi les passagers se trouve le chef de la police de ***. C’est un homme on ne peut plus gai et aimable. Ses saillies font rire tout le monde. Mais on sent qu’il a mangé de trop nombreuses tartines. Il paraît que c’est un officier très distingué, dont l’état normal est malheureusement celui dans lequel il se trouve pour le moment : ce qui fait qu’il ne pourra jamais s’élever bien haut. Nous passons à *** dans la matinée et nous rendons le chef à ses adminisitrés.
18 juin. — Je suis de bonne heure sur le pont. Presque personne n’est encore levé. Dans tous les coins on voit des paquets plus ou moins allongés : ce sont des passagers qui ont passé là la nuit, Derrière le salon, sous la partie couverte, les femmes dorment encore ; elles ont retiré leurs jupes pour s’en couvrir, car les nuits sont fraîches.
Peu à peu tout le monde s’éveille et s’habille. Les couvertures, les hardes qui ont servi se plient et reprennent la forme de paquets. Les gens ouvrent un panier, un cabas, pour y chercher l’indispensable théière ; ils étalent devant eux leurs petites provisions, puis vont à la cuisine faire verser l’eau bouillante sur les feuilles de thé. Les uns trempent leur pain dans le liquide brûlant, d’autres le mangent en grignotant un morceau de sucre, dont les Russes sont en général très friands.
Bientôt le Mouravieff Amourski retrouve sa physionomie de jour. Dans le salon, tout le monde a pris le thé, et le vint recommence de plus belle.
Vers midi, nous arrivons à Maryinsk, le plus gros village cosaque entre Nikolaïevsk et Habarovka. Nous passons Sophyisk, qui est relié par une route de poste à Alexandrevsk, où nous étions le 13 dernier, et nous nous arrêtons pour la nuit à Jerebtsova.

L’excellent général Kakourine à déjà fait plusieurs fois la route. Il a même redescendu l’Amour depuis Stretinsk, en radeau. Je lui sus redevable d’une grande part des renseignements que j’ai pu réunir en Sibérie. Il me donne une foule de conseils pratiques pour le voyage en tarantass, et me promet de télégraphier au gouverneur général de la Transbaïkalie pour le prier de nous aider de tout son pouvoir.
Toutes les fois que nous allons arriver dans un joli site, il s’empresse de venir nous chercher, et ce n’est pas une sinécure, car les jolis sites sont très nombreux. Il nous fait suivre notre route sur une magnifique carte de l’état-major, qui est déployée devant lui. Il nous montre dans le fond, à l’ouest, la grande chaîne des monts. Kingane qui va de la mer Jaune à la mer d’Okhotsk presque en ligne droite ; puis, à l’est, la chaîne des monts Sahota-Aline qui longe la côte depuis Vladivostok jusqu’à Nikolaïevsk. C’est cette dernière qui à empêché l’Amour de continuer à couler vers l’est et l’a forcé à un détour de plus de mille kilomètres vers le nord. Le fleuve a cependant fait tout son possible pour franchir cette barrière ; car, tandis que la rive gauche, habituellement plate, presque au niveau de l’eau qui bien souvent l’inonde, offre aux regards d’immenses plaines couvertes d’une herbe haute et serrée, sans un arbre pour en rompre la monotonie, la rive droite, au contraire escarpée, très élevée, n’est qu’une suite de montagnes boisées formant les premiers contreforts de la chaîne Sahota-Aline.

À mesure que nous avançons vers le sud, la neige se fait plus rare sur les sommets : la température devient plus chaude, car nous n’avons pas ici, comme dans la mer, les courants glacés du nord pour la refroidir. Mais, d’autre part, les journées deviennent moins longues, commençant plus tard et finissant plus tôt.
La différence de conformation des deux rives a une grande influence sur la population. Sur la rive droite de l’Amour, c’est-à-dire sur la partie montagneuse et boisée, je ne compte pas moins, sur la carte de l’état-major, de soixante-douze endroits habités entre Nikolaïevsk et Habarovka, tandis que sur la rive gauche il n’y en a que vingt-sept. Ces endroits marqués comme habités ne sont pas tous des villages, à moins que deux ou trois maisons réunies n’aient droit à cette appellation.
Presque à chacun d’eux, des piles de bois sont rangées à côté de l’eau avec l’écriteau : à vendre. Les steamers ne s’arrêtent pas indifféremment à une station où à une autre ; ils font, de préférence, escale dans les centres les plus grands de population, pour deux raisons : la première c’est qu’ils peuvent y prendre quelque petit fret, quelques voyageurs, et la seconde c’est que, comme beaucoup de nos passagers se nourrissent eux-mêmes, ils y trouvent en abondance des provisions, c’est-à-dire du pain de seigle, du lait, de cette maudite crème qui fait mon désespoir, du saumon séché et quelquefois des œufs. La route de poste suit Le bord de l’Amour, et le fil télégraphique qui relie Nikolaïevsk à Saint-Pétersbourg suit la route de poste. Les stations télégraphiques sont nombreuses : notre arrivée prochaine est donc toujours annoncée dans les grands centres. Du reste, nous sommes attendus presque à heure fixe, puisque nous portons la malle, et les gens du village peuvent préparer à coup sûr leurs provisions.

Ils sont là sur la berge, par groupes ou isolés, surtout des femmes, tenant dans leurs bras les denrées à vendre. À peine une longue planche a-t-elle établi les communications avec la terre, que les gens du bateau se précipitent à l’assaut des victuailles. Presque tous ont une ou deux bouteilles vides qu’ils échangent contre le même nombre de bouteilles pleines de lait, pour la modique somme de un ou deux kopeks. On les voit soupeser avec la main tous les pains l’un après l’autre, afin de bien choisir le plus lourd et d’en avoir pour leur argent. Munis d’un couteau ; ils examinent la crème, y goûtent, ne se décidant à la prendre qu’après être certains d’avoir bien choisi la meilleure. Les vendeuses les laissent faire, passives ; c’est à peine si l’on entend l’ombre d’une discussion. Mais je remarque que bien souvent ce sont les femmes les plus pauvrement habillées, celles qui, à en juger par leur aspect, auraient le plus besoin des quelques kopeks que peuvent leur rapporter leurs marchandises, qui s’en défont les dernières et qui quelquefois nous regardent partir l’air navré sans avoir rien vendu.
Rien n’est gai comme l’arrivée à une escale. Tout le monde en général y est propre. On n’y remarque que peu ou point de guenilles ; partout des couleurs voyantes où le rouge domine, mais un rouge coquelicot : c’est la couleur préférée par les hommes pour leurs blouses, par les femmes pour leurs robes. Tout ce qui n’est pas rouge vif est ou rose, ou vert, ou blanc.
Souvent, au milieu de la verdure, dans un buisson, on aperçoit avec stupéfaction des fleurs d’une grandeur démesurée que le vent agite, tantôt courbe et tantôt redresse : en s’approchant on découvre que ce sont des jeunes filles à moitié cachées dans le feuillage. Les hommes ont presque tous des bottes ; les enfants et les femmes marchent généralement pieds nus. Ces dernières ont sur la tête un fichu noué sous le menton, quelques-unes ont un châle sur les épaules.

19 juin. — C’est aujourd’hui dimanche. Aux escales, les gens sont encore plus propres et mieux habillés que les autres jours. Beaucoup de jeunes filles portent une jupe dont le bas est orné d’une large bande de broderie de toutes les couleurs. En somme, aucun de ces Sibériens ne paraît misérable. Tous ont un air de prospérité qui surprend, car on ne voit nulle trace d’un travail dont cette prospérité serait Le fruit. On est tenté de croire plutôt que ne rien faire est la principale occupation des habitants de tous ces villages. En effet, pas la moindre culture autour des hameaux, par le plus petit jardin autour des maisons ; le gouvernement leur fournit une certaine quantité de farine : à quoi bon cultiver la terre pour faire pousser du grain ? Et puis n’ont-ils pas ces pêches qui tiennent du miracle et qui leur donnent en quelques jours de quoi vivre le reste de l’année ? N’ont-ils pas là, sous la main, du bois pour se chauffer d’abord et pour vendre aux bateaux à vapeur, afin d’acheter de belle toile rouge ? N’ont-ils pas des troupeaux dont ils peuvent tirer, outre leur nourriture, un certain revenu par la vente du lait, de la crème, de la viande ?
Le Sibérien, dont les besoins sont restreints, est très paresseux : cela ne fait aucun doute, mais c’est parce que la Sibérie est trop riche, étant donné son peu de population. Du reste, nous dit-on partout, « ce sont des Cosaques », or qui dit Cosaque dit tout.
Les Cosaques sont en quelque sorte des colons enrégimentés, chargés héréditairement de défendre le pays contre les attaques des voisins, On sait quels services rendirent à l’Europe, au commencement du xvie siècle, ces colons ukrainiens et moscovites établis sur la Volga, le Dniepr et le Don, où ils menaient une existence libre, vivant de ba chasse et de la pêche, en arrêtant l’invasion des Tatars et des Turcs. Les Cosaques de l’Amour, colons comme ceux du Don, se considèrent comme appelés à rendre les mêmes services et par conséquent montrent le même orgueil et la même horreur de tout travail manuel. Ce sont des guerriers, Monter à cheval ou conduire, voilà leur seul plaisir et la seule occupation à laquelle ils ne refusent jamais de se livrer. Les Cosaques de Transbaïkalie furent les premiers organisés pour faire le service à la frontière chinoise en 1815. Ceux de l’Amour ne datent que de 1859.
Le soir vers 5 heures, nous longeons une falaise très élevée qui domine le fleuve sur la rive droite. Tout au sommet se dresse une croix. Est-ce encore en souvenir de quelque missionnaire auquel l’estomac des habitants a servi de tombeau ? Deux enfants sont à côté : leur blouse rouge tranche agréablement sur la sombre verdure des sapins qui les entourent.
Le beau tableau qu’offre le paysage a attiré tous les passagers et suspendu le vint pour quelques moments. C’est que nous arrivons à Malmechskoï, lieu très intéressant à plusieurs points de vue. D’abord, paraît-il, au sommet de la falaise, à côté de la croix, se trouvent les restes d’un fort chinois en terre. Et puis Malmechskoï produit le caviar salé le plus renommé de tout l’Amour. Ce caviar se vend dans des vessies aplaties, qui ont tout à fait la forme d’un jambon.
Bien que nous ne voyions aucune habitation, on annonce que nous mouillerons dans quelques minutes. En effet, arrivés au bout de la falaise, nous tournons à angle droit. Devant nous, en plein midi, dans un nid de verdure, se trouve le village adossé à une muraille abrupte formée de rochers entre lesquels Les arbres ont poussé leurs racines. Tous les habitants sont au bord de l’eau, dans leurs gais costumes. Ce n’est pas grandiose, mais c’est ravissant.
Hélas ! il n’y a pas de caviar pour tout le monde. On n’en apporte que deux pains. C’est tout ce qu’il y a dans le village. La gourmandise doit obéir aux lois de la hiérarchie. Nous avons deux généraux à bord. Chacun d’eux prend un pain à raison de 45 kopeks la livre.
Nous repartons et le vint recommence. La nuit devient assez sombre, et par peur des bancs de sable, nous renonçons à gagner la prochaine station. Nous mouillons dans un endroit désert et inhabité, à peu de distance du lac Sorgou.
Le caviar étant un des principaux produits du grand fleuve dont nous remontons le cours, il est intéressant de dire quelques mots de l’animal qui le produit et de la manière dont on s’en empare.
Le plus gros poisson que l’on puisse prendre dans l’Amour est l’esturgeon, dont une variété, le belougue, atteint quelquefois le poids énorme de 40 pouds, soit 640 kilogrammes, dont 140 kilogrammes à peu près d’œufs ou caviar. Il se pêche toute l’année, mais principalement depuis la débâcle jusqu’à la fin de juin, car le caviar produit pendant les mois d’été n’est pas mangeable. Les plus beaux esturgeons se prennent entre Nikolaïevsk et l’embouchure du Soungari, c’est-à-dire sur un parcours de 1 200 verstes environ.
Des poutres de quatre ou cinq mètres de longueur sont fixées, à 45 degrés avec le courant, sur des lignes parallèles, barrant la moitié du fleuve. Elles sont munies d’une infinité de cordes de différentes dimensions, à chacune desquelles pend un hameçon sans aucun appât. Tout poisson d’un certain volume passant avec rapidité au milieu des cordes est saisi infailliblement par un ou plusieurs hameçons. Les mouvements brusques que la douleur lui fait faire ont pour résultat de l’accrocher à d’autres, et bientôt il est pris par toutes les parties du corps. C’est ainsi que se pêchent les plus grosses pièces.
20 juin. — Le pays devient moins beau, moins accidenté. Le temps aussi se gâte. Une légère pluie nous force par instants à rester dans le salon. Je cause avec le général Kakourine, qui m’apprend que le général Arsenieff va être nommé d’un jour à l’autre gouverneur de Blagovechtchensk, que peut-être il ne s’arrêtera pas à Habarovka, mais continuera le voyage avec nous.
À la station où nous prenons du bois, nous faisons une promenade dans les environs. La chaleur commence à être assez forte. Les fleurs, peu à peu devenues plus nombreuses, émaillent les prairies. Sédum, nigelle, belvédère, pois de senteur et surtout lis jaunes poussent au milieu de l’herbe, qui ici est très haute. Mais aussi, pas de roses sans épines, pas de fleurs sans chaleur, pas de chaleur sans moustiques. Or ceux de Sibérie ont une vilaine réputation. On nous les avait signalés comme un des grands ennuis du voyage, et ce n’est pas sans terreur que nous les voyons faire si tôt leur apparition.
Il n’est bruit dans le village que d’une nouvelle apportée par un bateau qui descendait le fleuve. Une jeune fille d’une très bonne famille, habitant Habarovka, désespérée du départ d’un officier de la garnison qui venait d’être envoyé à Vladivostok, s’est précipitée dans l’Amour. Malgré toutes les recherches, son corps n’a pu être retrouvé. Chacun porte instinctivement ses regards sur le fleuve comme dans le vague espoir d’y découvrir le cadavre de cette infortunée. Mais l’Amour, souvent sans profondeur et rempli de bancs de sable, n’a pas moins, un peu au-dessous de Habarovka, de neuf verstes de large, d’après la carte de l’état-major, que le général Kakourine veut bien m’offrir et dont je lui suis très reconnaissant. Nos passagers sont fort affectés par celle nouvelle : tous connaissaient la jeune fille.
Au moment de partir on s’aperçoit qu’il y a une petite avarie à la machine, ce qui signifie arrivée à Habarovka avec du retard. Tous nos officiers, qui sont attendus chez eux avec impatience, se précipitent au bureau du télégraphe. Je les vois revenir furieux au bout de quelques minutes : le télégraphiste était trop ivre pour recevoir leurs dépêches.
Voilà un employé qui choisissait bien mal son temps ! Se griser au moment où des officiers supérieurs en inspection ont besoin de ses services ! Nos pauvres généraux ont l’air très déconfit. Ce sont des hommes de famille par excellence, et la pensée qu’on peut être inquiet chez eux les tourmente.
Bientôt le temps devient tout à fait mauvais, la pluie tombe à torrents à deux reprises ; il n’y a que demi-mal, car le pays est assez plat et peu intéressant. Mais nos officiers me font remarquer que la montagne Hertsire, située à une trentaine de verstes de la ville, droit au sud, est couverte de nuages, ce qui est un signe infaillible de mauvais temps. Nous aurions bien besoin cependant d’un peu de soleil, pour visiter Habarovka, la capitale et le grand centre militaire de ces immenses provinces de l’Amour.
XII
Habarovka.
Nous n’arrivons à Habarovka qu’avec une heure de retard. Déjà nous apercevons sur la haute falaise une grande construction isolée, Des soldats montent la garde autour : c’est la poudrière. Plus loin, à une certaine distance, encore une construction, mais plus importante : c’est la prison. Puis nous distinguons les toits de la ville, les clochetons de la cathédrale, et la pointe Mouravieff à l’embouchure de l’Oussouri, surmontée de la statue du conquérant de l’Amour, qui domine le fleuve et son affluent. Enfin nous sommes amarrés à un grand ponton en fer en communication avec la terre.

Mme la générale Arsenieff monte à bord avec sa fille.
Elle nous fait le plus gracieux accueil. Puis, pendant
que Marie et elle causent dans le salon, nous regardons,
les deux généraux et moi, le débarquement des
passagers : c’est toujours intéressant. Tout à coup, au
tournant de la route, qui fait un coude, débouche un
magnifique drojki, traîné par deux chevaux superbes.
C’est une femme qui tient les rênes, une femme jeune
et élégante. Au trot de l’un des chevaux et au galop de
l’autre, elle fait décrire à son attelage un cercle de la
plus pure correction, et s’arrête. Un de nos passagers
saute à côté d’elle dans la voiture, qui repart comme
elle est venue. « Eh quoi ! dis-je aux généraux, même à
Habarovka ? — Oui, monsieur, me répond l’un d’eux,
même à Habarovka. »
Bientôt nous restons seuls dans le salon. Il est près de 6 heures, et nous devons aller souper chez le général Arsenieff, ce qui veut dire habit noir et le reste. Or tout cela est dans la soute aux bagages, enregistré pour Stretinsk, et je ne pourrai l’avoir que quand on aura enlevé tous les sacs de dépêches. Cela demande un temps énorme. Vers 8 heures, par une pluie battante, nous voyons arriver, dans sa voiture, le général Arsenieff, qui très aimablement vient nous chercher. Une fois entrés dans l’hospitalière demeure de notre hôte, nous aurions pu nous croire dans n’importe quelle maison de Paris, et cela d’autant plus facilement que le général, sa femme et sa sœur, qui vit avec eux, s’expriment dans le plus pur français. La conversation roule surtout sur des sujets de littérature. Ils sont abonnés à la Revue des Deux Mondes et ont trouvé dernièrement dans certain roman des phrases nombreuses qui les ont plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient s’ils n’avaient pas oublié leur français dans ces solitudes. Ils savaient au fond parfaitement à quoi s’en tenir, mais ils n’étaient pas fichés de prouver que les publications les plus lues à l’étranger doivent toujours observer une grande réserve, si elles ne veulent s’exposer à perdre en un jour la faveur et la réputation qu’il leur a fallu des années pour conquérir. Vers 11 heures la voiture du général nous reconduit à bord.
21 juin. — Il pleut. Il n’en faut pas moins visiter la ville.
À quelque cent mètres de notre débarcadère, en remontant l’Oussouri, commence un village chinois, composé d’une seule rangée de masures en bois, placées au bord de l’eau et adossées à la colline. C’est devant ce village que s’amarrent tous les bateaux chinois venant du Soungari. Nous en rencontrerons encore un assez grand nombre avant d’arriver à l’embouchure de cette rivière. Ils ont bien la même forme que ceux que l’on voit sur le Peï-Mo : même mât, même voile, mais ils nous paraissent un peu plus fins. Comme Habarovka est en communication directe par l’Amour avec l’Europe, c’est donc un centre assez important, où l’on trouve une foule de produits de notre industrie, à meilleur compte que lorsqu’ils viennent par les ports du nord de la Chine et la voie de terre. Je ne crois cependant pas que le commerce soit très actif.
La ville est bâtie sur trois montagnes presque parallèles. Un grand boulevard suit la crête de chacune ; mais des rues toutes droites les relient entre elles, en suivant les ondulations du terrain, que l’on n’a cherché à atténuer ni par des courbes ni par des remblais. Cochers et chevaux ont du reste l’air d’être habitués à ces pentes invraisemblables et de ne pas plus s’en soucier les uns que les autres.

Le débarcadère est au pied de la colline centrale. Comme cette montagne est presque à pic du côté de la rivière, il faut en faire le tour. La route, formant un demi-cercle réguler, longe un petit ruisseau qui vient se jeter dans l’Oussouri, à quelques mètres au-dessus du ponton. Elle est bordée de chaque côté par une suite de petites maisonnettes basses en planches, dans lesquelles on vend exclusivement des provisions de bouche pour les nombreux passagers des bateaux : poissons frais et salés, saucisses, œufs, viande crue et cuite, surtout pain blanc et noir. La vodka est également débitée au verre et à la bouteille. Bien qu’il soit interdit aux passagers de troisième d’en emporter à bord, la consigne n’est pas scrupuleusement observée et il en pénètre toujours.
Les gens qui tiennent ces petites boutiques offrent un mélange extraordinaire de toutes les races qui composent l’immense empire russe, avec addition de Chinois. Les femmes y sont en grand nombre. Notre foire aux jambons de Paris, si elle était installée autour d’un monument rond, donnerait une idée exacte de ce marché.
À l’autre extrémité du demi-cercle, nous trouvons la grande rue qui monte au sommet de la montagne centrale. Une douzaine de forçats, les fers aux pieds, sont occupés à la réparer, sous la garde de quatre Cosaques en tenue de campagne. Tout en haut, ayant vue sur l’Oussouri, se dresse le monument élevé l’an dernier en l’honneur du passage du Tsarevitch. Nous nous trouvons alors sur une grande place : à droite la cathédrale, et plus loin le palais du gouverneur, construit en briques, et d’un assez bel effet ; à gauche, une longue balustrade, vers laquelle je me dirige. Elle longe le bord de la falaise qui domine l’embouchure de l’Oussouri, et me conduit au jardin, c’est-à-dire, comme à Vladivostok, au bouquet d’arbres conservé en souvenir des forêts qui couvraient naguère le pays.
C’est là que se dresse la statue élevée en l’honneur du général Mouravieff Amourski. La vue que l’on a de cette pointe est excessivement belle. Au midi, elle est bornée par les monts Hertsire, à la base desquels apparaît l’Oussouri, qui vient de se grossir d’une petite branche de l’Amour, et qui, s’étendant dans Les plaines, a parfois une largeur de 2 000 mètres. Loin, bien loin dans l’ouest, à plus de 100 verstes, on aperçoit les premiers contreforts des monts Kingane. L’Amour se déroule, petit dans l’éloignement, majestueux quand il s’approche, terrible quand, recevant les eaux de l’Oussouri, il vient heurter la falaise qui arrête brusquement sa marche vers l’ouest et le renvoie vers le nord, où l’œil le suit pendant longtemps. Tel est le grandiose décor que la jeune fille, dont le suicide récent a causé tant d’émoi, a choisi pour être Le théâtre de sa mort ; c’est au pied même de la falaise qu’elle s’est précipitée dans les flots.
À Habarovka les Chinois sont nombreux. Ils sont employés à mille petits travaux dans lesquels ils excellent, et ne tarderont pas à avoir, comme partout où ils pénètrent, le monopole de certains métiers, tels que le jardinage, le blanchissage, la couture, la cuisine et surtout le petit négoce. Une des principales maisons de commerce appartient à un Chinois, Thi-Feng-T’ai, dont on nous a beaucoup parlé. Nous sommes ici dans le pays des riches fourrures : renards bleus et noirs, martres, zibelines, panthères, tigres, pour ne parler que des plus recherchées, c’est ici que l’on peut en voir les plus beaux spécimens. À Pékin, j’ai eu beaucoup à m’occuper, soit pour mes amis, soit pour moi, de ce genre de bibelot, dans lequel je passais pour un connaisseur ; je ne suis pas fâché de pouvoir me faire par comparaison une idée de la valeur de ce que nous achetons en Chine. Or Thi-Feng-T’ai est justement le plus grand négociant en fourrures de Habarovka. Je me dirige donc vers sa demeure.
Son magasin ressemble au premier magasin venu de mercerie en Europe, et au premier abord on est fort surpris de voir des Chinois derrière les comptoirs, en train d’auner du fil ou de vendre des jarretières à quelque noble dame de la ville. On me demande en russe ce que je désire, et je réponds en chinois que je veux voir le patron. Ahurissement complet des employés, qui en négligent leurs pratiques. Au bout de deux minutes, le magasin est envahi par tout ce qui, dans la maison, porte une natte derrière la tête. On veut voir l’étranger qui parle la langue mandarine. C’est une curiosité, à ce qu’il paraît. Bientôt arrive Thi-Feng-T’ai lui-même, petit, gros, empressé, qui immédiatement me prend par la main, chose peu chinoise, et me conduit dans ses appartements particuliers, chose moins chinoise encore. Il a choisi tous ses employés parmi ses compatriotes, mais ses domestiques sont Russes. C’est sa femme chinoise qui vient elle-même nous servir le thé et Les gâteaux.
Thi-Feng-T’ai est un des vieux colons de Habarovka, où il est arrivé comme simple ouvrier. Il n’a que quarante-huit ans. Malgré les règlements qui interdisent aux étrangers de posséder, il est propriétaire de plusieurs maisons et de vastes terrains. On ferme les yeux, car il est à peu près entendu que son fils se fera naturaliser. Celui-ci est déjà chrétien et ne porte pas la queue. Thi-Feng-T’ai, lui, ne veut pas couper sa natte : « On ne fait pas cela à mon âge, dit-il, je l’ai toujours portée, je mourrai avec ». Se faire chrétien lui serait parfaitement égal ; mais le pope chargé de le baptiser, que dirait-il de l’existence de son harem ? Laquelle de ses trois femmes lui laisserait-on ? La première en date probablement, c’est-à-dire la Chinoise, celle qui est de son âge. Que deviendraient les deux jeunes, la Japonaise et la Russe ? « Vous comprenez que je ne puis les abandonner. »
Je lui demande à voir ses plus belles fourrures. Il a de superbes peaux de tigre. Nous sommes ici dans la patrie véritable de ce tyran des forêts qui, sous le rapport de la longueur de la toison, est au tigre du Bengale ce que le chat angora est au chat de gouttière.
Les martres sont jolies. Il en a des centaines, mais c’est tout au plus si dans le nombre j’en trouve cinquante très belles. Ces dernières lui reviennent à une trentaine de roubles la pièce. Ce qui me séduit, c’est, au milieu d’autres moins parfaits, un magnifique renard noir. Voilà qui ferait un beau cadeau pour ma femme, dont le jour de naissance arrive le 25 juin ! Thi-Feng-T’ai m’assure qu’une seule peau suffit pour une parure. « À Paris, dit-il, on ne porte plus maintenant de manchon. Avec celle-ci on vous fera un grand col mobile. » Ce Chinois avait raison. À Habarovka on connaissait les modes de Paris, que moi j’ignorais. Je ne puis résister au plaisir d’offrir à ma femme ce souvenir des pays que nous traversons. À la foire de Nijni-Novgorod on m’a demandé six et sept cents roubles pour des peaux de renard noir qui ne valaient pas à beaucoup près celle-ci.
Je retourne à bord par une pluie battante qui m’empêche de continuer ma promenade dans la ville. Impossible de songer à faire de la photographie.
Devant notre ponton, au pied de la colline, est un grand hangar composé de six ou huit piliers de bois supportant une toiture. Ce n’est, en somme, qu’un vaste parapluie sous lequel une foule de gens ont cherché un abri. Ce sont presque tous des passagers qui attendent un départ pour Blagovechtchensk, Nikolaïevsk ou l’Oussouri. Parmi eux, beaucoup de Chinois.
En Sibérie, l’heure des repas est des plus variées. Nous avons été invités à dîner à toutes les heures depuis midi jusqu’à 7 heures. Il faut que l’estomac se fasse à cela. Aujourd’hui, par exemple, nous dînons à 3 heures chez le général Arsenieff et nous soupons à 7 heures chez le général Kakourine. Nous nous efforcerons de faire honneur, malgré le déjeuner qui nous est servi à bord à midi, aux deux esturgeons que l’on ne manquera pas de produire sur la table dans ces deux maisons. Car l’esturgeon est le meilleur poisson de l’Amour. Ne pas en offrir serait manquer aux lois de l’hospitalité. Il est du reste excellent quand il est encore de très petite taille, c’est-à-dire quand il pèse sept ou huit livres seulement.
Plusieurs maisons de Habarovka ont une sorte de terrasse couverte, remplie de fleurs, qui forme comme une annexe au salon. Cette terrasse doit être garnie d’une double rangée de vitres pendant la saison froide et faire un jardin d’hiver. Maintenant nous sommes en été et c’est ici qu’on se réunit pour prendre le tchai, c’est-à-dire le thé, toujours accompagné d’une mince tranche de citron, et toujours exquis.
N’est-il pas superflu de dire que Mme Kakourine, elle aussi, parle très bien le français ? Nous ne sommes toutefois pas peu surpris d’apprendre que sa sœur a habité longtemps Tien-Tsin, que c’est la femme du colonel Poutiata, attaché militaire russe en Chine, que nous connaissons fort bien.
La maison où le général nous reçoit a été louée temporairement. La sienne est en réparation, et il nous propose d’aller la voir, en attendant le souper. Son véritable but était, j’en suis persuadé, de nous montrer deux tapisseries, deux merveilles dignes de trouver, un jour, une place dans un musée. Elles représentent, l’une les enfants d’Édouard, l’autre un lansquenet. Aucune description ne saurait donner une idée de la pureté du dessin, du choix des couleurs et de l’harmonie des tons. On dirait de vieilles tapisseries des Gobelins. Comment le général a-t-il pu découvrir ces deux chefs-d’œuvre d’art et de patience dans ces pays perdus ? La réponse fut bien simple : « C’est ma mère qui a fait ces deux tapisseries ».
Le général habite la Sibérie depuis de longues années. Il était en Transbaïkalie avant de venir à Habarovka. Il connaît donc merveilleusement le pays, et nous indique sur la carte de l’état-major les points les plus remarquables du voyage, et ceux également où il est particulièrement nécessaire de ne pas s’endormir par crainte des mauvaises rencontres. Il ajoute qu’il a déjà télégraphié et écrit à notre sujet au gouverneur de Blagovechtchensk et au gouverneur général de la Transbaïkalie. C’est avec plaisir que nous nous chargeons de quelques commissions du général et de Mme Kakourine pour le colonel et Mme Poutiata, en ce moment à Saint-Pétersbourg. Nous prenons congé de nos hôtes et retournons à bord dans leur voiture, sous un véritable déluge.
Le fidèle Hane était couché en travers de la porte de notre cabine, le samovar tout prêt pour le cas où nous aurions besoin d’eau bouillante.
22 juin. — Le temps est couvert, mais il ne pleut pas : sortons vite pour faire quelques photographies. Je prends une voiture d’un modèle assez curieux et qui se trouve presque partout en Sibérie. Elle se compose d’une double banquette sur laquelle on est assis comme sur l’impériale des omnibus en France, dos à dos : ce n’est pas commode pour causer. Je veux aller sur la montagne derrière le village chinois qui est le long de l’Oussouri. La route est abominable. Le cheval s’abat et nous sommes obligés, Hane et moi, de mettre pied à terre dans la boue.
À 9 heures et demie, les voyageurs de pont commencent à affluer. Il y en a de toutes descriptions. Beaucoup sont chargés d’un paquet contenant quelques guenilles. D’autres n’ont que les vêtements qu’ils portent sur eux. L’animation est extrême dans la rue circulaire aux boutiques. Les piles de pains et de saumons, les rangées de bouteilles de lait disparaissent comme par enchantement.
C’est que non seulement nous allons appareiller, mais l’Alexis, bateau de notre compagnie, beaucoup plus petit que le Mouravieff Amourski, est arrivé de Blagovechtchensk dès hier matin, et va partir un peu après nous pour Nikolaïevsk. Il a aussi des passagers. Il a apporté les malles d’Europe, et les lettres ne sont pas encore distribuées ! Le public subit ces lenteurs sans en approfondir les raisons.
Bientôt le pont est encombré au delà de toute expression. Les amis de ceux qui partent sont venus leur dire adieu : les larmes se mêlent aux baisers. Le plus affairé de tous, celui qui serre le plus de mains, c’est Thi-Feng-T’ai. La popularité dont il jouit semble être universelle, car il est choyé par tout le monde. Il me présente deux Chinois qui vont à Blagovechtchensk, où se trouve leur maison de commerce.
Nous voyons arriver le général Arsenieff avec sa femme et sa fille. Ils ont tenu à ce que nous ne fussions pas les seuls à ne pas serrer une main amie en quittant Habarovka. Nous sommes très touchés de cette démarche. Il a, lui aussi, télégraphié au général Popoff, gouverneur de Blagovechtchensk, auquel il doit prochainement succéder.
Bientôt nous partons : les mouchoirs s’agitent, les chapeaux se lèvent. Au bout de quelques minutes, nous ne distinguons plus les personnes, mais nous voyons toujours les signes d’adieu. Nous continuons à apercevoir pendant longtemps la triple colline sur laquelle la ville est assise, magnifique position stratégique qui commande et l’Amour et l’Oussouri, et d’où l’on pourrait facilement foudroyer l’envahisseur assez téméraire pour y envoyer des navires.
Ai-je dit que Habarovka (écrit d’ordinaire Khabarovka) tire son nom du Cosaque Habaroff qui, à la tête de quelques aventuriers, fit une des premières expéditions sur l’Amour, en 1648 ?
Le fleuve est ici à 77 mètres au-dessus du niveau de la mer.
(La suite à la prochaine livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[44],
XIII
De Habarovka à Blagovechtchensk.
ous passons au
nord de l’île
Oussouri. Cette île a
donné lieu à de sérieuses
contestations
entre la Russie et le
Céleste-Empire.
Les Chinois prétendaient que l’Oussouri se divise en deux branches qui vont se jeter dans l’Amour, à 50 verstes de distance, l’une à l’est, l’autre à l’ouest, et que, comme l’Amour sert de frontière aux deux pays, l’île leur appartenait.
Les Russes, de leur côté, affirmaient que l’Amour se divise en deux branches dont l’une, celle qui coule au sud, vient recevoir les eaux de l’Oussouri, et que, comme l’Amour sert de frontière, l’île par conséquent ne pouvait être qu’à eux. Ce fut la diplomatie russe qui l’emporta.

Hélas ! nous avons perdu nos officiers ! Adieu le français, car, à part notre capitaine Phalsky, Polonais de naissance, qui n’en sait pas beaucoup plus que je ne sais de russe, et un officier à peu près de même force, dont la mère cependant est Française, personne à bord ne parle notre langue. J’ai essayé le latin avec l’abbé Radzichevsky, mais il à fallu y renoncer. Notre prononciation était tellement différente que nous étions obligés d’écrire notre conversation. Heureusement il y a les deux Chinois avec lesquels nous pouvons causer et qui me fournissent quelques renseignements.
Sur le pont, nous avons deux Goldes, habillés de fourrures qui ont été blanches, recouvertes d’une cotonnade qui a été bleue. Ils sont fort sales. Par les traits ils se rapprochent beaucoup des Mongols et sont, comme eux, nomades, mais pas de la même façon. En effet, les Mongols, grands éleveurs de troupeaux, vont planter leur tente là où il y a de l’herbe, à mesure que les environs de l’endroit où ils se trouvent sont rasée par leurs bestiaux. Les Goldes, peu nombreux, n’ont pas de tentes. Ils vivent sur l’eau, sans jamais s’écarter beaucoup du Soungari et de l’Oussouri, qui semblent être leurs limites est et ouest. Le poisson est leur nourriture presque exclusive.

Nous avons cessé depuis assez longtemps de voir les Ghiliaks, dont les traits nous rappelaient si bien les Peaux-Rouges de l’Amérique. Ils se tiennent plus au nord et descendent rarement jusqu’à Habarovka. Nous avons aperçu le dernier sur la berge, il y a deux jours. Il fumait tranquillement sa pipe en nous regardant passer.
Les Goldes du bas Amour ont de nombreux points de ressemblance avec les Ghiliaks. Ils paraissent cependant moins sauvages. Les femmes sont coquettes ; elles ornent leur chapeau de bimbeloterie. Non seulement elles portent jusqu’à trois rangs de boucles d’oreilles énormes fixées dans trois trous superposés, mais leur nez est orné d’un gros anneau, le plus généralement en argent.

Toutes les différentes hordes qui peuplent le nord-est de l’ancien continent ont, à n’en pas douter, la même origine. Mais chacune tient à sa dénomination propre et méprise ses voisines.

À l’avant-dernière station, Marie, se promenant avec le capitaine, vit sur la berge des indigènes accroupis : « Sont-ce des Ghiliaks ? » demanda-t-elle à haute voix. « Niete Ghiliaks, Toungouses », répondirent eux-mêmes ceux-ci avec les marques de la plus profonde indignation.
La peuplade des Toungouses, peut-être la plus importante des tribus indigènes de la Sibérie, s’étend depuis l’Amour jusqu’au 60e degré de latitude et de la mer d’Okhotsk jusqu’au Iénisséi. C’est en 1675 que leur prince Ganetimour fit, avec sept nulle des siens, sa soumission à la Russie.
Les Toungouses sont beaucoup plus civilisés que les Goldes et les Ghiliaks, avec lesquels cependant ils ont de nombreux rapports. Lesseps, qui a traversé le pays en traîneau, prétend que leur ressemblance avec les Russes est frappante. Je retournerai la proposition et je dirai qu’un grand nombre de Russes offrent une ressemblance frappante avec les indigènes de l’Asie, ce qui s’explique par ce fait que tous les jours des indigènes asiatiques renoncent à leur costume, à leur religion, à leurs coutumes, à leur nationalité, pour adopter les coutumes, la religion, le costume des Russes, et devenir sujets du Tsar. Nous en avons plusieurs exemples, même parmi nos amis.

Le Mouravieff ne marche plus avec la même rapidité. C’est que, depuis Habarovka, nous avons à la traîne une grande barge, plus longue et plus large que notre steamer. L’intérieur contient des marchandises à destination du haut Amour ; sur le pont se trouvent près de deux cents soldats, avec les femmes de ceux qui sont mariés et les enfants. La corde qui relie ce bateau au nôtre ayant plus de 100 mètres de longueur, ils sont à l’abri des étincelles. Pendant les averses, on étend sur eux de larges tentes en toile pour les protéger, absolument comme on couvrirait des sacs ou des caisses, sans aucuns montants pour maintenir ces tentes un peu au-dessus de leurs têtes.
Le pont du Mouravieff est dégagé d’autant, mais nous avons pris, en échange, un certain nombre de passagers nouveaux de troisième et parmi eux quelques Chinois.
Aux secondes, nombreuse compagnie, surtout beaucoup d’enfants. Dans une famille j’en compte huit, dont l’aîné n’a pas quinze ans ; dans une seconde, six ; et tout ce petit monde paraît très bien élevé.
Nous avons aux premières un monsieur en uniforme qui fait voyager sa femme en seconde. C’est un employé du cadastre ; il n’a pas trente ans. Il a été retenu par ses fonctions pendant deux ou trois ans sur les bords de l’Oussouri, et nous raconte du tigre et de l’ours dans ces contrées les histoires les plus effrayantes. Il est certain que ces animaux pullulent, à en juger par les nombreuses peaux que l’on voit chez les marchands et les méfaits dont nous les entendons charger à chaque instant.
Le pays est devenu beaucoup moins beau, très plat, surtout du côté russe. Ce ne sont qu’immenses prairies, où je suis surpris de ne pas voir une seule tête de bétail. Il semble qu’on devrait pouvoir élever ici des millions de bœufs comme en Australie, en Amérique ou même dans les plaines de la Mongolie. On me répète ce que l’on m’a dit au-dessous de Habarovka, que l’herbe magnifique que je vois, et qui a plus de deux pieds de haut, n’a aucune qualité nutritive. Je veux bien le croire, mais je ne puis m’empêcher de le déplorer.
Les rives du fleuve sont rongées par les eaux. On ne voit partout qu’arbres tombés, retenus encore par quelques racines. C’est que le sol n’a pas de profondeur. Bien souvent l’épaisseur de l’humus n’atteint pas 20 centimètres, et, les racines se refusant à pénétrer dans l’énorme couche de sable qui est en dessous, les bords sont continuellement minés et s’éboulent.
Du côté russe, aux endroits où la berge est un peu élevée et en plein midi, elle est, jusqu’à un mètre à peu près de la surface, percée de trous multiples de la grosseur d’une pomme, qui la font ressembler à une éponge ; ces trous, dont je ne puis d’abord m’expliquer la cause, ont été creusés par les hirondelles, auxquelles ils servent de nid. Ces gentils oiseaux sont en effet ici dans un pays de Cocagne. Rien ne vient troubler leur quiétude, si ce n’est de temps en temps le bateau qui passe ! Ces immenses prairies, le plus souvent marécageuses, leur fournissent en abondance les moustiques dont ils sont friands. Ils élèvent en paix leurs petits, ne regrettant, j’en suis sûr, qu’une seule chose, c’est qu’un été trop court ne leur permette pas de jouir assez longtemps de cet Éden. Sur la rive chinoise, peu ou point de ces nids ou plutôt de ces terriers. C’est qu’elle est presque partout exposée au nord, c’est-à-dire aux vents glacés.
L’Amour est naturellement moins large qu’au-dessous de Habarovka. Mais il atteint encore de loin en loin de 5 à 6 kilomètres d’une rive à l’autre. Les bancs de sable sont nombreux au milieu du courant, dans lequel nous décrivons des zigzags sans fin, longeant tantôt la côte russe et tantôt la côte chinoise. Sur cette dernière, nous avons déjà vu deux postes militaires gardés par des Mandchous, portant le costume de leurs « bannières ». Nous ne voyons ni femmes ni enfants, mais il doit y avoir à peu de distance un petit village où se trouvent les habitations particulières de ces soldats.
Cependant les eaux du fleuve ont changé d’aspect. Toujours noires le long de la rive gauche, elles deviennent d’abord grises le long de la rive droite, puis blanchâtres. C’est que nous arrivons à l’embouchure du Soungari, l’affluent le plus considérable de l’Amour, le grand déversoir de l’immense vallée des monts Kingane, dont les flots limoneux sont d’un jaune sale, comme ceux, du reste, de presque tous les fleuves grands et petits de Chine.
Que de fois n’ai-je pas entendu les Russes déplorer que le général Mouravieff n’ait pas choisi le Soungari comme frontière entre les empires russe et chinois ! Cela eût été très beau en effet et eût augmenté la facilité du système de défense, le Soungari et ses affluents offrant au moins 2 000 verstes de plus à la navigation, dans un pays beaucoup plus peuplé que la rive gauche de l’Amour. Mais il ne faut pas oublier que le Soungari arrose tout le nord de la Mandchourie, que la dynastie qui règne actuellement en Chine est la dynastie mandchoue et que de grands souvenirs historiques se rattachent à ce pays. Le Céleste Empire n’aurait peut-être pas renoncé facilement et sans lutte à la possession d’un pays où s’est passée une partie de son histoire, et qui est le berceau des ancêtres de ses souverains.
L’archimandrite Palladius, qui, lors de mon arrivée à Pékin, dirigeait en cette ville la mission orthodoxe, fut chargé par la Société de géographie de Saint-Pétersbourg d’explorer la Mandchourie, et consacra une année entière à la parcourir dans tous les sens. Il y trouva les ruines de nombreux établissements, décorés dans les annales du nom pompeux de villes, mais qui ne devaient être, en réalité, que des camps retranchés construits par les guerriers pillards.
Dans le sud, beaucoup plus fertile, et par suite beaucoup plus peuplé que le nord, dont le climat est fort rude, onze nations ou plutôt onze tribus indépendantes se partageaient quelque deux cents kilomètres carrés de terrain montagneux.
L’une d’elles était la tribu mandchoue. Le fait que les historiens parlent des six « villes » qui lui appartenaient, et racontent « qu’un de ses souverains, d’une bravoure héroïque, rassembla les forces du royaume, attaqua et défit dix-huit brigands, ce qui le rendit maître de cinq passes dans les montagnes et de cent kilomètres de territoire », donne une idée de son importance, à l’origine.
Et pourtant c’est elle, l’une des-plus petites, qui, après avoir soumis les dix autres, est parvenue à s’emparer d’un des plus grands empires du monde, et à commander à 400 millions d’individus.
C’est en l’année 926 de notre ère que la domination des Mandchous s’étendit pour la première fois sur la partie septentrionale de la Chine. Les envahisseurs portaient alors le nom de Kitane, d’où les Russes ont tiré celui de Kitaï par lequel ils désignent encore, à l’heure actuelle, le Céleste Empire et ses habitants.
Cependant la chaleur est devenue beaucoup plus forte. Depuis l’embouchure du Soungari nous sommes sous la même latitude que Paris. Les fleurs, rares d’abord sur le bas Amour, plus nombreuses à mesure que nous avancions vers le sud, constellent maintenant les prairies, qui s’étendent à perte de vue et se déroulent à notre droite pendant des kilomètres et des kilomètres encore. Les lis surtout, tantôt jaunes, tantôt rouges, tantôt tigrés comme au Japon, apportent une note éclatante et un parfum pénétrant qui vient embaumer l’air jusque sur le pont du bateau, c’est-à-dire souvent à 500 mètres du rivage. Plus loin c’est la même profusion de pivoines sauvages, qui sont simples et presque toujours blanches. À chaque escale les passagers qui descendent à terre reviennent chargés de bouquets énormes.
Le Mouravieff a pris maintenant un aspect particulier : partout où il est possible d’accrocher quelque chose on voit pendre du linge de toute sorte ; les langes cependant dominent. Les bébés sont nombreux à bord et il faut profiter du soleil, qui s’est décidé à se montrer, car un Russe en voyage porte bien rarement avec lui plus de linge qu’il n’est strictement nécessaire d’en avoir. En revanche, il a presque toujours son oreiller, qui lui permet de se coucher tout habillé sur un banc, sur une table ou même par terre dans un coin, sans se trouver trop mal à l’aise. C’est souvent tout son bagage avec ses cigarettes et une icône, dont il ne se sépare jamais.
Il y a aux secondes, depuis Nikolaïevsk, un individu qui nous intrigue ; il est vêtu d’un complet noir et porte un chapeau melon, ses mains sont abritées sous une paire de gants jaune-paille, trop grands pour lui et manquant de fraîcheur. Il se promène gravement, un stick à la main et le cigare aux lèvres du matin au soir : il ma tout l’air d’un Chinois déguisé. C’en est un en effet, ou plutôt un Mandchou devenu chrétien et naturalisé Russe ; il a presque oublié la langue de son pays d’origine, pour lequel il professe maintenant un profond mépris. Il m explique qu’il est employé au télégraphe et qu’il a épousé une Russe, dont il me montre la photographie ; il ne cause du reste ni avec Hane ni avec les négociants chinois de Blagovechtchensk.
Ceux-ci font l’amusement du salon ; on examine leur natte, leurs robes de soie, leurs souliers ; on leur demande de manger avec des baguettes et l’on s’extasie sur leur dextérité. L’un d’eux a eu la mauvaise idée d’acheter à Habarovka une de ces petites boîtes à musique dont les Chinois raffolent : la sienne ne joue qu’un air qui dure deux minutes à peine ; quand c’est fini, ça recommence. Notre homme est enchanté de son acquisition, et dès qu’on n’occupe plus son attention, il remonte sa machine : c’est à rendre fou.
Cependant les plaines ont peu à peu disparu, et c’est au milieu de collines assez élevées que nous mouillons pour la nuit. Nous sommes à l’entrée du défilé des monts Kingane.
24 juin. — Des nuages épais couvrent le ciel. Ils marchent avec vitesse, léchant Le sommet des montagnes élevées qui nous environnent, et les cachant quelquefois à nos regards, C’est un vrai décor d’opéra, Le fleuve s’est considérablement resserré : il n’a pas ici plus de 500 mètres de large, mais en revanche sa profondeur est de 100 pieds. Il coule avec une rapidité vertigineuse, et nous voyons passer à chaque instant de gros troncs d’arbres emportés par le courant, que nous avons de la peine à remonter.
Nous marchons entre quatre murailles de verdure, d’une hauteur considérable, qui se dressent presque à pic, devant, derrière, sur les côtés. Nous ne pouvons pas plus distinguer le défilé qui nous a livré passage que celui qui va nous permettre de continuer notre route. Nous sommes comme dans le fond d’une boîte carrée, et, sans le courant terrible contre lequel nous luttons, nous pourrions nous croire dans un lac de très moyennes dimensions. Le halètement de la machine répercuté par les parois du puits gigantesque dans le fond duquel nous nous trouvons, a des sonorités fantastiques.
Les arbres commencent au pied des montagnes et continuent sans interruption jusqu’au sommet. Leurs premières branches baignent presque dans l’eau. Ce ne sont plus les pins et les bouleaux blancs que nous voyions presque exclusivement entre Nikolaïevsk et Habarovka. Il y en a bien encore, mais en moins grand nombre : beaucoup de chênes et d’érables, mais aucun de ces géants que l’on s’attendrait à rencontrer dans ces forêts impénétrables qui datent du déluge.
Le défilé des monts Kingane, à travers lesquels l’Amour s’est frayé un passage de vive force, est des plus grandioses. La mer intérieure au Japon en donne une idée assez juste, mais elle est très loin d’en avoir la majesté imposante.

En dépit de la pluie fine qui tombe par moments, tout le monde est sur le pont à admirer. Il est impossible, je crois, de rester insensible à la beauté du décor, varié à l’infini dans ses effets, qui se déroule sous nos yeux pendant une partie de la journée.
Quelle heureuse inspiration nous avons eue de renoncer à traverser les plaines monotones de la Mongolie pour remonter le cours de l’Amour ! Que de choses intéressantes nous n’aurions pas vues en suivant le premier itinéraire ! Dans la suite nous rencontrerons de jolis paysages, de belles montagnes, mais rien de comparable au défilé des monts Kingane.
Sur une plate-forme, entre deux contreforts, nous apercevons une maison bizarre. Elle est construite en troncs d’arbres sur le modèle de toutes les maisons en Sibérie, mais c’est à peine si elle a 3 mètres de côté sur 2 de hauteur. Ni porte ni fenêtre à cette étrange demeure. Seulement, du côté du fleuve, au ras de la terre, est ménagée une ouverture carrée pouvant livrer passage à un homme, qui, pour y pénétrer, doit nécessairement se mettre à plat ventre. Une trappe solide placée à l’intérieur permet de clore hermétiquement cette habitation, qui abrite généralement trois ou quatre individus, venus camper dans ces déserts pour y couper du bois. En effet des piles sont déjà prêtes. Quand il y eu aura une quantité suffisante, on fera un radeau avec les plus belles pièces pouvant servir à la construction des maisons, on chargera ce radeau de bois de chauffe pour les steamers et l’on suivra Le fil de l’eau pour vendre le tout dans les villages, ou même à Habarovka ou Nikolaïevsk.
Il faut toute la solidité de la maisonnette que nous avons devant les yeux pour protéger les ouvriers, la nuit, contre les ours, les tigres et autres bêtes dangereuses. Nous avons la bonne fortune de voir sortir un individu de cette espèce de niche. Il rampe comme un reptile et lorsqu’il se lève nous pouvons le contempler : tout le monde a lu Robinson Crusoë : c’est ainsi que je me le représente.
On voit également de temps en temps des huttes de chasseurs et de pêcheurs. Ces huttes sont simplement faites de branches entrelacées. Ceux qui y cherchent un abri doivent se relayer la nuit, afin de ne pas laisser s’étendre les feux nécessaires pour écarter les bêtes fauves.

Le défilé des monts Kingane n’a pas moins de 150 verstes de longueur, et pendant plus de 50 le paysage est féerique. Il commence à Yékatérino Nikolskaïa, et finit, à proprement parler, à quelques verstes au-dessus de Paddevka, par deux énormes cirques formant un S régulier à la suite duquel le fleuve coule, droit comme un canal creusé par la main de l’homme, pendant plus de 30 verstes, suivant sur la rive chinoise une chaîne de montagne assez élevée et également droite, dont il contourne la pointe dans les environs de Pachkova.
Depuis Yékatérino Nikolskaïa nous avons marché presque exclusivement vers le nord. Maintenant nous reprenons la direction nord-ouest. La température, si douce hier, s’est subitement abaissée. Tout le monde est rentré dans le salon, mais moi, je ne puis me résoudre à quitter mon poste d’observation, à côté de la cabine des hommes de barre, qui, par parenthèse, fument comme la cheminée du Mouravieff, ce qui est généralement interdit sur les bateaux.
J’aperçois tout à coup sur la berge, entre des saules, un lièvre assis ; il est du plus beau noir. Notre arrivée le met en fuite. N’ayant jamais entendu parler de lièvre
de cette couleur, je m’abstiens de faire part de cette rencontre ; mais ayant amené le capitaine à nous dire que la Sibérie en produisait effectivement quelques rares spécimens, je déclarai que j’en avais vu un.
25 juin. — Je n’ai aucune difficulté à me procurer de quoi faire un joli bouquet pour Marie, dont c’est aujourd’hui l’anniversaire. Je n’ai qu’à aller à 50 mètres des maisons pour trouver à profusion les fleurs les plus jolies et Les plus odoriférantes.
Vers 2 heures nous passons devant l’embouchure de la rivière Toureya ou Boureya, un des plus gros affluents de l’Amour sur la rive gauche. Elle a ici près de 200 mètres de large. On m’assure que sur son parcours, qui est d’environ 500 verstes, elle traverse des contrées riches en or, dont elle roule même des paillettes.
Nous sommes retombés dans les plaines à perte de vue du côté russe et dans ces prairies constellées de fleurs qui font mon admiration et mon étonnement. La rive chinoise est toujours beaucoup plus élevée. Le soir nous mouillons à Poïarkova.
26 juin. — L’Amour est très large par endroits, mais rempli de bancs de sable, Nous nous arrêtons d’assez bonne heure pour faire du bois, sur la côte chinoise, devant un village dont je demande le nom. Il s’appelle le « village des quatre familles », Sseu-Thia-Ts’oune. On pourrait se croire dans n’importe quel hameau des bords du Peï-Ho, que nous avons quitté il y a quarante jours : mêmes maisons en terre et en briques, mêmes clôtures, même temple au centre du hameau, même aspect des habitants, dont beaucoup sont accroupis sur la berge à nous regarder, les mains cachées dans leurs manches : quelques enfants ont les pieds nus.
Un marchand de petits gâteaux saupoudrés de graines de sésame et d’échaudés frits crie sa marchandise dans les mêmes termes et avec les mêmes intonations que ses confrères de Pékin : « You tcha kouei, joh chao ping ! Échaudés frits à l’huile, galettes brûlantes ! » Le flegmatique Hane sent son cœur tressaillir : il a quelques sapèques dans sa poche, il se régale.

Ainsi font nos Cosaques, mais dans un autre ordre d’idées. Il y a, à peu de distance, un marchand d’eau-de-vie de sorgho, ils envahissent sa boutique et ingurgitent verre sur verre.
Les Russes ont toujours une maxime toute prête pour servir de prétexte à une nouvelle tournée. Un secrétaire d’ambassade à Pékin m’a initié il y a déjà longtemps à cette litanie d’un nouveau genre. On boit :
Un premier verre parce qu’il n’y a qu’un Dieu ;
Un second parce qu’on a deux jambes ;
Un troisième en l’honneur de la Trinité ;
Un quatrième pour les quatre points cardinaux ;
Un cinquième pour les cinq doigts de la main, et ainsi de suite.
Cela mène souvent très loin.
Sseu-Thia-Ts’oune, en sa qualité d’ancien port militaire, possède un temple du dieu de la guerre. Les idoles qu’il contient sont, comme dans tous les villages peu riches ; en torchis recouvert d’une couche de peinture. La piété des fidèles ne va pas jusqu’à réparer les ruines dû temps. Ce pauvre Mars et ses serviteurs commencent à s’écailler.

Les villages chinois sur l’Amour n’ont pas l’air de propreté et de prospérité des villages russes. Ils sont aussi moins gais d’aspect. Plus de vêtements aux couleurs voyantes : le rouge, le vert, le blanc ont fait place au bleu sombre, au gris foncé. Les habits sont souvent rapiécés avec des morceaux disparates.
Et cependant il faut bien constater ici un fait tout à l’avantage de la race jaune. Près dû village, qui maintenant pourrait s’appeler le « village des vingt familles », je vois des cultures, autour de chaque maison un jardinet avec des légumes, et dans les prairies des troupeaux de bœufs et de chevaux. Il faut que les Chinois soient bien favorisés du ciel pour que la terre soit fertile et que l’herbe soit nutritive exclusivement sur la rive droite de l’Amour ! Ne serait-ce pas plutôt qu’ils sont travailleurs et industrieux, lorsque leurs voisins ne je sont pas ?
Dans une petite anse, un carrelet est monté. Notre arrivée a arrêté la pêche. Ce que je vais dire paraîtra extraordinaire et c’est pourtant l’exacte vérité. Nous sommes à plus de 1 700 kilomètres de l’embouchure de l’Amour et ce carrelet est le premier filet que nous voyions. Le Cosaque ne pêche que quand il y a tellement de poisson qu’il n’y a qu’à se baisser pour en prendre. Nous verrons maintenant des filets de pêche, des cultures et des bestiaux dans tous les villages chinois.
Depuis que nous avons quitté Habarovka, nous rencontrons tous les jours de grands bateaux à voiles chinois. Ils peuvent porter de vingt à trente tonnes et sont montés par une vingtaine d’individus. Ils font le trafic entre Habarovka, le Soungari et Aïgoune, où nous arriverons dans quelques heures.
Ils descendent l’Amour avec une grande rapidité, cela se conçoit. Mais comment font-ils pour remonter le défilé des monts Kingane où le fleuve, resserré, coule avec une rapidité si effrayante ? Je m’imagine qu’il y a des jours où ils n’avancent pas d’un kilomètre. I] n’y a pas de chemin de halage, et s’ils font par an un voyage aller et retour d’Aïgoune où nous arrivons, à Habarovka, je considère cela comme très beau.
Aïgoune a été fondé sous la dynastie des Yuane ; c’est-à-dire vers le xie ou xiie siècle de notre ère. C’était primitivement un poste militaire, comme ceux que nous avons rencontrés déjà et sans plus d’importance, Seulement, il se trouvait alors à 4 ou 5 verstes plus haut, sur la rive gauche du fleuve.
La ville actuelle fut construite, mais sur la rive droite, par ordre de l’empereur K’ang-Shi, la vingt-deuxième année de son règne.
Elle est à une distance de 400 kilomètres de Tsi-Tsihar, la capitale actuelle de la Mandchourie, et entièrement sous les ordres de mandarins militaires, dont le plus élevé a le rang de général. La garnison est d’environ 3 000 hommes. Elle se compose de soldats des bannières mandchoues, autrefois armés du fusil à mèche, que l’on change maintenant pour des armes européennes.

Il y a également à Aïgoune une flotte, instituée l’année qui suivit la fondation de la cité actuelle. Nous voyons en effet des jonques de guerre chinoises à l’ancre, un peu au-dessus de la ville. On les reconnaît facilement à la finesse de leurs formes. Elles ressemblent du reste à celles que l’on rencontre sur les fleuves en Chine. Les quais sont très animés et la population a l’air assez dense.

D’Aïgoune à Blagovechtchensk il n’y a plus qu’une quarantaine de verstes. Des deux côtés du fleuve les villages chinois se suivent nombreux et ayant toujours le même aspect. Partout des traces de travail, un peu de culture, des filets de pêche, etc.
Cette présence de villages chinois sur la rive russe de l’Amour demande quelques explications.
Il est rare que les environs d’une grande ville soient inhabités, à moins que cette ville ne soit plantée au milieu d’un désert improductif. Elle est généralement, au contraire, un centre autour duquel viennent s’établir une foule de gens qui vivent d’elle, tout en aidant à sa subsistance. Aïgoune n’avait pas échappé à cette loi, et son influence s’étendait sur une population nombreuse répartie également sur les deux rives de l’Amour, et sur une longueur d’une cinquantaine de verstes.
Lorsqu’en 1858 le traité conclu et signé à Aïgoune par le général Mouravieff Amourski avec les Chinois donna à la Russie toute la rive gauche de l’Amour, il fut stipulé, dans un des articles de ce traité, que tous les Chinois établis sur cette même rive gauche, en face d’Aïgoune, auraient le droit d’y rester, sans cesser pour cela d’appartenir au Céleste Empire. Mais depuis cette époque les Russes n’ont jamais voulu permettre, malgré les récriminations souvent fort aigres de leurs voisins, à de nouveaux Chinois de passer le fleuve pour venir s’établir sur le territoire que le traité venait de leur attribuer.
Nous voyons du côté gauche du fleuve une chose assez curieuse : un canot remonte le courant ; un homme est dedans qui gouverne à l’aide d’une rame plongée dans l’eau à l’arrière. Deux chiens attelés à ce canot au moyen d’une longue corde, suivent la berge en halant de toutes leurs forces. Ils tirent une langue longue d’une aune. Les pauvres animaux doivent être rompus à ce métier, car ils s’en acquittent scrupuleusement. Ce sont sans doute des chiens à traîneau, dont on a eu l’idée d’utiliser l’intelligence et la force pendant l’été.

Les eaux sont devenues troubles : elles sont couvertes d’une grande quantité d’écume. Ce changement d’aspect est dû à la rivière Zéa, longue de plus de 1 000 verstes, le plus important des affluents de l’Amour sur la rive gauche. Elle part des monts Stanovoï, coule d’abord presque directement vers le sud, puis vers le sud-est, parallèlement à l’Amour, pendant plus de 300 verstes, pour revenir ensuite au sud-ouest se jeter dans le grand fleuve, à quelque 2 000 mètres de l’extrémité est de Blagovechtchensk. On trouve sur son cours moyen de nombreuses yourtes de Manégris, branche de la grande tribu des Toungouses.
La Zéa, comme la Boureya, roule des paillettes d’or. Elle traverse des pays où le précieux métal est en abondance. Des usines importantes ont été établies à grands frais dans plusieurs endroits et sont très productives. Des bateaux à vapeur remontent le cours de la Zéa, une ou deux fois par semaine, suivant les besoins.
À son confluent avec l’Amour, la Zéa forme de nombreux bancs de sable qui changent, dit-on, de place, et nécessitent à bord la présence d’un pilote spécial. Nous marchons avec lenteur dans cette eau limoneuse qui rappelle celle du Yang-Tsé, changeant à chaque instant de direction, et guidés par des constructions triangulaires élevées de tous Les côtés sur le rivage. Il paraît que sous son précédent capitaine, le Mouravieff Amourski s’était mis, ici, sur un banc de sable et y était resté six à sept semaines. Nous franchissons heureusement ce passage dangereux et nous nous retrouvons dans les eaux noires de l’Amour, qui est beaucoup moins large que son affluent.
À l’angle des deux rivières s’élève une construction assez importante ; c’est, me dit-on, un moulin à vapeur. Il est situé à l’extrémité est de la grande rue de la ville de Blagovechtchensk, rue toute droite, très large, parallèle au fleuve, longue de plus de 2 kilomètres, mais qui pendant 1 200 mètres au moins n’existe qu’à l’état de projet.
Après le moulin solitaire, au milieu d’une plaine où elle fait l’effet de la grande pyramide dans le désert, se dresse… la cathédrale ! dont la construction n’est pas terminée. À côté une énorme caserne blanche, sans goût, ou une prison : on me dit que c’est le séminaire. Puis plus rien, pas une maison dans un rayon de 500 mètres.
On m’explique qu’il y a là une petite spéculation fondée sur les sentiments religieux bien connus des Russes. Les terrains n’ont aucune valeur pour le moment dans ces parages, mais Les fidèles ne peuvent manquer de venir se placer autour de la cathédrale et d’en faire ainsi monter les prix !
Le fleuve est bordé par des maisons, devant lesquelles est cependant une chaussée qui suit et les sinuosités de l’eau et tous les accidents du terrain. Le ponton auquel nous devons nous amarrer et ses abords sont noirs de monde, ainsi que le vapeur Yermak, qui doit nous conduire à Stretinsk, et qui est mouillé à peu de distance. Le quai est ici orné d’une balustrade derrière laquelle se presse la foule.
À Blagovechtchensk comme partout sur l’Amour, l’arrivée et le départ d’un vapeur sont des événements.
Il est 7 heures du soir : à demain les affaires sérieuses ; à demain ma visite au gouverneur. Car ce n’est pas une petite affaire qu’une visite à un gouverneur en Sibérie ! À n’importe quelle heure même du jour, il faut se mettre en costume de marié, habit noir, cravate blanche, chapeau haut de forme, si, et malheureusement c’est le cas pour moi, on n’est pas l’heureux possesseur d’un uniforme quelconque. J’ai du reste été stylé à ce sujet, et sur la recommandation de mes amis russes de Pékin, j’ai fait venir de Paris un claque, plus portatif en voyage, bien que moins conforme à l’étiquette.
XIV
Blagovechtchensk.
À peine sommes-nous amarrés que le Mouravieff est envahi et que les embrassades commencent.
Un officier cependant fend la foule, adresse une question à notre second, qui me désigne du doigt, s’avance vers moi, me salue et dit : « Je suis le chef de la police, envoyé par le gouverneur. J’ai préparé un logement pour vous, il y a une voiture sur le quai ! Vous pouvez me suivre ! »
Ces paroles, prononcées en Sibérie, ont de quoi faire frémir. Mais notre conscience est tranquille. Nous nous imaginons qu’on nous à retenu une chambre à l’hôtel et que de là nous pourrons envoyer chercher nos bagages, Nous nous apprêtons à suivre le chef de la police lorsqu’un autre monsieur se présente. C’est un Français celui-là, M. Ninaud, dont je connaissais l’existence et que je me proposais d’aller voir demain. Il se met très obligeamment à notre disposition et me dit qu’il va venir immédiatement nous retrouver dans le logement que l’on nous a préparé. Le chef de la police pendant ce temps s’était discrètement éloigné. Quand il nous voit nous avancer, il se précipite pour offrir son bras à Mme Vapereau, nous conduit à une superbe calèche dont un majestueux cocher maintient les chevaux, et lui-même prend place dans un drojki de louage. Nous partons, laissant Hane à bord, mais nous commençons à nous trouver gênés de notre costume de voyage. Et ce fut bien pis lorsque, après avoir contourné deux ou trois pâtés de maisons, nous voyons notre attelage se diriger vers une belle construction en briques, ornée d’un double perron en fer à cheval, devant lequel deux soldats montent la garde : c’est évidemment le palais du gouverneur. On nous conduit à un élégant pavillon où tout est préparé pour nous recevoir. Nous coucherons donc dans un lit ce soir !
Quelques minutes après on nous annonce que Son Excellence le Gouverneur et Mme Popoff nous attendent pour prendre le thé. Il n’y a qu’à nous exécuter et à nous présenter, tels que nous sommes, en nous excusant.
Il est difficile de se figurer des gens plus simples, plus aimables, plus gracieux que nos hôtes. Nous les trouvons entourés de leur nombreuse famille et de quelques amis, et nous avons bientôt fait connaissance, le verre… d’excellent thé à la main. Une Française, née à Saint-Dié et mariée à un Autrichien, musicien remarquable, qui donne ici des leçons, paraît enchantée de voir des compatriotes,
Il faut que j’aille chercher nos bagages. Au moment où nous nous retirons, Mme Popoff nous indique les heures des repas : déjeuner à midi, dîner à trois heures et souper à dix ! Nous commençons à être accoutumés aux heures bizarres. Nous trouvons M. Ninaud qui nous attendait. Il se charge d’aller chercher nos bagages ; mais il revient au bout de vingt minutes, annonçant que Hane, qui a les clefs de la cabine et des malles, a disparu. Que peut-il lui être arrivé ? A-t-il été subitement pris du mal du pays à la vue du drapeau jaune qui flotte de l’autre côté du fleuve et a-t-il gagné la rive chinoise ? Cela me surprendrait fort, étant donné son caractère. Comme nous avons la police dans notre manche il ne sera pas difficile de le retrouver demain, mais il nous faut nos bagages aujourd’hui. Je vais à bord avec M. Ninaud. Hane est sur le pont, tranquille et insouciant comme un homme qui a la conscience calme. Ne comptant pas sur un retour si prompt de notre part, il était allé causer avec des compatriotes.
En retournant au palais je me croisai avec une troupe nombreuse d’hommes, de femmes et d’enfants au teint basané, aux cheveux d’un noir brillant, aux yeux expressifs et intelligents : c’étaient des Tziganes. Il y en a, ma dit ensuite le gouverneur, quarante-deux, qui viennent d’arriver et qui sont dénués de ressources. Une grande et belle femme à l’air insolent me demanda l’aumône dans notre langue en m’appelant « monsieur le voyageur français ».
Ces Tziganes, arrivés par le Yermak, vivent de rapines et de mendicité. Le général Popoff ne sait encore ce qu’il va faire de ces gens turbulents et dangereux que la police est obligée de surveiller. On les mettra probablement sur la barge que le Mouravieff emmènera à Habarovka.
Il est beaucoup plus de 10 heures quand nous nous mettons à table. Ce pauvre gouverneur, depuis ce matin, n’a pas eu une minute de libre. Les officiers se succèdent dans son cabinet et les télégrammes ne cessent d’arriver. Il n’en a pas reçu moins de six pendant le repas. C’est qu’il y a pour le moment une affaire très grave. Un petit steamer d’une compagnie minière sur la Zéa, monté par trois hommes, s’étant arrêté le long de la berge pour faire du bois, a été attaqué par des voleurs. Un des matelots a été tué, les deux autres blessés, et l’or qu’ils transportaient à Blagovechtchensk enlevé. Il y en avait 17 pouds, ce qui, à 16 kilogrammes le poud, fait 272 kilogrammes, soit près d’un million de francs.
Cent Cosaques à cheval ont été envoyés dans toutes les directions. Mais jusqu’à présent aucune piste sérieuse n’a été découverte. L’opinion générale est que l’or a été enterré et que ce ne sera que dans quelques mois, pendant le traînage, qu’on cherchera à l’écouler, probablement avec l’aide des banques chinoises.
27 juin. — Je cours dès l’aube chez M. Ninaud. Cet excellent homme veut bien me servir de guide. Il est négociant en même temps que pâtissier et confiseur, et jouit à Blagovechtchensk de l’estime universelle. Il a épousé une Sibérienne et a des enfants charmants, dont un, âgé de plus de vingt ans, a fait ses études à Paris.
L’hôtel de ville n’est qu’à deux pas. Il est de construction toute récente ; le maire, dont c’est l’œuvre capitale, serait, me dit-on, très flatté de m’en faire les honneurs. Il désirerait me montrer le musée qui occupe l’étage supérieur. Je ne suis pas moins désireux de visiter ce musée, qui possède un remarquable modèle en bois de la principale mine d’or sur la Zéa, représentant exactement, en miniature, tous les travaux exécutés sur cette mine ; puis toute une série d’échantillons des terrains aurifères du pays.
Sur une planche, dans une vitrine, est une très belle peau, non montée. Le maire la met dans mes mains, en me disant : « Voici le lièvre noir, qui n’existe qu’en Sibérie ! » Dans ma joie de trouver ici une preuve de l’exactitude d’une de mes observations, je saisis la peau par la tête et par la queue, puis, pour mieux examiner la beauté de la fourrure, je donne un coup sec, ainsi que cela se pratique pour faire redresser les poils, mais la peau déjà vieille se déchire par la moitié, et me voilà les bras écartés au bout desquels pendent, d’un côté la tête, de l’autre la queue de l’infortuné lièvre noir. Jamais je ne me suis trouvé aussi sot. On voulut bien m’assurer que le mal n’était pas grand et qu’il serait très facile de se procurer un autre spécimen du curieux animal ; c’est égal, je conseille de se méfier du lièvre noir en tant que fourrure : c’est une peau peu solide.
À signaler aussi un joli bouquin porte-musc tué dans les environs. Il est muni à la mâchoire supérieure de deux longues dents un peu recourbées, qui dépassent Les lèvres d’au moins 4 centimètres.
Puis un champignon énorme que l’on nomme dans le pays « pied de cheval », à cause de sa forme toute particulière. Il ressemble en effet à s’y méprendre à un pied de cheval, dont il a les dimensions. Ce champignon, que l’on m’a dit à Paris, au Muséum, être le Polyporus sulphureus, est très recherché ici, non pour ses qualités comestibles, car il ne peut être mangé, mais parce qu’il remplace admirablement le savon, fort cher dans ces pays éloignés. Mme Popoff m’affirme que dans beaucoup de familles on ne se sert que de ce champignon pour les lessives.
À midi, au moment du déjeuner, nous voyons entrer dans le salon un de nos passagers, avec lequel nous n’avions échangé depuis Habarovka que des saluts. C’est l’homme le plus simple qu’il soit possible d’imaginer. Rien ne révélait à bord sa haute position, car il ne portait même pas la casquette officielle. Aujourd’hui il est en grand uniforme. C’est, me dit-on, le général Kapoustine, contrôleur général des finances, postes et télégraphes, le fonctionnaire Le plus important et le plus puissant de toute la Sibérie, entre le Baïkal et l’océan Pacifique, après le gouverneur général. Ses huit enfants, dont l’aîné n’a pas quinze ans, vont, accompagnés de leur mère, à Tomsk, pour faire leurs études. Le général les conduit jusqu’à Irkoutsk. Nous découvrons tout d’un coup que nous avons tous les deux autrefois su l’allemand et qu’il nous en reste encore assez dans la mémoire pour causer ensemble. Quant à Mme Kapoustine, elle le parle comme le russe.
Son Altesse Impériale le Tsarevitch a fait à Blagovechtchensk un séjour de quarante-huit heures. Naturellement il devait loger chez le gouverneur. Tout le monde connaît la touchante coutume russe qui veut que l’on offre à son hôte le pain et le sel. Pour cette cérémonie, la ville de Blagovechtchensk fit fabriquer un plat et une salière dont elle fit hommage au prince. Le maire eut l’amabilité de m’offrir une photographie de ces deux belles pièces d’orfèvrerie. Au centre du plat est l’N russe, première lettre de son nom Nicolas. Les dames de la ville se chargèrent de l’installation de sa chambre à coucher, sous la direction de Mme Popoff. Je dois avouer qu’elles réussirent à faire quelque chose de ravissant, de jeune et de chaste. Tout est bleu et blanc, en soie brodée au point russe par les dames elles-mêmes.

Il est nécessaire d’ajouter qu’après son départ, la chambre à coucher du prince devint le lieu de pèlerinage de toute la partie féminine de la ville, et que peu à peu tout ce qu’il avait touché s’évanouit mystérieusement : deux cigarettes intactes oubliées dans une coupe, des bouts de cigarettes fumées, d’allumettes jetées dans un cendrier, tout disparut. Faut-il dire que les draps eux-mêmes de son lit, ne devant plus servir à personne, furent déchirés et que toutes les jeunes filles se partagèrent cette précieuse relique ?
Que n’aurait-il obtenu, s’il avait demandé ?
Après le dîner, qui à 3 heures a réuni une plus nombreuse compagnie, un colonel du génie, le chef de la police, l’abbé Radzichevski et le pasteur Rumpeter, le café nous est servi dans le jardin, ou plutôt dans le parc, qui n’est autre chose qu’un reste des antiques forêts riveraines de l’Amour, échappé à la hache des colons, percé d’allées nombreuses et entouré de murs.
La calèche du gouverneur est à nos ordres. Elle nous conduit d’abord à la tour du veilleur. Cette tour, placée au centre de la ville, en domine toutes les parties. Elle est surmontée par un belvédère contenant une cloche, autour duquel un homme ne cesse de tourner comme l’aiguille autour du cadran d’une montre. Dans les grandes villes, à Tomsk par exemple, il y a sur chaque tour deux veilleurs qui doivent marcher dans le même sens, mais toujours sur le même diamètre, comme aux deux extrémités d’une aiguille à secondes, sans qu’il leur soit jamais permis de se rattraper. Ils sont là pour veiller aux incendies et sonner le tocsin à la moindre fumée suspecte.

Du sommet de cette tour, nous avons une très belle vue de la ville. Je dois avouer cependant que la cathédrale, plantée toute seule au milieu d’une immense plaine, parait un peu ridicule. Le but de spéculation qui a déterminé l’emplacement de cet édifice religieux est par trop apparent.
La ville est jolie, les rues sont larges ; la plupart des maisons ont un petit jardin qui les entoure. Malheureusement, comme du reste partout en Sibérie, les rues sont fort mal entretenues, et déparées par de grandes flaques d’eau. Il est vrai de dire cependant que si le Russe a l’air de se soucier médiocrement de l’état de la partie de la route où devront passer les voitures et les chevaux, il a toujours grand soin de se ménager une place où passer sans trop salir ses bottes, probablement-pour ne pas avoir à les nettoyer. En effet, à l’intersection de deux rues il y a généralement un passage en planches, et le long des maisons est un trottoir, en planches également, large de plus de 1 mètre, et élevé d’au moins 20 centimètres au-dessus du sol. Ce trottoir est presque toujours en très bon état. Nous en avons trouvé non seulement dans les grandes villes, comme Vladivostok, Nikolaïevsk, Habarovka, mais même dans les petits villages.
Il est vrai que l’on a sous la main les matériaux nécessaires à leur entretien : la forêt les fournit. Sous le rapport des trottoirs, les villes et villages de Sibérie l’ont emporté pendant longtemps sur l’ancienne capitale de l’empire. Ne m’a-t-on pas dit, à Moscou, que ceux que l’on y voit maintenant sont l’œuvre du présent gouverneur de la ville et qu’il y a quelques années ils n’existaient pas ?
Nous voulions aller à l’embouchure de la Zéa par une rue et revenir par une autre. Le cocher s’y refuse malgré les efforts de M. Ninaud, parce que, disait-il, il salirait les roues de sa voiture et Les pieds de ses chevaux.
Ce petit fait prouve plusieurs choses : d’abord, le mauvais état des rues et le peu de soin des ingénieurs, car il n’avait pas plu depuis deux ou trois jours ; ensuite la paresse de l’automédon qui ne voulait pas avoir à travailler pendant une heure pour laver ses roues et les pieds de ses bêtes. La paresse est, je crois, le péché mignon des Sibériens et Le plus grand obstacle au développement rapide des incalculables richesses que contient le pays.
Un autre petit fait. Pour reconnaître un peu l’hospitalité qui nous était si gracieusement offerte par le gouverneur et par sa femme, et pour conserver aussi un souvenir durable de ceux qui nous recevaient si bien, j’avais pris, dans le jardin, un groupe de la nombreuse famille du général et de quelques personnalités de la ville. Nos hôtes avaient paru enchantés de l’attention. Toutefois, comme mes clichés ne devaient être développés et imprimés qu’à mon arrivée à Paris, c’était véritablement faire attendre bien longtemps une photographie peut-être mauvaise. Je pensai donc à m’adresser de suite à un artiste du pays pour ce cliché spécial, Il y a deux photographes à Blagovechtchensk, et chez tous les deux il me fut répondu que, le patron faisant sa sieste, on me priait de repasser plus tard.
Faire la sieste, en Sibérie ! On se croirait sous l’équateur. Il est certain qu’habitués aux rudes gelées de l’hiver, les Russes souffrent plus que nous de la chaleur, qu’ils trouvent excessive, tandis que pour nous elle est très supportable. Il est vrai que nous arrivons de Pékin, où les étés sont fort chauds.
À l’ouest de la ville sont les camps. Nous les visitons un peu à la hâte, en voiture. Ils sont cachés au milieu des bois. Ici, on a eu le bon esprit de ne pas dénuder sans raison tous les environs. Les soldats que nous voyons manœuvrer ont une bonne tenue, ils sont propres, et ont l’air de connaître leur métier. Ils font l’exercice du canon, et c’est avec plaisir que je les regarde, car ils effacent une impression fâcheuse que j’avais conservée d’une petite troupe rencontrée au commencement du voyage.
Le polygone est derrière le camp. On y tire à la cible tous les quinze jours, je crois ; derrière, sur une colline, se trouve la prison. En revenant du camp, nous traversons le quartier réservé aux soldats mariés. C’est un groupe fort important de petites maisons entourées d’un peu de verdure ; elles paraissent propres et bien tenues : des enfants, tous très jeunes, nous regardent passer et saluent.
Nous rentrons enchantés, en somme, de notre promenade, et séduits par ce que nous avons vu de la ville. Nous ne sommes pas non plus choqués outre mesure de rencontrer de temps en temps dans les rues des cochons qui se promènent, cherchant leur nourriture. C’est un spectacle auquel notre vie à Pékin nous a habitués, il n’y a que la couleur de ces animaux qui diffère : à Pékin ils sont noirs, ici ils sont blancs.
Fondée en 1857, la ville de Blagovechtchensk a été pendant longtemps le grand centre des provinces de l’Amour. Elle lutte maintenant pour conserver la prépondérance, qu’on veut lui enlever en faveur de Habarovka. Elle prétend que, comme position militaire et commerciale, sa situation à proximité des grandes villes chinoises, Aïgoune, Tsi-Tsihar, où sont concentrés près de 40 000 hommes de troupes, lui donne une importance singulière, et qu’en dépit des efforts de l’administration, elle ne cessera de s’étendre et de prospérer, beaucoup plus rapidement que sa rivale, bien que cette dernière soit maintenant le siège du gouvernement général des provinces de l’Amour.
Malheureusement pour la ville de Blagovechtchensk, un coup terrible va lui être porté : elle ne se trouve pas sur le tracé du chemin de fer, qui passera, d’après les projets actuels, à plus de 200 verstes au nord. Mais ce projet est-il définitif ?
Pendant l’hiver, de nombreuses caravanes de chameaux arrivent de la Mandchourie, apportant de la viande gelée, du gibier. Elles pourraient apporter, en outre, des produits bruts, des laines à échanger contre des objets manufacturés, dont des fabriques seraient établies dans les villes que traversera le chemin de fer, ou même à Blagovechtchensk. Mais il faudrait pour cela une initiative qui m’a l’air de manquer ici.
La vie matérielle n’est pas chère. Le pain de seigle se vend 10 kopeks le poud ; la vodka, cet autre élément indispensable à l’existence de tout bon Russe, coûte de 25 à 40 kopeks la bouteille.
De l’autre côté du fleuve est une station télégraphique chinoise. Pour 1 rouble et 40 kopeks par mot, on peut correspondre avec Pékin, mais comme il n’existe pas de communication entre la ligne chinoise et la ligne russe, il suffit de cette interruption voulue de quelques centaines de mètres pour empêcher les relations télégraphiques par cette voie, La plus rapide, la plus simple, et celle qui devrait être la moins coûteuse, entre l’Europe et le Céleste Empire. On prétend que la faute en est surtout au gouvernement russe, qui, pour des raisons de famille, désire favoriser la compagnie danoise à laquelle appartient le câble sous-marin qui rayonne de Changhaï vers Hongkong, le Japon et Vladivostok[55].
Nulle part, dans tout l’empire russe, il n’y a, me dit-on, autant de sectes religieuses dissidentes que dans le gouvernement de Blagovechtchensk. La plus curieuse est la Douhobore. Cette secte refuse aux hommes le libre arbitre. Tout doit se faire par la volonté du ciel. Ni la femme ni l’homme ne peuvent choisir le père et la mère de leurs enfants, et de grands meetings nocturnes ont lieu à des époques déterminées, dans des lieux sans lumière, et pendant l’été au fond des bois. Là, le hasard est chargé de représenter, la volonté d’en haut. La police est impuissante à empêcher les membres de cette secte de se livrer à leurs pratiques religieuses. « Dans ces assemblées, dit M. Anatole Leroy-Beaulieu, parlant d’une secte analogue, les Skakouni, l’inceste même n’était point regardé comme un péché, tous les fidèles, prétendaient les sectaires, étant frères en Jésus-Christ. »
Pendant notre absence, Mme Popoff a reçu quelques visites.
Des dames sont venues faire un pèlerinage dans la chambre du Tsarevitch. Au fond, on sait que nous logeons au gouvernement et l’on veut s’assurer que nous ne profanons pas la chambre bleue.
28 juin. — Le Yermak doit partir à 10 heures. L’affluence de monde est encore plus grande qu’à l’arrivée du Mouravieff Amourski. Le gouverneur et Mme Popoff ont tenu à nous accompagner jusqu’au steamer, et à ne nous quitter qu’au dernier moment, Je me demande, en vérité, ce que ces aimables gens auraient fait de plus pour des amis de vingt ans. Blagovechtchensk est peut-être, de tout notre long voyage, la ville dont nous avons conservé le meilleur souvenir ; c’est qu’elle nous rappelle la sympathie dont nous avons été l’objet.
Cet excellent M. Ninaud est également venu nous dire adieu avec son fils. Il a placé dans notre cabine un petit paquet dont il nous prie d’accepter le contenu. Ce sont quelques sucreries, quelques biscuits de sa fabrication, un de ces fameux saumons fumés de l’Amour et deux taies d’oreiller en toile blanche à fleurs. Il craint que nous ne manquions de choses molles pour amortir les chocs dans le tarantass, et nous dit de faire remplir, à Stretinsk, ces taies de laine de chameau. Puis il me remet une longue lettre dans laquelle il a résumé tous ses conseils pour la route. Quelques-uns ont l’air enfantins ; mais nous n’en avons négligé aucun, et nous nous en sommes maintes fois félicités.
Il est midi, le sifflet de la machine met un terme aux baisers d’adieux, et, par un soleil radieux, nous quittons Blagovechtchensk, nom qui signifie en russe « Bonne Nouvelle » ou « Annonciation » : en route pour Stretinsk, « Visitation » !
(La suite à la prochaine livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[56],
XV
De Blagovechtchensk à Pakrovska.
ous n’avons pas encore perdu
de vue les mouchoirs qui
continuent à s’agiter sur le ponton
et sur le quai, que déjà nous
sommes devant les camps. Les
soldats, les femmes
et les enfants, dans
leurs gais costumes où
le rouge domine, forment
une longue ligne
sur le rivage. Là
aussi des mouchoirs
s’agitent sur notre passage,
car le Yermak emporte
de nombreux soldats
qui laissent des
amis derrière eux. Nous
n’avons plus de barge à la
traîne, et nous marchons
rapidement.
Le Yermak est le type
du bateau construit pour naviguer sur les fleuves sans
profondeur, long d’une centaine de pieds, large de
près de 30 ; la machine est sur l’avant et les deux roues
sont tout à fait à l’arrière. Il cale environ 3 pieds
quand il a, comme maintenant, sa cargaison humaine.
Il prend peu ou point de fret. Sur la plate-forme supérieure
se trouve la chambre du capitaine et celle des
hommes de barre. Au premier étage, sur l’avant, les
cabines des passagers de première, sur l’arrière les
salles de seconde, puis la buvette, où l’on va prendre
avant chaque repas la zakouska de rigueur.

Notre cabine est superbe ; elle mesure 8 pieds sur 6, avec trois larges banquettes sur lesquelles nous installons nos matelas, car naturellement il n’y a pas de lit. Au milieu, une table carrée ; on nous y sert nos repas. Le domestique est propre, soigneux ; la nourriture est copieuse et assez bonne. La seule chose qui fasse regretter le Mouravieff, ce sont Les trépidations abominables que la machine imprime au bateau. Avec la meilleure volonté du monde, il est impossible d’écrire le moindre mot, il faut attendre pour cela les escales. Autour des cabines, une galerie couverte pour protéger contre les escarbilles, et un banc assez mal imaginé, car il vous fait tourner le dos au pas sage.
Au-dessous de nos cabines sont deux ou trois salles pour les bagages, les sacs de dépêches, les provisions, puis la cuisine. C’est dans la galerie qui entoure ces salles que les 150 soldats, femmes et enfants, que nous devons conduire à Stretinsk, s’étendent en rangs serrés, mangent, boivent, dorment, etc.
Nous avons pris quelques nouveaux passagers de première et de seconde, entre autres le directeur du séminaire de Blagovechtchensk, qui va à Saint-Pétersbourg, et un colonel de Cosaques, sorte de colosse au teint cuivré, à la figure énergique ; son origine est pour nous une énigme.
Le capitaine Lahanine, qui commande le Yermak, est un lieutenant de vaisseau. Il s’avance vers moi, accompagné d’un nouveau passager, qui me dit dans notre langue que le capitaine, ne parlant pas français, me prie de vouloir bien m’adresser à lui Poutiatitski pour obtenir tout ce dont j’aurais besoin ; que des ordres ont été donnés au personnel du bateau pour que rien ne nous manque. Je remercie M. Poutiatitski en français, et le capitaine en allemand, car je découvre qu’il parle très bien cette langue.

Le paysage est sans grand intérêt. À citer toutefois, sur la rive chinoise, une sorte de ferme dans un site pittoresque. Quelques beaux arbres ont été préservés autour des maisons. Les montagnes commencent presque immédiatement derrière.

Devant un village, non loin de Blagovechtchensk, une vieille femme couverte de haillons est sur le bord de l’eau. Armée d’une longue gaule, munie à une extrémité d’un petit crochet, elle arrête au passage. toutes Les brindilles qui flottent : elle en a déjà un tas à côté d’elle, et cependant la forêt n’est pas loin. C’est que pour le Chinois il n’y a pas de petit profit, pas de travail insignifiant.
Je passe mon après-midi à causer avec Mme Kapoustine, qui est assez aimable pour ne pas se moquer de la manière dont j’écorche la langue de Gœthe et de Schiller.
Tout à coup des cris terribles se font entendre au-dessous de nous, et tout le monde se précipite pour voir ce qui se passe. Une de nos passagères de troisième est devenue folle et veut se jeter dans le fleuve. On l’en empêche, et le capitaine lui donne comme gardes du corps deux matelots qui ont, à plusieurs reprises, toutes les peines du monde à la maintenir. Cependant on ne tarde pas à s’apercevoir que ce que l’on prenait pour de la folie est une belle et bonne attaque de delirium tremens, suite de trop copieuses libations. Nous débarquons notre passagère à la première escale. Elle repartira par le prochain bateau pour Habarovka, d’où elle vient, et l’on télégraphie de l’interner dans une maison de santé.
À ce propos on m’édifie sur les femmes des villes de Sibérie en général et de Habarovka en particulier. La capitale des provinces de l’Amour est, paraît-il, un endroit favori de déportation pour le beau sexe. On évalue à près de 400 le nombre de celles qui y sont actuellement internées pour avoir assassiné leur mari. La plupart ont une conduite déplorable. C’est cependant parmi elles que sont recrutées les domestiques. Il y a aussi beaucoup de femmes de soldats que les maris, leur temps de service fini, oublient de remmener avec eux dans leur village. L’ivrognerie à Habarovka est un vice commun, même chez les femmes, et la plaie de cette classe de la société.
Demain nous arriverons à ce que l’on appelle la boucle de l’Amour. Le fleuve se replie deux fois de suite sur lui-même, formant deux presqu’îles contiguës dont l’une est chinoise, l’autre russe, revenant à moins d’un kilomètre de l’endroit où il vient de passer après un parcours, la première fois, de 42 verstes et, la seconde, de 30.
Je demande si le capitaine ne consentirait pas à nous déposer à terre à l’entrée de la boucle, pour nous reprendre à la sortie. Une promenade à pied serait une agréable diversion à la monotonie de la vie à bord. On me répond que cela se faisait autrefois, mais qu’il y a quelques années deux voyageurs s’étant égarés et n’ayant été retrouvés qu’au bout de deux jours, cette petite excursion avait dorénavant été interdite. Je n’en parlerai donc pas au capitaine, mais je le regrette.
Nous passons la nuit à Bibicova. Nous avons fait une centaine de verstes.
29 juin. — À peine suis-je sorti de ma cabine que je vois arriver notre capitaine. Il me dit très aimablement que nous arriverons à la boucle vers 10 heures du matin, et que si je désire traverser l’isthme à pied il se fera un plaisir de me déposer à terre. Mais que, comme il lui faudra près de 4 heures pour arriver à l’endroit où nous remonterons à bord et où nous serons en 30 minutes, il faut emporter quelques provisions, que le cuisinier nous préparera.
J’accepte avec enthousiasme. Marie, un peu fatiguée, reste sur le Yermak. Plus de quarante personnes profitent de l’occasion inattendue qui leur est offerte, et quand je quitte le steamer avec le général, Mme Kapoustine et quatre de leurs enfants, le gros de la bande a déjà disparu dans les bois. Hane porte quelques provisions. M. Poutiatitski, grand chasseur, a pris son fusil, car, dit-il, Le pays fourmille de coqs de bruyère : un corbeau fut notre seule victime.
Le sol est marécageux. La colline que nous devons traverser est à 100 mètres au plus et nous avons de la peine à trouver un chemin au milieu des marais. À certains endroits nous faisons un petit pont de branchages pour Mme Kapoustine. Au pied de la colline nous trouvons la route, c’est-à-dire la longue coupée dans la forêt qui, suivant montagnes et vallées, part de Nikolaïevsk et traverse toute la Sibérie. Les poteaux du télégraphe sont au milieu, à l’abri des incendies, qui sont très fréquents dans ces pays, car il ne se passe pas de jour que nous n’en voyions.
Le long des bois de chaque côté de la route, je trouve des fraisiers en fleur, et une douzaine de fruits mûrs, que j’enveloppe soigneusement pour Marie : les premières fraises de l’année, évidemment !
Nous marchons doucement, car, si le fond de l’air est frais, le soleil est brûlant. Un ruisseau serpente le long de la route. J’ai heureusement ma tasse en cuir qui se plie et se met facilement dans la poche, et nous buvons tous avec délices.
Après un peu de repos au sommet de la colline, nous commençons à descendre. Nous marchons sur un véritable tapis de fleurs. Là où les bois cessent, la prairie commence, mais une prairie presque sans verdure : pivoines, aconit, lis jaunes et rouges, orchidées, etc., diaprent le sol de mille couleurs et laissent à peine passer un brin d’herbe. Hélas ! la médaille a son revers. Nous avons troublé dans leur solitude des myriades de taons, qui se jettent en rangs serrés sur les envahisseurs. Bientôt chacun de nous ressemble à une ruche autour de laquelle volent en bourdonnant des milliers d’abeilles. Nous cassons des branches d’arbres feuillues, avec lesquelles nous battons furieusement l’air tout autour de notre tête. Les victimes sont nombreuses, mais plus nombreux encore sont les assaillants qui reviennent à la charge.
On nous a bien recommandé de ne jamais cesser de descendre, après avoir commencé. Or, depuis quelques minutes déjà, nous avions quitté le sommet de la passe, lorsque nous voyons que la route tourne brusquement à droite et se remet à monter. Nous l’abandonnons donc, et nous nous enfonçons au milieu des fourrés et des fleurs, nous dirigeant vers le bas de la colline. Quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivons au bord de l’Amour, où nous trouvons nombreuse et joyeuse société. Nos compagnons de voyage, arrivés depuis longtemps, sont installés çà et là sur l’herbe, par groupes. Ils ont apporté théières et bouillottes, et étalé leurs provisions. Les uns vont chercher des branches mortes, tandis que les autres allument des feux, dans le double but de préparer le thé et de chasser les taons. Notre petit groupe les imite, et, le repas terminé, chacun tue de son mieux le temps en attendant le Yermak, qui n’arrive qu’à 4 heures.
Le fleuve, aujourd’hui, est assez animé. Nous voyons passer plusieurs vapeurs, puis des trains de bois, ensuite le radeau d’un marchand au détail ambulant. Ce radeau est formé à Stretinsk avec de gros madriers propres à construire : il a une centaine de pieds de long. Des poutres transversales supportent une sorte de plancher, destiné à empêcher d’être mouillés les ballots de marchandises placés aux deux bouts, sous des bâches en nattes. Sur l’avant, généralement, est un cheval, qui, à un moment donné, peut rendre de grands services, Au centre est une maison en planches, qui ressemble, quand vous pénétrez dedans, à un grand bazar. Les parois sont garnies du haut en bas de cases pleines de marchandises. Vous y trouvez de tout, de l’épicerie, de la mercerie, de la bonneterie, de la coutellerie, de la chaudronnerie, etc.

Ce marchand ambulant descend le fleuve, s’arrêtant à tous les villages. Il s’arrange pour partir de Stretinsk à l’ouverture de la navigation, il met trois mois à descendre l’Amour, et quand il arrive à Nikolaïevsk, il ne lui reste plus généralement que les madriers du radeau et les planches de la maison. Il vend le tout à un chantier de construction et remonte en vapeur à Stretinsk pour préparer son voyage de l’année suivante. Des trains de chevaux et de bestiaux sont expédiés d’après le même principe.
La chaleur est très forte et les taons sont insupportables. Les enfants en font un véritable carnage avec des filets que je leur fabrique à l’aide d’un vieux voile. Nous passons la nuit à Koumarskaya.
30 juin. — À 4 heures du matin le thermomètre marque 31° dans notre cabine fermée. Dehors il fait une température agréable, mais on sent que la journée sera chaude.
Le paysage est plus pittoresque. Vers 8 heures, nous longeons sur la rive chinoise une falaise qui a près de 200 pieds de haut ; elle est à pic et formée d’énormes assises de rochers superposés, entre lesquels, vers le milieu, suinte un liquide abondant que le capitaine me dit être du pétrole, que personne ne songe à exploiter. De l’autre côté du fleuve, à peu de distance, est le village russe de Koltsova.
Le fleuve coule rapide et large, suivant le pied des montagnes, souvent très élevées, qui lui font décrire les courbes Les plus majestueuses. La nature est sauvage. Des troncs calcinés, mais encore debout, émergent çà et là des taillis d’un vert frais qui ont remplacé l’antique forêt, détruite par l’incendie jusqu’aux sommets les plus élevés. Souvent nous passons, par une brusque transition, de l’extrême chaleur à une fraîcheur glaciale, quand nous nous trouvons dans un de ces cirques entourés d’une haute muraille de verdure, où à le soleil semble ne jamais pénétrer.
Une chose à laquelle je n’ai jamais pu m’habituer en Sibérie, c’est à voir, disons le mot, chiquer presque tout le monde. Hommes, femmes, garçons et filles ont les mâchoires perpétuellement en mouvement. Il ne s’agit pas ici de tabac, mais de résine d’une sorte de pin. Cette chique a au moins cela d’avantageux, qu’elle est économique : la même peut servir des années. Vous causez avec une jeune fille, par exemple ; quand elle parle, vous vous imaginez qu’elle à une fluxion qui voyage de la joue droite à la joue gauche ; quand elle ne parle plus, vous pourriez croire qu’elle rumine.
Vers 4 heures nous arrivons aux montagnes blanches, ou montagnes qui fument. La rive chinoise est basse et complètement nue. C’est une longue pointe, formée vraisemblablement d’alluvions apportées par le remous, débris de la haute muraille blanche que nous voyons à notre droite. L’Amour, dont ici le courant est extrêmement violent, se précipite comme un bélier sur les calcaires qui l’arrêtent. Il a déjà creusé leur masse sur près de 5 verstes de profondeur, et nous voyons les deux parois entre lesquelles il décrit une demi-circonférence parfaite de moins de 1 500 mètres de rayon.

Au sommet, la végétation n’est pas très active, la terre végétale est trop peu épaisse. Sur les flancs, quelques bouleaux ont réussi à trouver une nourriture suffisante dans les miettes d’humus apportées par des éboulements. À certains endroits, entre les interstices des assises de pierre ou à l’orifice d’un trou dont les bords sont tout noirs, s’échappe une fumée grise d’une intensité variable. D’où provient cette mystérieuse fumée ? On prétend que sous la montagne se trouve du charbon en voie de formation.
Combien je regrette de ne pouvoir descendre à terre et prendre une vue de ce cirque merveilleux ! Il faut me contenter d’un instantané saisi au vol du pont du Yermak, qui me donnera quelques mètres seulement des montagnes blanches fumeuses, mais sera dans tous les cas un souvenir de cette étrange et sauvage partie de l’Amour.

On m’assure que le charbon de terre ne manque pas en Sibérie, et, si je demande pourquoi on ne l’exploite pas, on me montre les forêts qui nous entourent en disant : « À quoi bon creuser la terre pour chercher du charbon, quand on a à sa surface un combustible tout trouvé et facile à prendre ? »
Toute la Sibérie est là. Le pays est trop riche pour le petit nombre de ses habitants, auxquels la facilité de la vie donne des allures de créoles.
Bientôt le paysage change d’aspect. À la muraille blanche succède un champ d’immenses rochers à surface presque unie. L’un d’eux a plus de 20 mètres de diamètre : on dirait Fontainebleau et les gorges de Franchard. Puis les rochers disparaissent, et l’Amour coule plus doucement au milieu des forêts sans fin qui recommencent à border ses rives.
À 6 heures nous nous arrêtons pour faire du bois à Yermakova. Ce poste, de même que notre steamer, à reçu son nom en souvenir d’Yermak, ataman des Cosaques du Don, qui en 1580, à la tête de 6 000 hommes, s’empara de Sibir, sur l’Irtich, la capitale de la Sibérie, qui bientôt lui fut soumise en entier, et dont il fit hommage en 1583 au tsar Ivan IV, afin de pouvoir conserver sa conquête. Attiré dans une embuscade par un chef tatar, Yermak, se noya dans le fleuve, qu’il tenta de traverser à la nage pour échapper à la captivité.
Nous nous amarrons contre un radeau qu’on est en train de charger de bois de chauffe. À terre, les muguets ont reparu, ils jonchent le sol. Nous trouvons aussi quelques fraises.
Cependant la soirée est splendide. Après la chaleur étouffante de la journée, tout le monde est dehors à respirer, car dans les cabines il fait une température de serre chaude. Rien n’est beau du reste comme ces longs crépuscules du nord au milieu de ces solitudes immenses mais toujours variées.
Cela tient probablement aux essences que nous brûlons, mais jamais il n’y a eu autant d’escarbilles. La cheminée lance un véritable feu d’artifice, Les étoiles de feu qui en sortent en gerbe s’éparpillent dans tous les sens et viennent tomber en pluie de tous Les côtés du Yermak, dans le fleuve, où elles crépitent en s’éteignant. Pas le plus petit souffle de vent ne trouble l’air.
La lune se lève : dans l’eau noire du fleuve les arbres se reflètent avec des tons plus noirs encore. Le halètement de la machine se répercute dans les montagnes qui nous entourent, et trouble seul le profond silence de ces solitudes, que des éclairs de chaleur illuminent de temps à autre. Il y a longtemps que nous n’avons joui d’une pareille soirée et d’un si beau spectacle. Vers 11 heures la lune a disparu derrière les montagnes, nous ne distinguons plus les rives ; continuer à marcher serait dangereux, et force nous est de nous arrêter à Tabinskaya, petit dépôt de bois où deux hommes vivent en ermites. La rivière a beaucoup baissé, et 10 mètres de boue séparent le Yermak de la rive ; on allume, au milieu de cette boue et sur le rivage, de grands feux de bois pour éclairer les travailleurs, puis nos passagers cosaques descendent à terre comme d’habitude et s’installent sur le flanc d’une colline boisée pour préparer leur repas. Réunis par groupes de sept ou huit, ils alimentent un brasier au-dessus duquel une marmite est suspendue à une des extrémités d’un pieu incliné dont l’autre bout est maintenu à l’aide d’un poids quelconque.

Rien de plus fantastique que la scène que nous avons devant les yeux. Ces porteurs de civières chargées de bois, avec leurs vêtements aux couleurs voyantes, passant successivement, d’un pas rapide, de l’ombre à la lumière et de la lumière à l’ombre ; ces hommes et ces femmes, les uns accroupis, les autres couchés, les uns attisant le feu, les autres soulevant le couvercle des marmites pour y plonger des choses que l’on ne peut distinguer, rangés en cercle autour des brasiers qui les éclairent diversement, tout a un aspect diabolique : on croirait assister à quelque gigantesque sabbat.
Pour ajouter au fantastique, les deux chiens des bûcherons, effrayés par tout ce monde, poussent dans l’ombre des hurlements lugubres.
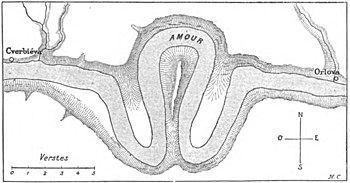
1er juillet. — Il est 7 heures. Il y en a cinq que nous sommes en route. Nous nous arrêtons à Tcherniaeva. Nous avions pris à Blagovechtchensk une dizaine de passagers chinois. Ils descendent tous ici, portant sur leur dos quelques instruments de travail. Ils ont entendu dire qu’il y avait de l’or dans le pays et sont accourus.
Nous sommes ici à une cinquantaine de verstes seulement de la Zéa, dont le bassin est habité par les Manégris. Les Manégris, de même que les Orotchones, autre famille de la grande tribu des Toungouses, vivant sur les bords de l’Amour dans les environs des monts Kingane, habitent des huttes formées de menues branches et d’herbe sèche, recouvertes soit d’écorce d’arbres, soit de peaux de bêtes où même de nattes. Ces indigènes vivent de chasse et de pêche.

Le Yermak avait laissé ici à son dernier voyage un mouton, que l’on nous rapporte. La pauvre bête n’a pas l’air d’avoir trouvé la nourriture à son gré à Tcherniaeva, car elle est bien maigre. On nous vend aussi un veau et de la glace.
L’Amour s’élargit beaucoup, et est coupé par de nombreux îlots. Nombreux aussi sont, paraît-il, les bancs invisibles autour desquels il nous faut chercher notre route, en nous aidant de la sonde. Le courant a diminué de force, mais nous avons modéré notre allure. Sur l’avant du steamer, un homme tient une longue perche divisée en dix fractions d’un pied chacune, toutes de couleurs différentes.
C’est la sonde qu’il plonge dans l’eau, et à chaque immersion il crie d’un ton monotone la profondeur constatée.
Pendant une bonne parte de la journée nous serpentons ainsi dans le fleuve, passant d’une rive à l’autre, et nous demandant si nous n’allons pas nous échouer, car les eaux sont très basses. Le capitaine nous dit avoir mis une fois trente-deux jours à aller de Blagovechtchensk au confluent de la Chilka.
Nous rencontrons dans la journée plusieurs radeaux. Sur l’un d’eux, les bœufs sont entassés en si grand nombre, qu’il ne paraît presque plus à la surface, et que les pieds des malheureux animaux baignent dans l’eau ; leur poids est trop considérable.
Depuis Blagovechtchensk nous avons été presque directement vers le nord. À partir de Vahanova, où nous sommes à 4 heures, l’Amour nous conduit vers l’ouest. Nous nous arrêtons à Beketova. Le paysage a été pittoresque toute la soirée.
2 juillet. — Sur tous les bateaux russes que nous avons vus, à l’exception du Vadivostok, il n’y a pas dans les cabines plus de cuvette que de lit. Il faut aller faire sa toilette dans le lavabo commun, à moins d’avoir ; comme nous, une cuvette de voyage et un domestique pour aller la remplir et la vider. Ce lavabo, sur les bateaux de l’Amour, est un des points faibles. Je me demande qui est chargé de son entretien : c’est de beaucoup ce qu’il y à de plus sale à bord.
Ce matin j’ai vu l’archiprêtre, directeur du séminaire, sa serviette sous le bras, sortir de chez lui. Il a, comme tous les popes, les cheveux aussi longs que la nature les fait pousser. Les siens sont soyeux et frisés et tombent toujours en longues boucles sur ses épaules. Mais il paraît que pour le soir il lui faut prendre autant de précautions qu’une femme, car son chef est orné de petites papillotes serrées, destinées à donner à sa chevelure ces ondulations que nous admirons le jour, et qui lui donnent la nuit l’aspect d’une respectable mais coquette douairière.
Vers 11 heures, nous dépassons un vapeur qui, me dit-on, est fortement soupçonné de faire la contrebande de l’or. Sur le Mouravieff un Russe a montré des pépites à Hane, en lui disant de me demander si je voulais en acheter.
À midi nous stoppons à Albasine, point où les souvenirs historiques sont nombreux.

Albasine fut détruit presque immédiatement après sa fondation, vers 1640, par les Mandehous. Occupé de nouveau, en 1648, par Habaroff, il devint, en 1654, un centre de colonisation. On l’entoura de murailles de terre. Mais, en 1685, il fut de nouveau pris et détruit, après un siège fort long, par les troupes et les jonques de guerre venues d’Aïgoune, et ses défenseurs, à peu près une centaine de Cosaques, emmenés prisonniers à Pékin. Frappé de la haute taille des Russes, dont il avait apprécié la valeur militaire, l’empereur de Chine résolut de les conserver à son service. Il les incorpora dans une des bannières, la bannière blanche, leur donna des femmes et fonda dans un ministère une école pour enseigner la langue russe à leurs enfants. Les descendants de ces Cosaques forment toujours, à Pékin, une petite colonie, mais il est bien difficile de retrouver parmi ses membres le type des défenseurs d’Albasine.

Un long escalier en bois, de plus de soixante-dix marches, conduit du bord de l’eau à la berge, sur laquelle s’élève le village qui a remplacé l’ancienne ville, dont les seuls vestiges sont quelques débris de murailles en terre. Derrière est une vaste plaine. Pendant que je prends la vue de ce point célèbre, je vois sortir de la maison à côté de laquelle je me trouve un beau vieillard tout blanc. Il est en uniforme et porte sur sa poitrine la croix des braves, On me dit qu’il a quatre-vingt-cinq ans, que c’est un des compagnons du général Mouravief : il se nomme Skobieltsine. Je lui demande la permission de le photographier. Il y consent, mais pendant que je me prépare à la hâte, le Yermak siffle pour rappeler tout le monde à bord. On ne fait pas de bois ici, on ne s’arrête que pour la poste. Je suis obligé de mettre mon appareil sur mon épaule et de redescendre au galop l’escalier. On retire la planche qui nous met en communication avec la terre et nous partons juste au moment où un infortuné passager de troisième, chargé de plusieurs peaux d’ours qu’il était allé acheter, s’engageait dans l’escalier. Le capitaine est obligé, dit-il, d’être inflexible, sans cela il y aurait toujours des retardataires. Un moment auparavant, un Chinois était rentré avec des cornes d’une espèce de cerf appelé en russe yzioubre (?). Ces cornes ont une très grande valeur pour les Chinois, qui n’hésitent pas à les payer aux chasseurs 15 à 20 roubles la livre. Elles sont molles et recouvertes d’une sorte de velours gris-souris. Je ne sais plus trop quelle maladie elles ont la réputation de guérir, mais je sais qu’elles sont, avec la dent de tigre, les scorpions, le sang des décapités et plusieurs autres produits que je m’abstiendrai de nommer, un des remèdes pour l’usage interne les plus en faveur auprès des Chinois.
À 4 heures nous faisons du bois à Reinova.
Depuis notre départ de Blagovechtchensk, à chaque station, beaucoup de passagers des deux sexes descendent, s’éloignent d’une cinquantaine de mètres du bateau, se déshabillent et prennent un bain dans le costume d’Adam et Ève avant la faute, sans se soucier le moins du monde de qui peut ou ne peut pas les voir. C’est à peine si les femmes laissent une cinquantaine de mètres entre elles et les hommes. Si la nuit est arrivée, la distance diminue singulièrement. Personne ne s’en occupe. À Reinova, les baigneurs sont moins nombreux, non pas parce qu’il ne fait pas chaud, mais parce que c’est un centre assez important. Il y a un ou deux magasins, des boulangers, et il faut renouveler les provisions.
Nous qui comptons pour cela sur le chef du Yermak, nous nous promenons. À quelques pas est une chapelle, entourée d’un jardinet qui sert de cimetière. Allons la visiter et suivons l’archiprêtre, qui se dirige de son côté avec un ou deux passagers. La porte du cimetière est ouverte et nous arrivons bientôt devant celle de la chapelle. Un homme est couché sur le seuil ; on le réveille, il grogne ; on le met sur ses jambes, il titube ; on le pousse un peu brutalement hors du cimetière, il en paraît ahuri. C’était un si bon endroit pour cuver sa vodka ! L’archiprêtre est désolé que cette scène nous ait eus pour témoins. Nous renonçons à visiter l’église, dont la porte est fermée, et nous allons dans le village, qui paraît assez animé. Il y a dans la rue, qui suit comme toujours le fleuve, des chevaux, des bœufs, des cochons en liberté. À la fenêtre d’une maison très propre, nous voyons une femme en train de pétrir la pâte au moyen d’un bâton. Nous rencontrons des passagers qui retournent à bord avec des pains, du lait, du tabac. Au milieu de la rue, des gens sont rassemblés, des Chinois et des Russes, dont la mine n’est pas faite pour inspirer confiance. Entre eux, à terre, est un billet d’un rouble, couvert d’une pierre, à côté cinquante kopeks en argent. Ils lancent d’un seul coup un certain nombre d’osselets, et selon que les osselets tombent perpendiculairement ou parallèlement au rouble on a perdu ou gagné. Ce jeu se nomme barki. Les joueurs ont l’air très animés, et il me semble que pour un rien ils se jetteraient les uns sur les autres.
À 100 verstes de Reinova il y a des placers assez riches : tous ces gens, Russes et Chinois, travaillent aux mines. Derrière les vitres nous voyons des fleurs, surtout des pétunias, dont les vives couleurs font ressortir encore l’encadrement blanc qui orne presque invariablement les fenêtres en Sibérie.
Cependant notre capitaine paraît inquiet. Il trouve que l’eau baisse dans l’Amour, et craint bien de ne pouvoir remonter jusqu’à Stretinsk. S’il en est ainsi, il nous transbordera à Pakrovska sur un bateau plus petit, et cette perspective n’a rien de bien gai. Espérons encore ! À minuit et demi nous stoppons pour quelques heures à Cverbiéva, après avoir franchi une passe de 46 verstes des plus pittoresques. Nous sommes à 53°5’ de latitude. C’est le point le plus nord de tout le cours de l’Amour ; Nikolaïevsk n’est qu’à 53°3’.
Dimanche 3 juillet. — À midi, nous nous arrêtons à Ignacina. Le pays est aride et rocailleux. Il y a affluence de monde, car à 8 verstes du fleuve est une source d’eau gazeuse qui attire les malades en foule. Nous y goûtons : elle est on ce moment très chargée de fer, bien que souvent elle n’en contienne aucune parcelle. C’est une particularité qu’on m’a déjà signalée. Il y a dans la Sibérie et surtout dans la Transbaïkalie de nombreuses sources d’eau minérale. Mais quelques-unes n’ont pas une Composition constante et sont successivement chargées de matières diverses.
De l’autre côté du fleuve s’élève un village chimois. Les habitants sont tous des chercheurs d’or. C’est là qu’il y a quelques années, une douzaine de malheureux furent exécutés par les autorités de leur pays, pour avoir enfreint les lois sur les mines de métaux précieux, et leurs corps abandonnés sur le lieu du supplice. On me raconte qu’un grand nombre de Russes vivaient autrefois à cet endroit dans une sorte de république. Il n’y avait pas d’autorités constituées, la police était faite par les gens eux-mêmes. La loi de Lynch existait dans toute sa rigueur : tout voleur était pendu. Maintenant les Russes, chassés il y a quelque cinq ans, ont été remplacés par Les Chinois.
La rive russe est très belle, très pittoresque, grandiose même. De grands rochers à pic bordent le fleuve. Nous passons devant une construction bizarre, un grand hangar dont nous ne pouvons nous expliquer l’utilité à cet endroit désert.
C’est, paraît-il, une protection pour un steamer qui s’était laissé prendre dans ces parages par les glaces. Je me demande de quoi ont pu vivre pendant le long hiver les malheureux qui étaient à bord !
7 heures, Pakrovska est en vue. Nous apercevons un minuscule steamer à l’ancre, c’est la Zéa, dont l’aspect ne nous dit rien de bon. Mais le voici qui s’ébranle, il descend l’Amour, il nous croise ! Hourrah ! lui aussi part pour Blagovechtchensk, nous resterons sur le Yermak.
Hélas ! cette fausse joie est bien vite dissipée. La Zéa est venue au-devant de nous. À peine nous a-t-elle dépassés qu’elle vire de bord et se met à nous suivre.
Bientôt nous sommes à l’ancre à Pakrovska et fixés sur notre sort. Nous serons transbordés sur la Zéa, qui partira demain à 5 heures du matin. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur, et passons au moins cette nuit-ci dans notre cabine sur le Yermak. En attendant je vais prendre un dernier bain dans l’Amour.
Tandis que je suis ainsi plongé dans les eaux noires du fleuve, je vois accourir Hane, qui me dit que le capitaine me prie de revenir au plus vite. Dix minutes plus tard celui-ci me conduisait, flanqué du capitaine de la Zéa, à bord de ce bateau pour nous installer le moins mal possible.
XVI
De Pakrovska à Stretinsk.
Qu’on se figure un bateau-mouche comme ceux qui naviguent sur la Seine à Paris. Nous sommes là-dessus bien près de 200, sinon plus ! À l’avant, dans la cale, est le salon des dames. Il y a place pour dix, elles sont vingt. À côté est une petite cabine pour trois personnes : le général Kapoustine, sa femme et ses huit enfants ont trouvé le moyen de s’y caser, comment ?
À l’arrière est le salon des hommes. Autour sont des banquettes qui doivent permettre à huit passagers de s’étendre : nous sommes dix-neuf. Inutile de dire que moi, qui ne m’attendais à rien de pareil et qui arrive le dernier, je trouve les huit places de banquettes prises et dix personnes installées par terre. Les deux capitaines me disent de choisir la place que je désire sur les banquettes, et qu’on en délogera immédiatement celui qui l’occupe. M. Poutiatitski insiste pour que je prenne la sienne, et j’accepte. Même cérémonie dans le salon des dames pour Marie, qui se met en face de la porte afin d’avoir un peu d’air.
Les bagages sont à l’avant sur le pont. On les recouvre d’une bâche trouée par les escarbilles. S’il pleut, cette bâche me paraît une protection bien insuffisante. Marie serait désolée que son renard noir fût mouillé, et moi je tremble pour mes plaques photographiques. Devant les bagages est un espace vide de 2 mètres de côté, entre les banquettes toujours couvertes de monde. C’est là que se tiennent les dames quand il fait beau temps, quand il ne fait pas trop chaud, quand les Cosaques ne l’ont pas envahi, car parmi les choses nombreuses qui manquent sur la Zéa, ce qui fait le plus défaut c’est la discipline, c’est l’ordre et par suite la propreté.
L’arrière, au-dessus de notre : cabine commune, est noir de monde. Hommes, femmes et enfants, tout est pêle-mêle sur le pont. Pour gagner notre réduit ou pour en sortir, il faut serpenter au milieu des corps étendus, et faire attention à ne pas mettre le pied sur un bras ou sur une tête. Ces malheureuses gens ont essayé de se faire un abri avec des haillons, des débris de nattes. Rien, rien ne peut donner une idée de l’aspect de la Zéa, qu’on ose nommer un bateau de passagers.
Le cuisinier et le garçon du Yermak sont passés sur notre bateau. Mais la cuisine est en plein vent. Nous ne sommes plus servis maintenant avec le même soin et la même propreté qu’autrefois. Tout est, du reste, moins bon. On a dit bien souvent qu’il ne fallait jamais aller voir préparer les mets si l’on voulait conserver son appétit. Comment éviter ce spectacle, puisque l’officine du chef est au milieu du bateau ? On est forcé de le voir passer dans une machine à hacher cette viande qu’il décorera du nom de beefsteak. Mais glissons !
Aucune tente, aucun abri pour nous protéger contre l’eau du ciel, contre les rayons du soleil, et surtout contre les escarbilles qui tombent en pluie perpétuelle, soit d’un côté, soit de l’autre, suivant que le bateau ou le vent changent de direction. Tantôt c’est un habit qui brûle, tantôt c’est la bâche des bagages, tantôt une ombrelle. Les vêtements que nous portons sont tous des vêtements sacrifiés, et pour beaucoup c’est un sérieux accident, auquel la compagnie, si elle était soigneuse, pourrait facilement parer.
La Zéa n’a pas pu embarquer tous les passagers du Yermak. Nous avons laissé sur la rive à Pakrovska un certain nombre de Cosaques qui vont continuer leur route à pied. Le gouvernement leur alloue pour cela de 9 à 15 kopeks par jour pour leur nourriture, suivant les pays qu’ils traversent. Ils ne poussent aucun cri, ne font aucune récrimination, quand, le 4 juillet, à 5 heures du matin, nous levons l’ancre. Ils sont là sur la berge, autour de leur feu, sur lequel bout l’eau pour le thé. Ils nous regardent partir comme des gens résignés qui se disent : « C’était écrit ».
L’Amour, qui tire son nom du mot mongol Mouran (fleuve), ne commence à s’appeler ainsi qu’à une verste de Pakrovska, au confluent des deux rivières l’Argoune et la Chilka.
L’Argoune prend sa source non loin d’Ourga en Mongolie, sous le nom de Keroulen, dans les monts Gentaï, d’où part la grande chaîne des Yablonovoï ou « Pommiers », traverse le nord du grand désert de Gobi, forme avec l’Oursoune le grand lac Dalaï, à une quarantaine de verstes duquel il commencé à servir de frontière aux deux grands empires Russe et Chinois. Son cours est d’environ 1 800 verstes. La Chilka est formée de deux grandes rivières, l’Onon et l’Ingoda, qui partent des mêmes monts Gentaï. À Ouste-Strélotchnei, leur point de jonction, la Chilka et l’Argoune ne paraissent pas à l’œil être de dimensions bien différentes.
Pour nous qui remontons le courant, le paysage est très pittoresque. L’Amour devant nous se partage en deux branches à peu près égales, séparées par une colline que l’on voit grandir au loin. Les remous de ces deux masses d’eau qui se rencontrent ont formé au milieu du fleuve un banc de sable que la baisse des eaux rend encore plus difficile à franchir. Nous calons moins de 2 pieds, nous devrions passer partout.
À peine dans la Chilka, nous sommes entre deux montagnes couvertes de forêts. Sur la rive droite commence la chaîne des monts Nertchinsk, qui a 500 verstes de longueur. La Chilka n’a guère que 200 mètres de large et son cours est des plus capricieux. Moins grandiose que l’Amour, elle ne manque cependant pas de majesté, et souvent les murailles feuillues entre lesquelles nous voguons n’ont pas moins de 500 à 600 mètres d’altitude, d’après le capitaine. Dans certaines parties on voit également de très beaux rochers.
La profondeur moyenne en temps ordinaire est de 6 pieds, ce qui suffit amplement au Yermak ; mais pour le moment on se demande si à certains endroits nous trouverons les 2 pieds qui sont nécessaires à la Zéa.
Le trajet de Pakrovska à Stretinsk doit se faire normalement en deux jours et demi : aujourd’hui on nous parle de quatre ou cinq. Le capitaine nous menace même de la possibilité d’être abandonnés par lui sur la berge avec nos bagages. Il nous faudrait alors louer de petits bateaux qui nous conduiraient d’un village à l’autre, tirés à la cordelle par des chevaux. Nous haussons les épaules, et nous avons tort : quand on voyage en Sibérie, il faut s’attendre à tout.
Les sept premières stations sur la Chilka jouissent d’une réputation détestable : on les nomme les « sept péchés capitaux », parce qu’elles sont dénuées de ressources et que le passage en est très difficile. Mais en revanche comme elles sont jolies, pittoresques et sauvages ! Je vois paître dans les bois des chevaux de poste, de distance en distance, et des vaches. On a calomnié ces sept stations, j’en ai la preuve à la seconde.
Pendant qu’on embarque le bois, je me promène sur le bord de l’eau. Ma vue effraye une écrevisse, puis une seconde, puis une troisième. J’appelle Hane à la rescousse avec les filets à taons, et quand le sifflet nous rappelle à bord, nous avons une soixantaine de ces intéressants animaux dont nous n’avons pas mangé depuis 1883. Je les fais cuire à la cuisine dans de la vodka et mettre dans deux assiettes, dont une sera portée aux dames.
Elles sont fort bonnes, mes écrevisses ! Mais, à part Poutiatitski, personne ne veut y goûter. Quant aux dames, elles n’ont jamais reçu les leurs. Il s’est probablement trouvé un amateur peu galant à la cuisine.
De même que sur le grand fleuve, je vois installées des lignes à hameçons sans amorce, pour prendre des poissons d’une certaine taille.
Les arbres sont ici beaucoup plus beaux que sur l’Amour. On en voit de magnifiques. C’est, paraît-il, dans ces parages que l’on prend la plus grande partie du bois de construction employé même à Habarovka et Nikolaïevsk. De tous les côtés nous voyons les préparatifs pour la coupe prochaine. On a enlevé un anneau d’écorce d’à peu près 1 mètre à la base de tous les pins qui doivent être abattus cet hiver. La sève va s’écouler, ils se dessécheront au printemps ; on les abattra et l’on en fera des radeaux. Souvent, sur le flanc des montagnes qui bordent la rivière, on voit de longues bandes dénudées, au milieu desquelles un sillon est creusé, depuis le bas jusqu’au sommet. C’est par ce sillon que l’on précipite les madriers coupés sur Les hauteurs, puis des traîneaux les transportent jusqu’aux villages où se forment les radeaux.
La table est trop petite pour nous contenir tous : nous sommes donc obligés de manger en deux fois. Le Sibérien se sert très peu de sa fourchette, c’est Le couteau qui joue ici le rôle prédominant. Il coupe la viande et sort de véhicule pour porter les aliments à la bouche. À cet effet, il est très large, peu tranchant, et arrondi du bout. La fourchette sert à placer sur l’extrémité du couteau les morceaux que l’on veut manger. L’impression que l’on éprouve à voir cela pour la première fois est désagréable. Pas de verre sur la table ; j’en demande un et une carafe. À peine ai-je fini de boire que mon verte est saisi, chacun se le passe à tour de rôle, s’en sert et finalement me le rend. Moi qui ne suis pas habitué à cette promiscuité, j’abandonne le verre au public, et quand j’ai soif, je me sers de ma tasse en cuir, que je remets immédiatement dans ma poche après chaque opération, car elle ferai également le tour de la table, et je n’y tiens pas. Cet ustensile, si simple et si commode en voyage, parait exciter l’admiration. Ma cuvette en caoutchouc n’a pas moins de succès. Sur la Zéa, pas de lavabo. On va à la pompe, on pompe d’une main, on se débarbouille de l’autre c’est simple, c’est pratique, peu coûteux. C’est de la civilisation à la Diogène.
Parmi les Cosaques, j’en remarque un ou deux dont une seule oreille est percée et ornée d’une boucle. C’est une chose fort commune en Chine. A-t-elle dans les deux pays la même cause superstitieuse ? Pour la race jaune, les fils seuls comptent. Ce sont eux dont on remarque le plus la perte, et l’on s’imagine que les divinités infernales, partageant ce mépris des hommes pour la femme, sont plus acharnées contre les garçons que contre les filles. Cette boucle d’oreille a pour objet de les tromper sur le sexe de celui qui la porte.
À Outesnaya, premier péché capital, j’ai remarqué un certain nombre de pêcheurs à la ligne. Ils sont tous Chinois. Le Russe a l’air de dédaigner ce genre de distraction. Le Chinois, J’en suis sûr, pêche dans un but de spéculation : il n’y a pas pour lui de petit profit.
Trois nouveaux voyageurs montent : où va-t-on les mettre ? C’est le chef de la police de Stretinsk et deux médecins, arrivés ici par le dernier bateau pour faire une enquête sur un assassinat. Le chef de la police, apprenant de quelles recommandations je suis muni, se montre fort aimable. Il télégraphie à Stretinsk pour annoncer mon arrivée. Il se met du reste à ma disposition pour faciliter nos préparatifs de départ en tarantass. L’un des médecins parle un peu français ; il habite Nertchinsk.
Le temps est à la pluie. Je tremble pour les bagages, et je les fais recouvrir un peu par Hane. J’avais raison. Dans la nuit il tombe des torrents d’eau. Et ces pauvres Cosaques qui sont sur le pont, et ces malheureuses femmes avec leurs enfants ! L’une d’elles est à la porte de notre cabine, donnant le sein à son bébé. Je la fais entrer. Mais, le plancher étant couvert de passagers couchés par terre, elle s’assied sur les marches de l’escalier : à elle est au moins à l’abri de la pluie. Les dames ont également donné asile à une passagère et son enfant.
Cependant dehors, sur la berge, les Cosaques ont allumé leur feu et font la cuisine comme si Le ciel était pur et parsemé d’étoiles. La seule chose qu’ils cherchent à protéger contre les cataractes du ciel, c’est leur brasier et leur marmite.
5 juillet. — À 3 heures et demie nous partons. Nous allons doucement, en sondant tout le temps. À plusieurs reprises la voix monotone de l’homme de sonde nous a donné des émotions. Il a annoncé deux pieds et demi, puis deux. Nous avons senti des secousses produites par les cailloux du fond de la Chilka, mais nous avons franchi la passe. À 9 heures et demie c’est plus sérieux. Nous entendons successivement : « Dua polovinoi, dva, deux et demi, deux », puis nous sentons des soubresauts et nous nous arrêtons : nous sommes au plein. Il nous faut quelques minutes pour nous dégager en faisant machine en arrière. La Zéa accoste le bord, et le capitaine ordonne à tous les passagers de troisième de descendre à terre et de s’en aller à travers champs jusqu’à un village que l’on voit à une certaine distance. Allégés d’autant, nous passons ; nous reprenons nos Cosaques, que je compte au moment où ils montent à bord : ils sont plus de cent, et ils n’étaient pas tous descendus. La même opération se renouvelle une heure plus tard. Cette fois-ci, pour prendre un peu d’exercice, je me joins, avec une ou deux personnes, aux Cosaques qui descendent.
On nous avait dit de suivre le bord de l’eau et que notre promenade serait à peu près d’une verste : elle fut de huit, et à 100 mètres de l’endroit où la Zéa nous attendait la rive était un vrai marais qu’il nous fallut traverser dans de la boue jusqu’aux chevilles.
L’archiprêtre est un peu inquiet. Il se dit que je ne manquerai pas, en rentrant en France, de parler de ce que j’ai vu en Sibérie. Or le général Kapoustine envoie ses enfants à l’université de Tomsk, ce qui tendrait à prouver que Tomsk est le seul endroit en Sibérie où l’on puisse s’instruire. Cela n’est pas exact. Dans toutes les grandes villes il y a des collèges, des séminaires, à Blagovechtchensk notamment, où l’instruction que l’on donne est tout aussi bonne qu’à Irkoutsk ou à Tomsk ; il déplore cette habitude que l’on a de chercher au loin ce qui est sous la main.
5 juillet. — À 6 heures nous arrivons à Gorbitsa, le septième et dernier des péchés capitaux. La rivière est maintenant partout à peu près assez profonde pour nous permettre d’arriver à Stretinsk sans encombre. Des indigènes montés sur des rennes viennent auprès du bateau. Ils chassent devant eux plusieurs de ces animaux portant des fardeaux. C’est la première fois que nous en voyons.

De nouveaux passagers montent à bord, un monsieur et une dame. Cette dernière trouve qu’elle sera mieux avec nous que dans le salon de l’avant. Elle vient donc sans façon s’installer à notre table. À 11 heures nous nous arrêtons pour la nuit à Ouste-Tchernaya. Avant de me coucher, je vais prendre un bain, Il fait une lune splendide. En rentrant, mon attention est attirée par des éclats de rire. Un triton et une naïade prennent leurs ébats à quelque 30 mètres du steamer. Mon apparition n’a pas l’air de les gêner outre mesure ; ils se contentent de me tourner le dos, en s’enfonçant tant soit peu dans l’eau.
6 juillet. — Nous avons pris à Gorbitsa un certain nombre de juifs ; ils sont facilement reconnaissables. L’un d’eux m’aborde timidement et, m’appelant général, me demande la faveur de quelques minutes d’entretien. Il sait que je suis Français, et voudrait, au nom de ses coreligionnaires, me charger d’un message pour Paris. La conversation a lieu en allemand. C’est grâce à la générosité du baron Hirsch qu’un grand nombre de juifs ont pu quitter la Russie pour venir s’établir en Sibérie. « Nous étions plus malheureux que des esclaves, dit-il, maintenant nous sommes relativement libres et tranquilles. C’est au baron Hirsch que nous le devons. Nous voudrions lui envoyer l’expression de notre gratitude, mais nous ne savons comment faire pour être certains qu’elle arrivera jusqu’à lui. » Il ajouta qu’ils ne demandaient plus rien, que leur vie était facile, et que le baron Hirsch devait consacrer ses libéralités à leurs malheureux frères, encore si nombreux en Russie.
Cette démarche me toucha. Je lui promis de m’acquitter de grand cœur de cette commission que je considérais comme un devoir. À mon arrivée à Paris, j’obtins à grand’peine une audience du célèbre financier, qui me parut tant soit peu ému. On est si peu habitué à la reconnaissance, me dit-il, qu’on est toujours heureux de l’entendre exprimer. Je suis particulièrement sensible à la manière dont celle-ci m’est témoignée. »
Ma démarche toute désintéressée eût, peut-être, mérité une carte de visite, mais, comme me l’a dit lui-même le baron Hirsch, on est si peu habitué à la reconnaissance !
Le maître de poste de Stretinsk est à bord. Il me promet que je ne manquerai pas de chevaux jusqu’à Tchita. Il est arrivé, paraît-il, des ordres du gouverneur général. Voilà une bonne nouvelle. De son côté, le chef de la police, qu’un télégramme arrête en route pour un autre assassinat, vient me serrer la main. Il va télégraphier à l’ataman des Cosaques de Stretinsk de se mettre à ma disposition.
À midi nous sommes à Ouste-Karyiskaya.
La Chilka, basse comme elle est aujourd’hui, n’a pas plus de 100 mètres, mais à certain moment elle doit en avoir 300. Entre l’eau et le quai est une large grève à sec. Une longue jetée en bois, la plus longue depuis Nikolaïevsk, terminée par un arc de triomphe élevé en l’honneur du Tsarevitch, établit les communications avec la terre quand les eaux sont hautes. Elle est noire de monde et de monde élégant ; uniformes, robes de soie, ombrelles, témoignent de l’importance de la station.

Cependant les abords n’ont rien de bien somptueux, et je scandalise fortement le général et Mme Kapoustine en photographiant les maisons qui bordent la rivière, avec leur toit en écorce de bouleau, qui doit être une maigre protection contre les intempéries. Je ne puis pourtant pas ne photographier que ce qui est joli ! Ouste-Karyiskaya a été pendant longtemps le lieu de déportation le plus important de toute la Sibérie. Il y avait encore en 1879, d’après M. Cotteau, 2 144 condamnés aux travaux forcés, dont 41 seulement pour crimes politiques, employés dans les mines d’or, qui sont toutes à la surface du sol et non sous terre, comme on se l’imagine généralement.
Mais on ne veut plus maintenant dans les mines de ce genre d’ouvriers, qui en somme coûtent cher et ne travaillent pas. On leur préfère de beaucoup les ouvriers libres. Le gouvernement a donc à peu près cessé d’envoyer à Ouste-Karyiskaya les condamnés de droit commun. Il y a cependant un certain nombre de déportés politiques, qui le plus généralement sont libres de leurs mouvements, à condition de ne pas quitter le village. La femme de l’un d’eux, aimable et parlant très bien français, prend passage à bord de la Zéa. Elle va au Caucase, auprès de son père qui est malade.
Tous les déportés cependant ne sont pas libres. Il y a les dangereux, les incorrigibles. Un de nos passagers me donne la photographie d’une nihiliste célèbre qui, à la suite de plusieurs évasions, dut être enfermée et mise aux fers.

Nous retrouvons un peu plus loin la rive percée de trous dans lesquels nichent les hirondelles, comme dans certaines parties de l’Amour. Beaucoup de juifs, passagers de troisième classe, sont montés à Ouste-Karyiskaya. Presque tous parlent allemand. Le bateau est littéralement bondé. À partir de maintenant nous refusons tous les passagers.
Sur la rive gauche, au milieu des forêts, un ruisseau vient entre deux collines se jeter dans la Chilka. À l’embouchure est un bloc de glace qui forme un pont de plus d’un mètre d’épaisseur. Je me demande quelles dimensions pouvait avoir au commencement du dégel pour exister encore le 5 juillet ! Toute la contrée est verte et fleurie.
Nous passons le soir un petit village sans grande importance, mais qu’on nous montre avec orgueil. Il se nomme Chilkino. C’est là que fut construite la barge que nous avons vue à Nikolaïevsk, sur laquelle Le général Mouravieff descendit l’Amour il y a trente-cinq ans ! Près de Chilkino nous voyons de grands champs cultivés. Ce sont les premiers que nous remarquions.
7 juillet. — Il est bientôt 3 heures de l’après-midi, Stretinsk est en vue. La partie pénible du voyage va commencer, celle que l’on nous a dépeinte comme si dure à supporter. Avons-nous un tarantass ? Est-il bon ? Et d’abord qu’est-ce que cela peut bien être qu’un tarantass ? Nous n’en avons encore jamais vu.
Maintenant plus de compagnon de voyage parlant français ou allemand. C’est en russe qu’il va falloir nous débattre contre le mauvais vouloir des simotritiels ou maîtres de poste, nous refusant des chevaux sous prétexte qu’ils n’en ont pas, pour se les faire payer plus cher ; en russe encore, que nous ordonnerons au yemchtchik de presser ou de ralentir l’allure de ses chevaux ; en russe, que nous aurons à pourvoir à notre subsistance, à satisfaire à toutes les nécessités de la vie et des voyages, manger, boire, dormir, vivre en un mot, et gagner Tomsk, où nous retrouverons un confort relatif avec la navigation à vapeur.
(La suite à une autre livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[66],
XVII
Stretinsk.
l y a une jetée à Stretinsk,
la foule s’y presse. Au premier
rang se trouve le colonel
qui commande la garnison, entouré
de ses officiers. À peine
avons-nous établi les communications
avec la terre
qu’il monte à bord, et vient
très aimablement m’annoncer
que par ordre du gouverneur
général de la
Transbaïkalie il nous a
fait préparer des chambres
au Vauxhall ; il
ajoute que l’ataman des cosaques,
qu’il me présente,
a ordre de rester jour et nuit
à ma disposition ; puis il me remet un ordre du gouverneur
général à tous les maîtres de poste d’avoir à
me fournir des chevaux sans le moindre retard, en
réquisitionnant, s’il en est besoin, ceux des paysans.
Au Vauxhall nous sommes aussi bien installés qu’on peut l’être dans un hôtel, si l’on n’a pas la luxueuse habitude de coucher dans un lit et de se servir de draps. Un monsieur s’avance et me dit : « Permettez à un compatriote de vous souhaiter la bienvenue ». Fort surpris de trouver un Français à Stretinsk, j’apprends qu’il se nomme X…, qu’il est en Sibérie depuis une vingtaine d’années, et au service du gouvernement russe. Sa résidence est Tchita, mais, profitant d’un congé, il est venu voir des amis à Stretinsk.

Puis M. Mikoulitch, exilé polonais, propriétaire de l’hôtel, qui parle très convenablement notre langue, me présente M. Choustof, l’agent de M. Cheveleff, qui m’annonce qu’il m’a acheté pour la somme de 325 roubles le plus beau tarantass qui ait jamais paru à Stretinsk, fabriqué à Kazan, absolument neuf, ni trop grand, ni trop petit : juste ce qu’il nous faut.
Allons voir cette merveille : elle est dans la rue, à la porte de l’hôtel, avec une douzaine d’autres qui attendent des acquéreurs.
Je dois dire que notre tarantass brille en effet d’un rare éclat au milieu des horreurs qui l’entourent. On n’a rien exagéré, et les Kapoustine, qui m’avaient tant parlé de l’importance d’un bon et solide véhicule, ne cessent de pousser des cris d’admiration : « Sehr gut, ganz qut ! » Leur enthousiasme me fait plaisir, et ce qui me rassure le plus, c’est de voir dans quel équipage ils se disposent à partir pour Tomsk. Leurs roues sont gondolées, deux ou trois d’entre elles ont été raccommodées avec des attaches. Ils ont tremblé pour nous, nous tremblons maintenant pour eux.
Hane définit ainsi le tarantass : un gros tonneau coupé en deux dans le sens de la longueur, avec une capote par derrière, et un siège par devant, placé sur un chariot à quatre roues. Il y a beaucoup de vrai dans cette description.
Le chariot se compose de huit perches d’environ 3 m. 25 de long, fixées à l’arrière sur l’essieu et à l’avant sur une pièce de bois que traverse la cheville ouvrière, perches dont la longueur fait l’élasticité. C’est sur celles que se pose le demi-tonneau, comme dit Hane, dont, à l’inverse de ce qui se voit dans les navires, l’armature est placée en dehors. Un tablier qui vient s’attacher à la capote permet de fermer assez hermétiquement la voiture quand il pleut ou quand on veut dormir. Un sabot, destiné à enrayer une des roues de derrière, est fixé à l’avant par un long câble. Derrière est une fourche en fer qu’on doit laisser traîner aux montées pour empêcher l’équipage de reculer aux pentes trop rudes quand les chevaux sont impuissants à le retenir. Cette dernière pièce est plutôt un embarras : elle aurait pu nous servir une fois, mais naturellement elle était à ce moment attachée la pointe en l’air.
La caisse de la voiture, longue de 2 mètres et large de 1 m. 30, ne contient aucun siège. On y range ses bagages comme des paquets dans une valise, et l’on se met par-dessus. Il est évident que nos belles et solides malles, commandées à Paris pour la circonstance, seraient on ne peut plus incommodes dans le tarantass. D’un autre côté, tout le monde n’a cessé de nous répéter que ce que l’on place derrière la voiture, attaché avec des cordes, est volé. Nous avons vu plus tard cependant beaucoup de tarantass portant des malles ainsi placées par derrière : mais elles étaient attachées par tout un système de chaînes de fer.

Nous nous résolvons à réexpédier une caisse par Nikolaïevsk et les Indes. Nous la chargerons des choses qui ne sont pas d’absolue nécessité, les plaques photographiques déjà employées, le renard noir, etc. La seconde malle vide sera placée derrière la voiture. Si on la vole…, on sera volé et nous en serons quittes pour en racheter une autre à Tomsk. Si elle arrive à bon port, nous serons très heureux de l’avoir. J’ai vu souvent aux stations des gens à mine louche jeter sur cette malle des regards suspects. J’avais grand soin de dire assez haut aux cochers, qui avant de monter sur le siège doivent faire le tour de l’équipage pour s’assurer que tout est bien en ordre, de ne pas s’inquiéter de la malle, qu’elle était vide. N’ai-je pas vu à plusieurs reprises des gens dans les villages, pendant que nous changions de chevaux, venir essayer de la soupeser ?
Les Sibériens se servent de valises en cuir mou, très larges, très longues, très plates, sans autre fermeture que des boucles. Ces valises, fort chères, ne nous seraient d’aucune utilité à partir de Tomsk. Nous nous contenterons donc de faire deux ou trois ballots que nous entourerons de feutre mongol et d’une simple corde. Un panier japonais composé de deux parties dont l’une rentre dans l’autre contiendra les effets qui craignent d’être froissés, la robe de cérémonie de Madame et l’habit noir de Monsieur. Deux sacs en toile à voile compléteront les bagages.
Je vais faire une visite au colonel, qui m’assure que des ordres ont été donnés à toutes les stations de tenir toujours trois chevaux prêts jusqu’à mon passage. Je n’aurai qu’à prévenir l’ataman des cosaques de l’heure à laquelle je désire partir.
Vendredi. — Nous faisons les paquets. Le garçon de l’hôtel va m’acheter pour 3 roubles un carré de feutre et une certaine quantité de cordes. Il revient en me disant qu’il s’est bien gardé d’aller prendre ces choses chez un juif, « Les juifs sont, dit-il, trop voleurs ». Je ne fais nulle réflexion.
Le général et Mme Kapoustine viennent nous dire adieu. Ils sont accompagnés d’une bonne. Nous les voyons monter en deux voitures tous les onze, je pourrais dire douze d’après les confidences qui me sont faites et qui devraient nous rassurer sur le voyage en tarantass, que Mme Kapoustine affirme du reste préférer au voyage en chemin de fer : à la vitesse près, nous sommes maintenant de son avis…, quand les routes sont bonnes.
Stretinsk, tête de ligne de navigation, est plus grand qu’un bourg. Il s’étend sur la rive droite de la Chilka, sur une longueur de plus de deux verstes. À l’extrémité Nord est un camp assez important dans lequel se trouve la prison où l’on enferme les forçats jusqu’à leur départ en barge pour le bas Amour. Nous en voyons justement passer une chaîne devant nos fenêtres. La décrire, c’est décrire toutes celles que nous avons rencontrées entre Tomsk et Stretinsk. Celle-ci cependant est particulièrement importante comme nombre. On y voit des types de toutes les races qui composent l’immense empire russe. Les uns ont le visage pâle et les cheveux blonds des hommes du nord, d’autres le teint cuivré des Asiatiques, la figure énergique des habitants du Caucase, le nez crochu des Israélites, etc. Presque tous ont encore le costume de leur pays. Je reconnais entre autres deux Persans. Ils sont à pied, avec des chaînes aux jambes qui ne les empêchent cependant pas de marcher d’un pas rapide. Des télégas suivent, dans lesquelles sont entassés un certain nombre de femmes, d’enfants et de condamnés malades ou infirmes. Devant, sur les côtés et derrière, marchent une douzaine de Cosaques, fusil sur l’épaule. Très peu d’ordre du reste dans le cortège ; les deux ou rois premiers rangs seuls un peu serrés. Tout ce monde, détenus et escorte, cause, rit et a plutôt l’air gai. Hane a surtout le don de les mettre en joie, et il vaut peut-être mieux pour nous ne pas comprendre très bien toutes les remarques que lui adressent certaines jeunes personnes qui font partie de la chaîne, bien que libres de leurs mouvements.
L’ataman prend son rôle un peu trop au sérieux. Il est vêtu de noir de la tête aux pieds et, à la chaîne au cou près, ressemble assez à un huissier. Je ne puis sortir de ma chambre sans voir paraître sa longue silhouette. Il cherche à deviner mes désirs et en est parfois gênant. Il ne s’éloigne que quand il voit qu’il ne peut nous être utile en rien ; mais il veille !
Il y a un établissement de bains froids dans la Chilka, à une cinquantaine de mètres du Vauxhall, construit sur le modèle de ceux de Paris, mais sans cabines, et ayant à peu près 3 mètres dans tous les sens. C’est suffisant pour se tremper. Ces bains doivent surtout servir aux dames, car je n’en vois pas se baigner sur le rivage, où en revanche les hommes sont nombreux, dans le costume d’Adam, cela va sans dire. Plongeons-nous une dernière fois dans les eaux du fleuve du Dragon Noir !
M. X… est descendu de Tchita par la rivière, dans un bateau du pays qu’il avait payé trois roubles. Si l’eau avait été trop basse aux Péchés Capitaux pour permettre à la Zéa de passer, c’est dans un bateau semblable que nous aurions eu à remonter la Chilka pendant plusieurs centaines de kilomètres.

On nous a assez dit qu’en dehors des grandes villes nous ne trouverons rien à acheter. Nous nous munissons donc ici de traits de rechange, qui ne sont du reste que de simples cordes, et de quelques clous ; Hane a apporté de Pékin un marteau et des tenailles. Chacun nous répète qu’ayant un bon tarantass nous n’avons pas besoin de nous encombrer de matériaux pour le réparer. « Vous verserez cinq ou six fois avant de rien casser d’important », ajoute-t-on.
Ce n’est pas la première fois qu’on nous avertit de la fréquence de ces accidents. Le chargé d’affaires de Russie à Pékin nous avait bien recommandé de ne pas oublier d’attacher solidement, au moyen de cordes, nos bagages dans le fond du tarantass, « parce que, dit-il, répondant à un pourquoi bien naturel, lorsque vous verserez, vous ne serez pas alors écrasés par vos caisses ». Verser serait-il donc une aventure quotidienne ?
Toutes les cinquante verstes à peu près il est indispensable de graisser les roues si l’on ne veut s’exposer à les voir prendre feu dans une de ces courses vertigineuses auxquelles il faut nous attendre. Je fais donc mettre six livres de graisse dans un coffre fermé à cadenas, car on me dit que la graisse est une chose qui s’évapore facilement dans les stations.
Sur la recommandation de M. Ninaud, je me suis procuré vingt roubles de pièces de cuivre et d’argent, de un, deux, dix et vingt kopeks. Cette précaution est nécessaire, car jamais vous ne trouvez nulle part de monnaie pour faire l’appoint lorsque vous payez, et vous êtes obligé d’abandonner chaque fois une vingtaine et souvent plus de kopeks, ce qui finit par faire une somme.
8 juillet. — Il nous faut encore un carré de feutre et une corde pour attacher la caisse qui doit partir par mer. M. Mikoulitch les fait acheter, mais j’ai à payer un rouble de plus qu’hier pour la même quantité et la même qualité de marchandise. La raison en est assez amusante. C’est aujourd’hui samedi, jour du sabbat, et toutes les boutiques de ces juifs que l’on méprise sont fermées. Les honnêtes chrétiens en profitent pour vendre plus cher ce jour-là. C’est un fait reconnu, et chacun ici fait ses provisions le vendredi. Mais il me semble qu’ils ont du bon, les juifs, et que
- Le plus juif des deux……
J’ai prévenu l’ataman que je désire partir aujourd’hui à deux heures. Après le déjeuner, nous rangeons nos paquets dans le fond du tarantass.. Nos matelas de voyage sont étendus par-dessus, en plan incliné, de façon à nous permettre de voir le paysage, et nos oreillers nous soulèvent encore les épaules et la tête. Je remets à l’agent de M. Cheveleff la caisse qu’il doit m’expédier par mer, et qui par parenthèse m’est arrivée à Paris dans la première semaine de janvier 1893, soit exactement six mois après notre départ de Stretinsk. M. X…, qui retourne à Tchita, ne partira que cette nuit. Il nous donne rendez-vous à Nertchinsk.
Le maître de poste est exact. À 9 heures le yemchtchik est sur son siège, et nos trois chevaux partent au trot. Ils s’arrêtent au bout de 200 mètres devant le bac qui doit nous transporter de l’autre côté de la Chilka. Le fidèle ataman commande la manœuvre. Bientôt il nous fait ses adieux, nous sommes sur la rive gauche de la rivière, et nos chevaux gravissent lentement la côte qui se trouve devant nous. Hane est sur le siège à côté du yemchtchik.
XVIII
De Stretinsk à Tchita.
Quelque prévenu que l’on puisse être de l’allure à laquelle vont les cochers sibériens, il est impossible de ne pas ressentir un peu d’émotion pendant la première heure que l’on passe en tarantass, surtout dans la Transbaïkalie. D’abord, pas de frein pour ce lourd véhicule. Il y a bien le sabot, mais on s’en sert rarement : si l’on voulait le mettre et l’enlever toutes les fois qu’il serait prudent de le faire, le voyage serait alors deux fois plus long.
Ce ne sont que montées et descentes, que ravins dans lesquels on s’enfonce pour en ressortir immédiatement. La route suit toutes les ondulations du sol, bien rarement atténuées, et il faut que les pentes soient véritablement infranchissables pour que l’on condescende à faire un léger détour.
Au rebours de ce que nous faisons en Europe, où l’on serre les freins et où l’on modère l’allure à la descente, dès que la moindre inclinaison vient en aide aux chevaux la vitesse s’accentue, le galop commence et devient souvent quelque chose de fantastique.
Debout sur son siège, joignant l’action à la parole, le yemchtchik crie et fouaille à tour de bras, et l’on arrive au bas de la côte avec une vitesse de train express. Ce n’est quelquefois, lorsque la route devient plate, qu’un ou deux kilomètres plus loin qu’il est possible d’arrêter les chevaux emportés. Mais si, comme c’est le plus souvent le cas, une nouvelle côte se présente, la vitesse acquise en fait remonter une bonne parte, puis On va au pas.
Souvent au fond d’un ravin ou entre deux collines se trouve un torrent, une rivière qu’un pont en bois traverse, auquel on n’arrive presque jamais que par une courbe, je ne sais trop pourquoi. C’est toujours avec la rapidité de la foudre qu’on le franchit.
Nous avons remarqué bien des fois que plus la route était accidentée, plus nous faisions de verstes à l’heure.
Notre yemchichik n’a garde de manquer aux traditions sibériennes, et souvent aux descentes, emportés dans un galop frénétique, nous éprouvons les mêmes sensations que lorsque, étant enfants, dans une balançoire arrivée au haut de sa course, nous nous sentions précipités dans le vide avec une vitesse toujours croissante : seulement les mouvements n’ont pas la même mollesse.
Il est de règle, pour tout yemchtchik qui se respecte, de partir d’une station ou d’y arriver ventre à terre, à moins qu’il ne faille traverser une rivière à peu de distance de la maison de poste. Les chevaux, qui sont habitués à la manœuvre, une fois attelés ont l’air inquiets ; ils dressent les oreilles, tournent la tête ; cherchant à saisir le moment précis où le fouet va s’abattre sur eux. Deux et quelquefois trois hommes les maintiennent par la bride. Cependant le yemchtchik, sans se presser, fait une dernière fois le tour du tarantass, met tranquillement ses gants, s’il en a, puis, rassemblant dans la main gauche les cordes épaisses qui lui servent de rênes (il y en a quatre pour une troïka), il s’élance d’un bond sur son siège, brandissant son fouet à manche court. Les hommes qui sont à la tête des chevaux n’ont que le temps de s’écarter pour laisser passer l’ouragan qu’aucune force humaine ne pourrait arrêter pendant les premières minutes.

Dans tout attelage russe est une pièce de bois semi-circulaire, placée au-dessus du collier du cheval qui est dans les brancards. Cette pièce de bois est très importante. Elle sert d’abord à maintenir l’écartement des brancards. En outre, à sa partie supérieure est fixé un bridon qui met l’animal dans l’impossibilité de baisser la tête et de prendre le mors aux dents. Le yemchtchik à donc toujours un cheval bien en mains. Tout en haut sont attachées trois sonnettes dont le tintement doit annoncer de loin l’arrivée de l’équipage et indiquer au maître de poste qu’il faut préparer au plus vite des chevaux. Mais cela, c’est de pure théorie quand il ne s’agit pas du service des dépêches ou de voyageurs annoncés par les autorités. Ce dernier cas est le nôtre, et quand nos chevaux ruisselants de sueur s’arrêtent devant la station, nous en trouvons trois autres tout harnachés, attachés à des piquets. Trois palefreniers se précipitent sur notre attelage, en deux minutes notre troïka est changée, j’ai payé le tarif fixé pour les trente verstes de la nouvelle étape, et nous dévorons de nouveau l’espace.
Même cérémonie aux stations suivantes. Nous nous mettons dès le premier jour au régime des voyageurs sibériens, c’est-à-dire que nous ne perdons pas notre temps à manger dans les stations. Le pays n’a rien de bien remarquable, et n’offre aux regards que des collines presque entièrement dénudées. La nuit est particulièrement froide, et les flaques d’eau sont recouvertes d’une mince couche de glace. Il fait presque aussi clair qu’avant le coucher du soleil, la lune est splendide, et ces premières cent verstes en tarantass nous ravissent d’aise. Il faut dire que notre mince bagage a été très bien arrimé ; nos petits matelas amortissent suffisamment les chocs, et nos oreillers sont une bonne protection pour la tête. La position semi-horizontale est évidemment la seule qui convienne pour les longs voyages en voiture, car nous ne ressentons pas la moindre fatigue. Nous augurons donc bien sous ce rapport des milliers de kilomètres qu’il nous reste à parcourir, et c’est avec une sorte de satisfaction triomphale que nous entrons dans Nertchinsk.
Nous suivons d’abord une rue ressemblant à toutes les rues de toutes les villes sibériennes, bordée des mêmes maisons en bois, avec les mêmes fenêtres encadrées de blanc ; puis, tout à coup, nous débouchons sur une grande place et nous croyons rêver.
En face de nous se dresse un immense palais dont les murailles d’un blanc de lait éclairées par une lune resplendissante se découpent dans l’azur du ciel. L’architecture en est bizarre, tous les styles s’y rencontrent. C’est un splendide décor de féerie.
Qui se serait jamais attendu à trouver au fond de la Sibérie un édifice aussi imposant, et quel peut être cet édifice ? Tout d’un coup l’idée me vint que nous avions devant nous la célèbre maison de M. Boutine, le grand marchand sibérien, chez lequel on nous avait prévenus qu’une chambre nous était préparée, et le yemchtchik se mit à chercher la porte d’entrée.
En nous approchant, nous remarquons que tout semble abandonné : aucun bruit, aucune lumière dans l’intérieur, pas de rideaux aux fenêtres. Nous allons de porte en porte sans parvenir à nous faire entendre. C’est le palais de la Belle au bois dormant.
De guerre lasse nous allons à l’hôtel ou gastinitsa, où l’on nous donne deux chambres très propres, presque élégantes, convenablement meublées et ornées de belles plantes vertes des tropiques. Je me souviens surtout d’un superbe caoutchouc qui atteignait le plafond. Toutes les fenêtres sont condamnées : les plantes s’en trouvent, paraît-il, fort bien, mais un peu plus d’air serait désirable pour les humains.
9 juillet. — À mon réveil, je trouve dans la cour un agent de police en uniforme qui m’explique en allemand qu’il est originaire des provinces baltiques et qu’il a reçu l’ordre de se mettre à ma disposition pendant tout mon séjour à Nertchinsk.
M. X… arrive vers 9 heures, et nous accompagne dans la ville. Nous allons d’abord visiter le musée : le directeur nous en fait les honneurs et met beaucoup d’empressement à me donner tous les renseignements que je lui demande sur le pays ; il m’offre, sur l’histoire de la Sibérie, un tableau résumé des principaux épisodes de la conquête. Le musée est très riche en échantillons minéralogiques, et surtout en échantillons aurifères. On nous montre un morceau de granit contenant des pépites du précieux métal, ce qui est, paraît-il, d’une extrême rareté.
À la suite de la visite de Son Altesse Impériale le Tsarévitch, il y a un an, le directeur a eu l’idée de prier les visiteurs de mettre leur signature sur un livre d’or préparé à cet effet. Il regrette que la première signature ne soit pas celle du futur Empereur de toutes Les Russies, et se console en pensant que ce sera la mienne. Je ne puis que partager ses regrets de ne pas voir mon nom à la suite de celui d’un si auguste personnage, et me décide à noircir le premier la première page du registre.
Quelques minutes après, nous sommes dans la maison hospitalière de M. Boutine, le frère de celui qui à construit le magnifique palais dont j’ai parlé plus haut, dans un immense salon, situé au premier étage, rempli de plantes tropicales, et où 150 personnes pourraient danser à l’aise. À l’une des extrémités du salon se trouve une estrade pour l’orchestre. Après le déjeuner nous allons visiter la chambre dans laquelle le Tsarévitch a couché. Rien n’y a été changé : on a simplement mis des housses sur Les fauteuils.
Tout respire ici le plus grand luxe : les serres, les jardins sont à l’avenant.

Nous demandons cependant à visiter le palais, et nous l’obtenons avec quelque peine, car il est sous scellés. La maison Boutine a été mise en faillite, contre toute espèce de justice, nous ont affirmé dans la suite des gens bien informés. Le procès de liquidation est loin d’être terminé, et tout porte, à croire qu’il le sera en faveur du malheureux négociant.
La photographie de l’extérieur donne une idée de l’intérieur de cette immense maison de commerce : escaliers, chambres, salons, salles de fêtes, etc., rappellent par leurs dimensions ceux de certains palais princiers. On y voit des meubles de grand prix, des tableaux de maîtres, un grand portrait de Mme Boutine en costume russe, par Markovski, des porcelaines de Sèvres, une énorme glace de Saint-Gobain qui a figuré à l’Exposition de 1867, et dont le prix de transport a triplé ou quadruplé le prix d’achat, etc. On se demande en parcourant ces immenses salles pour qui elles ont été faites. A-t-on jamais pu trouver dans la ville de Nertchinsk, même au temps de sa plus grande splendeur, assez de gens à inviter pour qu’elles ne paraissent pas vides ?

Les comptoirs, les bureaux, sont dans les mêmes proportions. Ils égalent en dimensions, je ne dirai pas ceux des plus grands, mais ceux des grands magasins de Paris. C’est que la maison Boulne tenait entre ses mains tout le commerce de la province, toutes les affaires de banque, et possédait de nombreuses mines d’or.
Nertchinsk, fondée en 1654, est la plus ancienne ville de la Sibérie orientale. C’est là que fut conclu en 1689, avec la Chine, le traité qui excluait les Russes du bassin de l’Amour et d’Albasine dont ils s’étaient emparés en 1648. La découverte de mines d’or dans tous ses environs lui donna presque aussitôt une importance énorme qui ne fit qu’augmenter par suite de son choix comme lieu de déportation.
Nertchinsk nous a un peu rappelé Nikolaïevsk : c’est une ville qui se meurt. La faillite Boutine est-elle la cause ou le résultat de cette décadence ? La population varie suivant les saisons, comme celle de toutes les villes dans le voisinage desquelles sont des mines d’or. L’hiver, les mines sont abandonnées et les mineurs vont dans les grands centres.
10 juillet. — À 5 heures du matin nous quittons Nertchinsk. Au bout d’un quai d’heure de galop, à travers une large plaine unie, nous arrivons au bord de la Nertcha, que nous passons en bac. Les papiers dont je suis porteur me donnent la franchise sur les ponts et les bacs, et comme les rivières sont très nombreuses en Sibérie cette franchise n’a pas laissé de me faire économiser un nombre respectable de roubles pendant le voyage. La Nertcha n’a pas plus de 100 mètres de large, et nous perdons cependant un grand quart d’heure à la traverser. À 7 heures nous arrivons à la première station, Mirsanova : nous avons fait 30 verstes.
Des chevaux nous attendent. Pendant qu’on les attelle, un des nombreux curieux qui nous entourent vient causer avec Hane, en chinois. J’apprends que cet homme, que nous avions pris d’abord pour un Cosaque, n’est autre chose qu’un Coréen établi dans le pays depuis quelques années. Son étonnement n’est pas petit de m’entendre, après avoir causé avec lui en chinois, lui adresser la parole dans sa langue maternelle. Il me dit que maintenant il est Russe, et fixé pour toujours à Mirsanova.
La route est plate, ou plutôt il n’y a pas de route. On va droit devant soi au milieu d’immenses plaines. Un tarantass venant dans l’autre sens passe à plus de 100 mètres de nous. Bientôt nous ne sommes plus qu’à ou 6 verstes de Kazanova, la prochaine station. Tout à coup nous voyons arriver sur notre gauche, à une cinquantaine de mètres, la voiture de M. X… qui cherche à nous dépasser. Notre yemchtchik se dresse sur son siège, et alors commence entre nos deux attelages une lutte de vitesse difficile à décrire. Les chevaux deviennent aussi fous que les cochers, l’épuisement seul aura raison des uns et des autres, si toutefois aucun accident ne vient mettre un terme à celle course. Des chevaux paissent non loin de là : entraînés par noire exemple, ils se mettent de la parue et galopent autour de nos voitures, ce qui affole encore davantage nos bêtes. Mais tout a une limite, même la force des chevaux sibériens : les nôtres s’arrêtent d’eux-mêmes devant la station de poste, plus qu’à moitié fourbus.
Nous sommes en plein pays aurifère. Nous résolvons de faire un détour pour aller visiter les mines, bien qu’il soit dangereux d’abandonner la route de poste et de s’enfoncer dans les montagnes.
Nous partons après un déjeuner sommaire. Le chemin suit une étroite vallée, au milieu de laquelle coule un torrent. C’est à peine si nos quatre chevaux, attelés de front comme d’habitude, ont, en certains endroits, assez de place pour passer. Un faux pas, et nous serions précipités dans l’eau. Ils galopent cependant avec ardeur, conduits habilement par un excellent yemchtchik qui ne ralentit même pas leur allure quand il faut passer d’un bord à l’autre du torrent, sur des ponts étroits, sans parapets, composés de troncs de sapins placés côte à côte sur deux ou trois plus gros qui servent de solives, et nous arrivons, après avoir franchi 19 verstes en 70 minutes, devant le placer ou prise de M. Jan Bujwid. Nos chevaux, fatigués, ont peine à gravir la pente au haut de laquelle se trouve la maison. À 10 mètres du sommet ils s’arrêtent et sont entraînés en arrière par le poids de notre lourd véhicule. C’est ici que la fourche aurait pu nous servir. Le yemchtchik, Hane et moi sommes à terre en un clin d’œil, des gens accourent, on pousse aux roues, et M. Bujwid aide Marie à descendre.
Nous n’avons pas de chance. C’est aujourd’hui la fête des saints Pierre et Paul et l’on ne travaille pas. Notre hôte nous montre des échantillons d’or et m’offre un morceau de granit contenant des pépites, cette rareté du musée de Nertchinsk. Sa maison est petite, mais très propre. M. Bujwid est un homme jeune, instruit, à la figure énergique et distinguée. Grand chasseur, il possède des chiens de race et des armes de prix, nécessaires également pour sa défense contre les bandits dont le pays pullule. À 3 heures cet demie, nous prenons congé de lui, conduits par un yemchtchik superbe, dans sa livrée de drap noir, grand, carré d’épaules, barbu, tout le physique de l’emploi.
Les chemins sont abominables, étroits, pierreux, remplis d’ornières. Notre cocher n’en a cure. Nous cherchons à modérer son allure, il l’accélère. Marie lui dit d’aller doucement, il lui répond : « Ici, il faut aller vite ». Un peut pont se présente, jeté sur un fossé heureusement peu profond, nous le passons au galop, deux roues sur le pont, deux roues dans le fossé ; la vitesse nous empêche de verser. Plus de doute, notre automédon se nomme ou Pierre ou Paul et a trop fêté son saint. Il commence en effet à s’agiter sur son siège en se balançant le corps, et se retournant continuellement pour voir si la seconde voiture nous suit. Car dans ces pays sauvages il est prudent de marcher de conserve, Bientôt il accroche un arbre ; je lui dis d’arrêter, il presse le pas, passe sur une énorme pierre qu’il ne voulait pas se donner la peine d’éviter, et patatras ! notre voilure verse et nous nous trouvons ensevelis sous nos bagages, qui heureusement sont mous. Me relever et administrer une correction à notre automédon fut J’affaire d’un instant. Pendant la correction il montrait le poing à la pierre en lui adressant toutes les injures que le vocabulaire russe pouvait lui fournir, tout en faisant signes de croix sur signes de croix. Il nous fallut près d’une heure pour relever notre tarantass et nous remettre en roule. À peu près dégrisé par l’incident, notre yemchtchik se montra plus maniable.
Enfin, après avoir franchi deux montagnes assez élevées, traversé plusieurs rivières et torrents, nous arrivons en vue de la prise ou placer Andrewski, but de notre excursion. Nous côtoyons une ligne de huttes de travailleurs : elles sont faites en écorce d’arbres. Des gens nous crient de nous arrêter, que nous sommes dans un mauvais chemin. Notre cocher, qui, malgré la nuit, aperçoit au loin les lumières du village, continue sa route. Nous nous arrêtons au bord d’un précipice et revenons dans le bon chemin à travers champs. C’est le dernier incident. Dix minutes après, nous arrivons devant la porte du propriétaire de la mine, qui nous invite gracieusement à entrer. Nous sommes chez des israélites.

Ici encore, l’allemand m’est d’un grand secours, et c’est en cette langue que notre hôte, M. Kaplounof, m’adressera toujours la parole. Bientôt tous nos paquets sont transportés dans la maison et le dîner est servi. Tout est propre et bon. Quand vient le moment de fumer, on ne veut pas que je me serve de mes cigarettes. Tout ce qui est ici est à ma disposition : me servir de mes affaires serait faire offense à l’hospitalité juive, M. et Mme Kaplounof ont abandonné leur propre chambre pour nous l’offrir. Nous avons des lits et des draps ! Je remarque que les couvertures sont un peu légères et je vais chercher Les nôtres. On me les prend des mains et l’on en apporte de nouvelles, toujours d’après le même principe d’hospitalité. Nos objets de toilette obtiennent cependant droit de cité.
11 juillet. — Dans le milieu de la vallée, près de deux cents hommes et femmes, armés de pelles et de pioches, sont occupés à charger une cinquantaine de tombereaux avec tout ce qui compose le sol, terre, sable, pierres, depuis la surface jusqu’à une profondeur qui ici dépasse rarement deux mètres. Cette profondeur, de même que la largeur du terrain à enlever, est indiquée par des laveurs au plat qui accompagnent les travailleurs. Voici en quoi consiste leur occupation : ils prennent dans la partie à essayer une pelletée de terre qu’ils mettent dans un grand plat creux en bois, au bord du ruisseau qui traverse l’exploitation. Avec une sorte de griffe en fer, ils délayent cette terre en plongeant une partie du plat dans l’eau courante. Il se forme d’abord une bouillie qui peu à peu s’éclaircit, la terre étant emportée par le courant. Il ne reste plus au fond du plat que les matières lourdes, c’est-à-dire les cailloux et l’or. Le précieux métal, ayant une densité beaucoup plus grande que la pierre, se trouve au-dessous. Il suffit alors d’incliner le plat en l’agitant légèrement pour en faire tomber les cailloux. Bientôt il ne reste plus que les pépites, dont le nombre indique la richesse du terrain que l’on veut essayer.
Le principe du lavage au plat, basé sur la densité de l’or, est appliqué au lavage en grand. Il est tout d’abord nécessaire d’avoir une chute d’eau d’au moins six mètres, et, pour l’obtenir, on est généralement obligé de détourner le cours d’un ruisseau que l’on amène par un aqueduc en bois, long quelquefois d’un ou deux kilomètres, jusqu’au point où l’on veut établir cette chute, en plan incliné d’une vingtaine de mètres de longueur. Ce plan incliné est muni d’un bout à l’autre d’un plancher en fer parfaitement uni, sur lequel viennent s’appliquer des grilles en fer à raies carrées, destinées à arrêter les pépites et les cailloux. Au-dessus est une plaque en tôle percée d’innombrables gros trous permettant aux pépites de passer, mais faisant glisser les gros cailloux dans les tombereaux placés en bas, qui les emportent au loin.

D’autres tombereaux apportent la terre aurifère au sommet du plan incliné. Cette terre est emportée par les eaux, et l’or est retenu danses grilles dans lesquelles son poids l’a entraîné. Un simple lavage à la main deux fois par jour permet de le séparer des sables qui l’ont accompagné. Un Cosaque représentant l’autorité est toujours présent à l’opération. L’or est immédiatement desséché au feu sous ses yeux et il en insert scrupuleusement le poids.
La mine Andrewski doit en recueillir au moins 700 grammes par jour pour couvrir tous ses frais, qui sont considérables. M. Kaplounof eut l’amabilité d’offrir à Marie quelques pépites récoltées sous nos yeux, en souvenir de notre visite.
L’établissement d’une mine est entouré de formalités sans nombre et ne se fait pas sans une première mise de fonds qui ne laisse pas d’être relativement considérable.
Le premier venu ne peut errer dans les montagnes à la recherche de placers. Il faut, tout d’abord, obtenir du gouverneur général de la province une autorisation spéciale pour soi-même et pour les ouvriers que l’on emploie, dont on est responsable et dont il faut présenter les papiers aux autorités ; on doit désigner les districts que l’on a l’intention d’explorer, afin d’être toujours sous la surveillance de la police.
Si l’on a le bonheur de découvrir un terrain riche en or, il faut demander l’autorisation de l’exploiter, en dresser un plan détaillé, avec indications précises de l’endroit où il se trouve, faire des fouilles dont le nombre est fixé par la loi, en donner les résultats, planter des poteaux pour marquer les limites de la mine, remettre tous les documents au bureau de police le plus voisin et attendre.
Ce n’est qu’au bout de deux ou trois ans que l’on est déclaré propriétaire du placer. Un géomètre du gouvernement vient en dresser le plan, puis fait son rapport au bureau des Mines, qui, au bout d’un certain temps, délivre un plan exact et officiel des terrains que l’on a le droit d’exploiter. Il reste alors à établir l’aqueduc, le plan incliné de lavages, à acheter les chevaux, les voitures, etc.

Le gouvernement prélève sur la production un droit qui va de 5 à 10 pour 100. Toute pépite doit être pesée et inscrite sur un livre de contrôle. La moindre infraction peut être punie d’une forte amende et même de deux ou trois ans de prison. La totalité de l’or extrait doit être envoyée à la fonderie impériale à Irkoutsk, mais ce n’est qu’au bout de six mois qu’on le rend, monnayé, en pièces de cinq roubles.
La prise Andrewski paraît prospère, si l’on en juge par le nombre des travailleurs et par l’aspect du village qui entoure la maison de M. Kaplounof. Je remarque beaucoup de cultures maraîchères.
Cependant il faut songer au départ. J’offre à nos hôtes une boîte d’un thé parfumé qu’ils ont paru trouver exquis. Ils ne veulent l’accepter que si je consens moi-même à emporter un peu d’excellent tabac qui vient de Moscou. L’échange se fait, et prenant enfin congé de ces aimables gens, nous partons, sous la conduite de leur fils qui nous accompagne à cheval.
La forêt commence à la sortie du village et c’est à peine si un chemin y est tracé. Mais nos conducteurs se reconnaissent très bien au milieu des arbres, car c’est par ici qu’ils vont trois ou quatre fois par mois à la station de poste porter leur or. Les chevaux sont bons et nous marchons vite. Tout à coup Hane se rappelle qu’il a oublié de graisser les essieux. C’est une grave faute et nous sommes obligés de nous arrêter pour le faire. N’ayant aucun levier pour soulever le tarantass pendant l’opération, nous ne retirons les roues qu’à moitié. C’est un graissage insuffisant, mais espérons que nous arriverons au relais prochain sans que nos roues prennent feu.
La forêt est superbe, les arbres beaux et vigoureux. La moindre clairière est un parterre de fleurs. Nous passons devant d’anciennes prises abandonnées. Dans un ravin absolument désert, nous rencontrons deux hommes suspects, mais nous sommes en nombre et n’avons par conséquent rien à redouter d’eux. Une rivière se présente et nous ne parvenons pas à trouver le gué. Le passage se fait au petit bonheur et est assez émouvant ; nous arrivons cependant sans encombre de l’autre côté.
Nous sommes devant une assez haute montagne qu’il faut franchir. Des ornières indiquent un chemin, mais ce chemin fait, paraît-il, un long détour. Un des yemchtchiks propose de couper à travers bois. Après un court conciliabule où nous n’avons naturellement pas voix au chapitre, l’escalade commence, Nous serpentons au milieu des arbres, dans une herbe très haute émaillée de fleurs, qui malheureusement couvre un terrain assez peu uni. Il faut toute la vigueur des excellentes bêles qui nous traînent pour sortir à notre honneur de cette aventure. Nous nous attendons à chaque minute à verser, à casser un trait, un essieu, une roue, que sais-je ? et ce n’est pas sans étonnement que nous arrivons intacts au sommet, Où nous retrouvons le chemin tracé, qui maintenant est excellent. Après quelques minutes d’un repos bien gagné, nous réparions à l’allure habituelle, c’est-à-dire au galop, et bientôt après nous sommes au pied de la montagne dans un village où l’on nous donne des chevaux frais.
La route de poste n’est plus qu’à 40 verstes, M. Kaplounof fils nous dit adieu et nous descendons rapidement la petite pente au haut de laquelle se trouve le hameau, Un de nos chevaux de côté cependant est récalcitrant, il cherche à se dérober. Notre yemchtchik n’est pas à la hauteur ; au lieu de le fouailler d’importance, il cherche à le maintenir avec la bride. L’animal tire de plus en plus de côté, le yemchtchik perd un peu la tête et notre tarantass finit par s’arrêter tout à coup, moitié sur une sorte de mur écroulé et moitié sur la route. Je me demande encore comment nous n’avons pas versé. On accourt, on nous aide à sortir de ce mauvais pas, et nous continuons notre route. Mais noire automédon ne nous inspire aucune confiance. Nous mettons quatre heures à faire les quarante verstes, et c’est avec un profond soupir de soulagement que Marie se retrouve sur la route de poste.
Notre arrivée à la station de Galkina est un événement. On était, paraît-il, fort inquiet à notre sujet. On avait été informé de notre départ de Nertchinsk ; nous aurions dû arriver ici hier au soir, nos chevaux étaient préparés, et tout à coup on apprit que nous avions disparu après la station de Kazanova. Il est tout particulièrement recommandé de nous donner de bons chevaux et un bon cocher, et depuis hier on garde à la station le yemchtchik qui a eu l’honneur de conduire le Tsarévitch. C’est un vieux Cosaque barbu, à la figure sérieuse, aux mouvements lents. Il monte sur son siège avec majesté et nous partons à une allure modérée.
Dans chaque maison de poste est un tableau indiquant la route et tous ses accidents. « De… à…, tant de verstes. À la Xme verste, une rivière que l’on passe en… Aux Xme, Xme, Xme verstes, une montagne où il est nécessaire de mettre le sabot. Terrain de telle et telle nature », etc.
Le tableau indiquait pour les 30 verstes que nous avons à faire quatre montagnes où il fallait mettre le sabot ; la première presque au départ. Arrivé au sommet, le yemchtchik descend tranquillement de son siège, entrave la roue et repart à un pas de tortue. Même manœuvre à la seconde. Ni l’une ni l’autre ne nécessitaient pareille précaution, et le regard de notre Cosaque indiquait une commisération dédaigneuse. À la troisième, il se prépare à remettre le sabot. Je lui crie : « Pas besoin de sabot ! » Il me regarde surpris et me montre la descente qui serpente pendant 2 verstes sur le flanc de la montagne. « Nitchévo, cela ne fait rien », lui dis-je. Son regard brille. Il remonte sur son siège et part bon train. De temps en temps il tourne la tête pour nous examiner, et à chaque fois, nous trouvant parfaitement calmes, il presse l’allure de ses chevaux. Nous remontons évidemment dans son estime, et lui dans la nôtre.
La dernière montagne est la plus élevée. Du sommet on à une vue splendide sur toutes celles qui nous environnent et qui sont couvertes de forêts, sur la plaine remplie de pâturages dans laquelle il nous faut descendre par une rampe de plus de 4 verstes, sinueuse et assez dénudée. Notre yemchtchik, après avoir accordé à ses chevaux un repos bien mérité de quelques minutes, remonte sur son siège, et la descente commence. C’est ce que nous avons vu de plus fantastique dans tout notre voyage, comme course folle sur une rampe bordée de précipices avec des coudes brusques franchis à bride abattue. Le yemchtchik sait que nous n’avons pas peur ; nous lui sommes particulièrement recommandés, il tient à montrer comment on conduit quatre chevaux en Sibérie.

À 1 verste de la station nous passons sur la route devant un hameau bouriate composé de quatre tentes.
Les Bouriates sont soumis aux Russes depuis 1644. On évalue leur nombre à 300 000. Grands éleveurs de bétail et surtout de chevaux, ils habitent la Transbaïkalie. Le gouvernement russe n’intervient pas dans leur administration, C’est le type pur de la race mongole : ils en parlent les divers idiomes.
Ils sont presque tous bouddhistes et leurs pratiques sont les mêmes que celles des Mongols de Chine. Ils ont des lamas, des processions, des fêtes musicales.

À la station je donne un bon pourboire à notre yemchtchik, et M. X… l’entend dire à celui qui doit lui succéder : « Ils n’ont pas peur, vas-y carrément ».
Nous avons en somme toujours été très vite dans notre voyage, et cela tient au pourboire. Il y a économie à se montrer généreux. Plus vous donnez au yemchtchik qui vous quitte, plus celui que vous prenez vous mènera rondement. Quelques personnes ne donnent que 5 ou 10 kopeks : c’est trop peu pour marcher rapidement. De 20 à 40 vous assurent la bonne volonté du prochain cocher.
Les yemchtchiks ne doivent en aucun cas vous demander de gratification, et ils ne le font jamais. Ils ne s’approchent même pas de vous d’un air significatif. Il y a, à ce sujet, des règlements très sévères qu’ils n’osent enfreindre. Il faut aller à eux ou les appeler pour leur remettre leur pourboire.
La route est toujours pittoresque, même quand on traverse les plaines et les pâturages, car les montagnes ne sont pas éloignées. Souvent, le matin et le soir, au fond des vallées, on a l’illusion de la mer. On aperçoit comme un grand navire, dont toutes les voiles seraient déployées. C’est l’église de quelque village : peinte en blanc, elle se découpe seule sur les teintes sombres de l’horizon.
Après Tourino Povorotnoï, nous côtoyons l’Ingoda, ayant à notre droite la montagne dans laquelle la route a été percée. Dans les endroits dangereux on a placé un parapet, protection insuffisante en cas de choc : il a surtout pour objet d’indiquer la route aux chevaux. De temps en temps une croix solitaire vient vous rappeler qu’il est nécessaire de ne pas trop s’endormir, car cette croix est toujours un signe qu’un assassinat a été commis à l’endroit où elle est élevée.

À Oust Gloubokaya, la dernière station avant Tchita, nous trouvons le maître de poste tout atterré. Il nous attendait depuis hier, et il y a deux heures un officier lui ayant affirmé que nous n’arriverions que demain, il lui a donné nos chevaux. Pour le moment il n’a plus que ceux nécessaires pour la poste, qui doit arriver dans une heure. Il ordonne, après quelques hésitations, de les préparer à mon intention. Son employé lui fait remarquer qu’il sera puni s’il n’a pas de chevaux pour le service des dépêches. Il lui répond qu’il ne le serait pas moins s’il n’en avait pas conservé pour moi, mais que je consentirai peut-être à intercéder en sa faveur auprès des autorités de Tchita. 10 minutes après, nous partions. Nous n’avions pas fait deux kilomètres que nous croisions les voitures de la poste. Il était temps !
Au bout de 2 ou 3 verstes d’une ascension difficile, nous suivons la crête d’une montagne élevée, d’où nous dominons toutes celles qui nous entourent. La route est splendide, percée au milieu de forêts superbes où les beaux arbres sont nombreux. C’est entre deux futaies de sapins séculaires que s’opère la descente par une route unie. Mais tout à coup, à deux ou trois reprises, on se trouve en présence d’une sorte d’escalier des plus dangereux qu’on ne peut franchir qu’au galop, car les chevaux ne pourraient retenir le tarantass. On frissonne, des cahots secs et brefs se succèdent pendant une minute ; on est passé. Il faudrait pourtant bien peu de travail pour supprimer ces passages où se jouent la vie des animaux et celle des voyageurs.
Le jour baisse. Au moment d’entrer dans la ville, notre cocher allache le battant des sonnettes pour les empêcher de tinter : les voitures qui portent la poste ont seules droit dans les villes à ce gai carillon, qui annonce aux habitants l’arrivée du courrier.
Nous n’avons pas à chercher un hôtel, une chambre nous ayant été gracieusement offerte. Il est 8 heures et demie quand nous arrivons. Un dîner est bien vite improvisé ; nous avons des conserves, c’est le cas de nous en servir. Puis, comme nous sommes un peu fatigués, nous étendons nos matelas par terre dans une chambre, à côté de la salle à manger, et nous nous couchons.
Hélas ! il faut bien l’avouer, jamais, même sous la tente chez les Mongols, nous n’avons passé plus mauvaise nuit. Jamais nous n’avons eu à nous défendre en si peu de temps contre une pareille nuée de plats ennemis. Nous avons beau dans l’obscurité faire des hécatombes faciles, des troupes fraîches remplacent immédiatement les bataillons anéantis. Nous devons céder devant le nombre, c’est-à-dire allumer une bougie pour attendre le jour, et nous cherchons un prétexte honnête pour éviter par la fuite, sans offenser nos hôtes, que cette nuit ait une seconde édition.

14 juillet. — Tchita, située au confluent de la rivière de ce nom avec l’Ingoda, est à 767 mètres au-dessus du niveau de la mer. Fondée en 1851 seulement, elle est la capitale de la Transbaïkalie. La température, très élevée en été, y est très basse en hiver. Les habitants se plaignent beaucoup de la sécheresse de la saison froide. Il ne neige presque jamais. Le traînage y est donc impossible et le climat fort énervant, quoique sain.
Le général Hahochkine, gouverneur général, ne comprend pas le français, me dit-on, mais le général Koubé, gouverneur civil, le parle aussi bien que le russe. C’est donc pour ce dernier que sera ma première visite, Il me reçoit de la façon la plus aimable, et m’offre immédiatement de m’accompagner chez Son Excellence le gouverneur général.
Le général Hahochkine s’informe gracieusement de la façon dont s’est effectuée la première partie de notre voyage, et me gronde doucement d’avoir abandonné la route de poste. Il me dit qu’il a déjà donné des ordres pour que je ne manque pas de chevaux jusqu’au Baïkal. « Je ne veux pas, ajoute-t-il, que vous puissiez conserver le plus léger mauvais souvenir de mon gouvernement de la Transbaïkalie, je vais vous trouver un officier parlant le français, qui vous escortera jusqu’au lac Baïkal ; je regrette de ne pouvoir l’envoyer plus loin, mais je vais télégraphier au gouverneur général d’Irkoutsk pour lui annoncer votre arrivée. »
Comment ne pas être sensible à tant de marques de bienveillance ? Je me confonds en remerciements et je prends congé du général, qui, peu de temps après, vient, accompagné de sa fille comme interprète, rendre visite à Marie. Il lui dit que, Mme Hahochkine étant malheureusement malade, il ne peut nous offrir l’hospitalité, mais que sa voiture est à notre disposition, et que nous n’avons qu’à formuler un désir pour qu’il s’empresse de le satisfaire.
Non certes, je ne dirai pas de mal de la Transbaïkalie, car c’est en Transbaïkalie que nous avons trouvé, outre le plus gracieux accueil et la bienveillance des autorités grandes et petites, les stations de poste les mieux tenues, les chevaux les plus vifs, les cochers les plus habiles, les routes les mieux entretenues et les paysages les plus beaux de notre longue pérégrination en tarantass.
À l’hôtel, qui est fort propre, et où l’on nous donne une chambre suffisamment meublée, le premier soin de Hane est de battre soigneusement toutes nos affaires.
À peine étions-nous installés qu’un officier vient nous annoncer qu’il est chargé de nous accompagner jusqu’au lac Baïkal et qu’il se tient à notre disposition. Nous sommes enchantés du choix fait par le gouverneur général, car notre aide de camp a l’air tout à fait charmant ; de plus je connais son père, M. Chichmareff, consul général de Russie à Ourga. Nous devons déjeuner demain chez le général Koubé, nous partirons immédiatement après notre retour de chez lui. M. Chichmareff nous promet que les chevaux seront attelés à 8 heures.
À l’hôtel se trouve un certain M. Arnold. Arrivé à Tchita comme architecte, il commençait à faire de brillantes affaires, quand à la suite d’un accident il dut subir l’amputation d’une jambe. Obligé de renoncer à son métier, il se fit avocat. Il me raconte qu’il doit plaider demain devant le conseil de guerre. Il est chargé de la défense de quatorze Cosaques qui ont — comment dirai-je ? — brutalisé une femme : c’est la déportation. Mais il espère qu’en insistant sur la moralité douteuse de la victime et en rejetant la responsabilité du crime sur les fumées de la vodka, il apitoiera les juges sur le sort de ses intéressants clients. Il se met à ma disposition, non comme avocat, mais comme interprète. Je le remercie, car pour le moment nous n’avons qu’à commander notre dîner et à nous faire rôtir un gros filet de bœuf pour emporter demain, et pour cela notre connaissance du russe est amplement suffisante.
Aujourd’hui la France entière est en fête, c’est le 14 juillet. Nous n’avons garde de l’oublier et nous buvons à la prospérité de la patrie.
Cependant nos yeux se ferment, mais nous n’osons nous étendre sur nos matelas : les assauts de la nuit dernière nous ont rendus craintifs. Hane jure ses grands dieux qu’il n’a rien vu de suspect dans la chambre, et que nous pouvons dormir sans inquiétude. Il nous quitte, et nous prenons notre courage à deux mains : je souffle la bougie.
15 juillet. — Rien n’est venu troubler notre sommeil.
(La suite à la prochaine livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[77],
XIX
De Tchita à Irkoutsk.
l
est 3 heures,
le yemchtchik
monte sur le siège,
fouette ses
bêtes et… nous
ne bougeons pas.
Le cheval de
droite refuse d’avancer
et rue sur
place, tandis que
les autres tirent.
On nous crie de
descendre, qu’il
va nous arriver
un malheur, qu’il
faut envoyer
chercher une autre
troïka. Alors
le yemchtchik,
qui sent son
honneur engagé,
dételle le cheval
du milieu et met
le récalcitrant à sa place. On lui dit que le cheval qui
doit trotter va prendre le galop, que celui qui doit
galoper va prendre le trot : il répond l’éternel
nitchévo, « cela ne fait rien », et au milieu des exclamations, des cris des assistants, il tape à tour de bras
sur ses bêtes, qui finissent par partir ventre à terre. Au
bout de la rue nous tournons à angle droit, puis nous
traversons le pont sur la Tchita, sans accroc, Dieu sait
comment ! Enfin nous passons les dernières maisons,
nous avons l’espace devant nous : nitchévo !
La route commence immédiatement à monter ; elle domine la ville, qui paraît maintenant à son avantage.
La Tchita et l’Ingoda, dont le confluent est sous nos yeux, et que nous voyons disparaître dans le sud-est, sont les derniers cours d’eau, non seulement du bassin de l’Amour, mais du versant de l’océan Pacifique.
À 8 heures, nous sommes à 1 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, au sommet de la chaîne des monts Yablonovoï ou des Pommiers, et nous entrons dans le bassin de l’océan Glacial arctique : nous n’en sortirons que de l’autre côté des monts Ourals.
M. Chichmareff n’a pas de tarantass à lui. Dans toutes les maisons de poste il y a des voitures à capotes fixes, d’aspect misérable, construites sur le modèle réduit du tarantass, que le smotritiel, maître de la station, est tenu de mettre à la disposition des voyageurs. On ne paye que pour les chevaux. Le périclodnoï, tel est le nom de ce véhicule peu agréable, a un grand inconvénient : il faut en changer à chaque station. C’est au moyen des périclodnoïs que se fait le service des dépêches. M. Chichmareff a pris avec lui Hane, qui peut donc se reposer et dormir ; nous, nous faisons l’économie du prix d’un cheval. Que l’on soit seul ou deux dans une voiture, il faut payer pour deux chevaux, mais pour deux chevaux seulement, quel que soit le nombre de ceux qui vous traînent. Jamais nous n’en avons eu moins de trois, mais nous en avons eu jusqu’à cinq. C’est au smotritiel à juger de ce qui est nécessaire d’après l’état des routes et la vigueur de ses bêtes. Si l’on est trois, on paye pour trois chevaux.
Quand les chevaux de poste arrivent à la station, ils retournent aussitôt à vide à leur point de départ : s’il a un périclodnoï, le yemchtchik s’y couche et s’endort, sinon il dort à cheval. Les animaux, qui connaissent fort bien la route, s’en vont au petit pas et mettent six où huit heures à refaire la distance qu’ils viennent de franchir en deux. Arrivés à l’écurie, on leur donne à manger. Mais on ne peut obliger le smotritiel à les atteler que trois heures au moins après leur retour. Sur un registre spécial que chacun peut consulter sont indiqués, avec la plus scrupuleuse exactitude, le nombre de chevaux dont dispose la station, et les heures de départ et de rentrée de chacun d’eux.
Scellé à la cire rouge, sur une able, dans un coin de la salle commune, est le cahier de réclamations, qu’un inspecteur vient de temps en temps examiner. Sur un registre à double souche on inscrit : un numéro d’ordre, le nom et la profession du voyageur, l’heure de $on départ, le nombre des chevaux qu’on lui donne, le prix payé, et le nom du yemchtchik qui le conduit. Ce dernier, de même que le voyageur, reçoit de ce document une copie détachée de la souche, qu’il doit remettre au smotritiel de la station suivante. C’est pour le fisc un moyen de contrôle, et pour la police celui de surveiller les voyageurs et les cochers.
M. Chichmareff s’est chargé de tous les détails. Habitués déjà au mouvement de la voiture, nous nous endormons d’un sommeil profond, et nous passons plusieurs stations sans nous en apercevoir. Réveillé à un moment, je n’entends aucun bruit et je regarde dehors. Il n’y a pas de lune, mais la nuit est claire. Nous sommes arrêtés au sommet d’une montagne, au milieu des bois. Le cocher fait reposer ses chevaux. Mes yeux se faisant peu à peu à l’obscurité, je distingue devant nous comme une large caverne qui s’enfonce dans les profondeurs de la terre : c’est la route, bordée d’arbres élevés, dont les cimes semblent se rejoindre ; la pente paraît effroyable. Le yemchtchik remonte sur son siège, et nous nous enfonçons au galop dans le trou béant. Marie dort inconsciente ; ce que j’ai de mieux à faire, c’est de limiter. J’avoue qu’il me fut impossible de reprendre mon sommeil interrompu, jusqu’au moment où une allure moins échevelée m’apprit que cette longue descente avait pris fin.
Vingt-quatre heures après notre départ de Tchita, nous avions fait près de 300 verstes. Nous ne nous sommes arrêtés que trois fois, pour le thé. Marie, pour qui c’est un régal, a pris, pendant que nous changions de chevaux, quelques tasses d’un lait qu’elle a déclaré délicieux. C’est du reste le seul genre de provision qu’il soit possible de trouver sur la route. Nous avons maintenant des yemchtchiks bouriates. Quelques-uns se montrent aussi habiles cochers que les Cosaques. Ils sont plus démonstratifs, crient, gesticulent et se servent davantage du fouet.
Le pays est très beau, très accidenté. Nous traversons de superbes forêts de pins, les plus belles de tout notre voyage. Dans beaucoup d’endroits le feu en a détruit d’énormes surfaces, ne laissant que des troncs noirs aux formes fantastiques, qui émergent au milieu des fleurs.
Les fleurs ! Comment donner une idée de leur profusion qui ne cesse de nous émerveiller ? J’ai parlé des lis, des pivoines, des muguets sur l’Amour. En Transbaïkalie ce sont de nouvelles espèces. Ici les prairies semblent disparaître sous la neige : les pâquerettes, la reine-des-prés causent cette illusion ; là des spirées aux couleurs éclatantes, hautes de plus d’un mètre ; plus loin, de véritables champs d’aconit.
Vers 5 heures du soir, après un galop échevelé, nous nous arrêtons pour laisser souffler les chevaux. Passant derrière la voilure, je m’aperçois que le boulon en fer qui, à l’arrière, fixe la pièce de bois dans laquelle passe la cheville ouvrière, est à moitié cassé. L’accident s’est probablement produit lorsque nous avons versé. Si le boulon se casse tout à fait, les roues de devant partiront avec les chevaux, laissant le train de derrière sur la route. Nous consolidons la chose de notre mieux avec des cordes. On changera le boulon à Verkné-Oudinsk, où nous devons nous arrêter quelques heures chez Mme Goldobine, veuve d’un des plus grands marchands de Sibérie, à qui le gouverneur de Tchita a télégraphié pour annoncer notre arrivée.
Nous marchons bien jusqu’au matin. Mais la pluie s’étant mise à tomber, nos roues enfoncent dans le sol détrempé et nous n’avançons plus qu’avec peine. Pour comble de malheur, à la dernière station nous tombons sur de mauvais chevaux, un mauvais yemchtchik bouriate, et cela avec 34 verstes à faire par de mauvais chemins ; cette étape nous prend cinq heures.
Il est 3 heures quand nous arrivons chez Mme Goldobine. On nous conduit dans la chambre qui a abrité le Tsarévitch. Après un bout de toilette, nous passons dans la salle à manger, où une zakouska a été servie pour attendre le dîner. Mme Goldobine est aux eaux pour sa santé, à plusieurs centaines de verstes d’ici. Elle a télégraphié à son représentant de nous recevoir selon les règles de l’hospitalité sibérienne.
Sur une immense table, dans la salle à manger, nous voyons, disposé sur deux rangs, tout ce qu’il est possible de servir comme hors-d’œuvre : caviar frais et salé, harengs et sardines de plusieurs espèces, saucissons, viandes froides, cèpes au sel, etc., et enfin un poisson délicieux, l’omoule, charnu et gras, qui ne se trouve que dans le Tac Baïkal et les rivières qui communiquent avec lui. Derrière toutes ces victuailles appétissantes est une rangée de treize bouteilles, toutes pleines et toutes débouchées, afin de bien indiquer qu’elles ne sont pas là pour la montre. Les étiquettes portent les noms les plus estimés des gourmets. Les vins, venant de France et d’Espagne, sont de première qualité. Ils sont si chers en Sibérie qu’il serait ridicule de payer de gros prix pour des produits inférieurs.
M. Galoutsine, chef de la police, est présent au dîner. Il avait reçu l’ordre de renvoyer M. Chichmareff à Tchita s’il pouvait le remplacer auprès de nous par un autre officier parlant le français. Il y en a bien un, mais c’est un Russe des provinces baltiques, un Russe allemand, nous dit-on, et, par une extrême délicatesse, on décide que M. Chichmareff nous accompagnera jusqu’au Baïkal. Nous aurons été désolés qu’il en fût autrement.

Verkné-Oudinsk, fondé en 1668, doit sa prospérité aux mines d’or découvertes dans ses environs, et à sa situation au confluent de la rivière Ouda avec la Sélenga, qui se jette dans le lac Baïkal. Toute cette partie de la Transbaïkalie est très peuplée, surtout au sud. C’est ici, de l’autre côté de la Sélenga, que vient s’embrancher la grande route qui, passant par Kiakhta, traverse le grand désert de Gobi, la Mongolie et conduit à Pékin. L’établissement du commerce par caravane, entre la Russie et la Chine, par cette route, remonte à l’année 1698 : Kiakhta ne fut fondé qu’en 1728. Verkné-Oudinsk est à 600 mètres d’altitude.
C’est dans les mines d’or que M. Goldobine a fait son énorme fortune. Il s’est occupé également d’industrie. Il avait établi dans les environs une verrerie, dont les produits furent immédiatement très demandés, et qui ne tarda pas à être une source de gros bénéfices, malgré la modicité des prix, les objets en verre étant fort rares et chers dans la contrée, par suite de la difficulté des transports. On nous montre des verres à boire à dix kopeks, des carafes, des vases qui suffisent amplement aux habitants de ce pays.
Ici, comme à Nertchinsk, chez Mme Boutine, nous trouvons des journaux français, entre autres l’Illustration. La censure russe en a noirci, à l’encre d’imprimerie, des paragraphes entiers.
On a remplacé le boulon cassé du tarantass et redressé le marchepied faussé : total, huit roubles ! Il est midi et nous parlons. À la sortie de la ville, on passe sur la rive gauche de la Sélenga, dans un bac formé de deux bateaux attelés côte à côte. La route traverse d’abord une plaine cultivée sans grand intérêt, puis elle devient plus pittoresque ; à gauche est la montagne dont nous suivons le pied, et à droite, la Sélenga, que nous perdrons bien rarement de vue pendant une centaine de verstes. Vers 2 heures, nous arrivons à la jolie station de Polovinnaya.
Trois ou quatre maisons au plus avec leurs dépendances, écuries, étables, composent tout le hameau. Elles sont adossées à la montagne, qui est ici presque à pic et couverte d’arbres jusqu’au sommet ; devant sont des taillis épais. La route passe entre la montagne et les taillis, puis, faisant un coude brusque, vient regagner les bords de la Sélenga. Pendant qu’on change les chevaux, je ne puis résister au désir de prendre une vue de ce joli endroit, et je choisis le moment où notre tarantass descend au galop la pente légère qui conduit hors du hameau. Deux vaches paissent tranquillement sur le chemin, sous la surveillance d’un chien que nos mouvements paraissent étonner.

La route n’est pas bonne. Souvent taillée dans le roc, trop étroite pour livrer passage à deux voitures, elle domine de dix ou quinze mètres le fleuve qui coule avec rapidité au pied de la falaise sur laquelle nous passons au galop, protégés contre une chute dont il vaut mieux ne pas entrevoir la possibilité, par un simple parapet en bois. Chevaux et yemchtchik sont excellents, nous volons plutôt que nous ne courons, et quand nous arrivons à la station, une roue du périclodnoï de M. Chichmareff est en feu. On l’arrose copieusement. Cet accident n’est d’aucune importance pour nous, puisque M. Chichmareff change de voiture à chaque étape. Un généreux pourboire donné au précédent yemchtchik a stimulé son successeur, qui marche d’un train désordonné. Parus de Polovinnaya à 2 heures 15, nous arrivons à Tara-Kanovskaya à 5 heures 50, après nous être arrêtés 15 minutes à moitié chemin pour changer de chevaux. Nous avons fait 51 verstes, c’est-à-dire 54 672 mètres, en 3 heures 20 minutes. Soit une moyenne de 16 kilomètres et demi par heure.
À Kabanskaya, on nous apporte des fraises. On nous dit encore une fois que ce sont les premières de l’année : elles sont à peine mûres.
Comme le bateau le Platon, qui doit nous emporter de l’autre côté du Baïkal, ne quittera qu’après-demain Moïssovaya, dont nous ne sommes plus qu’à 78 verstes, rien ne nous presse, et nous décidons de passer la nuit à Kabanskaya. Au moment du dîner, Hane exhibe une foule de provisions que nos aimables hôtes de Verkné-Oudinsk lui avaient remises à notre insu.
La route devient très accidentée ; ce ne sont que montées et descentes, courtes, mais escarpées. Au bas d’une rampe fort raide, terminée par un pont, le périclodnoï de M. Chichmareff, lancé à fond de train, rase de trop près le parapet, long d’une centaine de mètres, qui borde la route. Le cheval de gauche, affolé, franchit ce parapet d’un bond et continue dans le fossé sa course folle. Comment le yemchtchik parvint-il à arrêter ses bêtes, sans verser, sans accrocher, sans rien casser ? C’est ce que ni M. Chichmareff ni Hane n’ont jamais pu comprendre.
À 6 verstes de Boïarskaya, nous nous arrêtons à quelques mètres du lac Baïkal. Nous éprouvons la même impression qu’au bord du lac Michigan. C’est une véritable mer. De petites vagues viennent l’une après l’autre couvrir les galets du rivage. À l’ouest, les côtes se dessinent vaguement ; au nord, on ne voit que de l’eau et toujours de l’eau. Des pêcheurs sont à 100 mètres de nous, ils tirent un filet.
Est-ce dû à l’altitude à laquelle il se trouve (534 m.) ou à l’absence de senteurs salines, ou simplement à la sensation étrange de me voir dans ces pays éloignés, j’éprouve sur les bords du lac Baïkal une impression bizarre, différente de celle que me produit la mer, et que je ne puis définir. Nous cueillons sur la rive de magnifiques myosotis : ne m’oubliez pas ! Comment oublierions-nous ce lac majestueux ?
Au moment où nous passons devant la prison de Boïarskaya, un convoi de galériens en sort ; il va dans la même direction que nous. Ce sont, paraît-il, des forçats qui ont fini leur temps en Sibérie orientale et qui seront internés à Irkoutsk ou à Krasnoyarsk.
Boïarskaya était autrefois le port d’embarquement et de débarquement. Maintenant les bateaux à vapeur s’arrêtent à 30 verstes d’ici, à Moïssovaya, qui a une rade plus profonde ; nous y arrivons à 2 heures. Cette dernière étape est la plus belle depuis Polovinnaya.
En somme, dans la Transbaïkalie, nous avons, depuis Stretinsk, fait 1037 verstes, changé 41 fois de chevaux sans éprouver une seule minute de retard. Nous n’avons eu qu’à nous louer de la politesse et de l’empressement des smotritiels, de l’habileté des yemchtchiks et de la rapidité des chevaux. Il s’est trouvé un cocher ivre, mais c’était en dehors de la route de poste.
Le Baïkal est le plus grand lac d’eau douce de la Sibérie. Il a 660 kilomètres de longueur sur une largeur qui varie de 40 à 100 kilomètres. Sa plus grande profondeur est de 1 200 mètres, mais les Sibériens prétendent qu’on n’a jamais pu en trouver le fond. Il ne possède qu’une île importante, l’île Olehone, qui a 54 verstes de longueur. On y pêche des poissons qui, tels que l’omoule, lui sont particuliers. Il y a également des phoques. Un certain nombre de rivières lui apportent le tribut de leurs eaux ; quelques-unes ont un assez gros volume. La plus importante est la Sélenga, qui prend sa source au nord de la Mongolie, à plus de 1 200 kilomètres de son embouchure.
Des vapeurs transportent les voyageurs, trois fois par semaine, de Moïssovaya à Listvinitchnaya, sur la côte ouest. C’est une distance de 75 verstes, que l’on met par beau temps 6 heures à franchir ; mais sur le Baïkal s’élèvent quelquefois des tempêtes terribles. L’hiver on passe en traîneau sur la glace. Comme les mêmes chevaux ne pourraient faire un aussi long trajet, on installe une station à moitié chemin. Au moment où le lac commence à geler, ainsi qu’au moment où la glace devient trop faible pour supporter le poids des voitures, il arrive souvent des accidents. L’établissement de la navigation à vapeur sur le lac Baïkal remonte à l’année 1844.
Il n’est pas indispensable de traverser le lac Baïkal pour aller à Irkoutsk. On peut en contourner l’extrémité sud. La route existe, mais elle-est peu fréquentée et par conséquent peu sûre. Dans les stations, les chevaux sont à paître dans la montagne, il faut aller les prendre : il y a donc perte de temps. Un jour, sur la Zéa, Poutiatitski, assis à table à côté de roi, me vantait les beautés de cette route : « Vous la connaissez donc ? lui dis-je. — Si je la connais, mais c’est moi qui l’ai faite ! J’y ai travaillé pendant mes premières années de bagne. » On a beau savoir que le pays est rempli de déportés, on n’en éprouve pas moins une impression bizarre, en entendant son voisin de table parler à brûle-pourpoint du temps où il était forçat. J’appris que Poutiatitski avait pris part à l’insurrection de la Pologne : il avait alors dix-sept ans, et qu’il appartenait à une famille fort riche. Il fut envoyé en Sibérie, les fers aux pieds, et resta au bagne pendant onze années.
20 juillet. — Le Platon, retardé par une tempête, n’arrive que le soir à 7 heures. À peine est-il possible de sauter à terre que tous les passagers se précipitent vers la maison de poste ; le premier arrivé partira le premier et aura partout les premiers chevaux. La même chose se passera lorsque nous serons de l’autre côté du lac. Mais je ne ferai pas la course. Car, ou le gouverneur d’Irkoutsk, sur les recommandations du comte Cassini qui lui a écrit, et du général Hahochkine qui lui a télégraphié, m’aura fait préparer des chevaux, comme l’assure M. Chichmareff, et alors inutile de me presser, ou il n’aura rien fait préparer du tout, et je m’exprime trop mal en russe pour pouvoir lutter avec les Russes.
Nous disons adieu à cet excellent Chichmareff, qui depuis Tchita ne nous a pas quittés d’une semelle, sanglé dans son uniforme, sabre au côté et revolver à la ceinture, et nous montons à bord.
Le Baïkal, large et profond comme une mer, en a toutes les allures. Le vent est tombé, mais il reste de la houle, et le Platon est un peu secoué. Heureusement il y a à bord un assez bon cuisinier et nous faisons un dîner passable. Parmi les passagers se trouve une jeune fille en costume de bicycliste. Elle parle très bien français. Elle est avec son père, riche marchand de Tomsk, propriétaire de mines d’or, qu’il vient de visiter, en Transbaïkalie.
Il n’y a pas ici de cabines, mais le salon des dames est très convenable. Chacun s’étend comme il lui plaît sur les banquettes. Hane va dormir dans le tarantass.
21 juillet. — Il est cinq heures quand nous abordons enfin à Listvinitchnaya. La population est tout en émoi. Le feu s’est déclaré pendant la nuit dans une maison située au centre même du village : en un clin d’œil ce n’a été qu’un immense brasier. Le calme de l’air a empêché le sinistre de s’étendre ; le moindre souffle aurait suffi pour ne laisser ici que des ruines.
Il n’est arrivé aucun ordre pour nous. Le service des dépêches a pris tous les chevaux de poste ; les autres voyageurs sont partis avec des chevaux appartenant à des particuliers : nous aurons à faire de même, mais rien ne nous presse encore : nous ne sommes qu’à 61 verstes d’Irkoutsk. Allons à la station et tâchons d’y trouver quelque chose à nous mettre sous la dent. Le smotritiel me dit d’abord que je n’aurai pas de chevaux avant 9 heures du soir. Je lui montre ma liste blanche du gouverneur de Tchita, il me dit avec mépris qu’elle n’a aucune valeur dans le gouvernement d’Irkoutsk, que je n’ai qu’à attendre jusqu’à ce soir, et il me tourne le dos.
Un jeune garçon est à côté de nous : il ne demanderait pas mieux que de gagner une petite pièce blanche. Je le prie de me trouver des œufs et du lait pour Marie, avec du pain blanc ou noir. Il revient au bout d’une demi-heure, me rapportant mon argent. À Listvinitchnaya, point de départ des bateaux, village qui a une verste de longueur, on ne trouve à acheter ni un œuf, ni un pain, ni une tasse de lait. Nous demandons le samovar et trempons ce qui nous reste de biscuits dans de nombreuses tasses de thé. Puis nous allons faire nos ablutions dans le lac. L’eau est à 11° centigrades. J’ignore si M. Pasteur y découvrirait des microbes, mais rien ne peut donner une idée de sa limpidité, et c’est avec délices que, penchés au-dessus de l’immense cuvette, nous procédons en plein air à notre toilette du matin.
L’idée me vient de demander au bureau du télégraphe s’il n’y a rien pour moi. L’employé, auquel je montre la liste blanche, est surpris du peu d’empressement du maître de poste. Il va lui représenter que des gens porteurs de pareils papiers ne sont certainement pas des voyageurs ordinaires, et au bout de quelques instants le smotritiel vient annoncer que dans un quart d’heure nous partirons.
Listvinitchnaya est un long village, composé d’une seule rangée de maisons adossées à la montagne et séparées du lac par la route. Au bout d’une verste au plus, les maisons cessent ; on se trouve à l’entrée de l’Angara, large d’un millier de mètres, l’unique déversoir du Baïkal, dans lequel les eaux se précipitent avec furie, pour aller, après un parcours de 1528 kilomètres, grossir celles du Iénisséi. Les Sibériens prétendent que l’Angara est le prolongement de la Sélenga.

Nous partons enfin, et à 200 mètres du village nous trouvons la route barrée dans toute sa longueur par une énorme poutre placée à trois pieds de terre, et auprès de laquelle se tiennent deux soldats. Nous sommes devant la douane. On va réveiller le directeur qui dormait et à qui je montre passeport, liste blanche, enfin tout ce que je possède en fait de papiers. Il me demande si ma femme a des robes, je réponds que oui ; si elles sont neuves, je réponds que non ; si nous avons du thé, combien nous en avons. Il demande à le voir, le flaire, le déclare exquis, s’encquiert si nous n’en possédons pas davantage, pousse un soupir à ma réponse négative, et donne l’ordre de nous laisser passer. La poutre, munie d’un contrepoids à une extrémité, se soulève et nous partons au galop.
La route s’écarte peu des bords de l’Angara, traversant d’abord des forêts assez belles, puis de vastes plaines fort bien cultivées dans lesquelles une moisson qui s’annonce comme devant être très riche indique l’extrême fertilité du sol.
Ici, parmi les fleurs sauvages, ce sont les roses qui dominent. On en voit partout d’énormes buissons. Les prairies sont couvertes de reines-des-prés. À mesure que l’on approche de la ville, la route est mieux entretenue. Des tas de cailloux attestent que l’on pense à combler les ornières. Enfin, nous apercevons les clochers qui dominent les maisons d’Irkoutsk, et à 5 heures nous descendons de voiture dans la cour de l’hôtel Déko. Est-ce une gracieuseté des autorités ? à toutes les stations les chevaux étaient tout harnachés : nous n’avons donc éprouvé de ce fait aucun retard.
XX
Irkoutsk.
Fondée en 1652 sur la rive droite de l’Angara, la ville d’Irkoutsk tire son nom de la rivière Irkoute, devant l’embouchure de laquelle elle a été construite. Son altitude est de 500 mètres, soit 34 mètres de moins que le Baïkal, ce qui explique l’extrême rapidité de l’Angara. Le centre de la ville est un terrain plat d’une étendue de 8 verstes carrées, entouré de collines couvertes de bois de bouleaux, dans lesquelles les riches commerçants se sont taillé de jolies villas.
La Grande-Rue, dans laquelle se trouve notre hôtel, va du nord au sud et a 2 verstes de longueur. Elle aboutit à l’Angara, et est terminée par un majestueux tout monument en briques rouges, le musée, inauguré récemment. À quelques pas plus loin, sur le quai, est le palais du gouverneur.
Irkoutsk a été en partie détruit, le 7 juillet 1879, par un incendie qui, dit M. Cotteau, « dévora 3 600 maisons, 19 églises, 5 bazars, la douane et un grand marché, les deux tiers de la ville et tous ses plus beaux quartiers, causant en 24 heures une perte de 30 millions de roubles ». Malgré ce terrible exemple, la ville est encore, à l’heure actuelle, exposée à un sinistre analogue, car presque toutes Les maisons ont été reconstruites en bois de sapin. Elles offrent au feu un aliment tout aussi puissant que par le passé. Les puits creusés sur les sept grandes places, en vue d’un sinistre, seraient d’un secours bien insuffisant. N’a-t-on pas cependant sous la main, à 61 verstes seulement, cet énorme volume d’eau qui domine la ville de 34 mètres, et dont on ne songe pas à se servir ? Pour l’alimentation, les habitants d’Irkoutsk n’ont que l’eau de l’Angara, que l’on va puiser dans des tonneaux, et que des industriels colportent de maison en maison.
La crainte des incendies hante cependant les autorités à un tel point qu’en ce pays de fumeurs il est interdit de fumer dans les rues.
Irkoutsk est de fait la capitale de la Sibérie orientale. C’est le grand centre du commerce ; ses importations s’élèvent à la somme de 12 millions de roubles, sans compter le thé qui, venant de Chine à travers le désert de Gobi, se centralise ici pour être dirigé sur les différents marchés de l’empire. C’est la résidence d’un archevêque. Outre deux cathédrales, dont l’une n’est pas encore terminée, il y a une trentaine d’églises orthodoxes. On y trouve également une église catholique, un temple protestant et une synagogue juive, un couvent de femmes situé dans un des faubourgs, de l’autre côté de la rivière Ouchakovka qui se jette dans l’Angara, et un monastère. Dans le faubourg, dit des Artisans, est la prison centrale de la Sibérie orientale, qui renferme plus de mille prisonniers ordinaires, et qui contient en outre de nombreux forçats, qu’elle dirige sur Les pénitenciers de l’Est. La fondation de la première école à Irkoutsk remonte à l’année 1718 : le Collège national à lui-même plus de cent ans d’existence : il fut ouvert en 1789, quatre années après l’établissement d’une imprimerie officielle.

La chambre que nous occupons à l’hôtel est très élevée d’étage. Une cloison en planches, de 2 mètres de haut, forme une sorte de cabine où se trouvent un divan + une table surmontée d’une cuvette en cuivre : ce sera notre chambre à coucher. On mettra le matelas de Marie sur le divan, et le mien par terre.
On nous avait beaucoup vanté les hôtels d’Irkoutsk et surtout l’hôtel Déko. Nous ne nous y trouvons pas mieux qu’à Stretinsk, à Nertchinsk, à Tchita, mais notre chambre est plus spacieuse. Nous avons deux fenêtres sur la rue ; j’ai toutes les peines du monde à les faire ouvrir pour changer l’air. La cuisine est assez bonne. Bien que la chasse ne soit pas encore ouverte, on nous sert de jeunes coqs de bruyère fort délicats. Le poisson de l’Angara est également très fin.
Ma première visite fut pour le gouverneur général, le général Gorémékime. Il était en conférence avec le gouverneur de Iakoutsk et je ne pus le voir ; mais il me fit remettre dans la journée une nouvelle liste blanche. Muni de ce document avec lequel j’étais désormais certain de ne pas manquer de chevaux aux prochaines cinquante-quatre stations, c’est-à-dire jusqu’à notre entrée dans le gouvernement de Tomsk, je me sentis le cœur plus léger, et j’eus plus de plaisir à me promener dans la ville. Un photographe français, M. Bogdanovitch, voulut bien nous servir de guide. C’est à lui que je dois une bonne partie des renseignements obtenus sur le pays et sur l’exploitation des mines d’or.

Sur la place de la cathédrale, la plus importante d’Irkoutsk, se dresse l’église catholique, élégante construction en briques rouges dont l’unique clocher élancé fait contraste avec les sanctuaires orthodoxes aux multiples clochetons semi-sphériques. Le curé est un vieux Polonais de quatre-vingt-dix ans. Il compte bien que nous viendrons à la grand messe dimanche, c’est-à-dire après-demain, mais, apprenant que nous serons partis, il nous promet de l’avancer d’un jour en notre honneur.

À quelques mètres seulement se trouve une église, que l’on me dit être la plus ancienne de la Sibérie. Elle est peinte en blanc, avec de curieuses fresques extérieures. Les intempéries ne semblent pas avoir par trop abîmé les peintures. Ces fresques extérieures ne sont pas rares en Sibérie. Nous en verrons encore dans plusieurs grandes villes.
Mme Grorémékine, chez qui nous allons dans l’après-midi, est une grande dame un peu perdue dans ces pays lointains. Elle nous reçoit d’une façon polie, aimable même. Elle a l’air de qu’au point de vue social Irkoutsk est une ville de peu de ressources, et est surprise d’apprendre qu’à Pékin, où nous ne sommes cependant qu’une poignée d’Européens, la vie est non seulement très supportable, mais gaie et animée. À Irkoutsk il y a 35 000 âmes et l’on s’ennuie.
On traversait autrefois l’Angara en bac, mais, pour le passage du Tsarévitch, on se décida à construire un pont. Il est en bois, a 636 mètres de long et a coûté fort cher. Or le Tsarévitch, étant part d’Irkoutsk en bateau à vapeur, n’est jamais passé dessus. Nous le franchissons, et, suivant la route qui contourne le lac Baïkal, nous escaladons la montagne qui domine la ville. La vue est superbe : à gauche et à droite de la chaussée qui descend, des taillis de bouleau ; au fond de la vallée, la ville, autour de laquelle serpente l’Angara, avec ses nombreuses églises, presque toutes blanches, qui se découpent sur le fond plus noir des collines situées au nord. Des rayons de soleil percent de temps à autre les nuages et vont se projeter sur les toits des monuments.

Nous trouvons à l’hôtel la carte du gouverneur.
23 juillet. — Le marché me paraît bien approvisionné. On y vend non seulement de la viande, du poisson, du gibier, des légumes, mais aussi du pain.
Nous allons à l’église. Le sacristain nous attendait à la porte : il nous conduit à nos places et va prévenir M. le curé. La paroisse n’est pas riche et les objets du culte sont plus que modestes. La cloche qui doit appeler les fidèles au saint lieu est fendue ; la fabrique est trop pauvre pour la remplacer, et une église catholique ne peut guère compter sur l’appui du gouvernement. Les fidèles sont presque tous des Polonais exilés, anciens forçats internés à Irkoutsk. Des livres de messe sont sur les bancs, ils sont tous écrits en langue polonaise.
Dans l’après-midi nous allons visiter la fonderie d’or, et nous assistons à toutes les opérations successives : ouverture des petits sacs qui contiennent les précieuses pépites, constatation du poids, mise au creuset, fonte, coulage des lingots. Dans une chambre aux murailles épaisses, dont la porte cerclée de fer est garnie de traverses multiples, on nous montre une rangée de lingots préparés en vue d’un départ prochain : il y en a pour des millions.
La Sibérie orientale, d’après les statistiques officielles, produit chaque année environ 1 300 pouds d’or, soit, en mettant le poud, qui est de 16 380 grammes, à 14 104 roubles, 25 387 200 roubles, un peu plus de cent millions de francs. Tout cet or, transformé en lingots à Irkoutsk, est expédié à Saint-Pétersbourg. Il y a quatre transports par an, deux en hiver par traîneaux et deux en été par voitures : chaque voiture, attelée de quatre chevaux, porte trente pouds au maximum. Le trajet se fait en trente ou quarante jours. Chaque convoi est escorté par plusieurs Cosaques ; mais ce qui le protège le mieux, c’est la sévérité avec laquelle toute attaque est réprimée.
L’assassinat d’un voyageur est peu de chose, et les brigands le savent bien : c’est la déportation, et voilà tout. La peine de mort n’existe pas pour ce genre de délit, elle est réservée pour les crimes politiques et pour l’attaque des convois d’or ou de la voiture qui porte la poste. Autant on met de mollesse dans la recherche des assassins dans le premier cas, autant on déploie d’activité dans le second, même quand il ne s’agit que d’un commencement d’exécution.
XXI
D’Irkoutsk à Krasnoïarsk.
24 juillet. — Il est 6 heures : le tarantass est chargé. Nous avons renouvelé notre provision de graisse pour les roues, de roubles pour les smotritiels, de kopeks pour les yemchtchiks. Nous emportons du pain pour dix jours, et un filet de bœuf rôti.
Nous partons de l’hôtel Déko par une pluie battante. Le pays est peu intéressant. À 6 verstes de la ville nous traversons un village long de 2 000 mètres, dans lequel se trouve le grand monastère de l’Ascension. Il est entièrement peint en rose extérieurement : je le trouve de forme plus svelte et moins lourd que la cathédrale d’Irkoutsk.
Jusqu’à quelques verstes de Krasnoïarsk, c’est-à-dire pendant plus de 1 000 kilomètres, nous allons nous maintenir à une hauteur variant entre 1 200 et 1 800 pieds. Les villages sont plus importants qu’en Transbaïkalie. À l’entrée et à la sortie de chacun d’eux est un poteau qui indique le nombre d’hommes, de femmes, de chevaux, de bestiaux qu’il possède, et dans plusieurs nous avons remarqué que les femmes étaient en extrême minorité. Ce qui n’empêche pas qu’on en voie beaucoup se livrer à des travaux d’hommes. À Toulounovskaya, on construit une grande maison en briques : ce sont des femmes qui portent le mortier et les matériaux. Nous en avons vu également qui fauchaient les récoltes. Maintenant à presque toutes les stations on nous offre des myrtilles, dont les baies noires sont de la grosseur et de la forme d’un petit grain de raisin. Dans les environs des grands centres, nous rencontrons des voitures qui en sont chargées ; cette baie n’a pas grand goût, mais elle est fraîche, et je m’en régale.
À une cinquantaine de verstes d’Irkoutsk nous commençons à voir dans les plaines un petit rat à longue queue touffue au bout : c’est une sorte de gerboise. Il est gris cendré, avec une double raie noire qui suit la colonne vertébrale dans toute sa longueur. À certains endroits c’est par centaines qu’on le rencontre. Rien n’est gracieux comme ce petit animal, une vieille connaissance pour nous, car la terre des herbes en Mongolie en fourmille : nous en avons même conservé un apprivoisé à Pékin, pendant quelques semaines : il est mort d’indigestion. Au moindre bruit, ces petites bêtes se dressent sur leurs palles de derrière, et conservent une telle immobilité qu’on les prend d’abord pour des bâtons fichés en terre, puis, effrayés, ils disparaissent dans un trou. Nous voyons également des moutons : ils sont blancs avec la tête noire, leur queue est allongée comme en France. En Chine la queue des moutons est très courte, mais elle est entourée d’un volumineux paquet de graisse, et pèse parfois jusqu’à sept ou huit livres.
Les cochons, dont nous rencontrons de nombreux spécimens dans les rues, méritent une mention particulière. Petits, trapus, avec des oreilles de loups, quelques uns ont une robe gris-perle, d’autres café au lait, semée de larges taches noires.
Chaque village est entouré d’une barrière : aux deux extrémités est une porte qu’un vieillard ou un homme estropié est chargé d’ouvrir. Il est d’usage de donner un ou deux kopeks à ce vieillard.
Autour de presque tous les hameaux nous voyons des champs cultivés : du seigle surtout et du blé noir. Ce dernier est en fleur, mais au lieu de présenter aux yeux comme en France l’aspect d’une belle nappe blanche, il est d’un rose tendre du plus bel effet.
L’allure est ici moins rapide qu’en Transbaïkalie : les chevaux sont moins sauvages. Plusieurs de nos yemchtchiks sont des gens contrefaits, malingres, incapables de faire autre chose que de conduire. On se demande quel service ils pourraient rendre en cas d’accident ?
Une fois, je me rappelle que nous eûmes pour cocher un enfant ne paraissant pas avoir plus de dix à douze ans. On prétendit qu’il en avait dix-sept : c’était un mensonge évident. Les 23 verstes qui composaient l’étape se terminaient par une très longue descente sur laquelle il fut impossible au gamin de retenir ses chevaux emballés. La station se trouvait sur le versant opposé, à l’autre bout du village, que nous traversâmes comme la foudre, heureusement sans écraser personne et sans rien accrocher. À la montée les chevaux s’arrêtèrent d’eux-mêmes.
Détrempée par la pluie qui n’a pas cessé de tomber depuis notre départ d’Irkoutsk, la route est mauvaise. À la onzième étape nous sommes dans un terrain marécageux, la boue est profonde, notre tarantass enfonce jusqu’au moyeu. Les 5 chevaux qui le traînent ont toutes les peines du monde à avancer. Ils s’arrêtent tous les 10 mètres, et l’élan qu’ils prennent à chaque départ me fait craindre que quelque chose ne casse. C’est ici surtout que nous nous sommes félicités d’avoir un tarantass de premier ordre. Ce mauvais pas n’a qu’une verste au plus, nous mettons cependant plus d’une heure à le franchir. Plus loin nous passerons encore de nombreux terrains marécageux. On a eu recours pour les franchir à un dallage en bois que je ne recommande ni pour les voyageurs, ni pour les voitures. Des troncs d’arbres ont été placés bout à bout sur toute la longueur de la route, puis on a simplement rangé sur eux, côte à côte, d’autres troncs de sapins, sans même se donner la peine de les équarrir. Quand on passe à fond de train sur les routes ainsi faites, je me demande comment voitures et voyageurs ne se désagrègent pas complètement. Nous sommes très mollement installés dans notre tarantass, cependant le passage de ces chaussées, qui ont parfois des kilomètres de longueur, nous paraît un supplice oublié par Dante dans son enfer.
Je dois dire qu’on est en train de remplacer ce pavage primitif par une belle chaussée en macadam, bordée de fossés comme nos grandes routes. Nous avons rencontré de nombreuses équipes de forçats affectées à ce travail, et d’ici peu, j’espère, les routes en troncs d’arbres non équarris ne se trouveront plus que dans les récits des voyageurs.

Nous croisons et nous dépassons tous les jours de nombreuses caravanes. Quelques-unes se composent d’une cinquantaine de voitures. Ce sont les messageries. En l’absence de voie ferrée et de communication par eau, elles ont une grande importance. Les voitures sont des plus rudimentaires. Chacune est attelée d’un seul cheval qui doit fournir plusieurs milliers de kilomètres, et par conséquent ne peut faire plus d’une quarantaine de verstes par jour. Toutes les caravanes sont escortées par une douzaine de conducteurs armés. Mais les conducteurs dorment la plupart du temps sur les voitures, et pour empêcher les chevaux de s’arrêter ou de s’écarter pendant leur sommeil, ils ont imaginé de mettre une mangeoire avec un peu de foin ou d’herbe derrière chaque véhicule.
Quand arrive la nuit, ils s’arrêtent au bord de quelques cours d’eau dans une clairière, réunissant toutes les voitures en un cercle au milieu duquel ils placent les chevaux, sous la garde d’un ou deux chiens.
Chaque caravane emporte des roues et des essieux de rechange. Un jour nous voyons à une centaine de mètres de nous une voiture perdre le cercle en fer d’une de ses roues, sans que le conducteur s’en aperçoive. Notre yemchtchik s’arrête, Le ramasse et repart au galop. J’eus toutes les peines du monde à l’obliger à rendre le cercle à son propriétaire, qui se confondit en remerciements. « Si le cercle était à vous, me disait le yemchtchik, et si cet individu l’avait trouvé, il ne vous le rendrait pas. Pourquoi en user autrement avec lui ? »
Tous les jours nous croisons de longs convois d’émigrants. Chacun se compose de plusieurs centaines d’individus. Les charrettes qui les transportent, attelées de deux chevaux, sont recouvertes d’une tente en nattes, sous laquelle on aperçoit des femmes et des enfants vêtus souvent de haillons. La charrette contient tout ce qu’ils possèdent au monde, c’est-à-dire bien peu de chose. Ce sont de malheureux paysans chassés de leur village par la disette, qui s’en vont coloniser dans les provinces de l’Amour.

Ils n’ont eu qu’à se pourvoir d’un attelage et à justifier de la possession de quelques roubles. Le gouvernement se charge de remplacer les chevaux qui succombent pendant le voyage. On alloue à chaque famille une certaine quantité de pain par jour. Quand ils arriveront au terme de leur voyage, on leur donnera un terrain sur lequel ils se construiront une maison avec les arbres d’alentour, et eux qui ont travaillé à la terre toute leur vie deviendront, plus que probablement, des paresseux comme les Cosaques que nous avons vus sur l’Amour, vivant des produits faciles du fleuve, jusqu’au jour où les habitants, trop nombreux pour ce pays encore si riche, seront obligés de lutter pour l’existence. Le prince Grégoire Galitzin, chargé par l’Empereur des détails de l’émigration, m’a dit qu’au mois de juin 65 000 paysans avaient été dirigés, par ses soins, sur les provinces de l’Amour.
Tous les deux villages, c’est-à-dire à peu près toutes les 50 verstes, se trouve une grande prison, facilement reconnaissable aux barreaux en fer des fenêtres et aux guérites bariolées de blanc et de noir qui se trouvent aux quatre angles. Ces prisons sont très propres, tout aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ressemblent comme distribution aux dortoirs que j’ai vus à Saghaline. On y renferme les convois de forçats pour la nuit et pour le repos du milieu du jour. Quand elles sont habitées, le drapeau flotte au-dessus de la porte, et devant chaque guérite est une sentinelle.

À Houdoslanskaya nous nous arrêtons pour changer de chevaux, juste devant la prison. Cinq musiciens ambulants, quatre cuivres et une clarinette, s’arrêtent à quelques pas de nous et jouent plusieurs airs connus. Immédiatement derrière les barreaux des fenêtres apparaissent quelques figures de forçats. Dans la cour de la prison, les Cosaques de l’escorte se pressent à la balustrade extérieure. Juste à ce moment arrive une caravane d’émigrants. Je me demande si ces musiciens font fortune à voyager ainsi dans la Sibérie et à donner des aubades aux Cosaques.
Le soir nous traversons Nijné-Oudinsk, petite ville de 3 000 habitants, sur la rivière Ouda, que l’on passe en bac, et nous renouvelons notre provision de pain blanc. Nous sommes à 484 verstes d’Irkoutsk.
27 juillet. — Le jour commence à poindre, il fait un brouillard intense, on ne voit pas à deux pas devant soi ; nous comptons sur nos clochettes pour avertir les gens de notre arrivée, et nous partons au galop.
Quelques stations plus loin, un de nos chevaux est absolument sauvage, il faut deux hommes pour le maintenir ; on le lâche, il rue dans toutes les directions ; le yemchtchik le roue de coups et parvient à le dompter. Il m’avoue, en arrivant à l’étape, que ce cheval était attelé pour la première fois.
Au moment où je descends de voiture, j’aperçois un prêtre lama dans de superbes habits jaunes. Il est accompagné de trois domestiques, dont un Russe. J’entends le smotritiel lui dire qu’il n’y aura de chevaux que dans sept ou huit heures, qu’il vient de donner les derniers à un monsieur et une dame qui sont en train de monter en voiture. Je lui en demande à mon tour, il me répond que je n’en aurai que demain matin. C’est le moment de montrer ma liste blanche : à peine l’a-t-il lue qu’il se précipite dans la cour. Le yemchtchik allait sauter sur son siège et partir avec le tarantass dans lequel les deux voyageurs étaient déjà installés. Il lui donne l’ordre de dételer les chevaux et de les atteler à ma voiture. Quelques instants après, nous quittions la station sans que les malheureux voyageurs, ainsi dépouillés, eussent proféré une seule parole. La chose leur paraissait toute naturelle, bien que fort désagréable.
Les moustiques et les taons, peu gênants sur la route quand on galope, sont insupportables pour ceux dont les chevaux marchent au pas, et surtout pour les gens qui vont dans Les bois chercher des champignons et des myrtilles. On fabrique une sorte de sac en toile qui couvre toute la tête, et vient se nouer au cou sur le collet de la blouse. Devant la figure est pratiquée une ouverture carrée munie d’un morceau de gaze. Ce masque peu dispendieux est à la portée de toutes les bourses : villageois, émigrants et même forçats en sont également ornés.
Le 19 juillet, à 2 heures, nous arrivons à Kansk, petite ville de la même importance que Nijné-Oudinsk, après avoir couru un très sérieux danger. La ville est dans une vallée : on y arrive par une descente assez raide de plus d’une verste, et la route raboteuse est bordée de larges fossés peu profonds. Au plus fort de la pente nous étions au galop, mais le cocher n’avait pas encore rendu la main aux chevaux, lorsque celui de gauche s’abattit. La pauvre bête fut traînée pendant plus de 50 mètres. Notre tarantass s’arrêta enfin : une roue de derrière et une de devant étaient dans le fossé avec le cheval tombé, les deux autres sur le talus avec les chevaux restés debout. Comment n’avons-nous pas roulé jusqu’au bas de la montagne ? Comment n’avons-nous pas versé ? Comment le yemchtchik est-il parvenu à arrêter en si peu de temps notre lourd véhicule, en l’absence de frein, et lorsque les chevaux étaient lancés au galop sur cette pente rapide ? Nous nous le demandons encore. L’animal lui-même en est quitte pour quelques écorchures. Kansk contient quelques jolies maisons et des magasins qui ont fort bon air. En dehors de la ville nous longeons une grande construction isolée. On nous dit que c’est un hôpital.
Les yemchtchiks de la poste portent à leur chapeau et au bras gauche une large plaque, emblème de leurs fonctions. Quand un de leurs collègues vient en sens inverse, ils daignent se déranger, mais juste assez pour que, lancés à fond de train, les deux tarantass ne s’accrochent pas. Tout attelage qui n’a pas l’honneur d’appartenir à la poste doit leur céder le pas. Ils ont les règlements pour eux et s’en réclament avec insolence. Un jour, descendant une côte par un chemin de traverse, nous rencontrâmes un convoi d’émigrants, et cette insolence faillit avoir des conséquences graves, notre yemchtchik voulant obliger deux cents à trois cents voitures à passer dans le fossé, lorsque la route était bien assez large pour tous. Il dut céder devant une levée de manches de fouet, Un autre règlement interdit de dépasser sur la route les voitures qui portent les dépêches, à moins qu’elles ne soient arrêtées par suite d’un accident. Or à sept stations de Krasnoïarsk, dans un village où nous nous étions arrêtés pour la nuit, au moment où nous prenions tranquillement le thé, l’agent des postes arriva et prit la tête avec deux périclodnoïs, suivant la même direction que nous. Pendant cinq étapes il nous fut impossible de le dépasser. Mais, sachant que nous avions une liste blanche, il prévenait en arrivant les smotritiels et nous trouvions des chevaux tout prêts.
Vers 9 heures, nous arrivons à Onyarskaya, grand village construit autrefois sur deux coteaux entre lesquels coule une rivière que traversait un superbe pont en bois. Il y a quinze jours, le feu s’est déclaré dans la dernière maison à l’est ; poussé par le vent, il détruisit la majeure partie des habitations. Le pont lui servit de trait d’union entre les deux collines maintenant couvertes de débris noirs. Nous traversons la rivière sur un pont rudimentaire construit à la hâte.
Cependant entre deux stations il est arrivé un accident à l’une des voitures de la poste, nous sommes dans notre droit, et nous passons.
Nous arrivons enfin à l’extrémité ouest de la partie montagneuse de la route. Devant nous est un panorama splendide, nous nous arrêtons pour l’admirer. À nos pieds commence la plaine ; le chemin qui va nous y conduire est effrayant de pente. Au nord on dirait la steppe ; c’est à peine si quelques collines nous cachent l’horizon. Le Iénisséi serpente majestueux au milieu des terres dénudées, couvertes autrefois de superbes forêts. Krasnoïarsk est devant nous à 40 kilomètres. La descente commence à l’allure habituelle : nos chevaux ont le pied sûr, le yemchtchik est habile ; elle se termine bien. Il est midi, nous n’avons plus que 30 verstes à faire, nous demandons le samovar.
Pendant que nous déjeunions, arrive l’agent des postes. Il a été si aimable que je lui offre de prendre une tasse de thé : il accepte. Il accepte également un morceau de pain. Je lui sers une tranche de viande : il la trouve délicieuse, et me demande ce que c’est. Je lui dis que c’est du jambon. Notre homme devient sérieux, repousse son assiette, balbutie un compliment et disparaît. C’était un Israélite !
C’était bien la peine de nous donner tant de mal pour tirer de notre vocabulaire restreint les explications dont nous étions si fiers, et apprendre à un juif avec lequel nous voulions nous montrer aimables que nous lui faisions manger du cochon !
Deux heures après, nous arrivons au bord du Iénisséi, qui se divise ici en deux bras, dont le second a 900 mètres de large. Krasnoïarsk est devant nous, de l’autre côté du fleuve, que nous traversons en bac.

La façon dont ces bacs sont manœuvrés est très ingénieuse. Le bac lui-même est composé de deux chalands accouplés et surmontés d’une plate-forme. À l’avant est fixée une chaîne, longue de près d’un kilomètre, dont l’autre extrémité est munie d’une ancre mouillée à une égale distance des deux rives et qui est maintenue au-dessus de l’eau par un nombre variable d’embarcations. Ici il y en a quinze. Le bac, détaché de l’embarcadère, est entraîné, la chaîne se tend lorsqu’on est au milieu du fleuve, le courant, agissant sur le gouvernail, fait décrire à l’appareil un are de cercle et l’on arrive mathématiquement au débarcadère.
Dans la cour de la station de poste se trouve un hôtel : nous nous y installons faute de mieux.
Krasnoïarsk date de 1626 et compte 18 000 habitants ; son altitude est de 152 mètres. En partie détruite par le feu en 1881, beaucoup de ses édifices ont été reconstruits en pierre. Les rues sont larges. Sa cathédrale, assez élégante, élevée par les soins et aux frais d’un riche colon, est l’œuvre d’un architecte français.
31 juillet. — On me dit que nous avons ici un compatriote, M. Regamey, professeur au gymnase. Je m’empresse d’aller le voir, malgré l’heure matinale. Je le trouve en train de faire des paquets : il vient d’être nommé à Vilna et doit partir mardi avec sa femme, Il nous propose de les attendre, et nous offre l’hospitalité. Sa maison est très propre, très bien tenue, j’accepte.
M. Regamey est Suisse de naissance, sa femme est Russe ; elle ne parle pas le français, mais elle le comprend. Avec notre léger bagage de russe, la conversation peut encore se soutenir. Ils ont deux domestiques, qui sont, comme partout en Sibérie, deux condamnés à la déportation : l’un pour vingt ans, le cocher, valet de chambre, qui répond au nom de Cidor, compromis dans une affaire de viol ; l’autre à perpétuité, la cuisinière, pour infanticide. Ce qui me surprend, ce n’est pas qu’elle ait tué son enfant, mais c’est qu’elle ait eu l’occasion de commettre un semblable crime : elle est laide à faire peur. Il paraît que Mme Regamey n’a jamais eu de servante plus dévouée, plus attentive et soignant mieux les enfants. Nous en avons tellement vu de ces déportés que cela ne nous semble plus étrange. On en trouve même, paraît-il, beaucoup dans la société qui ne font nullement mystère des causes qui les ont amenés dans le pays. On dirait qu’ils s’imaginent qu’ayant passé les monts Oural, ils ont payé leur dette à la société. N’est-ce pas plutôt qu’ils savent que la plus grande partie de ceux qui les entourent sont dans la même situation qu’eux ? Krasnoïarsk possède un avocat qui ne cache pas qu’il est ici pour avoir fait un faux testament, et qui ajoute que son châtiment mérité prouve que la justice est bien faite en Russie.
Je vais chez le gouverneur, le général Teliakovski. Il me reçoit très bien, me donne une nouvelle liste blanche et un ordre de réquisition pour les chevaux des paysans : il me promet de télégraphier au gouverneur de Tomsk, et me présente à sa femme et à ses filles, à qui nous allons, dans l’après-midi, rendre visite avec Marie. Là encore, comme à Habarovka, chez le général Arsenieff, nous aurions pu nous croire à Paris. Tout le monde parle le français le plus pur. Nos visites nous sont rendues presque immédiatement et nous sommes invités à dîner pour le lendemain.
Nous avons vile fait le tour de la ville, puis nous allons au jardin public où se réunit le soir le beau monde, et où nous prenons d’excellente bière fabriquée ici. On dit qu’il serait dangereux de se promener la nuit après 10 heures dans ce jardin public, qui n’est qu’un taillis percé d’allées, car il est rempli de gens sans aveu. Pourquoi ne pas faire des raffles ? On trouverait des gens fort intéressants pour la police, des évadés du bagne, et l’on préserverait peut-être ainsi la vie de nombreux voyageurs. Nous avons remarqué sur la route que plus on approche des grandes villes, plus les croix se multiplient. Elles sont parliculièrement nombreuses dans les environs de Krasnoïarsk. Mais, encore une fois, qu’importent les brigands et les quelques imfortunés qu’ils peuvent assassiner ? Les déportés politiques, voilà ceux qu’il faut surveiller.
Les nihilistes sont nombreux, paraît-il, dans le pays, et l’an dernier, lors du passage du Tsarévitch, on dut prendre ici encore plus de précautions que dans les autres gouvernements. Au jardin public, nous rencontrons beaucoup d’élèves de M. Regamey. Ils lui font tous le salut militaire. Trois fois par an, les élèves, sac au dos, comme les soldats, font dans la campagne une promenade d’une dizaine de verstes. Ils sont précédés de la musique militaire et les professeurs les accompagnent sur le côté, comme des officiers.
Je remarque que les gens qui, pour nous saluer, soulèvent leurs chapeaux, au lieu de le prendre, comme nous, par le bord au-dessus du front, le saisissent à pleine main par derrière au-dessus de la nuque. Est-ce parce que j’y suis habitué, je trouve notre méthode plus élégante.
Cependant les nouvelles sont mauvaises, des télégrammes annoncent que le choléra sévit en Europe ; qu’il est particulièrement violent de ce côté-ci de l’Oural et que plusieurs cas ont été observés à Tomsk. Pendant le dîner, Mme Teliakovski nous dit qu’elle devait partir pour Saint-Pétersbourg avec ses filles, mais qu’il n’y faut plus songer, que nous allons nous trouver en pleine épidémie et qu’elle se demande si nous pourrons passer. Nous répondons que nous nous sommes trouvés en Chine, en Corée, au Japon, au milieu d’épidémies terribles de choléra ; que, sans le rechercher, nous n’en sommes pas plus effrayés qu’il ne faut ; et puis, du reste, que faire ? Retourner à Changhaï prendre la malle française, attendre ici six mois peut-être la fin du fléau ou le braver ; il n’y a pas d’autre alternative.
Le lendemain à 1 heure, notre tarantass passe sous les fenêtres du palais du gouverneur, qui, prévenu de notre passage, est sur son balcon, entouré de sa famille, pour nous souhaiter une dernière fois un bon voyage. Que de dettes de reconnaissance nous avons contractées en Sibérie !
Les adieux ont été touchants entre Hane et la servante infanticide, et j’ai surpris un baiser furtif, donné par elle, naturellement, puisque le baiser est inconnu des Chinois, lorsqu’elle apportait le dernier paquet à mettre dans la voiture. C’est un volcan que cette femme : gare la récidive !
(La fin à la prochaine livraison.)
DE PÉKIN À PARIS[86],
XXII
De Krasnoïarsk à Tomsk.
et Mme Regamey nous suivent. Leur
tarantass est plus petit que
le nôtre. Ils ont mis dedans
une énorme malle, sur
laquelle ils sont juchés,
dans une position qui
manque de sécurité.
Heureusement la route
est bonne, les côtes
moins nombreuses
et moins
raides. Les
villages sont
plus rapprochés
et plus
importants. Le
premier que nous
traversons se compose
d’une unique rue, qui a 7 verstes de longueur.
La province du Iénisséi est très fertile ; le gouverneur nous dit que dans le district de Minousinsk, à 200 verstes au sud, le seigle coûte 5 kopeks le poud, et qu’on vend pour le moment la récolte de 1889. Faute de pouvoir écouler les produits, une faible partie du territoire seulement est mise en culture. S’il y aval des moyens de communication, ce pays serait le grenier de la Sibérie. Tandis qu’ici on ne trouve pas à vendre les grains, il y a disette et famine à 1 000 verstes à l’ouest et les paysans affamés sont obligés d’émigrer.
En contemplant les merveilleuses récoltes qui se préparent çà et là, Hane est surpris de voir si peu de terrain mis en culture, et ne peut s’empêcher d’en exprimer son étonnement : il explique la chose par la paresse manifeste des habitants.
J’ai eu souvent l’occasion de voir l’ingénieux appareil que les Sibériennes ont imaginé pour bercer les enfants sans interrompre un travail de couture. Qu’on se figure un cadre en bois muni d’une toile : c’est le berceau. Il est suspendu par quatre cordes à une longue perche flexible ; au-dessous pend un anneau au moyen duquel on imprime avec le pied un mouvement de haut en bas. Quelquefois cet anneau n’existe pas, et l’on se contente de faire balancer le berceau. Hane m’affirme que cette méthode est également chinoise et très usitée dans les campagnes.

Dans toutes les maisons de poste, généralement dans un des angles faisant face à la porte d’entrée, est une grande icône encadrée, devant laquelle une veilleuse brûle perpétuellement ; puis, vers le milieu d’un panneau, la photographie du tsarévitch.
À quelques verstes au delà d’Atchinsk, nous remarquons deux colonnes en briques rouges. Elles indiquent la limite du gouvernement du Iénissé. Nous quittons la Sibérie orientale pour entrer dans le gouvernement de Tomsk et la Sibérie occidentale.
Jusqu’ici, à part de rares exceptions, nous avons trouvé les routes de poste bonnes ou assez bonnes. Maintenant elles deviennent abominables. Rien ne peut donner une idée des fondrières au milieu desquelles il faut passer par moments : je me demande comment notre tarantass y résiste. Or il faut remarquer que nous sommes favorisés par le temps, et que s’il pleuvait, les routes seraient encore plus mauvaises. Certains villages sont des nids de boue et d’ordures ; on marche dans le fumier jusqu’à la porte des stations de poste, qui sont sales et mal tenues. Il y a ici une incurie évidente. Le Sibérien est paresseux et apathique, mais il a au plus haut point le sentiment du respect et de l’obéissance. S’il est bien dirigé, on obtient de lui ce que l’on veut. C’est malheureusement le laisser-aller qui domine dans le gouvernement de Tomsk, et, nous sommes heureux d’ajouter : dans le gouvernement de Tomsk seul !
À toutes les stations M. Regamey demande des nouvelles du choléra, et plus nous avançons, plus ces nouvelles sont mauvaises. On nous parle d’abord d’un, puis de deux, puis de quatre décès par jour à Tomsk. Enfin un voyageur allant à Irkoutsk nous affirme que sur le Kosakovski il est mort cinq personnes, que sur la barge qu’il avait à la traîne il est mort quarante-six forçats, que la navigation est interrompue par ordre supérieur, et que nous ne pourrons quitter Tomsk. Il nous conseille fortement de retourner à Krasnoïarsk. Notre ami, qui s’impressionne facilement, le ferait pour bien peu. Je lui conseille de ne plus rien demander à personne.
Ma liste blanche n’a plus ici aucune valeur. À une station, ne trouvant pas de chevaux, nous nous adressons à un paysan qui veut bien nous conduire pour le même prix que la poste et qui, arrivé à l’étape suivante, nous propose, de lui-même, de nous trouver des chevaux de particuliers, dans les mêmes conditions. Nous avons fait ainsi huit des dix-neuf étapes du gouvernement de Tomsk, sans aucun ennui, et sans autre accident que la chute, sans conséquence, d’un des chevaux du tarantass de M. Regamey. Par contre, entre deux stations, dans des chemins impossibles, nous dépassons six voitures de la poste arrêtées ; l’une d’elles à une roue cassée. C’est merveille que pareil accident n’arrive pas à tous les véhicules.
À Haldieva, petit village pittoresque, on arrive par une descente très dangereuse dallée du haut en bas avec des troncs d’arbres non équarris. Le yemchtchik n’ose la descendre sans mettre le sabot, dont nous nous servons pour la dernière fois.
6 août. — Il est 10 heures ; nous arrivons à Cemilijnaya. C’est la dernière station avant Tomsk, dont nous ne sommes plus qu’à 31 verstes. Encore trois heures, et nous serons au bout de nos peines. Il n’y a pas de chevaux à la poste, mais les chevaux volnés (c’est-à-dire appartenant à des particuliers) sont là. On nous demande un rouble de plus que le prix ordinaire : va pour le rouble, et nous partons au galop de quatre bêtes fougueuses. À moitié chemin est une descente. Je fais arrêter le tarantass, je prends mon appareil et je cours installer Hane, à qui je donne mes instructions ; puis, remontant en voiture, ordre est donné au yemchtchik de se lancer à fond de train sur la pente rapide. Hane presse la poire : quel sera le résultat ? Notre gravure le fait connaître.

Bientôt les dômes des églises de Tomsk apparaissent au loin, éclairés par un brillant soleil. La partie du voyage qui nous effrayait le plus sera terminée dans moins d’une heure, et nous ne pouvons que nous féliciter de la façon dont elle s’est effectuée.
On nous avait beaucoup parlé de l’ivrognerie en Sibérie : nous avons eu rarement à en souffrir. Un cocher ivre nous a versés en Transbaïkalie, mais ce n’était pas un cocher de la poste. Une fois, à je ne me rappelle plus quelle station du gouvernement de Tomsk, nous avons trouvé absolument tout le personnel dans l’impossibilité de parler ou même de se mouvoir : smotritiel, yemchtchiks, garçons d’écurie, femmes des uns et des autres. Tout le village semblait du reste à l’unisson. Nous désespérions de pouvoir partir, quand par bonheur vint à passer un paysan en assez bon état, qui consentit à nous conduire. C’était un jour de fête, de Praznik.
En dépit des croix qui émaillent le paysage, jamais nous n’avons eu d’alerte sérieuse.
On nous avait prévenus que ce serait autour du lac Baïkal et dans les environs des villes qu’il serait Le plus nécessaire de ne dormir que d’un œil. Il est certain que c’est entre Irkoutsk et Tomsk que nous avons rencontré le plus de gens à mine suspecte, forçats évadés, nous disait-on, mais qui ne sont dangereux que quand ils sont en nombre. Pour rendre les embuscades moins faciles, de chaque côté de la chaussée, qui est déjà large par elle-même, la forêt a été abattue, presque partout, sur une largeur de 15 à 20 mètres, ce qui permet de surveiller la route, et de se préparer à la bataille en cas d’attaque. J’ai remarqué que la nuit on rencontrait bien rarement un attelage voyageant seul. Le jour, c’est différent.
Nous savions qu’il ne faut pas compter pour la nourriture sur ce qu’on peut se procurer dans les villages, et nous avions des provisions. Le samovar, c’est tout ce qu’on doit s’attendre à trouver dans les maisons de poste. Toutefois, outre le thé, dont on fait une incroyable consommation, les habitants boivent une sorte de bière fabriquée avec le pain de seigle et parfumée aux fruits, qu’ils nomment kvass. C’est une bière de ménage, à laquelle on s’habitue très bien. On en trouve assez souvent dans les maisons de poste.

Une seule fois dans tout Le voyage, on nous à proposé du bouillon de mouton. Nous avons accepté avec empressement et nous nous sommes mis à able. On apporta une soupière fumante. Elle était pleine d’un liquide absolument blanc sur lequel nageaient des morceaux de graisse de mouton, sans la moindre parcelle de chair. On dit que les Cosaques mangent de la chandelle : ce n’était pas de la chandelle, mais peu s’en fallait. Ce que c’est que la famine ! nous avons bu ce bouillon.
À une heure nous entrons dans la cour de l’hôtel de l’Europe, à Tomsk, où nous trouvons, dans une bonne chambre, deux sofas sur lesquels nous placerons nos matelas. Nous voyons sur une pancarte qu’on peut, pour une trentaine de kopeks, obtenir un drap et une taie d’oreiller. Qui se serait attendu à pareil luxe dans un pays où les routes sont en si mauvais état ?
En somme, de Stretinsk à Tomsk, en comptant le petit détour pour aller visiter les mines d’or, nous avons franchi dans notre tarantass 2 813 verstes, soit 3 015 kilomètres, changé 115 fois de yemchtchik, et employé 410 chevaux environ.
À une altitude de 92 mètres, Tomsk a été fondé en 1604, sur le flanc de la colline qui domine la rive droite de la rivière Tom. Les rues y sont moins larges que dans les villes plus nouvelles de la Sibérie, mais les maisons y ont un aspect plus européen. On y voit moins de constructions simplement en bois.
Notre premier soin est d’envoyer un garçon de l’hôtel à la poste chercher nos lettres ; il revient bientôt, nous disant qu’il n’y en a pas. L’absence de nouvelles, quelque pénible qu’elle soit, est un mécompte auquel il faut s’attendre en voyage, sans s’inquiéter outre mesure.
À deux pas du télégraphe, où, par parenthèse, je ne puis me faire comprendre qu’en allemand ou en russe, est l’établissement de bains. Nous y allons, suivis de Hane, auquel une opération de ce genre ne fera pas moins de bien qu’à nous. Les bains russes ont été trop souvent décrits pour que j’entre ici dans des détails. Qu’il me suffise de dire que l’établissement dans lequel nous entrons est propre et bien tenu. Il y a plusieurs chambres séparées, munies d’une seule baignoire, mais dans laquelle on ne peut, comme chez nous, renouveler l’eau à volonté. J’ai quelque peine à faire admettre qu’une seule chambre est insuffisante pour nous trois.
La malle que nous avions attachée derrière le tarantass n’a pas été volée, mais elle a besoin de réparations aux charnières. Nous sommes heureux de la retrouver, elle suffit amplement à notre garde-robe bien modeste maintenant, Un des grands ennuis en voyage, c’est le blanchissage ; mais nous avons trouvé le moyen de nous en passer. Nous conservons soigneusement notre vieux linge, qui peut toujours servir encore une fois, et nous le semons sur la route. Toutefois, avant d’imiter ainsi le Petit Poucet, Marie a le soin de le démarquer. A-t-elle peur qu’on le lui rapporte ? Plus nous allons et moins nous avons de bagages.
Il existe à Tomsk une société de secours aux émigrants. Nous nous empressons de faire un paquet pour cette société, de toutes les choses qui nous sont désormais inutiles, habits chauds, chapeaux, théière et assiettes en fer émaillé, etc. Ce n’est pas un grand cadeau, mais cela peut encore faire plaisir à ces malheureux.
De retour à l’hôtel, nous trouvons M. Regamey qui nous remet une lettre de mon père, qu’il a trouvée lui-même à la poste en cherchant les siennes. L’adresse de celle-ci, qui porte une douzaine de cachets, est ainsi conçue :
Cette lettre est allée à Pékin et en est revenue avec la traduction de « Poste restante » en russe. Il en a été de même de toutes celles envoyées par ma famille en Sibérie : toutes sont allées à Pékin, je les ai reçues à Paris trois mois après mon arrivée. Les connaissances en français des agents en Sibérie ne vont pas jusqu’à « Poste restante ».
Il n’est question ici que du choléra. Les nouvelles qui nous arrivent de Tobolsk et de Tiumen sont navrantes : la mortalité y est effrayante. Il y a bien eu plusieurs décès parmi les forçats amenés par le Kosakovski, sur lequel nous nous embarquerons dans deux jours, mais pas quarante-six, comme on nous l’avait dit. Il y a bien eu quatre décès à Tomsk hier, mais deux d’entre eux sont au moins dus à des imprudences. Un Cosaque ayant mangé six harengs salés est mort au bout de quelques heures. Un marchand de concombres ne pouvant se consoler de la mévente de sa marchandise et ne voulant pas la remporter l’avait dévorée. Il avait succombé après l’ingestion de la vingt et unième de ces cucurbitacées. En somme, il est certain que le choléra existe et que les autorités font tout ce qu’elles peuvent pour en cacher les ravages.
Tomsk est rempli de monuments ; le plus laid est certainement la cathédrale. Nous avons pris pour nous conduire un cocher qui, voyant la difficulté que nous avions à nous exprimer en russe, s’avise de nous parler allemand. Nous sommes sauvés ! Je le prie de nous montrer les points les plus curieux de la ville. Il nous conduit immédiatement dans le quartier juif, nous disant avec complaisance que les juifs sont les gens les plus industrieux, les plus travailleurs, bref les seules gens de valeur de Tomsk, et m’avoue modestement qu’il est israélite, ce dont je me doutais. Une erreur judiciaire le condamne à vivre désormais dans ce pays où les criminels fourmillent : je m’en doutais également. Tomsk possède une église catholique, petite, mais très bien située, d’où l’on a une très belle vue. À côté est la tour au sommet de laquelle deux veilleurs tournent sans cesse, prêts à sonner le tocsin, en cas d’incendie.
À l’hôtel, je trouve un Allemand, juif évidemment, qui m’offre 100 roubles de mon tarantass. Je refuse de le vendre pour une somme si minime, préférant le laisser à l’agent de M. Cheveleff, qui en trouvera peut-être un prix supérieur après mon départ.
Le surveillant de l’hôtel est un homme de très bonnes manières, parlant français et se montrant fort empressé. J’ai appris dans la suite que c’est un ancien officier de cavalerie, qu’une gestion fantaisiste des fonds de son régiment à conduit à Tomsk. Mais les gens victimes d’accidents de cette sorte sont si nombreux en Sibérie, que nous y faisons à peine attention.
8 août. — La ville de Tomsk est traversée dans sa largeur par un torrent, dont le lit est presque à sec pour le moment, sorte de déversoir où viennent se réunir les eaux de la ville pendant les averses, pour aller se jeter ensuite dans la rivière Tom. La rue principale le coupe dans un des nombreux zigzags qu’il décrit, et en longe la rive gauche, formant un magnifique quai circulaire bordé de belles maisons. Sur la rive droite est le marché : on nomme ainsi une construction carrée, longue de 200 à 300 mètres, composée d’une galerie couverte au fond de laquelle sont de nombreux magasins, étroits mais très profonds. À l’angle nord s’élève, dans un jardinet entouré d’une balustrade, une chapelle très renommée. Il paraît qu’aujourd’hui il y aura dans cette chapelle une importante cérémonie, dont la terreur qu’inspire le choléra est la cause. On croit généralement que l’apparition du fléau est due à la sécheresse, et pour le faire cesser on vient prier le ciel d’ouvrir ses cataractes. Le ban et l’arrière-ban du clergé de Tomsk et des environs va se réunir et faire une grande procession en habits sacerdotaux, portant les objets du culte, jusqu’à la petite chapelle où seront faites des prières publiques. Toute la population, si religieuse dans l’empire russe, est invitée à se joindre au clergé. Vers dix heures, la procession passe devant les fenêtres de l’hôtel, et je réussis à en prendre une photographie. C’est un imposant spectacle : riches et pauvres, tête nue, accompagnent les dignitaires ecclésiastiques dans leur resplendissant costume.

À midi nous allons déjeuner chez M. Y…, une des plus hautes autorités de Tomsk, qui, dans une visite que je lui ai faite hier, à bien voulu nous inviter pour aujourd’hui. Mme Y… est l’amabilité même et nous fait seule les honneurs de sa table. Notre hôte a une telle crainte du choléra, qu’il ne veut toucher à aucun mets : il voit des microbes partout. Par deux fois, il vient s’asseoir à côté de nous et se laisse servir, mais, au moment de porter la fourchette à sa bouche, le cœur lui manque et il abandonne la table, après avoir trempé un biscuit anglais dans un doigt de vin. Il a une mine affreuse et meurt littéralement de faim. C’est cependant un homme très instruit et fort distingué. La terreur lui donne des idées rétrogrades. Il gémit de voir que Tomsk devient un grand centre de commerce. Car, nous dit-il, ce sont les voyageurs qui apportent toutes ces épidémies, et il se réjouit à la pensée que, d’après les projets, le chemin de fer passera à 50 verstes au sud. Tomsk deviendra alors une ville morte et restera seulement un centre d’études.
Un des monuments les plus imposants est l’Université, dont le recteur, le docteur Vasili, voulut bien nous faire les honneurs.
Je connais peu d’installations scolaires qui puissent l’emporter sur celle de Tomsk. Les salles sont très vastes, bien éclairées, munies de pupitres, de tables, de tableaux de grandes dimensions ; rien n’a été épargné pour assurer le confort et l’hygiène des élèves. Les laboratoires, avec leurs instruments et leurs collections, feraient honneur à beaucoup de villes d’Europe. Le recteur nous montre avec amour la planche à vivisection, qui fait pousser des cris d’horreur aux dames. Enfin il nous conduit à la bibliothèque, dont la ville de Tomsk est très fière. C’est parmi les nombreux livres français que je trouvai la relation de voyage de Lesseps.
L’université de Tomsk est de fondation récente. Elle ne date que de 1880, et c’est seulement en 1888 qu’elle a été inaugurée. Cependant grande est sa réputation, car les étudiants y viennent de tous les points de la Sibérie, bien qu’il y ait des gymnases dans beaucoup de villes. N’avons-nous pas vu le général Kapoustine envoyer ses enfants faire leurs études à Tomsk, à la grande indignation de l’archiprêtre directeur du séminaire de Blagovechtchensk ? Il y a ici également une école militaire.
Hane à découvert qu’il avait ici des compatriotes, des marchands de thé, et me demande la permission d’aller les voir. Comme notre provision de thé est épuisée, c’est une bonne occasion de la renouveler, et je le conduis. Ma connaissance de la langue mandarine me fait obtenir un accueil chaleureux.
Le Chinois, en dehors de la Chine, est toujours le Chinois. Il conserve non seulement son costume, mais aussi ses coutumes et ses habitudes, à de bien rares exceptions près. On m’invite à entrer dans Îles appartements privés. Il ne faut pas s’attendre à ce que je parle des femmes de mes hôtes : ils n’en ont pas ici. Ceux qui sont mariés ont laissé les leurs en Chine. Et pourtant, il y a bien dans le petit magasin une dizaine d’employés qui viennent passer ici trois ans dans le célibat. Je pourrais me croire dans une arrière-boutique à Pékin. Des malles chinoises sont empilées de tous côtés, des livres de compte pendus aux murs, les couvertures, pour la nuit rangées dans les coins, et dans le fond le petit autel et l’image sacrée du dieu de la fortune, devant lequel est un brûle-parfums : les cendres accumulées prouvent que ce dieu ne chôme pas pour être déporté. On sert le thé avec du sucre, ce qui est une concession aux coutumes des barbares. Le patron de l’établissement en servant Hane lui dit ces paroles aimables : « Ce que c’est que l’exil ! Vous n’êtes qu’un domestique ; en Chine nous ne voudrions même pas vous regarder : ici cela fait plaisir de vous voir, et nous vous traitons en égal. » Hane grimace un sourire qui peut être de remerciement à ce compliment douteux.
Les Chinois ont une peur atroce du choléra. Ils me demandent ce qu’il faut faire pour ne pas en être atteint. L’un d’eux, fataliste comme la plupart de ses compatriotes, cite d’un ton sentencieux ce vieux proverbe de son pays : « Si tu dois mourir pendu, ne crains pas de tomber à l’eau, tu ne pourras jamais te noyer ! — C’est vrai », répondent tous les autres en chœur. Nous les quittons sur ces paroles consolantes et nous regagnons l’hôtel. Ils nous ont vendu du thé exquis à raison d’un rouble la livre. Ils ont également cédé à Hane une paire de souliers, car les siens commencent à ne plus être de mise.
Dans la salle à manger de l’hôtel est un magnifique orchestrion. Il à presque des dimensions d’orgue d’église. Le maître de l’établissement nous affirme que c’est le plus beau de la Sibérie. Il vient de Suisse et a coûté 15 000 francs. Je n’aime pas beaucoup, en général, la musique des orgues de Barbarie ; je dois avouer toutefois que nous eûmes plaisir à entendre l’ouverture de Guillaume Tell, des morceaux d’Aïda et différents autres opéras célèbres, sur cet instrument perfectionné.
XXIII
De Tomsk à Tobolsk.
La route qui, passant par Omsk, va de Tomsk à Tiumen, n’a qu’une longueur de 1 595 verstes, soit 1 635 kilomètres. En été, il est plus agréable de faire le trajet par bateau à vapeur, mais la distance est à peu près doublée. On descend d’abord la rivière Tom, puis le grand fleuve Ob ; on remonte ensuite successivement l’Irtich, le Tobol et la Toura. Ce trajet est de neuf à dix jours. Lorsque les eaux sont suffisamment hautes, on va directement des deux points extrêmes, sans transbordement. Ce n’est malheureusement pas le cas en ce moment. Non seulement le Kosakovski, sur lequel nous devons faire le voyage, n’a pas pu remonter la rivière Tom, et est resté sur l’Ob, c’est-à-dire à 60 verstes, mais la petite annexe qui doit nous conduire à lui a été obligée de mouiller à 6 verstes de Tomsk. C’est là qu’il faut aller la chercher.
9 août. — À neuf heures notre cocher juif vient nous prendre pour nous conduire à bord. On nous prévient, en nous donnant nos billets, que, s’il ne survient pas de crue dans la rivière Toura, le Kosakovski ne pourra remonter jusqu’à Tiumen ; que nous aurons à descendre à Yévliévo, à peu de distance de Tobolsk, et à gagner Tiumen par voie de terre. C’est avec cette perspective peu séduisante que nous nous embarquons.
Vers midi nous voyons arriver de nombreux uniformes. Les autorités de Tomsk, gouverneur en tête, viennent conduire à bord un très influent personnage, M. Boutovski, sénateur, procureur général à Saint-Pétersbourg, en mission spéciale, chargé de l’inspection des cours et tribunaux dans les gouvernements de Tomsk et de Tobolsk ; il est accompagné de trois autres magistrats et d’un secrétaire particulier.
Tous les cinq parlent admirablement le français. Ils vont pour le moment à Tobolsk, où ils doivent rester quelques jours, ce qui ne laisse pas de les effrayer.
La rivière Tom, qu peut avoir 200 mètres de large, roule des eaux pres- que aussi limpides que l’Angara. À une grande profondeur on peut voir les poissons se jouer sur le sable. Les rives manquent d’intérêt et le pays est peu accidenté. La navigation paraît difficile, car à plusieurs reprises nous modérons notre allure, passant d’une rive à l’autre. En peu d’heures nous arrivons à l’Ob et nous prenons possession de notre cabine sur le Kosakovski.
Ce vapeur ressemble beaucoup au Mouravief, mais il est plus grand : même entassement de passagers sur l’arrière, même promiscuité qui nous paraît si étrange.
Aux premières il n’y a que les magistrats et nous. Nos cabines sont dans la cale. Il est impossible de se faire une idée de l’humidité qui y règne : humidité singulière, car les cabines sont spacieuses.
Le service est bien fait, et la cuisine bonne. Les repas sont servis à heure fixe, et quand ils sont terminés on vous apporte l’addition, comme dans un restaurant.
Nous fournissons notre thé et notre sucre : nous n’avons droit qu’à l’eau bouillante. Nous mangeons d’excellent poisson. Le sterlet surtout est délicieux, bien meilleur, à notre avis, que celui de la Volga, pourtant si renommé.
Il y a à bord une blanchisseuse : il y en avait une également sur le Yermak ; mais, n’ayant plus de linge, nous n’avons pas besoin de ses services.
Que dire de la navigation sur l’Ob, sur cet énorme fleuve, large parfois de plusieurs kilomètres, dont les rives basses souvent inondées, couvertes d’une herbe maigre, donnent l’idée d’un immense marais ? Nous sommes dans la partie la moins intéressante du voyage, qui nous paraît d’autant plus triste et monotone que nous avons encore présent à l’esprit le souvenir de ces merveilleux paysages de l’Amour, toujours si variés, Si pittoresques.
Nous marchons vers le nord et nous voyons peu à peu la végétation devenir plus maigre, les arbres de plus en plus petits, et quand nous avons dépassé le 60e degré de latitude nous ne trouvons plus que des forêts vierges impénétrables de saules serrés les uns contre les autres comme des roseaux dont le plus gros n’a pas plus de quelques centimètres de diamètre. C’est le pays de la désolation. Et cependant on y trouve des habitants, des Ostiaks, misérables humains à la figure hébétée, population douce et tranquille lentement refoulée vers le nord par les Russes. Ils vivent de pêche et de chasse. Nous en voyons de nombreux spécimens aux escales ; ils me rappellent les Ghiliaks, mais sont peut-être encore plus repoussants de saleté. On les dit d’une intelligence très bornée. À une escale, des passagers se précipitent à la suite de notre cuisinier pour acheter du poisson aux pêcheurs ostiaks qui attendaient sur la berge. L’un d’eux avait à lui seul une centaine, au moins, de livres de sterlets vivants, dans une longue bourriche en branches de saule. Je l’entendis demander un rouble de tout le lot. Notre maître-queux eut assez peu de pudeur pour rabattre quelques kopeks. Le misérable indigène accepta sans murmurer la somme offerte, il avait même un air de résignation qui faisait de la peine. Quelques minutes après, le maître d’hôtel entrait dans le salon, portant un superbe sterlet vivant, pouvant peser 3 livres. On devait nous le préparer pour le déjeuner et il venait nous le montrer. Ce sterlet, sur l’addition, représentait deux fois le prix du lot tout entier.
Nous sommes revenus aux longs crépuscules, cependant les nuits sont très noires pendant deux ou trois heures. Il ne faut pas oublier que nous sommes au milieu du mois d’août, On m’affirme que dans ces latitudes le soleil ne disparaît pas de l’horizon le 21 juin.
Par un curieux hasard, c’est la nuit que nous arrivons aux trois points les plus connus de la route : le premier est Narym, centre de déportation. Le procureur général, y faisant son, inspection, reçut la visite d’un escroc des plus célèbres qui venait lui demander de faire changer le lieu de son internement : « Que voulez-vous que fasse ici un raffiné comme moi, habitué au luxe, un homme d’une intelligence supérieure et qui peut se vanter d’avoir été un moment recherché par toutes les polices du monde ! »
Sourgont est un gros village sans aucun autre intérêt que celui-ci : c’est le point le plus nord que nous atteignions pendant tout notre voyage, 61° 20′. Dans la nuit il y a eu deux incidents. D’abord, une superbe aurore boréale. Tous les passagers sont furieux contre le capitaine, qui ne les a pas réveillés. L’autre incident est plus grave. Un passager avait été pris d’une attaque de choléra dans la matinée d’hier, on l’avait transporté sur la barge, et il y est mort. Pour n’effrayer personne, on a voulu le débarquer la nuit ; les gens ou les autorités du pays voulaient s’y opposer. Les discussions vives qui s’ensuivirent portèrent la terreur à bord du Kosakovski, car elles confirmaient ce que nous savions déjà, que le bateau était contaminé. On n’entend plus parler que du choléra, et naturellement les nouvelles deviennent terrifiantes en passant de bouche en bouche. Il y a un médecin aux secondes. Il conseille de ne manger ni légumes, ni poissons surtout, ni viande qui ne soit fraîchement abattue. Or la seule viande que l’on mange à bord vient de Tomsk, et elle a déjà cinq jours de date. Je conseille à l’impressionnable M. Regamey de faire son vint en paix, sans penser au choléra, comme nous faisons le nôtre, les magistrats et moi, mangeant ce que l’on nous sert, légumes, poisson, qui est délicieux, et viande de Tomsk.
Samarova : autre centre de déportation, à l’embouchure de l’Irtich, énorme affluent qui prend sa source aux frontières de Chine dans les monts Altaï, traverse Sémipalatinsk, Omsk, Tobolsk, et vient après un cours de 4 500 kilomètres, quatre fois celui de la Loire, se jeter dans l’Ob, qu’il égale presque en largeur. Il est 10 heures du soir quand nous y arrivons, après avoir admiré un superbe coucher de soleil, qui a ce grand avantage sur ceux que l’on peut voir sous les tropiques, d’avoir une durée incomparablement plus longue.
Nous remontons maintenant l’Irtich, allant directement au sud. Nous avons vu la navigation se ralentir et les arbres diminuer de grosseur à mesure que nous avancions vers le nord en descendant l’Ob. Nous voyons maintenant la transformation s’opérer dans l’autre sens et la végétation devenir plus luxuriante. Dans les environs de Sourgout et de Samarova, l’été, qui n’a peut-être qu’un mois d’existence, est déjà terminé ; les feuilles ont pris les teintes rouillées de l’automne. C’est avec une sorte de soulagement que nous abandonnons ces tristes pays.
Les bords de l’Irtich sont beaucoup plus accidentés que ceux de l’Ob. La plupart du temps on longe de hautes falaises de terre rongées par le fleuve et surmontées de forêts impénétrables. Des arbres renversés, retenus encore par quelques racines, pendent la tête en bas, n’attendant qu’un léger désagrégement du sol pour être précipités dans [es eaux.
14 août. — Nous avons débarqué dans la nuit un autre passager ou… son cadavre.
Le second du Kosakovski vient me trouver. M. Regamey lui a dit qu’entre Krasnoïarsk et Tomsk il avait été très indisposé, et que je lui avais administré un remède qui l’avait guéri presque immédiatement. Notre pilote est très souffrant et l’on me demande si je puis le soulager. Après avoir décliné toute espèce de responsabilité, n’étant pas médecin, je lui fais prendre 40 gouttes de chlorodyne, cette excellente médecine si peu connue en Europe, mais dont aucun Européen ne se sépare en Extrême-Orient. L’effet en fut si merveilleux que le second vint le lendemain m’en demander pour lui-même. Ai-je préservé ces deux hommes d’une attaque de choléra, je l’ignore, mais ils l’ont cru et m’en on témoigné de la reconnaissance.
Dans la soirée nous croisons un vapeur qui remorque une barge contenant des forçats. Au centre est une longue coupée grillée où sont réunis tous les prisonniers. On me dit qu’il y en a plusieurs centaines derrière ces barreaux.
Ce spectacle nous émeut toujours, mais il laisse absolument froids nos magistrats, qui, à ce sujet, nous parlent des criminels en Sibérie, dont ils déplorent, au point de vue de l’art, le peu d’ingéniosité. Ce sont presque tous des échappés du bagne, qui assassinent bêtement, sans passion, pour voler quelques kopeks ou des habits. Ils savent qu’ils ne risquent que d’être renvoyés là d’où ils viennent, et se laissent prendre les mains rouges de sang, sans avoir pensé à se les laver. Il n’y a pas, pour le magistrat, de chasse contre un gibier rusé dont on perd et retrouve la piste : c’est une chasse dans une basse-cour. Jamais il ne se présente d’affaire comme celle d’Eyraud et Gabrielle Bompard où l’habileté d’un juge d’instruction puisse trouver à se manifester.
Les crimes sont nombreux en Sibérie et les constatations difficiles. Celles-ci doivent être faites en présence de trois personnes : le chef de police du district, un médecin et un pope. Or il est quelquefois peu commode de réunir ces trois fonctionnaires, dont un ou deux ont souvent à venir de 700 ou 800 verstes : l’absence d’un seul rend les constatations impossibles. C’est partie remise, et pendant ce temps-là, la décomposition fait son œuvre. Il faut donc pouvoir conserver les cadavres. À cet effet, il y a, dans chaque village, des glacières ou morgues très bien installées. Ces détails ne nous surprennent nullement. Le médecin de Nertchinsk n’était-il pas allé avec le chef de la police de Stretinsk faire une constatation à Outesnaïa, c’est-à-dire à 652 verstes de chez lui !
16 août. — Vers 11 heures, Tobolsk est en vue. Nous apercevons sur la berge de la rive gauche, qui est basse, de grands hangars en planches : c’est le lazaret ; la croix rouge y brille partout. En face, sur une haute falaise, de grandes constructions blanches : c’est Tobolsk, l’ancienne capitale de la Sibérie, ou du moins c’est le Kremlin qui renferme le palais du gouverneur, la cathédrale, des casernes, la prison, etc., dominant la ville de près de 80 mètres.
Sur le ponton auquel nous devons nous amarrer est le chef de la police, flanqué de ses agents : il nous intime l’ordre de rester à 10 mètres, et d’attendre la visite du médecin. On veut savoir si nous n’avons pas à bord de cholériques, pour les diriger sur le lazaret. Cette cérémonie dure plus d’une heure. Suivi du chef de la police, le docteur fait le tour du bateau. Hommes d’équipage, passagers placés en rang doivent lui montrer leur langue et se laisser tâter la main, la gorge et le front. Toutes ces formalités impressionnent vivement nombre de personnes. Le pouls d’un de nos magistrats bat 106 pulsations. Les autres sont plus calmes, mais au fond la perspective de rester une huitaine de jours à Tobolsk n’a rien qui les enchante, d’autant mieux qu’on vient de leur crier du rivage qu’un de leurs amis, le procureur de la ville, est mort dans la matinée.
Enfin, nous sommes libres et nous pouvons descendre à terre. Nos compagnons de voyage nous quittent et nous sommes désolés de les voir partir, car, depuis huit jours que nous vivons avec eux, ils n’ont jamais cessé de nous montrer la plus grande amabilité. L’heure du déjeuner étant arrivée, nous nous mettons à table, Marie et moi, pour ne pas descendre à terre à jeun.
La fondation de Tobolsk date de 1586, c’est-à-dire quatre années seulement après la réunion à la Russie de la Sibérie, dont ce fut longtemps la capitale. La ville a beaucoup perdu de son importance depuis qu’elle ne se trouve plus sur la grande route des caravanes. Marchandises et voyageurs à destination de Tomsk, Irkoutsk, la Transbaïkalie, et thés de Chine passent à plus de 200 verstes au sud, allant directement de Tiumen à Omsk. Il ne reste plus à Tobolsk que le commerce des fourrures, que fournissent les forêts du nord, et du poisson, extraordinairement abondant dans l’Irtich. C’est aussi toujours le point où se centralise la déportation.
Un Français, l’abbé Chappe d’Auteroche, fit à Tobolsk un assez long séjour, au siècle dernier. Il y avait été envoyé par l’Académie des sciences pour observer le passage de Vénus sur le Soleil, le 6 juin 1671. Le récit de son voyage et de son séjour dans cette partie de la Sibérie, publié sept années plus tard, fit beaucoup de bruit en Russie.
Nous visitons Tobolsk dans de fâcheuses circonstances. Nous ne voyons d’animation qu’autour du débarcadère, où de nombreux petits marchands ont étalé des provisions pour les passagers du Kosakovski ; la crainte de la contagion empêche beaucoup de gens de faire des achats.

La seule chose qui distingue Tobolsk de toutes les villes que nous avons vues en Sibérie, c’est le dallage ou plutôt le parquetage des rues. Perpendiculairement aux trottoirs on a placé, tous les 4 mètres environ, de grosses traverses où lambourdes sur lesquelles on à cloué, côte à côte, parallèlement à l’axe de la voie, des troncs d’arbres sciés en deux, ce qui, à l’origine, devait constituer une chaussée idéale, mais ce qui manque, je crois, de solidité et de durée. Ces chaussées sont dans un état abominable, et il faut toute l’habileté des yemchtchiks pour faire éviter aux pieds des chevaux et aux roues des voilures les trous béants dont elles sont émaillées. Sur plusieurs points de la ville on est en train de remplacer les lames pourries de ce parquet. Il faut avoir habité Pékin pour se faire une idée des cloaques que l’on met à découvert et des miasmes fétides qu’ils dégagent. N’eût-il pas été préférable d’exécuter ces travaux pendant la saison froide ? Car s’ils ne sont pas la cause de la terrible épidémie qui sévit dans le pays, ils ne peuvent que contribuer à l’entretenir.
À la coupée du Kosakovski on a placé un agent de police qui empêche de monter à bord tous ceux qui ne sont pas reconnus comme faisant partie de l’équipage ou des passagers. C’est probablement pour prévenir les tentatives d’évasion.
Nous voyons bientôt arriver nos magistrats : ils ont la mine soucieuse. Toul le monde est affolé dans la ville. Chacun pense à soi et se calfeutre dans sa maison. On leur à bien préparé des logements à terre, mais ils ne peuvent trouver à s’y nourrir, même à peu près convenablement. Pas la moindre bouteille de vin à acheter ! Il est deux heures et ils n’ont pas déjeuné. Ils veulent faire encore un bon repas et sont revenus pour cela sur le Kosakovski, dont le maître d’hôtel leur prépare un panier de provisions. Ils se rendent parfaitement compte du danger qu’ils courent en restant à Tobolsk, mais, obligés de donner le bon exemple, ils sauvent les apparences et font tous assez bonne figure, à exception d’un seul qui paraît anéanti et refuse de prendre part an déjeuner. Il se promène mélancoliquement sur le pont. À ce moment une barque quitte la rive un peu au-dessus de nous, et se dirige vers le lazaret, de l’autre côté de l’Irtich. Elle est couverte et sur ses côtés nous voyons une grande croix rouge. À l’arrière, flotte un drapeau sur lequel sont peintes une pelle et une pioche. Il n’y a pas besoin de faire un grand effort d’imagination pour découvrir la signification de ces emblèmes et l’usage de cette barque. Notre ami ne peut supporter cette vue, et descend dans le salon. Nous le plaignons, ce pauvre homme, car on prétend que, dans ces sortes d’épidémies, la terreur aide beaucoup à la contagion.
L’heure du départ est arrivée : la police est à son poste, examinant d’un œil scrutateur tous ceux qui montent à bord. Deux de nos Cosaques sont absolument ivres. L’un d’eux échappe aux regards des officiers : il s’est caché la tête dans sa houppelande et fait semblant de dormir. L’autre, moins heureux, est renvoyé à terre cuver son vin. On lui passe ses hardes. Il regarde faire l’appareillage sans souffler mot, mais au moment où nous démarrons, certain d’être à l’abri des représailles, il vomit un torrent d’injures contre les officiers.
XXIV
De Tobolsk à Paris.
Cependant le ciel s’est couvert de nuages, et un orage se prépare au-dessus du Kremlin. La ville se déroule sous nos yeux dans une sorte de cirque ; ses nombreuses églises, blanches pour la plupart, se détachent sur le fond sombre de la colline qui entoure Tobolsk. Le panorama est splendide. Nous remontons l’Ilrich, puis presque immédiatement nous pénétrons dans la rivière Tobol, qui a donné son nom à la ville.
17 août. — Les eaux sont très basses. Il n’y a plus de doute à avoir : notre bateau cale trop pour pouvoir aller jusqu’à Tiumen. Dès l’aube, nous faisons nos préparatifs, non seulement pour quitter le Kosakovski, mais pour rouler encore sur les grands chemins, pendant au moins deux jours, dans un pays décimé par la maladie.
En nous embarquant à Tomsk, nous pensions être au terme de nos misères, n’avoir plus qu’à sauter des bateaux dans les chemins de fer jusqu’à Paris, et voilà qu’on va nous déposer à Yévliévo, c’est-à-dire à 128 verstes de la gare ! Notre désappointement est grand. Maintenant, plus de bon et confortable tarantass ; il va falloir nous contenter d’un misérable périclodnoï. Plus de liste blanche pour les chevaux, dans un pays où, nous le savons, il n’y a que deux troïkas à chaque station, ce qui est à peine suffisant pour les voitures de la poste.
Vers dix heures, on annonce que nous sommes à Yévliévo, et nous accostons devant une berge élevée, au pied de laquelle on ne parvient qu’après avoir barboté dans la boue pendant 20 mètres. Arrivé au sommet, je cherche des yeux la ville, le village, le hameau ! Rien de tout cela n’existe. À 200 mètres est la maison de poste, et 200 mètres plus loin j’aperçois trois ou quatre maisons d’aspect misérable : voilà Yévliévo !
Cependant on a descendu les bagages des passagers et on les a déposés sur la berge. Le temps est très menaçant, une pluie fine commence déjà à tomber, et en attendant les voitures et les chevaux de paysans qu’on est allé chercher pour les Regamey et nous, je photographie la scène, afin de montrer aux gens civilisés qui seraient tentés de faire ce voyage, la façon barbare dont on est exposé à être traité par les grandes compagnies subventionnées de navigation, en Sibérie.

Or ce qui se passe aujourd’hui n’est pas un accident imprévu. À peu près tous les ans à pareille époque, le manque d’eau oblige les grands vapeurs à déposer leurs passagers à Yévliévo. Il serait pourtant bien facile de les transborder sur un petit steamer à fond plat, qui, lui, pourrait remonter jusqu’à Tiumen. Mais c’est une attention dont les compagnies n’ont aucun souci, parce que l’opinion publique ne se soulève pas contre elles et que les passagers supportent tout sans faire entendre la moindre protestation. Au fond, il y a dans le caractère russe beaucoup du fatalisme des Orientaux : heureuses gens !
Au bout d’une heure d’attente, nous voyons arriver deux télégas, sorte de grosses corbeilles dans lesquelles nous empilons tant bien que mal nos bagages, puis nous nous juchons par-dessus et nous voilà partis. Il n’est plus maintenant question de s’étendre mollement sur nos matelas étalés. L’important est de se tenir solidement et de ne pas être jetés hors de la corbeille dans les cahots violents qui se succèdent sans interruption. La route est abominable, par moments c’est un véritable marais dans lequel nous pataugeons au petit bonheur, verste après verste. Pour la première fois depuis notre départ de Pékin, le caractère de ma femme semble s’être modifié. Elle est franchement de mauvaise humeur et peste à haute voix contre le temps toujours menaçant, les télégas, la route, la Sibérie, les Russes et son mari. Laissons passer cet unique orage après cent jours de calme et de sérénité.
Les Regamey, eux aussi, sont trois dans leur téléga. Ils ont offert l’hospitalité à une jeune Sibérienne qui vient de Tchita et qui va à Paris étudier la médecine. Elle ne suit du reste pas un mot de français. Ses études finies, elle compte retourner s’établir dans la Transbaïkalie.
Au bout de 25 verstes, nous changeons de chevaux et de voiture. Nous tombons cette fois sur une téléga encore plus petite que la précédente, et cette seconde étape est peut-être plus pénible que la première. Enfin, vers dix heures du soir, nous arrivons dans un grand village. Il fait nuit noire. Notre yemchtchik nous conduit chez un de ses amis, qui met volontiers une chambre à la disposition des voyageurs, et qui certainement nous trouvera des chevaux pour demain. Arrivés devant sa maison, nous avons quelque peine à nous faire entendre. Au bout de plusieurs minutes, il paraît enfin, une lanterne à la main. Il nous dit, d’un air triste, qu’il lui serait bien difficile de nous recevoir chez lui ce soir, car son fils est mourant : il a été atteint du choléra ce matin. Nous n’insistons pas. Un paysan qui assistait au colloque nous dit que le choléra avait fait plusieurs victimes dans le village, mais que sa maison était indemne, qu’il avait une belle chambre bien propre à notre disposition, et des chevaux et des voitures pour demain. Il n’y a qu’à accepter.
Dans la cour de sa maison, on est obligé de placer des planches pour nous permettre de franchir le fumier qui la remplit et qui va jusqu’à la première marche de l’escalier. Il a en effet une chambre assez propre avec une sorte de cloison en planches au milieu.
Nous n’avons rien mangé depuis notre départ de Yévliévo, et il est près de minuit. Six œufs, voilà tout ce que nous trouvons à nous procurer comme provision dans ce village. Nous sommes six, le partage est facile. De nombreuses tasses de thé prennent la place d’une nourriture solide. Nous procédons à notre installation pour la nuit, et il est près d’une heure quand nous éteignons les bougies.
Il n’y avait pas dix minutes que l’obscurité régnait dans nos appartements, qu’un colloque à voix basse s’établissait dans la chambre des Regamey, de même que dans la nôtre. On sentait qu’il se passait quelque chose d’anormal, et que nous étions tous sous la même impression désagréable. À une heure un quart les bougies étaient rallumées. Nous cédions devant l’attaque d’ennemis trop nombreux et nous redemandions le samovar, pour passer le temps pendant qu’on préparerait les voitures et les chevaux.
Toute une journée en voiture découverte non suspendue, dans des chemins abominables, par un temps pluvieux, rien à manger, privation de sommeil, voilà de l’hygiène dans un pays contaminé !
18 août. — Ce n’est qu’à six heures que nous partons dans des télégas encore plus rustiques que les premières, et qu’on a dû mettre en état pour la circonstance. Nous longeons un joli étang, long et peu large, bordé de saules et de roseaux, que nous prenons d’abord pour une rivière. De nombreux canards sauvages y élèvent leur petite famille. Ce serait à photographier ; mais si je parlais de m’arrêter, je serais honni. Nous traversons de magnifiques plaines bien cultivées, et qui font un contraste frappant avec les déserts incultes des bords de l’Ob et du bas Irtich. Partout la moisson se prépare abondante, et cependant on dit que la disette règne dans cette partie de la Sibérie : c’est à n’y rien comprendre.
Vers dix heures nous entrons dans l’immense cour d’une riche ferme, et l’on nous sert en peu de temps de quoi réparer nos forces. Nous y trouvons de plus des chevaux et un périclodnoï dans lequel nous serons au moins à l’abri s’il pleut.
Le fermier est un homme superbe. Il n’a pas moins de quarante personnes sous ses ordres. Sa fille, une jeune femme aux traits réguliers, est plus grande que lui de la moitié de la tête ; c’est le plus beau type qu’il soit possible de voir de la race sibérienne.
Je vais prendre une vue de la petite église du village qui est devant la porte, puis je propose au fermier qui m’a suivi de le photographier avec tout son personnel. Il me demande en hésitant ce que cela lui coûtera, et, sur ma promesse de ne rien lui faire payer, se prête assez volontiers à mon désir.


Nous partons conduits par un yemchtchik tatar, et traversons des plaines fertiles et bien cultivées. Les villages paraissent de plus en plus riches et de plus en plus habités. Quelques-uns d’entre eux nous frappent par la propreté qui y règne, et Île bon entretien des cours. Les maisons ont un aspect plus gai. De loin nous apercevons les églises ; elles sont peintes en blanc ou en vert comme partout, et ont un clocher élancé. En approchant, nous remarquons que ce ne sont pas des croix qui surmontent ces édifices, mais le croissant : ce ne sont pas des églises, mais des mosquées. Les habitants ont, de plus, un costume particulier : ce sont des villages tatars.
À la sortie de l’un d’eux est un bois épais, entouré d’une barrière. Il longe la route, qui décrit ici un demi-cercle : c’est le cimetière. Sous la verdure des arbres nous voyons des cercueils rangés, se touchant presque. Ils sont un peu soulevés, de façon à ne pas toucher la terre, et un petit auvent, supporté par quatre montants, les protège contre les intempéries. Quelques-uns sont en mauvais état, et leur délabrement prouve leur vétusté.

Marie, ayant déjeuné, étant assez confortablement installée dans son périclodnoï, jouissant du beau soleil qui nous est revenu, a retrouvé sa bonne humeur. Elle se félicite maintenant de cette sécheresse qui nous a permis d’ajouter à nos souvenirs la téléga, le périclodnoï, de nouvelles punaises, la famine et enfin les villages tatars. Car Tiumen se dessine dans le lointain, nous longeons la rive gauche de la Toura et nous pouvons même distinguer les wagons de marchandises rangés sur la rive droite, où se trouve la ville. Un galop nous amène aux faubourgs, et notre joie tombe instantanément devant le lugubre aspect qu’offre cette ville, pourtant jolie. Presque personne dans les rues, toutes les maisons fermées, les fenêtres condamnées, on sent qu’il n’y a plus dans Tiumen que ceux qui n’ont pu fuir. Ce n’est pas le délabrement de Nikolaïevsk, c’est l’abandon précipité à l’approche d’un danger. J’ai su dans la suite, de très bonne source, qu’au 18 août il était déjà mort 1 800 personnes du choléra depuis le commencement de l’épidémie.
La Toura coule encaissée entre deux berges élevées de près de 20 mètres. Nous la traversons sur un pont presque à fleur d’eau, auquel on accède des deux côtés par une rampe fantastique. Comment dans cette ville de plus de 15 000 âmes, où se trouvent plus de cent fabriques, tête de ligne du chemin de fer et des bateaux à vapeur de Tomsk et de Sémipalatinsk, où des foires importantes produisent un mouvement énorme de marchandises et des échanges pour des sommes considérables, ne fait-on rien pour améliorer ce dangereux passage que l’on s’est contenté de daller en bois ?
Nous passons sans encombre, et bientôt nous arrivons devant une sorte de jardin public que contourne la route, derrière laquelle se dresse un gracieux monument en briques rouges : c’est la gare.
Il est 2 heures, et le train ne part que ce soir à 10 heures. À côté du buffet, qui, par parenthèse, est excellent, sont deux salons de toilette, d’où nous sortons au bout d’une trentaine de minutes avec des vêtements bien brossés, aussi frais que peuvent l’être des habits portés pour ainsi dire nuit et jour depuis trois mois.
Le prince Grégoire Galitzin part ce soir par le même train que nous. J’ai pour lui une lettre du comte Cassini, je la lui remettrai demain. On me montre au buffet un des secrétaires du prince en train de dîner. Je le prie de vouloir bien demander pour moi une audience. Il est probable que mon costume me nuit dans l’esprit de cet officier, car je ne rencontre pas chez lui la civilité à laquelle les Russes m’ont habitué. Il prend néanmoins ma carte. Vers onze heures, un autre officier, des plus courtois, vient me prévenir que le prince me recevra volontiers demain vers neuf heures, dans son wagon-salon.
Je n’eus garde de manquer au rendez-vous, et je restai avec le prince Galitzi pendant deux stations. C’est un des hommes les plus aimables que je connaisse.
À Yékatérinbourg le prince doit rester vingt-quatre heures, nous le voyons quitter la gare, puis, pendant que nous déjeunons, un bijoutier vient de sa part nous montrer des alexandrites, cette curieuse pierre précieuse qui est verte pendant le jour, ressemblant à une émeraude, et rouge la nuit, comme un rubis. Le prince sait que je veux emporter ce souvenir de notre passage dans les monts Oural et nous adresse un bijoutier de confiance avec quelques mots sur une de ses cartes. J’eus à Saint-Pétersbourg occasion de le remercier et de lui montrer la jolie alexandrite achetée par son entremise.
Que dire du reste du voyage ? Nous sommes maintenant dans des pays trop connus et trop souvent décrits pour que j’y insiste beaucoup.
À Perm nous montons sur un excellent steamer qui en trois jours nous amène à Nijnii-Novgorod : excellente cuisine, lumière électrique dans les cabines, mais toujours pas de draps ni même de lit.
À Kazan, nous stoppons devant le lazaret ; il est 9 heures du matin, et tout le monde est sur le pont. Un infirmier et une infirmière viennent à bord et aident un passager atteint du choléra à descendre. À peine arrivé à terre, nous voyons ce malheureux s’affaisser. On est obligé de le transporter à l’hôpital. Cette lugubre scène nous impressionne péniblement tous, et terrifie plusieurs passagers.

À Nijnii-Novgorod, beaucoup de monde dans les rues. On nous dit cependant que la foire est bien moins animée que les autres années, à cause de l’épidémie. Nous faisons quelques achats dans le grand pavillon central, qui ressemble, en petit, à notre palais de l’Industrie, valises en cuir de Russie, châles d’Orenbourg, ces merveilles de patience et de travail. Un de ceux achetés par nous mesure 11 mètres de superficie. Il est carré, et en le prenant par un angle, il passe, tout entier, sans difficulté aucune, dans la bague de Marie qui a 1 centimètre de diamètre.
Le caviar à Nijnii est exquis.

Malgré le vent violent qui souffle, nous allons visiter la ville en voiture découverte. Elle est des plus pittoresques. D’un côté de la rivière, les vieux quartiers, le Kremlin, les anciennes églises, en amphithéâtre sur le flanc de la colline, du sommet de laquelle la vue est superbe. Elle embrasse de l’autre côté de la rivière toute la plaine, sur laquelle se trouve la nouvelle ville avec la foire et ses magasins : au loin, la Volga serpente à perte de vue.

Le lendemain, à Moscou, nous disons adieu aux Regamey, qui vont directement à Vilna. Il y a près d’un mois que nous vivons ensemble, ce sont des amis que nous quittons.
5 septembre. — Enfin, après être restés quatre jours à Moscou, quatre à Saint-Pétersbourg, et un à Vienne, nous rentrons en France par le Tirol. Malgré le choléra qui nous suit et nous cause des tracas sans nombre à toutes les frontières, nous jouissons d’une parfaite santé.
Nous traversons l’ancien continent dans toute sa largeur. Nous rapportons de notre voyage 150 clichés 18 × 24 qui, grâce à l’excellence des appareils choisis par M. Paul Nadar lui-même, m’ont donné des résultats fort satisfaisants. Et s’il y a eu parfois des moments pénibles pendant notre longue pérégrination, nous nous les rappelons avec plaisir maintenant, car ce sont autant de souvenirs pour le reste de notre vie.
Il y a cent douze jours que nous avons quitté Pékin.

- ↑ Voyage exécuté en 1892. — Tous les dessins de ce voyage ont été exécutés d’après les photographies de l’auteur.
- ↑ Dessin d’A. Paris, gravé par Devos.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.
- ↑ Notre collaborateur ajoute, on le voit, un e muet aux noms chinois terminés d’ordinaire par n. T’ai Ho-Tiene, Fou-Sane, etc. Cette orthographe a l’avantage d’indiquer clairement la prononciation aux lecteurs français. Nous l’avons suivie ici, bien qu’elle ne soit pas adoptée dans les ouvrages de géographie.
(Note de la rédaction.)
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Privat.
- ↑ Dessin de Taylor, gravé par Ruffe.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Ruffe.
- ↑ Dessin de Riou, gravé par Privat.
- ↑ Suite. — Voyez p.177.
- ↑ Gravure de Rousseau, d’après une photographie de M. Piry.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Faucher-Gudin, d’après une photographie prise au Musée Guimet.
- ↑ Gravure de Florian, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Riou, gravé par Privat.
- ↑ Dessin de Weber, gravé par Privat.
- ↑ Gravure de Ruffe, d’après une photographie.
- ↑ Dans une publication officielle qui vient de paraître, le Grand Sibérien, le ministre des finances russe annonce (Débats, 12 janvier 1894) qu’en l’année 1900 la ligne sera terminée entre Vladivostok et Grafskaïa, ville située sur l’Oussouri, d’une part, et entre Irkoutsk et Tcheliabinsk, point extrême des chemins de fer russes actuels, de l’autre. Cela, je Le crois sans peine. Mais il ajoute que la partie comprise entre Irkoutsk et Grafskaïa sera livrée à la circulation en 1904. Enregistrons cette promesse qui, si elle est exactement tenue, fera le plus grand honneur au gouvernement pour sa persévérance et aux ingénieurs pour la rapidité avec laquelle ils auront mené à bien cette œuvre gigantesque.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Ruffe, d’après un croquis.
- ↑ Dessin de Taylor, gravé par Maynard..
- ↑ Suite. — Voyez p. 177 et 193.
- ↑ Gravure de Devos, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie japonaise.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Ruffe.
- ↑ Gravure de Berg, d’après des dessins japonais.
- ↑ Gravure de Berg, d’après des dessins japonais.
- ↑ Reproduction d’une ancienne gravure.
- ↑ Suite. — Voyez p. 177, 193 et 209..
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Privat.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie de M. Ninaud.
- ↑ Dessin d’A. Paris, gravé par Devos.
- ↑ Dessin de Riou, Gravé par Morizet.
- ↑ Dessin de Riou, gravé par Ruffe.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.
- ↑ Suite. — Voyez p. 177. 193, 209 et 225.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie de M. Ninaud.
- ↑ Dessin de Riou, gravé par Bazin, d’après une photographie de M. Ninaud.
- ↑ Dessin de Slom, gravé par Derbier, d’après une photographie de M. Ninaud.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin, d’après un croquis.
- ↑ Dessin de Slom, gravé par Devos.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Privat.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Privat, d’après un croquis.
- ↑ Dessin de Krieger, d’après une photographie.
- ↑ La communication entre la ligne chinoise et la ligne russe a été établie dans les derniers mois de 1893, mais les hauts prix des télégrammes pour l’Europe ont été maintenus.
- ↑ Suite. — Voyez p. 177, 193, 209, 225 et 241.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photograghie.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Riou, gravé par Privat.
- ↑ Gravure de Bocher, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin, d’après un croquis.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Devos, d’après une photographie.
- ↑ Suite. — Voyez t. LXVII, p. 177, 193, 209, 225, 241 et 257.
- ↑ Gravure de Berg, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin.
- ↑ Gravure de Th. Weber, gravé par Privat.
- ↑ Dessin de Gotorbe, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Taylor, gravé par Marynard.
- ↑ Dessin de Marius Perret, gravé par Rousseau.
- ↑ Dessin de Slom, gravé par Ruffe, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Suite. — Voyez t. LXVII, p. 177, 193, 209, 225, 241 et 257 ; t. LXVIII, p. 193..
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Berg, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Vogel, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Berg, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Berg, d’après une photographie russe.
- ↑ Dessin de Gotorbe, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Privat, d’après une photographie.
- ↑ Suite. — Voyez t. LXVII, p. 177, 193, 209, 225, 241 et 257 ; t. LXVIII, p. 193 et 209.
- ↑ Dessin d’A. Paris, gravé par Bazin, d’après un croquis.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Berg, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin, d’après un croquis.
- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.
- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.
- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.