Correspondance d’Eulalie/II/01
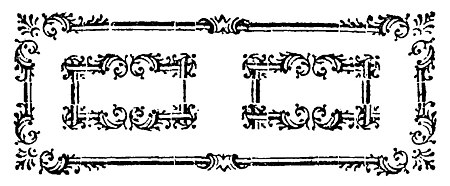

Pour mes étrennes le Comte m’a
donné une paire de bracelets en brillans,
ſur l’un deſquels eſt ſon portrait,
et ſur l’autre ſon chiffre et le mien. Je
l’ai beaucoup remercié, mais il m’a
impoſé ſilence de la façon la plus
galante. Mon amant m’a donné un petit pompon, mes beaux eſprits, des
vers et des dragées. Quelques amis du
Comte m’ont donné d’autres petites
babioles. Je ſuis très-contente, et
voudrois que le jour de l’an vînt tous
les mois.
Si tu as jamais un mari, je ſouhaite qu’il reſſemble au héros de cette chanſon, qu’on peut appeller le modèle des maris :
Chaque jour plus élégante,
Si partout ma femme plaît ;
Des amis qu’elle me fait,
Si toujours le nombre augmente,
Hé ! qu’eſt qu’ça me fait à moi ?
C’eſt ainſi qu’on repréſente.
Hé ! qu’eſt qu’ça me fait à moi.
Quand je chante et quand je boi ?

Qu’elle reſte à ſa toilette
Juſqu’à l’heure du rempart ;
Que ſon panache avec art
Se leve et flotte en aigrette,
Hé ! etc.
Pour qui crois qu’elle eſt faite ;
Hé ! etc.

On la lorgne et chacun dit :
La parure s’embellit
Sur une femme gentille.
Hé ! etc.
Le ſoir je la déshabille.
Hé ! etc.

Se donnant mille bijoux ;
Qu’un Chevalier des plus foux
La ramene à la nuit noire,
Hé ; etc.
Je ne paye pas le mémoire.
Hé ! etc.

Souvent, ſans que je la preſſe,
Elle ſoupe à la maiſon,
Et quand je rentre au ſalon,
J’y vois régner l’allégreſſe ;
Hé ! etc.
On me flatte, on me careſſe,
Hé ! etc.

C’eſt là que Madame rit ;
Et plus le cercle s’étrécit,
Plus Madame eſt adorable ;
Hé ! etc.
Chacun m’applaudit à table.
Hé ! etc.

Elle pétille d’eſprit ;
C’eſt toujours elle qui dit
Le bon mot que j’allois dire.
Hé ! etc.
Je la vois pâmer de rire.
Hé ! etc.

Il y a deux jours que j’ai fait connoiſſance avec un jeune officier aux gardes françoiſes qui a tout au plus dix-ſept ans. Il eſt de la plus jolie figure du monde. Je t’avouerai que j’en ſuis amoureuſe ; j’ai bien envie d’en faire mon farfadet. Je le crois encore novice, cela m’amuſera de lui donner la premiere leçon d’amour. Cependant à cet âge, à Paris, avoir encore ſon pucelage, cela me ſurprendroit. Je le ſaurai avant peu ; il vient me voir demain, et comme je me meurs d’envie d’en jouer avec lui, je lui donnerai ſi beau jeu, que, s’il fait quelque choſe, il le fera voir. Au ſurplus, s’il le faut, je ferai les avances, malgré ce qu’il pourra m’en coûter. L’amour n’écoute rien et fait taire les bienſéances. Tu vois, chere Eulalie, que je me diſpoſe à bien commencer l’année ; ſois perſuadée que je ne la paſſerai pas ſans bien m’en donner. Adieu. Porte-toi bien.
Hier mon petit officier, chere
amie, eſt venu à dix heures du matin
comme je lui avois dit. J’étois reſtée
au lit. Sophie l’a introduit dans ma
chambre et lui a approché un fauteuil
près de mon lit. D’abord ſaiſiſſant une
de mes mains, et la couvrant de
baiſers, il m’a dit qu’il m’aimoit à
l’adoration ; que depuis l’inſtant qu’il
m’avoit vue, il n’avoit pas fermé l’œil,
qu’il ne faiſoit que penſer à moi, et
étoit conſumé par un feu brûlant, que
ſi je ne l’aimois, il mourroit de chagrin.
Hélas ! ſes yeux en diſoient davantage :
ils étoient animés. Son diſcours, qu’il
débitoit avec tant de chaleur et de
vérité, joint à l’amour que je reſſentois
déjà, me donnoient pour le moins
autant de déſirs qu’à lui. Je lui paſſai
la main derriere le cou, et lui donnai
un baiſer de flamme, en lui diſant
qu’une demoiſelle riſquoit beaucoup
en ſe fiant trop légerement aux diſcours
ſéduiſans d’un jeune homme ; que l’inconſtance
et l’indiſcrétion étoient les
moindres maux à redouter d’un tendre
commerce avec des gens de ſon état et
de ſon âge. Ah ! répliqua-t-il, je ne
ſais comment ſont les autres, quant à
moi, je jure d’être diſcret et de vous
aimer toute la vie. Auſſitôt
m’embraſſant il s’évanouit, et reſta un moment
comme anéanti, la tête couchée ſur
mon ſein : puis revenant ſubitement à
lui, il recommença de m’embraſſer en
ſoupirant et avec un regard languiſſant.
Je m’apperçus alors qu’il étoit
novice, et ſoupiroit après quelque
choſe qu’il n’oſoit ni prendre ni demander.
Je ſonnai Sophie et me levai
auſſitôt, bien réſolue de ne pas perdre
ma matinée, mais que mon joli boudoir
ſeroit le théâtre de nos ébats. Je
ne mis qu’un léger déshabillé piqué ;
mon corſet étoit ouvert, et mes cheveux
flottoient ſur mon ſein. Ainſi
arrangée, je paſſai avec lui dans le
boudoir, et l’ayant fait aſſeoir à côté
de moi ſur mon canapé, je le laiſſai
maître de s’emparer de ma gorge, et
de me donner autant de baiſers qu’il
voulut. Mais voyant qu’il étoit dans
un état brillant, je fis en badinant
ſauter les boutons de ſa culotte, et je
vis alors paroître un bijou qui me fit
friſonner de crainte et de plaiſir. Soit
inſtinct naturel, ſoit que mon badinage
l’ait rendu plus hardi, il paſſa la main
ſous mes jupes et y fouragea. Son
front ſe couvrit d’une aimable rougeur ;
ſon trouble et ſon embarras étaient
extrêmes, lorſque l’attirant tout d’un
coup ſur moi, et dirigeant ſon dard
amoureux vers le centre des plaiſirs,
je lui en indiquai l’uſage. Je crus alors
qu’il me déchireroit, tant il me faiſoit
ſouffrir. Pluſieurs fois je le priai de
ceſſer, mais inutilement ; ſemblable
à un cheval échappé, rien ne pouvoit
l’arrêter. Mais bientôt épuiſé lui-même
par une ample effuſion de la liqueur
amoureuſe dont je me ſentis inondée,
il demeura un inſtant ſans mouvement,
comme enivré de plaiſirs. Puis revenant
de ſa léthargie il recommença de
plus belle. Enfin, après quatre aſperſions,
il s’arrêta. Pour moi, plongée
dans une mer de délices, et ne ſentant
plus rien à force de ſentir, j’étois
tombée en pamoiſon. Mon éleve s’occupoit
à conſidérer mes charmes ; ſes
careſſes et les baiſers dont il couvroit
toutes les parties de mon corps, me
firent revenir à moi. Accablée de fatigue,
je me recouchai ; mon amant
me demanda de partager mon lit : je le
lui accordai, ſachant le Comte à la
cour ; mais ſous la condition qu’il me
laiſſeroit dormir. Il me promit tout ce
que je voulus ; mais à peine y avoit-il
une heure que j’étois au lit, qu’il
manqua à ſa parole. Je l’aurois grondé
ſi j’en avois eu la force ; mais cela
m’étoit impoſſible. Enfin, après une
heure paſſée dans de nouveaux plaiſirs,
nous nous ſommes levés et avons
dîné enſemble. A quatre heures je l’ai
congédié et me ſuis recouchée, voulant
réparer mes forces. Adieu. Ton
amie pour la vie.
Voici ma chere, quelques petites
nouveautés qui ont été dites à un
ſouper qu’il y a eu chez moi le jour
des rois. J’ai été la reine, le Comte
ayant eu la fêve. La ſoirée a été des
plus gaies.
Les courtiſans ſont des jetons,
Leur valeur dépend de leur place ;
Dans la faveur des millions,
Et des zéros dans la diſgrace.
Un Pere avoit un garnement
Qui faiſoit chaque jour quelques fraſques nouvelles,
On le nommoit la terreur des pucelles ;
Toujours au jeu, le vin étoit ſon élément.
Il avoit fui loin des yeux de ſon pere,
Qui ne pouvoit exhaler ſon courroux
Qu’en ſtyle épiſtolaire :
Or, des mots ne ſont pas des coups.
Le bon-homme en fureur ne ſachant plus que dire,
A ſon vaurien écrivit ces deux mots :
„ Si les coups de bâton, coquin, pouvoient s’écrire,
Tu ne lirois ceci qu’avec le dos. ”
Pour tous les vers qu’il fait, le poëte Lubin
Reſſent une tendreſſe extrême :
Mais des enfans gâtés ſes vers ont le deſtin,
Leur pere eſt le ſeul qui les aime.
Mon petit Farfadet eſt bien inſtruit, il fera ce que je voudrai et ſera à mes ordres. Maintenant j’en jouis à mon aiſe et le contiens. Je veux cependant le tant exercer d’ici à dimanche, qu’il ne lui prenne pas fantaiſie de me faire aucune infidélité pendant les huit jours qu’il ſera à Verſailles pour ſa garde. Cela ſeroit un friand morceau pour quelques vieilles Ducheſſes, ou quelques paillardes de la cour. Le Comte ne ſe doute de rien. Amant, entreteneur, farfadet, je ſais les tromper tous, et faire croire à chacun qu’il poſſede ſeul mon cœur. Adieu.
Un jeune homme de ma connoiſſance,
ma bonne amie, qui le jour des
rois à ſoupé avec Mademoiſelle Saint-Leger, m’a raconté qu’ayant été reine
de la fève, elle fit cet impromptu.
Air : Dans ma cabane obſcure.
Du poids de ma fortune,
Je n’ai point à gémir :
Loin qu’elle m’importune,
Mon cœur ſait en jouir.
Oui, la grandeur ſuprême
A les plus doux attraits,
Quand on peut dire j’aime,
J’aime tous mes ſujets.
M. de Saint-Ange répondit auſſitôt à ce couplet par celui-ci.
Air : Philis demande ſon portrait.
Qu’une princeſſe dans ſa cour,
Regne par l’étiquette,
Par les talens et par l’amour,
Ici regne Minette,
Phœbus, du laurier des neuf ſœurs
A courronné ſa tête ;
Et l’amour lui ſoumet les cœurs,
Par le droit de conquête.
Pour moi le jour des rois, j’ai ſoupé tête-à-tête avec mon jeune auteur dramatique qui me donne une année d’entrée aux italiens. Elle commencera le dix de ce mois. S’il eſt auſſi bon auteur que fouteur il doit réuſſir. Je lui accorderai quelquefois mes bonnes grâces. Sept fois dans une nuit ne ſont rien pour lui. Adieu, je ſouhaite que tu trouves à Bordeaux un homme qui lui reſſemble.
J’AI été hier au bal de l’opéra. J’étois
miſe fort ſimplement, mais avec élégance.
Reneſſon m’accompagnoit.
J’avois ſur le viſage un petit loup[1]
de velours noir. Je fus agacée pendant
plus de deux heures par un étranger
qu’on m’a dit être un Polonois. Je
m’amuſai beaucoup de ſa maniere de
me faire la cour. Son air guindé à
vouloir contrefaire le petit-maître
françois me faiſoit rire. Enfin, après
m’avoir bien excédée, nous étant
perdus dans la foule, il me dit que,
ſi je voulois aller paſſer un quart
d’heure avec lui dans une loge grillée
dont il pouvoit diſpoſer, il me donneroit
cent louis en deux rouleaux
qu’il me fit voir. Je fis d’abord quelques
façons, puis je me laiſſai aller.
Imagine-toi que lorſque je fus rentrée
chez moi, et que je voulus ſerrer mon
argent, ayant défait les rouleaux,
je n’y ai trouvé que des jetons. Je
ſuis furieuſe contre cet étranger ; ſi
je le tenois, je lui arracherois les
yeux. Ah ! quel gueux ! Ce que je
crains, c’eſt qu’il n’aille publier cette
aventure, mais ce qui me tranquilliſe,
c’eſt qu’il ne me connoît pas ; cela
m’obligera à changer de déguiſement
quand je retournerai au bal de l’opéra.
Adieu, ma chere, penſe à ce qui m’eſt
arrivé, ſi on veut te donner des rouleaux,
et n’oublie pas de les défaire ;
pour moi, je n’y manquerai jamais.
Hier, ma bonne amie, mon vieux,
qu’il y a quelques jours que je n’avois
vu, eſt entré avec un air triſte. Je lui
demandai ce qu’il avoit, „ ah ! me dit-il
en ſoupirant, la mort de ma femme
a réduit ma fortune à moitié, et je
ſuis obligé d’aller vivre en province,
vous ſavez combien je vous aime,
voudriez-vous y venir avec moi. ”
Je ne puis tout de ſuite me décider,
répliquai-je auſſitôt, je vous demande
trois jours pour cela. Hé bien !
ſoit, mon cœur, me dit-il en m’embraſſant,
et me quitta pour aller
vaquer à ſes affaires qui ne lui laiſſent
gueres de tems libre. A peine étoit-il
parti que je lui écrivis cette lettre :
„ Malgré, Monſieur, tout l’attachement que j’ai pour vous, je ne puis me réſoudre d’aller enſevelir mes charmes dans la province. Le théâtre de la capitale eſt celui ſur lequel ils doivent briller. Croyez que quoique éloignée de vous j’y penſerai toujours et n’oublirai jamais les marques d’amitié que vous m’avez données ; croyez auſſi que je vous déſire tout le bonheur que vous méritez. Vous trouverez ſurement en province quelques jeunes filles qui s’empreſſeront à briguer l’avantage de vivre avec vous. Le libertinage a étendu ſon empire juſques dans les provinces. Je me flatte que quoique je ne conſente point à vous ſuivre hors la capitale, cela ne m’empêchera pas de vous voir juſqu’à votre départ. Je vous attends le premier moment que vous aurez à vous. Votre chere amie. ”
Dès que j’eus cacheté ma lettre, je l’envoyai par mon domeſtique et lui recommandai de la remettre lui-même à mon vieux, et de bien remarquer la figure qu’il feroit en la liſant. Il a bien fait ſa commiſſion et m’a rapporté que le vieux n’avoit pas eu l’air trop affecté et l’avoit chargé de me dire qu’il viendroit me voir dans quelques jours et me faiſoit bien des amitiés. Il me tarde de voir ce qu’il me dira. Adieu, ma bonne amie, je t’en ferai part. Tu devrois donner plus de détails ſur ta vie de Bordeaux. Je te mande exactement celle que je mene ici.
Avant-hier, ma chere amie,
il y avoit du monde à dîner chez
moi ; on y a raconté mon aventure
du bal. J’ai penſé rougir ; mais j’ai
fait bonne contenance. Ce qui me
faiſoit enrager, c’eſt que tout le
monde paroiſſoit enchanté de ce que
le Polonois avoit attrapé cette demoiſelle,
ſur laquelle on lâcha mille quolibets ;
il m’a fallu dire auſſi mon mot
comme les autres. Le Comte diſoit
qu’il donneroit dix louis pour la connoître,
qu’il iroit lui en faire ſon
compliment de condoléance. On a
enſuite parlé nouvelles ; on aſſure
que nous aurons la paix dans peu.
Tant mieux, car la plupart de nos
demoiſelles font une triſte figure. Au
deſſert, comme d’uſage, on a lu
quelques vers et chanté des chanſons.
Tu trouveras ci-inclus ce qui m’a paru
le plus amuſant. Les épigrammes ſurtout
ont été fort applaudies de nos
beaux eſprits, quoiqu’elles aient pu
très-aiſément s’appliquer à chacun
d’eux. Adieu.
Tout fier de quelques prix qu’au Louvre il remporta,
Du nombre des Quarante Argan ſe croit déjà.
Oui, j’en jure, dit-il, ſi la troupe immortelle
Ne m’a pas, à trente ans, au fauteuil inſtallé,
Je veux me brûler la cervelle.
Mes chers amis, c’eſt un cerveau brûlé.

Bas à quelqu’un, tout le long d’une allée,
Certain auteur ſa piece récitoit,
Dont l’autre ayant la cervelle troublée,
Bas contre lui de ſon côté peſtoit ;
Lorſqu’un paſſant, coupant leur promenade,
Au-devant d’eux fit un grand bâillement.
„ Paix, à l’auteur ſouffla ſon camarade,
Un peu plus bas ; cet homme vous entend. „
Chanson d’un homme de 50 ans, à
une jeune demoiselle, pour le jour de
ſa fête.
Air : Avec les jeux dans le village.
De ta fête, aimable Suzette,
Jadis j’eus mieux fait les honneurs ;
J’aurois pu te conter fleurette,
Je n’offre aujourd’hui que des fleurs ;
Le tems a, d’une main péſante,
Couvert mon front de cheveux gris,
Et toi, ſur ta tige élégante,
Comme une roſe tu fleuris.

Tu croiſſois à l’abri des vents,
Je diſois : elle ſera belle
Et la merveille de nos champs.
Mais maintenant ma douce envie
Eſt de voir hâter l’heureux jour,
Où cette fleur ſera cueillie
Et par l’hymen et par l’amour.
Je veux, ma chere amie, être la
premiere à t’apprendre la nouvelle
de la paix, elle eſt ſignée d’hier. On
l’a annoncée aux ſpectacles. J’en ſuis
au comble de la joie. J’aurai du plaiſir
à faire danſer des guinées. On dit
que c’eſt à M. le Comte de Vergennes
que nous devons la paix. Tiens, je
lui en ſais ſi bon gré, que s’il vouloit
je coucherois gratis avec lui, et
je te réponds que je n’épargnerois
rien pour le faire bander. A ſon âge
cela n’eſt ſouvent pas choſe aiſée.
Mais je me donnerois tant de peines
et j’y employerois tant de moyens
que j’y réuſſirois. Adieu, ma chere
amie, on m’annonce un jeune homme
de ma connoiſſance et je vais m’en
donner avec lui en l’honneur de la
paix. Tu vois que ton eſpiégle eſt
en 1783 comme il étoit en 1782. Je
te promets qu’il ſera toujours le même.
La paix eſt enfin ſignée d’hier ; j’en
ſuis au comble de la joie. On l’a
annoncée au ſpectacle. Le roi eſt venu
ce jour là aux François voir la premiere
repréſentation du roi Lear,
tragédie de M. Ducis, imitée de
Shakeſpear. Les acclamations du peuple,
qui ne ceſſoit de crier avec une
allégreſſe extrême, Vive le Roi, Vive
le Roi, lui ont aſſez témoigné la joie
qu’on reſſentoit de la paix. On fait
partout l’éloge de M. de Vergennes,
qu’on nomme le pacificateur de l’Europe.
Je ne te mande pas les conditions
de la paix, cela t’intéreſſe
fort peu. On dit qu’elles ſont très-avantageuſes
pour la France et pour
l’Eſpagne ; que l’orgueil des Anglois
eſt ; enfin rabattu et qu’ils ne ſe regarderont
plus comme les rois de la mer.
Quand les Milords le voudront, ils
le ſeront toujours des filles. Adieu.
Je t’écris ceci à la hâte et en raccourci
parce que j’ai un peu mal à
la tête et ſuis fatiguée d’avoir paſſé
une partie de la nuit à un bal bourgeois.
Je ſuis, ma bonne amie, d’une colere
affreuſe contre mon coquin de vieux.
Ah ! le ruſé, le chien, qui auroit pu
s’imaginer qu’il eut tant d’eſprit.
J’étouffe de rage. Tu ſais bien qu’il
m’avoit fait dire qu’il viendroit dans
quelques jours. Eh bien ! il eſt arrivé
ce matin dans un ſuperbe équipage
et après m’avoir fait beaucoup de
fauſſes amitiés, il m’a engagé d’aller
avec lui ſous prétexte de lui dire mon
avis ſur un appartement qu’il faiſoit
meubler pour paſſer le reſte de l’hiver
à Paris, ne voulant le quitter qu’au
printems. J’y ai conſenti et auſſitôt
prenant un deshabillé et ma péliſſe
je ſuis parti dans ſa voiture. Arrivé
à la chauſſée d’Antin, il m’a fait
monter dans un ſuperbe appartement
meublé avec tout le goût poſſible et
où rien ne manquoit. Après avoir
tout examiné, comme nous allions
nous en aller, il me pria d’entrer
dans la loge du portier et de l’y
attendre un moment ayant à faire
une viſite au bout de la rue, et me
donnant un papier, tenez, voilà une
pièce de vers qui paroît d’hier, liſez
la, cela vous amuſera en m’attendant
et auſſitôt il monte en voiture. La
prétendue pièce de vers étoit cette
lettre.
„ Devenu, Mademoiſelle, par la mort de ma femme poſſeſſeur d’une grande fortune. Je voulois vous la faire partager, mais avant il m’a pris envie de vous éprouver. C’eſt pour cela que je vous ai propoſé, de venir vivre en province avec moi ; votre lettre m’a appris à vous connoître, l’appartement que vous venez de voir eſt pour celle qui vous remplacera. Je déſire que vos charmes brillent ſur le théâtre de la capitale. Mais ils ſeront en concurrence avec tant d’autres qu’ils pourront être éclipſés. Vous pouvez, Mademoiſelle, après avoir lu cette lettre, vous en aller chez vous, où je ne remettrai le pied de la vie. Votre ancienne dupe. ”
Quoi que je fuſſe outrée de cette lettre je cachai mon dépit et un moment après j’envoyai chercher un fiacre diſant que Monſieur tardoit trop à venir me reprendre et que j’avois affaire chez moi. O ! tiens ma bonne amie, je ne me poſſède pas. Moi avoir été jouée par un homme. Quel affront ! je m’en vengerai ſurement.
Je ne t’écris qu’un mot pour t’envoyer
une chanſon ſur la paix, et te
mander que depuis trois jours je ſuis
obligée de garder le lit pour une perte
qui m’eſt ſurvenue de m’en être trop
donné avec mon farfadet au retour
de ſa garde, dans un tems où j’aurois
dû être ſage. Je fais paſſer cela vis-à-vis
du Comte pour avoir trop danſé
au bal bourgeois. Mon chirurgien
appuie là-deſſus, en diſant que les
femmes devroient reſter tranquilles
dans ces ſortes de tems et ne pas
ſe remuer. J’enrage de ma ſituation
qui me réduit à la continence au
moins pendant dix jours. On me fait
prendre des demi-bains, et l’on me
fait des embrocations d’huile roſat
ſur le ventre. Je ſuis à la diete et obligée de boire des tiſanes. Au diable
la maladie, elle m’ennuie furieuſement.
Adieu. Il faut que j’entre dans
le bain. Ton amie pour la vie. Je ne
te ſouhaite pas un état pareil au mien.
La paix eſt donc certaine :
Chantons tous le ſage Vergennes.
Sur les bords de la Seine
Nous faut la publier.

Et ne pas oublier
Que le ſage Vergennes
Chantons, etc.
Nous donne cette étrenne
Qu’on ne ſauroit payer.

Qu’on ne ſauroit payer.
Ceinte de l’olivier,
Sa tête vaſte et pleine,
Chantons, etc.
Vient de briſer la chaîne

Nous allons commercer
Sans contrainte et ſans gêne :
Chantons, etc.
Deſſus l’humide plaine
Nous pourrons naviguer.

Et quand le Marinier,
Qu’un meilleur ſort ramene,
Chantons, etc.
Viendra reprendre haleine
Au ſein de ſes foyers.

Au ſein de ſes foyers,
Couronné de lauriers,
Sa femme en ſera vaine :
Chantons, etc.
Il contera la ſcene
De ſes exploits guerriers.

Puis du vin du celliers
Buvant à taſſe pleine :
Chantons, etc.
Enfans, parens, Marraine
Et le Ménétrier.

Crieront à plein goſier :
Vive le Roi, la Reine,
Le Dauphin, le ſage Vergennes !
Que le Ciel les maintienne
En joie un ſiecle entier.

Depuis, ma chere amie, que je
ſuis ma maîtreſſe je vas ſouvant aux
ſpectacles. J’ai été aux François voir
l’Anglois à Bordeaux qu’on a joué à
cauſe de la paix. C’eſt une piece charmante
qui eſt de Favart pere ; il eſt
dommage qu’il n’ait donné que cette
piece aux François.
Pariſſeau, l’ancien directeur des éléves de l’opéra, vient de donner une charmante petite piece aux italiens, elle a été jouée le 24. C’eſt le bouquet et les étrennes, dont le ſujet eſt tiré d’un conte de M. Imbert. Elle a été fort applaudie. Mais ce ſont de ces pièces qui n’ont qu’un moment.
Hier j’ai été au bal de l’opéra ; il y avoit une heure que j’y étois lorſque je fus attaquée par un charmant petit maſque. Mais en vain je cherchai à le reconnoître. A la fin il me dit comment vous ne reconnoiſſez pas la petite Cécile, et auſſitôt m’entraînant dans un coin de la ſalle elle m’a conté qu’au bout d’un mois qu’elle étoit chez la Comteſſe, Monſieur de M***, fermier général, l’en avoit retirée et l’avoit miſe dans ſes meubles et lui donnoit un caroſſe de remiſe au mois. Elle m’a priée d’excuſer ſi elle n’étoit pas encore venue me voir, mais elle en a rejetté la faute ſur ce qu’elle étoit fort occupée à apprendre la muſique et à jouer de la harpe. Elle m’a fort engagée à aller dîner chez elle. Elle n’a eu de ceſſe que je n’aie accepté. J’y vas dimanche, elle m’enverra ſa voiture me chercher. Elle loge à la chauſſée d’Antin et à changé de nom, elle s’appelle maintenant Olympie.
Perſonne n’a encore remplacé le vieux qui a maintenant la petite Roſette. Comme les étrangers abondent ici, je vais tâcher d’en ſubjuguer un. Adieu, écris moi donc, tu es d’une pareſſe inſuportable.
Le Comte m’obſede, ma chere amie,
à force de ſoins ; il ne me quitte
preſque pas. Je ne puis voir ni mon
amant, ni mon farfadet. Pour me diſtraire,
il s’occupe à me lire mille
jolies choſes, entr’autres un nouveau
recueil de pièces choiſies. Je l’ai prié
de m’en copier pluſieurs que je t’envoye
ci-jointes.
On dit qu’il arrive déjà beaucoup d’Anglois ; je déſirerois bien que la paix te ramene à Paris ; il y a bien long-tems que je ne t’ai vue, j’aurois bien du plaiſir à t’embraſſer encore. Je te dirai pour toute nouvelle qu’on a volé la montre à Reneſſon au dernier bal de l’Opéra ; elle a été en faire ſa déclaration à la Police et, fort heureuſement pour elle, le filou ayant été arrêté le lendemain, ſa montre lui a été rendue ; elle en a été quitte pour la peur. On m’annonce mon Médecin, je quitte la plume, je la reprendrai dès qu’il ſera ſorti.
Demain, ma chere amie, je pourrai me lever, mais il faudra reſter ſur ma chaiſe longue. De huit ou dix jours, je ne pourrai monter en voiture, et mon Médecin m’a dit qu’il falloit que je force le Comte à être ſage encore douze jours au moins ; cela me déſole. Je crains qu’on ne m’enleve mon farfadet pendant ce tems-là, mais pour me le conſerver, je ferai uſage de mes mains. Le Comte eſt obligé d’aller à Verſailles pour un jour ou deux, je le verrai tout à mon aiſe en ſon abſence. Tu vois l’ordre et l’arrangement que j’ai dans mes affaires, ſi tu m’en crois, tu imiteras ta chere Julie.
Un Cordélier avoit un jour prêché
Un beau ſermon contre l’intempérance,
Et déployé toute ſon éloquence,
Pour démontrer que c’eſt un grand péché.
Un auditeur qui ſe ſentit touché,
Court s’accuſer d’un peu de gourmandiſe.
Dans la cellule, il voit la nappe miſe,
Et de Champagne un flacon débouché,
Plus, deux perdrix, une rouge, une griſe ;
On peut juger quelle fut ſa ſurpriſe.
Par mon ſermon, je vous ai convaincu,
Dit le Pater ; mais l’habitude eſt priſe,
Et c’eſt ainſi que j’ai toujours vécu.
Diſpenſez-vous d’un conſeil inutile :
Tout ce que j’ai prêché pour un écu,
Pas ne voudrois le faire pour cent mille.
La jeune Eglé, quoique très-peu cruelle,
D’honnêteté veut avoir le renom ;
Prudes, pédans vont travailler chez elle
A réparer ſa réputation.
Là, le jour, le cercle miſantrope
Avec Eglé, médit, fronde l’amour :
Hélas ! Eglé, ſemblable à Pénélope,
Défait la nuit tout l’ouvrage du jour.
Jurer de n’aimer que Julie
Et tenir ce qu’on a promis,
C’eſt vouloir s’amuſer deux nuits,
Pour s’ennuyer toute ſa vie.
Grand Jupiter ! diſoit dans ſon émoi
Une Brebis au maître du tonnerre,
Las ! tout ce qui peuple la terre,
De tous les tems, s’eſt ligué contre moi.
J’ai beaucoup à ſouffrir ; chacun me fait la guerre.
Le Dieu l’entendit
Et lui dit :
Pauvre chétive créature,
Il eſt trop vrai, je conviens de mon tort ;
De tant d’êtres divers en peuplant la nature,
J’oubliai qu’un arrêt du ſort
Soumettoit tout à la loi du plus fort,
Et toi ſeule n’as rien pour repouſſer l’offenſe.
De griffes, ſi tu veux, je vais armer tes pieds ;
Ta bouche va t’offrir une belle défenſe. —
Avec les animaux cruels et carnaſſiers
Je ne veux pas de reſſemblance,
Dit la Brebis. — Aimes-tu mieux
Que ſous tes dents un poiſon — Ah ! grands Dieux. !
On les hait trop, ces bêtes venimeuſes.
— Eh bien, je vais parer ton front
De deux cornes majeſtueuſes,
Et de ton cou les forces s’accroîtront. —
Non, mon pere, non, non, l’offre eſt trop dangereuſe,
Je deviendrois peut-être querelleuſe.
— Mais ta raiſon eſt en défaut,
Répond Jupin, c’eſt une regle admiſe,
Si tu ne veux pas qu’on te nuiſe,
Il faut pouvoir nuire. — Il le faut,
Répond en pleurant la pauvrete ?
Laiſſez-moi donc comme vous m’avez faite.
A mes ennemis furieux
Je ne prétends plus me ſouſtraire ;
Je ſubirai mon ſort, et j’aime mieux
Souffrir bien du mal que d’en faire.
Oui, ſous votre pinceau, je vois tout s’animer ;
Vos papillons, Iris, ſont ceux de la nature,
Et vous avez trop bien le ſecret de charmer
Pour en faire jamais autrement qu’en peinture.
Nicodême, fils d’imprimeur,
Et Suſon, fille de Libraire,
S’éprirent d’une folle ardeur,
Sans pourtant ſonger à mal faire.
Amour fit un jour au duo
Eſſayer du baiſer la volupté ſuprême,
Si que la paſſion du pauvre Nicodême,
D’in-ſeize qu’elle étoit, devint in-folio.
Leurs quatre levres toutes neuves,
Du premier choc trouverent le plaiſir ;
Tant eſt vrai qu’on fait bien quand on cede au déſir,
Tant eſt vrai qu’en baiſant n’eſt pas beſoin d’épreuves.
Or Nicodême auſſitôt s’en alla :
„ Ah ! dit la fille du Libraire,
Le ſot Imprimeur que voilà !
Peut-il attrapper la maniere
D’un baiſer comme celui-là,
Et n’en tirer qu’un exemplaire ?
Maudits ſoient grilles et verroux,
Avec eux les maris jaloux,
Et toute prude ſurveillante !
Liſe toujours eſt chez ſa tante :
J’y vais, dans un fauteuil, à l’aiſe au coin du feu,
Doucement la tante ſommeille.
Voyant cela, Liſe à l’oreille
Me dit : enfin, Damis, je te dois un aveu ;
Oui, pour jamais mon tendre cœur t’adore.
Depuis long-tems auſſi, même ardeur me dévore,
Lui dis-je à demi-voix ;
Ah ! ſi nous n’étions deux, que ſerions-nous, ma chere ?
Elle ſaiſit ma main, contre ſon ſein la ſerre,
Et répond ſeulement : hélas ! nous ſommes trois.
et les yeux bleus.
Un jour les beaux yeux noirs, aux vives étincelles,
Et les bleus aux regards doux, tendres et mourans,
(Jamais plus grand objet n’intéreſſa les belles)
Voulurent à la fin terminer leurs querelles,
Et que l’amour fixât leurs rangs.
Au Juge de Cythere ils préſentent requête ;
Ils plaident : mes amis, c’eſt bien en pareil cas
Qu’il eſt charmant de voir plaider les Avocats.
L’amour en bonne et grave tête,
Sur la foi des baiſers, integres rapporteurs,
Mit ainſi d’accord les plaideurs :
Les yeux noirs ſavent mieux briller dans une fête,
Les bleus ſont plus touchans à l’heure du berger ;
Les yeux noirs ſavent mieux conquérir, ravager,
Les bleus gardent mieux leur conquête ;
Les noirs prouvent un cœur plus vif, mais plus léger,
Les bleus un cœur plus tendre et moins prompt à changer ;
Les noirs lancent mes traits, les bleus ma douce flâme ;
Les noirs peignent l’eſprit et les bleus peignent l’âme.
A juger des beaux yeux l’Amour riſqua les ſiens ;
Une belle aux yeux noirs eût pu venger ſa cauſe.
Même par ce récit je ſais que je m’expoſe ;
Mais vos yeux indulgens protégeront les miens.
Tu dois, mon cœur, m’avoir cru
morte ne t’ayant pas écrit depuis plus
de ſix ſemaines. Hélas ! ce n’eſt pas
de ma faute. Tu ſais que je t’avois
mandé que j’irois à la meſſe de minuit.
Eh bien ! j’y ai été il m’en ſouviendra
long-tems. On m’y a volé
une montre d’or de quinze louis, et
j’ai gagné une ſuppreſſion, qui m’a
miſe à deux doigts du tombeau. Je
ſuis encore d’une foibleſſe extrême
et ma figure eſt à faire peur. Je ne
pourrai me montrer de plus de quinze
jours ; ſi je ne trouve quelque Anglois
pour payer les frais de ma maladie
et réparer mon tems de non-valeur[2],
je ſuis écraſée. Adieu,
mon cœur, je n’ai pas la force de
m’entretenir plus long-tems avec toi.
Tu ſauras, ma chere amie, que le
Marquis de *** vivoit depuis trois
mois avec la belle Sainte-Marie. S’étant
douté qu’elle lui faiſoit des
infidélités pendant les fréquens voyages
qu’il étoit obligé de faire à la cour,
il l’a fait épier. On lui a rapporté que
l’Evêque de ** le remplaçoit ſouvent
dans le lit de la belle. Piqué de cet
affront, il réſolut de s’en venger
avantageuſement. En conſéquence il
prétexta un voyage de pluſieurs
jours. Le Prélat ayant été informé
de l’abſence du Marquis, ne manqua
pas, ſelon ſa coutume, de ſe
rendre chez Sainte-Marie. Le Marquis
vient au milieu de la nuit, et
comme il avoit un paſſe-partout, il
entre ſans être apperçu. Arrivé près
du lit, il en tire les rideaux et fait
l’étonné en reconnoiſſant Monſeigneur.
Soyez le bien venu ici, lui
dit-il ; mais, en vérité, il n’eſt pas
juſte que je paye vos plaiſirs. Il y a
trois mois, Monſeigneur, que je vis
avec mademoiſelle, elle me coûte
quinze mille livres, il faut que vous
me les rendiez, ou j’envoye chercher
la garde pour vous arrêter et vous
reconduire chez vous. Monſeigneur
voulut compoſer, mais il n’y eut pas
moyen de reculer. Il donna ce qu’il
avoit ſur lui et fit un billet du reſte
payable le lendemain. Le Marquis tirant
les rideaux leur ſouhaita une
bonne nuit, et dit à Monſeigneur
qu’il lui cédoit tous ſes droits ſur la
belle. Le billet ayant été acquitté le
lendemain, le Marquis n’eut rien de
plus preſſé que de publier ſon aventure,
qui fait aujourd’hui la nouvelle
du jour. Monſeigneur en eſt plus déſolé
que de l’argent que cela lui
coûte ; on croit qu’il ſera obligé d’aller
faire un tour à ſon dioceſe.
Ma ſanté va toujours mieux. Demain je monterai en voiture pour la premiere fois. Adieu.
Depuis que je peux monter en voiture,
je me ſuis un peu dédommagée
du tems que j’ai gardé la chambre.
J’ai été à tous les ſpectacles, et ce
ſoir je vais au bal de l’Opéra. Mais
je ſuis obligée d’avoir beaucoup de
ménagemens pour l’amoureuſe jouiſſance ;
j’en enrage ainſi que mon farfadet
et mon amant à qui je rends
de petits ſervices pour éviter les infidélités.
Cela les calme un peu ; mais
ce jeu ne fait qu’irriter mes déſirs,
en voyant dans ma main le fruit défendu
ſans en pouvoir goûter.
Les Anglois arrivent en foule. L’intrigant S*** qui eſt au fait de tout cela, m’a aſſuré qu’il y en avoit plus de ſoixante à Paris. Il va tâcher de ſe placer pour interprete auprès de quelqu’un ; il m’a propoſé de me faire faire avec eux quelques paſſades[3]. J’y ai conſenti, pourvu qu’elles ſoient au moins de cent louis. Nous ſommes convenus qu’il en auroit le quart, et que ſon appartement ſeroit le lieu de nos rendez-vous et le théâtre de mes ſecrets ébats. Rien n’eſt plus commode que ſon logement pour ces ſortes d’intrigues ; il demeure dans le paſſage du Commerce, qui, comme tu ſais, a trois iſſues ; on peut entrer ou ſortir alternativement par l’une ou par l’autre, ſans crainte même du ſoupçon. Je crois, ma chere amie, que ſi tu étois ici, tu ferois bien tes affaires. Tu as une jolie figure, et tu ſais amorcer tes amans. Adieu. Je vais voir comment je me maſquerai ce ſoir pour que le Polonois ne puiſſe pas me reconnoître. Je ſuis fâchée de ne pouvoir m’en venger, je le ferois avec bien du plaiſir ; mais ce qui me conſole, c’eſt que mon hiſtoire étant ſue, il ne trouvera plus de dupes. Porte-toi bien.
J’ai dîné chez Olimpie le jour que
je t’ai mandé, elle m’a reçue le plus
amicalement du monde, et m’a donné
une jolie montre ; ce qui augmente
ſon prix eſt la maniere dont
elle m’a fait ce préſent. En arrivant
elle s’eſt plainte de ce que je venois
bien tard, et m’a dit : ſurement
votre montre va mal. Tenez, ma chere
Victorine, faites-moi le plaiſir d’accepter
celle-ci ; jamais elle ne marquera d’heure
que je ne penſe que c’eſt à vous que je
dois mon bonheur. Le dîner a été des
plus gais. Le ſoir nous avons été à
l’Opéra où elle a une petite loge.
Son financier y eſt venu ; il m’a fait
toutes ſortes d’honnêtetés. Après le
ſpectacle elle m’a ramenée chez moi,
en exigeant que je lui promiſſe que
j’irois la voir ſouvent. Je ne te ferai
pas les détails de tout ce qu’elle a.
Je me contenterai de te dire qu’elle
eſt ſuperbement meublée, et que ſa
garderobe eſt de porcelaine. Il y a
des perſonnes bien heureuſes dans
notre état. Adieu, ma bonne amie.
J’ai été, ma chere amie, au bal
Jeudi et Dimanche dernier, où je me
ſuis bien amuſée. J’étois Jeudi avec
ma femme de chambre, et le Dimanche
avec mon farfadet que j’avois
habillé en femme, comme il a la peau
très-blanche et n’a pas encore de
barbe, mes ajuſtemens lui vont à
merveilles. Le Comte a paru fort
intrigué de ſavoir avec qui j’étois,
je lui ai dit que c’étoit une nouvelle
connoiſſance que je lui préſenterois
au premier jour, il s’en eſt contenté.
Après le bal, j’ai amené mon farfadet
chez moi, et lui ai donné mes prémices
depuis ma maladie ; mais je
ne l’ai pas laiſſé en prendre à ſa fantaiſie,
parce qu’on m’a recommandé
beaucoup de modération ſur cet article.
D’avoir été quelque tems ſage,
cela ne m’a pas fait de mal ; j’ai mieux
ſenti le plaiſir. Demain le Comte aura
ſon tour, c’eſt choſe convenue avec
le médecin. Adieu, je te ſouhaite
joie et ſanté.
Mardi dernier, ma bonne amie,
j’étois allée aux italiens, pour voir la
premiere repréſentation de Sophie de Francour.
On avoit joué les deux
premiers actes lorſqu’après un aſſez
longue interval, M. Granger vint prier
d’attendre quelques inſtants parce que
Mademoiſelle Pitrot s’étoit évanouie.
Au bout d’un quart d’heure le même
acteur revint dire que l’état de Mademoiſelle
Pitrot ne lui permettant pas
de continuer ſon rôle, on prioit d’accepter
au lieu de la piece nouvelle,
l’Officieux ou les deux Jumeaux, on a
demandé que quelqu’un lut le rôle
ne voulant pas d’autre ſpectacle. On
a baiſſé le rideau qui s’eſt rélevé après
une demie heure et Carlin s’eſt préſenté.
On a crié de nouveau que
quelqu’un lût le rôle, qu’on vouloit la
nouvelle piece. Enfin Carlin à force
de Lazis avec leſquels il a harangué
le public, eſt parvenu à faire faire
ſilence, et l’on a joué les deux Jumeaux.
Tu verras inceſſamment le chevalier de S***, il va à Bordeaux pour un procès. Je lui ai promis de te le recommander. Tu peux en tirer parti. Mais je te préviens qu’il a la manie du ſentiment et n’aime pas qu’on lui demande. Quand il a le cœur pris, il ne s’agit que de montrer des déſirs pour qu’il les ſatisfaſſe. Je l’ai eu pendant quelque tems. Il m’a quittée lorſqu’il fut rejoindre ſon régiment. A ſon retour la place étoit priſe. Il me voit comme une ancienne connoiſſance. Quelques-fois il a mes faveurs. Il les paye bien. C’eſt un bon pigeonneau. Tu vois que je penſe à toi, crois que je te ſerai attachée pour la vie.
Je crains d’avoir fait une imprudence
en menant mon farfadet au bal de
l’opéra déguiſé en femme. Le Comte
m’a parlé pluſieurs fois de ma nouvelle
amie ; il a eu l’air de me railler et
dit qu’il ſeroit enchanté de la connoître.
Il me bat un peu froid, cela
m’inquiete, quoique ſur le pied où
je ſuis, j’aurai bientôt trouvé quelqu’un
qui briguera l’honneur de ſe
ruiner avec moi. Nous ſommes, ma
chere amie, des effets commerçables,
et nous augmentons de valeur
à proportion que nous changeons de
main. Au reſte, arrive ce qui pourra,
je ne ſerai pas embarraſſée ; il y a
déjà ici beaucoup d’étrangers, et il
en arrivera ſurement encore ; ainſi
là-deſſus, point d’inquietude. Adieu,
chere amie, il faut pourtant convenir
que la vie eſt remplie de bien
des traverſes.
Je ſors depuis quelques jours, mon
cœur, et ce ſoir je vas au bal de
l’opéra. Il eſt arrivé une plaiſante
aventure à celui de dimanche dernier
à un de nos agréables. Le Marquis
de P***, pourſuivoit depuis plusieurs
bals une jolie femme qui ſe
maſquoit toujours avec un domino roſe
et un maſque noir. Violette, qui
comme tu ſais, eſt un eſpiégle, s’en
étant apperçue, et ayant remarqué
qu’elle avoit même taille et même
tournure que cette dame, elle réſolut
d’attrapper le Marquis. En conſéquence
dimanche dernier elle ſe maſque
comme la dame et ſe rend des
premieres au bal. Il y avoit une heure
qu’elle y étoit lorſque le Marquis
arriva. Dès qu’il l’eut apperçue, la
prenant pour ſa dulcinée, il l’aborde
avec le plus grand empreſſement, et
la prie en grace de céder à ſon violent
amour. Enfin Violette conſent et le
Marquis la mene dans une petite loge
dont il avoit la clef. Envain il chercha
à devenir heureux, jamais il ne lui
fut poſſible. Violette ennuiée ſe demaſqua
et lui dit, en partant d’un grand
éclat de rire, ah ! Marquis j’ai cru vous
tromper, mais c’eſt moi qui la ſuis. Le
Marquis voulut ſe fâcher, mais il ſe
radoucit bien vîte et finit par prier
Violette de garder le ſecret ſur cette
aventure. Elle lui jura que non, et
tint parole, car elle la conta à toutes
ſes connoiſſances, et en moins d’une
demie heure tout ce qui étoit au bal
ſavoit l’hiſtoire. Adieu, mon cœur.
Le Comte a toujours beaucoup de
froid vis-à-vis de moi. Je n’ai plus le
même empire ſur lui ; j’ai voulu bouder,
il m’a laiſſée là. Je vois qu’il faut
que je me montre ſouvent en public
pour trouver quelqu’un qui le remplace.
J’ai écris à S*** pour lui en
faire part ; il m’a répondu qu’il falloit
prendre patience et ne m’inquiéter
de rien. Le Comte dit qu’il va paſſer
quelques jours à Verſailles. Eſt-ce un
prétexte ? Ai-je mon congé ? Je voudrois
tout de ſuite ſavoir à quoi m’en
tenir. Les jours gras ſeront bien triſtes
pour moi ; j’avois cependant eſpéré
de les paſſer gaiement. Ah ! qu’une
imprudence fait de tort ! mais hélas !
a-t-on toujours le pouvoir de réfléchir ?
Je vais eſſayer de faire la malade ;
ſi cela ne ramene pas le Comte, il
n’y faudra plus compter. Adieu, ma
chere amie, j’ai bien du chagrin.
Jeudi dernier, mon cœur, j’ai fait
au bal de l’opéra la conquête d’un
Anglois qui m’eſt venu voir le lendemain.
Il avoit ſu mon nom et mon
adreſſe par ſon domeſtique de louage
qui m’a fait ſuivre. Il eſt fort aimable
et très-jeune. J’aurois envie de le faire
un peu ſoupirer. Mais comme je
craindrai de le perdre, je borne le
tems de ſes ſouffrances juſqu’à demain
au ſoir au retour du bal de l’opéra
où il doit me mener. Je ne veux pas
faire de marché avec lui, il a l’air
d’un homme qu’il faut prendre par
le ſentiment. Tu avoueras que mes
premieres ſorties ſont fort heureuſes.
Adieu, mon cœur, je te manderai
dès qu’il y aura eu quelque choſe
avec l’Anglois. Je ſais l’intérêt que tu
prends à moi. Crois que je te paye
bien de retour et qu’il ne t’arrivera
jamais autant de bonheur que je t’en
ſouhaite.
MA feinte maladie n’a ſervi de
rien ; le Comte eſt parti pour Verſailles
en me diſant d’un air moqueur que
je n’avois qu’à envoyer chercher ma
nouvelle amie, qu’elle me tiendroit
ſurement bonne et fidelle compagnie.
J’enrageois. Je lui ai ponctuellement
obéi ; car à peine a-t-il été parti,
que j’ai mandé à mon farfadet de venir.
Je vais bien employer mes momens
avec lui, et cela me calmera un peu,
car je ſuis en colere et d’une humeur affreuſe. Je veux cependant aller ce
ſoir au bal de l’opéra ; le Comte étant
abſent, farfadet me donnera le bras.
Je crains que le Comte n’ait été inſtruit de ma conduite par un domeſtique que j’ai renvoyé il y a un mois. Je conviens que j’ai eu tort de le mettre à la porte, mais c’étoit un inſolent.
En feuilletant pluſieurs papiers, j’ai trouvé quelques vers que j’avois fait copier par le Comte pour te les envoyer, je les joins à ma lettre. Si le Comte me quitte, plus de poéſie. Adieu, chere amie ; que l’incertitude ſur ſon ſort eſt cruelle.
Alain diſoit : ma femme, écoute-moi.
Je t’avouerai qu’avant que d’être à toi,
Bien jeune encor, je fis une folie ;
J’eus une fille : elle eſt, ma foi, jolie.
Prends-là chez nous, faute de nourriſſon ;
Je veux de toi qu’elle prenne leçon ;
Tu l’aimeras, car elle te reſſemble.
Et moi, j’ai fait, dit-elle, un beau garçon ;
Il nous faudra les marier enſemble.
La faim preſſoit ta femme, elle a dîné ſans toi,
Damon, je ne vois pas de quoi
Gronder comme tu fais, et faire tant de gloſes.
Dîner ſans ſon époux eſt-ce un ſi grand péché ?
Ta femme a fait ſans toi de plus étranges choſes
Dont tu ne t’es pas tant fâché.
De cette nuit, mon cœur, l’Anglois
a pris poſſeſſion de mes charmes. Il
eſt un vigoureux compere et m’a fort
contentée de tous les côtés ; car ce
matin en ſortant il a laiſſé cent louis
ſur ma toilette. Il eſt très-paſſionné
et m’a aſſuré qu’il n’auroit que moi
pour maîtreſſe. Il eſt impoſſible de
t’exprimer mon contentement. Plaiſir
et richeſſe en même tems. C’eſt une choſe
unique et qui n’arrive qu’une fois
dans la vie. Je vais bien en profiter,
et je veux après mon Anglois pouvoir
me retirer du métier ſi j’en ai envie.
Il m’a dit qu’il vouloit que je courre
avec lui tout Paris et les environs
qu’il veut voir. Il a pour cela acheté
un livre qui enſeigne les endroits
curieux ; cela m’amuſera. Je finis,
mon cœur, l’Anglois entre.
Tu dois avoir été inquiéte, chere
amie, de ce que je ne t’ai pas écrit
depuis plus de quinze jours ; c’eſt
que j’ai été fort occupée avec le
Comte. A ſon retour de Verſailles,
je l’avois un peu ramené, je croyois
le tenir de nouveau dans mes filets,
quand une nouvelle imprudence à
achevé de me perdre totalement dans
ſon eſprit. Je n’attendois pas le Comte,
et j’étois avec mon farfadet, toute
nue et lui de même, lorſqu’arrivant
ſubitement, il nous ſurprit dans cette
attitude, et s’en eſt allé ſans dire un
ſeul mot, et voici la lettre qu’il m’a
écrite un quart d’heure après.
Ma maniere d’agir avec vous et l’honnêteté de mes procédés auroient dû me gagner votre amitié et méritoient au moins que vous me fuſſiez fidelle. Je vois que vous êtes comme toutes vos ſemblables, et que celui qui paye n’eſt jamais l’amant du cœur. Je vous ſouhaite beaucoup de plaiſir avec le jeune homme que j’ai ſurpris chez vous. Je vous laiſſe maintenant libre de faire ce que vous voudrez ; j’exige ſeulement que vous faſſiez ôter mon portrait de deſſus votre bracelet, et me le faſſiez tenir par le porteur ; il n’eſt pas fait pour reſter entre les mains d’une perſonne qui a ſi cruellement offenſé l’original. Je vois bien à préſent que tout ce que la Jeuneſſe m’a dit eſt vrai. Je n’avois pas voulu le croire, vos feintes careſſes m’avoient ſéduit. Il faut être bien fou de s’attacher à de pareilles créatures ! Je vous conſeille, ſi vous trouvez encore quelque dupe, de mieux prendre vos précautions et de ne pas vous laiſſer ſurprendre.
Il m’eſt impoſſible, cher Comte, de pallier mes torts. Ne me pardonnerez-vous pas ce moment de foibleſſe ? Faut-il que je perde le meilleur des hommes pour une erreur ? Je ne chercherai pas à réfuter les propos de la Jeuneſſe ; mais pouvez-vous écouter ce que dit un laquais qu’on renvoye et que l’humeur fait parler ? Revenez, cher Comte, que je me jette à vos genoux et que j’obtienne mon pardon. Je vous jure une fidélité à toute épreuve. Comment pouvez-vous appeller les marques de mon amitié de feintes careſſes ? Ah ! ingrat, c’étoient bien les expreſſions du cœur. Quoi ! vous voulez que je rende le portrait d’un homme que j’aime et à qui je dois tant ? Demandez plutôt ma vie. Oui, je le garderai, et l’arroſerai de mes larmes. Ah ! Comte, venez, ou vous me cauſerez la mort. Hélas ! mon repentir mérite grace.
la plus déſolée
et la plus punie des
femmes.
J’en reçus le billet ſuivant.
Puiſque mon portrait peut vous intéreſſer encore, gardez-le ; mais ne comptez plus ſur l’original. Quand une fois j’ai pris mon parti ; tout eſt dit. Je vous ſouhaite beaucoup de bonheur et de proſpérité.
Tu vois, ma chere, que c’eſt une affaire terminée et que j’ai mon congé dans les formes. Tant mieux, je ſuis charmée de ſavoir mon ſort et que cela n’ait pas lambiné. J’irai ce ſoir aux François, et demain à l’opéra ; il faut bien tâcher de trouver quelqu’un qui faſſe aller la maiſon. Je ne veux pas cependant me donner au premier venu. S*** m’aidera beaucoup dans cette circonſtance. Je crois que je ne prendrai pas de François ; il me faut un Milord, ou bien un jeune homme qui ait hérité fraîchement de quelque vieil avare, et ſoit empreſſé à faire danſer les eſpeces du défunt. Adieu.
Il y a deux jours, ma bonne amie,
que l’Abbé Chatar m’eſt venu propoſer
un Ruſſe pour entreteneur ; j’y ai
conſenti. Hier il m’a donné à ſouper
avec lui, et le marché a été conclu
à cinquante louis par mois, le Ruſſe
a payé le premier d’avance, et eſt
entré en jouiſſance de cette nuit.
Sa froideur ſe reſſent du climat de
ſon pays. Je crois qu’il m’a priſe plutôt
par air, pour pouvoir dire : j’entretiens
Mademoiſelle Victorine. Les beſoins
phyſiques ont l’air peu conſidérables
chez lui. Cela m’eſt égal, je ſaurai
trouver des perſonnes qui feront l’office
en ſa place. L’Abbé Chatar à
été raiſonnable, il ne m’a demandé
que trente louis pour la connoiſſance
du Ruſſe ; ſurement il ſe ſera auſſi
fait payer par lui. Ces Meſſieurs
prennent de toutes mains. Adieu, ma
bonne amie, maintenant je ne regrette
plus le vieux, et vais l’oublier.
Il y a eu le 25 une courſe de chevaux
anglois de la barriere de la conférence
à la grille du château de
Verſailles. Le cheval de M. le Chevalier
de Saint-Georges a gagné ; il a
fait le chemin en 31 minutes : il y
a cependant près de quatre lieues.
C’eſt bien fort.
Je n’ai encore perſonne. Il s’eſt préſenté différens partis, mais cela n’eſt pas du coſſu. Je me ſuis contentée de faire deux paſſades. J’ai maintenant mes coudées franches ſur cet article. Mon farfadet a été plus déſolé que moi de l’aventure du Comte. C’eſt un bon diable ; il eſt bien fâché de ne pouvoir rien me donner ; il a peu de ſes parens pour ſes menus plaiſirs.
Voici un petit conte qui m’a paru plaiſant, ce ſera à peu près les derniers vers que tu recevras de moi. Adieu, ma chere Eulalie, je ne ſuis pas mécontente de la vie libre que je mene ; elle m’amuſe aſſez.
Certain prêcheur, par ſa longueur extrême,
Laſſa les gens : l’auditoire s’endort ;
On ſe réveille, on voit qu’il n’eſt encor
Qu’au premier point ; on étoit en carême :
On veut dîner, on défile et l’on ſort.
Le ſacriſtain reſte et ſe réconforte ;
Il boit un coup, mange du pain beni,
Puis va chercher les clefs et les apporte :
Il faut, dit-il, mon pere, que je ſorte ;
Voici les clefs : quand vous aurez fini,
Vous voudrez bien fermer la porte.
- ↑ C’eſt un petit maſque qui ne couvre que les yeux et le nez, qui n’a point de mentonniere.
- ↑ C’eſt ainſi que les Demoiſelles appellent le tems où elles ne gagnent point d’argent.
- ↑ C’eſt ainſi que les demoiſelles appellent une infidélité pour une fois ſeulement.