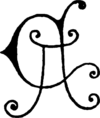Cléopâtre (Bertheroy)/Texte entier
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
« As-tu parlé à la reine ce matin, Taïa ?
— Oui.
— Sais-tu si elle a revu Marc-Antoine ?
— Pas encore.
— Pas encore ! Mais elle le reverra. Si ce n’est pas cette nuit, ce sera la prochaine, et le mois de Paophi ne s’écoulera pas sans que la charmeuse ait ressaisi sa victime ; et les fêtes et les folies recommenceront ; et le vin des orgies coulera de nouveau comme un huitième bras du très saint fleuve… ; et, pendant ce temps, l’Égypte glissera, sans qu’on s’en aperçoive ou sans qu’on s’en inquiète, sous la domination souveraine de Rome. Maudits soient-ils, ces deux efféminés qui laissent notre gloire s’éteindre ainsi que les rayons mourants de Sérapis !
— De grâce, Paësi, tais-toi. Ne crains-tu pas, toi prêtre, de prononcer un pareil blasphème ? Pour Antoine encore, je te l’abandonne ; c’est un étranger, et plût aux dieux qu’il n’ait jamais abordé à ces rivages ! Mais Cléopâtre ! la reine d’Égypte !
— Eh ! que m’importe ! N’est-elle pas une étrangère, elle aussi, une Grecque, la descendante des Ptolémées, dont le premier était fils illégitime de Philippe de Macédoine ? L’antique sagesse d’Hermès, qui fit si grande notre puissance, la sagesse de Ramsès et de Sésostris, ta Cléopâtre ne l’a jamais connue. C’est une créature aux instincts corrompus, qui possède toute l’astuce de la Grèce et tous les raffinements voluptueux de l’Orient. De nous, de notre théosophie, elle n’a pris que l’art de charmer, et la redoutable science de nos hiérophantes qui peuvent à leur gré fasciner les autres hommes et leur faire accomplir les plus secrètes volontés. Toi-même, Taïa, tu subis sans t’en douter cette influence mystérieuse ; la reine est pour toi plus qu’une divinité ; et quand tu t’agenouilles à ses pieds en l’appelant nouvelle Isis, ton corps frémit d’un tressaillement non moins intense que lorsque tu te prosternes devant la statue voilée de la sublime Déesse ! »
La jeune fille secoua la tête :
« Quoi d’étonnant, Paësi, à ce que j’aime la reine ? Il n’est point nécessaire pour cela qu’elle exerce sur moi un pouvoir magique. Ne m’a-t-elle pas enlevée, quand j’étais enfant, aux mains de mon premier maître, pour me donner une place toute particulière dans son palais ? Ne m’a-t-elle pas fait apprendre à jouer du tambourin et de la cithare, et à tracer pour elle sur les feuilles de byblus les signes éloquents de sa pensée ? Oui, je l’aime et je crois voir réellement en elle un être d’une essence supérieure à la nôtre ; parfois même je m’imagine que la sublime Déesse au front voilé de noir doit avoir les traits et le regard de Cléopâtre.
— Prends garde, Taïa ; cette femme porte malheur ! Tous ceux qui ont subi l’ensorcellement de ses charmes en ont éperdument souffert avant d’en mourir. Vois Marc-Antoine, qui certes, il y a peu de temps encore, était un brave soldat ; regarde cette sauvage et rude nature subir comme un enfant la domination de ta maîtresse, au point d’abandonner sur un signe d’elle toute son armée. Ah ! si du moins Cléopâtre faisait servir cet ascendant à la gloire du royaume ! Mais, au contraire, il semble qu’elle ait pris à tâche de l’amoindrir.
— Écoute, Paësi, la reine a une excuse : elle aime Antoine ; en le voyant assailli de tous les côtés par les javelots d’Octave et sur le point de tomber à sa merci, elle a tout oublié pour ne songer qu’à sauver cette précieuse existence. Certes il n’est pas de femme vraiment amoureuse qui à sa place n’en eût fait autant. Mais à peine Cléopâtre avait-elle cédé à ce mouvement de faiblesse, qu’elle en comprit la portée irréparable. Moi, qui étais à ses côtés, j’ai essuyé ses larmes, et je puis t’assurer qu’elles étaient sincères.
— Et c’est pour se consoler sans doute qu’après cette fuite honteuse elle est rentrée à Alexandrie en souveraine triomphante, ses trirèmes couronnées de fleurs et ses esclaves en habits de fête chantant au son des flûtes les hymnes de victoire[1] ? C’est dans cet appareil qu’elle était allée à Tarse conquérir le cœur du triumvir romain ; c’est dans ce même appareil qu’elle est revenue d’Actium après avoir consommé la déchéance de son royaume et la ruine de son amant. En vérité, Taïa, ta divine Cléopâtre n’a ni les sentiments d’une femme, ni la dignité d’une reine. »
La jeune fille ne répondit pas et le prêtre poursuivit, en s’animant :
« Pourvu que sa main tienne le sceptre, peu lui importe de régner sur l’Égypte, ou sur une autre contrée ! Il ne lui importe pas davantage que celui dont elle accepte l’alliance s’appelle Marc-Antoine ou César-Octave ; et si ce dernier venait en ce moment lui proposer de le suivre jusqu’à Rome afin de partager l’empire du monde, elle quitterait la terre du Delta sans même se retourner pour voir s’allonger sur le sol l’ombre vénérée de nos Pyramides. Déjà Alexandre II avait légué l’Égypte aux Romains, et, n’eût été l’intervention de Mithridate Eupator, le royaume devenait province romaine ; Cléopâtre se chargera d’accomplir les désirs de son aïeul : tu verras avant peu les aigles détestées du Latium remplacer au fronton de nos temples les ibis saints. Déjà les villes sacrées sont désertées ; à peine une fois par an va-t-on adorer à Thèbes le dieu Amon sous le symbole du bélier immolé ; Memphis, plus désolée encore, ne sort de sa léthargie que pour l’intronisation d’un nouveau souverain ; et c’est à Alexandrie, où s’élèvent à côté de nos temples les sanctuaires de toutes sortes de divinités étrangères, que réside maintenant le siège du royaume d’Égypte.
— Heureusement pour ce royaume qu’il en est ainsi ! devrais-tu dire. Sans le double port d’Alexandrie où viennent se déverser à flots les richesses des autres nations, il y a longtemps que l’Égypte serait abandonnée, sinon oubliée. Voudrais-tu voir revenir l’époque où la ville de Naucratis[2] était le seul point abordable du royaume[3], et où les marchands étaient, dit-on, obligés de transporter leurs cargaisons dans des barques, parce qu’il était défendu d’entrer dans le Nil par une autre embouchure que la Canopique ? — D’ailleurs, je ne connais pas grand’chose à tout cela, mon esprit se complaît peu dans les combinaisons des princes suprêmes, et si ma glorieuse maîtresse n’avait pas pris le soin de me façonner et de me faire instruire à son gré, je serais en ce moment, comme presque toutes les femmes de ma race, simple esclave d’un chef barbare. Un seul souci me préoccupe : Cléopâtre. Et, quoi qu’il advienne, je la servirai avec une fidélité aveugle. »
À travers la double rangée de sphinx qui prolongeait l’atrium, la jeune fille s’éloigna et le prêtre la poursuivit longtemps d’un regard soupçonneux.
C’était une créature insaisissable que cette Taïa, et merveilleusement belle, de cette beauté inquiétante et sévère des femmes de la Libye ; il semblait que sa chair eût été pétrie du sable doré des déserts où s’était écoulée sa première enfance, et que les jeunes fermetés de son corps eussent été durcies par le souffle desséchant des plaines de la Syrte ; sa peau avait la couleur et le vernis des dattes que les esclaves de la Cyrénaïque et des pays voisins venaient chaque année récolter sous les palmiers nombreux d’Augila.
Au palais de Cléopâtre elle occupait une place à part ; c’était elle que la reine gardait à ses côtés lorsque les autres suivantes étaient repoussées ; seule, elle recevait les confidences de sa maîtresse et accomplissait pour elle les missions secrètes. Aussi Taïa était-elle peu aimée par les fonctionnaires du palais qui enviaient son intimité avec la reine, et surtout par les prêtres et les anciens Égyptiens, dont elle blessait à chaque instant les superstitieuses croyances. Au milieu des exagérations du culte, dans une nation qui n’avait subsisté et ne subsistait encore que par l’organisation religieuse qui en était l’âme, elle passait, indifférente aux dogmes, parmi la foule des adorateurs de Sérapis. On ne lui connaissait pas de dévotions particulières ; sa poitrine, nue sous la colasyris entr’ouverte, ne recélait aucun des symboles mystiques chers aux habitants du Delta. Ses dieux, elle les avait laissés au fond des solitudes mystérieuses de la Libye ; c’étaient, sous la splendeur des soleils couchants, les grands fauves muets allongés sur les sables et qui semblaient porter en eux la science des choses inconnues.
Silencieuse elle était elle-même à l’ordinaire, réservant sans doute ses effusions pour les longues heures qu’elle passait dans l’appartement de la reine ; le reste du temps, elle s’occupait aux abords du palais à égrener dans une patère d’or les baies de genièvre dont Cléopâtre faisait aromatiser ses vins, ou à préparer les diadèmes de lotus et d’épis que la Nouvelle Isis portait sur sa tête aux jours des publiques réjouissances.
Depuis la défaite d’Actium, Taïa semblait plus hautaine, plus renfermée encore. Une préoccupation constante faisait se rejoindre l’arc mobile de ses sourcils, et parfois des larmes s’échappaient de ses yeux sans que personne autour d’elle n’osât ou ne daignât lui en demander la cause. Paësi seul qui, lui aussi, vivait dans l’atmosphère intime de la reine, aurait pu dire ce qui se passait au fond du cœur de la jeune Libyenne ; la haine du prêtre pour Cléopâtre ne le rendait pas moins clairvoyant que Taïa son amour, et tous deux sentaient se creuser rapidement le gouffre où l’indépendance dernière de l’Égypte devait s’engloutir ; mais ce qui s’exhalait chez le prêtre en colère furieuse contre la souveraine, qui avait ainsi compromis la fortune du royaume, se traduisait chez la jeune fille en tristesses profondes dans l’attente du malheur qui pesait sur la destinée de Cléopâtre.
En effet la situation de la reine était presque désespérée. Dans la lutte qu’elle avait suscitée formidable entre l’Orient et l’Occident elle se trouvait prise, écrasée entre ces deux masses mouvantes et agissantes qu’elle avait cru un instant pouvoir diriger. De son armée, de l’immense armée d’Antoine il ne restait maintenant que quelques tronçons épars composés d’éléments divers et impuissants à se rejoindre sur le signal de leur chef vaincu. Les Galates, les Mèdes, les Gètes et tous les petits peuples qui, de l’Asie à l’Adriatique, avaient prêté main-forte au triumvir dans sa querelle avec Octave l’avaient abandonné, et même les légions romaines, cantonnées dans la Cyrénaïque, refusaient de s’aligner sous ses ordres et se révoltaient, incitées par Pinanus Scarpus. Seuls, les gladiateurs et quelques peuplades voisines de l’Égypte lui étaient demeurés fidèles.
César-Octave, au contraire, profitant habilement de sa victoire inespérée, en tirait sans tarder d’incalculables avantages ; déjà il s’était rendu en Orient afin d’y poser les premiers jalons de son empire, cet empire dont Cléopâtre avait rêvé de tenir le sceptre, et dont, la première, elle avait conçu l’idée grandiose.
Pourtant tout espoir n’était pas éteint dans le cœur de l’ambitieuse souveraine ; bien des pensées d’orgueil l’enivraient encore quand, de la terrasse de son palais, elle contemplait la ligne lointaine de ces continents, qu’elle se sentait si bien faite pour dominer et dont les vents étésiens venaient lui apporter par instants les enveloppantes caresses.
CHAPITRE II
Dans l’appartement de Cléopâtre la clepsydre de bronze en forme de taureau, chargée de mercure, a marqué l’avant-dernière heure du jour ; toute agitation a cessé autour de la reine et jusque dans les profondeurs du palais du Bruchium, devenu morne depuis que les deux royaux amants n’y célèbrent plus les mystères joyeux de leurs orgies. C’est à peine si de loin en loin on entend résonner sur les dalles d’onyx des salles basses le pas sourd d’un surveillant chaussé de sandales ou le murmure étouffé des jeunes esclaves couchés à plat ventre et suivant, le menton dans la main, les hasardeux coups de dés d’une partie clandestine.
Cléopâtre, à demi étendue sur un amoncellement de coussins, laisse ses suivantes procéder aux soins de son coucher. Indifférente, elle considère d’un œil lassé les splendeurs éparses autour d’elle ; son regard se promène des merveilleux lampas tissus d’or et de pourpre qui s’étalent sur les parois de la chambre aux grandes amphores incrustées d’argent, dont le col allongé et brillant ressemble à celui d’un cygne.
D’un pas mesuré et rythmique ses femmes vont et viennent ; sans dire une parole, elles s’alternent dans des mouvements prévus, et comme en l’accomplissement d’un rite. Une odeur d’encens s’élève des profonds cratères d’airain où brûlent le kyphi[4] et les résines mêlées du benjoin et de la myrrhe.
Les longues tresses noires de Cléopâtre ont été déroulées par les soins de Charmione. D’un geste sûr la jeune Grecque soulève de sa main gauche l’épaisse toison et de la droite y fait tomber par saccades régulières une pluie embaumée d’essence de néroli. La plus jeune des suivantes s’est agenouillée devant les divins pieds de sa maîtresse, et, après les avoir frottés d’une huile odorante, elle les enferme dans des sandales brodées de saphirs que lui tend une esclave subalterne. À quelque distance, Taïa, assise à terre, surveille et dirige les allées et venues de ses compagnes.
Cependant la toilette a pris fin. Une à une, chaque jeune fille s’est approchée de la reine et l’a saluée en abaissant sa main au genou selon la coutume égyptienne.
Taïa s’est avancée à son tour ; et Cléopâtre, posant sur elle son regard clair et la touchant légèrement à l’épaule de la baguette d’ivoire à tête d’épervier qui lui sert à commander ses femmes :
« Toi, reste ! » murmura-t-elle.
Elle l’entraîna, par une large baie ouverte, à une terrasse d’où la vue s’étendait à l’infini, d’un côté sur les flots bleus de la Méditerranée, de l’autre sur les nappes grises du lac Maréotis, au delà des longues avenues de colonnes que renfermait la double enceinte d’Alexandrie.
« Écoute, Taïa, lui dit-elle, — je me meurs : un ennui profond me monte des choses. Oh ! cette Égypte avec ses sphinx éternellement muets, ses syringes éternellement désertes, ses barques monotones qui glissent silencieusement sur les eaux du Nil, je la hais ! Elle me pèse, elle m’étouffe ! Je voudrais m’en éloigner pour toujours. »
La jeune fille ne répondit point. Cléopâtre étendit ses deux bras nus dans la direction de l’Occident :
« C’est là qu’est la vie ! reprit-elle ; l’Orient n’est plus qu’un tombeau, le tombeau des vieilles dynasties mortes et des antiques gloires éteintes. »
Un profond soupir soulevait sa gorge ; maintenant ses doigts fébrilement effeuillaient les larges pétales des roses d’Asie qui débordaient aux balustres de la terrasse.
Taïa osa dire :
« Nouvelle Isis, je ne puis comprendre vos paroles. La grande souveraine qui n’a qu’un signe à faire pour voir ses rêves les plus vastes se réaliser ; la déesse auguste aux pieds de laquelle les fronts les plus orgueilleux se sont prosternés en adoration ; celle qui possède autant de richesses que la terre en peut contenir et qui fait par sa science l’admiration des plus grands philosophes d’Alexandrie et d’Athènes, Cléopâtre a senti le reptile de l’ennui s’enrouler à son cœur ? »
La reine soupira longuement.
« Enfant, il est des heures où toute cette science me paraît néant, où toutes ces richesses me semblent plus vaines que ces nuages d’or que tu vois là-bas s’amonceler sur l’île fortunée d’Antirrhodos. Souviens-toi de Schelomo, le grand roi dont nos hiérogrammates ont relaté l’histoire : il avait tout vu, tout connu, tout sondé ; il savait les mystères glorieux du cèdre et les secrets cachés de l’hysope ; il possédait des trésors sans nombre et l’amour de la fille du roi d’Égypte, qu’il amena triomphalement dans Jérusalem sur les beaux chars de Guézer traînés par des chevaux ardents[5]. De plus, son dieu lui avait donné la faveur insigne de la sagesse ; et, à cause de cela, Schelomo sentit qu’il avait multiplié en lui-même les sources de la douleur, et il comprit que la suprême sagesse était l’oubli de toutes choses dans les secousses voluptueuses du plaisir. »
Du lac montaient par bouffées de lourds effluves, saturés de natron et d’alumine ; les vents argestes qui d’ordinaire passaient à cette heure n’étaient point venus rafraîchir l’atmosphère ; une chaleur morne pesait sur la ville ; et dans l’air dense pullulaient de larges mouches cantharides étendant leurs ailes vertes, immobiles, comme en l’attente d’un souffle de vie.
Cléopâtre ajouta d’une voix moins assurée :
« Taïa, va dire à Marc-Antoine que je l’attends. »
Accoutumée aux caprices impérieux de sa maîtresse, la jeune Libyenne ne répliqua point : elle s’éloignait à pas rapides après avoir baisé le bas de l’étroite tunique striée d’argent qui formait en cet instant le seul vêtement de la reine ; mais, d’un geste, Cléopâtre la retint :
« Écoute-moi bien, lui dit-elle. Pour arriver au Timonium où est Antoine fais un détour, car Paësi, qui me surveille étroitement depuis la défaite, devinerait sans doute le but de ta course ; quand tu seras auprès du Triumvir, dis-lui simplement de te suivre. »
Alors Cléopâtre détacha de son sein une large bandelette enrichie de pierres précieuses, autour de laquelle étaient suspendues les minuscules figures d’argent des animaux sacrés de l’Égypte ; elle plaça elle-même ce joyau au cou de son esclave favorite ; puis, l’attirant plus près encore dans l’atmosphère même de son haleine, elle l’embrassa longuement, comme pour rendre plus infaillible par cette caresse le pouvoir mystérieux dont elle voulait revêtir sa messagère.
La tour de Timon, bâtie par les ordres d’Antoine après la défaite de sa flotte, était située à l’extrémité d’un promontoire qui dominait le grand port d’Alexandrie ; ce promontoire était le Posidium où s’élevait un temple à Neptune, le dieu éponyme invoqué des navigateurs[6]. Abandonné de ses phalanges les plus fidèles, doutant de lui-même et de Cléopâtre, le triumvir, après avoir erré plusieurs mois dans les solitudes de la Cyrénaïque, s’était réfugié dans cette retraite où, comme Timon de Calyttus, il voulait vivre inconnu et mourir oublié.
Quelques stades à peine séparaient le Timonium du palais de Cléopâtre. Toutefois Taïa, obéissant aux recommandations de sa maîtresse, prit pour y arriver une voie détournée ; rapidement elle traversa le quartier du Bruchium, l’un des cinq grands quartiers de la ville[7], désert à cette heure, et, longeant la file des nombreux édifices que chacun des Ptolémées s’était plu à élever ou à embellir, elle pénétra dans les jardins royaux qui s’étendaient jusqu’à la Porte du Soleil.
Deux Androsphinx de taille gigantesque veillaient à l’entrée de ces jardins ; d’immenses avenues parallèles, coupées transversalement par d’autres allées symétriques, prolongeaient à perte de vue leurs arceaux de feuillage d’une coloration particulièrement douce à l’œil sous les rayons bleuissants de la lune. C’étaient d’abord les bouleaux argentés, les acacias épineux que de mystérieux frémissements agitaient, alors qu’autour d’eux toutes les autres essences paraissaient dormir du sommeil recueilli des plantes.
Des gerbes bleues de galegas et des touffes rose-mourant de valériane émergeaient çà et là des pelouses épaisses faites de saxifrages et de statices gazonneux. Des ricins géants aux feuilles très amples couvertes d’une pruine blanchâtre luisaient comme des miroirs de métal, tandis que les hautes hampes des balisiers lactescents pointaient droit vers le ciel leur pavillon de verdures.
Autour des plates-bandes, encerclant étroitement les massifs, couraient les grappes étoilées des nycteris selagines dont les fleurs violettes ouvraient aux approches de la nuit leurs pétales ciliés de jaune qui exhalaient une suave odeur de vanille. Dans des triangles, semblables à une éclosion d’insectes bizarres, des orchidées, transportées à grands frais des Indes, étalaient le luxe éclatant de leurs corolles variées à l’infini. Là se trouvaient des cypripèdes au corsage allongé comme celui des guêpes, des ophyrs brillant comme des scarabées, des spiranthes se balançant comme des libellules au sommet de leur tige filiforme, des satyriums voraces repliant leurs lèvres sensuelles sur les moucherons passant à leur portée, au fil de l’air.
Quittant les longues avenues, Taïa s’engagea dans une allée de traverse ; sur son front les sycomores majestueux formaient une voûte aux arceaux impénétrables de feuillage. Elle était arrivée à la partie centrale des jardins, immense rond-point autour duquel les rosiers de mer et les glaïeuls poussaient leurs quenouilles arborescentes étoilées de fleurs. À l’entrée de ce rond-point, face à face, se dressaient deux statues en terre cuite finement coloriées comme des figures de Tanagra ou d’Éphèse : l’une représentant Hâthor, la Vénus Deltique, revêtue de la tunique talaire et entourée de rameaux de persea, cet arbre de vie de la théosophie égyptienne[8] ; l’autre, Hypnos, dieu du sommeil, surgissant d’une touffe de pavots multicolores ; un papillonnement de doliques aux légères fleurs violacées caressait d’un battement d’ailes les jambes graciles et nues des deux jeunes divinités.
Au milieu, une immense pièce d’eau, ou plutôt un lac, étendait sa nappe transparente sillonnée de minces canots en terre cuite[9], dans lesquels les hôtes royaux d’Alexandrie venaient se reposer et s’endormir parfois aux heures brûlantes du jour. Toute une végétation aquatique, la flore mystique de l’Égypte, s’élançait des fraîches profondeurs de ce lac et du recueillement de ses sources. La gloire liliale des lotus s’y épanouissait à l’aise dans sa triple transformation[10] : le lotus bleu, emblème d’Osiris, le dieu Père, première personne de la Trinité hermétique, se balançait au moindre souffle de l’air en un mouvement rythmique d’encensoir ; le lotus blanc, nymphée virginale consacrée à la chaste Isis, tremblait au sommet de sa tige ; enfin le lotus rose, le nymphea nelumbo, évasé en ciboire, offrait à la consécration solennelle des nuits ses fèves sacrées, hosties agréables à Horus, le fils très saint d’Isis et d’Osiris.
Sur les bords, à travers les arundos empanachés de blanc, à travers les joncs roux et les iris fauves étendus comme un luxuriant rideau au bord de leur couche nuptiale, sommeillaient les nénuphars. Ces épouses inviolées du Nil n’entr’ouvraient leur corolle qu’au moment de la crue montante du Fleuve Sauveur : ainsi elles étaient, aux yeux du peuple, le précieux gage de sa fécondité.
Taïa se sentait troublée malgré elle par le travail mystérieux de la sève, dont elle connaissait l’occulte symbolisme ; maintenant les troènes florescents l’enveloppaient de leur parfum âcre et il lui semblait entendre glisser à sa suite le pas d’un compagnon invisible. Elle se hâta de quitter les jardins.
Traversant rapidement la grande place qui séparait le Gymnase de la Palestre, elle se dirigea vers le Panœum. C’était une colline de rocaille factice placée au centre même de la ville et qui avait la forme oblongue d’une toupie. Un escalier en limaçon menait au sommet, où un large banc circulaire en granit permettait aux promeneurs de se reposer en contemplant le panorama merveilleux d’Alexandrie et de ses faubourgs. La jeune fille, lasse déjà du chemin qu’elle avait parcouru, et cédant au désir de se recueillir quelques instants avant d’accomplir sa mission, gravit cet escalier et s’assit.
La ville tout entière était à ses pieds dans un scintillement de lumières ; les rues nombreuses, régulièrement tracées et éclairées par d’énormes candélabres de bronze que supportaient des ibis aux ailes éployées, semblaient sortir les unes des autres et gagner ainsi en relief ce qu’elles perdaient en étendue. Les maisons, petites ou grandes, toutes surmontées de toits plats en terrasse, se découpaient très nettement au milieu des édifices colossaux qui les dominaient.
Taïa d’un regard embrassait l’ensemble de ces édifices dans les lignes principales de leur configuration. Le sanctuaire de Saturne, les deux temples d’Isis, le grand et le petit Serapeum surgissaient du milieu de leur péristyle dans le prolongement des colonnes de porphyre. Immédiatement au-dessous d’elle le Soma[11], où reposaient Alexandre et les premiers Ptolémées, étalait la masse blanche de ses sépultures ; quelque chose de majestueusement calme s’exhalait de ce cimetière des rois et montait au cœur de la jeune esclave ; l’idée que la mort n’est qu’un sommeil, cette idée qui fait le fond de la doctrine ésotérique de l’Égypte, vivait aux lieux de sépulture et y répandait une atmosphère de tranquillité consolante. À l’entrée de chaque hypogée, des urnes à encens, des fioles à parfums, des lampes prêtes à être allumées pour éclairer le réveil du défunt ; l’appareil des festins futurs : huile, miel, fruits contenus dans des vases fictiles ; dans des amphores l’eau lustrale attendant l’heure de la résurrection pour le baptême de la vie à venir : tout cela disait surabondamment la foi attachée au dogme de l’immortalité.
Sur les stèles de marbre blanc des peintures polychromes représentaient le défunt dans les attitudes qui lui étaient familières. Au bas de ces stèles, des inscriptions tracées en ocre rouge parlaient en son nom, comme si du fond de sa demeure funèbre il les eût lui-même dictées.
Çà et là, coupant la monotonie des sarcophages, une chapelle funéraire plus haute, un édicule soutenu par des piliers ornementés de chapiteaux à fleurs de lotus bleu ; et sur le fronton la clef de toute initiation mystique : le disque solaire ailé où s’entrelaçaient des serpents urœus. Presque à chaque porte de ces édifices isolés se répétait la représentation en granit d’Horus debout marchant sur des crocodiles ; un scorpion, un lézard, une gazelle, se débattaient sous l’étreinte du jeune dieu ; près de lui, les divinités maîtresses, Thoth et Phta, l’aidaient à dompter les animaux malfaisants. Au-dessus de sa tête juvénile était placé comme un génie protecteur le masque de Bess, le dieu triomphant de la guerre et de la joie ; une mitre aplatie couronnait sa face labourée de rides et encadrée d’une barbe droite et touffue. De chaque côté, en caractères hiéroglyphiques, se lisait cette formule du rituel funèbre égyptien[12] : « Salut à toi, dieu fils de dieu : Salut à toi, Horus,… toi qui as eu soin de clore la bouche de tous les reptiles. Repousse loin de moi les lions venant de la terre, les crocodiles sortant du fleuve, la bouche de tous les reptiles. Rends-les pour moi comme de petites pierres sur la terre, comme des débris de vases près des habitations[13]. »
Autour du Soma, qui dans sa ceinture de murailles émergeait au centre même d’Alexandrie comme une île silencieuse, la ville sans relâche s’agitait, se mouvait ; un immense bruit, quelque chose de pareil à l’écrasement des vagues sur le roc, venait de tous les coins de la cité se perdre dans cette enceinte de la mort. Tout le long de l’avenue Canopique, entre la double colonnade qui s’étendait de la Porte de la Lune à celle du Soleil, une rumeur montait ; des chars, des quadriges brillamment attelés, couraient à l’Hippodrome ; les sabots étincelants et cerclés de cuivre des mules et des chevaux retentissaient sur les dalles compactes de la chaussée rendues sonores par les canaux et les aqueducs qui formaient sous Alexandrie une seconde ville souterraine ; d’autres chars s’empressaient dans la direction des plaines charmantes d’Éleusis, où les jeunes débauchés grecs et alexandrins avaient caché leurs maisons de plaisir parmi les aloès et les citronniers en fleurs.
La grande clameur augmentait encore ; elle sortait du théâtre qui déversait à tout instant la foule bigarrée dans les galeries extérieures et sur les places publiques ; elle montait des profondeurs de Rhakotis où la tourbe de la population s’amassait pour échanger des propos plaisants et chanter des refrains en l’honneur des divinités bucoliques. C’était là, dans ce quartier perdu au sud-est d’Alexandrie, que Cléopâtre aimait à s’égarer le soir avec Antoine, se mêlant sous un déguisement aux groupes des pâtres établis dans ces parages.
Elle venait, la grande rumeur, de l’Emporium, dans lequel se trafiquaient jusqu’à des heures avancées de la nuit les précieuses denrées de l’Orient, les étoffes rares de la Perse et de l’Inde, les essences multiples du Liban, les vins délicieux et le safran que l’Ibérie exportait. Des hommes de toutes les nationalités, de toutes les races, revêtus de costumes divers, allaient de l’Emporium aux Apostases où les marchandises étaient amoncelées ; des Arabes, le front rasé, enturbané de rouge ; des Juifs, les cheveux flottants, le corps perdu dans de longs manteaux de lin ; des Macédoniens, les bras nus jusqu’aux épaules, souples sous les plis serrés de l’exomide ; enfin des Égyptiens de tous les nomes ; des Éthiopiens, des Libyens, des Mèdes ; tous s’interpellant, se querellant, s’insultant dans un langage confus où l’idiome grec dominait.
Et au-dessus de cette clameur, de cette grande voix d’Alexandrie, dont les vibrations traversaient la ville d’un bout à l’autre, une voix plus puissante s’élevait, dominant tous les bruits, les engloutissant dans son harmonie sonore : la voix des flots de la Méditerranée à laquelle répondait comme un écho la plainte sourde des ondes maréotiques.
Taïa, immobile au sommet du Panœum, s’était laissée peu à peu envahir par une rêverie profonde ; les murmures qui lui venaient de tous les quartiers de la cité, cette clameur vague sortie de milliers de poitrines humaines, avaient dans son esprit une signification unique et ne lui apportaient qu’un nom, toujours le même, celui de Cléopâtre. C’était elle que célébrait la gloire liliale des lotus dans les sources susurrantes des jardins ; elle que couronnaient les urœus sacrés aux frontispices majestueux des temples ; elle qu’invoquaient les supplications silencieuses des morts royaux au fond des blancs hypogées du Soma ; c’était dans la soif de voluptés semblables aux siennes que les jeunes efféminés d’Alexandrie couraient à leurs solitudes embaumées d’Éleusis et de Canope ; c’était elle qu’attendaient au bord des fontaines les pâtres joyeux de Rhakotis ; c’était pour elle que des esclaves empressés s’agitaient aux abords de l’Emporium ; pour elle que les métropoles du monde entier envoyaient des tissus de pourpre et des joyaux d’or ; c’était elle, enfin, l’Aphroditè, qu’appelaient la plainte grandissante des flots et les mugissements sourds du grand lac.
La jeune fille descendit l’escalier du Panœum ; une force secrète, irraisonnée comme l’instinct et aveugle comme l’amour, la poussait maintenant vers Antoine et lui faisait envisager sa mission avec une sorte de joie ; elle se sentait fatalement désignée pour l’accomplissement d’une volonté obéie d’avance et nécessaire à l’ordre éternel des choses. Après avoir abaissé devant ses yeux le bandeau qui entourait sa chevelure, elle s’avança à pas pressés droit devant elle, vers le Timonium. Les rues, un instant avant débordantes de monde, étaient devenues presque désertes ; la voie transversale du Soma, où elle s’était engagée, paraissait particulièrement lugubre, rayée de place en place par les grandes ombres rectilignes que projetaient les piliers sous la lumière de la lune.
Arrivée devant le temple d’Isis Plusia, la jeune fille s’arrêta ; de nouveau il lui avait semblé entendre derrière elle, comme tout à l’heure en sortant des jardins, un bruit insolite, le pas rapide de quelque animal bondissant sur les dalles sonores ; mais elle ne vit rien qu’un ibis blanc qui, troublé dans son repos nocturne, tirait gravement sa tête déplumée des chaudes profondeurs de son aile.
Maintenant Taïa, touchant presque au but de sa course, traversait les vastes chantiers du Sebasteum[14]. Ce monument, que Cléopâtre avait voulu faire élever à la gloire d’Antoine, et qui ne devait pas avoir son pareil au monde, sortait à demi de sa base, au-dessus d’un entassement gigantesque de blocs de granit et de marbre ; d’énormes monolithes de porphyre couchés, pareils à des géants endormis, attendaient pour se relever l’heure de la glorification du héros vaincu ; des salles à ciel ouvert ébauchaient entre leurs épaisses murailles de grès leurs quadrilatères au milieu desquels étaient jonchés, parmi la masse des ornements votifs, les tableaux retraçant les fastueuses amours du triumvir et de la reine d’Égypte, et les colossales statues d’or et d’argent qui les représentaient tous deux sous les traits de l’Abondance et de la Joie.
Taïa s’avançait péniblement dans le désordre des matériaux accumulés ; elle avait relevé son bandeau et posait avec précaution sur les débris d’onyx et de marbre ses pieds étroits, chaussés de minces sandales. Il était plus de minuit ; la ville peu à peu s’était apaisée : quelques rumeurs lointaines montaient encore par instants des quartiers de plaisir.
Tout à coup d’une rue voisine un tapage éclata, fait de rires prolongés et de chansons. Les voix bruyantes se rapprochaient, devenaient de plus en plus distinctes ; avant que Taïa ait eu le temps de se dissimuler, trois jeunes Grecs débouchèrent devant le Sebasteum ; leurs chlamydes déchirées, souillées du vin odorant de Maréotis, témoignaient d’une orgie à peine consommée ; les pétales des roses effeuillées étaient encore entremêlés aux boucles de leurs chevelures et leurs doigts, chargés de lourds anneaux, portaient de longs sistres d’or dont ils accompagnaient leurs chants. En apercevant la Libyenne, les trois jeunes débauchés avaient interrompu leur marche. Elle-même, par un mouvement machinal, prise de peur, s’était arrêtée et demeurait droite à l’entrée du chantier, le front haut et les mains relevées aux épaules dans une attitude hiératique ; la lune très claire détachait nettement les lignes merveilleuses de son corps.
« Par Dionysios ! dit l’un d’eux, il y a de jolies filles à Alexandrie ; mais en voici une dont les sandales ne devront pas traîner longtemps dans la poussière des chemins ! Comment te nommes-tu, la belle enfant ?
— Eh, ne la reconnais-tu donc pas, Philéas ? n’as-tu jamais rencontré, remontant le canal et couchée sur un bateau thalamège débordant de fleurs, la très auguste reine menant aux fêtes de Canope[15] son esclave favorite, la jeune Taïa ? Et dans les réjouissances publiques, sur le char d’Antoine et de Cléopâtre, n’était-ce pas celle-ci que l’on voyait toujours, partageant les plaisirs des amants royaux ?
— Qu’est-il donc survenu pour que la suivante aimée de la reine rôde ainsi seule la nuit par les carrefours déserts ? Sans doute quelque rendez-vous où l’amour n’est pas étranger ; car l’atmosphère que l’on respire au palais du Bruchium n’est point faite pour endormir les sens d’une belle fille libyenne. »
Tous trois étaient près d’elle à la toucher. Celui qui avait parlé le dernier, dégageant son bras gauche de sa chlamyde, en avait entouré la taille de la jeune fille et l’attirait brusquement contre lui. Les deux autres riaient d’un rire complaisant et lascif.
Taïa poussa un cri ; mais aussitôt, bondissant derrière elle, une forme sombre avait surgi ; un homme aux membres athlétiques, le corps nu sous une légère écharpe, se ruait comme une bête fauve entre elle et ses insulteurs ; l’échiné courbée, la gorge haletante, le front en avant, dédaignant de se servir de ses poings fermés, il alla donner de sa tête pesante dans la poitrine du jeune Grec.
À cette intervention inattendue, le groupe des efféminés s’était dispersé ; les pétales de roses, se détachant de leur chevelure, avaient jonché le sol et les sistres d’or, tombés de leurs mains, luisaient comme des lampyres sous les rayons de plus en plus intenses de la lune.
Taïa leva les yeux vers son défenseur et étouffa une exclamation de surprise :
« Toi, Kaïn ? Comment es-tu ici ? »
Le noir secoua sa tête ronde.
« Ne nous arrêtons pas davantage, dit-il, et laisse-moi t’accompagner où tu vas ; l’heure s’avance, ta royale maîtresse doit être inquiète. »
Pendant quelques instants ils marchèrent en silence côte à côte ; démesurément leurs ombres s’allongeaient devant eux sur la jetée blanche du Timonium où ils s’étaient engagés ensemble.
« Tu savais donc où j’allais ? » demanda tout à coup Taïa.
De nouveau Kaïn hocha la tête.
« L’épervier connaît les méandres de la colombe dans l’air ; l’ichneumon suit les traces du lézard bleu à travers les roseaux du fleuve. Comment le Chef des esclaves n’aurait-il pas souci de la plus belle des suivantes de Cléopâtre ? Depuis ta sortie du palais je t’ai guettée ; dans le jardin je marchais derrière toi à te toucher ; mais tu ne m’as pas entendu. »
Il parlait, le front bas, les lèvres frémissantes ; un souffle impétueux sortait de ses narines ouvertes et faisait voltiger les cheveux dénoués de la Libyenne. D’autres paroles encore montaient à sa gorge comme un grondement d’orage.
Mais Taïa ne l’écoutait plus. L’œil fixé sur l’infini des flots, elle pensait au grand amour qui domine le monde, et qui, en dépit de tous les obstacles, allait jeter de nouveau le Triumvir et la reine d’Égypte dans les bras l’un de l’autre.
CHAPITRE III
Ce jour-là il y avait dans Alexandrie une animation extraordinaire. Du Port des Rois à l’île d’Antirrhodos une quantité inaccoutumée de barques allaient et venaient, transportant la foule bariolée des esclaves. Cléopâtre donnait un grand festin pour célébrer l’anniversaire de la naissance d’Antoine. Déjà, à cette occasion, des fêtes nombreuses s’étaient succédé ; pendant une semaine, oubliant les hontes de la défaite et les incertitudes du lendemain, le peuple s’était rué, à la suite de ses maîtres, au Gymnase, à l’Hippodrome et dans tous les endroits de plaisir.
Mais, cette fois, c’était d’une solennité plus grande encore qu’il s’agissait. L’île d’Antirrhodos, où Cléopâtre avait un palais de plaisance, et dont les abords étaient ordinairement fermés, allait être accessible à tous. Autour des salles du banquet des tables avaient été dressées en plein air pour la foule ainsi que pour la milice d’Antoine ; de plus on devait boire les couronnes[16] en l’honneur de l’association nouvelle des Inséparables dans la Mort, que le Triumvir venait de fonder pour remplacer désormais celle des Jours Inimitables. Enfin on avait annoncé que les objets d’or et d’argent et les coupes de prix qui devaient servir au festin seraient indistinctement distribués entre les convives[17].
Dès les premières lueurs du soleil, Kaïn s’était transporté dans l’île pour ordonner les préparatifs de cette fêle unique et veiller à ce que tout fut fait selon la volonté de Cléopâtre. Le Chef des esclaves, Psylle d’origine, inspirait à ses subordonnés une terreur très grande. Rarement cependant il se servait du fouet à triple tête de scorpion qui pendait à sa ceinture ; mais les paroles de commandement sortaient de ses lèvres avec un sifflement aigu, pareil au cinglement des lanières de cuir sur les épaules nues des travailleurs ; et sa force physique, la force d’un Hercule libyen, en imposait aux plus indisciplinés parmi les esclaves.
En ce moment une troupe de jeunes Lacédémoniens était occupée à vider sur le rivage de l’île les galères remplies de quartiers de viande, de fruits de provenance exotique et de provisions de toutes espèces. Des esclaves sortaient en courant des salles basses du palais et croisaient leurs compagnons qui s’y rendaient chargés de corbeilles pesantes. Tous étaient vêtus de tuniques de coccina[18], différemment teintes mais de forme semblable, qui laissaient à découvert une épaule et tout un côté de la poitrine ; leur tête était rasée scrupuleusement selon la coutume adoptée à la cour des Lagides.
Dans les bosquets et sous les ombrages des allées, de petits Nubiens complètement nus et de taille pareille avaient été placés à des distances égales pour tenir les flambeaux ; en attendant l’arrivée de la reine ils jouaient à se poursuivre avec des pierres bleues qu’ils ramassaient dans le sable chaud de l’île.
Des Égyptiens, maigres et jaunes, roulaient devant eux de lourds tonneaux de vin dont ils allaient remplir des réservoirs de marbre ; à ces réservoirs étaient ajustés de longs cols de cigogne au bec d’argent finement ciselé qui vomissaient le liquide en cascades écumeuses. Ils avançaient péniblement, tout en échangeant les plaisanteries habituelles à leur race, car le peuple d’Égypte est un peuple gai.
« Cette liqueur-là, dit l’un d’eux, ne fera pas, je suppose, regretter aux soldats d’Antoine le vin libyque qu’ils boivent à Parœtonium, ni aux marins du port d’Eunoste le vin d’Antiphræ ou la bière d’orge que l’on distribue dans les tavernes des Navalia[19]. Les richesses de la grande reine sont donc inépuisables pour qu’après toutes ses défaites le vin de l’abondance coule encore comme aux plus beaux jours du royaume ?
— Les richesses de Cléopâtre ne sont pas près d’être taries, dit un vieux qui s’était attelé à un tonneau avec son écharpe et tirait en tête. Ne voyez-vous pas d’ici le mausolée qu’elle a fait construire sur le cap Lochias ? Il contient, dit-on, plus de trésors que les trois cent mille habitants d’Alexandrie n’en pourraient amasser pendant un siècle. Et n’avez-vous pas entendu, hier encore, le grand prêtre Paësi lui reprocher publiquement, devant le Sérapeum, ses prodigalités et ses folies ? »
Soudain Kaïn apparut sur le péristyle.
« Silence, maudits chiens, hurla-t-il, ou je vous envoie de compagnie tourner la meule jusqu’à la fin de vos jours ! »
Sans attendre l’effet de cette menace, il pivota sur ses talons et rentra dans l’intérieur du palais. On y préparait la table autour de laquelle devaient seulement prendre place Cléopâtre et Antoine avec les principaux personnages de la cour.
Le lieu du festin ressemblait à un temple ; les lambris des murs disparaissaient complètement sous d’épaisses lames d’or ; la voûte, oblongue et très élevée, était étoilée d’une multitude de pierreries éblouissantes. Les saphirs, les rubis, les émeraudes, les callaïs, les opales flamboyaient, semblables à des étincellements d’astres dans la profondeur fluide de l’éther. Une profusion de sardoines habilement parsemées mettait à ces ciels lumineux des reflets de soleils couchants ; et, comme d’énormes stalactites, des lustres de topazes transparentes y pendaient.
Les huit portes monumentales de la salle étaient faites avec l’ébène massif de Meroë[20]. Sur ces portes immenses des écailles de tortue de l’Inde étaient appliquées en relief ; au milieu de chacun des compartiments brillait une large émeraude, symbole de l’œil mystérieux d’Osiris.
Peu à peu la table du festin se couvrait de vaisselle rare et de pièces d’argenterie portant le sceau des maîtres orfèvres d’Alexandrie et de Sidon ; des réchauds de jaspe de forme étrange, les uns allongés en losanges, les autres arrondis en coupes, étaient disposés sans symétrie apparente, mais avec un art exquis, pour supporter les vaisseaux d’or apyre, dans lesquels les mets avaient subi la cuisson. Des récipients de bronze en forme d’obélisque[21] contenaient les shaï, sortes de pâtés froids faits de gibier et de fleur de farine. Dans des amphores revêtues d’argent ajouré aux anses fleuries de pierres précieuses, on avait versé les vins fameux du Massique et de la Grèce. De hauts vases murrhins[22], laissant courir dans l’opacité de leur substance des bandes ondulées pourpre, blanc et couleur de flamme, étaient placés devant chaque convive. Aux extrémités de la table, l’une au levant, l’autre au couchant, se dressaient deux grandes urnes de cristal faites à Akko de Phénicie avec le sable blanc du fleuve Bélus et dans lesquelles était présentée l’eau du Nil pour les ablutions rituelles.
Cependant l’heure avançait. Kaïn appela les esclaves employés au luminaire ; ils vinrent, armés de longs bâtons de cyprès, au bout desquels brûlait une torche de résine. En un clin d’œil les milliers de lampes et de flambeaux s’allumèrent. Alors ce fut un éblouissement. De tous les côtés de la salle, des jets de lumière partaient et allaient se briser aux aiguilles évidées des stalactites de topaze qui les renvoyaient colorés, selon la diversité de leurs rayons, en fusées de toutes les nuances du prisme. À la voûte, les étoiles de rubis et de saphir fulguraient, faisant courir des météores à la surface polie des vaisselles, noyant des soleils au fond des coupes d’or brillant. Les anneaux de sardoines, les lunes d’opale se réfléchissaient sur les immenses plats d’électrum, les émeraudes incrustées dans les portes croisaient le miroitement de leurs feux à travers le col cristallin des urnes.
Maintenant tout était prêt. Kaïn, après avoir jeté un dernier coup d’œil sur l’ensemble des tables, traversa l’île pour aller au-devant de la foule. Taïa était attendue la première, précédant le chœur des musiciens qui allaient saluer Cléopâtre et Antoine à leur arrivée ; elle-même, après le festin, devait chanter au son des harpes ; et ce n’était pas un des moindres attraits de la jeune Libyenne que cette voix pure et sonore dont Cléopâtre avait fait cultiver le développement par les soins des maîtres les plus habiles.
Elle vint en effet dans une trirème que protégeait un tendelet de pourpre. La reine exigeait que son esclave favorite eût dans ces circonstances un appareil quasi royal. L’étroite barque glissa parmi les roseaux et vint aborder à un estuaire qui servait de port à l’île. Kaïn l’attendait, agenouillé sur le sable, prêt à saisir la chaîne d’argent que devait lui tendre le timonier. Un esclave se précipita pour lui épargner cette besogne ; mais le Psylle l’écarta d’un geste violent.
Taïa descendit ; une légère tunique de gaze peinte voilait à peine les contours de son corps ; ses bras nus étaient encerclés de bracelets de lapis ; à ses jambes d’autres anneaux s’enroulaient, pareils à des serpents. Un bandeau d’or souple retenait son épaisse chevelure. Autour de son cou brillait le collier à figurines émaillées que Cléopâtre y avait placé le soir de sa réconciliation avec Antoine.
C’était la première fois que Kaïn se trouvait en présence de la jeune fille depuis ce même soir où il l’avait défendue contre la brutalité des Grecs au chantier du Sebasteum ; aussi s’attendait-il à une parole affectueuse, ou tout au moins à un regard ; mais Taïa passa sans faire attention à lui, indifférente comme toujours à ce qui n’était pas Cléopâtre.
Pourtant il était resté agenouillé, tenant encore dans sa main la chaîne d’argent et ses yeux s’étaient fermés à demi, comme s’il cherchait à retrouver au dedans de lui-même la trace lumineuse d’une vision aimée.
Il ne resta pas longtemps plongé dans ce recueillement ; de toutes parts des embarcations arrivaient, portant les musiciens, les chanteurs et la foule du peuple. D’autres barques, des pacton[23] en forme de radeaux faits de joncs tressés, amenaient la milice d’Alexandrie et les soldats d’Antoine ; ils se tenaient debout, serrés les uns contre les autres, sans s’inquiéter de l’eau qui baignait leurs pieds, très excités par l’appât du festin et aussi par la joie de revoir leur chef. Plusieurs s’étaient échappés de Parœtonium, désobéissant aux ordres de Cornélius Gallus qui avait déjà donné des gages de servitude à Octave Auguste[24].
Tous ces gens s’étaient amassés sur le rivage ; soudain un immense cri de joie sortit à la fois de leurs poitrines ; ils venaient d’apercevoir, quittant le port royal d’Alexandrie, la trirème d’or de Cléopâtre et d’Antoine qui arrivait lentement, laissant derrière elle un immense nuage bleu, la fumée de l’encens brûlé à la poupe.
À mesure que l’embarcation se rapprochait, les acclamations augmentaient. Quand elle fut près d’aborder, ce devint du délire ; les cris de la multitude couvraient le chœur des musiciens qui s’étaient rangés pour faire cortège à la nouvelle Isis et au fils d’Hercule.
Revêtue de la robe isiaque, Cléopâtre s’avança. L’image de l’urœus sacré ombrageait son front ; ses yeux, dont la couleur était changeante, regardaient loin devant eux ; ils semblaient refléter l’infini des flots et les abîmes plus insondables encore de son cœur.
Sur son passage, les choristes psalmodiaient un vieux refrain populaire égyptien ; chaque théorie de chanteurs en scandait une phrase qu’accompagnait un ronflement de tambourins et de sistres :
La prêtresse d’Hathor est une palme d’amour,
Une palme d’amour auprès du Roi.
Noire est sa chevelure, plus que le noir de la nuit,
Plus que les baies du prunellier ;
Rouge sa joue plus que les grains de jaspe rouge,
Plus que l’entame d’un régime de palmes.
Ses seins sont bien plantés sur sa poitrine[25].
À côté de Cléopâtre et la dépassant d’une demi-coudée, marchait Antoine. Le triumvir portait le costume des souverains d’Arménie ; une longue saie aux couleurs écarlates enveloppait son torse puissant ; sur sa tête s’élevait la cidaris pointue, surmontée d’une triple rangée de perles. Sa barbe, qu’il laissait pousser tout entière, s’épanouissait en touffes abondantes.
Derrière Antoine et Cléopâtre venaient, dans l’ordre prescrit par le cérémonial, le grand prêtre Paësi et les invités de la maison royale.
Ils entrèrent dans la salle du festin ; les deux souverains prirent place sur un lit de pourpre rehaussée d’or.
Quand tous les invités furent assis, de jeunes esclaves vinrent distribuer les couronnes. Elles étaient faites de plusieurs sortes de fleurs et particulièrement de roses et de feuillages de nard ; les convives s’en ceignirent le front, le cou et la taille.
La masse du peuple se rua autour des tables dressées en plein air et sur lesquelles, dans les intervalles du banquet, on introduisit des combats de coqs et de cailles dressés à l’avance à ce jeu barbare.
Cependant Antoine, que des fêtes répétées avaient rendu à ses vieilles habitudes de débauche, paraissait plus gai que jamais et plaisantait avec ses compagnons d’armes. Le vin avait déjà coulé dans les coupes et les mets rares avaient circulé en abondance. Les larges portes d’ébène de la salle furent ouvertes, et la foule qui était dehors se mêla aux convives royaux.
Alors le triumvir se leva ; ses soldats s’étaient groupés autour de lui ; il effeuilla les pétales de sa couronne dans sa coupe ; puis après l’avoir portée à ses lèvres il la présenta à Cléopâtre qui la vida d’un trait. Tous les Inséparables dans la Mort, tous ceux qui s’étaient fait serment de ne pas se survivre les uns aux autres et de sacrifier leur vie pour la même cause, vinrent à leur tour boire les couronnes. Les coupes circulaient de main en main ; chaque fois qu’il en passait une devant Antoine, le triumvir y prenait une large gorgée.
À la fin, quand les derniers pétales des fleurs eurent été effeuillés, Antoine fit de nouveau remplir sa coupe ; aux acclamations des convives, il la tint élevée sur le front de Cléopâtre et, d’une voix de buveur heureux que des libations copieuses n’avaient pas affaiblie, il chanta :
Oui, buvons aux Inséparables.
Que les dieux leur soient favorables,
Que les Amours planent sur eux !
Ceux qui savent chanter et boire
Sont plus proches de la victoire
Que les tristes et les peureux !
Dans le breuvage aux reflets roses
Puisons l’oubli des jours moroses
Et l’ardeur du devoir pressant.
Au lendemain de nos orgies
Plus fortes sont nos énergies
Et plus fiévreux est notre sang.
La vie est courte, la mort proche ;
Buvons ! Et bientôt sans reproche
Nous combattrons jusqu’au dernier.
Que peut-on regretter sur terre
Quand avant d’affronter la guerre
On a vécu son rêve entier ?
Un tumulte indescriptible suivit ces couplets. Antoine était bien à ce moment-là redevenu l’idole de ses soldats et le maître du peuple.
Seul, pendant cette scène de triomphale joie, Paësi était demeuré muet ; ses bras pendaient immobiles sous les plis de l’éphod que retenait à sa taille une splendide ceinture de fin lin ; sur sa poitrine aussi immobile que celle d’un dieu de granit, le zodion saint étincelait.
Antoine l’interpella :
« Eh bien ! respectable Paësi, ni les vins capiteux du Massique ni les liqueurs ambrosiaques dont Cléopâtre n’a donné le secret qu’à une seule de ses esclaves n’ont donc pu réussir à te dérider ? Te voilà aussi renfrogné que si tu avais pour tout souper des macres arrosés d’eau du Nil, — la plus savoureuse, dit-on, qui soit au monde, ce que j’ignore, n’en ayant jamais goûté. »
Le vieux prêtre souleva ses paupières ridées.
« Il vaudrait mieux pour vous, Marc-Antoine, dit-il, ainsi que pour l’auguste reine Cléopâtre, que vous en eussiez fait plus souvent usage. Autrefois les rois d’Égypte étaient accoutumés à des aliments simples ; ils se nourrissaient de chair de veau et d’oie et ne devaient boire qu’une certaine mesure de vin, afin d’éviter de donner à leurs sujets l’exemple honteux de l’ivresse.
— En ce cas, répliqua Antoine, ils ne leur donnaient pas non plus une ample part à leurs festins ni aux réjouissances d’une fête comme celle-ci. »
Des murmures approbatifs se firent entendre. Cléopâtre passa ses bras nus et parfumés autour du cou de son amant :
« Ne tourmente donc pas ainsi mon prêtre, Antoine ! dit-elle avec un sourire. Paësi est né triste et mourra triste ; les dieux en ont décidé ainsi. »
Le triumvir poussa un rire bruyant.
« Félicitons-nous alors de ne l’avoir pas enrôlé dans notre association des Inséparables. Je souhaite pour traverser le Styx voir des visages plus gais que le sien. Mais, quoi que tu puisses dire, divine Cléopâtre, le Grand Prêtre a quelque pensée plus sombre aujourd’hui. Il se sera endormi dans le temple de Sérapis et y aura fait sans doute un mauvais rêve. »
Paësi cette fois étendit les bras ; il répondit d’une voix dure :
« Il n’est pas besoin de faire de tels rêves pour que la crainte des catastrophes prochaines fasse trembler ceux que la folie ou l’ivresse n’ont pas encore atteints. Dois-je vous rappeler tous les présages malheureux qui vous concernent et tous les avertissements que les dieux nous ont donnés par des signes ? À votre approche les ibis sacrés se sont enfuis de nos temples ; parmi l’horreur des nuits occidentales la voix des typhons a gémi ; dans Albe votre statue de marbre a sué le sang ; dans Athènes elle a été renversée, seule, au milieu des autres restées debout !
— Assez ! assez ! cria Antoine (il affectait de rire très haut, mais en réalité il craignait sur la foule superstitieuse le mauvais effet des paroles du prêtre). — Belle Taïa, fais-nous entendre quelque chant d’amour ; cela nous purgera les oreilles des gémissements de cet oiseau de mauvais augure ! »
La gaîté interrompue un instant par ce colloque reprit plus vive. Bientôt apparurent des musiciennes en grand nombre diversement vêtues. Des jeunes filles syriennes, belles d’une beauté langoureuse particulière à leur race, portaient dans leurs mains des cithares d’argent ; leur tête fine était ornée du voile de Sidon, que les femmes d’Égypte avaient su rendre plus transparent encore en séparant avec l’aiguille les fils de ce léger tissu ; des Syracusaines, glorieusement parées de longues robes surchargées de broderies, se tenaient debout, inclinées sur les volutes d’or de leurs harpes ; enfin de jeunes Athéniennes couronnées de violettes et de lierre, presque nues sous la mince tunique couleur de safran, pressaient contre leur poitrine la lyre à cinq cordes. Toutes devaient suivre la phrase musicale de la chanteuse et l’accompagner sur un rythme que décidait le caprice de son inspiration.
Au milieu d’elles Taïa s’avança ; ses yeux ardents et fauves se posèrent sur le visage divin de Cléopâtre ; sa voix passionnée phrasait les paroles de l’hymne, comme si elle-même les eût composées à cet instant pour répondre à un besoin de sa pensée. Elle dit :
« Ton amour pénètre en mon sein, de même que le vin se répand dans l’eau ; de même que le parfum s’amalgame à la gomme ; de même que le lait se mêle au miel.
— Ô ma souveraine, ô ma sœur ! les baies odorantes qui causent ton ivresse, je ne les jetterai point aux quatre vents du ciel ; on ne les écrasera pas à la veillée de l’inondation, en Syrie avec des bâtons de cyprès, en Éthiopie avec des branches de palmier, sur les hauteurs avec des rameaux de tamaris, dans la plaine avec des tiges de souchet.
— Mais pour te plaire je m’embarquerai sur le canal, j’entourerai mes épaules de myrte et j’arriverai à Ouktnoui et j’adresserai ma prière à ton dieu :
« Que ma sœur soit pendant la nuit comme la source d’eau dont les myrtes sont semblables à Phta ; qu’elle éclaire la terre de sa beauté, que Memphis garde pour elle la boîte de fard qu’on apporte de Nofrino ! »
— Je serai sur le rempart, mon sein plein de fleurs de persea, mes cheveux alourdis d’essences[26]. »
Elle s’agitait, se grisant elle-même au souffle vibrant de ses paroles ; ses yeux n’avaient pas quitté le visage de Cléopâtre. La reine, les bras étendus sur les deux bords de sa couche, avait abaissé ses paupières lourdes et semblait écouter sa suivante dans un recueillement voluptueux.
D’un rythme plus lent, que soutenaient à peine les arpèges onduleux des luths, Taïa reprit :
« Le figuier ouvre sa bouche et son feuillage va dire : apprends de moi ce qu’on te veut.
— Je viens vers une maîtresse qui certes est une reine ; et moi je suis l’esclave de la bien-aimée ; elle m’a fait mettre dans son parc, elle ne m’a pas donné un breuvage commun.
— Le petit sycomore, qu’elle a planté de sa main, ouvre sa bouche pour parler. Ses accents sont doux comme l’écume d’un miel excellent ; ses touffes sont gracieuses, plus fleuries que celles du sorbier, chargées de baies plus rouges que la cornaline ; ses feuilles sont serrées et bariolées comme l’agate ; son bois est de la couleur du jaspe vert ; ses grains sont comme le tamaris ; son ombre est fraîche et éventée de brise :
— Ô ma souveraine, ô ma sœur, viens ! Passe un instant ici au milieu des jeunes femmes. Le verger est dans son beau jour ; les gouverneurs des domaines se réjouissent et tressaillent de plaisir à ta vue ; tes esclaves défilent en ta présence, armés de leurs outils, grisés de leur ardeur à courir vers toi. Les serviteurs viennent avec leur appareil, apportant de la bière et toutes sortes de pains mêlés, des plantes nombreuses et tous les fruits plaisant à tes lèvres, matin après matin, trois jours de suite.
— Ô souveraine, ton maître est assis à ta droite : fais ce qu’il veut ; enivre-le selon son désir ! La salle où l’on boit est bouleversée par l’ivresse. Soulève ton voile sans crainte ; moi, j’ai le sein fermé ; mes yeux ne diront pas ce qu’ils ont vu et ma bouche gardera le silence. »
Elle se tut. De nouveau les coupes avaient été remplies et vidées ; d’autres musiciens étaient venus prendre place sur l’estrade avec des instruments bruyants, des sistres, des tambourins, des sambouques, dont ils accompagnèrent les dernières phrases musicales de la chanteuse. En même temps un adolescent entra dans la salle ; il marchait gravement, le corps enguirlandé de fleurs, portant dans ses mains une petite momie en bois sculpté, étendue dans un cercueil. Il la présenta à Cléopâtre en disant :
« Regarde ceci et hâte-toi de boire et de jouir ; car telle tu seras après la mort. »
Cléopâtre prit la momie des mains de l’adolescent ; elle la donna à Marc-Antoine, en répétant la même formule. Puis chaque assistant à son tour accomplit le rite et prononça les mots consacrés.
C’était là ce qu’on appelait le Maneros[27] ; les Égyptiens, qui se plaisaient aux contrastes violents, avaient dès longtemps adopté cette coutume d’introduire dans leurs fêtes, au moment où la gaîté était à son comble, le symbole inoublié de la mort.
Quand la momie eut ainsi circulé de main en main, un chœur de jeunes hommes, qui avait remplacé Taïa au centre de l’estrade, entonna un hymne ; c’était un de ces chants où dominait un sentiment, toujours le même, cher à la théologie de l’Égypte : l’adoration de la vie en toutes ses formes avant que les puissances destructives aient réussi à l’anéantir.
Ils entonnèrent d’une voix forte :
Ra se lève
Au matin ;
Toum achève
Son destin.
L’homme engendre
Et son fruit,
Sans attendre,
Est détruit.
Fais un heureux jour,
Ô prêtre aux mains pures,
Ô Nofrihotou !
Un ah ! énervé, que poussaient tous les assistants, était l’applaudissement obligatoire de cette finale à chaque fois qu’elle revenait ; et leurs mains qu’ils frappaient l’une contre l’autre soutenaient la mesure et accompagnaient les chanteurs.
Le chœur reprit :
La narine
Hume l’air ;
La poitrine
Boit l’éther,
Jusqu’à l’heure
Où nous prend
La demeure
Du Dieu grand.
Fais un heureux jour,
Ô prêtre aux mains pures,
Ô Nofrihotou !
Des parfums nouveaux avaient été apportés ; maintenant sur les réchauds fumait l’essence du pays de Pounit, que l’on ne pouvait faire brûler qu’après le coucher du soleil. D’autres coupes plus profondes étaient distribuées, dans lesquelles les esclaves versaient une liqueur d’ambre.
Les chanteurs continuèrent ensemble :
Ta sœur t’aime,
À ses pieds
Cours et sème
Des pourpiers,
Des offrandes
De crocus,
Des guirlandes
De lotus.
Fais un heureux jour,
Ô prêtre aux mains pures,
Ô Nofrihotou !
Une pluie de fleurs, toutes les fleurs de l’île, arrachées par les mains avides des Alexandrins, s’épandit alors sur Antoine et sur Cléopâtre. Les deux souverains disparaissaient presque sous l’amoncellement des pétales embaumés ; frénétiquement toutes les mains battaient, hâtant par leurs claquements sonores le rythme des instruments :
Que ta fête
Soit sans prix :
Oins ta tête
D’ambre gris,
Geins ta taille
De lin blanc,
Tau tressaille
Dans ton flanc.
Fais un heureux jour,
Ô prêtre aux mains pures,
Ô Nofrihotou !
À ce moment, une nuée de jeunes vierges vint se placer sur le devant de l’estrade ; des écharpes transparentes les enveloppaient savamment, laissant nus et libres leurs jambes souples et leurs bras encore graciles. Elles aussi marquèrent des pieds et des mains le mouvement qui s’accélérait, au point de donner à peine aux chanteurs le temps de prononcer les paroles.
Ils dirent :
Livre, livre
Au plaisir
Qui t’enivre
Ton désir ;
Chante et danse
Jusqu’au soir
Du silence
Sans espoir.
Fais un heureux jour,
Ô prêtre aux mains pures,
Ô Nofrihotou !
Un ah ! plus formidable que les autres couvrit cette finale. Maintenant dans les allées comme dans la salle immense, d’un bout à l’autre de l’île, les convives s’étreignaient, pris de fièvre, dansant au son des instruments et des voix, sous les feux de la voûte illuminée et dans le prolongement des verdures. Et de plus en plus le mouvement se précipitait ; les paroles se heurtaient.
Ce fut au milieu de cris sauvages que le chœur acheva son hymne :
Va, redouble
Tes transports ;
Mets le trouble
Dans ton corps.
Le temps presse :
Plus qu’hier
Mets l’ivresse
Dans ta chair.
Fais un heureux jour,
Ô prêtre aux mains pures,
Ô Nofrihotou ![28]
Le matin, quand le soleil se leva, les amschirs fumaient encore ; mais Antoine et Cléopâtre avaient disparu dans leur trirème, laissant le peuple d’Alexandrie consommer à son aise l’orgie de la veille.
CHAPITRE IV
Sous un quinconce de térébinthes, au fond des jardins de Cléopâtre, Kaïn attendait Taïa.
Bien que revêtu de la tunique de coccina qu’il portait pour faire travailler les esclaves, et ayant encore à son côté le fouet du commandement, le Psylle était inoccupé. Il marchait la tête basse et les bras pendants, sans s’inquiéter des zigzags de feu que filtraient les rameaux élargis des arbres et qui venaient par instants mordre sa nuque découverte.
C’était l’heure la plus chaude de la journée, celle où le soleil était au zénith. Alors toute animation cessait dans Alexandrie, et riches et pauvres, maîtres et serviteurs se retiraient dans les maisons pour s’abandonner au repos.
Taïa avait choisi ce moment et cet endroit désert pour donner rendez-vous au Chef des esclaves. Le matin, elle lui avait fait dire de l’attendre, et il était venu, agité d’une inquiétude vague, ne sachant pas dans quel but la Libyenne, qui pouvait le voir chaque jour autour du palais, l’avait convié à cette mystérieuse entrevue.
Il était là depuis longtemps déjà, à en juger par la marche descendante du soleil qui dardait maintenant ses rayons obliques sur la sur face d’une piscine où Cléopâtre avait parfois la fantaisie de venir se baigner. Il existait même dans cet endroit, pour servir au délassement de la reine, un pavillon en bois du Liban, ce qui était une chose unique dans Alexandrie, où toutes les maisons étaient de pierre ou de brique. Kaïn aurait pu y entrer et s’y reposer, car les portes en étaient ouvertes et du quinconce d’arbres verts on apercevait la première chambre tendue d’étoffes étrangères ; mais il préféra calmer l’agitation de sa pensée en continuant de marcher en tous sens.
Machinalement ses yeux se fixaient sur les naïades de marbre blanc qui émergeaient devant lui de l’eau limpide. Elles renversaient leurs torses nus sous les caresses brûlantes du soleil. Les rayons de l’astre ardent leur entraient dans les yeux, s’enfonçaient dans leurs narines, les baisaient à la bouche, animaient d’une apparence de vie les méplats luisants de leurs faces. À chaque fois que le Psylle passait, les jeux capricieux de la lumière leur donnaient une expression différente.
Taïa arriva enfin ; et de très loin il la vit s’avancer entre les colonnes régulières des arbres ; elle marchait lentement, paraissant ignorer la longue attente dont elle avait été l’objet. D’un mouvement irréfléchi Kaïn s’était pelotonné derrière un massif de lentisques ; c’était le caractère particulier à sa race qui ressuscitait en lui tout à coup, l’instinct qui poussait le Psylle à se dérober à la vue de la femme qu’il convoitait — comme au passage du serpent qu’il guettait naguère parmi les hautes herbes, dans les plaines onduleuses de la Syrte.
La jeune fille traversa le quinconce, fit le tour de la piscine, sonda du regard les allées avoisinantes ; elle ne vit rien.
Alors, levant la tête, elle interrogea l’horizon ; le soleil qui s’éloignait marquait sans doute une heure plus avancée qu’elle ne pensait, car sa figure prit une expression d’inquiétude. Toutefois, sans s’attarder davantage, elle disparut dans le pavillon de la piscine.
À présent, Kaïn ne savait plus comment la rejoindre. Il se reprochait de s’être caché à sa venue et de ne pas lui avoir laissé l’initiative de la première parole échangée. Dans son âme primitive cela s’agitait confusément, se mêlant à un autre sentiment naturel, celui de n’être plus pressé de satisfaire sa curiosité, puisque Taïa l’attendait et ne pouvait quitter le pavillon sans qu’il l’eût aussitôt rejointe.
Pourtant il se décida à sortir de son abri ; et, dès qu’il eut aperçu de nouveau la Libyenne, la même émotion vague le ressaisit.
Elle était assise au fond de la chambre sur un tabouret de jaspe, les coudes aux genoux et la tête dans les mains ; il resta debout devant elle sans trouver une parole.
Après quelques instants de silence elle découvrit son front :
« Tu as bien fait de venir, Kaïn, lui dit-elle ; voilà bien des jours que je voulais te parler seul à seule ; ici, du moins, nous ne serons dérangés par personne. »
Il crut qu’elle faisait allusion à leur rencontre nocturne au Sebasteum ; peut-être même était-ce pour le remercier de l’avoir défendue qu’elle l’avait appelé là. Il en fut rasséréné un peu. Mais elle reprit :
« Pour t’avoir donné ce rendez-vous dans cet endroit isolé des jardins, à cette heure où tout le monde repose, il fallait que j’eusse un motif unique. Cherche ; dis-moi si tu as deviné ma pensée. »
Elle avait incliné en arrière son visage, sur lequel Kaïn se tenait penché ; lentement leurs regards se pénétraient, entraient l’un dans l’autre comme les jets de lumière de deux foyers opposés.
Le Psylle, de plus en plus bouleversé, répondit :
« Je ne sais pas,… je ne puis comprendre… »
Taïa, le tenant toujours sous la domination de ses yeux fauves, ajouta lentement :
« Il est un être dont l’amour m’a prise et enveloppée tout entière ; un être à qui je me suis juré de donner toutes mes forces et toute ma vie en reconnaissance de sa tendresse. C’est cela qu’il faut que tu saches et c’est pour te l’apprendre que je suis venue. »
Kaïn tomba sur ses deux genoux comme un homme que terrasse un heurt violent entre les épaules ; sans quitter les yeux de Taïa, il murmura suppliant :
« Oh ! quel est cet être ? Dis-moi son nom ! »
Un voile venait de se déchirer devant lui ; il crut qu’il allait saisir enfin les visions fugitives de ses rêves et tout tremblant il tendit les mains vers la Libyenne.
Maintenant elle s’inclinait pour lui répondre ; ses lèvres touchaient presque le front du Psylle ; elle murmura d’un souffle brûlant :
« Cléopâtre ! »
Il se redressa, comme touché d’un fer rouge ; son regard s’était détourné. Ce fut d’une voix sans accent qu’il répondit :
« Eh bien, quoi ? Qu’as-tu à me dire de Cléopâtre ? »
Alors longuement, pleine de l’idée qui la dominait, Taïa commença par expliquer au Chef des esclaves la situation presque désespérée de la reine ; avec mille détails précis qu’elle était seule à connaître, elle lui montra le désarroi dans lequel était tombé le royaume et que l’on cachait au peuple en l’enivrant de fêtes perpétuelles ; mais chaque jour apportait l’annonce de nouvelles trahisons. Le roi des Mèdes, celui du Pont et de la Cilicie, qui jusque-là faisaient cause commune avec l’Égypte, l’avaient abandonnée depuis la défaite. Hérode, roi des Juifs, qui devait son royaume à l’intervention d’Antoine, venait d’embrasser le parti de Rome. Enfin les peuples limitrophes, dont on sollicitait l’appui, se renfermaient dans l’indifférence et refusaient de recevoir les envoyés d’Antoine et de Cléopâtre. Pendant ce temps, la puissance d’Octave s’affermissait de tout ce que celle d’Antoine perdait chaque jour. Le triumvir s’était, il est vrai, rendu en Cyrénaïque afin d’essayer encore une fois de réunir les débris de son armée et de les ramener à Alexandrie pour résister à l’attaque prochaine qu’Octave préparait contre cette ville ; mais l’issue de cette tentative était trop facile à prévoir. Puis le triumvir et la reine étaient fatigués de combattre. Cléopâtre surtout se sentait lasse de ce trône qui lui avait coûté tant de luttes depuis dix-neuf ans[29] : au prix de quelles hontes accumulées ne l’avait-elle pas acheté d’abord, conservé ensuite ! Jules César, Sextus Pompée, Marc-Antoine s’étaient succédé dans la couche d’où la reine d’Égypte dictait ses volontés au monde.
En énumérant ces choses, la voix de Taïa tremblait ; Kaïn, toujours immobile, l’écoutait dans la même attitude prostrée.
« Cléopâtre, ajouta-t-elle, n’a plus qu’un rêve : échapper à la domination d’Octave-Auguste et fuir avec Marc-Antoine dans quelque île isolée de l’océan Indien ; pour cela elle a résolu de faire transporter ses navires à travers l’isthme qui sépare la Méditerranée du Golfe Arabique[30]. C’est une entreprise difficile, mais non pas impossible. Tu sais, Kaïn, que la reine a toujours triomphé des obstacles les plus invincibles et mené à bien tout ce qu’elle a tenté. Déjà des préparatifs considérables ont été faits dans ce but. D’énormes chariots ont été amenés jusqu’à l’entrée de l’isthme afin de recevoir les navires, qui seront transportés de la sorte et relancés ensuite dans les eaux du Golfe. Il ne manque plus à la reine, pour faire réussir cette opération, qu’un homme sûr et dévoué, intelligent et fort, qui dirige les autres et ne se laisse pas séduire par les promesses des chefs ennemis. »
Elle s’arrêta de parler un instant, puis reprit en regardant Kaïn :
« J’ai pensé à toi, et je suis venu te demander d’être cet homme. »
Le Chef des esclaves répondit froidement :
« Taïa, je n’ai ni l’habileté, ni la puissance que tu me prêtes dans ton amour pour ta maîtresse, et je me contente de faire ma besogne quotidienne sans me mêler aux graves affaires du royaume. D’ailleurs le projet dont tu me parles est insensé. De lourds vaisseaux de guerre comme ceux de Cléopâtre et d’Antoine ne se manœuvrent pas comme des barques de papyrus. Encore si c’était les légers navires d’Octave que nous voyons chaque jour courir à pleines voiles sur la mer… »
Taïa l’interrompit :
« En mettant plus de bras et plus de bêtes de trait, on arriverait à transporter les gros navires comme les petits. Puis l’isthme n’est pas bien long à parcourir ; neuf cents stades à peine. On a fait faire bien plus de chemin aux blocs immenses que l’on a taillés dans la montagne de Porphyre et dans la gorge des Émeraudes pour la construction des pyramides. Rien n’est impossible quand on le veut. »
Elle se faisait persuasive, presque tendre. Jamais Kaïn ne l’avait vue ainsi ; il résistait cependant, secouant obstinément sa tête ronde, blessé encore douloureusement de sa désillusion de tout à l’heure.
Pourtant elle lui avait pris les mains et l’avait forcé à s’asseoir à côté d’elle sur un siège plus bas ; le contact de cette chair nerveuse et fine faisait au Psylle courir un frémissement par tout son corps. De nouveau, le souffle de la Libyenne lui effleurait les tempes quand elle parlait ; et elle trouvait mille bonnes raisons à donner pour qu’il acceptât.
Maintenant elle lui faisait un tableau riant du bonheur de Cléopâtre dans l’île rêvée, et ce nom qui revenait sans cesse sur ses lèvres y prenait une saveur étrange de passion, une accentuation dont les vibrations brûlaient encore au passage le front de Kaïn.
À la fin il serra fiévreusement dans ses mains les mains de Taïa :
« Cléopâtre ! rugit-il ; toujours Cléopâtre ! Tu n’as que ce nom à la bouche, que cette image devant les yeux ! Pour aller à elle tu foulerais sans pitié tout ce qui se trouverait sur ton chemin ! Que t’a-t-elle donc fait, la souveraine ? Quel philtre t’a-t-elle donné à boire pour que sa volonté soit entrée en toi si profondément ? »
Il s’était levé et marchait dans l’étroite salle avec des mouvements de bête fauve enfermée dans une cage.
Taïa avait allongé son corps brun et restait immobile à le regarder, telle la femelle d’un tigre habituée aux violences du mâle.
« Pour elle, continua-t-il, tu veux m’envoyer de gaîté de cœur me faire écraser comme un scorpion avec les autres. Mais cela ne te fait rien, n’est-ce pas, tout au contraire cela te réjouit qu’on s’expose à être tué pour Cléopâtre ? Puis, quand je me serai brisé les reins à transporter ses vaisseaux, tu partiras avec elle là-bas et tu passeras ta vie à te rouler à ses pieds, et à respirer les parfums de sa chair méprisée. Tiens ! je vous hais, toi, elle, et tout ce qui vous touche. »
Il pantelait, aplati à terre, le front sur les dalles. La Libyenne, sans lui répondre, se dirigea vers la porte ; mais il la saisit par les pans flottants de son écharpe. Il sentait que, s’il la laissait s’éloigner ainsi, elle lui échapperait sans retour, et que, s’il ne lui disait pas maintenant, dans le flot montant de sa colère, tout ce qu’il avait de passion au cœur, il ne pourrait jamais le lui apprendre.
« Écoute-moi, supplia-t-il, j’ai menti tout à l’heure ; il n’est pas vrai que ma pensée t’ait maudite. Je t’aime et toute ma vie t’appartient. »
Il cherchait à contenir les hoquets tumultueux de sa gorge et parlait maintenant à voix basse.
« Comment as-tu été assez aveugle pour ne pas le voir, assez indifférente pour ne pas le sentir ? Je t’ai aimée toute petite, quand la reine t’a ramenée de l’oasis d’Augila. Tes cheveux étaient encore courts et tes seins n’étaient pas formés ; mais tu m’apportais les senteurs de mon désert et dans tes yeux je reconnaissais les reflets du soleil de ma terre natale. Je te voyais grandir et mon amour grandissait avec toi. À cause de cela je n’ai pas voulu m’éloigner du palais et quand mes huit années de servitude ont été accomplies, je me suis laissé percer l’oreille droite avec le poinçon, en signe d’esclavage perpétuel. Je veillais sur toi constamment, prêt à te venir en aide au moindre péril qui t’aurait menacée. La nuit, tu m’apparaissais dans mon sommeil ; je rêvais que nous dormions ensemble sous les palmiers de la Syrte, ton front sur mon épaule et mes bras noués à ta ceinture. Je t’aime plus que la lumière de mes yeux, plus que le pain qui nourrit ma bouche. »
Il s’arrêta de parler et se cacha la tête dans ses mains, étonné d’avoir trouvé des paroles et d’avoir osé les prononcer. Et Taïa, qui songeait toujours à Cléopâtre, avait déjà pesé dans son cœur tout le parti qu’elle pourrait tirer de cet aveu.
Avec autorité elle s’empara des poignets du Psylle et le força à se découvrir le visage ; tous deux étaient debout l’un devant l’autre, tellement près que les tresses relevées sur le front de Taïa effleuraient par instants le menton luisant de Kaïn.
« Je ne savais pas que tu m’aimais, lui dit-elle lentement, et, si je l’avais su, cela n’aurait rien changé à ma vie puisque tu n’aimes pas Cléopâtre ; je ne me donnerai jamais qu’à celui qui partagera mon dévouement à la reine. Bien souvent j’ai regretté de n’être qu’une femme et de ne pouvoir accomplir ce que je rêve pour le salut de ma divine maîtresse. Parfois je pensais à toi, et je me disais que si tu voulais… Mais je ne sais pourquoi la reine t’inspire un sentiment de colère ; tout à l’heure encore tu osais parler d’elle avec mépris ; tu qualifiais ses projets d’insensés. »
Elle disait cela à voix basse sans le regarder, tandis qu’il se grisait au parfum qui montait de sa chevelure ; les paroles de la jeune fille lui arrivaient très douces comme à travers une musique de brise ; il la serra violemment sur sa poitrine :
« Il n’y a plus rien d’insensé, puisque j’ai l’espérance de ton amour ; pour toi je traverserais les cataractes du fleuve ; je passerai au milieu des flammes si tu m’aimes. »
Elle resta appuyée contre lui :
« Alors tu consens à faire ce que je te demande ? »
Kaïn fit un signe d’assentiment.
« Et tu partiras ?
— Dès que la reine m’en aura donné l’ordre. »
Elle s’arracha à son étreinte et s’éloigna d’un pas rapide après l’avoir enveloppé une dernière fois dans le rayonnement de ses yeux d’or.
CHAPITRE V
Entre Péluse et Arsinoé un canal existait[31], reliant la Méditerranée à la mer Rouge. C’était le travail accumulé des générations endormies maintenant dans les hypogées ; l’œuvre tentée à maintes reprises par le génie des souverains glorieux de l’Égypte, depuis les anciens Pharaons qui en avaient conçu la première idée jusqu’au second des Lagides qui en avait achevé l’exécution. Le grand Ousortesen Sesostris, Nekao fils de Psametikos, Darius Hystaspes, Ptolémée Philadelphe enfin, avaient tour à tour étudié et poursuivi la gigantesque entreprise. Pendant un espace de plus de vingt siècles, des millions de bras humains avaient par intervalles creusé le sol sablonneux de l’isthme, des millions d’existences humaines étaient descendues dans des profondeurs que le travail accompli rendait chaque jour moins accessibles.
Faire aux ondes tumultueuses de la Méditerranée un lit assez large pour qu’elles pussent y tenir à l’aise n’était pas chose facile ; d’autre part, il fallait éviter que les eaux de la Mer Rouge, dont le niveau était de trente pieds plus élevé, ne vinssent s’engouffrer dans le canal, dont elles seraient sorties pour tout submerger autour d’elles. Mais ni la patience des Pharaons ni le génie des Ptolémées ne devaient se rebuter à ces obstacles ; avec un art étonnant et après bien des essais successifs, ils arrivèrent à imaginer un système de barrages mobiles qui permit de livrer passage aux gros vaisseaux sans que le péril de l’inondation fût à redouter.
Des richesses considérables, venant des lointaines métropoles de l’Asie, étaient par ce moyen déversées dans le royaume : les toiles de pourpre de l’île Taprobane, les éléphants de l’Inde, plus beaux et plus forts que ceux de l’Afrique ; les cristaux merveilleusement colorés de la Chersonèse ; les sacs énormes remplis de poudre d’or que les bâtiments faisant escale à la côte occidentale du golfe chargeaient en passant, tout cela arrivait directement dans les villes maritimes du Delta et jusque dans les deux ports d’Alexandrie. Longtemps la ville de Coptos en Thébaïde avait été l’entrepôt de ce commerce[32]. Les marchandises débarquées à Myoshormos étaient péniblement apportées à dos de mulets ou d’éléphants et distribuées de la même façon dans toutes les directions de l’Égypte.
Il eût été facile à Cléopâtre de se servir du canal pour le passage de ses navires mouillés dans la Méditerranée ; mais le canal s’ouvrait à Péluse, et Péluse, qui était la clef de l’Égypte, restait strictement gardée à vue par la flotte d’Octave. Ce fut donc à Tanis que Kaïn reçut l’ordre de se rendre, pour procéder au formidable transbordement dont, à la prière de Taïa, il avait accepté la conduite. Malgré la position isolée du lieu, des précautions avaient été prises afin que les travaux restassent inaperçus ; on devait attendre la nuit pour opérer le chargement des navires sur les grands chariots qui seraient dirigés ensuite à travers la plaine de l’isthme jusqu’aux premiers rivages du golfe.
Cinq mille esclaves avaient été réunis pour cette besogne parmi les plus robustes de ceux qui travaillaient à l’exploitation des mines d’or du Sud ; deux mille appartenaient à l’équipe qui creusait les carrières de granit dans les environs de Syène. Tous étaient des criminels condamnés ou des prisonniers de guerre ; ils portaient entre leurs sourcils le sceau ineffaçable de l’esclavage qui rendait leur évasion impossible ; là-bas, ils peinaient jour et nuit sans relâche, sous la surveillance de soldats que l’on choisissait exprès ignorants de leur idiome, afin qu’ils ne pussent se laisser attendrir par les supplications de ces malheureux[33].
En attendant le moment de se mettre à l’œuvre, ils s’étaient répandus un peu partout aux abords de Tanis et dans la ville même ; la plupart s’étaient couchés le long des lagunes, sur le sable encore tiède du soleil brûlant de la journée ; d’autres avaient escaladé le plateau du Grand Temple, d’où leurs yeux, habitués aux obscurités souterraines, se fatiguaient à contempler l’immense plaine mouvante de la Méditerranée. Autour de l’enceinte des deux cimetières quelques-uns rôdaient, pris déjà de l’oubli de toutes choses, comme ceux qui dormaient leur dernier sommeil dans les demeures funèbres.
Cette ville de Tanis[34], l’une des plus opulentes de la basse Égypte à l’époque du Moyen et du Nouvel-Empire, avait perdu peu à peu, sous la domination grecque, son ancienne splendeur. Des nombreux obélisques recouverts d’hiéroglyphes à la glorification des Ramsès, sept seulement étaient restés debout. Les sphinx des Hyksos, qui gardaient l’entrée du Grand Temple, chancelaient sur leur base de granit ; ils semblaient expier ainsi par cette décadence prématurée le crime d’appartenir à une race et à un art étrangers à l’Égypte. Au lieu de la beauté tranquille et régulière des figures hiératiques, ils avaient la tête osseuse, les yeux petits, les pommettes saillantes, les lèvres épaisses des guerriers chaldéens ; la crinière des lions d’Assyrie s’étalait en nappes lourdes sur leurs épaules. Un mystère était en eux qu’augmentait encore la mutilation de leur visage ; ces faces dont le nez avait été écrasé à dessein défiaient l’investigation de la pensée ; leur expression restait problématique, perdue tout entière dans cette trouée des fosses nasales, à travers laquelle on cherchait vainement à reconstituer l’harmonie disparue des traits.
À l’entrée du Temple de l’Est, élevé par Ramsès II à Phta, la Souveraine Lumière, deux colosses énormes se contemplaient orgueilleusement. C’était d’abord la statue en granit rouge d’Amenemhat I ; le roi, assis et les mains allongées sur les genoux, dressait sa tête puissante que recouvrait une mitre oblongue ; ses oreilles, placées très haut, débordaient en relief sur la coiffure comme deux coquilles univalves ; et ses yeux proéminents, les yeux des grands sensuels de la dynastie diospolite, souriaient, voilés à demi par des paupières épaisses. En face de lui, et comme lui assis et les mains aux genoux, mais plus colossal encore, était le roi Sésonkis[35]. L’Ousortesen, taillé dans la syénite noire et brillante, rayonnait d’une splendeur farouche ; il était coiffé de la partie supérieure du pschent ; sa barbe longue et carrée descendait jusqu’au milieu de sa poitrine.
Ces deux géants résumaient en eux l’âge héroïque de la sculpture égyptienne ; jamais en effet, à aucune époque, les contours n’avaient été polis avec plus d’art, les lignes découpées avec plus de science que par les statuaires de la douzième et de la treizième dynastie. Ces artistes modelaient leurs colosses avec un soin aussi méticuleux que pouvait en mettre un lapidaire à ciseler un camée et les livraient ainsi à l’immortalité des siècles dans toute la perfection de leur humanité agrandie.
Puis, sortant de ces deux géants, de même que tous les êtres à l’origine sont sortis des deux divinités premières, des milliers de statues des Sebek-Hotep et des Ramsès peuplaient les avenues, remplissaient les dromos, se dressaient entre les obélisques, s’entassaient devant les propylones. Il y en avait de toutes les dimensions et de toutes les matières, depuis le calcaire blanc compact jusqu’au basalte gris ou vert, depuis le bronze jusqu’à l’albâtre, depuis la serpentine finement veinée jusqu’aux granits des nuances les plus variées : le rouge sombre qui semblait avoir absorbé les reflets du soleil couchant, le rose pâle à peine teinté des premiers rayons de l’aube et le noir dont toutes les surfaces, luisantes et polies comme des miroirs, réverbéraient les jets capricieux de la lumière.
Cependant la nuit était venue, sans crépuscule, ainsi que toutes les nuits d’Égypte. C’était le moment désigné par Kaïn pour que les esclaves se réunissent au bord du vaste estuaire formé par les eaux à quelque distance de Tanis. Dans la journée, des préparatifs avaient été faits ; d’énormes machines et des chariots immenses avaient été amenés jusque-là, et leurs masses sombres et confuses s’étalaient maintenant comme des mastodontes à travers les saules grêles du rivage. En même temps les vaisseaux de Cléopâtre apparaissaient dans la baie : on les devinait aux feux à peine visibles allumés à leur proue et au bruissement de leurs carènes qui fendaient l’onde avec un déchirement pareil à celui d’une lame pénétrant à travers une étoffe soyeuse.
Les esclaves entrèrent dans l’eau ; chacun portait, comme pour le travail souterrain des mines, un flambeau de résine attaché à son front ; ils traînaient derrière eux l’appareil qui allait servir à soulever les navires. Des plans inclinés furent placés à des distances égales, tandis que de chaque côté des mâts très élevés, destinés à supporter des moufles, étaient solidement plantés dans la vase. D’autres esclaves complètement nus s’enfoncèrent plus avant dans les eaux montantes ; ils attendaient, submergés jusqu’aux aisselles, que les vaisseaux fussent assez rapprochés pour y jeter les cordages des poulies que les hommes de bord devaient attacher aux anneaux des écoutes.
Quand le premier navire fut ainsi amarré, les esclaves, tous ensemble attachés aux cordages, tirèrent ; Kaïn les excitait du geste et de la voix, en poussant des cris rauques et inarticulés ; et, d’un même mouvement, ils tanguaient, les reins tendus, les épaules voûtées, emportés en arrière par le poids énorme du bâtiment, avançant quand même par la puissance de l’effort commun ; une sueur épaisse coulait sur leur corps déjà mouillé par l’eau du fleuve et y formait par places une seconde couche visqueuse. Plusieurs s’affaissaient sous le poids, cherchant vainement à se relever ; leurs pieds glissaient dans la vase comme ceux de chevaux embourbés ; mais, sans que la manœuvre en fût interrompue, d’autres venaient prendre leur place sur un signe impérieux de Kaïn.
Pendant plusieurs nuits, le travail continua de la sorte jusqu’à ce que les trente vaisseaux de Cléopâtre fussent chargés. C’était juste la moitié de ceux que Marc-Antoine, se défiant avec raison de la lâcheté proverbiale des Égyptiens, avait consenti à leur laisser armer au moment de la bataille d’Actium et sur lesquels la grande reine avait, à tout hasard, fait entasser d’immenses richesses.
Chaque navire était hissé, à mesure, sur un chariot que traînaient vingt chevaux asiatiques appartenant à la race élégante et forte que Thoutmès III avait importée de la vallée de l’Euphrate dans celle du Nil[36]. À l’entrée de la plaine basse et déserte de l’isthme, les chariots se rejoignirent, mais de grandes difficultés restaient encore à vaincre pendant le trajet. À chaque instant les chevaux refusaient d’avancer, flairant sous leurs pas la présence des serpents qui abondaient dans cette partie de l’Égypte. C’était le plus communément des scytales, ou des cérastes cornus dont la morsure causait d’atroces souffrances ; alors les esclaves poussaient des hurlements de terreur et se suspendaient par le milieu du corps aux montants élevés des chars, afin que leurs pieds ne touchassent pas le sol. Souvent Kaïn pour les rassurer descendait de sa monture et venait près d’eux ; le Psylle sifflait sur un mode lent et monotone, et, quand la vipère dardait à travers le sable sa tête triangulaire, il lui appuyait le pouce entre les yeux et la rendait par ce contact inoffensive, plongée dans une sorte de catalepsie. Quelquefois il s’en entourait le cou comme d’un collier dont les rangs s’élargissaient en descendant sur sa poitrine ; il ressemblait ainsi au dieu Râ enveloppé dans les anneaux du serpent Meheu et portant en lui-même la force et la plénitude de la vie.
À sa suite, les esclaves reprenaient leur marche vers Héroopolis. Il fallait parcourir la région redoutable où les prêtres avaient placé la demeure symbolique de Typhon ; c’était là que cet éternel ennemi du bonheur des hommes et de la fertilité de l’Égypte exerçait en secret ses néfastes influences. La ville d’Héroopolis elle-même était appelée dans les livres sacrés Aouaris[37] (malédiction), en souvenir de la tyrannie des Pasteurs attirés dans son enceinte par le Génie du mal.
À Héroopolis, le long convoi fit une halte. Les chevaux fatigués furent remplacés par des attelages de chameaux, que le voisinage de l’Arabie avait mis en usage dans le nome héroopolite. Encore deux journées et l’on arriverait à Arsinoé-Cléopatris ; on longeait maintenant la plaine parallèle aux Lacs Amers et quelques signes de végétation apparaissaient ; des bouquets de santoline et de verbena, émergeant de loin en loin, formaient de maigres îlots de verdure au milieu de l’Océan mouvant des sables ; et les hommes s’arrêtaient par instants pour aspirer les vapeurs humides qui montaient des infiltrations du sol. À mesure qu’on avançait, les serpents devenaient moins nombreux ; on apercevait seulement de grands lézards craintifs qui fuyaient à l’approche de la caravane et des scorpions lourds qui rentraient leurs anneaux mobiles en agitant dans tous les sens l’aiguillon de leur queue venimeuse. Des multitudes de grenouilles jaunes et vertes sortaient de terre, comme la production naturelle de ces parages ; et elles s’éloignaient à petites saccades promptes, étonnées d’être troublées dans leur solitude.
Cependant on touchait presque au but, et Kaïn, que la pensée de Taïa fortifiait sans cesse, sentait une grande joie entrer dans son cœur. La partie la plus difficile de sa mission était accomplie : il avait triomphé des difficultés presque insurmontables que présentait le chargement des navires, trompé la vigilance des espions d’Octave et traversé sans accident la plaine redoutée de l’isthme ; les esclaves, qui dans le commencement lui avaient obéi d’une façon passive, sans intelligence ni élan, semblaient avoir pris à tâche de mieux le seconder depuis qu’ils entrevoyaient, eux aussi, le succès au bout de la tentative qu’ils avaient crue vaine tout d’abord. L’espérance des récompenses promises était sans doute pour beaucoup dans l’éclosion tardive de cette ardeur.
Enfin on arriva au port d’Arsinoé-Cléopatris. Cléopâtre, ayant fait ouvrir un quartier considérable sur la rive du canal des Ptolémées, avait ajouté son nom à celui que cette ville portait précédemment[38]. C’était là que les navires devaient être mouillés de nouveau ; cette opération présentait moins de périls que celle du chargement ; toutefois de grandes précautions furent prises encore : les plans inclinés étaient placés comme dans la baie de Tanis et les vaisseaux, soutenus par des câbles, y glissaient insensiblement. Un sentiment général de satisfaction soulevait les poitrines chaque fois qu’un des vaisseaux, détaché de ses liens, s’enfonçait dans les hautes eaux avec un sourd bruissement.
Les esclaves se hâtaient, car un vent violent soufflait par intervalles, entraînant avec lui des tourbillons de sable et de poussière. Sur son passage, les palmiers, les habitations et même les eaux prenaient une coloration jaunâtre, comme baignés sous une pluie de soufre.
Tout à coup une odeur méphitique se répandit et une fumée épaisse s’éleva ; de tous les côtés à la fois des fantômes humains surgirent sur le tillac des vaisseaux déjà mis à l’ancre ; d’autres, sortis en rampant des ajoncs qui bordaient les deux rives, étaient armés de longues phalariques avec lesquelles ils lançaient des flèches enflammées. En même temps, la surface du golfe se couvrait de petites barques ; les hommes qui les montaient jetaient par-dessus le pont des navires de grosses étoupes de chanvre imbibées d’huile de pierre.
L’incendie se propageait avec une rapidité effrayante. Des craquements sinistres se faisaient entendre et par les carcasses entr’ouvertes des navires des flammes sortaient, qui couraient longtemps sur l’eau avant de s’éteindre. Les mâtures, embrasées de la base au sommet, formaient d’énormes faisceaux de lumière, et les voiles roulées encore autour des vergues s’en détachaient par places sous l’action du feu ; des lambeaux incandescents étaient emportés au loin par le souffle impétueux du Khamsin.
Mais le fléau s’acharnait surtout aux flancs métalliques des navires qui résistaient encore à l’embrasement général. Des langues de feu léchaient les rebords cuivrés ; elles paraissaient et disparaissaient comme des feux follets, repoussées d’abord par la rigidité froide du métal, jusqu’à ce que, s’amollissant sous cette caresse, il se fût fondu en un brasier liquide de forge, où elles s’enfonçaient victorieusement.
Au premier coup d’œil, Kaïn avait mesuré toute l’immensité du désastre ; il avait compris avec sa sûreté de vue habituelle que tenter d’arrêter l’incendie des vaisseaux à l’ancre serait impossible et que tout son effort devait se borner à protéger les navires demeurés encore sur la terre ferme. Il en restait une dizaine, autour desquels il plaça une triple rangée de ses hommes les mieux armés, avec l’ordre de se tenir prêts à repousser les agresseurs. Puis, suivi des autres esclaves, le Psylle retourna promptement au bord du golfe. Il voulait reconnaître l’ennemi et savoir de quel côté était partie l’attaque.
C’étaient des hordes d’Arabes Scénites et de Nabathéens. Les premiers vivaient sous la tente, répandus un peu partout, le long de la côte orientale du golfe ; les seconds s’étaient cantonnés dans les environs de Petra ; les uns et les autres vivaient de pillage et de piraterie, toujours à l’affût de proies nouvelles, guettant l’arrivée des caravanes sur le littoral ou l’entrée des navires dans le golfe pour les attaquer, tantôt avec le fer, tantôt avec le feu et en recueillir les épaves. Ils vivaient libres, affranchis de toute domination ; les rois des Mèdes, des Macédoniens et des Perses, qui les avaient successivement combattus, n’avaient pu parvenir à les dompter[39].
Cependant Kaïn et ses hommes redoublaient d’efforts ; ils ramassaient sur le rivage de grosses pierres lisses et pointues, qu’ils lançaient à tours de bras sur les barques des Nabathéens. Mais ceux-ci manœuvraient leurs embarcations avec une agilité surprenante entre les carènes embrasées.
Sur le tillac des navires, quelques hommes, attardés par l’appât des trésors, couraient encore comme des ombres à travers les flammes grandissantes ; puis quand les morsures de l’incendie devenaient intolérables, ils plongeaient, — et tout chargés de joyaux, qui brillaient sur eux comme les écailles luisantes des squales, ils regagnaient en nageant le large.
Les lueurs de l’incendie éclairaient très loin l’horizon. Au sud de la presqu’île Arabique, le Sinaï dressait ses deux cimes resplendissantes.
Les dernières barques des fuyards disparaissaient, quand un tumulte confus s’éleva et l’on vit s’avancer une nuée d’hommes semblables à des spectres ; ils étaient nus et les lueurs de l’incendie faisaient paraître rouges leurs corps décharnés. C’étaient les Ichtyophages, qui habitaient les excavations des rochers le long de la côte[40] ; ils avaient vu de loin le ciel embrasé et ils accouraient les bras levés, en poussant des cris terribles.
CHAPITRE VI
Une nuit, Taïa, prévenue du désastre par un message de Kaïn, pénétra inopinément dans le palais pour en prévenir Cléopâtre. Malgré l’heure insolite, les femmes de service qui veillaient autour de l’appartement royal la laissèrent passer sans y prendre garde, connaissant la place importante que la jeune Libyenne occupait dans l’intimité de sa maîtresse.
Cléopâtre dormait. Ses deux bras, encerclés de perles passées sur des fils d’or, étaient arrondis au-dessus de sa tête comme une auréole resplendissante. Le haut de sa gorge était recouvert d’une grosse chaîne flexible, d’où pendait un scarabée de jaspe aux élytres en pâte de verre bleu rayée d’or. L'insecte mystique reposait entre les deux seins de la nouvelle Isis, soulevé et abaissé régulièrement par les ondes voluptueuses de son souffle.
De la voûte élevée du lit une lampe descendait, où brûlait lentement une mèche de fin lin plongeant dans l’essence embaumée du styrax. Ce lit ressemblait à un autel ; des quatre côtés s’élevaient de hautes colonnes formées par les torses de sphinx grecs à poitrine de femme ; leurs ailes déployées soutenaient de lourdes draperies d’hyacinthe et de pourpre pareilles à celles des sanctuaires. Sur le devant de la couche des bas-reliefs, sculptés dans l’or massif, représentaient les différentes scènes de la vie terrestre d’Isis à la recherche des dépouilles d’Osiris, son frère et son époux, tombé dans les embûches de Typhon.
En pénétrant inopinément auprès de Cléopâtre, la jeune Libyenne n’avait pas songé qu’elle allait la trouver endormie ; elle resta un moment immobile, arrêtée par cet obstacle imprévu du sommeil, mais décidée quand même à ne pas retarder sa pénible confidence.
Elle monta les six degrés de marbre recouverts de tapis de Sidon qui conduisaient à la couche royale et attendit.
Au bout de quelques minutes Cléopâtre sourit sans ouvrir les yeux ; quelque vision de gloire ou d’amour passait sans doute devant ses paupières closes ; peut-être vivait-elle en ce moment le rêve de l’île heureuse là-bas avec Antoine, dans un coin ignoré du monde, — peut-être se voyait-elle au contraire entrer en triomphatrice dans Rome, où elle jurait quelquefois par le Capitole de siéger en souveraine maîtresse.
Ses bras noués se détachèrent et vinrent s’abattre sur le lit ; un frémissement courut le long de son corps ; entre les seins le scarabée mystique se soulevait, mû avec plus de force par l’oppression subite du réveil.
Alors Taïa d’une voix claire, la voix dont elle appelait naguère les pâtres errants à travers les dunes de la Cyrénaïque, acheva d’éveiller Cléopâtre.
« Grande Reine, je viens de recevoir un message de Kaïn ; écoutez-moi. »
Cléopâtre se dressa sur son lit et reconnut sa suivante :
« Toi, Taïa ? Pourquoi viens-tu à cette heure ? Qu’y a-t-il ?
— Les Arabes ont brûlé les vaisseaux que Kaïn avait fait transporter dans le golfe ; la plus grande partie des richesses est tombée entre leurs mains… »
La reine ne lui laissa pas le temps d’achever.
« Misérable folle, c’est toi qui es cause de ce désastre ; c’est toi qui m’as suggéré l’idée de mettre Kaïn à la tête de l’expédition ; avec un autre chef que lui, mes vaisseaux eussent passé sans encombre ; je cherchais un homme capable de tenir tête à mes ennemis ; tu m’as fait prendre un Psylle, un charmeur de vipères.
— Grande Reine, il n’existe pas dans les deux Égyptes d’homme qui vous soit plus dévoué que Kaïn : il a accepté de faire ce que les plus fidèles d’entre vos serviteurs avaient refusé ; grâce à lui, quelques-uns de vos vaisseaux ont été sauvés ; en défendant les autres, il a reçu une blessure terrible. Ce sont les Arabes…
— Ces explications sont inutiles ! exclama Cléopâtre. Kaïn sera mis à mort avec une partie de ses hommes ; les autres seront renvoyés aux mines après avoir subi le supplice du fouet. Il faut qu’il y ait autant de sang versé qu’il y a eu d’or perdu par leur faute.
« Je vois bien d’où le coup est parti, ajouta-t-elle. C’est Didius, gagné par Octave, qui aura lancé des hordes sauvages contre mes navires[41]. Oh ! cet Octave, quel moyen trouver pour m’en défendre ? Antoine lui-même, malgré sa bravoure, demeure impuissant devant la force écrasante de son rival. Pour le combattre, il nous faudrait une armée nombreuse ; au lieu de cela, autour de moi, il n’y a que défections et lâchetés… »
Taïa était devenue pensive.
« Tout n’est pas perdu encore, dit-elle, Reine ; il vous reste de grandes ressources ; si vous voulez consentir à m’entendre… »
Cléopâtre l’interrompit de nouveau :
« Tais-toi ! tes avis, je ne les ai déjà que trop écoutés. Tous ceux qui m’ont conseillée m’ont perdue. Si j’avais suivi mes seules inspirations, je serais à présent la maîtresse de l’empire, la dominatrice du monde. Mais toujours j’ai eu auprès de moi des êtres qui se sont mis en travers de mes plans, Paësi, toi, tant d’autres encore. »
Elle frémissait, secouée par le flot montant de sa colère ; et Taïa eût dû être effrayée du ton menaçant de sa voix et du froncement redoutable de ses sourcils. Mais l’esclave favorite était accoutumée à ces emportements ; elle s’agenouilla sur les degrés, sa belle tête appuyée contre le bas-relief de la couche, et attendit que le calme fût revenu dans l’âme troublée de sa maîtresse.
Cependant Cléopâtre, toujours dressée, continuait à murmurer des paroles de découragement et d’amertume ; un affolement lui venait à la pensée de rester isolée dans son royaume, entravée à toute heure dans sa liberté, en butte aux conspirations de ses alliés anciens devenus ses ennemis.
Puis sa colère se fondant en un sentiment de pitié sur elle-même et sur ses projets anéantis, elle abaissa les yeux sur Taïa et lui dit d’une voix plus apaisée :
« Que fais-tu là ? Retire-toi et ne reviens que sur mon ordre.
— Nouvelle Isis, répondit Taïa sans quitter sa posture agenouillée, vous savez que votre esclave vous aime ; laissez-la, de grâce, vous proposer un moyen de tout sauver.
— Encore, si ce n’était que mes richesses perdues ! reprit Cléopâtre sans l’écouter. Des richesses, j’en ai suffisamment pour couvrir le sol de l’Égypte, depuis Alexandrie jusqu’aux Pyramides. Quand j’en aurai rempli mon mausolée du Lochias, il m’en restera encore assez pour charger des navires en nombre égal à ceux que l’imprudence de Kaïn vient de me faire perdre. Mais ce n’est plus seulement de l’or qu’il me faut pour rétablir ma puissance ; l’or ne lutte pas contre l’idée, et l’idée c’est la domination envahissante de l’Occident incarnée dans Octave. Ah ! ils le sentent bien ceux qui m’abandonnent dans l’inertie de mes trésors, dans la vanité de mes joyaux, presque aussi impuissante que les Pharaons qui reposent dans la mort au milieu de richesses incalculables. Pour repousser cette force, il faudrait une force semblable ; il faudrait qu’un homme se levât, traînant derrière lui tout un monde assoiffé de conquêtes nouvelles.
— Je sais où trouver cet homme », répondit simplement Taïa.
Cléopâtre regarda la jeune fille et ne put s’empêcher de sourire.
« Ma pauvre petite, le sommeil trouble ton cerveau. Va te reposer et continuer de rêver seule. Pour moi, je ne me fais plus d’illusions ; tout est fini cette fois, à moins qu’Antoine ne revienne de Parœtonium avec une armée bien organisée que le prestige de sa présence soutiendra encore. C’est là maintenant contre Octave mon dernier espoir de salut.
— Ce qu’Antoine ne peut accomplir à lui seul, il le fera vaillamment secondé, dit Taïa ; et, puisque l’appui des nations alliées vous échappe, pourquoi ne pas chercher ailleurs des moyens d’action ? N’avez-vous jamais pensé, Grande Reine, que près de vous, presque aux portes de votre royaume, il existe un élément formidable de destruction que vous pourriez faire servir à votre défense ? De l’immense désert Libyque surgirait de terre à votre appel un fourmillement d’hommes, une nuée de Barbares. Vous ne connaissez pas comme moi la force indomptable de ces races sauvages. Lancées contre le monde, elles balayeraient comme un cyclone tous vos ennemis coalisés. »
Cléopâtre était devenue attentive.
« C’est donc une invasion du continent blanc par le continent noir que tu me proposes là ? dit-elle. Mais, en admettant que l’idée soit bonne et que ces peuplades acceptent de combattre pour moi, comme tu le prétends, où trouver un chef qui les conduise et dans quel intérêt ce chef les armerait-il pour me défendre ?
— Dans l’intérêt de sa propre vengeance. Le chef auquel j’ai pensé est Magas, le roi des Nasamones. Vous le connaissez, divine Cléopâtre. C’est à lui que vous m’avez achetée toute enfant, lorsque vous étiez descendue dans l’oasis d’Amon pour consulter l’oracle du dieu.
— Je m’en souviens, dit Cléopâtre. Un colosse enveloppé dans une peau de bête et qui me regardait avec des yeux farouches. Et toi, petite Taïa, tu courais autour de lui comme une gazelle sauvage. Nul n’aurait pensé alors qu’un jour viendrait où tu serais assez savante pour discuter avec la reine d’Égypte les destinées des empires. »
La Libyenne baisa la main que lui laissa prendre sa maîtresse, puis elle continua :
« Ce Magas est un descendant des Carthaginois et, comme tel, il nourrit contre Rome une haine terrible, la haine accumulée de trois générations d’hommes. Bien souvent je l’ai entendu le soir sous sa tente raconter les horreurs du siège de Carthage, dont son aïeul avait été témoin ; ce récit, entremêlé de cris de fureur, frappait vivement mon imagination d’enfant. Je le vois encore brandissant sa hache de fer au-dessus de sa tête et renouvelant avec les accents d’un fanatisme féroce le serment de vengeance que son père lui avait fait prêter sur le tombeau de ses ancêtres. S’il n’a pas encore satisfait sa haine, c’est qu’il attend pour cela une occasion sûre. À vous, Reine, de la lui fournir, en l’associant à Marc-Antoine contre Octave. »
Taïa parlait avec une conviction chaude qui peu à peu gagnait l’âme facile à impressionner de Cléopâtre ; puis, malgré elle, la reine avait foi dans la justesse de vue de cette fille du désert qui avait su prendre sur son esprit un réel empire.
« Ce Magas a donc sous ses ordres une armée puissante ? demanda-t-elle.
— Innombrable. D’ailleurs il peut en outre faire appel à tous les Libyens nomades répandus dans la plaine depuis Thèbes jusqu’au lac Tritonis ; les Ligures, les Lytophages, les Marmarides, les Garamantes se rueront à sa suite avec joie ; car il est le plus redoutable et le plus respecté de tous les rois de la région.
— Mais pour organiser cette cohue de Barbares, reprit encore Cléopâtre, il faut du temps : or Octave est à nos portes ; Péluse est gardée à vue, Alexandrie est menacée…
— Ni l’une ni l’autre de ces deux places n’est encore prête à se rendre. Vous savez mieux que moi, Reine, quelles ressources Péluse et Alexandrie contiennent pour résister à l’attaque prévue de César-Octave. D’ailleurs Antoine, avec ce qu’il aura réuni de troupes, pourra les couvrir en attendant. Grande Reine, confiez-moi un message pour Magas ; nous sommes à l’époque de l’année où il monte avec ses hommes dans l’oasis d’Augila faire la récolte des dattes ; en partant sans tarder je le rencontrerai ; ne me refusez pas cette faveur. »
Cléopâtre, au fond d’elle-même, était déjà décidée ; elle se disait qu’il serait toujours temps de s’enfermer dans son mausolée au milieu de ses richesses ; cependant, par tendresse pour Taïa, elle feignit d’hésiter encore.
« Mais il y a treize jours de distance d’ici Augila. Ne redoutes-tu pas les dangers de la route ?
— Vous me donnerez une escorte. Nous passerons par le temple d’Amon, dont le chemin est déjà frayé par des caravanes nombreuses ; d’Amon à Augila il y a à peine cinq journées ; le désert, loin de m’effrayer, m’attire et la pensée de vous servir me soutiendra.
— Tu partiras donc, puisque tu le veux ; mais j’exige que tu aies un convoi bien organisé et digne de ma suivante favorite. Demain dès le lever du soleil je donnerai mes ordres à ce sujet. En attendant, repose-toi. »
Taïa s’étendit sur les degrés et s’endormit ; mais Cléopâtre resta éveillée. Avec cette mobilité d’esprit particulière à sa nature qui la faisait passer presque sans transition du découragement à l’espérance et que justifiaient d’ailleurs les revirements nombreux de sa fortune politique, elle se laissa emporter une fois encore par le courant rapide de ses ambitions ; et quand l’aube parut, elle se voyait assise sur le trône de Rome que lui avait conquis l’armée innombrable des Barbares.
Le soir de ce même jour la caravane était formée ; on avait été chercher dans le quartier du Camp Macédonien les éléphants de l’Inde qui étaient exclusivement réservés au service de Cléopâtre. C’étaient d’énormes animaux admirablement dressés pour la traversée du désert. Sur l’un d’eux s’étalait un pavillon somptueusement décoré et aménagé d’étoffes filigranées d’or et de coussins soyeux où Taïa prit place. La Libyenne avait voulu revêtir le costume de sa nation, qui consistait en une égide de peau de chèvre teinte en rouge et en une jupe courte d’étoffe rude recouvrant le bas de son corps ; des plaques de métal brillaient autour de son cou, s’incrustant presque dans sa chair brune. Ainsi, Taïa avait l’air d’une reine sauvage regagnant ses contrées lointaines.
Un second éléphant portait les femmes qu’elle avait choisies pour l’accompagner pendant le voyage : deux jeunes Grecques de Salamine à qui elle avait appris l’art de chanter comme elle au son des harpes les refrains favoris de la reine d’Égypte.
Quatre eunuques venaient à leur suite ; ils disparaissaient presque au sommet de leur gigantesque monture sous l’amoncellement des broderies et des joyaux dont ils étaient couverts.
Enfin deux autres éléphants avaient été chargés de lourds coffrets contenant les présents et les vaisselles d’or que Cléopâtre envoyait au roi Magas.
À la tête du cortège et massés en colonnes pressées, les cent cavaliers de l’escorte avaient grand’peine à maintenir au pas l’allure de leurs jeunes chevaux, habitués à courir librement dans les plaines qui avoisinaient le camp d’Alexandrie ; ces animaux fougueux secouaient leur crinière et poussaient des hennissements sonores ; quelques-uns se cabraient sous le frein tendu — et leur poitrail lisse brillait quelques secondes entre leurs sabots comme la surface polie des boucliers.
Par derrière, fermant la marche, venaient les serviteurs et les esclaves ; ils conduisaient les ânes porteurs des provisions de la route. L’eau des ablutions puisée dans l’aiguade d’Alexandrie et l’eau à boire prise dans le Nil étaient enfermées dans de larges outres ; des cornes contenaient le baume et les parfums ; dans des cages d’osier peint et tressé des cailles vivantes voletaient ; des quartiers d’oie conservés dans le sel, des gâteaux de farine d’épeautre remplissaient de larges corbeilles ; tout cela était accroché sur les flancs de ces ânes qui étaient presque aussi hauts que des chevaux et qui avançaient allègrement, malgré leur charge pesante.
La caravane, ainsi ordonnée, traversa l’avenue Canopique, entra dans le quartier du Serapeum et quitta la ville par le tranquille faubourg de Nécropolis.
CHAPITRE VII
Contrairement à Marc-Antoine et à Cléopâtre qui n’avaient jamais cherché l’orientation de leur politique ailleurs que dans leur propre génie, César Octave aimait à s’entourer de conseillers prudents. Tandis que les deux amants royaux voyaient seulement dans l’étude des diverses doctrines le côté spéculatif et esthétique, le sage neveu de Jules-César s’appliquait à trouver dans l’enseignement des philosophes qui l’entouraient des préceptes utiles pour la conduite de sa vie publique et privée[42].
Le vieil Apollodore de Pergame, le rhéteur Spherus, enfin et surtout Aréus d’Alexandrie et ses deux fils, Denis et Nicanor, vivaient dans l’intimité du jeune César qui, malgré ses trente-trois ans et sa destinée glorieuse, avait conservé pour eux la déférence d’un disciple à l’égard de ses maîtres.
Cet Aréus, qui jouissait auprès de lui de la plus haute faveur, appartenait à la secte des nouveaux pythagoriciens. À cette époque, le pythagorisme était devenu moins une philosophie qu’une thaumaturgie ; ainsi le célèbre voyageur de Samos[43], qui avait appris la science magique à Babylone de la bouche des prêtres chaldéens et qui avait été initié par les hiérophantes d’Égypte à la doctrine de la transmigration des âmes, revivait dans les écoles d’Alexandrie[44] par la parole éloquente et mystique du maître préféré d’Octave.
Dans ses relations extérieures Aréus apportait une quiétude souriante. Son geste sobre et sûr ponctuait élégamment ses discours ; quoi qu’il eût à dire, l’expression de son visage ne changeait point, et ses yeux, qu’il tenait toujours soigneusement baissés tandis qu’il parlait, se fixaient au contraire sur son interlocuteur avec une acuité surprenante quand celui-ci lui donnait la réplique.
Ce fut cet ambassadeur redoutable que César Octave se décida à envoyer auprès de Cléopâtre pour lui persuader de sacrifier Antoine à la cause de Rome et de l’Égypte. En cela le jeune Imperator imitait l’exemple des cités de l’Asie Mineure qui choisissaient dans les écoles les sophistes les plus habiles pour en faire leurs représentants auprès des puissances voisines[45]. D’ailleurs, il pouvait à bon droit s’inquiéter du résultat de cette nouvelle tentative ; déjà, il avait en vain député à la reine plusieurs messagers, entre autres son affranchi Tyrrhéus, qu’Antoine lui avait outrageusement renvoyé après l’avoir fait battre de verges par ses esclaves[46].
Mais cette fois le triumvir était hors d’Alexandrie et Cléopâtre, ébranlée par des déboires successifs, devait être plus disposée à entendre les propositions pacifiques de son rival.
Aréus fut donc, à son arrivée au palais, introduit dans une salle décorée de trophées étrangers et de statues de bronze, où Cléopâtre recevait les personnages qu’elle tenait plus spécialement à honorer. Par un sentiment de diplomatie et de coquetterie à la fois, la reine voulait apparaître à l’envoyé d’Octave dans tout le prestige de sa gloire, comme dans tout l’éclat de sa beauté. Quand Aréus entra, elle était assise sur un trône d’ivoire à têtes de sphinx auquel des arabesques d’or finement découpées formaient un revêtement somptueux. Son front était surmonté du pschent à double couronne rouge et blanche, signe de sa domination sur les deux Égyptes. Les officiers de sa maison royale l’entouraient.
Le philosophe s’avança vers elle, marchant droit dans les plis de son laticlave ; les larges bandes de pourpre qui descendaient de chaque côté de sa poitrine apâlissaient sa tête délicate ; ses lèvres dont le dessin n’était caché par aucun vestige de barbe se rejoignaient ; ni sensuelles, ni austères, elles semblaient également faites pour les voluptés idéales de la parole et pour les jouissances moins platoniques de la table et de l’amour.
Pendant qu’il traversait la vaste salle, Cléopâtre le regardait attentivement afin de surprendre sa pensée et de régler sa propre attitude sur la sienne, en souveraine bien avisée. Tout de suite elle comprit qu’il venait animé d’intentions conciliatrices ; et d’un geste de sa baguette sceptrale elle donna ordre à sa suite de se retirer.
Alors Aréus, après s’être incliné profondément devant elle, parla :
« Je supplie l’illustre Cléopâtre, dit-il, la souveraine glorieuse de l’Égypte, de ne voir en moi qu’un serviteur fidèle, entièrement dévoué à sa cause et prêt à lui être agréable en toutes circonstances. »
Cléopâtre fit un léger signe de bienveillant acquiescement ; il continua :
« César Octave, mon élève hier, mon maître aujourd’hui, m’a chargé pour vous, Grande Reine, de la mission dont je viens m’acquitter. Si je réussis à vous convaincre, ce sera le plus grand honneur de ma vie d’avoir mis ma parole au service d’une souveraine telle que la divine Cléopâtre. »
Cléopâtre sourit et attendit pour répondre qu’il se fût expliqué davantage. Aréus, sans la regarder, poursuivit son discours :
« Je n’ai pas la prétention, dit-il, d’apprendre à la glorieuse reine quel est l’état des ressources de Rome comparées à celles de Marc-Antoine et de l’Égypte. Chaque nation porte en elle des forces ignorées des nations rivales qui peuvent, en se révélant soudainement, faire mentir les prévisions les mieux établies et renverser l’ordre prévu par les sagesses humaines. Malgré cela, on peut le plus souvent, sans être accusé de présomption, tirer l’horoscope des empires et lire leur destinée, non dans l’arrangement fatidique des astres, mais sur le front et dans le cœur de ceux qui gouvernent. Or César Octave possède à un degré éminent toutes les qualités nécessaires à la prospérité d’un vaste royaume ; si la mort ne l’arrête pas dans sa marche, il sera bientôt le maître du monde. »
Il se tut, non qu’il eût achevé ce qu’il avait à dire, mais pour donner plus de portée à l’assertion qu’il venait d’émettre.
Alors Cléopâtre prit la parole :
« Quelle que soit la force d’un homme, sage Aréus, supposez-vous qu’à lui seul il puisse soutenir un pareil poids ? L’Orient et l’Occident, tellement hétérogènes dans leur civilisation, seraient difficilement gouvernables par une volonté unique ; il y a part à deux pour le moins dans cette proie sur laquelle votre avide pupille a jeté déjà son dévolu. »
Elle avait dit cela, moitié railleuse, moitié arrogante, et les notes sonores de sa voix remplissaient la vaste salle comme les arpèges d’une harpe touchée par une main habile.
Aréus la contemplait ; de son œil exercé il pesait la densité passionnelle de cette âme et se demandait si l’ambition y serait assez forte pour triompher définitivement de l’amour. Le résultat de ce rapide examen fut sans doute conforme à son désir, car il reprit avec une assurance parfaite :
« L’empire du monde, Grande Reine, ne saurait plus être partagé. Vous savez qu’à l’heure actuelle la plupart des peuples autochtones ont accepté depuis longtemps déjà la tutelle de la métropole du Latium. Les autres nations, restées fidèles à leur autonomie, ne tarderont pas à suivre cet exemple. Toutes, d’ailleurs, ont besoin de se sentir protégées par une autorité stable qui les mette à l’abri des revirements dont elles ne connaissent que trop les dangers. L’empire partagé c’est la guerre, sinon déclarée du moins latente, la guerre en fermentation au sein des peuples comme la lave aux entrailles d’un volcan ; or, il est temps qu’une ère de paix s’ouvre pour le monde et que l’immense majesté de la puissance romaine s’étende sur lui et le couvre comme un manteau. »
Cependant Cléopâtre ne paraissait pas convaincue. De nouveau sa voix claire se fit entendre :
« Avant d’arriver à cette organisation idéale, savant Aréus, que de sang à verser encore ! Croyez-vous que les nations orientales, qui vous restent à conquérir — et elles sont nombreuses — consentiraient à perdre leur indépendance pour le seul plaisir de jouer une partie dans cette symphonie universelle ? Et quand bien même l’Asie, lasse des bouleversements qui l’ont tant de fois agitée, accepterait la domination occidentale, supposez-vous que Marc-Antoine et Cléopâtre abandonneraient aux appétits insatiables de la louve romaine les États placés sous leur sauvegarde ?
— C’est précisément de cela que je suis venu vous entretenir, Grande Reine, répondit Aréus. Pardonnez-moi la franchise de mon langage, rendue nécessaire par la gravité même des circonstances ; mais il me semble que vous vous méprenez sur vos propres intérêts et sur ceux de votre royaume, en vous attachant sans réserve à la politique belliqueuse d’Antoine. Sans la fougue intempérante du triumvir, un arrangement serait possible entre Octave et Cléopâtre qui satisferait à la fois les exigences légitimes de la reine d’Égypte et les droits incontestables de mon maître. »
Il y eut un moment de silence.
« Je ne vois pas pour quelles raisons, dit enfin Cléopâtre, Marc-Antoine serait exclu de cet arrangement, si les conditions en étaient justes et conformes aux droits de chacun. Le triumvir, comme vous le savez, a fait cause commune avec moi depuis la onzième année de mon règne ; du jour de notre rencontre en Cilicie il n’a pas cessé de dépenser le sang de ses légions et le prestige de sa renommée pour le soutien de l’Égypte, de même que mes trésors et mes soldats ont été constamment au service de ses conquêtes. Ce serait avoir de moi une opinion bien hasardée que de me croire capable, dans l’intérêt de ma propre fortune, de trahir l’homme à qui j’ai donné mon amour.
— C’est à la reine que je parlais et non point à la femme, s’empressa de répondre Aréus. Il est des heures où les devoirs personnels les plus sacrés doivent être immolés à des intérêts d’ordre général plus sacrés encore. D’ailleurs, que demande Octave ? Rien qui ne soit conciliable avec les principes de la plus stricte sagesse. Marc-Antoine est à bout de forces et son prestige diminue à chaque heure comme le rayonnement d’un soleil qui va s’éteindre. Sans doute il est capable de résister quelque temps encore aux forces d’Octave ; mais l’issue de la lutte n’est point difficile à prévoir. N’attendez donc pas que tout soit perdu, Illustre Reine, car les avantages qu’Octave vous offre aujourd’hui vous échapperaient alors infailliblement. »
Un nouveau silence se fit, que Cléopâtre rompit encore la première.
« Mais enfin, dit-elle, quel est cet arrangement qu’Octave me propose ? »
C’était cette demande qu’attendait Aréus. Il répondit aussitôt :
« Renoncer à prolonger des hostilités vaines, préjudiciables surtout à votre royaume et qui entretiennent au centre du monde un foyer de discordes contraires aux projets pacifiques de César ; et, comme gage de bonne entente, lui livrer la ville de Péluse que vous tenez en état de défense contre la flotte romaine. L’Égypte n’en souffrira pas, tout au contraire. Et vous, divine Cléopâtre, vous ne perdrez rien à ce qu’Octave, devenu votre allié, remplace le triumvir dans vos bonnes grâces. »
Il avait souri, en prononçant ces derniers mots, d’un sourire pâle, plein de réticences et de promesses ; mais Cléopâtre, les deux mains appuyées sur les têtes de sphinx qui ornaient son trône, conservait la même attitude hautaine :
« Dites à votre maître, répondit-elle sans lever les yeux, que ma foi dans Marc-Antoine est inébranlable ; toutefois je saurai, ainsi que je l’ai toujours fait jusqu’à ce jour, imposer silence à mes sentiments si l’intérêt de mon royaume le commande. Je vous demande donc de me laisser quelque temps pour me recueillir avant d’accepter ou de refuser les offres de César. D’ailleurs, ajouta-t-elle en souriant à son tour, un politique aussi avisé que lui doit faire peu de cas de l’alliance d’une femme, et vous-même, prudent Aréus, vous devez le maintenir dans ces sages doctrines.
— Que la nouvelle Isis daigne avoir de son serviteur une opinion moins défavorable ! L’influence dont je dispose auprès de mon illustre élève est tout acquise à sa glorieuse rivale dans le présent comme dans l’avenir. D’ailleurs, pour être un prince calme et réfléchi, Octave n’en est pas moins accessible aux charmes inéluctables de la grâce, de l’intelligence et de la beauté ; et, en ce qui vous concerne, divine Cléopâtre, il est tout prêt à vous rendre hommage comme à la déesse incomparable qui réunit en elle seule tous ces dons. Quant à nous, philosophes ou rhéteurs, qui vivons dans la préoccupation unique de rendre par la forme l’harmonie éternelle du Nombre, nous ne saurions mieux faire que d’avoir recours à ce qui sur la terre est l’expression la plus complète de l’idée divine. C’est pourquoi notre premier maître Pythagore dicta à Théano, sa femme, ses vers dorés et pourquoi encore le sage Socrate et Périclès reçurent de la bouche d’Aspasie les premières leçons de l’éloquence. »
L’ambassadeur d’Octave jugea en avoir dit assez ; et, s’inclinant de nouveau devant Cléopâtre, il attendit qu’elle lui permît de se retirer ; d’un geste charmant, la souveraine, redevenue femme, lui tendit à baiser son poignet chargé d’anneaux d’or selon la coutume syriaque.
Quand il fut parti, Cléopâtre frappa de son bâton l’ivoire de son trône ; bientôt après ses officiers apparurent et, sur un signe d’elle, la précédèrent dans les longues galeries de marbre porphyrique qui conduisaient à ses appartements. Là, elle congédia Iras, Charmione et ses autres femmes ; elle éprouvait le besoin d’être seule, afin de penser librement à ce qu’elle venait d’entendre.
Ce qui dominait en son âme à cet instant, c’était un sentiment assez vif de joie ; avant de descendre au fond d’elle-même pour y discuter les propositions d’Octave, elle se sentait rassurée de les avoir reçues. Jusque-là, les messages qu’Octave lui avait envoyés n’avaient pas eu ce caractère bienveillant ; c’étaient plutôt des sommations de vainqueur à vaincu, que des discussions de puissance à puissance. Elle sentait bien d’une façon vague que l’abandon absolu d’Antoine était le prix de cette entente avec son rival ; mais elle ne voulait pas encore se l’avouer à elle-même, afin de savourer et d’énumérer tout à son aise les heureux résultats d’une alliance avec le maître de Rome.
Tout d’abord, ce qu’Aréus lui avait laissé entendre de la possibilité d’arriver jusqu’au cœur d’Octave la ravissait ; jusque-là elle avait cru le jeune César presque exclusivement tourmenté de pensées ambitieuses, peu occupé de Livie son épouse, et professant à l’égard de toutes les femmes un mépris que ses habitudes bien connues de froide débauche n’expliquaient que trop. Avec la déclaration presque ouverte dont le philosophe avait été l’intermédiaire, la scène changeait : Octave amoureux, ou bien près de l’être, c’était, à courte échéance, selon le rêve de Cléopâtre, la domination sur l’Occident et l’empire incontesté du monde. Elle se souvenait d’avoir vu le jeune prince, lorsqu’elle s’était rendue en Italie avec son frère Ptolémée, pour assister aux quatre triomphes de Jules César. C’était à cette époque qu’Octave avait pris la robe virile ; et, comme tous les citoyens de Rome, il avait été témoin des honneurs que le premier amant de Cléopâtre lui avait publiquement rendus. Aveuglé par sa passion, Jules César n’avait pas craint, en dédiant un temple à Vénus Génératrice, d’offrir à l’adoration du peuple romain une statue d’or de la reine d’Égypte, placée à côté de celle de la déesse[47]. De tels témoignages, auxquels s’étaient jointes depuis lors bien d’autres preuves éclatantes du pouvoir que Cléopâtre exerçait sur les cœurs, avaient sans doute impressionné profondément celui qui semblait aujourd’hui subir à son tour cette attraction toute-puissante. Seize ans avaient passé depuis cette première rencontre, mais la charmeuse n’ignorait pas que sa beauté, entretenue sans cesse par les raffinements d’un art toujours en éveil, était arrivée maintenant à son complet épanouissement ; pour peu qu’Octave se laissât aller à respirer une fois le parfum de sa chair, elle était sûre de se l’asservir, comme elle s’était asservi son oncle Jules César, ainsi que tous ceux qui l’avaient approchée. Cette domination qu’elle exerçait était si grande qu’autour d’elle on la taxait de surnaturelle, l’attribuant à des incantations magiques.
Elle s’était dressée devant un grand miroir de cuivre brillant qui la reflétait tout entière. Par quel revirement soudain le souvenir d’Antoine lui revint-il en cet instant, alors qu’elle était arrivée à l’éloigner complètement de sa pensée depuis une heure ? Quelque émanation de l’âme du triumvir était restée sans doute attachée à la surface polie du métal ; ou bien était-ce plutôt ce phénomène inexpliqué de l’appel des choses à la mémoire endormie ?
Alors Cléopâtre s’assit et ce fut presque une obsession que cette pensée d’Antoine qui lui revenait abondamment. Certes elle n’était pas très accessible à la pitié ; tout son passé en témoignait. Elle s’était débarrassée de son frère Ptolémée pour garder à elle seule le trône ; elle avait fait tuer Artavasde, le roi d’Arménie, sans compter un grand nombre de disparitions mystérieuses ou de meurtres avérés. Dernièrement encore, après la défaite d’Actium, elle avait donné ordre de mettre à mort plusieurs des principaux habitants d’Alexandrie qui avaient eu l’audace de blâmer ouvertement sa conduite[48]. Elle n’en était donc pas à son coup d’essai et le sang répandu ne la troublait guère. Mais cette fois il s’agissait d’Antoine, qu’elle avait aimé, qu’elle aimait encore ; il lui semblait que tout ce qu’elle avait donné d’elle à son amant crierait et saignerait dans ce sacrifice ; car elle ne pourrait se débarrasser de lui que par la mort ; elle se l’était attaché de telle sorte que, pour briser des liens si étroitement noués, il ne fallait rien moins qu’une catastrophe finale. Cependant elle n’avait pas le courage de considérer en face cette solution et vis-à-vis d’elle-même elle prenait des biais pour y arriver, supposant un malheur qui aurait frappé Antoine, une blessure mortelle reçue dans un combat, quelque chose enfin qui fût indépendant de sa volonté et sur quoi elle s’apitoyait réellement. Cela lui donnait le change et permettait à son imagination de s’enfoncer plus avant dans le rêve d’une liaison prochaine avec Octave. Pendant longtemps elle divagua ainsi ; à la fin, elle en était arrivée à penser que sa mort à elle habilement feinte déterminerait la mort volontaire de son amant.
Ainsi maintenant c’était sans trop de honte qu’elle envisageait comme possible la solution qui lui paraissait odieuse, il y avait un instant. Et, pour apaiser les protestations de sa conscience, elle se répétait les choses qu’Aréus lui avait dites sur les devoirs des souverains à l’égard de leur royaume ; quoiqu’elle ne fût nullement convaincue de la vérité de ces discours, elle se disait qu’elle pouvait bien se tromper elle-même, et que le philosophe devait avoir eu raison en lui affirmant que la reine d’Égypte n’avait pas le droit de sacrifier l’intérêt de son peuple à son amour pour Antoine.
Cependant, étant allée plus loin qu’elle ne l’aurait voulu dans la préméditation de ce crime dont elle avait fini par se tracer le scénario complet, un haut-le-cœur la prit ; elle se leva brusquement comme pour chasser un songe mauvais. Le soir était venu ; elle se rendit sur sa terrasse. Là encore des effluves des bonheurs passés lui montaient en foule de toutes parts ; elle apercevait la tour du Timonium qu’Antoine avait fait construire dans la baie, et elle se souvenait d’un soir presque semblable, où elle avait envoyé Taïa chercher son amant pour les joies charnelles de la réconciliation.
Plus loin dans la mer, presque en ligne parallèle avec la tour d’Antoine, le Phare[49], qui émergeait tout blanc de la pointe occidentale de son île, éclairait l’horizon dans un rayon de trois cents stades. Cette merveille du monde lui rappelait les destinées glorieuses, rêvées par elle pour Alexandrie, la ville incomparable qu’elle se plaisait à appeler la Rome nouvelle. Elle en revenait à penser que la vie serait encore heureuse avec Antoine dans cette capitale de l’Orient.
Mais toutes ces émotions l’avaient ébranlée au point de lui faire désirer la présence de quelqu’un avec qui elle pût communiquer une partie de ses réflexions ; si Taïa avait été là, nul doute que Taïa eût été appelée ; mais la jeune Libyenne était loin ; Cléopâtre fit demander le grand prêtre Paësi.
Le vieil Égyptien veillait ; toujours à l’affût de ce qui se passait autour de la reine, il avait vu venir Aréus, et, de la longueur de son entretien avec Cléopâtre, il avait auguré les bonnes dispositions d’Octave ; il s’en réjouissait, non par amitié pour le César — car, en bon Égyptien, il avait la haine de tout étranger — mais parce qu’il estimait comme un événement heureux tout ce qui pourrait arracher la reine à l’influence pernicieuse de Marc-Antoine.
Il fut donc étonné, quand il pénétra auprès de Cléopâtre, de lui trouver le visage bouleversé ; mais tout de suite, comme pour échapper à l’inquisition de son regard, elle l’avait interpellé du ton hautain, dont elle usait le plus souvent avec lui :
« Paësi, que se passe-t-il ? As-tu pris à tâche d’intercepter tous les messages qui pourraient m’arriver ? De Marc-Antoine, depuis qu’il est à Parœtonium, aucunes nouvelles ! De Taïa, pas davantage…
— Cléopâtre devrait craindre, en accusant faussement un innocent, de s’attirer le courroux de Thot, le dieu qui enregistre les paroles des hommes, répondit Paësi ; aucun envoyé ne s’est présenté au palais, sauf celui qui a été reçu aujourd’hui par la reine.
— Tu veux parler d’Aréus ?
— De lui-même, Reine. L’ambassadeur d’Octave n’a-t-il pas donné satisfaction à vos désirs, en vous apportant des nouvelles des deux armées ? »
Cléopâtre eut un geste d’impatience :
« Je n’ai pas à te rendre compte des paroles d’Aréus ; les messages que je reçois n’intéressent que moi…
— Et le salut de l’Égypte », interrompit le Grand Prêtre.
Cette fois Cléopâtre ne put réprimer un mouvement de colère ; elle se leva et jeta loin devant elle sa baguette de commandement, qui alla se briser sur les dalles en onyx de la terrasse.
« Sors, dit-elle, je suis lasse de sentir toujours ta volonté peser sur la mienne. »
Et de son bras tendu, elle lui montrait la porte dissimulée dans le mur entre deux pilastres de lazulite.
Sous sa mitre d’or Paësi ne bougea pas.
« Le devoir du prêtre, dit-il, est d’éclairer ceux qui tiennent entre leurs mains les destinées du royaume ; puisque les dieux ont inspiré à la reine de m’appeler en sa présence, elle m’écoutera jusqu’au bout. J’ignore ce qu’est venu dire l’envoyé d’Octave, j’ignore ce qu’Antoine peut espérer de ses troupes à Parœtonium, j’ignore pourquoi Taïa, l’inséparable suivante, a pris la route du désert. Mais ce que je sais de science certaine c’est le courroux des dieux, excité par les actes impies de la reine et du triumvir. Au lieu de chercher à apaiser les démiurges par des sacrifices, tous deux ont passé leurs journées dans les festins et leurs nuits dans les voluptés ; ils ont fait plus encore, ils ont pris la place de la divinité et se sont arrogé les attributs réservés à elle seule. »
Il alla ramasser sur la terrasse les morceaux épars du sceptre ; les débris remplissaient ses deux mains ouvertes ; il les montra à Cléopâtre :
« Ceci même est un mauvais présage, dit-il. Cet emblème de votre puissance, brisé à vos pieds, me fait redouter un malheur prochain. Reine, s’il en est temps encore, conjurez le destin funeste. Grande Prêtresse de Sérapis, offrez un sacrifice expiatoire à ce dieu que vous avez trop longtemps abandonné ; pour votre sauvegarde et celle de l’Égypte, consultez son oracle. »
Cléopâtre était superstitieuse ; les terreurs mystiques, les besoins de religiosité de toute une dynastie se résumaient en elle ; de sa main gauche elle pressa sur son sein l’amulette qui toujours y était suspendue, et murmura une courte formule. Puis elle répondit doucement à Paësi :
« C’est précisément pour cela que je t’avais fait venir. Rassemble le collège des prêtres. J’ouvrirai moi-même la bouche du dieu[50]. »
CHAPITRE VIII
Le Serapeum d’Alexandrie[51] était bâti sur une colline dans le faubourg isolé de Rhakotis ; au premier coup d’œil il apparaissait comme un entrecroisement gigantesque de colonnades et de galeries suspendues entre le ciel et la terre. Des voûtes en granit sombre, se confondant avec la couleur grise du sol, les soutenaient. Cent degrés taillés dans le porphyre ascendaient à la base de ce temple, qui passait pour le plus riche et le plus célèbre de tous ceux qu’eut Sérapis dans l’Égypte entière, malgré la vénération attachée au sanctuaire privilégié de Memphis et à l’oracle fameux de Canope.
Deux longues avenues latérales donnaient accès à des bâtiments dépendant du temple : au nord, la Maison de la Sagesse, où vivaient dans une continence perpétuelle les prêtres et les hiérodules commis à la garde du sanctuaire ; à droite et à gauche, de chaque côté, l’immense bibliothèque qui contenait plus de cinq cent mille volumes, présent royal d’Antoine à Cléopâtre, et les salles des conférences qui servaient de lieu de réunion aux grandes assises de la philosophie contemporaine.
Une suite de portiques régnait, comme un immense cloître, à la façade intérieure de ces bâtiments ; au milieu du quadrilatère qu’ils formaient surgissait le Temple même dans la nudité blanche de ses murs de marbre.
La pensée du dieu habitait cet édifice et le remplissait tout entier, comme le soleil, dont il était l’incarnation mystérieuse, inonde le monde de ses bons rayons. Depuis le premier propylone jusqu’à la partie la plus reculée du sanctuaire où résidait l’emblème redoutable, la même atmosphère pieuse était épandue, augmentant d’intensité à mesure que l’on s’avançait vers la chambre sainte accessible au seul Roi et au Chef des prêtres.
Devant le portique initial deux grands mâts étaient plantés, d’où pendaient de longues banderoles. Le pronaos venait ensuite, formant une sorte de vestibule soutenu par quatre rangées de colonnes ; puis c’était une première salle découverte dont les hautes cloisons encadraient un coin de ciel très bleu. Là s’assemblaient, pour se recueillir, les prêtres et le roi sacrificateur, avant de pénétrer plus avant dans la demeure intime du dieu sidéral.
Trois compartiments divisaient cette demeure ; et, selon leur degré d’initiation, les collèges sacerdotaux[52] y prenaient place pendant la célébration du mystère ; autour régnait une première ceinture de cellules ; les vêtements liturgiques, les grands sistres, les miroirs, les ustensiles d’or, d’argent et de lapis y étaient rangés ; dans d’autres de ces cellules on préparait les huiles et les essences qui servaient pour le culte ; une seconde ceinture de couloirs à ciel ouvert, où se déroulaient parfois les petites processions, occupait l’hémicycle du temple.
À l’intérieur des compartiments, des peintures murales d’une coloration violente montaient jusqu’aux frises ; les personnages des cortèges qu’elles représentaient étendaient vers le sanctuaire, dans des mouvements rigides, leurs bras chargés des hosties d’offrande ou des symboles de la fécondation. En vert et en bleu étaient peintes les divinités supérieures ; les déesses étaient recouvertes d’un enduit jaune comme d’un reflet de la chaude lumière de Sérapis ; les figures subalternes reluisaient d’une couche rouge brique, sur laquelle éclatait parfois la blancheur d’un tablier taillé en équerre[53].
De petits autels, faits d’une seule pierre et entourés de serpents sacrés et d’ibis, se dressaient de loin en loin ; ils formaient des chapelles isolées consacrées aux divinités secondaires du temple auxquelles on venait offrir des dons et des prières, pour se rendre favorable le dieu principal.
Mystérieux et obscur était le dernier compartiment, séparé des autres par un double rideau d’hyacinthe ; jamais aucun flambeau n’y était allumé ; les prêtres aux jours ordinaires n’y pouvaient entrer, sous peine d’être anéantis par la révélation de la sérapique splendeur. Là était la barque sainte, au centre de laquelle un édicule fermé cachait l’emblème du dieu aux profanations des regards ; un épais voile blanc la protégeait encore et y demeurait toujours étroitement fixé.
Pour consulter l’oracle et faire parler le dieu, le prêtre devait entrer dans l’enceinte redoutée. Cela n’avait lieu que dans des circonstances exceptionnelles. Aussi tous les collèges des prêtres avaient-ils été rassemblés ; un jeûne rigoureux de soixante heures les avait préparés à la fonction sainte, et pendant le même temps la reine s’était abstenue de nourriture forte et de boissons fermentées.
Longtemps avant le moment de la cérémonie une foule énorme, la foule bigarrée qui surgissait aux jours de fête de tous les carrefours de la ville, avait envahi le faubourg isolé de Rhakotis ; seuls les Juifs, qui formaient un tiers de la population, s’étaient cantonnés dans leur quartier du Delta, entre le Camp Macédonien et la mer. Toute cette plèbe se pressait au pied de la colline, l’accès du temple étant uniquement réservé au sacerdoce. Voir défiler la procession dans les dromos et sur les terrasses extérieures était le motif de ce religieux empressement. On savait que la reine était déjà là, à l’intérieur des cellules fermées qui servaient de sacristies au Temple, et l’on avait hâte de l’apercevoir dans sa gloire de Grande Prêtresse ; car le peuple d’Alexandrie aimait Cléopâtre, malgré ses déportements et ses caprices souvent cruels.
Tout à coup la musique des Hiéropsaltes accompagnant les hymnes sacrés retentit ; et dans les hauteurs du Temple, entre les colonnes du grand dromos, la procession apparut. Elle se déroulait lentement sous l’éblouissance d’un ciel très clair ; et du bas de la colline le peuple croyait voir la tête des prêtres toucher à l’azur.
Les moins avancés en dignité marchaient les premiers. C’étaient les Néocores à qui était confié le soin d’entretenir le temple et d’aider les ministres dans les cérémonies du culte. Un étroit caleçon de lin blanc serrait leurs cuisses au-dessus des genoux ; une ceinture chargée d’hiéroglyphes entourait leur poitrine, laissant à nu leur mamelle gauche ; un bonnet de lin blanc, haut et recourbé à la partie supérieure, couvrait leur front, et leurs mains pendantes portaient la croix ansée et le sistre.
Immédiatement derrière eux venaient les Pastophores ; dans des barques, sur leurs épaules, ils promenaient Anubis, le compagnon et le fidèle gardien de Sérapis, et les autres animaux sacrés. Quand ils passèrent, un frémissement courut dans la foule : à ces simulacres des dieux étaient attachées de secrètes influences.
À la suite des animaux sacrés parurent les prêtres qui en avaient la garde. On les appelait les Sphagistes. Le choix des hosties sanglantes leur était aussi dévolu ; c’était parmi les chèvres dorcades, abominables à Sérapis, qu’on les recueillait[54]. Quand ils avaient jugé les victimes aptes au sacrifice, ils leur attachaient au front une corne de papier, et, après y avoir appliqué de la terre sigillaire, ils y imprimaient le sceau qui les désignait à l’immolation. Avec le poil de ces animaux, on fabriquait les cuirasses dont les Sphagistes étaient revêtus et sur leur tête apparaissaient, comme insignes de leurs fonctions, les museaux grimaçants et pointus des dorcades.
Les Horoscopes, qui tiraient les présages de l’examen des victimes, défilèrent ensuite ; leurs pieds étaient nus comme ceux des autres prêtres ; mais la richesse de leur costume dénotait le rang élevé qu’ils occupaient dans le sacerdoce ; leur caleçon de lin, au lieu de s’arrêter aux genoux, descendait jusque sur les chevilles où il était retenu par un cercle d’or brillant ; un ample manteau cramoisi d’étoffe souple s’épandait à flots sur leur corps qu’il recouvrait entièrement, ne laissant passer que l’extrémité de leurs mains d’où sortait une longue palme.
Plus superbes encore semblaient les Hiérogrammates qui suivaient les Horoscopes ; leur dignité était grande : à eux appartenait le dépôt de la science hermétique. Ils connaissaient les occultes pouvoirs des démiurges et les mystères génésiaques de la formation des mondes. La foule les considérait avec avidité ; leur bonnet était percé des yeux mystiques du dieu Soleil ; et ils avaient les paupières abaissées sur le rouleau de papyrus qu’ils portaient et où étaient écrites les doctrines divines.
Les Stolistes apparurent à leur tour. Seuls ils avaient le droit d’ouvrir les arches et de parer de fleurs de lotus et d’ornements liturgiques les statues des dieux ; aussi étaient-ils d’une beauté parfaite et recouverts eux-mêmes de vêtements magnifiques afin d’être agréables à la divinité qu’ils approchaient de si près. Des anneaux de lapis leur entouraient le cou et les bras ; ils avaient la peau du visage et des mains parfumée des essences les plus pures ; une tunique aux manches écourtées serrait leur taille, laissant libres tous leurs mouvements ; une mitre éblouissante de pierreries était placée très bas sur leur front. En les voyant, le peuple, malgré son recueillement, laissa échapper des murmures d’admiration.
Aussitôt après marchaient les Prophètes. C’était l’ordre le plus élevé de la prêtrise. Ils interprétaient l’oracle et possédaient la vision des choses futures ; dans les songes ils savaient lire les révélations secrètes des dieux ; ils connaissaient aussi des formules pour opérer les miracles les plus étonnants. Mystérieux ils étaient eux-mêmes comme leurs doctrines. Un immense voile sombre les enveloppait tout entiers, cachant leur visage et leurs mains ; ainsi ils apparaissaient comme des êtres d’un ordre à part — et le peuple, à leur vue, se prosterna.
Puis un silence profond se fit, car on entendait le bruit des clochettes d’or appendues à la robe du Chef des prêtres. Paësi arrivait en effet, marchant seul à quelque distance des collèges sacerdotaux. Il portait le pectoral et l’éphod dont les pierres précieuses de neuf sortes différentes constellaient sa poitrine et le faisaient aussi brillant qu’une des divinités du Grand Temple ; une sorte de turban couronnait son front, que voilait à demi une étroite bandelette d’un tissu blanc lamé d’or. À ses côtés marchaient deux jeunes Choéphores, hiérodules du temple et sœurs jumelles, dont la fonction était de réciter les invocations à Sérapis et de faire les libations fréquemment prescrites dans le culte du dieu. À cet effet elles portaient les hautes urnes de cristal remplies de vin d’orge et de lait. De longues simarres blanches pressaient leur corps et en laissaient voir les formes charmantes ; leur chevelure, remontée en nattes serrées au sommet de leur tête, était parsemée de fleurs de lotus et d’épis.
Une théorie de Thuriféraires étroitement groupés agitaient des vaisseaux d’argent massif où fumait l’encens ; alors, dans un nuage, Cléopâtre apparut.
La reine d’Égypte, sous les plis raides de la chape d’or qui la couvrait jusqu’aux talons, était transfigurée. Sa tête seule, sur laquelle le disque de l’urœus irradiait au soleil, sortait de ce revêtement qui semblait fait des rayons mêmes du dieu sidéral ; c’était une gloire, un étincellement ; et d’en bas le peuple, toujours prosterné, lui tendait les bras comme à une divinité bienfaisante.
La procession contourna les couloirs extérieurs et s’engagea sur les terrasses élevées ; maintenant on ne distinguait plus qu’une ligne éblouissante, faite de couleurs variées comme un immense arc-en-ciel ; puis elle disparut pour entrer dans le Temple.
Cléopâtre à présent marchait la première, suivie des collèges sacerdotaux ; elle traversa les compartiments où les prêtres s’arrêtèrent selon leur ordre, et pénétra dans le sanctuaire même du dieu ; Paësi se tenait debout derrière elle, et sur les marches s’étaient accroupies les deux hiérodules[55], tenant au bout de leurs mains le pain et le vin des offrandes.
La Grande Prêtresse ouvrit le naos saint et tendit les bras vers l’image du dieu, en même temps que sa voix prononçait les paroles consacrées de l’hymne[56] :
« Salut à toi, Sérapis ! Roi des dieux, aux noms multipliés, aux formes mystérieuses, aux transformations saintes ! Être auguste, résidant dans Tattou ! Chef renfermé dans Sokhem ! Maître des invocations dans Oerti, jouissant de la félicité parfaite dans Hou ! Saint du mur blanc de Memphis ! Souverain de la Grande Demeure ! Seigneur de la longueur des temps dans Abydos ! Esprit bienfaisant dans le Lieu des Esprits ! »
Elle s’arrêta et joignit ses mains sur sa poitrine ; derrière elle les prêtres s’étaient agenouillés, et la demeure mystique d’un bout à l’autre s’emplissait des paroles d’adoration.
D’une voix plus basse, elle continua :
« De toi l’Abyssus tire ses eaux ; de toi provient le vent ; et l’air respirable est dans tes narines ; par toi l’espace goûte la félicité ; les astres dans la profondeur des cieux t’obéissent.
« Les constellations mouvantes sont tes demeures ; tu ouvres les portes des orbes célestes ; les dieux t’adorent avec respect dans le firmament ; ceux qui sont parmi les augustes se tiennent dans l’ombre de ta splendeur ; et la terre entière te rend gloire, Sahou illustre parmi les Sahous, grand de dignité, permanent d’empire.
« C’est toi, ô Sérapis ! qui maintiens la justice dans les mondes ; tu emportes les boulevards des méchants et tu conduis les bons par la main vers une prospérité multiple. Le ciel et la terre sont le lieu de ta face ; tu commandes aux humains, aux purs, à la race des habitants d’Égypte et aux nations étrangères.
« Dieu des semences, tu portes en toi tous les germes et sous ton action bienheureuse la terre se féconde paisiblement.
« L’universalité des hommes est dans la joie, les entrailles sont dans les délices, les cœurs sont dans le ravissement à cause de toi, seigneur miséricordieux ! »
Elle se tut et la vibration de sa voix faisait frémir encore les parois du Temple ; puis, s’inclinant sous la chape lourde, elle ajouta en terminant :
« Ce que ton père divin a ordonné par toi, ô Sérapis, que cela soit fait selon sa parole ! »
Il y eut un recueillement pendant lequel Cléopâtre commença le sacrifice. Avec des mouvements larges elle fit l’offrande des hosties pacifiques et les libations de vin d’orge et de lait ; et tout bas elle murmurait des prières dont Paësi lui avait enseigné le sens mystique.
Quand les libations furent faites dans le nombre prescrit, la Grande Prêtresse découvrit la statue du dieu[57]. D’abord elle la purifia par l’eau ordinaire et par l’eau rouge, par l’encens du midi et par l’alun du nord, et lentement elle la revêtit des ornements consacrés que le Chef des prêtres lui tendait.
Puis elle se retourna à demi vers les hiérodules qui commencèrent les invocations ; et, se penchant de nouveau vers la statue de Sérapis, elle lui caressa longuement la face de sa main droite ; c’étaient des gestes lents d’abord, plus pressés ensuite, une sorte de magnétisation par laquelle elle devait faire descendre dans le simulacre l’âme même du dieu et lui ouvrir la bouche pour les paroles prophétiques.
Pendant ce temps, la première hiérodule psalmodiait lentement les invocations rituelles[58].
« Viens à ta demeure, ô Sérapis ! viens à ta demeure. Ne m’aperçois-tu pas ? À cause de toi mon cœur est dans l’amertume. Mes yeux te cherchent. Tarderai-je à te voir ? Te voir est le bonheur. Aussi vers toi les dieux et les hommes ont tourné leur face. »
La seconde hiérodule reprit à son tour :
« Viens à ta demeure, excellent souverain, ô Sérapis ! Viens à ta demeure et réjouis-toi. Tes ennemis sont anéantis et tes deux sœurs sont auprès de toi en sauvegarde de ta personne sacrée ; tu vois leur tendre sollicitude. Viens, ô viens ! parle, ô Chef suprême ! Détruis les angoisses qui sont dans nos cœurs. »
Ainsi elles s’alternaient sur le même rythme monotone, où toujours les mots : « Viens à ta demeure », revenaient comme l’appel suprême de leur désir ; tandis que Cléopâtre, debout devant le dieu, continuait à lui caresser les lèvres de ses doigts souples. L’obscurité commençait à gagner le Temple qui se remplissait d’une atmosphère mystérieuse. Dans le fond luisaient seulement comme deux points d’or les yeux de l’urœus sacré dressé sur le naos de sa barque.
Au bout d’un moment, Paësi joignit les rideaux d’hyacinthe qui voilaient le troisième compartiment du Temple ; les hiérodules se turent, car l’oracle allait parler, et les Prophètes, derrière le voile fermé, se prosternèrent. Mais le Chef des prêtres et Cléopâtre avaient été seuls à entendre les paroles du dieu.
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER
Depuis six jours la caravane qui emportait Taïa vers le roi des Nasamones était en marche. Le désert Libyque, long, impitoyable, étendait devant les voyageurs ses plaines sans fin. Il ne fallait pas espérer rencontrer la moindre trace de végétation, ou le plus mince filet d’eau, avant l’oasis d’Amon ; en revanche, une bruine de poussière tombait presque continuellement du haut des dunes ; au loin, le prolongement de ces collines de sable formait une interminable ligne d’un gris jaunâtre.
D’êtres vivants, il n’y en avait pas davantage ; ce n’était pas là, comme dans la vallée silencieuse du Nil, le laboratoire mystérieux où se faisait l’éclosion des germes sous la chaude lumière d’Osiris, mais l’immensité stérile, au bout de laquelle il semblait qu’on ne retrouverait la nature en sève nulle part ni jamais.
Grâce aux précautions prises au départ, les envoyés de Cléopâtre n’avaient pas trop souffert ; sans ménagement on avait bu l’eau des outres et abreuvé les montures ; on savait, d’ailleurs, que d’abondantes provisions restaient encore sur le dos des ânes de charge.
Cependant, la traversée du désert remplissait les hommes d’une mélancolie vague ; ignorant pour quelle cause ils étaient en route, ils sentaient leur tristesse grandir à mesure qu’ils s’enfonçaient dans cette solitude dont on n’entrevoyait pas l’issue. Mais Taïa, aux heures d’implacable abattement, ranimait les courages ; elle faisait monter sur son éléphant les deux jeunes Grecques de Salamine, et leur commandait de chanter de vieux airs égyptiens, qu’elle accompagnait elle-même avec la cithare ; pris par la magie du rythme, les soldats pressaient leurs chevaux autour des chanteuses et la caravane avançait au milieu des mélopées monotones dont les vibrations allaient se perdre dans les plages lointaines du désert.
Le soir, quand la lune s’élevait doucement derrière les montagnes de sable, on faisait halte ; alors les eunuques racontaient l’histoire mystique des astres ; ils disaient la gloire incommensurable de Sirius et les migrations perpétuelles des étoiles : le ciel était rempli d’hypogées où dormaient les constellations éteintes, attendant pour briller encore l’incarnation nouvelle des dieux sidéraux.
Ainsi l’harmonie et le bon ordre étaient à peu près maintenus, lorsqu’un matin, au réveil, les soldats de la légion cherchèrent vainement dix de leurs compagnons, les plus vigoureusement montés ; sans doute, las des fatigues de la route, ils avaient fui avec leurs chevaux en ligne directe vers le cap de Leuce-Acte et la mer. En même temps les esclaves chargés de la distribution des vivres venaient en courant dire que deux des grandes outres remplies d’eau du Nil avaient disparu. Un instant la consternation fut vive, mais on se rassura promptement ; le mal en effet n’était pas complet et les fuyards avaient juste emporté ce qu’ils auraient consommé eux-mêmes jusqu’au terme du voyage.
Mais tout à coup, à l’arrière du campement, des cris de désolation et de fureur se firent entendre ; les outres qui restaient avaient été percées ; pendant la nuit, l’eau qu’elles contenaient était tombée goutte à goutte dans le sable aride et il n’en restait nulle trace.
Donc, là encore, la trahison s’était glissée. Un profond découragement s’empara alors des hommes ; sans même vouloir rejoindre leurs tentes, ils se couchèrent ; et ils murmuraient entre eux que mieux valait mourir dans les sables que de continuer sans eau la traversée du désert. Au loin, des blocs rocailleux, semblables à des stèles funéraires, s’élevaient ; — et les rides profondes du sol, ondulant à l’infini, formaient comme des plis de suaire.
Pour essayer de secouer cette inertie, les eunuques parurent ; ils racontèrent que pareillement le grand Alexandre avait été surpris par la disette d’eau presque à la même place, lorsque, parti de Parœtonium, il était venu consulter l’oracle d’Amon ; les dieux l’avaient secouru : une pluie abondante, comme il n’en tombait presque jamais dans cette contrée désolée, avait sauvé d’une mort certaine l’illustre pèlerin et sa suite[59]. Pourquoi la divinité, qui tant de fois s’était montrée favorable à Cléopâtre, ne renouvellerait-elle pas en faveur de ses serviteurs le même miracle ?
Mais les soldats, à mesure qu’ils faisaient abandon de leur vie, sentaient diminuer leur foi aux superstitieuses croyances ; aussi renvoyaient-ils les eunuques avec des paroles brutales ; quelques-uns même les menaçaient de leur longue épée, en les appelant maudits fourbes et diseurs de mensonges.
Alors Taïa vint au milieu d’eux ; froidement, en peu de paroles, elle ordonna aux esclaves d’apporter les provisions de fruits. Les lourdes corbeilles furent entr’ouvertes et l’or des citrons et des mandarines, la peau luisante des pommes et des poires cueillies dans les vergers fertiles d’Éleusis, étincelèrent. Taïa, d’un geste, montra aux soldats toutes ces richesses.
« Il y a là, dit-elle, autant de ressources qu’il en faut pour achever notre voyage ; deux jours seulement nous séparent de l’oasis d’Amon. Chacun de vous, au surplus, doit être muni d’une petite fiole d’eau-de-vie de palme, dont il peut faire usage à sa convenance. Comment osez-vous préférer aux hasards d’une courte lutte une mort lâche, sans gloire ni profit ? »
Les hommes en grand nombre se levèrent ; tout en murmurant encore, ils délièrent les entraves de leurs chevaux ; et bientôt après on se remit en marche ; au bout du premier stade parcouru, un galop rapide résonna, étouffé à demi par l’épaisseur des sables : c’était le reste de la troupe qui, gagné par la contagion de l’exemple, rejoignait en hâte le convoi.
Mais le découragement persistait parmi les gens de l’escorte ; on avançait silencieusement dans la route montueuse qui serpentait entre les dunes comme un immense ruban de moire blanche ; les bêtes surtout souffraient du manque de leur ration d’eau habituelle ; les chevaux relevaient avec peine leurs sabots fatigués, et les éléphants allongeaient leur trompe, cherchant à flairer le voisinage prochain des lacs de natron et des sources. Enfin on arriva sur le plateau de Pihosem, d’où le regard embrassait un large horizon circulaire : au nord, la côte toute blanche de Parœtonium et la ligne bleue de la Méditerranée ; à l’ouest, l’étroite vallée du Sylphium et plus près, dans une forêt de palmiers et de térébinthes, l’oasis d’Amon, au milieu de laquelle s’élevait, comme une autre végétation de granit, le temple immense du dieu qui renfermait toute une ville dans sa triple enceinte. C’était le salut, la terre promise où les gosiers altérés s’abreuveraient de l’eau des sources avant de reprendre la route d’Augila.
Maintenant on marchait sur un sol anciennement occupé par la mer ; à la surface affleuraient des éclats de bois fossiles pétrifiés ; des coquilles desséchées d’huîtres et de moules, des carapaces de tortues s’écrasaient avec bruit sous les pas des chevaux ; quelquefois des débris de navire, des figures de dauphins posées sur de petites colonnes brillaient à travers le sable ; c’étaient des offrandes faites à Neptune par les matelots cyrénéens que les vagues avaient rejetées jusque-là ; les esclaves dévots et les soldats, repris avec le désir de vivre de leurs craintes superstitieuses, les ramassaient et s’en faisaient des amulettes.
Enfin, un matin, on rencontra des sources jaillissantes. On touchait au bourg d’Amon ; le soir, on y serait arrivé. L’eau-de-vie de palme avait été bue et répandait parmi les hommes une gaîté chaude. C’était le dernier jour du mois d’Epiphi, celui où l’on célébrait par toute l’Égypte et dans la région Libyque la Fête des Lampes Ardentes. Chaque habitant devait exposer en plein air de petits vases remplis d’huile et de sel, où pendant toute la nuit brûlait une étoupe enflammée[60]. Au seuil des maisons, le long des chemins, entre les allées des temples et sous les feuillages luisants des arbres, brillaient avec un clignotement mystérieux les lumières saintes ; des chants résonnaient, qu’accompagnait le grincement monocorde des psaltérions. Dans les sentiers touffus et au fond des bosquets aux bonnes odeurs d’aloès et de térébinthes qui avoisinaient le temple, les hiérodules, transformées en courtisanes, faisaient aux passants l’oblation des joies charnelles en l’honneur du Père de la nature féconde, que glorifiait cette panégyrie. Entre leurs bras les soldats de la légion oublièrent cette nuit-là la soif brûlante du désert et les peines nombreuses de la route.
Cependant Taïa s’était dirigée vers la Fontaine du Soleil, que masquait encore le petit sanctuaire d’Amon[61] ; de loin, on entendait le jaillissement de la source qui s’élevait d’une très grande profondeur dans un pli de terrain entouré de dattiers, de nénuphars blancs et d’acanthes. Fraîches pendant le jour, les eaux de cette fontaine merveilleuse devenaient plus chaudes à mesure que le soleil s’enfonçait à l’horizon ; la nuit, elles étaient tièdes et parfumées de toutes les senteurs de l’oasis.
La jeune fille débarrassa sa poitrine du bouclier de peau de chèvre ; elle défit l’agrafe à tête de crocodile qui attachait sa jupe ; mais l’étroite cotte, retenue par la cambrure de ses hanches, y resta attachée ; et, d’un geste souple de ses deux mains, elle la rejeta par-dessus ses épaules, en pressant contre son corps le haut de ses bras charnus ; libre de tous vêtements, elle se plongea par trois fois dans l’eau claire de la source : ainsi l’exigeaient les rites avant de pénétrer dans le temple du dieu.
La demeure d’Amon était déserte ; mais les lampes ardentes, qui brûlaient à profusion dans les avenues de la triple enceinte, répandaient au loin une lumière ambiante et, par les salles à ciel ouvert, l’intérieur du temple en était suffisamment éclairé ; au plafond très élevé des autres compartiments étaient peintes des étoiles d’un rouge sombre, d’où semblait provenir cette lueur mystérieuse ; et, symboles de la fécondité, des vautours en grand nombre, les ailes éployées, paraissaient être descendus de ces régions sublunaires pour l’adoration nocturne d’Amon Générateur. À l’extrémité du sanctuaire, près de sa statue ruisselante d’émeraudes, des cérastes vivants, consacrés au dieu, sifflaient doucement au fond de leur barque, comme dans l’incubation d’une vie nouvelle.
Taïa s’agenouilla sur les dalles et demeura immobile ; il lui répugnait de se mêler aux orgies dont elle entendait monter jusqu’à elle les bruits confus ; elle préférait s’abîmer dans le recueillement, en face du dieu à tête de bélier. D’ailleurs, initiée par les confidences de Cléopâtre aux doctrines secrètes de l’Égypte, elle voyait dans ces figures tangibles, parfois bizarres, et dans les emblèmes multiples de la divinité, les agents d’une pensée supérieure et essentielle. Pour elle, qu’il s’appelât Amon, Sérapis, Kneph, le chef des diverses trinités égytiennes était toujours « ce dieu un, unique, le seul qui vive en substance et qui ne soit pas engendré ; le père des pères, la mère des mères[62] » ; et son esprit se perdait « au fond de l’océan primordial dans lequel, au commencement, flottaient confondus les germes des choses[63] ».
Le lendemain la Libyenne exigea qu’on se remît en marche pour Augila ; les bêtes s’étaient reposées, les provisions avaient été renouvelées ; mais les hommes, fatigués de leur nuit de plaisir, somnolaient sur leurs montures dont le pas lent et régulier les berçait. De nouveau apparut le désert vague ; pendant plusieurs jours les collines de sel, les montagnes de sable se succédèrent comme dans la vallée aride de Pihosem ; mais des phénomènes étranges venaient rompre la monotonie du trajet ; à travers la lumière fluide du soleil se réverbéraient des images lointaines ; parfois toute une ville apparaissait avec ses tours blanches et ses obélisques, ses palmiers et ses toits en terrasse, apothéosée dans la gloire éblouissante de l’astre ; mais à peine avait-on eu le temps d’entrevoir cette féerie qu’elle s’évanouissait à l’horizon, laissant aux voyageurs la vision consolante des cités prochaines. Cependant ce n’était pas toujours les mêmes splendeurs. Au coucher du soleil, l’atmosphère s’emplissait de formes bizarres ; et, comme d’une faune fantômale et gigantesque, le désert se peuplait d’êtres fabuleux ; de tous côtés on croyait voir surgir des sphinx à tête humaine, des griffons au corps de chacal, des tigres ailés, venant d’une terre inconnue où la divinité leur prêtait des formes surnaturelles ; ces ombres falottes s’attachaient aux voyageurs et les remplissaient d’épouvante, malgré les discours des eunuques qui expliquaient en termes savants les effets du mirage et de la réfraction des rayons solaires, si fréquents sur ce point du désert Libyque[64].
Dans cette région, d’ailleurs, tout semblait tenir du miracle, tout était fait pour frapper vivement l’imagination d’hommes simples et superstitieux ; le matin, au lieu de monter graduellement de l’orient, le soleil se dressait tout à coup à l’horizon en une énorme colonne de feu, dont le chapiteau s’écrasait un peu au sommet comme sous le poids de la voûte d’azur ; souvent il s’arrondissait dans l’éther, pareil à un grand bouclier de cuivre étincelant ; et les soldats en tiraient bon présage, disant que Sérapis lui-même marchait devant eux pour les protéger contre les dangers de la route. Quant à Taïa, elle pensait à Cléopâtre et à Kaïn.
Une oasis de palmiers au milieu de l’aridité des sables : tel était le canton d’Augila. Là, les barbares que commandait Magas[65] venaient chaque année pendant l’été pour la récolte des cinq espèces de dattes ; ils descendaient par troupes nombreuses des jardins des Hespérides ou des autels des Philènes ; plusieurs d’entre eux se répandaient alors dans les environs d’Augila, à l’entrée du désert, et ramassaient des sauterelles qu’ils faisaient sécher au soleil pour en tirer une poudre dont ils assaisonnaient leur breuvage.
Quand la caravane entra sous les grands arbres, tous les Nasamones étaient occupés à la cueillette. Demi-nus, ils se tenaient accrochés par les pieds à la branche la plus élevée des palmiers d’où ils détachaient péniblement, avec une hache, les lourds régimes de fruits ; au moyen d’une corde d’aloès ils les faisaient descendre ; les femmes, assises sur le sol, procédaient au choix et à l’arrangement. Presque toutes étaient belles et vêtues d’une courte tunique en poils de chèvre ; leurs cheveux, qu’elles laissaient croître, tombaient en masses lisses sur leurs épaules ; à leurs chevilles étaient suspendus des cercles de cuivre ; celles qui étaient encore vierges n’en portaient point ; en revanche les autres, chaque fois qu’elles faisaient à un homme nouveau le don d’elles-mêmes, devaient se parer d’un nouvel anneau ; quelques-unes — et ce n’était pas les moins estimées — en avaient les jambes couvertes jusqu’aux genoux.
À l’arrivée de la caravane, une rumeur s’était produite parmi les barbares ; promptement ceux qui étaient au faîte des arbres en étaient descendus, tandis que les femmes se hâtaient vers les tentes faites d’asphodèles et de joncs entrelacés, où d’autres Nasamones étaient occupés à entasser les fruits ; mais déjà ceux qui étaient disséminés aux abords de l’oasis avaient couru derrière les voyageurs ; bientôt l’éléphant que montait Taïa avait été escaladé par un barbare. Les soldats de la légion avaient voulu s’interposer ; mais, sur un signe de la Libyenne, ils s’étaient contentés de tirer leur épée et de se tenir sur la défensive. Poussés par la foule houleuse des barbares, ils arrivèrent à la suite de Taïa jusque devant le pavillon du roi Magas.
L’entrée, gardée par deux Nasamones armés de lances, était ouverte, et de loin on apercevait le chef étendu sur un monceau de peaux de panthères et de gazelles sauvages. Sa chevelure, raide comme une crinière, s’étageait sur ses épaules ; chacun de ses traits portait l’empreinte d’une volonté puissante, et ses mains larges et fortement nouées, qu’il tenait à plat sur ses genoux, avaient, elles aussi, la même expression de ténacité. Près de lui étaient accroupies ses femmes, nues sous un enguirlandement de plumes d’autruche et de coquilles peintes ; comme d’autres coquillages encore, leurs lèvres, leurs oreilles et les ongles longs de leurs mains étaient recouverts d’une couche de murex sauvage.
Taïa descendit de son éléphant et pénétra dans l’intérieur de la tente ; en la voyant revêtue de la peau de chèvre des Libyennes de la Cyrénaïque, un mouvement de surprise saisit les Nasamones et troubla même la majestueuse placidité de Magas. Une méfiance aussi le prenait à la vue de la double file de soldats étrangers dont les casques reluisaient sous le soleil, entre les figures hirsutes des barbares.
Il se souleva sur un coude et enveloppa la jeune fille d’un long regard ; il la touchait presque de ses yeux qui saillaient de l’orbite, à fleur de son front.
Sans détourner la tête, il s’adressa à celui qui avait amené Taïa :
« Qui est cette femme ? Que veut-elle ? »
Avant que le barbare eût parlé, la Libyenne répondit dans le même idiome :
« Je suis venue auprès du roi Magas, chargée d’une mission secrète ; il daignera m’entendre, avant de me faire repousser par ses sujets. »
En même temps elle tendait au chef le message de Cléopâtre ; mais lui, sans détourner les yeux du visage de Taïa, l’écoutait avec un étonnement croissant. Le son de cette voix, la lueur fauve de ces yeux, éveillaient en sa mémoire d’anciens souvenirs.
« Dis-moi ton nom, demanda-t-il de nouveau.
— Je suis l’une des suivantes de l’illustre reine d’Égypte. C’est elle qui m’a envoyée ici. »
Puis plus bas elle ajouta :
« Dans la lutte décisive qu’elle soutient, Cléopâtre a vainement cherché autour d’elle des alliés ; elle a tourné les yeux vers vous et sa dernière espérance est que vous lui veniez en aide contre Rome. »
Cette fois, Magas prit le rouleau de papyrus que lui tendait Taïa ; il reconnut l’empreinte du sceau à figure de sphinx dont se servait la reine d’Égypte et qui était communément gravé sur les monnaies du royaume.
Pendant qu’il lisait, Taïa avait fait apporter devant la tente les présents royaux. Autour des vaisselles d’or et des somptueux cristaux enchâssés dans le lapis, les barbares s’étaient groupés en poussant des cris d’admiration.
Mais Magas, considérant à peine ces trésors, les repoussa d’un geste orgueilleux.
« Tout ceci, dit-il, retournera à la cour de Cléopâtre ; il n’est pas besoin de pareilles richesses pour m’engager à assouvir ma haine contre Rome. Jeune fille, je t’accompagnerai à Alexandrie auprès de ta maîtresse. »
Puis encore il interrogea la Libyenne :
« Comment la reine a-t-elle choisi, pour me l’envoyer, un pareil ambassadeur ? »
Elle sourit.
« Personne mieux que votre ancienne esclave, illustre Magas, n’aurait su trouver le chemin d’Augila et celui de votre cœur. »
Magas alors reconnut Taïa, que curieusement les femmes du chef barbare examinaient.
CHAPITRE II
Le désir de César avait été exaucé : Péluse était tombée sans lutte entre les mains de l’armée romaine[66].
Dans toute l’Égypte un grand trouble s’était répandu à cette nouvelle ; quelques-uns l’estimaient heureuse, comme le premier pas vers le dénouement d’une situation désespérée ; d’autres — et c’était le plus grand nombre — tenaient encore pour Antoine ; nul n’avait songé à accuser Cléopâtre d’avoir été l’instigatrice de cette subite reddition.
Mais de Parœtonium le triumvir accourut. Il voulait couvrir Alexandrie et défendre Cléopâtre malgré les défaillances dont il soupçonnait la reine, car des doutes lui étaient venus, à lui qui connaissait mieux que personne les ressources que Péluse aurait pu opposer à l’ennemi. Pendant qu’il rentrait dans sa capitale par la Porte de la Lune, César Octave établissait son camp au nord-est de la ville, à l’Oppidum de Juliopolis[67], en vue de la mer.
Les soldats du jeune César étaient fatigués de la route ; sans attendre le soir ils s’étendirent sur le sable fin et s’endormirent, rêvant des délices promises à la prise prochaine d’Alexandrie. C’était là l’étape dernière après laquelle devait s’ouvrir l’ère de la paix universelle : Octave le leur avait dit et ils croyaient à la parole d’Octave.
Au milieu de cette quiétude Antoine vint les surprendre. Il avait réuni les parties éparses de son armée. Ses vétérans lui étaient restés fidèles ; quelques-uns des gladiateurs, qu’il exerçait jadis à Cyzique en vue de jeux insignes pour le triomphe qu’il se flattait de remporter sur Octave, étaient parvenus à le rejoindre ; enfin, il avait encore une phalange macédonienne, puis les cavaliers montés et les chars de la milice d’Alexandrie[68].
Octave les vit de loin s’avancer comme une trombe ; leurs ombres mouvantes envahissaient déjà la plaine d’Éleusis et la vallée des Sépulcres. Vivement il parcourut l’Oppidum et fit rassembler les soldats ; le jour commençait à baisser ; pêle-mêle les chevaux furent tirés des litières et amenés en ligne, tandis que les troupes de pied se massaient à la hâte sous la conduite de leurs officiers.
Mais à peine les premières escouades de cavaliers étaient-elles hors du camp que l’armée d’Antoine venait les cerner de tous côtés. Les Romains cependant se défendaient avec énergie, malgré le désordre de leur équipement ; plusieurs, dans la précipitation de l’alerte, avaient laissé sous les tentes quelques-unes de leurs armes, leur javeline ou leur lance, et, en des corps-à-corps désespérés, ils attaquaient les soldats égyptiens pour s’emparer des longues piques et des khopesch, dont ils se servaient pendant le combat ; mais ceux-ci, exercés à lutter, avaient presque toujours l’avantage.
Écrasés par les forces massives d’Antoine, les bataillons romains faiblissaient sensiblement. Octave, resté dans le camp, envoya à la rescousse ses dernières réserves de troupes légères. Ils vinrent et tout en courant ils lançaient de longues flèches, dont les soldats égyptiens cherchaient à se garer avec leur bouclier de peau de bœuf, qu’une rondelle de métal renforçait au milieu.
Cette fois, c’était la cavalerie d’Antoine qui se trouvait prise entre deux colonnes ennemies ; pour protéger les chars, les vétérans et les gladiateurs se multipliaient. Ils se tenaient à l’avant des chevaux et frappaient de l’épée ou du poignard tous ceux qui cherchaient à en approcher.
Mais le résultat était incertain encore quand une partie de la phalange macédonienne, demeurée en chemin à la hauteur des Salines, escalada le plateau de Juliopolis et accourut au secours du triumvir. Un soldat marchait en tête, excitant ses compagnons à l’attaque ; et avec sa hache il se faisait une vaste trouée au milieu de la masse des archers romains. Les autres le suivaient en l’imitant ; ils allèrent rejoindre Antoine au centre de la bataille.
Alors dans l’obscurité grandissante ce fut une mêlée terrible. Le triumvir, repris de toute sa fougue, se battait avec une témérité inouïe et ne laissait même pas à son écuyer, debout près de lui à l’avant du char, le temps de le protéger avec son bouclier contre les flèches des ennemis. La même ivresse s’était emparée de tous les hommes ; maintenant dans le vertige du combat ils se ruaient les uns sur les autres, avides de sang et indifférents au danger.
Quand la nuit vint, beaucoup de soldats romains étaient couchés dans le sable, leur casque rabattu sur la figure ; dans les ténèbres, Antoine avec ses cavaliers et ses chars poursuivit l’armée d’Octave le long des chemins en pente jusqu’aux rives du canal de Canope.
Le triumvir revint à Alexandrie avec la même promptitude ; sans prendre le temps de se débarrasser de ses armes, il rentra au palais du Bruchium ; la revanche qu’il venait de prendre le ravissait surtout à cause de Cléopâtre, et il était aussi pressé de la lui apprendre que s’il en avait été à son premier fait d’armes, tant l’amour de la reine d’Égypte lui suggérait au cœur de juvéniles faiblesses.
Prévenue par Kaïn, la reine l’attendait avec Paësi et quelques-unes de ses femmes. Pendant les trois heures qu’avait duré le combat, elle était restée hésitante entre deux sentiments opposés. La capitulation de Péluse lui donnait le droit de considérer Octave comme son allié et elle se croyait trop engagée vis-à-vis de lui pour ne pas souhaiter sa victoire définitive. Toutefois Antoine, malgré la trahison dont elle venait de l’accabler, était resté le maître de son cœur. Encore et surtout était-il le maître de ses sens, — et Cléopâtre, en voulant le rassurer à son retour de Parœtonium et dissiper les doutes qu’elle sentait naître en lui, s’était laissée reprendre elle-même aux séductions de cet amour.
Telles étaient ses pensées quand le triumvir entra ; il ploya d’abord devant elle le genou et, se relevant prestement, il l’attira sur son cœur et l’embrassa avec effusion.
« Que ma déesse, la nouvelle Isis, dit-il, soit satisfaite de son fidèle adorateur : l’armée d’Octave vient de subir un rude échec. Sans les ténèbres malencontreuses qui nous ont interrompus dans notre besogne, nous chassions l’ennemi assez loin pour lui ôter l’envie de revenir. »
Puis, la baisant plus tendrement encore, il ajouta :
« Mais elles sont les bienvenues, ces ténèbres puisqu’elles me ramènent auprès de toi, ma Cléopâtre. L’occasion, d’ailleurs, ne tardera guère d’une nouvelle rencontre, et cette fois définitive. »
Comme il se retournait pour déposer son armure, il aperçut un soldat qui se tenait debout, immobile, sous le linteau doré de la porte. De la main, il lui fit signe d’approcher :
« Je t’avais oublié, mon brave. Que n’oublierait-on pas aux pieds de la divine Cléopâtre ? »
Tout en parlant, il le poussait devant lui jusqu’auprès de la reine d’Égypte :
« Déesse, voici le plus brave de mes hommes, celui dont l’intervention m’a sauvé au milieu du combat et dont la vaillance a excité celle des légionnaires. Qu’il vous plaise de le récompenser selon son mérite ! »
Le soldat avançait gauchement sans lever les yeux. C’était un fantassin de la phalange. La splendeur de Cléopâtre l’éblouissait. Il aurait voulu retourner au Camp Macédonien où ses camarades étaient rentrés avant lui.
Cléopâtre qui souriait répliqua aussitôt :
« Je veux faire don à ce brave d’un casque et d’une cuirasse d’or[69] semblables à ceux de Marc-Antoine ; et, pour mieux lui montrer mon estime, je l’en revêtirai de mes propres mains. »
Puis elle s’approcha de Paësi et lui parla quelques instants à voix basse.
Le prêtre eut un mouvement de surprise.
« Comment, Reine ? murmura-t-il, vous choisiriez, pour le faire passer au camp ennemi, un soldat qui vient de donner de telles preuves de dévouement à la cause d’Antoine ?
— Qu’importe ? reprit Cléopâtre. S’il était Romain, je n’essayerais même pas de le séduire ; mais il est Grec, et un Grec est toujours disposé à vendre ses services au poids de l’or. Va, Paësi, et, pendant que je vais le revêtir de son armure, rédige en mon nom un message pour César ; il faut à tout prix que l’Imperator sache que je suis restée étrangère à la sortie de Marc-Antoine. Ajoute que je suis toujours prête à lui livrer les vaisseaux restés dans le port d’Alexandrie. Cela fait, guette cet homme quand il quittera le palais et remets-lui le message avec un sac de mille drachmes et la promesse d’en recevoir autant des mains de César Octave dès son arrivée à l’Oppidum de Juliopolis. »
Paësi sortit et, à la porte, il rencontra deux esclaves qui revenaient de la Maison des armes ; ils s’inclinèrent profondément devant le Grand Prêtre.
Avec des soins minutieux la reine prit la cuirasse et le casque d’or ; il n’y avait que les chefs supérieurs et les princes qui eussent le droit de porter cette armure ; les soldats des légions égyptiennes étaient simplement coiffés d’un bonnet de feutre et revêtus d’une sorte de brassière en cuir qui leur préservait la poitrine et le haut du ventre. Pendant qu’elle lui plaçait la cuirasse sur le corps, Cléopâtre interrogeait en riant le soldat qui tremblait :
« Comment t’appelles-tu ?
— Léosthénès.
— Es-tu riche ?
— Non, Grande Reine. C’est tout au plus si j’ai de temps en temps un demi-outnou de cuivre pour aller boire aux tavernes des Navalia avec mes compagnons.
— En ce cas, je te plains, dit la reine en continuant à le parer ; la richesse, vois-tu, c’est le bien par excellence, le seul avec lequel on puisse se procurer tous les autres ; car dans ce monde chaque plaisir s’achète. Si j’étais soldat macédonien, au lieu d’être reine d’Égypte, je voudrais échanger une à une les gouttes de mon sang contre autant de pièces d’or. »
Elle dardait les rayons de ses yeux étranges à travers le visage du soldat, tout en lui enfonçant sur la tête le lourd casque étincelant ; et lui frémissait au contact des doigts de Cléopâtre qui effleuraient doucement ses tempes et sous la caresse féline de ce regard qui éveillait en sa chair la soif des voluptés vénales.
À la fin Antoine s’impatienta :
« Il me semble, ma déesse, que voici un héros suffisamment récompensé. Vous oubliez sans doute qu’un autre de vos serviteurs attend, lui aussi, son salaire ? »
Il riait de son franc rire de soudard inaccessible à la fatigue et toujours disposé à des prouesses nouvelles.
Cléopâtre laissa le soldat, qui s’inclina profondément devant les deux souverains ; le sentiment des riches présents dont il était revêtu lui donnait de l’assurance et il se retira d’un pas ferme.
Le lendemain Antoine, en se rendant au Camp Macédonien, apprit que Léosthénès avait déserté ; il supposa qu’Octave l’avait fait séduire à force de promesses ; à son tour, l’idée lui vint d’employer les mêmes moyens d’action ; car il était las de voir, depuis la défaite d’Actinus, ses meilleurs soldats le trahir successivement. Immédiatement sa résolution fut prise d’acheter, lui aussi, au poids de l’or, tout ce qu’il pourrait de l’armée de son rival. Pendant toute la journée, des scribes furent occupés à écrire sur des triangles de papyrus des billets par lesquels il promettait quinze cents drachmes à chaque légionnaire romain qui abandonnerait pour le sien le parti de César[70]. La nuit suivante, ses archers se répandirent autour de Juliopolis et lancèrent dans l’Oppidum des flèches autour desquelles les billets étaient enroulés. Mais Octave veillait encore ; il ne se reposait qu’aux heures du jour, lorsque son armée était sur pied ; et la nuit il se promenait à travers les tentes, méditant sur les moyens de surprendre Alexandrie sans que Cléopâtre et ses richesses pussent lui échapper dans le désordre de la défaite ; il craignait aussi une seconde attaque d’Antoine, ou quelque ruse nouvelle de la reine d’Égypte, dont le message porté par Léosthénès ne l’avait que médiocrement rassuré. Quand ses yeux s’étaient fatigués à regarder du côté de la plaine d’Éleusis et de la Porte du Soleil, il consultait superstitieusement le scintillement des astres ou le vol des oiseaux nocturnes. Au premier billet qu’il avait ramassé dans le camp, Octave avait compris qu’il tenait le moyen de porter un coup définitif au prestige un instant réveillé de son rival. Il resta longtemps immobile à écouter les allées et venues des archers d’Antoine ; puis lorsqu’il les eut entendus s’éloigner définitivement dans la direction d’Alexandrie, il releva au hasard quelques-unes des flèches qu’ils avaient jetées : toutes elles contenaient la même promesse ; alors il appela ses soldats et, les ayant fait se grouper en cercle autour de lui, il leur lut à voix haute la proposition du triumvir.
« Soldats de la République, ajouta-t-il, voilà comment l’on vous traite ; c’est par de l’or qu’Antoine, vous confondant avec ses mercenaires, prétend payer le sang que vous versez librement dans les combats pour le triomphe de Rome. Tel est le degré d’abjection où le triumvir en est arrivé, conseillé par Cléopâtre. »
Des murmures d’indignation coururent comme un grondement lointain de tonnerre entre les rangs des soldats. Octave les domina de sa voix perçante :
« Soldats ! leur dit-il encore, tenez-vous prêts à toute attaque ; et, si dans trois heures l’ennemi n’est pas venu nous surprendre, c’est nous qui marcherons à sa rencontre dans Alexandrie. »
Une immense acclamation de joie salua longuement les paroles de César. De leur palais du Bruchium, Antoine et Cléopâtre, qui reposaient dans les bras l’un de l’autre, en entendirent l’écho affaibli. Le triumvir se leva à la hâte et courut sur la terrasse : l’aube blanchissait, laissant la ville dans une ombre vague, d’où émergeaient seulement la pointe dorée des obélisques et le faîte des grands mâts plantés devant les temples. Sur la mer, une brume lumineuse teintait de rose les flots bleus.
Antoine resta quelques instants à écouter dans le silence et à interroger l’espace. Tout à coup un cri rauque sortit de sa gorge.
Sur sa couche Cléopâtre tressaillit.
« Qu’as-tu, Antoine ? reviens près de moi ; reviens vite ! »
Elle l’appelait de l’élan impérieux de tout son corps dressé à demi hors de la couche, mais le triumvir restait immobile, le bras tendu vers un point fixe à l’horizon. Il venait de voir ses trirèmes sortir une à une de la passe du Taureau, contourner la jetée du cap Lochias et, saluant de leurs rames celles de César, voguer côte à côte avec elles vers la pleine mer.
Anxieuse, Cléopâtre se leva à son tour et alla rejoindre son amant sur la terrasse. On apercevait encore au large comme une volée de goélands les voiles blanches des trirèmes, toutes trempées de la lumière fluide du soleil.
« Tout est fini, dit Antoine. C’est toi, Cléopâtre, qui m’as trahi. »
Elle s’enlaça à lui, le nouant dans la souplesse ophidienne de ses membres :
« Moi te trahir ! Antoine, y penses-tu, quand tu sais que nos destinées sont communes et que nous avons juré de mourir ensemble ? »
Elle se faisait plus caressante, plus persuasive encore, lui soufflant aux oreilles des paroles amoureuses, des protestations de fidélité et de tendresse ; et elle cherchait de nouveau à l’entraîner vers le lit béant, au fond de la chambre que la clarté matinale emplissait peu à peu.
Mais, lui, demeurait insensible ; il regardait toujours à l’horizon le point où ses vaisseaux avaient disparu — et deux grosses larmes coulaient de ses yeux.
CHAPITRE III
Le lendemain était le quinzième jour du mois de Mésori. Au lever du soleil Antoine était sorti d’Alexandrie avec son armée, ne laissant dans la ville que la milice de garde ; et, malgré l’heure matinale, des gens un peu partout stationnaient, discutant au détour des rues et sur les places publiques les chances possibles de la bataille ; car une anxiété commune avait poussé hors des maisons les habitants indifférents d’ordinaire à ce qui n’était pas leurs affaires ou leurs plaisirs. Du petit port de Kibotos, situé à l’extrémité occidentale de la rade, jusqu’au port oriental des Rois, à chaque instant des mariniers et des marchands descendaient en bandes silencieuses et venaient se mêler aux groupes ; des femmes aussi, parmi lesquelles les Égyptiennes de race pure se reconnaissaient à leur longue jupe gaufrée, s’attardaient autour des interlocuteurs ; et les enfants, lâchés en liberté, très amusés par le bruit lointain des chars et par le fracas retentissant des trompettes, se roulaient entre les piliers des colonnades, le sarrau mal attaché aux épaules et la tresse pendante sur l’oreille.
Plus vive était l’émotion aux alentours de l’Hippodrome et dans les Copriœ, où quelques centaines d’hommes seulement s’étaient risqués ; les plus hardis avaient même franchi la seconde enceinte de la ville et poussé leurs investigations à l’entrée de la plaine jusqu’au temple de Cérès et de Proserpine[71]. Là, deux énormes statues figuraient Osiris et Isis sous les traits d’Antoine et de Cléopâtre ; ils en escaladèrent les piédestaux et, pour mieux sonder l’horizon, s’échelonnèrent sur le corps même des colosses ; la gravité de la situation leur enlevait tout scrupule de sacrilège ; et comme des nains ils se perdaient entre les plis de bronze des vêtements, à travers les membres gigantesques des deux souverains déifiés ; sur le disque solaire qui couronnait les têtes royales, plusieurs hommes se tenaient debout, tandis que dans les mains entr’ouvertes d’où pendait la croix ansée, symbole de la puissance féconde, d’autres gerbes vivantes s’épanouissaient comme une éclosion naturelle de cette force. Ainsi, Antoine et Cléopâtre semblaient avoir pris sur leurs épaules le peuple d’Égypte pour le faire assister à l’irréparable défaite que leur insouciant orgueil avait préparée.
Car c’était bien une défaite qui se dessinait à quelques stades de là, sur les plateaux sablonneux de Juliopolis. Telle était, du moins, l’impression que les hommes se communiquaient entre eux ; cependant ils ne se pressaient pas de quitter leur poste d’observation, se contentant de jeter à la dérobée, un coup d’œil sur le pronaos ouvert du temple, où ils comptaient se réfugier, lorsque l’armée triomphante de César s’avancerait vers eux ; ils savaient que l’Imperator, respectueux de la divinité, n’aurait garde de venir les poursuivre jusque dans son sanctuaire.
Tout à coup une nuée de poussière s’éleva sur la route des Salines ; au milieu des tourbillons rapidement soulevés, on voyait étinceler les roues brillantes d’un char auxquelles le soleil, à chaque tour, accrochait des éclairs. C’était Marc-Antoine qui rentrait en toute hâte ; il se tenait debout à l’arrière, les vêtements en désordre, tandis que son écuyer, courbé sur le timon, excitait l’allure des chevaux ; mais les bêtes ombrageuses s’ébrouaient, prises de peur en sentant les lambeaux des caparaçons leur cingler les flancs, et les hautes plumes dont ils avaient la tête ornée leur retomber sur les yeux, battantes et sanglantes comme les ailes d’un oiseau de proie.
Le char laissa à droite le temple de Cérès, et entra dans Alexandrie par la Porte Canopique ; derrière lui, surgissant de tous les coins de la ville, la foule haletante courait ; arrivé à la hauteur du Camp Macédonien, qui s’étendait en fer à cheval depuis le Théâtre jusqu’à l’Hippodrome, Antoine sauta à terre ; il entra seul et ordonna à des soldats qui étaient en faction d’aller chercher le commandant de la milice. L’officier ne tarda pas à paraître : c’était un homme de haute taille et de race thébaine ; il aimait Antoine à cause de la bravoure dont le triumvir avait fait preuve tant de fois ; il aimait aussi Cléopâtre.
« Que l’on ferme immédiatement les portes de la ville, dit Antoine, et que tous les hommes d’armes dont vous pouvez disposer se massent entre la Porte du Soleil et celle de Canope. Octave marche sur Alexandrie. »
L’officier eut un mouvement de surprise. Antoine le comprit.
« Il ne faut pas, expliqua-t-il, compter sur d’autres ressources que celles de la ville ; mon infanterie, dès le premier choc, s’est lâchement ralliée à l’armée romaine. Quant à ma cavalerie, elle se défend encore, mais ne tardera pas à être écrasée sous le nombre. »
Il détourna la tête, et ses yeux se mouillèrent à la pensée de tous ces braves, sacrifiés sans gloire ni profit à une cause fatalement perdue ; mais il fallait sauver Cléopâtre. Il se ressaisit bien vite et eut un grand geste d’indifférence. Qu’importait après tout ? l’essentiel était de gagner du temps, et la résistance des cavaliers empêcherait toujours Octave d’arriver sur Alexandrie avant qu’on eût organisé la défense de la ville.
« Faites aligner derrière les murs d’enceinte les mantelets mobiles et les machines de guerre, ordonna-t-il d’une voix ferme. Au besoin, fortifiez les positions qui vous paraîtraient faibles avec les fascines et les gabions entassés dans l’arsenal. Je reviendrai au milieu de vous quand il en sera temps. »
Et il courut au palais du Bruchium. La porte principale était ouverte et sous les portiques les esclaves causaient entre eux, délivrés de toute surveillance. Le triumvir traversa les vastes salles désertes ; de loin en loin un soldat de la garde de Cléopâtre se levait sur son passage et le saluait, un genou en terre, en abaissant devant lui la pointe de son glaive ; à mesure qu’il avançait, une inquiétude plus poignante le saisissait et, hâtant le pas, il pénétra dans l’appartement même de la reine.
Il était vide ; dans un vase épanoui en fleur de lotus des parfums brûlaient encore ; sur un tabouret en ivoire incrusté de pierres fines une tunique de soie pâle striée d’argent était posée, gardant la forme précise d’un buste. Il n’y avait pas à s’y tromper, c’étaient bien les bras de Cléopâtre qui avaient élargi les mailles souples du tissu ; c’étaient ses épaules un peu hautes et ses seins bombés qui lui avaient donné les renflements voluptueux qu’il conservait encore.
Antoine s’arrêta et attendit : la vue de ces objets familiers tout empreints de la senteur de Cléopâtre lui rendait plus amère la désolation de l’absence ; à chaque minute il lui semblait qu’il allait voir apparaître la reine, accompagnée de ses femmes. Elle viendrait à lui souriante, et l’entraînerait au fond de la chambre, sur cet amoncellement de coussins où ils avaient coutume de passer ensemble de longues heures.
Enfin une suivante entra. Brusquement il s’avança vers elle :
« Où est ta maîtresse ? lui demanda-t-il.
— Je l’ignore. L’illustre reine a quitté le palais peu d’instants après le départ du triumvir.
— Seule ?
— Non, seigneur, avec Iras et Charmione ; le Chef des esclaves les accompagnait. »
Sans attendre de nouvelles questions, la suivante versa d’autres parfums sur le trépied à fleur de lotus ; elle souleva la légère tunique qui perdit aussitôt sa forme vivante, la plia et l’enferma dans un coffre en bois d’ébène.
« La reine va revenir sans doute », ajouta-t-elle en se retournant à demi vers Antoine, qui suivait tous ses, mouvements d’un air hébété.
Alors il redescendit les degrés qui conduisaient à l’atrium ; là du moins il pourrait apercevoir plus tôt Cléopâtre, lorsqu’elle rentrerait au palais.
Entre les colonnes un homme se tenait debout. Il était appuyé sur une pique, dont la pointe lui dépassait l’épaule ; une large ceinture hérissée de dards enveloppait sa taille jusqu’aux aisselles ; le haut de sa poitrine était nu ; de sa tête, sur laquelle un pilier projetait son ombre, dans le demi-jour de l’atrium, on n’apercevait que les deux globes brillants des prunelles. C’était Magas qui, lui aussi, attendait Cléopâtre.
Le triumvir fut frappé par la mine hautaine du barbare ; il s’approcha de lui :
« Qui es-tu ? » demanda-t-il.
Sans changer d’attitude, Magas le toisa d’un long regard.
« Il t’importe peu de savoir mon nom, répliqua-t-il. Dis-moi plutôt si Marc-Antoine doit venir ici. »
Antoine jeta sur lui-même un coup d’œil rapide : l’ample manteau qui l’enveloppait entièrement était tout souillé de sang et de poussière ; il se souvint qu’un de ses légionnaires, passé dans l’armée d’Octave, lui avait fait tomber son casque d’un revers de sabre et il sentit alors ses tempes encore serrées par le bonnet de feutre dont un soldat égyptien l’avait cou vert au plus fort du combat.
« Que veux-tu à Marc-Antoine ? interrogea-t-il de nouveau.
— Je n’ai pas à te l’apprendre. C’est à la reine Cléopâtre que je pensais parler tout d’abord ; mais la reine a quitté le palais et l’esclave qui m’a conduit ici m’a dit que Marc-Antoine ne pouvait tarder à venir, car son char a été aperçu franchissant la Porte Orientale de la ville. »
Et il ajouta d’une voix impérieuse :
« Tu dois savoir où est ton maître. Conduis-moi auprès de lui. »
Antoine, sans répondre, écarta les plis de son manteau, et sa cuirasse d’or sur laquelle s’étalaient les insignes du commandement suprême resplendit tout à coup comme l’irradiation subite d’un astre.
Le chef barbare se prosterna ; bien des fois, au cours de la route d’Augila à Alexandrie, Taïa lui avait décrit le triumvir, et pour enflammer l’ardeur de Magas elle lui avait fait de longs récits dans lesquels toujours elle exaltait la vaillance du rival d’Octave.
Il le reconnaissait maintenant et, avide des représailles longtemps rêvées, il appuyait ses lèvres avec une piété frénétique sur l’épée encore sanglante du triumvir.
Antoine le releva promptement.
« Refuseras-tu encore de me dire ton nom ? »
Alors Magas, les yeux fixés sur ceux du triumvir, parla :
« Je suis le roi des Nasamones, et, comme toi, je commande une armée nombreuse ; or cette armée, je suis venu l’offrir à Cléopâtre pour la défendre contre César Octave et contre Rome. »
Il avait parlé d’une voix forte, sans gestes, comme un homme sûr de la vérité de ce qu’il avance, et Marc-Antoine, gagné par l’orgueilleuse simplicité de ce barbare, l’écoutait avec attention. Il lui demanda :
« Mais quel motif t’a poussé à quitter ton pays pour venir combattre en faveur d’une nation que tu ne connais pas, sous des étendards qui te sont étrangers ? »
Magas redressa encore sa haute taille ; sa main appuya plus lourdement sur le sol la pique de fer.
« Il est vrai, dit-il, que nous n’avons ni le même passé ni les mêmes espérances : les idoles devant lesquelles tu t’inclines ne sont pas les miennes et un destin différent est écrit pour nous au ciel dans les astres. Cependant il n’est pas besoin de beaucoup de paroles pour t’expliquer le motif qui me fait agir : cet Octave, en qui s’identifie aujourd’hui la gloire de Rome, tu le détestes, n’est-ce pas ? Or moi, c’est Rome même que je hais de toutes les puissances de mon être. »
Puis, comme Antoine le regardait avec étonnement, il ajouta d’une voix plus basse et frémissante :
« Mon grand-père était Carthaginois. Au siège de la ville, alors qu’en signe de deuil tous les murs étaient tendus de noir, sa femme lui fut arrachée pour être livrée à la brutalité de Scipion ; sous ses yeux ses enfants furent égorgés et jetés avec des fourches dans la fosse où, vivants et morts, les vaincus pêle-mêle étaient entassés. Mon père fut le seul survivant de ce massacre ; il s’enfuit dans le désert emportant avec lui ces visions sanglantes ; et plus tard les premiers mots qu’il m’apprit à prononcer furent des paroles de malédiction contre Rome. — Comprends-tu maintenant ? »
Antoine lentement avait incliné la tête.
Magas poursuivit :
« Tu comprends que cette revanche, que j’ai fait serment d’avoir, il me la faut ! — Ah ! il y a longtemps que je la médite ! Là-bas j’en rêve dans la tranquillité des oasis. Des lueurs rouges me passent devant les yeux ; les grands arbres qui dressent leurs branches vers le ciel m’apparaissent comme les formes vivantes de mes aïeux qui me reprochent mon inertie — et dans le jaillissement des sources je crois entendre couler à flots le sang des vaincus, le sang de ma race. »
Il s’arrêta de parler ; un mince filet d’écume blanchissait sa bouche ; il l’essuya du revers de son bras nu.
Cependant Antoine demeurait pensif.
« Pour avoir eu l’idée de lutter contre Rome, de combien de soldats disposes-tu donc ? » lui demanda-t-il au bout d’un instant.
Magas était redevenu calme.
« Tu connais, dit-il, les contrées qui s’étendent des Gaules cisalpines à la Sicile et qui s’appellent Campanie, Étrurie, Ammœur, Latium ? Eh bien, je n’aurai qu’à faire un signe et tu verras surgir de mon désert sept fois plus de barbares qu’il n’en faut pour noircir du nord au midi cette région détestée. Moins disciplinés mais plus farouches que les tiens, mes soldats ne portent ni la tunique serrée à la taille, ni la cuirasse, ni le casque ; et leurs cheveux flottent librement sur leurs épaules ; pour armes ils n’ont ni le glaive ni la lance, mais la pique étroite et longue et le boumérang, souple comme le corps d’un reptile, dont ils se servent pour abattre au vol les oiseaux sauvages. Malgré cela, leurs traits sont redoutables et quand ils passent à travers les dunes, pressant entre leurs cuisses nerveuses les flancs de leurs chevaux, ils semblent des êtres fantastiques vomis par la terre pour punir l’injustice et les crimes des hommes. Tous ils viendront. Il faut qu’ils fondent sur Rome comme une trombe et qu’ils l’engloutissent sous un amas de ruines sanglantes. »
Il s’agitait de nouveau et frappait violemment la dalle de sa pique de bronze. Puis il reprit :
« Pour cela il ne nous manque qu’un chef expérimenté qui nous conduise. Tu seras ce chef, toi Marc-Antoine, et tu vengeras Cléopâtre en même temps que je vengerai Carthage. »
Il s’était rapproché du triumvir et lui parlait d’une voix qu’il faisait douce, humble presque.
Marc-Antoine restait silencieux, la tête basse. Enfin, comme Magas insistait encore, il s’éloigna de quelques pas et, le regardant bien en face :
« Écoute, lui dit-il ; je suis pris, acculé, traqué de toutes parts, et dans un instant sans doute je vais tomber sous les coups de César Octave ; mais, fût-ce même pour sauver Cléopâtre, jamais — entends-tu bien ? jamais — je ne tournerai la pointe de mon épée contre ma glorieuse patrie. Crois-tu donc qu’il soit dans le destin de Rome, arrivée à l’apogée de sa puissance, d’être livrée par un de ses fils aux mains cupides des Barbares ? »
Le chef chercha quelque chose à répondre ; les paroles ne lui vinrent pas.
« J’attendrai la reine d’Égypte », dit-il simplement.
À cet instant, Paësi entrait dans l’atrium ; sa figure paraissait bouleversée ; avant qu’il eût parlé, Antoine l’avait saisi par un pan flottant de son manteau :
« Cléopâtre ? Il est arrivé malheur à Cléopâtre ?
— Est-ce donc un malheur de quitter ce lieu terrestre pour monter sur les ailes de l’ibis divin jusqu’en la sainte demeure d’Osiris ? » répondit gravement le prêtre.
Il fit une pause et ajouta :
« La reine vous a cru mort et, selon le serment que vous avez échangé, elle n’a pas voulu vous survivre. Elle s’est tuée ce matin dans le temple d’Isis Lochias. »
Alors Antoine poussa un cri strident, et ce fut une chose étrange pour le Grand Prêtre, habitué à saisir dans une seule note toutes les vibrations d’une âme, de percevoir dans ce cri un sentiment de soulagement et de joie. C’est que le triumvir avait douté de Cléopâtre ; il n’avait pas d’inquiétude plus poignante que celle de la voir appartenir à César Octave ; cela le lancinait comme un dard, dont la pointe, à chaque nouvelle défaite, lui entrait plus profondément dans le cœur. Et maintenant il la retrouvait au contraire telle qu’il l’avait connue au moment de leur vive tendresse, l’attendant à ce rendez-vous dans la mort, qu’ils s’étaient donné comme le but suprême de leurs amours.
Il ôta sa cuirasse et, se tournant vers Magas :
« Tu vas voir, lui dit-il, comment un Romain sait mourir. »
Lentement dans sa poitrine il enfonça la lame de son épée ; son sang gicla, puis retomba sur l’onyx des dalles, en larges gouttes, comme une pluie de rubis étincelants.
Le chef barbare en eut le visage éclaboussé. Sans effacer cette traînée sanglante, il s’éloigna recueilli. Ses yeux venaient de s’ouvrir à des horizons nouveaux, où lui apparaissaient pour la première fois les tendresses immarcessibles et l’amour plus fort que la mort.
CHAPITRE IV
Taïa, après avoir accompagné Magas au palais du Bruchium, avait brusquement quitté le chef barbare en apprenant la disparition de Cléopâtre ; et tout de suite elle s’était mise à la recherche de Kaïn ; un instinct infaillible lui disait que pour l’amour d’elle le Psylle aurait veillé en son absence à la sécurité de la reine ; cela était le meilleur moyen, l’unique peut-être, de toucher le cœur de la jeune fille.
Elle courut d’abord aux jardins de l’Est, vers le pavillon où se tenait ordinairement le Chef des esclaves ; les deux chambres qui le composaient étaient vides ; elle fit le tour de l’enclos des Fleurs et du bassin des Naïades, mais là encore elle ne vit personne. Exténuée, elle s’assit quelques instants sur une margelle de pierre.
Maintenant elle regrettait d’avoir entrepris ce voyage, cette double traversée du désert, au retour de laquelle elle trouvait tout changé. Est-ce qu’on devrait jamais se séparer de ceux qu’on aime ? Oh ! si elle parvenait à rejoindre Cléopâtre, elle s’attacherait si étroitement à elle qu’il n’y aurait plus désormais entre la souveraine et sa suivante la place d’une semelle de papyrus.
Soudain elle se leva ; l’idée lui était venue du Mausolée où Cléopâtre avait fait transporter ses trésors, et dont souvent à voix basse la reine avait parlé à Paësi comme d’un refuge extrême en cas de péril. Mais était-ce bien là que Cléopâtre se dissimulait ? Et comment aussi pénétrer dans cette enceinte, close hermétiquement comme une forteresse ?
Cependant elle irait ; tout lui semblait préférable à cette angoisse de ne pas savoir, dans laquelle son être agonisait.
Elle sortit du palais et longea l’Arsenal, qu’un grand désarroi avait d’un bout à l’autre bouleversé. À travers les baies ouvertes elle jeta un coup d’œil dans les salles. Les râteliers où étaient suspendues les armes étaient vides et béants ; les dernières machines de guerre venaient aussi d’être enlevées : on voyait encore la trace de leur forme dans le sable, sous les hangars ; dans les cours, quelques soldats retardataires emportaient en hâte des sacs de terre glaise et des fascines dont on devait fortifier les remparts.
Taïa pressa le pas ; le Camp Macédonien, qu’elle laissa à sa droite, était désert. Déserte aussi l’Acropole, où deux légionnaires seulement se promenaient, indifférents l’un à l’autre, laissant traîner derrière eux, sur le sol, la pointe luisante de leur glaive.
Enfin elle arriva jusqu’à l’extrémité du promontoire du Lochias, au pied même du Mausolée[72].
C’était un édifice unique, qui semblait avoir été construit pour la durée des siècles. À sa façade australe d’étroites fenêtres étaient pratiquées ; de l’autre côté, il dominait la mer, dont les flots perpétuellement venaient battre ses hautes murailles de marbre, impuissants à en entamer la solidité.
Un ancien palais des Lagides et un temple consacré à Isis l’avoisinaient ; grands eux-mêmes, ils disparaissent devant les proportions imposantes de ce tombeau, que Cléopâtre avait fait immense pour y enfouir ses trésors incalculables et ses rêves infinis.
Une porte monumentale en bronze, ne pouvant s’ouvrir que par un mécanisme intérieur, en défendait l’entrée. Taïa, de ses deux poings fermés, y heurta à plusieurs reprises, mais vainement : rien ne bougea dans le vaste édifice. Elle redoubla de force et ses mains s’ensanglantèrent ; alors elle appela et eut la sensation que sa voix se brisait contre la porte de bronze sans la dépasser. Cependant son instinct lui disait toujours que Cléopâtre était là, derrière ces parois froides et muettes qu’il lui était impossible de franchir. Elle se coucha à quelque distance et attendit. L’écrasement régulier des vagues sur les murailles lui arrivait comme le rythme monotone d’un hymne funèbre.
Au bout de quelques instants, un pas résonna dans l’intérieur du Mausolée ; il semblait venir de loin et Taïa s’étonna de l’entendre.
Avec un bruit sourd la lourde porte s’ouvrit et se referma.
C’était Kaïn. Il marchait la tête basse, comme un homme en proie à une préoccupation profonde ; une large entaille, mal cicatrisée, saignait à sa joue, de son menton à son oreille droite.
En deux bonds, Taïa fut près de lui. Mais, comme s’il ne l’apercevait pas, le Psylle passa sans lever les yeux.
Alors elle se dressa devant lui, immobile, impérieuse, les bras ouverts pour lui barrer le chemin :
« Cléopâtre est là ; j’en suis sure ! Il faut que je la voie. »
Il l’écarta d’un geste nerveux, presque brutal ; et, comme elle se cramponnait à sa tunique, pareille à une mendiante, en répétant toujours la même phrase désolée, il continua de marcher vers l’Acropole, sans lui répondre.
À la fin, Taïa se révolta contre ce mutisme ; elle jeta ses bras autour du cou du Libyen et le força de s’arrêter sous le poids de cette caresse. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans le regard de Kaïn elle vit une douleur tellement farouche qu’elle comprit seulement alors la faute qu’elle venait de commettre en ne lui parlant pas tout d’abord de la passion qui l’absorbait tout entier ; et d’une voix chaude, pleine de vibrations amoureuses :
« Tu ne m’aimes plus, Kaïn ? Qu’y a-t-il donc pour que tu ne m’aimes plus ? »
Alors il parla, soulagé de donner enfin un libre cours à ses reproches ; et les mots s’entrechoquaient sur ses lèvres, qu’une colère terrible faisait trembler.
« Misérable ! comment pourrais-je t’aimer encore, quand tu t’es jouée de moi, quand toutes tes promesses ont été des mensonges ? Pour te plaire, pour t’obtenir, je me suis risqué dans une aventure formidable, j’ai affronté des dangers de toutes sortes avec la presque certitude de mourir en route, là-bas dans cet isthme où tu m’envoyais satisfaire les caprices insensés de ta maîtresse ; mais cela m’était égal et la pensée que tu serais à moi me garantissait mieux que n’importe quel bouclier. Et quand je suis revenu, blessé, exténué, affamé de t’étreindre et d’avoir en toi ma récompense, tu n’étais plus là !… »
Il serra les poings, en proie à toutes les rages de la jalousie.
« Où étais-tu ? Je l’ignorais. Un mystère entourait ton départ ; les esclaves et les suivantes que j’interrogeai ne voulurent rien m’apprendre ; et je me consumai à te désirer, croyant que chaque jour qui se levait était celui qui allait te ramener dans mes bras. Enfin un matin, n’y tenant plus, je me décidai à questionner la reine elle-même. Je supposais pourtant que cette hardiesse allait m’attirer la condamnation au supplice que mon insuccès m’avait mérité et dont, je ne savais pourquoi, on m’avait fait grâce, à mon retour. Mais Cléopâtre, loin de se fâcher, me regarda en riant : « Ah ! me dit-elle, toi aussi, Chef des esclaves, tu es amoureux de ma petite Taïa ! Prends ton mal en patience et sers-moi plus fidèlement encore, en attendant qu’elle soit revenue. » Et, cette fois comme les autres, j’obéis, et, toujours dans la pensée de te gagner, je devins l’exécuteur dévoué des moindres volontés de Cléopâtre. »
La jeune fille, malgré son impatience, avait écouté, sans les interrompre, les confidences du Psylle ; il lui semblait que la colère accumulée en cet homme s’écoulait au cours de ses paroles, comme les eaux vives d’un torrent trop longtemps contenues. Sûre de le dominer maintenant, caressante, elle se serra contre lui.
« Eh bien ! tu m’as retrouvée et je ne m’éloignerai plus de toi, si tu le veux. Alors pourquoi me repousser, comme tu viens de le faire ? »
Mais lui n’avait pas encore tout dit ; et, sans répondre, il continua d’une voix haletante :
« Certes, en me faisant le chien couchant de ta maîtresse, je ne m’attendais guère à la récompense que tu me réservais. Quand ce matin, en me rendant aux Navalia pour le déchargement des gabarres, je t’ai aperçue dans la voie des Apostases ; tu étais montée sur un éléphant, à côté de ce chef libyen que j’ai reconnu pour ton ancien maître et qui inclinait vers toi les paillettes brillantes de son front ; et tu lui souriais à travers les anneaux dénoués de ta chevelure. Alors j’ai tout compris. N’est-ce pas ? Tu étais allée le chercher dans le désert, le séduire avec les caresses de tes yeux et les baisers de ta bouche, pour le ramener aux pieds de Cléopâtre, comme une bête domptée ? »
Toute son exaspération le reprenait plus terrible. Il repoussa la Libyenne loin de lui d’un mouvement brusque qui la fit chanceler et se mit à courir comme un fou sur la jetée qui prolongeait le cap. Arrivé au bord, il s’arrêta devant les vagues montantes.
Taïa, là encore, le rejoignit. Son désir de retrouver Cléopâtre lui faisait braver tout danger ; elle le pria, les mains jointes :
« Kaïn, ne refuse pas de m’entendre. Après, tu feras ce que tu voudras. Mais laisse-moi tout te dire. Je ne t’ai pas menti, je te le jure. Écoute-moi. »
Immobile, il continuait de regarder la mer. Doucement elle le prit par le bras. Derrière eux, le Mausolée dressait sous le ciel ses arêtes puissantes.
Elle força Kaïn à se retourner et, comme à un enfant auquel on fait oublier le chemin par des histoires, elle lui racontait son voyage, en le ramenant dans la direction du Mausolée. Elle lui dit tout : le projet de faire secourir Cléopâtre par les peuplades belliqueuses du désert, et pourquoi elle s’était mise en route.
Aux premières paroles, le Libyen hochait la tête silencieusement ; mais, quand elle parla de la rancune du roi des Nasamones contre Rome, il commença à se laisser convaincre ; lui-même avait trop de haine dans le cœur pour ne pas comprendre les sentiments de Magas.
Ainsi ils étaient arrivés tous deux au pied du Mausolée ; et Taïa, frémissante, leva vers le Psylle ses yeux suppliants. Kaïn crut voir les lèvres de la jeune fille se tendre vers les siennes ; il l’attira à lui et l’embrassa longuement. Dans cette caresse les derniers bouillonnements de sa colère s’étaient apaisés.
« M’aimeras-tu ? » lui demanda-t-il à voix basse.
Elle se contenta de se presser contre lui plus étroitement.
« Et tu seras à moi ? Tu m’appartiendras ? Tu me le jures ?
— Oui, tout ce que tu voudras, pourvu que tu me conduises à Cléopâtre. »
Et, de son bras tendu, elle montrait la lourde porte de bronze.
Il fit jouer un ressort dissimulé dans la muraille ; aussitôt sur une plaque d’airain un son grave et prolongé retentit ; quelques instants s’écoulèrent, puis un panneau de la porte roula sur lui-même et tous deux entrèrent dans le Mausolée.
Ils pénétrèrent d’abord dans des salles basses où étaient cachés les trésors ; une demi-obscurité y régnait. Mais, à mesure qu’ils avançaient, leurs yeux distinguaient des choses brillantes : des blocs de jaspe et de lazulite, des quartiers de roches où étincelaient des paillettes, des minerais d’argent d’Ibérie à l’état brut, mais qui rendaient le quart de leur poids en métal pur[73], des masses solidifiées d’électrum rapportées de l’île Basilée, transparentes comme de l’or en fusion ; puis d’autres masses de minerais noirs[74] marqués de veines blanches et de taches resplendissantes : c’étaient ceux qui contenaient l’or le plus pur des confins de l’Arabie. Cléopâtre avait fait entasser là toutes ces richesses non encore exploitées, impatiente de les posséder en prévision d’une gloire qui paraissait ne devoir jamais finir. Plus loin, c’étaient les parures toutes prêtes, les joyaux déjà montés pour les splendeurs somptuaires.
Puis on entrait dans une autre salle : il semblait qu’on pénétrait dans les entrailles mêmes de la terre où s’épanouissait une végétation inconnue. Des branches de corail d’un rouge écarlate fleurissaient en buissons ardents ; des corindons de toute couleur formaient des massifs de fleurs merveilleuses où le soleil aurait tranfusé toutes les nuances de son prisme. Dans les angles, des sacs pleins de poudre d’or étaient superposés ; aux parois luisantes et stuquées, des perles enfilées dans des cordelettes de papyrus pendaient de la voûte en lignes verticales, comme un suintement naturel d’humidité.
Les deux Libyens s’avançaient silencieusement au milieu de ces amoncellements de richesses. Kaïn pensait à Taïa et Taïa pensait à Cléopâtre. Le Psylle regardait la jeune fille qui marchait près de lui et, dans son cerveau où se reflétait inconsciemment toute la poésie sauvage des espaces, il la comparait aux lianes flexibles, aux jeunes palmiers élancés et forts des oasis natales ; sa chevelure couronnait son front comme les rameaux sombres des cyprès, si touffus que la lumière y pénètre à peine ; ses yeux avaient les lueurs attirantes et mystérieuses des astres qui là-bas se réfléchissaient à la surface polie du Lac des Gazelles — et sa bouche aux lèvres légèrement ouvertes et un peu pâles ressemblait aux pétales à demi déroulés des fleurs d’amandier fleurissant à la lisière des grands bois. La passion lui faisait envisager d’un œil jaloux tous les trésors entassés dans le Mausolée, il rêvait de les changer en un seul vêtement splendide dont la bien-aimée eût été couverte et qu’il aurait, dans la joie de la possession première, jeté comme une défroque inutile aux profondeurs vierges du désert.
Plus vagues, mais non moins ardentes, étaient les réflexions de Taïa. Surexcitée par les émotions de cette matinée, elle avançait comme dans un rêve, le corps allégi et l’âme en fièvre ; elle se plaisait à évoquer Cléopâtre, telle qu’elle s’imaginait la retrouver là-haut dans un instant, à l’étage supérieur du Mausolée. Puis, ainsi qu’une divinité qui se manifeste sous diverses formes, elle la revoyait tour à tour telle qu’elle l’avait connue pendant les dix années passées à ses pieds dans le culte fervent de sa personne : nouvelle déesse avec la grâce immanente de son être, qui l’enveloppait dans un rayonnement mystique comme du voile impénétrable de l’Isis ; souveraine redoutée et obéie, dont le génie avait un instant tenu en échec les forces du monde et bouleversé les empires ; magicienne prestigieuse qui, d’un imperceptible mouvement de ses lèvres, s’attachait à jamais ceux qu’elle avait marqués pour être siens ; femme enfin, et incomparable amoureuse — et alors plus redoutable et plus dominatrice encore dans la lasciveté de ses charnelles effervescences.
Subitement, au milieu de ces visions qui lui faisaient parcourir les salles plus vite, elle s’arrêta. À l’étage supérieur une voix vibrait, qui remplissait d’une coulée d’harmonie très douce le monument sonore. Kaïn crut à une terreur de sa compagne ; il voulut la rassurer en prenant dans sa main rude la petite main chaude et brune de Taïa ; mais elle, tout émue et impatiente :
« Non, non !… Là-haut, au-dessus de nous, la voix de Cléopâtre ! »
Sans attendre qu’il lui montrât le chemin, elle se remit à marcher plus fiévreusement à travers les tas énormes de pierreries, auxquelles Kaïn, dans son ardeur à la suivre, se heurtait parfois. Ils étaient parvenus au pied d’un escalier, pratiqué dans l’épaisseur même d’un mur de traverse ; elle s’y élança la première. À chaque degré qu’elle franchissait, ses talons nus sortaient de ses sandales ; et Kaïn, qui les devinait plus encore qu’il ne les voyait, se hâtait lui aussi, dominé par la hantise de cette chair tant désirée de la Libyenne, vers laquelle il sentait tous les baisers de son être courir.
Arrivée au sommet, elle ouvrit une porte hardiment ; mais une surprise la saisit. Elle avait cru se trouver en présence de Cléopâtre ; et c’était dans une chapelle funéraire, pareille à celles qu’on élevait à la dévotion des morts dans les hypogées du Soma, qu’elle se trouvait.
Tout d’abord elle n’y distingua qu’une chose : une idole de granit rose qui se dressait dans le fond. Cette idole, la reine l’avait fait tailler à sa ressemblance pour son tombeau ; c’était la coutume des grands d’Égypte d’avoir ainsi dans les syringes une image qui les représentait ; par des prières liturgiques et des formules rituelles le grand prêtre y faisait descendre une émanation d’Horus, le dieu des espérances immortelles. Dans la statue vivait cette parcelle de la divinité ; il était de foi qu’elle y demeurait tant que la statue elle-même restait intacte ; pour l’en faire sortir, il eût fallu briser l’enveloppe de pierre ; alors, comme un oiseau rendu soudainement à la liberté des grands cieux, la parcelle divine allait se perdre de nouveau au sein de l’essence même d’Osiris[75].
Et l’idole souriait sous les rayons multiples de la lumière, qui, descendus de la terrasse ajourée, formaient un nimbe d’or sur sa tête. Elle avait les yeux changeants de Cléopâtre, son nez aux narines palpitantes et minces, sa bouche énigmatique et cruelle ; comme Cléôpâtre, elle était coiffée du pschent au double diadème — et elle souriait dans l’attente des adorations futures.
Taïa se prosterna. Des paroles d’amour, des lambeaux d’hymne lui montaient à la fois aux lèvres ; elle s’abîmait en une extase faite de désirs mystiques et de frissons sensuels.
Kaïn, resté debout, lui frappa rudement sur l’épaule.
« Si tu veux rejoindre la reine, il est temps, dit-il. J’ai ordre d’aller à la recherche du triumvir et de le ramener près de Cléopâtre ; — car c’est lui, mort ou vivant, et non point toi que la reine désire voir à cette heure. »
Il avait parlé à voix haute et avec une intention blessante, comme s’il éprouvait le besoin de faire souffrir à la jeune fille un peu des tortures qu’elle lui infligeait à lui sans pitié. Et cela dans le recueillement de cette demeure sembla à Taïa une profanation ; elle se releva et le suivit.
Tout près de là, dans un compartiment qui formait la première chambre de la chapelle funèbre, il s’arrêta ; et, ainsi qu’il avait fait à la porte de bronze, il posa le doigt sur un ressort ; un panneau se releva subitement et retomba derrière la jeune fille aussitôt qu’elle eut pénétré dans la salle où était Cléopâtre.
CHAPITRE V
Dans cette salle la lumière, par de hautes fenêtres, pénétrait abondamment. Cléopâtre, assise dans un fauteuil en or massif, qui ressemblait à un trône, les pieds rejoints sur un escabeau d’ivoire, paraissait encore prête à commander à la foule de ses serviteurs ; ses paupières seulement étaient abaissées et l’on aurait pu croire qu’elle sommeillait, si par instants un léger frémissement n’eût fait onduler la frange luisante de ses cils.
Taïa s’avança ; les deux suivantes, Iras et Charmione, qui étaient agenouillées auprès de la reine, s’éloignèrent, comme c’était l’habitude quand l’esclave favorite venait prendre son service. Elle s’étendit sur une natte devant l’escabeau d’ivoire ; ce grand silence l’impressionnait et doucement elle appuya ses lèvres sur la pointe fine des sandales de Cléopâtre.
La reine ouvrit les yeux ; à voir Taïa couchée à ses pieds elle n’éprouva aucune surprise, et, sans quitter le cours des réflexions qui l’absorbaient si profondément, elle interrogea la Libyenne :
« Pour venir, tu as traversé l’Acropole ? Que se passe-t-il ? Octave est-il déjà entré dans la ville ? — Et Antoine ?… »
Et, comme Taïa, suffoquée par l’étrangeté de cet accueil, tardait à répondre, Cléopâtre poursuivit :
« Paësi a dû guetter le triumvir à son retour au palais, et, s’il est vaincu, lui faire croire que je me suis donné la mort. »
Puis, soupirant :
« N’est-ce pas être morte, en effet, que d’être enfermée dans ce mausolée, loin de toutes les rumeurs humaines ? »
Elle se leva et alla appuyer son front contre le mica brillant des fenêtres, du côté de l’orient.
« À l’heure qu’il est, dit-elle, les destinées du royaume se décident ; et la reine d’Égypte ne sait même pas si les tourbillons de poussière qui s’élèvent de Juliopolis sont rougis du sang d’Octave ou de celui d’Antoine. »
Elle resta longtemps ainsi immobile, à sonder l’horizon, perdue dans ses pensées.
Et Taïa, la tête dans ses mains, étouffait ses sanglots. Plus que jamais elle regrettait ce voyage au désert, qu’elle avait entrepris dans un but illusoire et dont la reine ne semblait même plus se souvenir. Elle ne pouvait s’empêcher de penser à Kaïn, qui, lui aussi, avait essayé l’impossible pour le bon plaisir de Cléopâtre. Une tentation vint à la jeune fille, devant la froideur de la reine, de fuir avec lui dans les oasis, sous les palmiers. C’était peut-être le bonheur, après tout, que la vie naturelle avec le Psylle qui l’aimait simplement, de toutes les forces de son cœur. Bien des fois déjà, dans maintes circonstances, le dualisme effrayant qui était en Cléopâtre lui était apparu nettement ; mais toujours elle s’était refusée à y croire ; et bien vite, d’ailleurs, elle avait été reprise par un regard, un mot, une caresse de l’énigmatique charmeuse.
Au bout d’un instant, Cléopâtre, comme si elle eût deviné ce qui se passait dans l’esprit de la jeune fille, se retourna vers elle à demi :
« Et la mission dont je t’avais chargée, lui dit-elle avec un semblant d’affection, tu ne m’en donnes pas de nouvelles ?
— J’attendais qu’il vous plût de m’en demander, Grande Reine.
— Ce chef libyen, sur qui nous avions fondé de si belles espérances, es-tu parvenue à le rejoindre à Augila ?
— Non seulement je l’ai rejoint, Reine, mais je l’ai ramené. Il doit être maintenant à vous attendre dans le palais du Bruchium. »
Cléopâtre déjà ne l’écoutait plus que distraitement, reprise par sa contemplation du dehors ; ce fut avec une profonde indifférence qu’elle répondit :
« Je crains fort pour la revanche de Magas et pour la mienne que vous ne soyez arrivés trop tard. Si Antoine est vainqueur, nous serons sages de nous en tenir à ce succès sans provoquer de nouvelles batailles ; et si c’est Octave, comme tout le fait supposer, la paix pour de longues années est assurée au monde. »
Soudain, elle poussa une exclamation :
« Voici des légionnaires ! Kaïn marche devant eux ! Mais alors… Antoine ?… »
Il y eut une minute de silence ; puis un second cri plus aigu de la reine :
« Antoine est mort ! c’est son corps que les légionnaires me rapportent !… Ah ! le Grand Prêtre ne m’a que trop bien obéi !… »
Mais au milieu de sa douleur une réflexion subite lui vint : il ne fallait pas que les soldats connussent l’entrée du Mausolée ; elle se retourna vers ses suivantes :
« Vite, enfants, courez mettre les traverses aux poternes et sur aucun signal ne donnez à personne l’accès de la porte principale ; c’est par ici que nous allons faire passer le corps du triumvir. »
D’un geste elle fit signe à Taïa d’ouvrir la fenêtre : le Chef des esclaves approchait et, derrière lui, les soldats avançaient lentement, à cause de leur fardeau.
« Appelle-le, Taïa ! » dit Cléopâtre.
Taïa se pencha en dehors des balustres, et Kaïn releva la tête. Ils échangèrent quelques mots. À cet instant, les légionnaires arrivaient.
« L’entrée du mausolée est inaccessible, leur dit le Psylle. Vous allez monter le cadavre du triumvir par cette fenêtre. — C’est la volonté de la reine ! » ajouta-t-il pour prévenir les murmures.
Malgré cet ordre explicite, les hommes allaient répliquer sans doute, mais dans l’encadrement de la fenêtre Cléopâtre, toute blanche, apparut. Alors, pris de crainte et de respect, ils déposèrent à terre leur fardeau. Taïa leur tendit des cordes ; ils les attachèrent autour de la ceinture et sous les aisselles du triumvir, qui lentement fut hissé par les mains tremblantes des trois jeunes filles[76].
Cléopâtre les regardait agir ; une épouvante la saisissait à voir s’enlever du sol ce cadavre, que soutenaient encore les légionnaires de leurs bras tendus. Quand ils ne purent plus y atteindre, et que, pareil à une dépouille inerte, elle le vit suspendu en l’air, ballotté le long des murailles, où tantôt sa tête, tantôt ses pieds venaient frapper, mal guidé par les mouvements incertains des suivantes qui d’en haut tiraient les cordes, son effroi redoubla ; cependant elle trouvait encore la force de les encourager :
» N’allez pas faiblir, au moins ! Oh ! si ce corps retombait à terre, il s’y écraserait en une bouillie sanglante ! Taïa, ma Taïa, toi qui es robuste et courageuse, ne le lâche pas ! »
Et elle s’attendrissait en voyant les efforts surhumains de la Libyenne, qui, presque à elle seule, soutenait tout le poids des cordages.
« J’ai été dure pour toi tout à l’heure, lui disait-elle ; mais va, tu seras encore la compagne bien-aimée, celle pour qui je n’ai point de secrets et qui me console de toutes mes douleurs. »
Elle se troublait, laissant dans son émotion échapper des confidences brûlantes, des aveux de passion où sa tendresse pour Taïa et son amour pour le triumvir se trouvaient mêlés.
En bas, Kaïn blêmissait.
Cependant, le corps avait été amené jusqu’à la hauteur des balustres, et Cléopâtre le reçut dans ses bras ; à l’autre bout de la chambre, un lit très bas, fait de coussins bariolés, était préparé. La reine et ses femmes y portèrent le triumvir.
Alors, en proie à une désolation sincère, Cléopâtre se coucha sur le corps de celui qu’elle avait aimé. Dans l’abîme que devant elle creusait cette mort, ses ambitions et sa volonté même se perdaient. Elle oubliait que c’était elle qui, par ses menées trompeuses, avait fait ce cadavre, afin d’être libre d’évoluer vers Octave si la fortune lui souriait ; et, dans cet effondrement de tout son être, elle pleurait de vraies larmes, les seules peut-être qu’elle eût jamais réellement versées.
Peu à peu le jour avait décliné et une ombre douce envahissait à présent le tombeau ; le bruit monotone de la Méditerranée accompagnait d’une mélopée sourde les sanglots de la reine d’Égypte.
Tout à coup elle se redressa :
« Il vit ! Taïa, Iras, j’ai senti battre ses artères. Là ! là ! »
Les jeunes filles étaient accourues ; elle saisit la main de la plus proche et la plaça au cou du triumvir, sous l’épaisseur de sa barbe. Il n’y avait pas de doute : Antoine vivait encore ; maintenant cette barbe soyeuse remuait, soulevée légèrement par l’effort de la respiration.
Cléopâtre colla sa bouche sur la bouche de son amant ; à cette caresse brûlante, le triumvir ouvrit les yeux ; un étonnement réveilla ses traits déjà rigides.
Il voulut parler, mais Cléopâtre le supplia :
« Non, ne dis rien ! Attends que la vie te soit tout à fait revenue… »
Pendant ce temps, Taïa était allée dans une salle voisine chercher des liqueurs et des élixirs ; quand elle rentra, Cléopâtre voulut se lever pour préparer elle-même le breuvage. Antoine, d’une pression presque insensible de la main, la retint contre lui :
« Ne t’éloigne pas, murmura-t-il. Les remèdes sont inutiles. Restons seuls plutôt. C’est ainsi que j’avais rêvé de mourir. »
D’un geste désolé elle congédia ses femmes ; puis, se penchant sur lui :
« Non, tu ne mourras pas ! c’est impossible que tu meures, puisque je t’aime !… Vois, je suis là, et ma vie par mes baisers va passer en toi ; mon souffle va descendre dans ta poitrine. Déjà mes caresses t’ont ranimé. Il ne faut pas que tu meures… »
Mais de nouveau le triumvir avait perdu connaissance ; et, à genoux par terre, les cheveux dénoués, Cléopâtre se tordait les bras, convulsée tout entière par cette lutte contre la mort où, pour la première fois, elle sentait son impuissance ; des spasmes d’agonie la secouaient, comme si quelque chose d’Antoine se révoltait en elle aussi contre cette mort. Avec la même sollicitude ardente qui lui avait fait défendre à son amant de parler, elle le pressait maintenant, avide d’entendre encore sa voix : et c’était son nom surtout qu’elle répétait avec frénésie, avec rage, comme si elle voulait arracher son amant aux griffes d’une rivale qui déjà l’aurait entraîné à demi :
« Antoine, Antoine, parle-moi, de grâce ; c’est moi que tu as aimée, c’est moi que tu aimes ; dis-le-moi,… répète-le-moi encore ! »
Plus étroitement elle l’enlaça ; sans soulever les paupières, d’une voix de rêve, il répondit :
« Oui, je t’aime. Ta tête sur mon sein, c’est comme un bon rayon de soleil dont tout mon corps demeure réchauffé. Je suis bien ainsi, avec la caresse de tes cheveux sur mes lèvres ! »
Et en effet il semblait pour un instant revivre ; — et sa bouche pâle souriait, tandis que Cléopâtre se hâtait de le tenir en éveil sous un flot de paroles amoureuses :
« Sens-tu que je suis bien à toi et que rien maintenant ne nous séparera plus ? Tu vas guérir et nous irons vivre où tu voudras, dans un coin perdu du monde et là nous oublierons tout ce qui ne sera pas notre amour. Je serai ta femme, ta servante. Est-ce que je tiens à autre chose qu’à toi dans la vie ? »
Elle lui avait enlevé sa cuirasse et mis la poitrine à nu ; et, autour de la blessure où le sang s’était amassé en caillots, ses lèvres promenaient des baisers ardents.
Puis, comme il ne bougeait pas, absorbé dans la volupté de cette caresse, l’idée lui vint qu’elle le fatiguait avec des étreintes trop vives ; alors elle s’arrêta, mais ses yeux, demeurés sur les yeux à demi clos d’Antoine, le pressaient d’une interrogation muette.
Il s’en aperçut et murmura :
« Si tu savais comme je suis heureux ! Jamais encore tu ne m’avais donné autant de bonheur ! Une suavité infinie s’échappe de toi, telle qu’il me semble être dans un monde nouveau où tu m’appartiendrais plus doucement et plus pleinement qu’autrefois. »
Il se recueillit dans la vision d’une béatitude inconnue et reprit d’une voix mieux assurée :
« Rêve ou certitude, chimère ou réalité, qu’importe ? nous nous sommes aimés ! — Et cela me suffit. De la vie je ne regrette rien, car toute ma soif de vivre s’est assouvie dans les délices de ton amour ; et je ne désire rien au delà, car l’éternité, je l’ai comprise et possédée en toi. »
Il ferma les yeux, mais ses lèvres continuaient à sourire. Cléopâtre avec emportement s’écarta de lui :
« Non ! Il est trop tôt pour que tu meures ! Mon âme, à moi, n’est pas satisfaite, et je veux encore goûter avec toi la douceur de vivre. Ainsi, pour avoir entrevu parfois, à travers des voluptés imparfaites, une étincelle du divin foyer, tu crois avoir connu et épuisé la somme des jouissances éternelles ? Ah ! mensonges que tout cela ! Mensonges ! L’éternité, vois-tu, elle est encore là tout entière, en fermentation dans mon sein ; et, quand tu crois l’avoir saisie au baiser de ma bouche, moi, je la sens encore qui m’étouffe et qui m’embrase. »
Et, comme à la morsure d’une inextinguible flamme, elle portait à sa poitrine ses deux mains nouées.
Antoine détourna tristement la tête. Ainsi Cléopâtre lui échappait encore ; et cette ultime consolation de la quitter apaisée, dans la concordance parfaite de leurs deux êtres, il ne l’aurait même pas.
Mais elle continuait à se soulever, à se rebeller contre la mort, effarée de la sentir la plus forte et de ne pouvoir lui arracher sa proie. Et c’était à pleine voix qu’elle se lamentait près du corps agonisant d’Antoine :
« Oh ! quelle chose infâme, se quitter pour toujours ! Ma jeunesse, ma puissance, tout cela n’est rien, ne sert à rien ! Oh ! dérision que je ne puisse avec toute ma vie insuffler mon haleine à cette bouche mourante, ni prolonger d’une seule minute les battements de ce cœur ! »
Elle regarda Antoine ; ses traits de plus en plus s’altéraient ; sa face devenait transparente ; la mort était là, occupant déjà cette enveloppe, prenant peu à peu possession de cette chair et de cet esprit et les tenant immobiles sous la stupeur de ses affres.
Devant cette agonie, Cléopâtre eut un long gémissement :
« Non, pas ainsi ! Ne meurs pas ainsi ! Attends encore. Tu sais, cette liqueur que tu aimais ? Laisse-moi t’en verser ; nous en boirons ensemble, comme autrefois…. »
Elle se releva et courut chercher une coupe, qu’elle emplit jusqu’aux bords d’un breuvage ambré. C’était sa coupe de prédilection, celle dont elle se servait chaque jour et sur laquelle le médaillon d’Antoine et le sien étaient modelés en relief.
Elle y trempa ses lèvres et l’approcha ensuite de la bouche de son amant.
Alors, le triumvir retrouva un peu de force ; il se souleva et ce fut à longs traits, lentement, qu’il but, dans un recueillement de toutes ses puissances en cette libation dernière. Quand il eut achevé, Cléopâtre voulut lui reprendre la coupe où quelques gouttes restaient encore.
« Non, dit-il, laisse-moi la vider tout entière. Ce sont tes baisers que je bois, c’est ta chaleur que je retrouve dans cette liqueur qui nous a donné tant de fois à tous deux l’ivresse de vivre. »
Il but encore en renversant le fond de la coupe, dont il garda longtemps les bords appuyés contre ses lèvres.
Mais cet effort l’avait épuisé. Tout d’un coup il s’affaissa en arrière, la tête décolorée — tandis que Cléopâtre, évanouie, roulait sur lui parmi les coussins de la couche.
Un grand silence, le silence de la mort, remplit alors le Mausolée ; puis de la route un tapage contenu monta et, peu d’instants après, par la fenêtre restée ouverte, un centurion et une foule de soldats romains pénétrèrent avec des visages effarés dans la salle où les deux royaux amants aux bras l’un de l’autre semblaient dormir.
CHAPITRE VI
Paësi n’avait pas tardé à rejoindre Cléopâtre au palais du Lochias, où la reine était gardée à vue par les soldats romains. Plus que jamais il s’appliquait, dans son amour inquiet de l’Égypte, comme un médecin au chevet d’un moribond, à compter les moindres pulsations de cet antique royaume agonisant. La pensée que l’Isis immaculée, qui avait traversé les siècles dans la splendeur de sa virginité mystique, cette Isis dont le voile jamais n’avait été soulevé, allait être violée par les regards d’un peuple jeune et impie, l’obsédait. Un cataclysme entr’ouvrant les flancs de la terre et engloutissant l’Égypte, avec tout son passé de traditions glorieuses, eût moins attristé le grand prêtre que la profanation de cette souveraineté étrangère. S’il avait un moment soutenu auprès de Cléopâtre la politique et les intérêts d’Octave, c’était avec l’espoir secret que le César laisserait à la reine son royaume intact pour prix de l’abandon, ou même de la mort d’Antoine. Mais le sacrifice avait été consenti trop tard. Maintenant César était entré triomphant dans Alexandrie, la reine était prisonnière et le spectre menaçant de l’Imperator dominait la masse imposante des temples et le profil orgueilleux des obélisques.
Ce qui l’inquiétait par-dessus tout, c’était la crainte que Cléopâtre, cédant aux promesses captieuses du vainqueur, ne consentit à l’accompagner à Rome ; lui, qui ne se méprenait pas sur les véritables intentions d’Octave, savait qu’à cette rentrée triomphale dans la capitale du monde l’Égypte recevrait en la personne de sa souveraine une flétrissure inoubliable ; et il s’ingéniait à trouver le moyen d’arriver jusqu’à Cléopâtre : il se sentait assez d’émotion au cœur et assez d’autorité dans les paroles pour la convaincre et l’arracher à cette ignominie dernière.
Mais Cléopâtre refusait obstinément de le voir. Cependant ce matin-là — c’était le quatorzième jour depuis la mort d’Antoine[77] — le Grand Prêtre, introduit par un soldat acheté à prix d’or, parut soudainement devant la reine, au moment où l’Imperator venait de la quitter. Elle avait conservé la pose étudiée, un peu alanguie, qu’elle avait prise pour recevoir le jeune César ; un de ses bras replié en arrière soutenait sa nuque bien arquée ; et la ligne de son corps ondulait tout entière sous la tunique de lin blanc. Aucun collier, aucun joyau ne gênait la souplesse de ses membres ; même elle avait supprimé de son ajustement, en signe de deuil, la large ceinture qu’elle portait d’ordinaire.
Le prêtre s’était arrêté en face d’elle, les bras croisés ; il la contemplait ; et, pour la première fois aussi pleinement, la prédominance du principe mauvais, cette malédiction latente épandue par Typhon au sein de l’Égypte et contre laquelle cette glorieuse nation luttait depuis sa genèse, lui parut manifestement incarnée dans la dernière descendante des Lagides. En elle, il sentait sourdre, ainsi qu’en un volcan tumultueux, la lave dont le jaillissement allait ébranler les civilisations anciennes. Et penser à cela donnait à son visage une expression prophétique et triste ; sa bouche se contractait dans l’impuissance d’exprimer la souffrance intime de son âme.
Cléopâtre, devant cette attitude douloureuse, contint l’exclamation de reproche qui lui était venue aux lèvres tout d’abord.
« Que me veux-tu, Paësi ? » demanda-t-elle simplement.
Il se recueillit un instant, comme en face de la barque sainte de Sérapis, avant de prononcer les formules rituelles ; puis, il étendit ses deux bras à la hauteur de son front :
« Au nom de tous les dieux de l’Égypte, je viens éclairer la reine sur les véritables intentions de César Octave. »
Malgré la solennité de ces paroles, Cléopâtre ne se troubla point :
« Comment les connaîtrais-tu toi-même, ces intentions ? dit-elle avec un léger haussement d’épaules. Tu ne prétends pas me faire croire qu’une communication occulte avec la divinité t’a révélé ces choses ? De telles supercheries sont bonnes uniquement pour impressionner le peuple et le maintenir dans une crainte salutaire de la religion. D’autre part, je ne suppose pas que César Octave t’ait choisi pour confident de ses desseins ?
— Le jeune Imperator est trop prudent pour cela, répliqua Paësi ; mais, si habitué qu’il soit à surveiller ses paroles, il oublie parfois que, derrière les sphinx de pierre dont les oreilles n’entendent point et dont les lèvres demeurent éternellement muettes, un être vivant peut se trouver caché.
— Voudrais-tu avouer que tu as abaissé la dignité de ton sacerdoce à faire un métier d’espion ?
— Précisément, Grande Reine ; il n’est pas de chose que je ne fasse pour la sauvegarde de l’Égypte. »
La reine s’étendit dans l’attitude d’une personne résignée à recevoir malgré elle une confidence pénible ; elle allongea sur ses genoux ses deux mains étroites.
« Eh bien ! parle, dit-elle. Qu’as-tu à m’apprendre ?
— Vous n’ignorez pas, Reine, que César Octave se fait accompagner presque toujours par le philosophe Aréus. Le maître et le disciple causent familièrement et plaisantent entre eux de la passion que le jeune César affecte de vous témoigner. Hier encore, je les ai entendus quand ils descendaient le dromos du temple d’Isis pour venir au palais. — « Je ne me serais pas cru si bon acteur, disait Octave et, si je n’étais pas le maître du monde, je pourrais tenir dignement un rôle dans les comédies de Plaute et de Térence » ; — et, comme le philosophe lui conseillait de ne pas s’engager trop avant dans ce jeu : — « Ne crains rien, mon bon Aréus ; j’attendrai au moins, avant de me laisser séduire par les attraits de la reine d’Égypte, de l’avoir montrée à mon peuple la chaîne au cou et les mains liées, suivant mon char de triomphe, depuis la voie d’Ostie jusqu’au Capitole. »
Cléopâtre se souleva menaçante :
« Tais-toi, prêtre, tais-toi. Tu mens ! Il y a un instant encore Octave était là, à mes pieds, m’offrant son amour et m’assurant le partage glorieux de l’Empire. Pourquoi m’aurait-il trompée ? Il m’aime comme Jules César et Marc Antoine m’ont aimée. — Ne suis-je pas assez belle pour cela ? »
Le prêtre, sans répondre à cette apostrophe véhémente, continua :
« Verra-t-on cette honte flageller l’Égypte en la personne de sa souveraine ? Déjà tout est préparé. J’ai entendu les ordres donnés par le jeune Imperator : l’illustre fille des Lagides, la descendante des Pharaons servira de risée à la tourbe romaine, et la fumée des outrages de tout un peuple flétrira celle vers qui n’avait cessé de monter l’encens des adorations. »
Il s’agenouilla sur un coussin devant elle, comme devant une divinité
« Crois-moi, lui dit-il très doucement, tout est préférable à une pareille ignominie ; et la mort est bonne à ceux qui savent l’appeler. Laisse à ton prêtre le soin de te dérober aux outrages de César. »
Comme elle ne répondait pas, les yeux perdus dans une pensée vague, il continua de lui parler avec ferveur, toujours agenouillé devant elle, inclinant la tête, — et la pointe de son haut bonnet recourbé venait par instants caresser les doigts allongés de Cléopâtre. Les moyens de mourir ne manquaient pas ; il en connaissait un grand nombre, depuis le poison qui tue sans laisser de traces, jusqu’au poignard enfoncé en plein cœur. Il les énumérait tous, la pressant de choisir, faisant valoir, comme un joaillier une pierre précieuse, les facettes de chacune de ces délivrances finales, dans lesquelles la vie se multipliait avant de s’éteindre. Certes il y avait une science de la mort, comme une science de la volupté ou de la douleur ; et lui, prêtre et hiérophante suprême, il en avait étudié tous les raffinements.
D’abord il insista pour un parfum très subtil, dont il possédait une amphore. Respirer une fois ce fluide suffisait pour que l’âme perdît la conscience d’elle-même et se retrouvât, libre de toute entrave, dans la demeure où elle subsistait éternellement.
Mais, comme la reine secouait la tête sans répondre, il crut qu’elle appréhendait de cette fin si prompte quelque flétrissure à son corps. Cléopâtre voulait sans doute s’endormir dans la splendeur entière de sa beauté, sans que rien de cette harmonie souveraine, qui l’avait rendue l’idole des foules, ne fût altéré après sa mort. Ce secret, Paësi le possédait également : quelques gouttes d’un suc injecté dans les veines au moyen d’une aiguille d’or assuraient à l’enveloppe charnelle l’immortalité de la jeunesse mieux que ne pourraient le faire toutes les manipulations des embaumeurs. C’est ainsi qu’avaient voulu s’éteindre Amyrthé et la reine Hatasou, de resplendissante mémoire.
Cléopâtre sourit.
« Si une reine Hatasou avait été Cléopâtre, ce n’est pas cette mort-là qu’elle aurait choisie, dit-elle. Cherche encore, mon prêtre ; trouve-moi quelque chose de plus merveilleux. »
Paësi haleta, une sueur mouilla ses tempes ; il traça secrètement sur sa poitrine, avec sa main droite, le signe par lequel il invoquait l’aide de la divinité.
Il reprit :
« Eh bien, oui, je sais mieux que cela ; je sais un breuvage, composé de chanvre mâle et de tiges de verveine cueillies au mois d’Epiphi, à l’heure où l’image flottante d’Isis monte sur les eaux du Nil. Sur ce philtre, j’ai prononcé des paroles ; j’ai invoqué Hâthor, la déesse de toute volupté, et Nou, la mère de toute génération. Celui qui en boira sentira tout son être se fondre dans une jouissance infinie, comme sous les étreintes d’un dieu créateur. »
Il avait dit cela, les yeux baissés, sans oser regarder Cléopâtre ; et, toujours dans le même trouble, il attendait sa réponse.
Mais elle, se dressant :
« Crois-tu donc que, si la reine d’Égypte consentait à mourir, elle redouterait d’assister à sa propre fin ? Peut-être, au contraire, est-ce dans la pleine possession de soi-même que l’on doit d’entrevoir à cet instant des éblouissances inconnues. Du moins Antoine le disait » — ajouta-t-elle à voix basse.
Le Grand Prêtre avait entendu.
« Je comprends ! s’écria-t-il. Tu veux mourir, comme est mort Antoine, d’un fer enfoncé dans ta poitrine. Ton sang comme le sien jaillira et le Delta saint en sera fécondé. Certes, c’est là une fin enviable et bien digne d’une souveraine. Mais comment faire ? Ceux qui t’approchent sont surveillés étroitement et dépouillés de leurs armes… »
Il réfléchit un instant.
« Je tromperai cette surveillance, ajouta-t-il. Demain, au coucher du soleil, l’arme libératrice te sera apportée. »
Mais Cléopâtre avait déjà repris son attitude impassible.
« C’est inutile, Paësi. Ne te mets pas plus longtemps en peine de moi. Je ne suis point pressée de descendre dans la vallée funèbre, d’où les lamentations des pleureuses[78] n’ont encore fait revenir personne. »
Le Grand Prêtre se releva et marcha lentement vers la porte : au milieu de la salle il se retourna, le bras étendu comme pour proférer des paroles de malédiction ; mais la personne de la reine était sacrée, identifiée à celle d’Isis : il n’osa pas commettre un pareil sacrilège et sortit en chancelant.
Alors Cléopâtre, sans quitter sa place, allongea la main et écarta une lourde draperie. Taïa apparut. Depuis la mort d’Antoine, la Libyenne se tenait sans cesse à côté de la reine, mêlée aux moindres incidents de sa vie.
« Tu as entendu ce qu’a dit le Grand Prêtre, Taïa ? » demanda Cléopâtre.
La jeune fille inclina la tête.
« Tu as entendu aussi ce que j’ai promis à César Octave ? Demain à pareille heure je pars avec lui pour Rome. La galère amirale qui doit nous emporter est déjà dans le port ; d’ici, tu peux l’apercevoir. »
Elle fit un geste dans la direction d’une plateforme qui s’étendait devant la chambre, surplombant la mer. Le bâtiment, à la poupe duquel les aigles romaines avaient été arborées, se balançait en effet dans le Port des Rois, en face de l’île d’Antirrhodos. Tout autour plusieurs trirèmes égyptiennes et les galères de César Octave flottaient, leurs voiles latines étendues sur les mâts, prêtes à accompagner le vaisseau royal.
« Donc, continua Cléopâtre, pour la première fois j’ai été jouée. Octave me trompait, quand en échange de mes baisers il me proposait la domination sur le monde. Pour moi, ni mes yeux ni mes lèvres n’ont menti et c’est sincèrement que je lui promettais mon amour, car les dieux me sont témoins que, quel qu’ait été le nombre de mes folies, j’ai toujours poursuivi la vérité essentielle dans le néant énigmatique de la chair. »
Debout devant elle, Taïa sanglotait. Elle l’attira contre sa poitrine, et tendrement :
« Ne pleure pas, petite Taïa. J’ai lutté jusqu’au bout. Maintenant c’est fini, vois-tu. Il faut que je meure. Mais rien de ce que m’a proposé Paësi ne convient à mon caprice. Je veux m’endormir dans l’étreinte et sous les baisers d’un amant nouveau. »
Taïa n’osa interroger sa maîtresse. Elle préférait d’ailleurs ne rien savoir, ne pas connaître le bien-aimé de l’heure suprême, en qui s’exhalerait le dernier souffle de la reine d’Égypte.
Cependant, comme Cléopâtre se taisait, elle balbutia :
« Que voulez-vous dire, Grande Reine ? »
Cléopâtre continua :
« Ses baisers ne doivent pas ressembler à ceux des hommes et ses caresses ont certainement quelque chose de plus excellent ; c’est lui qui calmera les brûlures de ma chair. Je l’aime d’un amour mystique et complet.
« Tu ne sais pas combien je l’aime, ajouta-t-elle en s’animant davantage. Toute petite, je rêvais de la fraîcheur de ses enlacements. Plus tard, chaque fois que j’allais au temple pour accomplir mes fonctions de Grande Prêtresse, je l’apercevais dans sa barque qui se dressait à demi et me fascinait de ses deux yeux clairs, — tellement que je tremblais parfois en prononçant les paroles du sacrifice. Le soir, quand au bras d’Antoine je passais au pied du Serapeum, je l’entendais siffler avec douceur comme pour m’appeler à lui, et je tressaillais involontairement. Il a été mêlé à toute ma vie. J’ai porté son image sur mon front comme l’emblème de ma splendeur. C’est par lui seul que je veux mourir. »
Cette fois, Taïa avait compris : c’était le grand urœus du Serapeum[79], gardien des traditions occultes de l’Égypte, qui allait être le libérateur de Cléopâtre. Elle respira ; son affection jalouse de la reine ne se sentait pas offensée par ce rival.
Mais pénétrer dans le temple n’était pas facile. Arracher l’urœus saint de sa barque et le transporter au palais l’était moins encore. Qui donc oserait s’exposer aux étreintes mortelles du serpent dieu ?
Cléopâtre devina son hésitation.
« N’as-tu pas, lui dit-elle, ton adorateur, le Chef des esclaves, qui possède l’art de toucher aux reptiles les plus dangereux sans en être mordu ?
— Oui, Grande Reine ; mais comment fera-t-il pour entrer dans le Serapeum ?
— Paësi se chargera de lui ouvrir les portes du sanctuaire. Va vite ; et que demain l’urœus saint soit au fond de la coupe de lotus que Kaïn m’apporte chaque jour. »
Taïa sortit pour rejoindre le Psylle ; il lui paraissait tout naturel que Kaïn, cette fois encore, exposât sa vie pour donner satisfaction à Cléopâtre. Aussi ne fut-elle pas étonnée de le trouver disposé à tout, lorsque bouleversée elle lui eut dit :
« Demain, à cette heure, la reine aura cessé d’exister ; et voilà, pour mourir, le service qu’elle attend de toi. »
Au fond, Kaïn était heureux de cette nouvelle ; il sentait bien que Cléopâtre avait toujours été l’obstacle à son bonheur et qu’à cause d’elle Taïa ne voulait pas lui donner sa vie. Jaloux, il l’était horriblement de la tendresse passionnée que la Libyenne témoignait à sa maîtresse. Cléopâtre disparue, Taïa allait lui appartenir absolument. Pourtant, devant la douleur profonde de la jeune fille, il n’osa pas témoigner sa joie ; et il se retenait de la prendre entre ses bras et de la baiser au visage, tandis qu’elle parlait tout près de lui à voix basse :
« La reine veut mourir de la piqûre d’un serpent ; demain avant le jour tu iras trouver le grand prêtre Paësi et tu lui diras de t’ouvrir le Serapeum sur l’ordre de Cléopâtre. Tu pénétreras jusqu’au troisième compartiment, au fond du sanctuaire ; là tu trouveras l’urœus sacré dans sa barque et tu le rapporteras ; car c’est celui-là, et non un autre, que la reine veut pour mourir. »
Kaïn resta silencieux. Toucher aux objets du culte, sentir peser sur son front le plafond du temple où des symboles terribles étaient appendus ; marcher sous le regard des cortèges peints en couleurs vives le long des murailles, ouvrir comme un voleur la barque sainte, — tout cela le remplissait d’une sorte de terreur inconsciente qui paralysait son courage. Il eût préféré s’enfoncer dans les plaines libyques, descendre dans les profondeurs des forêts et traverser les marécages des Syrtes pour trouver le dangereux reptile, que de pénétrer ainsi dans le temple du Serapeum.
Cependant Taïa le regardait anxieusement ; dans ses yeux il crut voir passer le bonheur si longtemps désiré, si près d’être atteint.
« J’irai », dit-il simplement.
Et Taïa alla veiller cette dernière nuit auprès de Cléopâtre.
CHAPITRE VII
Cléopâtre s’était préparée à la mort comme à une solennité glorieuse. Sous prétexte de voir une dernière fois avant de partir pour Rome les suivantes qu’elle aimait, elle avait fait demander à César de les laisser cette nuit auprès d’elle. Par leurs soins, son corps avait été oint de parfums exquis, ses cheveux avaient été saturés d’essence ; un cercle d’antimoine, habilement tracé autour de ses paupières, donnait à ses yeux un éclat particulier et les rendait pareils à deux pierres précieuses enchâssées dans le bronze ; une couche légère de vermillon avivait d’un rose ardent les contours de ses lèvres et la pointe de ses seins ; ses pieds admirables reluisaient sous une onction de vernis parfumé composé de benjoin et de nard.
Jamais pour les nuits fastueuses passées avec Jules César ou Marc-Antoine — les deux hommes qu’elle avait le plus aimés — elle ne s’était autant complu à se faire belle que pour les baisers de l’époux mystique dont elle attendait la venue.
Seule parmi les suivantes, Taïa était dans le secret de cette mort ; pourtant son agitation fiévreuse de la veille avait fait place à un grand calme ; et c’était avec une gravité souriante, augmentée d’une nuance de tendresse plus vive, qu’elle accomplissait ses fonctions auprès de sa divine maîtresse.
Cependant l’heure fixée par Octave pour le départ de la reine approchait, et Kaïn n’avait pas encore apporté la corbeille au fond de laquelle devait être caché l’urœus sacré. Cléopâtre s’impatientait comme dans l’attente d’un rendez-vous d’amour ; et tandis que la Libyenne lui nouait au cou la tunique filigranée d’or :
« Pourvu qu’il vienne, Taïa ! soupirait-elle.
— Ne craignez rien, Grande Reine, répondait Taïa ; Kaïn ne manquera pas à sa parole. »
À ce moment elles perçurent le bruit d’un cortège franchissant avec une cadence mesurée l’avenue du palais. C’était l’Imperator qui venait prendre possession de sa royale prisonnière. On entendit les soldats gravir lourdement les degrés de l’escalier de marbre ; à des intervalles réguliers ceux qui étaient devant s’arrêtaient pour laisser au groupe des licteurs qui escortaient Octave le temps d’avancer. Dans une salle contiguë à celle où était Cléopâtre les hommes se rangèrent ; et César parut, accompagné d’Aréus et des licteurs.
L’Imperator avait alors trente-trois ans, mais il avait conservé l’apparence frêle d’un éphèbe. Il entra, appuyé sur l’épaule du philosophe, et s’avança d’un pas tranquille, comme un maître dans cette demeure. Les hauts cothurnes dont il était chaussé dissimulaient la petitesse de sa taille ; une toge d’étoffe sombre et de forme presque semblable à la robe prétexte des adolescents l’enveloppait, laissant voir aux contours des manches l’indusium de nuance plus claire. Les yeux, d’une limpidité parfaite, brillaient sous l’auréole des cheveux bouclés ; les dents, petites et écartées comme celles d’un enfant, luisaient à travers les lèvres souriantes ; le nez seul, par ses arêtes fermement dessinées, mettait dans la grâce juvénile de ce visage — si soigneusement rasé qu’on y cherchait encore le duvet de la première jeunesse — une note volontaire et puissante.
À sa venue, Cléopâtre n’avait pas bougé du trône sur lequel elle était assise. Déjà indifférente à tout ce qui l’entourait, elle se recueillait pour la mort ; ainsi elle était si parfaitement belle, si pareille à une divinité, que pour la première fois Octave se troubla en l’abordant. Mais ce fut là un écart de sa volonté à peine sensible ; avec une aisance parfaite il s’inclina profondément devant la reine ; il affecta même de lui donner le titre qu’elle préférait :
« Nouvelle Isis, tout est prêt pour le départ ; vos serviteurs sont à vos ordres, et moi, le premier d’entre eux, j’attends votre bon plaisir. »
Il avait dit cela avec une sincérité si bien jouée qu’un instant la reine se demanda si tout ce que lui avait raconté Paësi n’était pas un nouveau subterfuge du Grand Prêtre. Sa beauté et les avances qu’elle avait faites à César auraient-elles réellement produit l’effet qu’elle en attendait ? Mais elle surprit un léger sourire sur les lèvres d’Aréus. Le philosophe, moins fort que le disciple, avait laissé deviner ses impressions.
Elle répondit :
« Prince, depuis la mort de Marc-Antoine, j’ai rejeté loin de moi tous mes joyaux ; mais aujourd’hui, pour suivre à Rome le maître du monde, je ne saurais être trop parée. Permettez q ue je me fasse revêtir de tous les insignes de ma royauté. »
En réalité sa préoccupation unique était de donner à Kaïn le temps d’arriver ; et, tandis que ses femmes s’attardaient à entourer ses bras et son cou d’anneaux précieux, elle songeait en elle-même au moyen d’échapper à la perfidie d’Octave, si le libérateur attendu lui faisait défaut. Taïa, sans parler, partageait son angoisse.
Enfin à la porte de la salle où la garde d’Octave s’était arrêtée, une discussion vive s’éleva, dominée par une voix tonnante ; et bientôt après Paësi, seul, entra. Le Grand Prêtre semblait bouleversé.
« Qu’y a-t-il ? demanda Octave.
— Les soldats refusent de laisser passer le Chef des esclaves de la reine qui lui apporte comme chaque jour les fleurs de lotus cueillies pour elle. »
Cléopâtre se retourna vers Octave :
« Le dernier moment de la reine d’Égypte dans son royaume sera-t-il attristé par un acte tyrannique de César ? — Je désire avoir les fleurs que cet esclave m’apporte. »
L’Imperator frappa dans ses mains.
« Qu’on laisse passer cet homme ! » dit-il au soldat qui se présenta.
Alors Kaïn entra à son tour dans la salle où était Cléopâtre. Il tenait sur ses bras une large patère d’or, qui disparaissait sous un amoncellement de lotus. Cette patère servait à recueillir le sang des victimes dans les sacrifices ; c’était tout ce qu’il avait trouvé parmi les objets du temple, pour placer l’urœus qu’il venait d’arracher à la barque sainte, où depuis des siècles il vivait, nourri de farine détrempée dans du miel[80]. Et les fleurs, disposées ainsi qu’elles l’étaient sur cette patère, avaient des grâces mystérieuses, comme celles dont le peuple ornait les divinités propices au jour des grandes panégyries d’Égypte. Elles semblaient elles-mêmes languir d’un mal secret, inclinant leurs corolles et vibrant de secousses intermittentes, tiraillées au bas de leur tige par des caresses invisibles.
Cléopâtre fit déposer la patère à côté d’elle, sur une console où son diadème était réuni à d’autres joyaux ; son regard rencontra Kaïn qui s’éloignait, et le remercia.
Ensuite elle appela ses femmes pour achever de la parer.
Octave et Aréus, suivis des licteurs, s’étaient mis à l’écart sur la plate-forme qui prolongeait la chambre. Octave regardait la mer ; il pensait qu’au delà de cette grande ligne qui ondulait à perte de vue devant lui, à droite et à gauche, puis au delà encore, des pays s’étendaient, qui tous subissaient sa domination ; et un orgueil immense faisait frissonner son corps frêle.
Cependant Cléopâtre lentement ôtait une à une les fleurs de la patère, dont ses femmes ornaient les tresses de ses cheveux et qu’elles entremêlaient à son diadème. Quand sa main rencontra les anneaux souples de l’urœus, la reine eut un mouvement de joie. Au contact de cette main, le serpent s’était dressé, subitement réveillé de son sommeil ; il gonflait sa tête, qui maintenant formait un disque lumineux ; les larges taches d’or dont son corps était parsemé étincelaient parmi ses écailles luisantes. Une fascination sortait de ses petits yeux couleur d’émeraude, sur lesquels Cléopâtre dardait ses yeux sombres ; et toute la luxure du monde antique était contenue dans ce double regard.
De ses deux mains, Cléopâtre le prit ; elle éleva le disque brillant que formait la tête du reptile à la hauteur de son front.
« Te voilà donc enfin ! c’est toi, toi que j’attendais ! » lui dit-elle à voix basse avec une accentuation passionnée.
Elle le noua autour de sa taille sous les plis flottants de sa tunique ; et à travers les mailles de l’étoffe les anneaux brillants de l’urœus transparaissaient comme les plaques d’une ceinture d’or. D’abord il ne bougea pas ; puis peu à peu sa gueule étroite se releva toute frémissante, et parcourut la poitrine lactée de Cléopâtre, cet abîme de voluptés infinies ; puis il s’y blottit tout d’une coulée, engourdi sans doute par la tiédeur de cette chair parfumée, bercé par le soulèvement de ces ondes vivantes.
Mais Cléopâtre voulait des amours plus aiguës, des baisers plus poignants. Ses doigts souples s’allongèrent sur les écailles luisantes de l’urœus. Alors le serpent sacré rouvrit les yeux ; son corps se raidit ; sa tête se gonfla comme tout à l’heure en un disque resplendissant ; il sembla hésiter un instant comme s’il cherchait à quelle place se poserait sa morsure ; puis il s’arrêta et parut subitement transfiguré, revêtu tout entier d’une poussière de soleil : il avait trouvé la rose vivante, la fleur éternelle où s’épanouissait la tentation des siècles ; et sur le bout du sein gauche — que, plus que l’autre, les battements du cœur soulevaient — profondément il enfonça son dard.
Cléopâtre réprima un cri ; ses yeux se voilèrent ; la fraîcheur, que les écailles glissantes du serpent avaient communiquée à sa chair, se changeait maintenant en une brûlure dévorante, quelque chose comme une traînée de feu qui courait dans toutes ses veines.
Rapidement Taïa, pour voiler l’urœus, avait jeté sur les épaules de la reine une écharpe de gaze lamée d’argent, tandis que Paësi, qu’une émotion religieuse avait jusque-là tenu immobile, cherchait à calmer l’agitation des suivantes.
Puis le Grand Prêtre alla rejoindre sur la terrasse César et Aréus ; il voulait les empêcher de troubler par leur présence les derniers moments de la reine d’Égypte.
Cependant Cléopâtre continuait à se débattre en des spasmes. Ses yeux mi-clos étaient fixés toujours sur les yeux ardents de l’urœus, qui la contemplait avec une curiosité lascive. Dans le paroxysme où elle était arrivée, elle lui adressait des paroles qu’il semblait comprendre ; elle serrait ses deux mains sur sa poitrine pour l’y attacher plus étroitement.
Taïa se pencha sur eux ; elle saisit la tête du serpent, qu’elle promena sur le haut de son bras nu, jusqu’à ce qu’elle eût senti à son tour l’acuité de la morsure ; alors elle se coucha aux pieds de Cléopâtre.
Maintenant l’urœus démesurément s’allongeait, excité par cette proie nouvelle, cherchant autour de lui d’autres victimes. Et, comme Aréus regardait du côté de la salle, il aperçut la tête fulgurante du serpent qui se dressait au-dessus de celle de Cléopâtre. D’un mouvement léger, le philosophe toucha le bras de César ; l’Imperator se retourna : tous deux comprirent.
Ils écartèrent Paësi, qui voulait leur barrer le passage, et s’approchèrent de Cléopâtre. Elle était déjà presque immobile, tendue dans une dernière contraction.
Octave blêmit ; le plus beau trophée de son triomphe allait lui échapper. Il jeta les yeux machinalement autour de la salle, pour chercher du secours. Tout à coup l’idée lui surgit que l’homme qui avait apporté le serpent devait connaître le moyen d’en guérir la morsure ; il appela une des suivantes.
« Cet homme qui est venu il y a un instant avec une corbeille de fleurs n’est-il pas un Psylle ? lui demanda-t-il.
— Oui, prince ! répondit la jeune fille.
— Qu’on aille le chercher et qu’on le ramène aussitôt ! » ordonna-t-il.
Un des licteurs se précipita et ne tarda pas à revenir avec Kaïn, qu’une inquiétude vague avait retenu dans la salle voisine.
Octave lui montra la reine.
« Sauve cette femme, lui dit-il d’une voix brève ; ta fortune et ta liberté seront assurées. »
Mais le Psylle venait d’apercevoir Taïa inanimée aux pieds de sa maîtresse ; il poussa un grand cri et se précipita sur elle. Ses lèvres cherchèrent la morsure du serpent ; et, quand elles l’eurent trouvée, elles s’y appliquèrent dans une succion désespérée.
Octave se pencha sur lui, menaçant :
« Fais ce que je t’ordonne, esclave ! » répétait-il en tremblant de colère.
Mais Kaïn n’entendait même pas, les lèvres frénétiquement appuyées sur la blessure de Taïa, perdu tout entier dans l’extase de ce semblant de possession.
À cet instant, Cléopâtre eut un dernier sursaut ; puis ses muscles se détendirent, sa tête s’abaissa sur sa poitrine, tandis qu’un sourire de béatitude entr’ouvrait ses lèvres. Elle était morte.
Alors Octave fut pris d’une grande colère.
« Qu’on tue cet homme ! ordonna-t-il en montrant Kaïn. Ici même, immédiatement ! Qu’on le tue ! »
Deux licteurs s’approchèrent avec leur glaive levé du Psylle, qui ne fit pas un mouvement ; ils le frappèrent — et le sang de Kaïn inonda Taïa, dont le visage pantelant d’amour était resté tourné vers le visage divin de Cléopâtre.
Naucratis était autrefois la seule ville de commerce qu’il y eût en Égypte. Si un marchand abordait à une autre bouche du Nil que la Canopique, il fallait qu’il jurât qu’il n’y était point entré de son plein gré, et qu’après avoir fait ce serment, il allât se rendre avec le même vaisseau à l’embouchure Canopique ; si les vents contraires s’y opposaient, il était obligé de transporter ses marchandises dans des barques autour du Delta jusqu’à ce qu’il arrivât à Naucratis. Telles étaient les prérogatives dont jouissait cette ville.
Cette ville dépendait du nome de Saïs ; c’était sous les rois égyptiens la seule ville où les commerçants étrangers pussent librement se rendre. Le pharaon Amasis permit ensuite aux Grecs de s’y établir. Naucratis était située sur le bord oriental de la branche Canopique et à l’occident de Saïs.
Le Kyphi est un parfum composé de seize ingrédients, de miel, de vin, de raisins secs, de souciet, de résine, de myrrhe, d’aspalathe, de seseli, de jonc odoriférant, d’asphalte, de feuilles de figuier, d’oseille, des deux espèces de genièvre, le grand et le petit, de cardamone et de roseau aromatique. Ces ingrédients ne sont pas mêlés au hasard, mais dans une proportion prescrite par les livres sacrés, qu’on lit à mesure à ceux qui sont chargés de composer ce parfum. Quant au nombre de seize, quoique ce soit un tétragone formé d’un autre, et que cette figure soit la seule qui, ayant ses côtés parfaitement égaux, ait aussi son périmètre égal à son aire, cette propriété contribue pour bien peu de chose dans l’effet salutaire des parfums. Comme la plupart de ces ingrédients ont une vertu aromatique, il s’en exhale une vapeur douce et active qui change la disposition de l’air, s’insinue dans le corps, donne à ses sens un mouvement convenable et l’invite agréablement au repos, lui procure des affections tranquilles, et, sans lui causer aucune ivresse, relâche et détend les impressions trop vives… Ces exhalaisons agissent puissamment sur l’imagination, le siège des songes, et, comme une glace bien polie, la rendent plus claire et plus pure ; elles ne sont pas moins efficaces que les sons de la lyre auxquels les pythagoriciens avaient coutume de s’endormir pour charmer, pour adoucir par ce moyen la partie raisonnable de l’âme, sujette au trouble des passions.
C’était la coutume, sur la côte d’Égypte où la navigation offrait tant d’écueils à cause des énormes roches qui formaient à fleur d’eau comme des îlots et dont la plupart étaient cachés sous les remous des vagues, de dédier des temples aux divinités protectrices des marins. En dehors de ce temple du Posidium consacré à Neptune, il existait, à l’extrémité du cap Zéphirium, entre Alexandrie et Canope, un autre sanctuaire consacré à Vénus Arsinoë. Les marins en danger priaient cette déesse, maîtresse divine de ces parages, pour l’apaisement des tempêtes et pour leur propre salut. À propos de ce sanctuaire le poète Posidippe écrivit deux épigrammes, dont l’une se trouve citée par Athénée ; l’autre se lit sur un papyrus publié par H. Weil.
Voici la première :
Rendez-vous propice et sur mer et sur terre ce temple de Vénus Arsinoë, l’épouse de Philadelphe, dont le navarque Callicrate a consacré la souveraineté sur le cap de Zéphyrium pour le salut des navires en danger.
Elle vous accordera un bon voyage, et, au milieu de la tempête, elle aplanira, si vous l’invoquez, la grande mer.
Voici la seconde :
Entre la falaise de Pharos et l’embouchure de Canope j’occupe, sur un cap qui s’avance au milieu des flots, de cette Lybie féconde en brebis la rive battue par les vents, qui se déploie et s’ouvre au zéphyr d’Italie.
En ce lieu Callicrate me consacra et me proclama sanctuaire de la reine Arsinoë Cypris.
Rendez hommage à Vénus la Zéphyrite qui exauce vos vœux ; venez, chastes filles des Hellènes, et vous aussi, travailleurs de la mer : car le navarque établit ce sanctuaire comme refuge entre toutes les vagues.
Philon l’Alexandrin et quelques autres écrivains anciens rapportent que la ville d’Alexandrie était divisée en cinq quartiers ou circonscriptions portant le nom des cinq premières lettres de l’alphabet grec.
Mahmoud-Bey, dans son Mémoire sur l’antique Alexandrie, reconstitue ainsi les cinq grands quartiers de la ville :
1o La portion orientale, que l’on voit séparée du reste de la ville par une prairie, devait à elle seule former un quartier traversé par la voie Canopique et contenant l’Hippodrome. C’était le quartier de l’Hippodrome, par l’état de son sol le plus vaste de tous ; mais il ne devait pas pour cela en être le plus peuplé ;
2o Le quartier du Bruchium a dû embrasser tout le terrain situé entre la mer et la rue Canopique, entre la place l’Heptastade et la place du Centre sur laquelle donnait le Gymnase ; c’était le quartier des palais ;
3o Le quartier du Soma. Tatius rapporte que le Soma donnait son nom au quartier de la ville où il se trouvait ;
4o Le quartier du Museum, le plus petit de tous, séparé du quartier du Soma par une rue transversale, occupait un plateau situé entre deux aqueducs ;
5o Le cinquième et le dernier quartier, le quartier de Rakotis, se trouvait presque isolé de la ville, par une petite gorge qu’on voyait entre le monticule du Sérapéum et les hauteurs qui forment le noyau du quartier du Museum. Il était limité des autres côtés par la mer et les murs d’enceinte de la ville. Le Sérapéum en occupait l’extrémité sud-est.
En ce qui concerne le perséa que Strabon (XVII, 316) mentionne parmi les arbres propres à l’Éthiopie, Diodore de Sicile (I, 34) nous apprend que le περσἐα fut introduit en Égypte par les Perses sous Cambyse.
M. G. Schweinfurth, naturaliste et voyageur d’Afrique bien connu, chargé par M. Maspéro, le savant égyptologue, de déterminer un grand nombre d’espèces de plantes trouvées dans les tombeaux de Deir-el-Báhary, en 1881, est parvenu à reconnaître les fruits et les feuilles du περσἐα des anciens auteurs dans ceux du mimusops, arbre originaire de l’Abyssinie et de l’Afrique tropicale. Ses fruits se trouvaient parmi les restes des repas funèbres et les feuilles étaient entrelacées avec les fleurs et le feuillage des couronnes et des guirlandes.
Les baies rouges et sucrées des mimusops, qui se trouvent en quantité dans les forêts du Soudan et de l’Abyssinie, s’accordent avec les paroles de Diodore qui vante la saveur du fruit du perséa.
Les anciens Égyptiens cultivaient cet arbre, lequel, à en juger par son emploi dans les rites funèbres, devait avoir une signification symbolique importante. Le perséa était l’arbre de vie de l’ancienne théosophie égyptienne : il était consacré à Hathôr. On voit souvent sur les monuments des dernières dynasties la déesse surgir de la cime du perséa pour verser de sa main l’eau de la vie sur le défunt, comme il est dit dans les inscriptions funéraires.
Ces canots en terre cuite sont mentionnés par Strabon (L. XVII). « On a soupçonné avec quelque vraisemblance qu’il s’agit ici de radeaux soutenus par des pots vides dont on se sert encore de nos jours en Égypte pour descendre le Nil. Toutefois, comme ces radeaux sont solides et presque insubmersibles, on conçoit difficilement pourquoi Strabon en aurait restreint l’usage aux canaux de l’intérieur du Delta, comme s’ils n’avaient pu servir que sur des eaux aussi tranquilles. D’ailleurs ces vers où Juvénal parle du même usage :
Parvula fictilibus solitum dare vela phaselis,
Et brevibus pictæ remis incumbere testæ.
semblent devoir s’entendre d’un petit canot fait en terre
cuite.
Les Égyptiens avaient peut-être trouvé le moyen de donner à la terre de poterie une dureté assez grande pour que de tels bateaux, nécessairement fort petits, pussent naviguer sur des canaux paisibles. La rareté du bois en Égypte en expliquerait l’origine : la même cause a pu faire imaginer les bateaux de papyrus, formés probablement de feuilles de papyrus séchées, enduites d’une substance grasse, et appliquées sur une carcasse d’osier ou de bois analogue.
Le nom de lotus a été donné par les auteurs anciens à des espèces de plantes très différentes. En Égypte il a été appliqué à trois plantes aquatiques de la famille des nymphéacées : 1o le lotus à fleurs blanches, nymphœa, ou lis du Nil à graines de pavots, décrit par Hérodote ; 2o le lotus à fleurs bleues, nymphœa cœrulea, dont la fleur est peinte dans les temples d’Égypte ; 3o le lotus à fleurs roses ou antinoïen (fève d’Égypte, lis rose du Nil d’Hérodote), nymphœa nelumbo. Le lotus de Libye, dont parle Homère, appartient à une famille toute différente de celle des lotus d’Égypte : c’est une espèce de nerprun.
Les deux premières espèces de lotus croissent encore aujourd’hui abondamment dans la basse Égypte ; c’est avec la farine de leurs graines que les anciens Égyptiens faisaient du pain.
« Le lieu appelé Soma (c’est-à-dire le corps) est une enceinte qui renferme les tombeaux des rois et celui d’Alexandre. Ptolémée, fils de Lagus, enleva le corps de ce prince à Perdiccas qui le transportait de Babylone et qui, par suite d’une ambition démesurée, s’était détourné de sa route pour s’emparer de l’Égypte ; mais ses soldats se révoltèrent contre lui et l’assassinèrent à coups de sarisse (longue pique), lorsque Ptolémée venant à sa rencontre l’eut bloqué dans une île déserte… Ptolémée transporta le corps d’Alexandre à Alexandrie et lui donna la sépulture à l’endroit où il est encore maintenant ; mais non pas dans le même cercueil. Celui qui existe à présent est en verre, au lieu que Ptolémée avait déposé le corps dans un cercueil en or qui fut enlevé par Ptolémée, fils de Coccès et surnommé Parisactus.
Le Soma, d’après Achille Tatius et Pseudo-Callisthène, était situé au milieu de la ville… il servait de point de démarcation entre la vieille bourgade égyptienne de Rakotis et la cité nouvelle, macédonienne et romaine, à l’est. Des inscriptions latines du IIe siècle de notre ère nous font connaître des personnages portant le titre de procurator Neaspoleos et mausolei Alexandri. (Remer, Inscr. alg., 3518.)
Dans ces inscriptions on voit que le Soma faisait partie de la cité nouvelle, du quartier des édifices et des palais, c’est-à-dire du Bruchium. Mais sous la domination byzantine, son emplacement était déjà effacé de la mémoire des hommes, et saint Jean Chrysostome dans une de ses homélies (XXVI, 12) en parle comme d’une chose parfaitement inconnue de son temps, c’est-à-dire vers la fin du ive siècle.
Cette même pensée de l’ancienne théosophie égyptienne se présente dans un tableau d’une chapelle funéraire des catacombes chrétiennes d’Alexandrie, peint sur la paroi de l’arcosolium : Jésus-Christ le Dieu, fils de Dieu, d’un âge juvénile et les pieds nus, marche comme Horus au milieu des serpents, des crocodiles, des lézards et d’autres reptiles de toute forme et de toute espèce… Deux figures, une de chaque côté, presque effacées et méconnaissables, et qui représentent peut-être des prophètes ou des apôtres, remplacent les divinités égyptiennes que l’on voit d’ordinaire à côté d’Horus. Deux anges peints sur les jambages intérieurs de l’arcosolium terminent le tableau à droite et à gauche. Sur les parois des deux côtés sont peints deux saints.
Au-dessus de Jésus-Christ jeune et imberbe plane, au ciel, Dieu le Père, l’Ancien des jours, nimbé d’une auréole triangulaire bleuâtre. L’inscription qu’on lit au pied du tableau n’est pas autre chose que le texte grec du 13e verset du psaume XC : « Tu marcheras sur l’aspic et le basilic et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon. » Un peu plus loin, au-dessus de la figure d’une femme (la Vierge ?), on lit : « l’espoir des chrétiens. »
Voilà donc, dans les catacombes chrétiennes d’Alexandrie, la reproduction de la figure d’Horus, fils d’Osiris et d’Isis, marchant sur les crocodiles et maîtrisant les serpents et le lion, sous la forme de Jésus-Christ, fils de Dieu, et de la Vierge, marchant au milieu de ces mêmes animaux malfaisants, faisant taire le lion et rompant le cou aux crocodiles.
Le Καισάρειον, ou Templum Cæsaris, commencé pendant les dernières années du règne de Cléopâtre pour servir de temple en l’honneur d’Antoine, puis resté inachevé à la suite des événements qui causèrent la mort de l’un et de l’autre, fut terminé sous le règne d’Auguste pour être consacré de son vivant à son culte. — D’après Dion Cassius (l. I, 15) c’est dans ce sanctuaire inachevé qu’Antyllus, fils aîné d’Antoine et de Cléopâtre, se réfugia après la catastrophe de sa mère et fut mis à mort par ordre d’Octave Auguste.
Voici ce qu’en dit Philon d’Alexandrie :
« Il n’y a sanctuaire au monde comme celui qu’on appelle Sebasteum, temple de César. Ce temple, très grand et très apparent et dont il n’existe pas un pareil ailleurs, s’élève majestueusement en face des ports les plus sûrs ; il est rempli d’ornements votifs consistant en tableaux, en statues et en objets d’argent et d’or ; il est entouré d’un enclos très large et pourvu de portiques, de bibliothèques, d’appartements d’hommes, de bois sacrés, de propylées, de lieux vastes et de salles à ciel ouvert, en un mot de tous les embellissements les plus somptueux. »
Les blocs des fondements du Sebasteum étaient, les uns en calcaire d’un grain homogène et blanc, et les autres en grès et en marbre. Travaillés diversement, ils conservaient des restes d’ornementation en style grec et en style romain, voire même en style ecclésiastique byzantin ; circonstance qui confirme la transformation du temple de César-Auguste en église chrétienne, sa destruction répétée et sa reconstruction sur le même plan avec les pierres du temple ruiné.
Strabon parle de ces bateaux sur lesquels les Égyptiens prenaient place pour leurs repas de fête. C’était à l’embouchure du canal de Schedia que les bateaux thalamèges étaient réunis ; les gouverneurs s’en servaient aussi pour remonter dans le pays haut.
La mosaïque de Palestrine offre trois barques de cette espèce. On voit que le θαλαμος qu’elles portent et d’où elles tiraient leur nom n’est autre chose qu’un pavillon en bois, sans doute doré, construit au milieu et divisé en plusieurs cellules selon la grandeur du bâtiment : ces barques égyptiennes sont donc à la lettre des yachts.
Canope est une ville située à 120 stades d’Alexandrie ; elle fut ainsi nommée de Canobus, pilote de Ménélas qui mourut dans cet endroit. On y voit un temple de Sérapis extrêmement révéré, où s’opèrent des cures nombreuses : les gens, même de la plus haute qualité, y ajoutent foi et viennent s’endormir dans l’enceinte du temple, ou bien d’autres s’endorment à leur place : il en est qui écrivent l’histoire de ces guérisons et d’autres qui recueillent les preuves de l’efficacité des oracles qu’on y rend. Mais rien n’égale surtout la foule de ceux qui, lors de la fête, se rendent d’Alexandrie à Canope par le canal. Jour et nuit, on voit une multitude de gens, hommes et femmes : les uns montés sur des barques, exécutent au son des instruments les danses les plus lascives ; les autres se répandent dans les auberges situées à Canope sur le bord de la mer et tout à fait propres à leurs orgies.
Boire les couronnes équivalait, chez les Égyptiens, à ce que les modernes appellent porter un toast, porter une santé. On effeuillait les fleurs de sa couronne dans une coupe remplie de vin et on la passait aux convives qui en buvaient quelques gouttes successivement, après avoir prononcé les vœux d’heureuse santé ou de bonheur.
Voulait-on saluer particulièrement un convive, on mettait du vin dans sa coupe, on la portait à ses lèvres, et, après en avoir goûté, on la lui envoyait pour qu’il l’achevât.
Chez les Romains, dans les repas d’apparat, les convives se couronnaient de fleurs. Dans le principe on n’en mettait qu’une sur la tête ; mais par la suite, on en passa une seconde au cou et sur la poitrine, pour mieux jouir de l’odeur des fleurs. Ch. Pascal, dans son traité De Coronis (p. 43), donne deux raisons de l’usage des couronnes : 1o Quod illæ primæ vincula erant, capul adstringebant ; — 2o quod nectebantur ex herbis et floribus in hoc lectis ut vini vint majori vi compescerent, certe aut refrigerabant, aut alia quapiam naturali facultate ebrietatis impetus reprimebant, tum capitis dolores mitigebant.
Les couronnes conviviales étaient composées de toutes sortes de fleurs, particulièrement de roses ; il y en avait aussi en or et enrichies de pierreries. C’étaient de jeunes esclaves qui distribuaient les couronnes au commencement du repas.
Athénée les mentionne également (l. XXIV).
Les coccina sont, d’après Strabon (l. XVII), des tissus faits en Égypte avec une certaine plante et semblables à ceux de jonc ou de palmier.
Il paraît d’ailleurs que Strabon n’a point su quelle était la plante dont on se servait pour faire ces tissus : on les faisait avec les feuilles d’une espèce de palmier appelé par Théophraste cucifera et par Pline, cuci. Delile (Description de l’Égypte, hist. nat.) reconnaît cet arbre dans le palmier-doum de la Thébaïde. Le doum est une espèce de palmier dont le tronc se divise en deux branches, et chaque branche en deux branches nouvelles : il porte des fruits assez gros que les Égyptiens d’autrefois estimaient beaucoup, ce semble. On ne trouve guère de palmier-doum avant Siout en remontant le Nil ; cet arbre tend à disparaître de l’Égypte propre.
L’auteur du Périple de la mer Érythrée parle également des tissus de coccina.
Tout le canton d’Antiphræ est peu fertile en vignobles ; aussi met-on dans les tonneaux plus d’eau de mer que de vin ; c’est ce qu’on appelle le vin libyque, qui forme, avec la bière, la boisson du peuple d’Alexandrie : on se moque beaucoup d’Antiphræ, à cause de son vin.
L’Égyptien est sobre d’ordinaire ; mais, quand il se donne « un jour heureux » il ne se prive pas de boire avec excès, et l’ivresse ne l’effraie point. La maison de bière, fréquentée ouvertement par les uns, en cachette par les autres, fait toujours d’excellentes affaires : si les cabaretiers ne sont pas toujours aussi estimés que les autres commerçants, du moins ils prospèrent.
La salle de réception de la maison de bière est garnie de nattes, de tabourets, de fauteuils, sur lesquels les habitués sont assis côte à côte, buvant fraternellement de la bière, du vin, de l’eau-de-vie de palme (shodou), des liqueurs cuites et parfumées, qui nous paraîtraient probablement détestables, mais pour lesquelles ils manifestent un goût particulier. Le vin est conservé dans de grandes amphores poissées, fermées avec un bouchon de bois ou d’argile enduit de limon peint en bleu, sur lequel on a frappé une empreinte au nom du propriétaire ou du pharaon régnant : une inscription à l’encre, tracée sur la panse, indique la provenance et la date exacte, l’an XXIII, vin d’importation, — l’an XIX, vin de Bouto, et ainsi de suite. Il y en a de tous les crus, vins blancs et vins rouges, vins de Maréotis, vin de Péluse, vins Étoile d’Horou, maître du ciel, originaires des oasis, vins de Syène, sans parler des vins d’Éthiopie, ni des vins dorés que les galères phéniciennes amènent de Syrie. La bière a été de tout temps la boisson favorite du peuple. On la fabrique avec un brassin d’orge, macéré dans l’eau et qu’on fait lever avec de la mie de pain fermentée. Au sortir du cuveau, elle est douce et plaisante au goût, mais se trouble aisément et tourne bientôt à l’aigre : la meilleure partie du vinaigre que l’on consomme en Égypte n’est pas du vinaigre de vin, mais du vinaigre de bière. On obvie à cet inconvénient, en y introduisant une infusion de lupin, qui lui communique une certaine amertume et le rend inaltérable. Bière douce, bière de fer, bière mousseuse, bière parfumée, bière aromatisée d’épices à froid ou à chaud, bière de millet épaisse et limoneuse, comme celle qu’on prépare en Nubie et chez les nègres du haut Nil, les cabarets ont en magasin autant de variétés de bière que de qualités de vins différents.
Les Égyptiens se servaient de vases ayant la forme d’un obélisque, et auxquels ils donnaient aussi le nom d’obélisques (tekhen). Des vases de cette espèce étaient destinés à l’encens ; d’autres contenaient des mets préparés (shaï).
Les textes montrent qu’on employait du veau et du gibier pour la confection des shaï. C’était un mets préparé, analogue à nos pâtés ; il y en avait de formes très variées, ronds, oblongs, carrés, coniques, etc.
Les anciens nommaient vases murrhins des vases dont ils faisaient un très grand cas et qu’ils tiraient de diverses contrées de l’Orient et particulièrement de l’Égypte. Ces vases étaient de deux sortes. Les uns se fabriquaient avec une matière naturelle, les autres avec une matière artificielle : ceux-ci venaient d’Égypte et étaient les moins estimés.
La matière murrhine avait l’aspect vitreux. Son éclat quoique brillant n’était pas celui des gemmes, mais on admirait la variété, la richesse et la vivacité de ses couleurs. C’est de la beauté de ces couleurs que les vases murrhins tiraient tout leur prix.
Les couleurs dominantes étaient le pourpre et le blanc disposés par bandes ondulées ou contournées de diverses manières, et presque toujours séparées par une troisième bande qui, participant des deux autres, imitait aux yeux la couleur de la flamme. On admirait aussi certains reflets irisés qui ajoutaient à la beauté de cette matière.
La transparence parfaite était un défaut plutôt qu’une qualité dans les vases murrhins.
Le Pacton était un petit bateau formé d’un assemblage de baguettes, ce qui lui donnait l’apparence d’une natte. Ce bateau était donc une espèce de radeau ou de train à fleur d’eau, de manière qu’on avait les pieds mouillés lorsqu’on se tenait debout. Pour avoir les pieds secs, il fallait s’asseoir sur de petites banquettes au bas desquelles était un marchepied.
Inscription de la stèle C. du Louvre.
« Une palme d’amour, la prêtresse d’Hathor Moutiritis, — une palme d’amour auprès du roi Menkoprirî ! C’est une palme auprès de tous les hommes, un amour auprès de toutes les femmes, — une jouvencelle dont on n’a jamais vu la pareille ! — Noire est sa chevelure plus que le noir de la nuit, plus que les baies de prunellier — rouge sa joue plus que les grains de jaspe rouge, plus que l’entame d’un régime de palmes ; ses seins sont bien plantés sur sa poitrine. »
Ceci est évidemment un morceau de poésie populaire appliqué à la princesse Moutiritis.
C’est à M. Maspéro (Études égyptiennes, t. I, fasc. III) que nous devons la connaissance de ces Chants d’amour égyptiens. — Voici d’autres fragments de Chansons récréatives. L’analogie de ces chants égyptiens avec la poésie hébraïque et en particulier le Cantique des Cantiques n’échappera à personne :
« Mon frère sort de sa maison ; il passe sans s’inquiéter de mon amour et mon cœur s’arrête en moi…
« La voix de la tourterelle résonne, elle dit : — Voici l’aube, où est mon chemin ?… — Toi, tu es l’oiseau, tu m’appelles : j’ai trouvé mon frère dans sa chambre à coucher et mon cœur se réjouit… et je ne m’éloignerai point, mais la main dans la main je me promènerai et je serai avec toi en toute place heureuse puisqu’il fait de moi la première des femmes et qu’il ne brise point mon cœur. Ah ! que je mette la tête à la porte du dehors ; mon frère vient à moi, mes yeux sont fixés sur la route, mon oreille écoute les bruits de pas sur la chaussée, car je me suis fait de l’amour de mon frère le bien unique…
« Mon cœur est si heureux de l’amour que tu as pour moi que la moitié du devant de ma coiffure tombe quand je viens en courant pour te chercher et mon chignon est défait. Pourtant je te jure que je pare ma chevelure et que je me tiens prête à toute heure… »
« Ô pourpiers, mon cœur est en suspens quand tu fais ce qu’on recherche et que je suis dans tes bras ! Je me suis adressée au kohol des yeux pour que j’apparaisse avec des yeux brillants et je me suis approchée de toi à la vue de ton amour. Ô maître de mon cœur, qu’elle est belle mon heure ! C’est une heure de l’éternité qui me vient quand je repose avec toi ! Mon cœur s’élève vers toi !
« Ô armoises de mon frère devant qui l’on se sent plus grand, je suis ta sœur favorite et je te suis comme le champ où j’ai fait pousser des fleurs et toutes espèces de plantes odorantes… c’est une boisson enivrante pour moi qu’entendre ta voix.
« Ô marjolaines de mon frère, j’ai pris tes guirlandes quand tu viens à moi ivre, et que tu te couches dans ton alcôve ; j’entre… »
Le procédé de composition est curieux à noter. Chaque couplet commence par un nom de plante qui fait allitération avec le verbe suivant. Il est probable que le chant tout entier est composé sur le modèle des trois couplets subsistants.
La place qu’occupe cette cérémonie du Maneros au milieu du banquet parait étrange tout d’abord et l’on pourrait s’étonner à bon droit de la rencontrer à la suite des chansons d’amour, si nous ne savions par d’autres exemples que les Égyptiens se plaisent aux contrastes violents. Hérodote raconte qu’au milieu des dîners d’apparat, vers le temps où la gaîté des convives était la plus bruyante, on faisait circuler une petite momie en bois, déposée dans un cercueil. L’esclave qui la présentait disait à chacun : « Regarde ceci, puis bois et hâte-toi de jouir, car tu seras tel après la mort. »
On sait que cette coutume raffinée passa à Rome au temps de l’Empire avec d’autres usages égyptiens : « Tandis que nous buvions, un esclave apporta un squelette d’argent dont les articulations et les vertèbres pouvaient se mouvoir en tous sens. Il le jeta sur la table une ou deux fois et cette poupée articulée en prit diverses poses, sur quoi Trimalchion ajouta : « Hélas ! hélas ! misérables que nous sommes ! comme toute notre pauvre humanité n’est rien ! nous serons tous ainsi après que nous aura enlevé l’Orcus ! C’est pourquoi vivons bien tant que nous aurons licence d’exister. » (Petron. Satyricon, C. 35.)
Paroles d’un joueur de harpe, traduction de Maspéro, d’après le papyrus Harris ; voici le texte intégral :
« L’immobilité du chef (Sérapis) c’est elle en vérité qui est le destin excellent. Les corps se produisent pour passer depuis le temps de Dieu et les générations jeunes viennent à leur place. Râ se lève au matin, Toum se couche au pays de Manou ; les mâles engendrent, les femelles conçoivent, tous les nez goûtent l’air au matin de leur naissance jusqu’au temps où ils vont à leur place. Fais un heureux jour, ô prêtre ! Qu’il y ait toujours des parfums et des essences pour ton nez. Des guirlandes de lotus pour les épaules, et pour la gorge de ta sœur chérie qui est assise auprès de toi. Qu’il y ait du chant et de la musique devant toi et négligeant tous les maux ne songe plus qu’aux plaisirs jusqu’à ce qu’il vienne ce jour où il faut aborder à la terre qui aime le silence, sans que cesse de battre le cœur du fils qui vous aime. Fais un heureux jour, Nofrihotou, prêtre sage aux mains pures ! J’ai entendu tout ce qui arrive aux ancêtres : leurs murs sont détruits, leur place n’est plus, ils sont comme qui n’aurait jamais été depuis le temps de Dieu. Tes murs à toi sont fermés, tu as planté des arbres sur la rive de ton bassin, ton âme reste sous eux et boit de leur eau. Suis ton cœur résolument aussi longtemps que tu es sur terre. Donne du pain à qui n’a pas de domaine afin de gagner une bonne renommée à tout jamais. Regarde les dieux qui ont été auparavant ; leur viande d’offrande est déchiquetée comme par une panthère, on salit de poussière leurs pains d’offrande… leurs formes ne sont plus debout dans le temple de Râ et leurs gens mendient. Ramit vient en sa saison, le destin compte ses jours. Fais un heureux jour, prêtre aux mains pures, Nofrihotou !…
« Le vivant n’a que faire des greniers de l’Égypte ; ses magasins à lui sont riches de toutes bonnes choses.
« Que Nofrihotou prie ceux qui ont été avant lui. Certes ils ont fait les heures heureuses et ils ont réservé la tristesse qui abrège les instants pour le jour où les cœurs sont détruits. Fais comme eux et rappelle-toi ce jour où l’on te conduira au pays qui mêle les hommes. Il n’y a point dans la terre d’hommes qui y ait mené ses biens avec lui, absolument, on ne peut pas en revenir.
« Leur enclos est détruit, leurs places ne sont plus comme s’ils n’avaient jamais été. Personne n’y vient qui célèbre leurs qualités… Tu es en bonne santé, ton cœur se révoltera contre les honneurs funèbres ; suis ton cœur tant que tu existes. Mets du parfum sur ta tête, pare-toi de fin lin, oins-toi de ce qu’il y a de plus merveilleux parmi les essences de dieu ! Fais plus encore que tu n’as fait jusqu’à présent ! Ne laisse pas aller ton cœur à l’ennui, suis ton désir et ton bonheur aussi longtemps que tu seras sur terre ; n’use pas ton cœur en chagrins jusqu’à ce que vienne pour toi ce jour où l’on supplie sans que le dieu dont le cœur ne bat plus écoute ceux qui supplient. Les lamentations ne font point que l’homme au tombeau est réjoui. Fais un jour heureux, et ne sois pas inactif en ceci. Certes, homme n’y a qui puisse emporter ses biens avec lui. Certes, il n’y a personne qui soit allé et qui soit revenu. »
Un canal construit à force de bras s’étend de la bouche Pélusiaque jusqu’au golfe Arabique et à la mer Rouge. Necos, fils de Psammétichus, commença à faire construire ce canal ; Darius, roi de Perse, le continua, mais il le laissa inachevé, car il avait appris que s’il perçait le détroit il ferait inonder toute l’Égypte. On lui avait en effet démontré que le niveau de la mer Rouge est plus élevé que le sol d’Égypte[81]. Plus tard Ptolémée II y mit la dernière main et fit construire une écluse dans l’endroit le plus favorable ; on l’ouvre quand on veut traverser le canal et on la ferme ensuite exactement. Ce canal est appelé Fleuve de Ptolémée. À son embouchure est située la ville d’Arsinoé.
Il existe un canal qui va se décharger dans la mer Érythrée ou golfe Arabique, près de la ville d’Arsinoé, appelée par quelques-uns Cléopatris. Il traverse les lacs dits Amers, dont les eaux étaient jadis amères avant que l’ouverture du canal eût changé la nature de ces eaux en y mêlant celles du fleuve. Ce canal fut creusé d’abord par Sésostris, avant l’époque de la guerre de Troie : selon d’autres, il fut entrepris par le fils de Psammitique, qui n’eut que le temps de le commencer parce que ce prince mourut peu après. Darius reprit le travail et l’abandonna lorsqu’il était déjà sur le point de l’achever. Le motif de cet abandon fut qu’il ajouta foi à l’opinion que la mer Érythrée est plus haute que l’Égypte, et qu’ainsi elle submergerait le pays si l’on venait à couper entièrement l’isthme de séparation. Néanmoins les rois Ptolémées coupèrent cet isthme et fermèrent le canal à l’entrée, de manière qu’on pût à volonté et sans obstacle passer dans la mer extérieure et rentrer dans le canal[82].
Tanis fut la capitale d’un des nomes de la basse Égypte ; sa juridiction s’étendait, selon toute apparence, sur les lieux situés dans le territoire compris entre les branches Pélusiaque et Tanitique du Nil, et le lac de Tennis appelé aujourd’hui Manzalèh.
L’époque de la fondation de Tanis est inconnue, comme l’origine de presque toutes les grandes villes de la haute et de la basse Égypte. Cependant l’on peut avancer en toute assurance que les villes de l’Égypte inférieure sont bien moins anciennes que celles de la moyenne Égypte et surtout que les dix villes de la Thébaïde propre… On peut donc dire que Tanis est beaucoup moins ancienne qu’Héliopolis, Memphis, Hermopolis-Magna, et que les autres villes de l’Égypte supérieure.
Un passage de l’Ancien Testament indique une époque de la fondation de Tanis. Les espions envoyés par Moïse pour reconnaître la Terre Sainte « arrivèrent à Hébron où demeuraient Akhiman, Sisaï et Thoulmaï, descendants d’Hénak ; car Hébron fut fondée sept ans avant Tanis, ville d’Égypte[83]. » Tanis ayant été bâtie sept ans après Hébron, il résulte de ce passage que cette ville est une des plus anciennes de l’Égypte inférieure.
Tanis était située sur la rive orientale de la branche tanitique et à quelque distance de son embouchure. Son étendue fut très considérable, et son enceinte renfermait de très grands monuments. Les ruines occupent encore un vaste espace de terrain ; on y voit sept obélisques de granit en partie brisés, des fragments de monolithes, de débris d’un colosse, et des arrachements d’édifices égyptiens d’une dimension très remarquable.
Quelques chronologistes modernes ont placé à Tanis le siège d’une dynastie égyptienne… Ce qui a beaucoup contribué à faire soutenir cette opinion, c’est la tradition qui veut que Moïse, enfant, ait été exposé dans son berceau sur la branche tanitique du fleuve ; et, comme c’est la fille du pharaon qui le sauva, il semble hors de doute que le pharaon et la princesse sa fille demeuraient à Tanis.
Le nom de Tanis nous a été transmis par les Grecs et ce n’est qu’une légère altération du véritable nom égyptien. Dans le texte hébreu des livres saints cette ville porte le nom de Tzan ou Ssan.
Pendant le laps de temps écoulé entre les Pharaons et l’empereur Titus, Tanis, ayant éprouvé une de ces révolutions si communes aux grandes villes, tomba en décadence, déclina insensiblement, et devint enfin une place de peu d’importance. Memphis, bien plus considérable que Tanis, n’a-t-elle point entièrement disparu ? Thèbes, cette immense et antique capitale, était du temps des Romains et est encore de nos jours remplacée par trois misérables villages. Mais à Thèbes, des monuments impérissables, comme sept obélisques dans les débris informes de Tanis, prouvent encore d’une manière incontestable l’ancienne importance de ces deux villes célèbres.
M. Maspéro attribue aux rois Pasteurs l’introduction des premiers chevaux en Égypte ; voici ce que dit à ce sujet le savant égyptologue :
« Les Pasteurs introduisirent le cheval en Égypte et peut-être durent-ils à l’effroi qu’il inspira dans les premières rencontres la rapidité incroyable de leurs succès. Il est en général vigoureux et de taille élevée. Il a le front bombé, ce qui donne à sa tête un profil légèrement busqué et comme moutonné. Le cou est effilé, la croupe mince et un peu étroite, la cuisse maigre, la jambe sèche, la queue longue et bien fournie. Il ne diffère en rien des chevaux qu’on voit chez les peuples asiatiques, mais ce n’est pas sans peine qu’on l’empêche de s’affaiblir et de dégénérer. Le climat l’énerve, le temps de l’inondation l’éprouve ; il faut toujours recruter l’espèce d’étalons et de juments qu’on achète ou qu’on prend en Syrie. Thèbes, Memphis, Hermopolis, la plupart des grandes cités de la moyenne Égypte possèdent des haras. »
La position d’Hérôopolis a été longtemps un sujet de discussion entre les géographes modernes. Les anciens l’indiquaient vaguement comme placée vers l’extrémité du golfe Arabique, d’où quelques-uns de nos géographes ont conclu qu’elle exista à l’extrémité même de la mer Rouge, dans le voisinage de Suez ; d’autres qu’elle se trouvait entre le Nil et la mer Rouge dans le voisinage de Suez ; d’autres qu’elle se trouvait entre le Nil et la mer Rouge, près des Lacs Amers. Cette dernière opinion, qui a été celle de d’Anville, se rapproche plus qu’aucune autre de la vérité.
Les ruines actuelles de cette ville offrent des preuves non équivoques de son existence du temps des anciens Égyptiens. Aouaris porta dans l’antique théologie égyptienne le nom de Typhonia ou ville de Typhon, parce qu’elle avait été la demeure et la place d’armes des Arabes pasteurs, ennemis de l’Égypte, que les mythes égyptiens regardaient alors comme fils de Typhon. Ce fut dans Aouaris que le pharaon Thoutmosis, chef de la dix-huitième race des rois égyptiens, massacra un grand nombre de ces Arabes et parvint enfin à les chasser tous de l’Égypte. Or les Égyptiens, selon Étienne, disaient emblématiquement que Typhon avait été foudroyé dans la ville d’Hérôopolis et que son sang y avait été répandu ; ce passage d’Étienne de Byzance prouve donc à notre avis l’identité d’Aouaris ou Typhonia et d’Hérôopolis
Les traditions se partagent sur le lieu de naissance de Pythagore. Selon les uns il était Samien, selon les autres Tyrrhénien, selon d’autres encore Syrien ou Tyrien. — L’opinion la plus accréditée le fait naître à Samos, qu’il habita certainement d’après le témoignage d’Hérodote.
On donne à Pythagore beaucoup de maîtres. Mais une source d’instruction plus féconde que l’enseignement des écoles, ce furent, selon les traditions, les voyages de Pythagore. Selon les uns c’est de l’Orient, de l’Égypte particulièrement, que Pythagore a rapporté en Grèce les principes de sa philosophie, par exemple sa philosophie mathématique et sa doctrine de la transmigration des âmes.
Cependant, à mesure que des doctrines nouvelles vinrent effacer les anciennes doctrines, le pythagorisme perdit peu à peu de son originalité et de sa pureté. Il ne dut quelques restes de puissance qu’en trompant le vulgaire superstitieux par les mensonges d’un art chimérique, la magie, que Pythagore, disait-on, avait appris lui-même à Babylone. En métaphysique, le pythagorisme revêtit les formes et adopta les idées du stoïcisme. Le dieu de Pythagore, dit Cicéron, était l’âme des choses tendue et répandue dans toute la nature ; c’est la même doctrine qui se retrouve dans les lettres attribuées à Apollonius de Tyane, le plus célèbre des nouveaux pythagoriciens. Mais à cette époque le pythagorisme se confondit, ainsi que le nouveau platonisme, dans la doctrine éclectique des Alexandrins.
L’école d’Alexandrie prit naissance vers le temps de Pertinax et de Sévère et se continua jusqu’aux dernières années du règne de Justinien, embrassant ainsi une période de plus de quatre siècles. Mais longtemps avant cette époque, et presque depuis sa fondation, Alexandrie avait été le centre d’un enseignement philosophique. Voici ce que dit Jules Simon sur les origines de cette école :
« … Alexandre en passant jette une ville sur les bords du Nil ; à sa mort, ce fut la proie des Lagides et le centre et la capitale d’un grand empire. Il n’y avait pour les Grecs que la Grèce et la Barbarie ; les Ptolémées se sentaient en exil, si la langue, les arts, les mœurs de la patrie n’étaient transplantés dans leurs États. Bien avant les temps historiques, l’Égypte avait fourni des colonies à la Grèce ; après tant de transformations glorieuses, la civilisation grecque se retrouva face à face avec les mœurs immuables de l’Égypte. Elle fleurit et se développa dans Alexandrie, à côté des croyances et des mœurs du peuple vaincu, qu’elle ne parvint pas à entamer.
« Le Musée, fondé par Démétrius avec les trésors de Ptolémée Soter, la Bibliothèque bientôt encombrée de richesses et qui déborda dans le Sérapéum où un second dépôt s’établit, les faveurs des rois qui, souvent, partagèrent les travaux du Musée, plus tard celles des empereurs romains jaloux d’encourager une compagnie d’historiens et de poètes, la magnificence d’Auguste, l’institution du Claudium par ce lettré imbécile qui eût tenu sa place parmi les grammairiens du Musée et qui ne fit que déshonorer la pourpre impériale, le concours de tant d’hommes supérieurs : les Zénodote, les Ératosthène, les Apollonius, les Callimaque, toute cette splendeur, toute cette gloire attira l’attention du monde sans triompher de l’indifférence et du mépris des Égyptiens. Les Grecs, au contraire, essentiellement intelligents, sans préjugés, sans superstitions, ne purent habiter si longtemps le temple même de Sérapis, sans contracter quelque secrète affinité avec ce vieux peuple ; leur littérature était celle d’une nation épuisée qui remplace la verve par l’érudition ; l’étude enthousiaste et persévérante du passé les disposait, en dépit de l’esprit mobile et léger de la Grèce, à respecter les traditions, à chercher la stabilité. Par une pensée profondément politique, les Lagides avaient voulu que le chef du Musée fût toujours un prêtre. Avec cela nulle intolérance : toutes les religions et tous les peuples avaient accès dans le Musée, les Juifs seuls en étaient exclus.
« Sur cette extrême frontière du monde civilisé, au milieu de ce concours inouï jusqu’alors, voués au culte des glorieux souvenirs de leur peuple, en même temps qu’initiés à d’autres croyances et à d’autres admirations, les Grecs, sans devenir Égyptiens ou Barbares, apprenaient à concilier les traditions en apparence les plus opposées, à comprendre, à accepter l’esprit des religions et des institutions qu’ils avaient sous leurs yeux.
« Le premier caractère de la philosophie des Alexandrins, le plus frappant et aussi le plus extérieur, c’est l’éclectisme. Ce fut, en effet, la prétention avouée de cette école, de réunir en un vaste corps de doctrines la religion et la philosophie, la Grèce et la mythologie orientale.
« S’ils sont à la fois Grecs et Barbares, philosophes et prêtres, la Grèce et la philosophie dominent et surtout la philosophie platonicienne. Puisqu’ils voulaient allier toutes les doctrines, et pourtant se rattacher principalement à l’esprit d’une certaine école, l’Académie seule leur convenait : c’est dans l’histoire philosophique de la Grèce, l’école qui prête le plus à l’enthousiasme. Et dans le platonisme, que prennent-ils ? Le côté le plus vague et le plus mystérieux, ce que l’on pourrait appeler le platonisme pythagorique. Les symboles pythagoriciens leur servaient en quelque sorte de lien entre la dialectique et l’inspiration, entre la cosmogonie du Timée et celle des Mages. »
Le phare d’Alexandrie était situé à l’extrémité nord-est de l’île de Parhos. Les témoignages de Strabon et de Jules César ne laissent à ce sujet aucune incertitude.
Pour les dimensions de l’édifice, nous ne savons rien de positif ; voici cependant ce qu’en dit Makrizi (édition de Boulak, t. II, p. 157) :
« La hauteur du phare, actuellement, est à peu près de deux cent trente coudées. Anciennement elle était d’environ quatre cents coudées ; le temps, les tremblements de terre et les pluies l’ont détérioré ; sa construction a trois formes : il est carré jusqu’à un peu moins que la moitié et un peu plus que le tiers ; là, la construction est en pierre blanche ; ce qui fait cent dix coudées à peu près. Ensuite la figure en devient octogone, et il est alors construit de pierres et de plâtre dans l’étendue de 60 et quelques coudées. Un balcon l’entoure pour pouvoir se promener. Enfin, la partie supérieure en est ronde. (Masoudi.) Un écrivain dit l’avoir mesuré et avoir trouvé 233 coudées pour la hauteur du phare ; il est de trois étages : le premier est un carré haut de 121 coudées ½ ; le second est octogone, de 81 ½ ; le troisième étage est rond, il a 31 coudées ½. Eben-Joubère cite, dans son mémoire de voyage, que le phare d’Alexandrie paraît à plus de 70 milles ; qu’il a mesuré lui-même un des quatre côtés de l’édifice, en l’année 578 de l’hégire. »
Flavius Josèphe dit à propos de la tour de Phazaël à Jérusalem, ce qui suit[84] :
« Sa forme ressemblait à celle du phare d’Alexandrie où un feu toujours allumé sert de fanal aux mariniers pour les empêcher de donner à travers les roches qui pourraient leur faire faire naufrage… La clarté du feu du phare s’étend jusqu’à trois cent stades[85]. »
On voit par ces passages des témoins oculaires que la largeur de la tour du phare devait avoir de 40 à 50 coudées, ou d’un plèthre et demi en mesures grecques. La hauteur, d’après l’estimation de Masoudi et de Flavius Josèphe, devait être de 100 à 120 mètres, et la distance de laquelle on voyait le feu du phare de 40 kilomètres environ.
J’ajoute que ce feu du phare moderne se voit à 34 kilomètres dans la mer, et que ce phare n’a qu’environ 65 mètres de hauteur, au-dessus du niveau des eaux.
L’ouverture de la bouche du dieu comportait des rites assez compliqués. Il s’agissait d’animer la statue, afin que le dieu, descendu de son nuage, en vînt à prononcer les paroles prophétiques. On accomplissait à cet effet le même mystère divin qu’Horus avait célébré autour de la momie d’Osiris.
Le Serapeum d’Alexandrie était bâti sur un tertre fait de main d’homme dans le quartier nommé Rakotis. On y montait par plus de cent degrés. Ce tertre était soutenu par des voûtes. La plate-forme était bordée de divers édifices destinés au logement et aux différents usages des gardiens du temple et d’un grand nombre de ministres qui faisaient profession de chasteté. On y voyait aussi une célèbre bibliothèque qui subsista jusqu’à l’invasion des Sarrasins. Après avoir traversé cette enceinte, on trouvait un vaste portique qui régnait autour d’une place carrée, au milieu de laquelle s’élevait le bâtiment du temple soutenu par des colonnes du marbre le plus précieux. Il était spacieux et magnifique. Les murailles étaient revêtues en dedans de lames d’or, d’argent et de cuivre, placées les unes sur les autres de sorte que le métal le plus riche était au-dessus. Ammien-Marcellin ne trouvait dans l’univers que le temple de Jupiter Capitolin qui pût égaler en splendeur et en majesté ce superbe édifice. Ce qui le rendait encore plus célèbre était les merveilles qui s’y opéraient. La statue de Sérapis étant placée à l’occident, on avait pratiqué dans le mur oriental une ouverture étroite et imperceptible par laquelle le soleil, dans un certain jour de l’année, dardait à une certaine heure ses rayons sur la bouche du simulacre. Le peuple, à la vue du rayon qui éclatait sur les lèvres de la statue, ne doutait pas que ce ne fût un baiser du dieu du jour ; il applaudissait à grands cris à l’embrassement des deux divinités. Après quelques moments, les prêtres ne manquaient pas de refermer l’ouverture et d’enlever l’image du soleil.
On racontait encore des prodiges d’une pierre d’aimant placée à la voûte du temple et dont les prêtres seuls avaient connaissance. (Parallèle des religions, t. II, p. 921.)
Les prêtres égyptiens que les auteurs grecs appellent communément thérapeutes étaient de différentes classes selon leur emploi. Il y avait les prophètes, les stolsites, les hiérogrammates, les hiéroscopes, les hiéropsaltes, les sphagistes. Tous ceux-là formaient un ordre supérieur, distingué en autant de classes, dont la dernière comprenait les sphagistes et la première les prophètes.
Les pastophores, les mélanéphores, les néocores et les zacores composaient un second ordre. Chaque collège ou chaque compagnie de ministres attachés à un temple était composé de ces différentes classes du premier et du second ordre et avait un président qui était comme archiprêtre ou le grand prêtre. Mais il ne parut pas qu’il y eût un souverain pontife qui fût supérieur de tous les collèges. Hérodote dit expressément que les femmes n’avaient aucune part au sacerdoce…. Cependant les monuments font foi qu’elles exerçaient certaines fonctions subalternes et qu’elles eurent une grande part aux différents mystères du culte.
À entendre Porphyre, les prêtres égyptiens menaient une vie retirée ; on ne les voyait que dans les solennités ; hors de là ils étaient inaccessibles. Occupés uniquement de l’étude des choses divines, ils ne prenaient aucun soin des choses humaines. Ils faisaient paraître beaucoup de gravité dans leur démarche, d’austérité dans leur air, de modestie dans tout leur extérieur. Leur vie était frugale ; ils gardaient la chasteté ; leurs jeûnes étaient fréquents. Il y avait quantité de choses dont ils s’abstenaient rigoureusement ; jamais ils ne mangeaient le cœur des animaux ; ils n’usaient jamais de fèves ; ils ne mangeaient que des productions du pays. Ils ne se servaient point du sel de mer. Ils avaient renoncé à toutes sortes de provisions ; la viande de cochon ne leur était pas permise. Le vin était interdit aux prêtres d’Héliopolis ; les autres n’en usaient qu’avec modération. Ils exerçaient des rigueurs sur eux-mêmes, comme de se mettre des colliers de fer, de s’attacher des cercles aux mains.
Ils avaient des lustrations réglées, soit ordinaires, soit extraordinaires. Les premières consistaient à se laver deux fois le jour, deux fois la nuit, avec de l’eau froide très pure. Les prêtres d’un rang supérieur se lavaient avec plus de soin que les autres. L’hysope était, à leur avis, très propre aux purifications. Les lustrations extraordinaires étaient celles qui précédaient certaines fêtes. Elles duraient plusieurs jours pendant lesquels les prêtres n’avaient aucune communication les uns avec les autres. (Parallèle des religions, t. II, p. 891.)
Ce n’étaient pas seulement les figures représentées sur les murs des temples qui étaient peintes ainsi selon des couleurs déterminées. L’usage de colorier la sculpture et l’architecture a été général chez tous les peuples sans exception : nous retrouvons les traces de cette habitude à travers toutes les époques, jusqu’au temps de la renaissance de l’art, au xve siècle. Notre goût se révolte sans doute à l’idée que l’Apollon du Belvédère, par exemple, était destiné à être peint en bleu, la Vénus de Médicis en jaune, et le Gladiateur en rouge[86] ; toutefois ces faits n’en sont pas moins positifs et le goût des anciens aurait peut-être été aussi blessé de voir une statue en marbre blanc se détacher sur un fond en couleur. Il faut d’ailleurs bien se rappeler que, chez eux, ces statues n’étaient pas comme chez nous un simple objet de curiosité, ou bien un sujet d’étude académique ; ils ne les exposaient pas dans des musées pour en admirer les formes et les proportions ; et c’est, je crois, dans cette différence d’envisager le but d’une chose, que nous devons chercher les causes de la répugnance que nous éprouvons en nous figurant les merveilles du ciseau antique cachées sous des couches de couleur. (Gau, Antiquités de la Nubie, p. 17.)
Les deux sœurs jumelles ou didymes qui faisaient partie des hiérodules du temple avaient pour fonctions principales d’offrir à Sérapis des libations funèbres. C’étaient des choéphores ; les libations jouaient un grand rôle dans le culte de Sérapis.
Le papyrus du Louvre no 22, qui est la minute d’un placet adressé au roi Ptolémée Philometor, commence par ces mots :
« Au roi Ptolémée et à la reine Cléopâtre, sa sœur, dieux Philométors, salut :
« Tayes et Thaous, sœurs jumelles, exerçant des fonctions religieuses dans le grand temple de Sérapis… du nombre de celles qui font des libations à Sérapis pour vous et pour vos enfants… »
Diodore de Sicile reconnaît que, suivant une opinion contemporaine, Sérapis n’est autre qu’Osiris (liv. I, ch. xxv) ; plus tard, Martianus Capella, dans son hymne au soleil, appelle le grand astre le dieu aux mille noms, Mithra, Amoun, Adonis, et proclame qu’il est adoré sur les rives du Nil et de Memphis sous les noms d’Osiris et de Sérapis. Les légendes contemporaines des Lagides confirment ce rapprochement : les Égyptiens avaient identifié ou plutôt confondu les deux personnes divines ; dans certaines villes, Osiris avait gardé son nom, tandis que dans d’autres Sérapis n’était pas seulement un Osiris au tombeau, un soleil automnal et d’hiver, un génie funèbre, un roi de l’Amenti, mais un dieu puissant, le soleil dans sa force, le dominateur des mondes, le bienfaiteur et le sauveur de la terre.
Les mêmes cérémonies et les mêmes paroles rituelles s’appliquaient donc aux deux divinités ; voici in extenso la reproduction de l’hymne à Osiris, traduite par Chabas :
« Salut à toi, Osiris, seigneur de la longueur des temps, roi du Dieu, aux noms multipliés, aux saintes transformations, aux formes mystérieuses dans les temples, être auguste résidant dans Tattou, chef renfermé dans Sokhem, maître des invocations dans Oer-ti, jouissant de la félicité dans Hon, à qui il appartient de commander dans le lieu de la double justice, âme mystérieuse du seigneur de la sphère, le saint du Mur Blanc, l’âme du soleil, son corps lui-même : l’auteur des invocations dans la région de l’arbre Ner ; dont l’âme est faite de la vigilance, le seigneur de la grande demeure, le plus grand des êtres et le seigneur de la longueur des temps dans Abydos. Le chemin de sa demeure est dans le To-sar ; il est stable de nom dans la bouche des humains. C’est un dieu de la terre, un Atoum qui parmi les dieux comble les êtres de félicité ; un esprit bienfaisant dans le lieu des esprits.
« De lui l’Abyssus tire ses eaux, de lui provient le vent, et l’air respirable est dans ses narines, pour sa satisfaction et pour les goûts de son cœur ; il aère l’espace qui goûte la félicité parce que les astres lui obéissent au haut des cieux.
« Il ouvre la grande porte, c’est le maître des invocations dans le ciel méridional et des adorations dans le ciel du nord ; les constellations qui se meuvent sont sous le lieu de sa face, ce sont ses demeures. À lui est présentée l’offrande par l’ordre de Seb ; les dieux l’adorent avec respect dans le firmament, les divins chefs avec révérence, tous en supplications. Ceux qui sont parmi les augustes l’aperçoivent dans son autorité et la terre entière lui rend gloire lorsque sa sainteté combat ; c’est un Sahou illustre parmi les Sahous, grand de dignités, permanent d’empire. C’est le maître excellent des dieux ; beau et aimable, celui qui le voit lui accorde le respect dans toutes les contrées ; tous ceux qui ont été exaucés par lui exaltent son nom au premier rang ; il est maître de commander au ciel et sur la terre ; des acclamations multipliées lui sont adressées dans la fête d’Ouk, les acclamations des deux mondes unanimes.
« Il est l’aîné, le premier de ses frères, le chef des dieux ; c’est lui qui maintient la justice dans les deux mondes et qui lance le fils sur le siège de son père ; il est la louange de son père Seb, l’amour de sa mère Nou ; très vaillant, il renverse l’impur ; invincible, il massacre son ennemi ; il impose sa crainte à celui qu’il hait. Il emporte les boulevards du méchant ; intrépide, ses pieds sont vigilants ; c’est le fils de Seb, régissant les deux mon des ; il (Seb) a vu ses vertus et lui a commandé de conduire les nations par la main vers une prospérité multiple. Il a fait ce monde de sa main et ses eaux, son atmosphère, sa végétation, tous ses troupeaux, tous ses volatiles, tous ses poissons, tous ses reptiles et ses quadrupèdes. La terre rend justice au fils de Nou et le monde se délecte encore lorsqu’il monte sur le siège de son père. Semblable au soleil, il brille à l’horizon, il donne la clarté à la face des ténèbres, il irradie la lumière par sa double plume, il inonde le monde comme le soleil du haut de l’empyrée ; — son diamètre prédomine au haut des cieux et s’associe aux étoiles ; et c’est le guide de tous les dieux.
« Il est bon de volonté et de parole ; il est la louange des grands dieux et l’amour des petits dieux.
« Sa sœur a pris soin de lui en dissipant ses ennemis par une triple déroute. Elle émet la voix dans l’éclat de sa bouche ; sage de langue, sa parole ne faillit pas. C’est Isis l’illustre, la vengeresse de son frère ; elle l’a cherché sans se reposer, elle a fait le tour de ce monde en se lamentant ; elle ne s’est point arrêtée sans l’avoir trouvé ; elle a fait de la lumière avec ses plumes ; elle a fait du vent avec ses ailes ; elle a fait les invocations de l’enterrement de son frère, elle a emporté les principes du dieu au cœur tranquille ; elle a extrait son essence ; elle a fait un enfant ; elle a allaité le nourrisson par un bras. On ne sait pas où cela se passa.
« Son bras est devenu fort dans la grande demeure de Seb ; les dieux sont dans la joie lorsqu’arrive Osiris, fils d’Horus, intrépide, justifié fils d’Isis, fils d’Osiris. Les divins chefs s’unissent à lui ; les dieux reconnaissent le seigneur universel lui-même. Les seigneurs de la justice qui y sont réunis pour disposer de l’iniquité sont ravis de rendre gloire dans la grande demeure de Seb au seigneur de la justice. Le règne de sa justice lui appartient. Horus a trouvé sa justification ; il s’avance couronné du bandeau royal, la couronne de la région supérieure est fixée sur sa tête. Par lui est jugé le monde dans ce qu’il contient ; le ciel et la terre sont sous le lieu de sa face. Il commande aux humains, aux purs, à la race des habitants de l’Égypte et aux nations étrangères. Dieu des semences, il donne toute la végétation et le kiphi précieux. L’universalité des hommes est dans le ravissement, les entrailles dans les délices, les cœurs dans la joie, à cause du Seigneur miséricordieux. Chacun adore ses bontés ; doux est son amour en nous ; sa tendresse environne les cœurs ; grand est son amour dans toutes les entrailles.
« On rend justice au fils d’Isis : son ennemi tombe dans sa fureur ; le violent est à son heure suprême : le fils d’Isis, vengeance de son père, s’approche de lui.
« Sanctifiants et bienfaisants sont ses noms ; la vénération trouve sa place ; le respect est immuable pour ses lois ; la voie est ouverte, les sentiers sont ouverts, les deux mondes sont dans le contentement ; le mal fuit ; la terre se féconde paisiblement sous son seigneur. La justice est affermie par son seigneur qui menace l’iniquité.
« Délicieux est ton cœur, ô Ounnefer, fils d’Isis ! Il a pris la couronne de la région supérieure ; le titre de son père lui est reconnu dans la grande demeure de Seb. C’est Phra quand il parle, Thoth dans ses écrits. Les divins chefs sont satisfaits.
« Ce que ton père Seb a ordonné par toi, que cela soit fait selon sa parole. »
C’est par cette espèce d’Ainsi soit-il égyptien que se termine l’hymne.
Au début de l’hymne d’Amen-em-ha, Osiris est salué des titres de Seigneur de la longueur du temps et de roi des dieux, qui lui sont communs avec le Soleil et avec Amon ; puis il est nommé le dieu aux noms multipliés, aux saintes transformations, aux formes mystérieuses dans le temple.
Le chapitre 142 du Rituel énumère 100 dénominations sous lesquelles Osiris reçoit l’adoration et de plus douze formules générales :
Osiris dans toutes ses demeures ; dans sa demeure de la région du Midi ; dans sa demeure de la région du Nord ; dans le lieu où il aime à se trouver ; dans toutes ses pratiques ; dans toutes ses créations ; dans tous ses noms ; dans tout ce qui le concerne ; avec toutes ses couronnes ; sous tous ses ajustements ; dans toutes ses stations.
La connaissance de ces formes multiples devait correspondre à un degré élevé de l’initiation à la science sacrée. (Chabas, Revue archéologique, t. XIV.)
Les statues prophétiques des dieux restent ordinairement cachées dans les profondeurs du sanctuaire. Quand on les en tire aux fêtes solennelles pour les promener en pompe autour du temple ce n’est qu’après leur en avoir humblement demandé l’autorisation.
Les divinités égyptiennes règlent leur manière de vivre sur la nature du pays qu’elles habitent. Leur arche est toujours une barque (bari), mais une barque relevée aux deux bouts et construite assez solidement pour pouvoir naviguer.
Notre texte se compose d’une série d’invocations et d’évocations précédées d’un préambule et suivies d’une clause finale. Le préambule nous renseigne sur la nature et l’objet de ces formules et indique qu’elles ont été récitées par Nephtis et Isis pour rendre la vie à leur frère Osiris.
La partie mythologique des lamentations touche principalement au double rôle divin et terrestre d’Osiris.
Invocations précieuses faites par les deux sœurs divines, dans la maison d’Osiris Khent-Ament, dieu grand, seigneur d’Abydos, au mois de choiak le vingt-cinquième jour. On fait de même dans toutes les demeures d’Osiris et dans toutes ses fêtes, et est avantageux à son âme, affermit son corps, répand la joie dans son être, donne le souffle aux narines, à l’aridité du gosier ; cela satisfait le cœur d’Isis, ainsi que celui de Nephtis ; cela place Horus sur le trône de son père ; cela donne la vie, la stabilité, la tranquillité à l’Osiris-Teutrut, fille de Takhaa, qu’on surnomme Persaïs justifiée. Il est profitable de faire ceci conformément aux divines paroles.
Le 23 choiak est indiqué comme le jour où Isis et Nephtis prononçaient à Pa-Osiris les chants de résurrection qui devaient rendre la vie à Osiris. C’était un jour très heureux ; Isis et Nephtis étaient parties et avaient accompagné Horus dans les panégyries en acclamant joyeusement Osiris dans Abydos. Commencée dans les larmes, la cérémonie finissait dans la joie.
Évocation d’Isis. Elle dit :
Viens à ta demeure ! viens à ta demeure, ô dieu An ! Viens à ta demeure ! tes ennemis ne sont plus. Ô excellent souverain, viens à ta demeure ! regarde-moi, je suis ta sœur qui t’aime ; ne t’arrête pas loin de moi, ô bel adolescent ; viens à ta demeure, vite, vite. Ne m’aperçois-tu pas ? Mon cœur est dans l’amertume à cause de toi ; mes yeux te cherchent, je te cherche pour te voir. Tarderai-je à te voir, tarderai-je à te voir, ô excellent souverain, tarderai-je à te voir ? Te voir c’est le bonheur, te voir c’est le bonheur ! Ô dieu An, te voir c’est le bonheur. Viens à celle qui t’aime, viens à celle qui t’aime, ô Ounnefer justifié. Viens à ta sœur, viens à ta femme ! Viens à ta femme, ô Ourthet ! Viens à ton épouse, je suis ta sœur par ta mère. Ne te sépare pas de moi. Les dieux et les hommes tournent leurs faces vers toi pour te pleurer tous à la fois, depuis qu’ils me voient poussant des plaintes jusqu’au haut du ciel, et tu n’entends pas ma voix. Je suis ta sœur qui t’aime sur la terre. Personne autre ne t’a aimé plus que moi [ta] sœur, [ta] sœur.
Cette belle évocation se réfère à la recherche que fit Isis de son frère Osiris.
La formule : Viens à ta demeure se répète très souvent dans notre texte. On a cru y reconnaître l’origine du mot Maneros, qu’Hérodote et Plutarque nous ont conservé comme ayant été le nom d’une chanson des anciens Égyptiens.
Le titre du dieu An, sous lequel Osiris est invoqué, se rencontre dans le Rituel. Voici un passage du Rituel qui peut être comparé au texte : « Que je voyage de même et ne m’arrête pas, semblable à ta sainteté, ô soleil ! »
(À cette section commence la 4e scène du tableau qui s’étend jusqu’à la 4e page. Elle représente, suivant les légendes : Osiris Khent-Ament, dieu grand seigneur d’Abydos, recevant l’offrande funéraire de l’Osiris Teut-rut, fille de Persaïs, justifiée, et de sa sœur l’Osiris Ta-rut, fille de Persaïs justifiée. Les deux sœurs sont précédées d’Isis la Grande, la Déesse mère et suivie de Nephtis, la fille divine.)
Évocation de Nephtis. Elle dit :
Ô excellent souverain, viens à ta demeure. Réjouis-toi, tous tes ennemis sont anéantis. Tes deux sœurs sont auprès de toi en sauvegarde de ton lit funèbre. Tu vois nos tendres sollicitudes, parle-nous, ô chef suprême, notre seigneur. Détruis toutes les angoisses qui sont dans notre cœur. Tes compagnons qui sont les dieux et les hommes, lorsqu’ils te voient s’écrient : À nous ta face, ô chef suprême, notre seigneur ; la vie pour nous c’est de voir ta face ; que ta face ne se détourne pas de nous ; la joie de notre cœur est de te contempler, à souverain ; notre cœur est heureux de te voir.
Je suis Nephtis, ta sœur qui t’aime. Ton ennemi a succombé ; il n’existe plus. Je suis avec toi en sauvegarde de tes membres à perpétuité et éternellement.
Ce paragraphe rappelle la scène bien connue de la momie étendue sur son lit funèbre, auprès duquel se tiennent dans l’attitude du deuil Isis et Nephtis, veillant sur le défunt et se lamentant.
(Cette section exprime la joie d’Isis qui reçoit Osiris sous sa forme lunaire. Ce n’est plus une évocation, c’est une invocation ou une sorte de litanie.)
Invocation d’Isis. Elle dit :
Ô dieu An, tu brilles pour nous au ciel, chaque jour. Nous ne cessons plus de voir tes rayons. Thoth est pour toi en sauvegarde ; il élève ton âme dans la barque de Ma-at, en ce nom qui est le tien, de dieu Lune. Je suis venue pour te contempler ; tes beautés sont au milieu de l’œil sacré, en ce nom qui est le tien de seigneur de la Panégyrie du sixième jour. Tes compagnons sont auprès de toi ; ils ne se séparent plus de toi. Tu t’es emparé du ciel par la grandeur des terreurs que tu inspires, en ce nom qui est le tien de seigneur de la Panégyrie du quinzième jour. Tu nous illumines comme Ra, chaque jour ; tu brilles sur nous comme Atoum. Les dieux et les hommes vivent parce qu’ils te voient. Tu rayonnes sur nous, tu éclaires les deux mondes. Le double horizon sans cesse te livre passage. Les dieux et les hommes tournent leurs faces vers toi ; rien n’est nuisible pour eux quand tu brilles. Tu navigues en haut du ciel et ton ennemi n’existe plus.
Je suis ta sauvegarde chaque jour. Toi qui viens à nous en fils aîné de l’éternité, nous ne cessons plus de te contempler. Ton émanation rehausse l’éclat des étoiles de Sahou au ciel en brillant et en disparaissant chaque jour.
Je suis la divine Sothis derrière lui ; je ne me sépare pas de lui.
Tout ce paragraphe se rapporte à la manifestation lunaire d’Osiris. Le dieu navigue dans l’arche sainte sous la forme de la lune ; il parcourt l’espace accompagné de son escorte céleste, sa splendeur jette de l’éclat sur le divin Sahou, nom que les Égyptiens ont donné à la constellation d’Orion, dans laquelle était placée l’âme d’Osiris. Il paraît au ciel chaque jour suivi de la divine Sothis, l’étoile de Sirius, dans laquelle l’âme d’Isis était censée résider. Son émanation, son influence humide donnent la vie aux êtres animés et même aux dieux. Puis Osiris semble être assimilé au Nil. Son âme c’est l’eau qui abreuve ; son être tout entier c’est la nourriture de l’univers. Ce dernier passage est très remarquable. Outre ces allusions cosmogoniques, le texte mentionne quelques dates astronomiques.
Invocation de Nephtis. Elle dit :
Ô excellent souverain ! viens à ta demeure. Ounnefer justifié, viens à Tattou. Ô taureau fécondateur, viens à Anap. Bien-aimé de l’Adytum, viens à Kha ; viens à Tattou, lieu que préfère ton âme. Les esprits de tes pères te secondent ; ton fils, l’adolescent Horus, fils de tes deux sœurs, est devant toi. Au lever de la lumière, je suis ta sauvegarde chaque jour. Je ne me sépare jamais de toi.
Ô dieu An, viens à Saïs ! Saïs est ton nom. Viens à Aper, tu verras ta mère Neith. Bel enfant, ne t’arrête pas loin d’elle. Viens à ses mamelles pour t’y abreuver. Frère excellent, ne t’arrête pas loin d’elle ! Ô fils, viens à Saïs !
Osiris-Tarut, surnommée Naï-Naï, fille de Persaïs, justifiée, viens à Aper, ta ville. Ta demeure est Tab. Tu y reposes auprès de ta mère divine pour toujours. Elle protège tes membres, elle disperse tes ennemis, elle est la sauvegarde de tes membres à jamais.
Ô excellent souverain, viens à ta demeure. Seigneur de Saïs, viens à Saïs.
Cette invocation s’adresse encore à Osiris dont elle fait ressortir la manifestation solaire. Le dieu revenant à la vie est assimilé au soleil diurne et sa mère devient alors Neith, la déesse mère et la mère du soleil, par excellence.
Le texte fait allusion à la formation nouvelle de l’Osiris terrestre par Isis dont parle l’hymne à Osiris, en ces termes : Elle a emporté les débris de son corps et lui a donné la mamelle en secret. On ne connaît pas le lieu où cela se fit.
Les localités désignées étaient situées dans la basse Égypte et n’étaient pas identifiées, excepté Saïs.
Invocation d’Isis. Elle dit :
Viens à ta demeure, excellent souverain ! viens à ta demeure, viens voir ton fils Horus, chef suprême des dieux et des hommes. Il a pris possession des villes et des campagnes par la grandeur du respect qu’il inspire. Le ciel et la terre sont sous sa crainte, les barbares sous sa terreur. Tes compagnons, qui sont les dieux et les hommes, sont devenus siens dans les deux hémisphères pour accomplir tes cérémonies mystérieuses.
Tes deux sœurs sont auprès de toi offrant des libations à ta personne ; ton fils Horus accomplit pour toi l’oblation funéraire de pains, de breuvages, de bœufs et d’oies. Thoth institue la panégyrie en t’appelant dans ses louanges. Les enfants d’Horus sont la sauvegarde de tes membres, glorifiant ton âme chaque jour. Ton fil Horus salue ton nom dans ta demeure mystérieuse, en te présentant les choses consacrées à ta personne.
Ici finissent les invocations. Cette section est un chant de triomphe, Osiris, renaissant sous la forme d’Horus vainqueur ou du soleil levant, est devenu le maître du monde entier qui le révère, les dieux et les hommes acceptent et pratiquent son culte qui est institué partout. L’assimilation d’Osiris avec le soleil est certainement la plus frappante et la plus importante. Ce n’était qu’une forme du culte du soleil, qui paraît avoir été le culte fondamental et national des anciens habitants de la vallée du Nil.
Lorsque cela est récité le lieu (où l’on est) est grandement saint. Que ce ne soit vu ni entendu par personne, excepté par le prêtre supérieur et l’assistant. Deux femmes, belles de leurs membres, ayant été amenées, on les fait asseoir par terre à la porte principale de l’Ousekh ; on fait inscrire sur leurs épaules les noms d’Isis et de Nephtis. On place des vases de cristal (?) pleins d’eau dans leur main droite, des pains faits à Memphis dans leur main gauche. Qu’elles soient attentives aux choses faites à la troisième heure du jour et pareillement à la huitième heure du jour. Ne cesse pas de réciter ce livre à l’heure de la cérémonie.
C’est fini.
Ce paragraphe commence par une curieuse formule mystique qu’on rencontre aussi dans le Rituel : « Qu’on ne fasse voir ce chapitre à personne, excepté au roi et aux prêtres supérieurs. »
Les détails liturgiques qui suivent sont infiniment curieux et se trouvent illustrés par les vignettes qui montrent deux femmes assises, tenant dans leurs mains les objets mentionnés dans le texte ; on y remarque les noms d’Isis et de Nephtis écrits auprès des figures.
Certaines cérémonies analogues se pratiquaient chez les peuples syriens à l’occasion des fêtes de deuil pour Adonis, dont le culte s’était introduit chez les Juifs restés à Jérusalem. Ezéchiel en fait mention (8,14).
On a cru reconnaître une origine commune aux légendes d’Osiris et d’Adonis, mais d’après les travaux de Movers il a fallu renoncer à cette hypothèse.
(Les lamentations d’Isis et de Nephtis, d’après un monument hiératique, par de Horrach.)
La contrée où est situé le temple est entourée d’un désert aride, sablonneux et tout à fait inhospitalier. Cette contrée, qui a environ 50 stades de longueur et de largeur, est arrosé par beaucoup de belles sources d’eau et couverte de bois, surtout d’arbres fruitiers. On respire un air de printemps dans ce lieu privilégié ; le séjour y est sain, bien qu’il n’y ait autour que les sables brûlants du désert. La région consacrée au dieu est limitée au midi et au couchant par les Éthiopiens, au nord par les Libyens nomades et par la tribu des Nasamones, qui s’étend dans l’intérieur du pays. Les Amoniens habitent des villages et, au milieu de leur pays, s’élève une citadelle, environnée d’une triple enceinte. La première enceinte entoure le palais des anciens rois ; la seconde contient les habitations des femmes, des enfants, des parents de la maison royale, le sanctuaire du dieu et la fontaine sacrée où l’on purifie les offrandes qu’on offre au dieu ; la troisième enceinte renferme le logement des satellites. En dehors de la citadelle, et à quelque distance de là, se trouve un autre temple d’Amon, ombragé d’arbres nombreux et élevés. Près de ce temple existe une fontaine à laquelle un phénomène qui s’y passe a fait donner le nom de fontaine du Soleil. Son eau varie singulièrement de température aux différentes heures de la journée : au point du jour elle est tiède, et devient froide à mesure que le jour s’avance, jusqu’à midi où elle atteint son maximum de froid ; la température s’élève à partir de midi, jusqu’à ce qu’elle ait atteint son maximum à minuit ; à partir de ce moment, la chaleur va en diminuant, jusqu’à ce qu’elle arrive au degré qu’elle avait au lever du soleil. La statue du dieu est couverte d’émeraudes et d’autres ornements, et elle rend ses oracles d’une manière toute particulière. Elle est portée dans une nacelle dorée, sur les épaules de quatre-vingts prêtres ; ceux-ci la portent machinalement là où le dieu leur fait signe d’aller ; cette procession est suivie d’une foule de femmes et déjeunes filles, chantant, pendant toute la route, des hymnes et des cantiques selon les rites anciens.
Les Nasamones, peuple nombreux, habitent tout l’intérieur de la côte cyrénaïque et s’étendent même jusqu’aux autels des Philènes. En été, ils laissent leurs troupeaux au bord de la mer et montent à un certain canton nommé Augila, pour y recueillir les fruits des palmiers. Ces arbres y croissent en abondance, y viennent très beaux et donnent tous des fruits. Les Nasamones vont à la chasse des sauterelles, les font sécher au soleil, et, les ayant réduites en poudre, ils mêlent cette poudre avec le lait qu’ils boivent.
Ils sont sauvages dans leur manière de vivre et dans leurs vêtements : ils ne s’habillent que de peaux de chèvres. Leurs chefs ne possèdent pas de villes ; mais ils ont des tours assises sur les eaux… Ils font annuellement prêter à leurs sujets serment de fidélité. Ils soignent comme leurs compagnons d’armes ceux qui leur sont soumis ; mais ils condamnent à la mort ceux qui ne reconnaissent pas leur domination et les poursuivent comme leurs ennemis. Leurs armes sont appropriées à leur pays et à leurs habitudes.
Après avoir traversé l’Hippodrome, dit Strabon (trad., t. V, p. 344), on trouve à 30 stades d’Alexandrie, sur le bord de la mer, Nicopolis, aussi peuplé qu’une ville. César Auguste embellit ce lieu, parce que ce fut là qu’il vainquit ceux qui s’avançaient avec Antoine contre lui, et c’est pour cette raison qu’il le nomma Nicopolis, la ville de la victoire, au lieu de Juliopolis, comme ce village s’appelait avant et même après, jusqu’au temps de Vespasien.
Un coup d’œil jeté sur la carte de l’ancienne Alexandrie et de ses environs nous persuade que la position stratégique choisie par Auguste, et où il a battu Antoine, ne pouvait être que ces hauteurs situées à une distance de 20 à 30 stades de la ville au nord-est. On voit là, en effet, entre autres ruines, les restes d’un petit temple récemment découvert au bord de la mer, à 100 mètres environ au delà du château fort appelé le château des Césars, lequel se trouve à 3 kilomètres environ de la porte Canopique. Si Josèphe estimait à 20 stades la distance de Nicopolis à la ville, tandis que Strabon en compte 30, c’est que, probablement, le faubourg se serait accru du côté de la ville, dans les quarante ou cinquante années qui séparent ces deux écrivains l’un de l’autre.
Les derniers vestiges des ruines du temple de Cérès et de Proserpine à Éleusis, aujourd’hui appelé Khâdra, avec les colonnes d’Antoine et de Cléopâtre figurant Osiris et Isis, ont en grande partie disparu.
Ce temple se trouvait à 180 mètres environ au nord-ouest du point situé, sur la prolongation de la rue Canopique, à 700 mètres hors de la porte. Il avait quatre plèthres environ de largeur sur un stade de longueur ; on y voit encore aujourd’hui une quantité de socles à leur place primitive, de chapiteaux, de tronçons, de colonnes brisées et de fûts entiers ; le tout en granit rouge. Mais ce qui attire l’attention des visiteurs, ce sont les deux statues colossales dont l’une (celle de Cléopâtre) est brisée en trois morceaux.
Plutarque (Vie d’Antoine, LXXIV) raconte que Cléopâtre avait fait construire, à côté du temple d’Isis, des sépultures monumentales d’une élévation et d’une magnificence étonnantes, où elle transporta tout ce qu’elle avait de plus précieux : sa fortune en or et en argent et toutes ses richesses. Ce même auteur (l. XXXIV), en parlant du genre de mort employé par Cléopâtre, ajoute : « on avait vu quelques traînées du reptile du côté de la mer où donnait la chambre. »
Cette relation de Plutarque est bien explicite : le tombeau monumental de Cléopâtre était contigu au temple d’Isis, du côté de la mer.
Dion Cassius (l. I, 8), qui mentionne lui aussi le monument bâti par Cléopâtre, dit : le tombeau qu’elle faisait construire à la suite du palais même. Or, on sait pertinemment que les palais royaux étaient à côté du cap, qui portait le nom de Lochias, et, les inscriptions en font foi, qu’il y avait là un temple d’'Isis Lochias Salvatrix.
Par conséquent, c’est à côté du temple d’Isis Lochias, où était le palais royal donnant sur la mer, qu’on doit chercher le mausolée de Cléopâtre, et non pas à côté du temple d’Isis de l’Abondance (Plusia), sur la rue transversale du Soma, aujourd’hui Nebi-Damel.
Les Égyptiens se figurent l’âme comme un double subtil qui reproduit l’individu trait pour trait avec sa taille, sa couleur, son geste, sa démarche. Chaque fois qu’un de nous vient au monde, son double ou, pour l’appeler comme les indigènes, son ka, y vient avec lui… Les tableaux où Pharaon Amenhotpou III a retracé à Louqsor l’histoire de sa jeunesse, nous sont un exemple de la façon dont on doit s’imaginer le double : Amenhotpou naît et son double est comme lui un nouveau-né que les nourrices soignent de leur mieux ; il grandit et son double grandit avec lui. Le double accompagne fidèlement son homme pendant les vicissitudes de l’existence terrestre. Après la mort, il le suit au tombeau et y reste près de la momie, tantôt caché dans les chambres funéraires, tantôt s’échappant au dehors et reconnaissable la nuit à une lueur pâle qui lui vaut le nom de Lumineux, Khou.
Les statues des rois ont chacune un double d’Horus qui loge en elles et fait d’elles une réplique animée du roi sous son apparence d’immuabilité. Lorsque Amenhotpou construisit le temple de Soleb en Nubie, il voulut y demeurer à côté de son père Amon. Il fit tailler à son usage une idole, y fixa par la prière un de ses propres doubles, l’introduisit dans le sanctuaire et accomplit devant elle les rites qu’on célèbre pour l’intronisation des dieux. Le double, une fois lié à son corps de pierre, ne l’abandonne plus tant qu’il est intact.
Antoine était mort le 1er août de l’an 29 avant Jésus-Christ. Cléopâtre se donna la mort le 15 août de la même année, c’est-à-dire le 21 mesori 718 de l’ère de Nébonassar, la deux cent quinzième année de l’ère des Lagides, après un règne de 22 années entières.
Ce jour fut le dernier de la race royale des Lagides et des successeurs d’Alexandre le Grand en Égypte.
Porphyre, en parlant des femmes qui occupèrent seules le trône d’Égypte, fait remarquer avec raison qu’en quelque temps qu’elles eussent gouverné, les années de leur souveraineté avaient toujours été attribuées à d’autres. La liste des rois d’Égypte ne contient pas le nom de Cléopâtre, veuve d’Evegète II, qui régna de fait pendant plus de 16 ans avec son fils Alexandre Ier. On n’y trouve pas non plus le nom de Bérénice, qui gouverna souverainement l’Égypte pendant que Ptolémée Denys s’était réfugié à Rome ; et pour Cléopâtre, au contraire, l’histoire lui donne les 22 dernières années du règne des Lagides en Égypte, quoique deux rois légitimes aient successivement occupé le trône avec elle dans ce même intervalle. Les circonstances du règne mémorable de Cléopâtre expliqueront cette différence.
Dans les funérailles égyptiennes, un groupe bruyant de « pleureuses » accompagnait toujours le défunt à sa dernière demeure. Voici, d’après Maspéro, un extrait des lamentations qu’elles prononçaient à la porte de l’hypogée où reposait le mort :
« Plaintes ! plaintes ! faites, faites, faites, faites des lamentations sans cesse, aussi haut que vous le pouvez. Ô voyageur excellent qui chemines vers la terre d’éternité, tu nous as été arraché ! Ô toi qui avais tant de monde autour de toi, te voici dans la terre qui impose l’isolement ! Toi qui aimais à ouvrir les jambes pour marcher, enchaîné, lié, emmailloté ! Toi qui avais beaucoup de fines étoffes et qui aimais le linge blanc, couché dans le vêtement d’hier !… »
Elien dit que, dans le temple d’Esculape à Alexandrie (qui n’était autre que celui de Sérapis), on nourrissait un serpent urœus d’une grandeur extraordinaire.
Mais le naya-hayèh, aspic de Cléopâtre ou urœus se rencontre surtout dans les fossés et dans les champs. Ce serpent a cinq pieds de long et, quand il est irrité, dresse la partie antérieure de son corps à une hauteur d’un demi-mètre, en la gonflant et l’élargissant en disque à la manière de tous les nayas. C’est avec le hayèh que les Psylles actuels de l’Égypte reproduisent les tours de ceux de l’antiquité.
TABLE DES MATIÈRES
- ↑ Champollion-Figeac, Annales des Lagides, t. II, p. 376.
- ↑ Voir note justificative no 1, p. 281.
- ↑ Letronne, Recherches sur l’Égypte, p. 141.
- ↑ Voir note justificative no 2, p. 282.
- ↑ Ledrain, Histoire d’Israël, p. 336.
- ↑ Voir note justificative no 3, p. 283.
- ↑ Voir note justificative no 4, p. 235.
- ↑ Voir note justificative no 5, p. 286.
- ↑ Voir note justificative no 6, p. 287.
- ↑ Voir note justificative no 7, p. 289.
- ↑ Voir note justificative no 8, p. 289.
- ↑ Traduction de Chabas.
- ↑ Voir note justificative no 9, p. 291.
- ↑ Voir note justificative no 10, p. 292.
- ↑ Voir note justificative no 11, p. 294.
- ↑ Voir note justificative no 12, p. 295.
- ↑ Plutarque, Antoine, LXXXI.
- ↑ Voir note justificative no 13, p. 296.
- ↑ Voir note justificative no 14, p. 297.
- ↑ Gabriel Peugnot, Du luxe de Cléopâtre dans ses festins.
- ↑ Voir note justificative no 15, p. 299.
- ↑ Voir note justificative no 16, p. 300.
- ↑ Voir note justificative no 17, p. 301.
- ↑ Dion Cassius, LI.
- ↑ Voir note justificative no 18, p. 301.
- ↑ Voir note justificative no 19, p. 302.
- ↑ Voir note justificative no 20, p. 304.
- ↑ Voir note justificative no 21, p. 305.
- ↑ Michelet, Histoire romaine.
- ↑ Plutarque, Antoine, LXXVII.
- ↑ Voir note justificative no 22, p. 308.
- ↑ Champollion le jeune, l’Égypte sous les Pharaons, t. I, p. 223.
- ↑ Diodore de Sicile, t. I, XII.
- ↑ Voir note justificative no 23, p. 310.
- ↑ A.-B. Edwards, The Story of Tanis (Harper’s 1886).
- ↑ Voir note justificative no 24, p. 312.
- ↑ Voir note justificative no 25, p. 313.
- ↑ Strabon, liv. V.
- ↑ Diodore de Sicile, liv. II, § xlviii.
- ↑ Diodore de Sicile, liv. III, § xviii.
- ↑ Dion Cassius, L. V.
- ↑ Suétone, Histoire des Douze Césars, t. I.
- ↑ Voir note justificative no 26, p. 315.
- ↑ Voir note justificative no 27, p. 316.
- ↑ Filleuil, Hist. du siècle de Périclès, t. II, p. 65.
- ↑ Plutarque, Antoine, lxxxx.
- ↑ Appian, de Bell, civil., II, p. 492.
- ↑ Dion Cassius, liv. LI.
- ↑ Voir note justificative no 28, p. 319.
- ↑ Voir note justificative no 29, p. 321.
- ↑ Voir note justificative no 30, p. 322.
- ↑ Voir note justificative no 31, p. 323.
- ↑ Voir note justificative no 32, p. 325.
- ↑ Elien.
- ↑ Voir note justificative no 33, p. 327.
- ↑ Voir note justificative no 34, p. 327.
- ↑ Voir note justificative no 35, p. 334.
- ↑ Voir note justificative no 36, p. 334.
- ↑ Plutarque, Alexandre, xxxvii.
- ↑ Hérodote, liv. II, 52.
- ↑ Voir note justificative no 37, p. 345.
- ↑ Livre des morts ou Rituel funéraire, chap. xvii, 1.
- ↑ G. Maspero, Hist. anc. des peuples de l’Orient.
- ↑ Diodore de Sicile, liv. III, 50.
- ↑ Voir note justificative no 38, p. 347.
- ↑ Dion Cassius, liv. LI.
- ↑ Voir note justificative no 39, p. 348.
- ↑ Dion Cassius, liv. LI.
- ↑ Plutarque, Antoine, lxxxii.
- ↑ Dion Cassius, liv. LI.
- ↑ Voir note justificative no 40, p. 349.
- ↑ Voir note justificative no 41, p. 350.
- ↑ Diodore de Sicile, liv. V, 36.
- ↑ Ibid., liv. III, 12.
- ↑ Voir note justificative no 42, p. 351.
- ↑ Plutarque, Antoine, lxxxv.
- ↑ Voir note justificative no 43, p. 352.
- ↑ Voir note justificative no 44, p. 354.
- ↑ Voir note justificative no 45, p. 354.
- ↑ Élien.
- ↑ Ici comme dans beaucoup d’autres circonstances les recherches des modernes sont venues confirmer l’opinion des anciens. En effet, l’élévation de la mer Rouge au-dessus du niveau de la Méditerranée a été trouvée, par une opération exacte, de cinq toises et demie. (Voy. Mémoire sur le canal de Suez, par M. le Père.)
- ↑ L’emploi des moyens nécessaires pour contenir les eaux ou pour les laisser échapper à volonté était connu en Égypte dès la plus haute antiquité. Diodore de Sicile attribue à Osiris l’invention des portes, c’est-à-dire des vannes servant à cet effet. En prenant ce passage de Diodore uniquement comme une preuve de la haute antiquité de l’invention on le trouve conforme à la vraisemblance, parce qu’on ne saurait comprendre, sans des moyens pareils, le régime de l’arrosement de l’Égypte. C’était avec des portes ou vannes semblables que se fermait le canal qui portait les eaux du Nil dans le lac de Mœris.
- ↑ Nombres, ch. xiii ; texte hébreu, V, 22 ; Vulgate, 2, 23.
- ↑ Guerre des Juifs avec les Romains, trad. française, l. V, ch. xiii.
- ↑ Ibid., l. IV, ch. xxxvii.
- ↑ La variation des couleurs, par rapport aux différents personnages que je viens d’indiquer, est établie d’après le système le plus généralement suivi chez les anciens Égyptiens : les grandes divinités sont le plus souvent peintes en bleu ou en vert ; les déesses en jaune et les personnages secondaires, en rouge. Il y a cependant des exceptions. Les draperies étaient teintes et dorées selon les différents genres d’étoffes qu’on avait l’intention de représenter.