Anecdotes pour servir à l’histoire secrète des Ebugors. Statuts des sodomites au XVIIe siècle./IV

APPENDICE

PROCÈS DE CATHERINE CADIÈRE
CONTRE LE PÈRE GIRARD
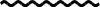
 E Père Jean-Baptiste Girard, jésuite
et prédicateur français,
fut nommé, vers 1728, recteur
du séminaire royal de la marine
à Toulon. Là, une de ses pénitentes,
Catherine Cadière, âgée de dix-huit ans,
d’une famille honnête et d’une grande
beauté, s’attacha à lui avec une exaltation
mystique fomentée par la lecture imprudente
des livres ascétiques : elle se prétendait
l’objet de toutes sortes de miracles.
Le Père Girard l’encouragea tout d’abord
dans cette voie dangereuse ; mais bientôt,
s’étant rendu compte de la supercherie, il
se retira. La demoiselle Cadière, piquée de
cet abandon, en fit confidence au prieur du
couvent des Carmélites, janséniste fervent
et grand ennemi des jésuites. Ce religieux
lui fit répéter ses accusations devant témoins.
Les jésuites réussirent alors à faire
enfermer la Cadière aux Ursulines. Cet
abus d’autorité leur fut très préjudiciable.
L’affaire fut portée devant le parlement
d’Aix, où Catherine Cadière accusa le Père
Girard de séduction, d’inceste spirituel, de
magie et de sorcellerie. Après de longs et
tumultueux débats, le Père Girard fut mis
hors de cour et de procès à la majorité
d’une voix : sur vingt-cinq juges, douze
l’avaient condamné à être brûlé vif. Le
peuple avait d’ailleurs ouvertement pris
parti contre lui ; il dut quitter secrètement
Toulon. Il se rendit à Lyon et de là à
Dôle, où il mourut deux ans après, le
4 juillet 1733.
E Père Jean-Baptiste Girard, jésuite
et prédicateur français,
fut nommé, vers 1728, recteur
du séminaire royal de la marine
à Toulon. Là, une de ses pénitentes,
Catherine Cadière, âgée de dix-huit ans,
d’une famille honnête et d’une grande
beauté, s’attacha à lui avec une exaltation
mystique fomentée par la lecture imprudente
des livres ascétiques : elle se prétendait
l’objet de toutes sortes de miracles.
Le Père Girard l’encouragea tout d’abord
dans cette voie dangereuse ; mais bientôt,
s’étant rendu compte de la supercherie, il
se retira. La demoiselle Cadière, piquée de
cet abandon, en fit confidence au prieur du
couvent des Carmélites, janséniste fervent
et grand ennemi des jésuites. Ce religieux
lui fit répéter ses accusations devant témoins.
Les jésuites réussirent alors à faire
enfermer la Cadière aux Ursulines. Cet
abus d’autorité leur fut très préjudiciable.
L’affaire fut portée devant le parlement
d’Aix, où Catherine Cadière accusa le Père
Girard de séduction, d’inceste spirituel, de
magie et de sorcellerie. Après de longs et
tumultueux débats, le Père Girard fut mis
hors de cour et de procès à la majorité
d’une voix : sur vingt-cinq juges, douze
l’avaient condamné à être brûlé vif. Le
peuple avait d’ailleurs ouvertement pris
parti contre lui ; il dut quitter secrètement
Toulon. Il se rendit à Lyon et de là à
Dôle, où il mourut deux ans après, le
4 juillet 1733.
Nous retrouvons dans le journal de l’avocat Barbier quelques échos du fameux procès :
« Les jésuites sont malencontreux ; en même temps que les affaires de la religion et les persécutions dont tant de prêtres sont l’objet leur ont attiré, on peut le dire, la haine de la plus grande partie de Paris, il est arrivé une diable d’histoire au recteur de la maison des jésuites de Toulon, homme de cinquante ans, appelé le P. Girard. Il est accusé d’avoir suborné une pénitente de dix-huit ans, nommée mademoiselle Cadière, de l’avoir ensorcelée, de l’avoir rendue mère et de l’avoir fait avorter. Cela fait un procès épouvantable au parlement d’Aix, et nombre de mémoires imprimés, de part et d’autre, se distribuent publiquement à la porte des promenades et des spectacles. Ils s’impriment à Paris, quoique faits à Aix, et on ne peut pas y suffire. »
« L’affaire du P. Girard et de la demoiselle Cadière, au parlement d’Aix, est ce qui occupe aujourd’hui toute la France et même l’Europe, car on en envoie les mémoires partout. Voici les conclusions du parquet, du 11 septembre : le P. Girard hors de cour et de procès ; la demoiselle Cadière condamnée à être pendue et auparavant appliquée à la question, etc. M. de Gaufridy, premier avocat général, était d’avis de faire pendre et brûler le P. Girard, et mettre tous les autres hors de cour ; mais, au parlement d’Aix, on compte les voix au parquet pour formuler les conclusions, et c’est l’autre avis qui a prévalu. On a été ici fort surpris de l’étrange différence des opinions de ces messieurs. »
« Enfin, cette fameuse affaire a été jugée le 10 de ce mois, et le jugement est des plus singuliers. On décharge le P. Girard des accusations formées contre lui et des crimes à lui imputés. On renvoie la demoiselle Cadière chez sa mère, pour en avoir soin, et on la met hors de cour et de procès, ainsi que tous les siens. Il n’y a pas le moindre dommages et intérêts prononcé par ce jugement. Onze juges ont condamné le P. Girard à être pendu et brûlé, et onze l’ont déchargé purement et simplement. En sorte que dans cette affaire, qui a fait tant de bruit, il y a beaucoup de crimes et point de criminels. La bonne ville de Paris est fort irritée de cet arrêt, qu’on regarde comme très injuste. On voulait absolument que le P. Girard fût brûlé. Cependant il ne devait pas l’être, car par l’anagramme de son nom il lui était prédit qu’on le ferait sortir de prison pour éviter le feu.
Jean-Baptiste Girard :
Abi, pater : ignis ardet[1].
Cette affaire fut le prétexte d’un roman obscène attribué au marquis d’Argens, Thérèse philosophe, dans lequel les deux adversaires sont présentés sous les anagrammes de Dirrag et d’Eradice. Thérèse y présente les faits de la façon suivante :
« Toute l’Europe a su l’aventure du Père Dirrag et de Mlle Eradice ; tout le monde en a raisonné ; mais peu de personnes ont connu réellement le fond de cette histoire, qui était devenue une affaire de parti entre les M… et les J… Je ne répéterai point ici ce qui en a été dit ; toutes les procédures vous sont connues, vous avez vu les factums, les écrits qui ont paru de part et d’autre et vous savez quelle en a été la suite. Voici le peu que j’en sais par moi-même, au delà du fait dont je viens de vous rendre compte.
« Mademoiselle Eradice est à peu près de mon âge. Elle est née à Volnot, fille d’un marchand auprès duquel ma mère se logea, lorsqu’elle alla s’établir dans cette ville. Sa taille est bien prise ; sa peau d’une beauté singulière, blanche à ravir ; ses cheveux noirs comme geai ; de très beaux yeux ; un air de Vierge. Nous avons été amies dans l’enfance ; mais lorsque je fus mise au couvent, je la perdis de vue. Sa passion dominante était de se distinguer de ses compagnes, de faire parler d’elle. Cette passion, jointe à un grand fond de tendresse, lui fit choisir le parti de la dévotion, comme le plus propre à son projet. Elle aima Dieu comme on aime son amant. Dans le temps que je la retrouvai, pénitente du Père Dirrag, elle ne parlait que de méditation, de contemplation, d’oraisons. C’était alors le style de la gent mystique de la ville et même de la province. Ses manières modestes lui avaient acquis depuis longtemps la réputation d’une haute vertu. Eradice avait de l’esprit ; mais elle ne l’appliquait qu’à parvenir à satisfaire l’envie démesurée qu’elle avait de faire des miracles ; tout ce qui flattait cette passion devenait pour elle une vérité incontestable. Tels sont les faibles humains : la passion dont chacun d’eux est affecté absorbe toujours toutes les autres ; ils n’agissent qu’en conséquence de cette passion ; elle leur empêche d’apercevoir les notions les plus claires qui devraient servir à la détruire.
« Le Père Dirrag était né à Lode. Lors de son aventure, il avait environ cinquante-trois ans ; son visage était tel que celui que nos peintres donnent aux satyres. Quoiqu’excessivement laid, dans la physionomie. La paillardise, l’impudicité étaient peintes dans ses yeux ; dans ses actions, il ne paraissait occupé que du salut des âmes et de la gloire de Dieu. Il avait beaucoup de talent pour la chaire ; ses exhortations, ses discours étaient pleins de douceur, d’onction. Il avait l’art de persuader. Né avec beaucoup d’esprit, il l’employait tout entier à acquérir la réputation de convertisseur ; et, en effet, un nombre considérable de femmes et de filles du monde ont embrassé le parti de la pénitence sous sa direction.
« On voit que la ressemblance-des caractères et des vues de ce Père et de Mlle Eradice suffisait pour les unir. Aussi, dès que le premier parut à Volnot, où sa réputation était déjà parvenue avant lui, Eradice se jeta, pour ainsi dire, dans ses bras. À peine se connurent-ils qu’ils se regardèrent mutuellement comme des sujets propres à augmenter leurs gloires réciproques. Eradice était certainement d’abord dans la bonne foi ; mais Dirrag savait à quoi s’en tenir ; l’aimable figure de sa nouvelle pénitente l’avait séduit ; et il entrevit qu’il séduirait à son tour et tromperait facilement un cœur flexible, tendre, rempli de préjugés, un esprit qui recevrait avec la docilité et la persuasion la plus entière, le ridicule des insinuations et des exhortations mystiques. De là, il forma son plan tel que je l’ai peint plus haut. Les premières branches de ce plan lui assuraient bien de l’amusement voluptueux de la fustigation, et il y avait quelque temps que le bon Père en usait avec quelques autres de ses pénitentes : c’était jusqu’alors à quoi s’étaient bornés ses plaisirs libidineux avec elles ; mais la fermeté, le contour, la blancheur des fesses d’Eradice avaient tellement échauffé son imagination qu’il résolut de franchir le pas. Les grands hommes percent à travers les plus grands obstacles : celui-ci imagina donc l’introduction d’un morceau du cordon de saint François, relique qui, par son intromission, devait chasser tout ce qui resterait d’impur et de charnel dans sa pénitente et la conduire à l’extase. Ce fut alors qu’il imagina les stigmates imités de ceux de saint François. Il fit venir secrètement à Volnot une de ses anciennes pénitentes qui avait toute sa confiance et qui remplissait ci-devant, avec connaissance de cause, les fonctions qu’il destinait intérieurement à Eradice. Il trouvait celle-ci trop jeune et trop enthousiasmée de l’envie de faire des miracles pour aventurer de la rendre dépositaire de son secret.
« La vieille pénitente arriva et fit bientôt connaissance de dévotion avec Eradice, à qui elle tâcha d’en insinuer une particulière pour saint François, son patron. On composa une eau qui devait opérer des plaies imitées des stigmates, et le jeudi saint, sous le prétexte de la Cène, la vieille pénitente lava les pieds d’Eradice et y appliqua de cette eau, qui fit son effet.
« Eradice confia deux jours après à la vieille qu’elle avait une blessure sur chaque pied. « Quel bonheur ! Quelle gloire pour vous ! s’écria celle-ci. Saint François vous a communiqué ses stigmates : Dieu veut faire de vous la plus grande sainte. Voyons si, comme votre grand Patron, votre côté ne sera pas aussi stigmatisé. » Elle porta ensuite ta main sous le téton gauche d’Eradice, où elle appliqua pareillement de son eau : le lendemain, nouveau stigmate.
« Eradice ne manqua pas de parler de ce miracle à son directeur, qui, craignant l’éclat, lui recommanda l’humilité et le secret. Ce fut inutilement ; la passion dominante de celle-ci étant de paraître sainte, sa joie perça : elle fit des confidences ; les stigmates firent du bruit, et toutes les pénitentes du Père voulurent être stigmatisées.
« Dirrag sentit qu’il était nécessaire de soutenir sa réputation, mais en même temps de tâcher de faire une diversion qui empêchât les yeux du public de rester fixés sur la seule Eradice. Quelques autres pénitentes furent donc aussi stigmatisées par les mêmes moyens : tout réussit.
« Eradice cependant se voua à saint François ; son directeur l’assura qu’il avait lui-même la plus grande confiance en son intercession : il ajouta qu’il avait opéré nombre de miracles par le moyen d’un grand morceau de cordon de ce saint, qu’un Père de la Société lui avait rapporté de Rome, et qu’il avait chassé, par la vertu de cette relique, le diable du corps de plusieurs démoniaques, en l’introduisant dans leurs bouches ou dans quelque autre conduit de la nature, suivant l’exigence du cas. Il lui montra enfin ce prétendu cordon, qui n’était autre chose qu’un assez gros morceau de corde de huit pouces de longueur, enduit d’un mastic qui le rendait dur et uni. Il était recouvert proprement d’un étui de velours cramoisi, qui lui servait de fourreau ; en un mot, c’était un de ces meubles de religieuses que l’on nomme Godemichis. Sans doute que Dirrag tenait ce présent de quelque vieille abbesse, de qui il l’avait exigé. Quoi qu’il en soit, Eradice eut bien de la peine d’obtenir la permission de baiser humblement cette relique, que le Père assurait ne pouvoir être touchée sans crime par des mains profanes.
« Ce fut ainsi, mon cher comte, que le Père Dirrag conduisit par degrés sa nouvelle pénitente à souffrir pendant plusieurs mois ses impudiques embrassements, lorsqu’elle ne croyait jouir que d’un bonheur purement spirituel et céleste.
« C’est d’elle que j’ai su toutes ces circonstances, quelque temps après le jugement de son procès. Elle me confia que ce fut un certain moine (qui a joué un grand rôle dans cette affaire) qui lui dessilla les yeux. Il était jeune, beau, bien fait, passionnément amoureux d’elle, ami de son frère et de sa mère, chez qui ils mangeaient souvent ensemble. Il s’attira sa confiance ; il démasqua l’impudique Dirrag ; et je compris sensiblement, à travers de tout ce qu’elle me dit, qu’elle se livra alors de bonne foi aux embrassements du luxurieux moine ; j’entrevis même que celui-ci n’avait pas démenti la réputation de son ordre, et par une heureuse conformation, comme par des leçons redoublées, il dédommagea amplement sa nouvelle prosélyte du sacrifice qu’elle lui fit des supercheries hebdomadaires du vieux druide.
« Dès qu’Eradice eut reconnu l’illusion du feint cordon de Dirrag, par l’application amiable du membre naturel du moine, l’élégance de cette démonstration lui fit sentir qu’elle avait été grossièrement dupée. Sa vanité se trouva blessée, et la vengeance la porta à tous les excès que vous avez connus, de concert avec le fier moine, qui, outre l’esprit de parti qui l’animait, était encore jaloux des faveurs que Dirrag avait surprises à son amante. Ses charmes étaient un bien qu’il croyait créé pour lui seul ; c’était un vol manifeste qu’il prétendait lui avoir été fait, dont il se flattait d’obtenir une punition exemplaire ; la grillade seule de son rival, qu’il méditait, pouvait assouvir son ressentiment et sa vengeance[2]. »
