Amélie, ou Les Écarts de ma jeunesse/Texte entier

 ouvent on s’effarouche en lisant le titre
d’un livre : s’il présente quelques idées
un peu libres, on le rejette avec dédain,
comme étant fait pour corrompre les
mœurs et faciliter aux jeunes gens les
moyens de se perdre ; mais quelquefois
on a tort de s’en tenir à ce jugement, dont la
légèreté peut priver celui qui le porte de quelques
traits de morale qui le dédommageraient
peut-être des efforts qu’il aurait faits pour vaincre
son injuste prévention.
ouvent on s’effarouche en lisant le titre
d’un livre : s’il présente quelques idées
un peu libres, on le rejette avec dédain,
comme étant fait pour corrompre les
mœurs et faciliter aux jeunes gens les
moyens de se perdre ; mais quelquefois
on a tort de s’en tenir à ce jugement, dont la
légèreté peut priver celui qui le porte de quelques
traits de morale qui le dédommageraient
peut-être des efforts qu’il aurait faits pour vaincre
son injuste prévention.
Si, dans l’histoire qu’on va lire, on trouve le récit d’actions quelquefois assez lestes que l’amour de la vérité n’a pu faire supprimer, on y remarquera qu’elles sont presque toujours suivies de désagréments et d’humiliations qui ne laissent à celle qui les avoue que la honte de les avoir faites.
C’est, sans doute, un devoir bien doux à remplir, que celui d’indiquer les écueils où plusieurs ont eu le malheur d’échouer, quand on a l’espoir d’en préserver les autres : ainsi donc, le but de cet ouvrage sera parfaitement rempli, si un seul être que son penchant au libertinage pourrait entraîner sur le bord du précipice trouve, dans la peinture même de quelques-uns des excès qu’il enfante, les moyens de les éviter.

AMÉLIE B…
À VICTORINE MALL…
 ous voulez absolument, ma chère, abuser
des droits de l’amitié : vous voulez me
forcer de mettre au jour l’histoire que
ma complaisance pour vous vient d’arracher
de ma plume, mais que la honte
d’en être l’héroïne me ferait supprimer,
si je pouvais effacer aussi aisément de ma mémoire
les faits qui la composent, que les caractères
que j’ai tracés. Je l’avouerai : je me repens quelquefois de vous avoir obéi. Chaque ligne que
je relis, atteste mon déshonneur ; je crains que
vous ne puissiez pardonner à votre amie les
égarements d’un cœur trop tôt abandonné à lui-même ;
et cette idée me fait frémir. Cependant, si
je vous en crois, « Cette confiance, de ma part,
m’est un titre de plus à votre amitié ; vous
m’en saurez gré toute la vie ». Et je pourrais
vous refuser ce que vous paraissez tant désirer !
Non, je n’en ai plus le courage. Mais, si vous
exigez de moi tout ce que vous voulez, n’ai-je pas
à mon tour le droit de demander que vous soyez
seule dépositaire de mes faiblesses ? J’aurais
trop à rougir, si quelque autre que vous les apprenait.
Je compte assez sur l’indulgence de mon
amie pour ne lui rien cacher ; mais je ne pourrais
soutenir les regards d’un étranger qui aurait
pénétré mes secrets.
ous voulez absolument, ma chère, abuser
des droits de l’amitié : vous voulez me
forcer de mettre au jour l’histoire que
ma complaisance pour vous vient d’arracher
de ma plume, mais que la honte
d’en être l’héroïne me ferait supprimer,
si je pouvais effacer aussi aisément de ma mémoire
les faits qui la composent, que les caractères
que j’ai tracés. Je l’avouerai : je me repens quelquefois de vous avoir obéi. Chaque ligne que
je relis, atteste mon déshonneur ; je crains que
vous ne puissiez pardonner à votre amie les
égarements d’un cœur trop tôt abandonné à lui-même ;
et cette idée me fait frémir. Cependant, si
je vous en crois, « Cette confiance, de ma part,
m’est un titre de plus à votre amitié ; vous
m’en saurez gré toute la vie ». Et je pourrais
vous refuser ce que vous paraissez tant désirer !
Non, je n’en ai plus le courage. Mais, si vous
exigez de moi tout ce que vous voulez, n’ai-je pas
à mon tour le droit de demander que vous soyez
seule dépositaire de mes faiblesses ? J’aurais
trop à rougir, si quelque autre que vous les apprenait.
Je compte assez sur l’indulgence de mon
amie pour ne lui rien cacher ; mais je ne pourrais
soutenir les regards d’un étranger qui aurait
pénétré mes secrets.
Agréez donc l’esquisse que je vous envoie comme un monument de ma tendresse pour vous, et persuadez-vous bien qu’il n’y a qu’à l’amitié qu’on peut faire de si grands sacrifices.
Adieu, plaignez votre amie, et ne la méprisez pas.
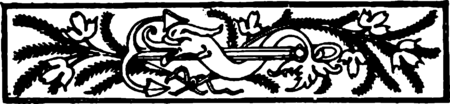
AMÉLIE
OU
LES ÉCARTS DE MA JEUNESSE
 ’avais juré de laisser à jamais étendu
sur ma vie passée le voile que mes mains
y avaient si soigneusement jeté ; et
tranquille au sein de l’abondance, je
devais même appréhender de le soulever.
Pourquoi faut-il qu’un sentiment
que je ne puis vaincre, celui de l’amitié,
m’oblige de publier ce que je voudrais me taire
à moi-même ? N’importe, j’ai promis : si je
manquais à ma parole, ce serait un tort de plus à
ajouter aux faiblesses que je dois me reprocher.
’avais juré de laisser à jamais étendu
sur ma vie passée le voile que mes mains
y avaient si soigneusement jeté ; et
tranquille au sein de l’abondance, je
devais même appréhender de le soulever.
Pourquoi faut-il qu’un sentiment
que je ne puis vaincre, celui de l’amitié,
m’oblige de publier ce que je voudrais me taire
à moi-même ? N’importe, j’ai promis : si je
manquais à ma parole, ce serait un tort de plus à
ajouter aux faiblesses que je dois me reprocher.
Je suis fille unique d’un fermier du Soissonnais : ma mère mourut fort jeune, et j’étais encore au berceau quand je la perdis. Mon père, après s’être ruiné dans un emploi auquel il n’entendait rien, fut forcé d’abandonner son équipage et de se retirer avec moi chez un de ses frères, curé d’un village près Orléans. Soit qu’il craignît d’être à charge à ce bon parent, brave homme qui nous avait appelés et reçus de bien bon cœur, malgré la modicité de son revenu, soit qu’il s’ennuyât de ne rien faire dans un pays où il n’avait ni connaissances, ni habitudes, le chagrin s’empara de lui, et quelques mois après notre arrivée, il fut attaqué d’une maladie violente qui le ravit en peu de jours à la tendresse de mon oncle et aux embrassements de sa fille.
Je n’avais alors que dix ans : mon oncle sentant bien qu’il était temps de commencer mon éducation, mais hors d’état d’en faire les frais, s’il n’augmentait son revenu par quelques accessoires à celui de sa cure, monta une petite maison d’instruction, et prit des pensionnaires, auxquels il enseignait la géographie et la langue latine. Au moyen de cette ressource, il ne se borna pas à mon égard aux leçons qu’il pouvait me donner lui-même, il me procura des maîtres ; et si j’acquis quelques talents agréables, je les dois au sacrifice que mon oncle fit de son repos pour activer cette institution.
De beaucoup d’élèves qu’il avait formés depuis les six années que durait cet établissement, il ne lui restait que les deux fils d’un riche négociant d’Orléans. L’aîné, nommé Georges, était âgé de dix-huit ans ; l’autre, qu’on appelait Joseph, n’en avait que dix-sept, et moi j’achevais ma seizième année.
Élevés ensemble, il régnait entre nous trois une tendre amitié ; je les appelais mes frères, ils me nommaient leur sœur : l’amour ne m’avait point encore appris qu’il est des noms plus doux, et nous coulions nos jours dans les douceurs de la paix et de l’union la plus intime. Nous les partagions entre l’étude, la promenade et les jeux de notre âge. Je ne sais si plus d’égards de la part de Georges me le faisaient préférer à son frère, mais mon cœur éprouvait près de lui de ces émotions douces, de ces sentiments tendres que l’autre ne m’avait point inspirés.
Un jour que Joseph, mandé chez son père pour faire consulter un mal d’yeux qui lui était survenu, avait engagé mon oncle à l’accompagner, nous restâmes seuls, Georges et moi. Une vieille bonne, sous l’inspection de laquelle nous étions depuis longtemps, était la seule gardienne qu’on nous eût donnée. Cette femme nous laissa libres, parce qu’elle ne s’était pas encore aperçu qu’il y eût du danger à le faire, et qu’elle aurait pu craindre que trop de précautions ne nous fît naître des idées toujours très difficiles à étouffer.
Le temps était superbe : Georges, après le dîner, me proposa un tour de promenade ; j’acceptai. Nous étions à peine sortis, qu’il me dit qu’il avait un grand secret à me confier ; qu’il n’avait pu jusqu’alors trouver l’occasion de soulager son cœur ; mais que, puisqu’elle s’offrait, il espérait que je ne dédaignerais pas de l’entendre.
— Non, mon ami, lui dis-je, vous ne devez pas craindre un refus de ma part. Pouvez-vous avoir des chagrins ou des plaisirs que votre sœur n’aime à les partager ? De grâce, calmez promptement mon inquiétude, apprenez-moi ce secret que je brûle de connaître.
Georges me fixe attentivement ; le feu brille dans ses yeux, son teint se colore, je le regarde sans oser dire un mot ; et, pour la première fois, mes yeux craignent de rencontrer les siens. Enfin, il rompt le silence :
— Ô mon amie, me dit-il, pardonne à ma franchise l’aveu que je vais te faire ; il importe à ma tranquillité de connaître tes véritables sentiments pour moi. Les traits divins dont la nature a pris plaisir à t’orner, ont fait sur mon cœur une impression si vive, que je ne suis plus maître d’en contenir les transports. La nature en vain se pare de ses plus beaux ornements pour embellir les lieux que nous habitons : l’étude même, qui faisait autrefois mes délices, et dont je sens la nécessité, n’a plus de charmes pour moi. Toi seule occupes mon âme tout entière. Je t’aime enfin, ma chère Amélie, et rien n’égale ma tendresse pour toi.
— Je t’aime aussi de bien bon cœur, et mon amitié pour toi, mon cher Georges, est un de mes plus grands plaisirs.
— Que parles-tu d’amitié ? est-ce là le seul sentiment qui nous convienne ? Et l’amour ? — Tout en prononçant ce mot, il imprima sur mes lèvres un baiser de feu — : et l’amour ?…
— Il ne peut pas m’obliger de t’aimer davantage.
— Non, je veux le croire ; mais il exige des preuves que l’amitié ne demande pas.
— Que veux-tu dire ? explique-toi. N’es-tu pas sûr d’obtenir tout ce que je peux t’accorder ?
— Oui ; mais l’amour, plus exigeant que l’amitié, ne se contente pas, comme elle, d’un attachement ordinaire ; il veut trouver dans l’union de deux cœurs, l’aliment nécessaire à sa subsistance ; et si tu m’aimes, comme tu me le dis, il faut m’accorder une faveur qui me sera bien chère, et me rendra le plus heureux des hommes.
— Mais je ne sais rien en mon pouvoir qui soit préférable à tout ce que j’ai fait, jusqu’à présent, pour te prouver que tu m’es bien cher.
Il n’osait me dire ce qu’il me demandait, et moi je feignais de ne pas l’entendre.
Tout en discourant sur ce sujet, dont je m’entretenais, pour la première fois, avec tant de plaisir, et que les baisers passionnés de mon cher Georges me rendaient bien intéressant, nous nous étions enfoncés dans un petit bois voisin. La chaleur nous avait un peu fatigués ; mais la conversation surtout y avait beaucoup contribué. Georges m’invite à m’asseoir, je ne me fais point prier, n’ayant aucune crainte sur les résultats de cette nouvelle position.
Nous voilà donc assis tout près l’un de l’autre.
Et les baisers de recommencer ; cependant ce petit jeu nous échauffait prodigieusement ; la sueur coulait de mon front ; ce fut un prétexte pour mon amant de me proposer de me débarrasser de mon mouchoir : il n’avait pas même achevé que ce voile n’était déjà plus sur mon cou. Ma gorge se trouvait alors en liberté ; il la presse contre son cœur, la couvre de baisers ; et, d’une main plus hardie, il parcourt mes autres charmes : je ne m’oppose à rien ; le cœur rempli du sentiment que j’éprouve, je n’ai pas la force de lui résister ; il me renverse, et sa main, sans doute, guidée par l’Amour lui-même, arrive à cet endroit, encore intact, où toutes mes idées vinrent probablement se confondre dès que je la sentis, car mon imagination s’exalta, mes sens se troublèrent, et je ne fus plus maîtresse de ma raison.
Georges allait passer de cet état délicieux, qu’il éprouvait lui-même, au comble de ses désirs : l’autel était orné ; les plaisirs l’environnaient ; nous allions jouir de cette suprême félicité qui, dans ce moment, élève au rang des dieux les êtres fortunés qu’un amour véritable et sincère unit.
Déjà Georges plaçait sur les bords de l’autel… Ô mortelles douleurs ! ô revers inouïs ! pourquoi ne sommes-nous pas morts de frayeur ? notre sort eût été, à jamais, envié des vrais amants, et je n’aurais pas été victime de la brutalité de mes ravisseurs. Trois hommes armés s’élancent sur nous, nous saisissent tous les deux, et garrottent mon pauvre Georges, qui se débattait vainement dans leurs bras. Quant à moi, la honte d’avoir été surprise dans cette position, et la peur que j’eus de ces scélérats, me firent tomber dans un évanouissement dont je ne sortis vraisemblablement que fort longtemps après ; car, en reprenant mes sens, je me trouvai dans une berline fermée avec soin, assise entre deux inconnus, chargés de me contenir dans tous les mouvements que je ferais, soit pour avoir du secours, soit pour m’échapper de leurs mains.
J’ignore combien de temps dura mon évanouissement ; mais lorsque nous arrivâmes dans la cour du château, où l’on me fit descendre, il était soleil couchant, d’où je calculai qu’il pouvait y avoir quatre heures que nous étions en route. Personne ne parut : mes conducteurs m’engagèrent à monter à l’appartement qui m’était destiné ; mais voyant que je refusais avec opiniâtreté de me rendre à leur invitation, ils me portèrent dans une chambre à coucher, assez bien ornée, dont l’un d’eux ferma les croisées, tandis que l’autre fut chercher des bougies.
On m’avait à peine déposée dans cette chambre, qu’une jeune personne, à peu près de mon âge, parut, et me demanda, de l’air le plus tendre, comment je me trouvais, et si j’avais besoin de quelque chose.
— Où suis-je ?… m’écriai-je en pleurant, où suis-je ?… mademoiselle, et quels sont les barbares qui ont pu abuser ainsi de ma faiblesse, pour me traiter aussi indignement ? répondez, de grâce ; oh ! qui que vous soyez, répondez ; vous n’êtes point assez cruelle pour me refuser les éclaircissements que je vous demande dans la malheureuse situation où je me trouve. Ah ! par pitié, mademoiselle !
Voyant qu’elle ne me répond pas, je me jette à ses genoux :
— Eh quoi ! vous vous taisez, quoi ! vous pouvez voir, sans être émue de compassion, l’innocence vous implorer ; et votre cœur, que mon état devrait intéresser, reste froid et sourd à mes prières !
Pendant tout ce temps, cette jeune fille n’avait pas seulement ouvert la bouche. Enfin, des larmes s’échappent de ses yeux en me regardant :
— Mademoiselle, je vous plains bien sincèrement, me dit-elle, mais il m’est défendu, sous peine de la vie, de vous donner des détails sur le lieu où vous êtes maintenant, et sur le sort qu’on vous y destine ; ne m’interrogez donc plus, je vous en supplie, car je suis dans la dure nécessité de vous refuser tout éclaircissement sur ce sujet.
Je me remis de nouveau à pleurer, mais plus amèrement.
— Quel est donc, me dis-je à moi-même, en me jetant dans un fauteuil, quel est donc ce mystère impénétrable ? à quel dessein m’a-t-on arrachée de la maison de mon oncle, et des bras de mon amant ? ô perfidie ! d’où vient cette différence effrayante entre les hommes ? pourquoi les uns sont-ils si cruels et les autres si bons ? Ô mon cher Georges ! qu’es-tu devenu ? toi, la douceur même ! toi, mon souverain bien ! Ces monstres ne t’ont-ils éloigné du bonheur que pour t’arracher la vie ? Ah ! s’il en est ainsi, qu’ils achèvent leur crime, et que je périsse ; je ne pourrai vivre, je le sens bien, séparée de celui qui m’est plus cher que le jour.
Je réfléchissais encore aux suites épouvantables de cet événement, lorsque j’entendis du bruit à la porte de la chambre.
— Ô ciel ! dis-je à ma trop discrète compagne, que vient-on m’annoncer, et que vais-je devenir ?…
Un homme inconnu se présente, et d’un ton ironique, bien cruel, bien molestant dans mon malheur :
— Eh bien ! la belle, me dit-il, en me passant la main sous le menton, êtes-vous un peu remise de vos fatigues ? car, Dieu merci, aujourd’hui vous en avez essuyées de bien des manières ; ce joli garçon, avec lequel nous vous avons surprise, ne vous a pas sans doute épargnée ? Allons, remettez-vous. S’il ne vous a pas entièrement contentée sur ce point, vous trouverez ici des gens tout aussi complaisants que lui, qui ne vous refuseront rien.
Ce discours ne me laissa plus de doutes sur le sort qui m’était réservé dans cette maison, et je vis bien que je n’y avais été amenée que pour satisfaire la passion de mes indignes ravisseurs. Un torrent de larmes inonde mon visage ; mais le barbare se rit de ma douleur, et continue son persiflage :
— Allons, la belle innocente, allons, préparez-vous à jouer à ce jeu charmant, auquel vous preniez tant de plaisir ce matin, et tenez-vous bien sur vos gardes, car vous aurez affaire à forte partie. Je ne crois pas cependant que cela vous inquiète. L’habitude vous a mise dans le cas de ne pas craindre un adversaire, quelque savant qu’il soit.
Je ne soufflais pas un mot ; je n’avais pas la force de lui répondre, tant était grand l’étonnement où j’étais, de me voir ainsi traitée. Puis, s’adressant à la jeune personne qui s’était levée à son arrivée, ce qui me fit présumer qu’elle était à son service :
— Adélaïde, lui dit-il, déshabillez mademoiselle, et disposez-la à nous recevoir ; nous allons entrer dans un moment. Il sortait, je cours après lui :
— Homme vil et méprisable, lui dis-je, avez-vous pu ordonner de sang-froid des apprêts qui font frémir la vertu, et a-t-on à vos yeux cessé d’adorer cette déesse, pour avoir voulu rendre heureux le plus aimé des mortels ?
Il m’écoute en riant, hausse les épaules, et se retire.
Restée seule avec Adélaïde, je veux l’interroger sur l’espèce d’hommes dont je suis la déplorable proie ; mais elle me fait la même réponse qu’auparavant, et m’engage à faire de bonne volonté ce qu’on exigera sans doute.
— Non, lui dis-je, jamais je ne consentirai à ce que cet homme féroce paraît vouloir obtenir. Je ne servirai point les caprices de ces barbares, pour qui rien n’est sacré ; et s’il n’y a que la mort qui puisse m’éviter le déshonneur, je suis prête à la recevoir.
— Hélas ! mademoiselle, me dit Adélaïde, c’est inutilement que vous voudrez résister : ils sont les plus forts ; vous résigner à leurs volontés, et vous soumettre, est le plus court parti qu’il vous reste à prendre.
— Non, jamais ; je n’y consentirai jamais…
Les sanglots m’empêchaient de continuer. Adélaïde, en rougissant, essayait de me persuader. On ouvre, et je vois entrer les monstres qui m’avaient enlevée, suivis de Georges, les mains liées. Parmi ces scélérats, je reconnus le marquis de R…, seigneur du village que nous habitions. Dans les visites intéressées qu’il faisait souvent à mon oncle, à cause de moi, il m’avait fait différentes propositions, que j’avais toujours rejetées, ce qui l’avait déterminé à m’enlever : il est présumable qu’il en guettait depuis longtemps l’occasion, pour avoir si complètement réussi ; mais pour ne pas s’exposer, si l’on faisait des recherches chez lui, il avait jugé plus convenable de me conduire chez un de ses amis, dont la terre était à quelques lieues de la sienne. À peine j’aperçois le malheureux Georges, que je m’élance auprès de lui :
— Ô mon ami ! lui dis-je, en le serrant dans mes bras, et sans faire attention à mes persécuteurs, que la présence de mon amant semble avoir fait disparaître ; ô mon ami ! dans quel abîme de malheur t’a plongé la triste Amélie !
Il me regarde sans proférer un seul mot ; la pâleur a remplacé les roses de son teint ; un froid mortel a passé dans ses veines : l’impuissance où il se trouve de se venger est le premier supplice qu’il lui faut endurer. Je veux délier les nœuds de cette corde fatale, qui tient sa colère captive ; à l’instant un de ces barbares m’arrache d’auprès de mon amant, et les deux autres l’attachent au pied du lit.
Grands dieux ! serait-il donc possible que vous voulussiez que l’homme injuste et cruel, auquel vous donnez la force en partage, ne l’employât que pour écraser le faible ? et n’est-il pas permis à l’innocence persécutée de douter du pouvoir qu’on vous suppose, si le titre de justes, dont vous vous parez, ne vous impose pas la loi d’empêcher ce que vous ne pouvez permettre ?
Quand ils eurent bien garrotté Georges, ils vinrent à moi, et m’ordonnèrent de quitter tous mes vêtements. J’eus beau employer la prière pour toucher ces farouches libertins, je ne pus rien obtenir ; ils s’élancèrent sur moi, et en un instant je me vis dans l’état où la chaste Suzanne fut autrefois surprise par ses vieux adorateurs.
Après m’avoir ainsi tenue exposée pendant quelque temps à leurs regards lascifs, et m’avoir fait l’objet de leurs injurieuses plaisanteries, un de ces monstres, que je supposai être laquais dans la maison, fut chercher une forte table, qu’il plaça au milieu de la chambre. On m’y étendit sur le dos ; l’un d’eux me prit les mains, qu’il appuya contre ma poitrine, pour me retenir sur la table ; deux autres élevèrent mes jambes en l’air ; en sorte que la chute de mes reins se trouvait précisément sur le bord de la table ; et le marquis, qui, pendant ces préparatifs, avait tout disposé pour l’attaque qu’il méditait, vint se placer entre mes jambes, et consomma, en présence même de Georges, le sacrifice sanglant que cet amant infortuné n’avait pas eu le temps d’achever.
Qui ne sait ce qu’on éprouve dans ce moment critique de la vie ? Ah ! si les douleurs qui accompagnent toujours la perte de cette fleur se pardonnent sans peine à l’amant heureux auquel on accorde la faveur de la cueillir, combien ne nous rendent-elles pas odieux le ravisseur méprisable, qui ne la doit qu’aux moyens violents qu’il a mis en usage pour s’en emparer ?
Aussitôt que ce tigre affamé eut mis un terme à sa voracité, son digne compagnon de débauche se jeta sur les restes sanglants de sa proie ; et sans pitié pour l’état affreux où je me trouvais, il eut la cruauté de renouveler des douleurs que la joie féroce et les propos insultants de ces barbares avaient rendues insupportables.
Ah ! sans doute, la maison où se passaient tant d’horreurs était dans le fond d’un désert, puisque aucun être vivant n’accourut aux cris perçants que je fis, chaque fois que j’essayai de me débarrasser de leurs mains.
Est-il une situation pareille à celle du malheureux Georges, et peut-on peindre les tourments affreux qu’il fut obligé de supporter pendant tout le temps que dura cette scène abominable ? Je crois, pour moi, qu’il n’en est pas de plus cruelle, et qu’il n’y a que ceux que j’éprouvai dans cette circonstance, qui puissent soutenir la comparaison.
On me laissa libre enfin, et je descendis de cette table, théâtre infâme des plaisirs horribles de mes bourreaux. On ordonna à Adélaïde de rester avec moi, pour m’aider à me r’habiller, et me tenir compagnie ; et les trois scélérats sortirent, emmenant avec eux l’infortuné Georges, qui jeta sur moi, en s’éloignant, un regard où se peignait son désespoir, et qui fit sur mon âme une impression qui ne s’effacera jamais.
Dès que nous fûmes seules, Adélaïde et moi, nous nous regardâmes, sans avoir la force de nous dire un mot ; les larmes, seule ressource de la faiblesse, soulagèrent un peu mes angoisses ; et la pauvre Adélaïde, qu’on avait obligée d’assister à l’opération qu’on venait de me faire subir, mêla ses pleurs aux miens. Je rompis enfin ce silence de mort.
— Eh quoi ! lui dis-je, il est donc sur la terre une espèce d’hommes qui ne cherche ses jouissances que dans les douleurs des autres, et pour qui les raffinements de cruauté, qui font frémir la nature, ne sont que des jeux qu’elle invente dans ses excès pour augmenter la masse de ses plaisirs ? Les cruels ! avec quelle joie barbare ils comptaient les soupirs de Georges ! comme ils insultaient à ses malheurs !
— Ce n’est rien encore que cela, mademoiselle, me répondit Adélaïde, et si je vous racontais les monstruosités dont j’ai été témoin dans cette abominable maison, mon récit seul vous ferait reculer d’horreur ; mais je dois épargner à votre sensibilité des détails qui ne pourraient qu’ajouter à vos maux.
Je me mis à pleurer de nouveau, et en regardant, avec l’œil du désespoir, la triste compagne de mes malheurs, je m’écriai :
— Ô ciel ! où mon destin m’a-t-il conduite, et qu’allons-nous devenir, mon pauvre Georges ?
Quand cette fille compatissante eut un peu rétabli le désordre de ma toilette, je la questionnai de nouveau ; mais je ne pus rien savoir ce jour-là ; toujours muette sur ce qui m’intéressait, elle me refusa impitoyablement les renseignements que je lui demandais. Je fus donc obligée d’employer cette éternelle soirée, ou à gémir des maux que je venais d’endurer, ou à parler de choses indifférentes.
Enfin, l’heure du souper arriva : le laquais qui avait été un des instruments de mes persécutions servit, et je forçai Adélaïde, qui voulait se retirer, de souper avec moi, pour me tenir compagnie. Après souper elle se jeta à mon cou, les larmes aux yeux, et me dit qu’elle allait s’occuper des moyens de nous servir, et qu’elle espérait réussir dans l’exécution d’un projet qu’elle avait conçu depuis longtemps. Elle m’aida à me déshabiller et je me couchai.
Je dormis peu, parce que je craignais toujours qu’on ne vînt me faire éprouver de nouveaux outrages. Cependant la nuit s’écoula tout entière, sans que j’entendisse parler de qui que ce fût. Le lendemain matin, Adélaïde rentra et m’assura que le soir même elle nous délivrerait, Georges et moi, de la captivité où on nous retenait ; que pour prix de ses soins, elle nous demandait seulement la permission de nous accompagner. Je le lui promis bien volontiers, et je me levai.
Dès qu’Adélaïde eut ouvert les contrevents de la croisée, je m’empressai d’y courir pour voir si je ne reconnaîtrais pas les lieux qui environnaient ma prison ; mais elle donnait sur un bois dans lequel je ne remarquai point de chemin pratiqué ; et la chambre où j’étais me parut être à plus de trente pieds d’élévation de la terre. Il n’était pas possible de s’échapper par là, sans se mettre en danger de périr en tombant ; néanmoins, j’aurais encore préféré ce moyen de fuite, au sort auquel je me voyais condamnée, si Adélaïde ne m’eût assurée qu’elle avait découvert un endroit par où nous pourrions nous évader, sans nous exposer à un aussi grand danger. Je la laissai donc maîtresse absolue de ma destinée, et je fis des vœux ardents pour notre délivrance.
On me laissa parfaitement tranquille toute la journée ; la seule peine que j’éprouvai, fut de la voir s’écouler aussi lentement. Enfin, la nuit arriva. Adélaïde m’avait quittée depuis environ deux heures ; je ne savais ce qu’elle était devenue, quand je la vis rentrer, tenant Georges par la main. Ô moment fortuné ! Je m’élance dans ses bras, nous nous tenons longtemps serrés l’un contre l’autre, nos larmes se confondent, et le plaisir de nous voir réunis nous fait oublier nos souffrances. Adélaïde m’apprend que Georges n’a pas voulu sortir sans moi, quoiqu’elle lui eût promis que nous allions le rejoindre, et tout en lui sachant gré de cette preuve touchante de son amour, je le blâmai de sa délicatesse, qui pouvait empêcher son évasion. Elle nous dit qu’elle avait profité du moment où le baron et son laquais étaient sortis, pour aller à une lieue de là, et que, comme il n’y avait dans la maison que le marquis, alors dans un appartement éloigné du nôtre, elle croyait l’instant favorable pour échapper à nos persécuteurs.
Comme nous nous disposions à la suivre, nous entendîmes marcher dans le corridor ; Adélaïde courut pour savoir qui c’était. Elle revint aussitôt :
— Nous sommes perdus, nous dit-elle, et qu’allons-nous devenir ? le marquis vient ici.
— Je veux l’y attendre, dit Georges, et s’il est seul, nous verrons si le crime triomphera toujours de la vertu.
Il était sans défense, le marquis pouvait être armé ; je ne voulus jamais consentir qu’il courût les risques d’un combat inégal, je le priai, les mains jointes, de se cacher sous le lit ; il m’obéit : pour moi, je pris un livre qui se trouvait sur la cheminée, et j’eus l’air de faire une lecture à Adélaïde ; tout cela fut l’affaire d’un instant, et il n’y avait plus matière au moindre soupçon quand le marquis entra.
— Comment se porte, aujourd’hui, dit-il en m’adressant la parole, la plus complaisante de toutes les beautés ?
Et il voulut m’embrasser ; je le repoussai vigoureusement sans lui répondre.
— Je ne viens point encore, reprit-il, avec cet appareil menaçant d’un chevalier méprisé, qui veut se faire obéir, mais avec la douceur d’un amant qui attend de vous son bonheur. Puis-je espérer que ma tendresse obtiendra le pardon d’un peu de rigueur ? et me laisserez-vous, de bonne grâce, réparer quelques légers torts dont j’ai pu me rendre hier coupable envers vous ?
— Ne l’espérez pas, lui répondis-je avec emportement ; il semblait que la présence de Georges enflammât mon courage, ne l’espérez pas ; jamais vous n’obtiendrez de moi ce que vous exigez ; j’ai bien assez souffert d’être obligée d’endurer vos outrages, sans vous permettre de les renouveler ! Sortez d’ici, barbare ! et ne réduisez pas au désespoir la plus malheureuse de toutes les femmes.
Le cruel se mit à rire, et ordonna à Adélaïde de sortir. Cette fille obéit sans répliquer. Dès qu’elle fut dehors, il mit les verrous, quitta son habit, vint à moi, me prit dans ses bras, et m’étendit sur le lit, malgré les efforts que je fis pour m’opposer à cette violence.
Georges, indigné, était sorti de dessous le lit. Il prend une pincette, seule arme qui soit en sa disposition, et en décharge un coup sur le derrière de la tête du marquis. Ce coup inattendu le fait tomber par terre ; mais bientôt, reprenant ses sens, il se relève et se précipite sur Georges. Celui-ci, qui guette tous ses mouvements, se jette en même temps sur lui ; et les voilà aux prises, se portant, l’un et l’autre, des coups qui font ruisseler le sang sur leurs visages. Ils se débarrassent enfin des mains l’un de l’autre ; le marquis se recule et sort de sa poche un pistolet, dont il ajuste son adversaire. Georges ne lui donne pas le temps de lâcher la détente ; furieux, il se jette sur lui et lui arrache des mains cette arme meurtrière. Le marquis désarmé, en reprend un second, tire sur Georges, qui, heureusement, évite le coup, et a le temps d’ajuster le marquis, qu’une balle, dans la poitrine, renverse au pied du lit.
Pendant ce temps, à genoux sur le lit et les mains levées au ciel, j’attendais, en invoquant les dieux, l’issue de ce combat, et quand je vis tomber l’infâme marquis :
— Je vous demande pardon, grands dieux ! m’écriai-je, d’avoir douté de votre justice. Tôt ou tard vous punissez le coupable, et si l’innocence fut sa victime, vous ne l’avez souffert que pour avoir plus de plaisir à la récompenser.
Adélaïde, que son intérêt pour moi avait fait rester à la porte de la chambre, pour savoir ce qui s’y passerait, épouvantée du bruit qu’elle entendait, frappait en désespérée. Georges, qui reconnaît sa voix, court lui ouvrir et la fait entrer.
Le marquis respirait encore. Elle le voit, et contemple, avec plaisir, ce méchant homme qui nageait dans son sang.
— Meurs donc, barbare, lui dit-elle, en l’entendant se plaindre, meurs. Délivre la terre d’un monstre qui la souillait par ses impuretés, meurs, et que ta mort, si elle est connue, épouvante les scélérats, qui, comme toi, dégradent le nom d’homme, par les crimes dont ils se rendent coupables, meurs.
Un mouvement du marquis nous annonça qu’il approchait du terme fatal, et nous le regardions encore qu’il n’était déjà plus.
— L’instant est favorable, nous dit Adélaïde, suivez-moi.
Nous descendons, et nous étions déjà dans la cour, lorsque nous entendîmes fermer la porte cochère.
— C’est le baron qui rentre, nous dit tout bas Adélaïde. Remontons sans faire de bruit ; nous allons tacher de sortir par l’endroit dont je vous ai déjà parlé.
L’obscurité dans laquelle nous nous trouvions favorisait son projet, et le baron, qui ne nous avait point entendus, regagnait lentement l’escalier. Le cerf que l’on poursuit fuit avec moins de légèreté que nous ; en un instant nous nous trouvons au bout du corridor ; Adélaïde marchait la première ; je la suivais, et Georges venait après nous. Elle ouvre la porte d’un cabinet d’aisance dont elle n’avait pu se procurer la clef que ce jour-là, malgré toutes les recherches qu’elle eût pu faire auparavant ; elle savait bien qu’il était possible de sortir de la maison par cet endroit éloigné, parce qu’un jour la porte de ce cabinet s’étant trouvée ouverte par la négligence d’un laquais, elle y était entrée, et se disposait à fuir, lorsqu’on était venu, sans le savoir, l’empêcher de mettre son projet à exécution.
Quoiqu’il n’y eût point de lumière dans cet endroit, cependant, à la faveur du crépuscule de la nuit, nous distinguions parfaitement qu’il était éclairé par une fenêtre. Adélaïde l’ouvre, pose un pied sur le siège du cabinet, l’autre sur l’appui de la croisée, et descend sur un petit toit qui régnait le long du mur. Elle me donne la main pour monter ; bientôt je la rejoins.
— Nous n’avons pas dix pieds à sauter, me dit-elle, ma chère demoiselle ; un pareil obstacle n’est pas fait pour nous arrêter en si beau chemin.
— Dépêchez-vous, disait Georges, car on nous poursuit.
Adélaïde et moi nous faisons, sans hésiter, puisqu’il n’y avait plus que ce parti, le saut qui devait nous sauver la vie ; heureusement, nous ne nous faisons point de mal. Georges, sur le toit, allait s’élancer près de nous ; un coup de feu part du corridor, l’atteint, et le fait rouler à nos pieds.
Ô fatalité ! destin inexplicable ! Georges et moi nous sommes victimes de la férocité de deux barbares ; l’innocence un moment triomphe ; l’un périt sous les coups de mon amant, et l’autre l’assassiné. Grands dieux ! faites donc briller à mes yeux la lumière céleste ! ou dites-moi ce que c’est que la justice éternelle ?
Je m’élance sur le corps de l’infortuné Georges ; je couvre de baisers sa bouche, qui venait, un instant auparavant, de me jurer une flamme éternelle ; je l’appelle, mais vainement ; il n’existait plus. Cependant Adélaïde a repris ses sens.
— Fuyons, mademoiselle, fuyons ce spectacle déchirant, puisque, hélas ! nos soins ne sont plus nécessaires à votre malheureux amant. Si les traîtres sont sûrs de la mort de Georges, ils vont nous poursuivre, et nous avons le temps de nous éloigner, si vous voulez m’en croire.
Je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes.
— Fuyons donc, mademoiselle, je vous le répète, ou la mort la plus cruelle va nous faire expier celle du marquis, si nous retombons dans les mains du baron et de ses gens.
Je me rends à l’avis d’Adélaïde, je lui donne le bras, et nous suivons, dans le bois, le premier sentier qui s’offre à nous.
Nous marchons quelque temps sans nous reposer ; à la fin, la fatigue nous force de nous arrêter : nous nous couchons par terre, et un quart d’heure de repos suffit pour rendre à nos jambes l’activité qui leur était si nécessaire. Nous nous trouvons enfin sur la grande route. Incertaines de savoir de quel côté tourner, nous prenons au hasard sur notre droite, et à une lieue environ, nous trouvons un village. Il n’était point encore jour, personne n’était levé : nous nous décidons à poursuivre notre route, remettant à demander des éclaircissements dans le premier endroit où nous passerons.
Nous n’avions pas fait une demi-lieue, que nous sommes devancées par une petite voiture, qui portait des provisions à la ville voisine.
— Questionnons le conducteur, me dit Adélaïde, et sachons au moins où nous allons.
Et sans attendre ma réponse, elle court après la voiture, et interroge le conducteur qui a la complaisance de s’arrêter ; ce qui me donne le temps de les rejoindre.
— Sommes-nous bien éloignées de la ville, monsieur, lui dit Adélaïde ?
— À trois lieues, mademoiselle, d’Orléans, où je vais ; et si vous voulez prendre chacune une place dans ma voiture, telle qu’elle est, je me ferai un vrai plaisir de vous y conduire.
L’offre était trop généreuse, et nous étions trop fatiguées, pour ne pas l’accepter. Nous voilà donc montées, assises sur la paille, et la voiture reprend son train.
— Il faut que vous ayez de grandes affaires, mesdemoiselles, nous dit notre conducteur, pour être ainsi seules sur un grand chemin, à deux heures du matin. Je suis étonné du courage qui vous fait braver les dangers que l’on court sur les routes.
— Notre voyage était indispensable, lui répondis-je, et comme nous étions à pied, il fallait partir avant le jour, pour trouver les personnes chez lesquelles nous nous rendons.
Mille autres mensonges servirent de réponses aux questions sans fin, que ce bavard ne cessa de nous faire.
Enfin le jour paraissait comme nous entrions dans Orléans. Nous descendîmes de voiture : j’offris au conducteur de payer les places qu’il nous avait fait prendre ; mais il ne voulut rien qu’un baiser de chacune de nous, en nous disant adieu.
Nous avions grand besoin de repos ; aussi nous cherchâmes promptement une auberge, où, après avoir amplement déjeuné dans une petite chambre que nous demandâmes exprès, nous nous mîmes au lit, où le sommeil nous retint jusqu’à l’heure du dîner.
La servante, que j’avais prévenue, vint nous avertir qu’on allait nous servir. Nous nous levâmes sur-le-champ, et notre toilette fut bientôt faite, car nous n’avions, pour tout ajustement, qu’un chapeau de paille sur nos cheveux flottants, et un déshabillé tout uni. Néanmoins ces riens, placés avec un peu d’art, sur deux jeunes personnes de seize ans, assez bien de figure, ne nous rendaient point indifférentes, et nous n’étions pas les moins bien des femmes qui se trouvaient à la table commune.
Cependant, un peu honteuses de nous trouver seules au milieu de tant d’étrangers, nous n’osions lever les yeux sur personne, et si parfois on nous adressait la parole, l’air modeste et décent que nous mettions naturellement dans nos réponses, parlait en notre faveur. Enfin, enhardies par les attentions qu’on voulut bien avoir pour nous, nous nous mêlâmes un peu de la conversation. Un indiscret, qui nous fixait presque toujours, nous demanda si nous allions plus loin qu’Orléans.
— À Paris, monsieur, lui répondis-je sans me déconcerter, où ma sœur et moi sommes mandées pour recueillir la succession d’une tante que nous n’avons jamais vue ; mais qui, meilleure après sa mort, qu’elle ne le fut pendant sa vie, nous laisse jouir de ce qu’elle n’a pu emporter.
On quitte la table enfin, et nous remontons à notre chambre.
À peine avions-nous eu le temps d’en fermer la porte, que la servante vient frapper, et nous dit qu’une personne, qui avait dîné avec nous, désirait nous parler. Nous étions deux ; il n’y avait aucun danger. Nous lui permettons d’entrer. Je présumais que ce pourrait être l’homme qui nous avait questionnées pendant le dîner ; mais c’en était un autre, d’environ quarante ans, que j’y avais remarqué, et qui ne s’était pas beaucoup mêlé de la conversation.
— Mesdemoiselles, nous dit-il en entrant, vous allez me trouver bien importun, et ma démarche vous paraîtra peut-être extraordinaire ; mais je n’ai pu résister à l’impression profonde que vous m’avez faite. Je n’ai pas vu, sans inquiétude pour vous, les dangers du voyage que vous entreprenez, et ceux que vous allez courir dans une ville où vous n’avez personne de connaissance. À votre âge on rencontre bien des écueils, et quelque vertueuse qu’on soit, on a beaucoup de peine à les éviter tous ; si j’avais le bonheur de mériter votre confiance, je vous offrirais de vous conduire à Paris, où j’ai mon établissement, et vous y trouveriez, dans la société de ma femme et de mes enfants, la sûreté et l’aisance que vous pourriez désirer pendant votre séjour dans notre ville. Faites vos réflexions, mesdemoiselles ; ma voiture est grande et commode ; je compte partir demain soir ; et si vous acceptez mes propositions, vous verrez que je sais tenir mes engagements.
En achevant ces mots, il se lève, ne nous donne pas le temps de le remercier, et sort, nous laissant tout étourdies de ce que nous venons d’entendre.
Nous nous regardions, Adélaïde et moi, bien embarrassées de la réponse que nous avions à faire ; retourner chez nos parents, c’était la chose impossible ; on m’aurait demandé compte de ma conduite. Forcée d’avouer la mort violente de Georges, je me livrais indubitablement à la fureur d’un père irrité, auquel je n’aurais pas pu donner des détails suffisants, puisque je ne connaissais point du tout le lieu de la scène ; enfin, ce qui pouvait m’arriver de plus doux, était, au moins, la perte de ma liberté. Adélaïde, par d’autres raisons, ne pouvait, pas plus que moi, se représenter chez sa mère ; nous n’avions, à nous deux, qu’une vingtaine de francs, ou environ ; un homme qui nous paraissait honnête, nous offrait des secours ; ma foi, la nécessité nous fit la loi, et nous convînmes que le lendemain matin nous dirions à notre protecteur qu’il pouvait compter sur nous, et que nous l’accompagnerions jusqu’à Paris. Heureusement que mon amie était plus décidée que moi, et qu’elle avait plus d’expérience ; elle se chargea de lui en porter la nouvelle. Il la reçut avec grand plaisir, et tout s’arrangea pour le mieux.
Nous partîmes donc d’Orléans, Adélaïde et moi, avec notre généreux inconnu, à sept heures du soir ; on courut toute la nuit, et le lendemain dans l’après-midi nous arrivâmes à Paris. Nous nous attendions à trouver chez notre père adoptif la famille qu’il nous avait annoncée ; mais nous ne vîmes en entrant que deux domestiques qui s’empressèrent beaucoup autour de leur maître, sans faire la moindre attention à ses compagnes de voyage.
Cependant, le maître de la maison nous conduisit au salon, sortit, et revint un instant après nous dire qu’il était désespéré que sa femme et ses enfants ne fussent point au logis pour nous tenir compagnie, comme il nous l’avait promis, mais qu’ils ne tarderaient pas à revenir de la campagne où ils étaient allés passer quelques jours, n’espérant pas le revoir si tôt.
Nous le crûmes sans peine, parce que l’air de vérité qu’il mettait ordinairement dans ses discours, nous avait, pour ainsi dire, habituées à le croire sur parole. Il nous fit donner à chacune une chambre, et après avoir, par ses soins, réparé nos forces, nous allâmes goûter, dans les bras du sommeil, un repos nécessaire.
Le lendemain matin on nous fit descendre au salon pour prendre le café ; notre hôte nous combla d’honnêtetés et de caresses ; et nous avions à peine fini de déjeuner, que deux marchandes qu’il avait fait venir, nous présentèrent, de sa part, plusieurs étoffes dans lesquelles il nous pria de choisir celles qui nous flatteraient le plus. Si nous eussions été seules avec lui, nous aurions vraisemblablement hésité à recevoir ce présent ; mais sentant bien que devant ces femmes, la moindre difficulté nous rendrait ridicules, pour ne rien dire de plus, nous nous crûmes obligées de faire ce qu’on exigeait de nous, sans nous permettre la moindre réflexion sur les conséquences de l’engagement tacite que nous prenions avec notre bienfaiteur. Nous choisîmes donc une pièce de ces étoffes, dans laquelle il se trouvait de quoi nous faire à chacune une robe, dont on nous prit à l’instant mesure.
— Je désire, dit notre hôte à ces femmes, que les ajustements de mes filles (c’est ainsi qu’il nous nomma devant elles) soient prêts pour demain ; et comme je leur ai fait laisser dans la maison d’éducation qu’elles habitaient en province, tout ce qui était à leur usage, voilà d’abord vingt-cinq louis que vous voudrez bien employer à leur procurer pour le moment tout ce qui leur est nécessaire, sauf à vous tenir compte de ce qui excédera cette somme, d’après l’état que vous me donnerez.
On promit que tout serait prêt pour le lendemain ; et effectivement, lorsque notre hôte, qui était sorti toute la matinée, revint à l’heure du dîner avec un de ses amis, il nous trouva parées de ses dons, et dans la toilette la plus brillante.
— Bonjour, mes chères filles, nous dit-il en entrant d’un air satisfait, comment vous portez-vous ? Vous voilà belles comme des anges ; allons, venez que je vous embrasse.
L’air de bonhomie du papa, un mouvement de reconnaissance, peut-être aussi la crainte de ne pas paraître devant un étranger ce qu’il disait que nous étions, tout cela nous détermina à nous jeter à son cou toutes les deux en même temps, en lui donnant le nom qui paraissait tant le flatter.
On dîna en partie carrée, et le soir on fut au spectacle. Adélaïde eut pour cavalier l’ami de notre hôte, et moi je pris le bras du papa. C’était nous faire un grand cadeau que de nous mener à la comédie, car je la voyais pour la première fois ; aussi je m’y amusai beaucoup.
De retour au logis, Adélaïde profita d’un moment où on nous laissa seules, pour m’instruire des propositions que lui avait faites l’ami de Richeville (car c’est ainsi que se nommait notre protecteur.) On l’avait informé de tout ce qui nous concernait, et il paraissait vouloir l’entretenir. Cette fille, qui avait reçu assez favorablement les propositions de son galant, m’avoua franchement que, dénuée de tout secours, et craignant de tomber dans la misère, elle allait lui laisser entrevoir qu’elle n’était pas éloignée de prendre ce nouvel engagement. En effet, trois ou quatre jours suffirent pour lier une entière connaissance, et elle me quitta pour aller demeurer avec lui. Peu de temps après ils partirent pour l’île de France, où cet ami avait des possessions, et je ne les revis plus.
Quant à moi, je sentis bien que j’étais destinée à servir aux plaisirs de mon trop généreux protecteur. Jusque là, cependant, il n’avait encore été question de rien entre nous. Mais je me familiarisais de jour en jour avec l’idée qu’un moment viendrait où je serais obligée de payer tout ce que je recevais de sa libéralité. Vainement je cherchais un moyen pour me soustraire à l’acquit de la dette énorme que je contractais envers lui. Que pouvais-je faire dans la position embarrassante où je me trouvais ? rien, que d’attendre avec soumission ce que le sort ordonnerait de moi. Je me livrais, quand j’étais seule, à mille réflexions.
— Il y a donc, me disais-je, des moments dans la vie où il est impossible à la fille la plus sage de rester vertueuse, et où la nécessité la contraint de se plier sous le joug qu’elle lui impose ?
Richeville, depuis la sortie d’Adélaïde, me traitait avec plus d’attentions ; tous ses domestiques, et une femme de chambre qu’il m’avait donnée, avaient ordre de m’obéir comme à lui-même. Tous les jours il me menait au spectacle, et je ne rentrais pas sans avoir reçu de sa générosité un présent de mon choix. Tant de marques d’amitié m’attachaient insensiblement à lui ; mon infortune commençait à moins peser sur mon cœur, et j’y sentis naître un sentiment plus doux que celui de la reconnaissance.
Il y avait déjà quinze jours que nous étions à Paris. Richeville et moi nous rentrions un soir de la comédie. Nous étions seuls. Sans doute qu’ayant conçu un projet qu’il voulait faire réussir, il s’était arrangé pour que nous pussions jouir d’un tête-à-tête. Quand je fus déshabillée, et qu’un simple négligé eut remplacé ma toilette, je passai au salon où il m’attendait. Il vint à moi et m’embrassa plus tendrement qu’à l’ordinaire.
— Asseyons-nous, me dit-il, ma chère petite, et causons tranquillement sur ce qui vous intéresse. Je n’ai point été dupe du petit mensonge que vous m’avez fait à Orléans ; l’état dans lequel je vous ai trouvées, vous et votre amie, m’a fait soupçonner que vous fuyiez la maison paternelle ; je prends trop de part à ce qui vous regarde, et je vous avoue même que je vous aime trop pour ne pas désirer d’être instruit de tout ce qui vous touche. S’il y a de l’indiscrétion à vous demander des détails que je brûle de connaître, vous aurez, j’en suis bien sûr, le bon esprit de me pardonner ma curiosité en faveur du motif.
Cette question me déconcerta un peu, et dès qu’il s’aperçut qu’un vermillon plus vif animait ma figure, il m’embrassa plus tendrement encore, et me pria de me remettre, en m’assurant que, quelque chose que j’eusse à lui apprendre, rien ne pourrait altérer la tendresse qu’il avait pour moi.
Je ne savais que lui dire, et j’étais d’avis de forger une histoire pour me sauver la honte de raconter ce qui m’était arrivé ; mais je craignais qu’à l’air embarrassé que je montrerais sans doute, il ne s’aperçut que je le trompais encore et ne me retirât ses bonnes grâces, dont je sentais tout le besoin ; je me déterminai donc à lui dire la vérité, quoiqu’il dût m’arriver, et je lui fis le récit fidèle de ma malheureuse aventure.
Pendant ce récit, qu’il écoutait avec la plus grande attention, je suivais tous ses mouvements pour y découvrir l’impression qu’il faisait sur lui ; j’eus la satisfaction de m’apercevoir qu’il était vivement affecté, et quand j’eus fini, il me remercia de ma complaisance, avec tant de bonté, que je me sus bon gré de ma franchise.
Il ne put en dire davantage pour le moment, parce qu’on vint annoncer que le souper était servi. Mais aussitôt que nous fûmes seuls, il remit la conversation sur ce qui nous avait d’abord occupés, et en me prenant la main qu’il couvrit de baisers, il me dit, du ton le plus expressif, qu’il n’avait plus qu’un désir, celui de me tenir lieu du trop malheureux Georges. Cet aveu, auquel cependant je m’attendais, me rendit un peu confuse, et je baissai les yeux sans lui répondre. Il se leva, vint à moi, et me prit sur la bouche un baiser que je ne défendis pas. Ce larcin, qui servit d’aiguillon à sa flamme, dérangea mes combinaisons ; ma tête obéit à mon cœur, et j’oubliai Georges et mes serments, pour me livrer tout entière à l’amour de mon bienfaiteur. Sûr du désordre qu’il cause, il me prend par la main, me reconduit au salon, qu’il ferme après lui ; et, comptant sur le moyen qui lui avait déjà si bien réussi, il reprend sur ma bouche les baisers de feu qu’il vient d’y déposer. Pour cette fois, je n’y suis plus ; mon égarement est à son comble : je me laisse tomber sur lui, il me soulève doucement, et me renverse sur un sopha ; déjà mon mouchoir a disparu de dessus mon cou ; déjà ses yeux perçants ont dévoré mes autres charmes ; et bientôt l’Amour me décoche le trait que Richeville est chargé de diriger. Oubli du monde entier ! ô volupté des sens ! avec quelle ardeur je savourai tes délices ! combien de fois je crus expirer dans les bras de l’auteur de mes plaisirs ! Vils assassins, qui osâtes assouvir sur moi votre passion féroce, ah ! l’Amour m’a bien vengée, ce jour-là, de votre brutalité !
Quand je fus revenue de mon extase, j’étais si honteuse que je n’osais pas lever les yeux sur Richeville ; mais il me fit tant de caresses, il me dit tant de belles choses pour justifier ma faiblesse, que je cessai bientôt d’en rougir, pour donner un libre cours aux épanchements d’un cœur tendrement affecté.
Un an s’était écoulé dans les divertissements de toute espèce qu’il m’avait procurés ; j’étais loin de m’attendre que mon bonheur dût bientôt cesser, quand un événement imprévu vint le détruire.
Nous étions, Richeville et moi, à nous promener au Bois de Boulogne ; un jeune homme, auquel je n’avais pas trop pris garde, s’était déjà arrêté plusieurs fois pour nous examiner. Fatiguée de tant d’importunités, je jetai les yeux sur lui pour tâcher de deviner ce qui pouvait attirer son attention ; mais quelle fut ma surprise, quand je reconnus Joseph, le frère de l’infortuné Georges ! Je n’essayerai pas de peindre l’effroi que me causa cette étonnante apparition ; ce qui me surprend, c’est d’avoir pu conserver l’apparence du sang-froid, dans une circonstance aussi embarrassante. J’engageai Richeville à rentrer chez lui, et pour le déterminer à hâter notre retour, je lui dis que j’avais donné rendez-vous à une marchande, qui sûrement m’attendait déjà. Pendant ce temps, j’examinais Joseph, pour savoir ce qu’il allait devenir ; il nous suivit jusqu’à la porte du bois. En montant en voiture, j’ordonnai au laquais de dire au cocher d’aller grand train, parce que nous étions pressés d’arriver. Je voulais, par ce moyen, empêcher Joseph de nous suivre, et lui laisser ignorer, s’il était possible, le lieu que j’habitais. Je ne sais s’il courut aussi vite que la voiture, ou s’il mit sur-le-champ du monde à ma poursuite ; mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’il sut ma demeure.
J’étais à peine rentrée, qu’un tremblement soudain s’empara de tous mes membres ; je fus obligée de me jeter sur un canapé où je restai évanouie. Cet état de faiblesse fut long ; cependant je revins à moi, mais je conservai, pendant quelques heures, un étouffement qui me fit beaucoup souffrir. Dès que Richeville me vit mieux, il voulut savoir la cause de cet accident ; je la lui appris, en lui observant que je ne l’en avais point instruit dans le bois, pour ne pas lui donner d’inquiétude à mon sujet. Nous reconnûmes alors que j’avais commis une grande imprudence en me montrant si souvent en public, et il fut convenu que je ne paraîtrais plus, qu’il n’y eût certitude que je pourrais le faire sans danger.
Je me couchai de bonne heure ; mais il me fut impossible de dormir un seul instant, tant je fus agitée. Je craignais que Joseph ne connût la maison que j’habitais, et qu’il me fût impossible de lui échapper. Hélas ! j’avais bien raison ; car, dès le lendemain, on remit au portier une lettre à mon adresse. Je ne pus pas douter qu’elle fût de lui ; je l’ouvris en tremblant. Elle était ainsi conçue :
« Quoique vous ayez paru méconnaître hier le frère de Georges, il est trop sûr d’avoir été reconnu pour n’être pas piqué de l’insulte qu’il a reçue. Il désire cependant avoir un entretien particulier avec vous sur l’événement qui a mis le deuil dans sa famille et donné la mort à votre oncle.
« P. S. — Le domestique qui vous porte ce billet retournera demain à huit heures du matin chercher votre réponse. »
Quand j’eus achevé la lecture de cette lettre, un torrent de larmes s’échappa de mes yeux.
— Hélas ! me dis-je en soupirant, mon oncle n’est plus ; c’est peut-être à cause de moi qu’il est mort, et je ne puis cependant me reprocher sa perte.
Comme j’allais rêver au parti qui me restait à prendre, Richeville entra, je lui donnai à lire l’écrit de Joseph.
— Il n’y a pas à balancer, me dit-il, ma chère, il faut changer de demeure ; je vais, à l’instant même, vous retenir un appartement le plus près d’ici qu’il me sera possible, et dès ce soir vous vous y installerez.
Je le remerciai bien sincèrement de tant de complaisance, et il me tint parole ; je couchai ce jour-là même dans mon nouveau logement.
On a bien raison de dire que l’imagination fait tout : je l’éprouvai, car je fus à peine dans cet appartement, que m’y croyant plus en sûreté, je n’eus plus la moindre inquiétude.
Richeville, qui m’y avait accompagnée, me dit, en se retirant, qu’il serait deux ou trois jours sans me venir voir, pour que, dans le cas où on l’épierait, on ne pût pas découvrir l’endroit où je m’étais retirée.
J’y restai donc seule avec une femme qu’il me donna pour me servir.
Le lendemain matin on vint frapper à la porte ; j’hésitai quelque temps à faire ouvrir ; cependant, n’ayant pas le moindre soupçon sur Joseph, qui ne pouvait pas encore, selon moi, être parvenu à me retrouver, je fis entrer. Mais, oh ciel ! quel fut mon étonnement, quand je le vis, avec un inconnu, se précipiter dans l’appartement.
— Mademoiselle, me dit-il, il ne s’agit pas de fuir un éclaircissement qui m’est nécessaire ; vous pouvez vous expliquer devant monsieur, qui est homme de loi, et que j’ai amené ici pour recevoir votre déclaration. Il importe à ma famille et à moi de savoir ce qu’est devenu mon frère, et vous seule êtes en état de m’en donner des nouvelles.
Ce début m’intimida d’abord, et je fus un peu déconcertée ; cependant, en me recueillant sur ce que j’avais à répondre, la persuasion de mon innocence me rendit le courage ; d’ailleurs, je me doutai bien qu’il n’était point instruit du sort de son frère, parce qu’il était présumable que ses assassins avaient fait disparaître toutes les traces de sa mort. D’après ce petit raisonnement, je crus pouvoir arranger une fable qui, sans faire grand tort à la mémoire de Georges, me sauva le désagrément de redire de tristes vérités qui auraient pu me compromettre ; et voici comme je m’y pris :
— Il est bien cruel pour moi, messieurs, leur dis-je, d’être obligée de renouveler le souvenir de ma douleur et de n’avoir d’autre moyen de justification devant vous, que d’avouer ma faiblesse pour le plus perfide des hommes ; je sens que je me dois cet aveu, quoiqu’il m’en coûte, et vous allez juger si je ne suis pas moins condamnable qu’à plaindre.
Georges, comme vous avez pu vous en apercevoir, mon cher Joseph, pendant que nous étions chez mon oncle, devint amoureux de moi ; je l’aimai véritablement, et, de bonne foi, je me sentais disposée à lui en donner toutes les preuves qu’il exigerait. Il avait préparé de loin le plan d’évasion qu’il méditait, et nous profitâmes de votre absence et de celle de mon oncle pour venir ici. Il y avait près d’un mois que nous y étions, quand il fit connaissance d’une Anglaise, dont il obtint les faveurs, et, sans s’embarrasser de ce que je deviendrais, il m’abandonna pour passer en Angleterre avec elle. C’est ainsi qu’après m’avoir tout fait quitter pour le suivre, le cruel m’exposa aux tourments de la misère et du désespoir.
Joseph parut touché de mes prétendus malheurs.
— Ma pauvre Amélie, me dit-il, en se jetant à mon cou, que je vous plains ! je n’aurais jamais cru mon frère assez peu délicat, pour se conduire ainsi. Et comment avez-vous vécu ? comment vivez-vous à présent ?
— Réduite à la plus affreuse misère, par l’abandon de cet ingrat, et n’ayant point osé retourner dans mon pays, après la conduite peu sage que j’avais tenue, j’ai, par le plus grand hasard, eu le bonheur de rencontrer un homme honnête et compatissant qui, touché de ma triste situation, a eu la bonté de m’adopter et de me traiter comme sa propre fille. Je ne puis vous donner d’autres éclaircissements, et je vous prie de vous retirer, car je ne suis point chez moi ; je craindrais que votre présence ici ne m’occasionnât des désagréments.
Je m’aperçus que cette histoire avait produit un grand effet sur Joseph ; mais j’étais loin de soupçonner l’étrange changement qui s’opérait en lui.
— Je ne puis plus me séparer de vous, me dit-il, ma chère petite sœur, je veux réparer tous les torts de mon frère : vous êtes libre ; venez demeurer avec moi, nous serons parfaitement heureux.
Je lui observai que tout s’opposait à l’exécution de ce projet ; que mes liaisons avec son frère étaient un obstacle invincible à notre réunion ; que je ne pouvais le suivre sans offenser les mœurs et me rendre criminelle (car je voulais qu’il me crût des principes) : tout fut inutile ; une passion subite enflamma son esprit ; il me déclara que rien ne lui coûterait pour en venir à ses fins ; que c’était à tort que je cherchais des excuses pour ne pas me rendre à ses désirs. J’étais seule alors ; ma domestique venait de sortir, et le confident de Joseph, qu’un signe de ce dernier avait fait disparaître, sans que je me doutasse de ses desseins, m’avait laissée à la merci du frère de mon malheureux amant : il court vers la porte, met les verrous, revient, me prend dans ses bras, et me couvre de baisers enflammés, dont l’ardeur pénètre malgré moi dans mes veines. En vain je veux lui résister ; un bras nerveux, dont il me ceint le corps, suffit pour m’étendre sur le lit, où mon vainqueur s’élance ; et bientôt, plus fortuné que son frère, il jouit d’un bonheur que Georges n’avait fait qu’entrevoir.
Nous en étions là de cet exploit, lorsque nous entendîmes un bruit épouvantable à la porte de mon appartement. Nous sautons en bas du lit, et pendant que Joseph se rajuste de son mieux, je m’avance du côté de la première porte, et je prête l’oreille pour connaître, s’il est possible, la cause de cet esclandre. Qu’entends-je ? oh ciel ! malheureuse Amélie ! Richeville, furieux de ne pouvoir entrer, et ma domestique essayant en vain d’ouvrir la porte, dont le verrou nous répondait.
— Voyez, dis-je à l’imprudent Joseph, à quoi votre aveugle passion vient de m’exposer ? que vais-je devenir ? et vous-même, comment allez-vous vous tirer de ce mauvais pas ?
J’ignorais l’effet que produirait cette aventure sur l’esprit de mon amant ; car je ne voyais nul moyen de lui prouver que je lui fusse restée fidèle. Joseph tremblait de toutes ses forces, et me suppliait de le cacher pour le dérober aux vengeances d’un homme qui, sans doute, ne l’épargnerait pas.
Peu rassurée moi-même, mais obligée de prendre un parti quelconque, je fis entrer mon trembleur dans une armoire pratiquée dans le mur, et j’en mis la clé dans ma poche ; mais trop effrayée sans doute pour prendre les précautions qui étaient indispensables, j’oubliai de réparer le désordre du lit et de ma toilette, témoins muets, mais suffisants, pour attester ma faute. Je fus donc ouvrir les verrous, et Richeville et sa suivante entrèrent, bien étonnés de ne trouver que moi dans l’appartement.
— Pourquoi donc, me dit-il, nous faites-vous attendre si longtemps, et qu’avez-vous à craindre pour vous enfermer avec tant de précaution ?
Et tout en me parlant, il jetait sur moi, et par tout l’appartement, des yeux inquiets, que ma rougeur et mon embarras enflammèrent de courroux. Ce n’est plus un homme, c’est un forcené dont on ne peut maîtriser la rage. En vain je veux faire entendre quelques mots pour ma justification, il ne m’écoute pas, et m’ordonne de lui livrer le traître qui a violé l’asile qu’il m’avait accordé contre une prétendue persécution, que je n’ai imaginée, selon lui, que pour jouir plus tranquillement du fruit de sa complaisance et de son fol amour pour moi. Je me jette à ses pieds, je le conjure de calmer les transports qui l’agitent, et de m’entendre avant de me juger coupable ; ma position suppliante le désarme ; il s’assied et m’écoute :
— Qui peut donc causer le trouble effrayant où je vous vois, lui demandai-je, en m’approchant de lui, pour l’apaiser plus sûrement par des caresses qu’il repousse ? Quel rapport alarmant a-t-on pu vous faire sur mon compte, et ne suis-je plus digne de la tendresse que vous m’avez vouée ?
— Il vous sied bien, ingrate, me répondit-il avec dédain, de me tenir un pareil langage, à vous, qui me payez de mes bienfaits par la plus noire perfidie ! Où est ce prétendu frère de Georges, qui venait, m’aviez-vous dit, la vengeance à la main, vous demander compte des destins de son frère ? Où est-il, que je lui fasse passer l’envie d’aller désormais en bonne fortune ?
Cette menace fut accompagnée d’un geste qui me fit trembler pour les jours de Joseph, s’il était découvert ; car il sortit de sa poche une paire de pistolets dont il me parut disposé à faire usage. Je protestai de mon innocence, et l’assurai que j’étais seule ; que si je m’étais enfermée aux verrous, c’était dans la crainte que Joseph, profitant de l’absence de ma domestique, ne revînt à la charge, et que je croyais que c’était lui qui reparaissait, quand j’avais laissé si longtemps frapper à la porte ; qu’il pouvait, au surplus, visiter mon appartement, pour s’assurer de la vérité de ce que je lui disais.
Il se contentait de cette explication, et j’allais en être quitte pour la peur, quand ma maudite servante entra dans ma chambre à coucher ; elle soutint que j’en imposais par ma fermeté, et que ma défense était un tissu de mensonges ; qu’elle n’était sortie pour avertir M. Richeville que lorsque l’ami de Joseph m’avait laissée seule avec lui, et qu’à la manière dont mon lit et mes cheveux étaient dérangés, il était facile de voir que je n’avais pas été aussi sage que je le prétendais.
Je convins qu’effectivement ce jeune homme avait voulu profiter de l’occasion que l’absence de ma dénonciatrice lui fournissait, pour obtenir quelques faveurs ; mais que ma reconnaissance et mon amour pour Richeville m’avaient prêté assez de force pour les lui refuser.
— À votre place, reprit cette mégère, je ferais la visite la plus stricte de l’appartement, et je suis sûre qu’elle ne serait pas infructueuse.
L’avis est trouvé bon, et voilà mon homme qui se met en devoir de faire la recherche qu’on lui conseille. Il regarde d’abord sous le lit, et passe ensuite avec elle dans un petit salon, qui, heureusement, n’avait qu’une porte sur ma chambre à coucher. Ils y sont à peine entrés, que je ne balance pas sur le parti qui me reste : je les y enferme, et je cours délivrer le trop heureux Joseph des frayeurs dont il avait failli périr dans son étroite prison.
Quand je crus lui avoir donné assez de temps pour être dans la rue, je revins ouvrir la porte du salon, où le couple que j’y avais consigné chantait à ma louange le plus joli duo du monde. Richeville fond sur moi, et me menace de me rendre victime de ma trahison. Loin de m’épouvanter de sa fureur, je Je regarde fièrement, et lui demande de quel droit il prétend m’avoir fait son esclave, s’il ne croit pas ce qu’il appelle des bienfaits assez payés par ma complaisance sans bornes pour lui, et s’il espère m’ôter jusqu’à la liberté d’y renoncer ?
— Non, me dit-il, mademoiselle, je n’ai pas ce pouvoir, et pour vous le prouver, je vous déclare que dès ce moment, il n’y a plus rien de commun entre nous ; vous êtes bien maîtresse de disposer de vous comme vous le jugerez à propos.
Il ne m’en dit pas davantage, et sortit en me laissant seule avec la méchante femme qui m’avait attiré cette scène.
Trop fière pour m’abaisser jusqu’à vouloir connaître les motifs de sa conduite, je ne lui fis pas l’honneur de lui adresser un mot. Mon mépris pour elle fut si profond, qu’il m’aurait été impossible de lui faire le moindre reproche.
Trop sensible pour n’être pas piquée du ton absolu que Richeville avait pris avec moi, je m’interdis toutes réflexions sur ce que j’allais devenir en le quittant. J’étais bien persuadée qu’il m’aimait assez pour me retenir chez lui, si je voulais faire quelques avances pour y rester ; mais je m’occupai sur-le-champ des moyens d’abandonner un homme que son courroux, peut-être légitime, mais molestant pour moi, venait de me rendre odieux.
Je regrettai fort de ne pas savoir où trouver Joseph ; car, d’après ce qui s’était passé entre nous, je me sentais décidée à accepter la proposition qu’il m’avait faite d’aller vivre avec lui ; mais je désespérai de le revoir, par la seule raison que je le savais trop peureux pour revenir dans une maison d’où il était échappé par une espèce de miracle, et où il pouvait croire que j’étais restée.
À peine Richeville fût-il dehors, que je m’empressai de recueillir tout ce que j’avais reçu de sa libéralité, en linge, hardes, bijoux et argent ; j’enfermai le tout bien soigneusement, et je sortis pour louer un petit appartement.
Chemin faisant, il me vint dans l’idée d’aller faire visite à une jeune personne, nommée Victoire, que j’avais eu occasion de voir souvent chez Richeville, parce qu’elle avait été entretenue par un de ses parents qui l’avait quittée depuis quelques mois. Je lui appris l’événement fâcheux qui m’arrivait ; elle y parut sensible, et l’air de vérité que je crus apercevoir en elle, redoubla l’affection que je lui portais ; mais on va voir dans quelle erreur grossière j’étais tombée à son égard, et ce qu’il m’en a coûté pour m’être trop facilement livrée aux mouvements de mon cœur, pour la plus scélérate de toutes les femmes.
Je lui fis part de l’intention où j’étais de me loger dans son quartier, pour être plus à portée de la voir, et de cultiver sa connaissance. J’eus aussi l’indiscrétion de lui parler d’une somme assez considérable que j’avais en ma possession. Elle connaissait une grande partie de ma garde-robe, et n’ignorait pas que j’avais été une des femmes les mieux entretenues de la ville. Il faut croire que ma petite fortune la tenta ; car, pour réussir dans son projet, elle fit usage d’un moyen qui devait d’autant mieux la servir, qu’il augmentait ma confiance, en paraissant m’indiquer le degré d’attachement qu’elle avait pour moi. Elle se jette à mon cou les larmes aux yeux, et me dit qu’elle ne souffrira pas que j’aille m’exposer à périr d’ennui dans la solitude où j’ai dessein de me retirer : elle veut absolument que je dispose d’une partie de son logement, et me promet de me faire trouver l’oubli de mes peines, dans les douceurs de l’amitié la plus tendre.
Je ne puis exprimer le plaisir que me fit l’offre consolante de cette généreuse amie. Trop pleine de ma reconnaissance, je ne pus lui répondre ; mais les pleurs de joie dont je mouillai son visage en l’embrassant, pour la remercier, durent lui faire assez connaître combien j’avais été touchée de l’honnêteté de son procédé.
Dès le lendemain matin, je fis faire mon déménagement, et il n’était pas encore nuit, que j’étais déjà chez elle.
Pendant le premier mois, je n’eus qu’à me louer de la manière dont je fus traitée. Soins, prévenances, elle ne négligea rien pour me captiver ; nous étions d’ailleurs du même âge, nous avions presque les mêmes goûts, et je ne refusais jamais les parties de plaisir qu’elle me proposait ; aussi ce premier mois fut-il employé en divertissements de toute espèce.
Victoire avait depuis quelque temps un nouvel amant que je ne lui connaissais pas ; il pouvait avoir trente ans, grossièrement tourné, mais assez bien de figure, bavard à l’excès, superficiel, parlant de tout, sans avoir jamais rien approfondi, et voulant paraître fort instruit, quoiqu’au fond très ignorant. Il avait été autrefois dans la pratique, puis il s’était fait commis ; mais ses appointements ne suffisant point à la dépense qu’il faisait, il était sur les crochets de cette amie qui, pour prix de son amour et des soins qu’elle lui prodiguait, n’en recevait souvent que dédains et mortifications. Cependant, avec tous ses défauts, elle l’aimait éperdument, et aurait tout sacrifié à l’avantage de le conserver. Je ne pouvais pas concevoir cette aveugle frénésie ; il me semblait extravagant de prodiguer tant d’amour à un être qui s’en montrait si peu digne ; et pour moi, il m’eut été impossible de nourrir dans mon cœur une flamme qui n’aurait pas embrasé celui qui l’y aurait fait naître.
Ce singulier galant était toujours de nos parties, et ne voulait jamais souffrir qu’on y admît d’autres hommes que lui, malgré les propositions que faisait souvent sa maîtresse, de me donner un cavalier, pour faire, à ce qu’elle disait, partie carrée ; mais plutôt de peur que trop d’occasions de se trouver seul, ou presque seul avec moi, ne lui inspirassent le désir de m’en conter à ses dépens. On va voir quels étaient les motifs de l’obstination de l’amant, et si les craintes de Victoire étaient fondées.
Je ne m’étais point encore trouvée en tête-à-tête avec lui ; je ne pouvais donc pas connaître ses véritables intentions à mon égard. Il s’était bien quelquefois, en présence de sa maîtresse, permis avec moi des libertés que j’avais toujours su réprimer ; mais cela n’indiquait pas assez clairement qu’il eût jeté des vues sur moi. Il ne lui était pourtant pas difficile de me rencontrer seule à la maison ; Victoire s’en absentait des heures entières, et j’ai souvent remarqué que ce n’était pas par excès de fidélité ; car ces sorties avaient toujours lieu le matin, quand elle était bien sûr que Lechesne (c’est ainsi qu’on appelait son ami) ne pouvait venir : son emploi le retenait presque toute la matinée, et elle comptait un peu sur cette espèce de servitude, pour se permettre des passades lucratives, que quelques femmes charitables se faisaient un devoir de lui procurer.
Un jour cependant qu’elle était sortie, il vint vers dix heures du matin. Je présume qu’il savait qu’il me trouverait seule ; j’étais encore couchée. Il entra dans ma chambre. J’avoue que ce ne fut pas sans crainte que je l’y souffris ; mais quand j’aurais voulu l’obliger de sortir et de passer dans une autre pièce, pour attendre sa maîtresse, cela eut été inutile, parce que je vis bien qu’il ne m’aurait pas obéi.
Il me fit quelques compliments, vint s’asseoir auprès de mon lit, et sans autre cérémonie, le téméraire glissa sa main sous le drap, me prît la gorge, et s’empara d’une de mes mains, qu’il baisa malgré mes efforts pour l’en empêcher. Je le repoussai brusquement, et m’enveloppai de manière à augmenter les difficultés de l’entreprise, mais ce fut en vain ; car, dès qu’il s’en aperçut, il se leva, et je me trouvai bientôt sans drap ni couverture. Profitant de cet avantage, il s’élance sur le lit pour se saisir de moi ; au mouvement que je lui vois faire, je suis bientôt debout, et dans l’instant où il veut me serrer dans ses bras, furieuse, je lui passe les miens autour du cou ; nous nous tenons quelques instants dans cette posture ; mais enfin, un effort pour me faire tomber sur le lit, un autre de ma part pour lui résister, nous entraînent tous les deux et nous précipitent en bas du lit. Heureusement qu’il eut le dessous dans cette catastrophe ; je ne me fis aucun mal en tombant sur lui, et le malheureux reçut à la tête une blessure qu’à tous égards il avait bien méritée. Cette chute me débarrassa d’un adversaire opiniâtre, qui commençait à se faire redouter.
Je ne voulais cependant pas jouer la prude dans cette circonstance ; je l’aurais même été de bonne foi, qu’on ne voudrait pas me croire ; mais deux fortes raisons m’empêchaient de me rendre à ses désirs ; d’abord, c’est que je ne me sentais aucun goût pour lui ; et, en second lieu, que mon amitié pour Victoire, à laquelle c’eût été manquer trop essentiellement, ne m’aurait jamais fait consentir à lui accorder la moindre faveur.
Au bruit que nous fîmes en tombant, la domestique accourut et me trouva occupée à donner des soins à ce jeune homme qui s’était évanoui. En me voyant aussi lestement vêtue, cette fille s’imagina, sans doute, qu’il avait été l’homme du monde le plus heureux, tandis que la blessure qu’il s’était faite, était tout le fruit, bien amer, qu’il avait recueilli de ses peines. Dans le moment, je m’inquiétai fort peu de ce qu’elle pouvait penser ; je ne songeai qu’à le rappeler à la vie ; mais, par réflexion, je craignis qu’elle ne m’accusât, auprès de sa maîtresse, d’avoir trahi l’amitié ; je fis tout ce qui dépendit de moi pour l’obliger à se taire, et Lechesne parvint à lui persuader qu’il ne s’était rien passé entre nous, en lui racontant l’événement comme il était arrivé.
Pendant le récit de cette scène, j’avais eu soin de me remettre au lit. Je m’attendais à quelques reproches ; il me les fit assez tranquillement, mais d’un air qui ne me laissa que trop apercevoir qu’il était vivement piqué contre moi ; il sortit aussitôt, me laissant livrée à mille réflexions sur les suites de cet accident.
Bientôt après, Victoire rentra ; le calme parfait qui régnait alors dans la maison ne lui fit rien soupçonner de ce qui s’y était passé ; ce ne fut qu’à l’heure du dîner, quand elle ne vit point venir son ami, qu’elle manifesta quelques inquiétudes ; elle envoya chez lui pour savoir ce qui causait ce retard ; il lui fit dire qu’il s’était, en tombant, fait à la tête une légère blessure qui l’obligeait de garder la chambre ; qu’il espérait que deux ou trois jours suffiraient pour sa guérison.
Après dîner, Victoire me témoigna le désir de l’aller voir, et me proposa de l’accompagner ; j’étais fort embarrassée pour lui répondre, je craignais d’éveiller ses soupçons en refusant tout net, et je redoutais de paraître chez celui que j’avais si maltraité sans le vouloir. Cependant, pour ne pas la contrarier, je promis dès qu’elle renouvela ses instances.
Il est aisé de se faire une idée de la manière dont je fus reçue ; son étonnement ne pourrait se rendre : il ignorait que j’eusse cédé aux sollicitations de mon amie, et pouvait croire que je n’étais allée chez lui que pour jouir de mon triomphe, et l’insulter dans sa défaite ; je crois même qu’il n’eut que cette dernière idée, parce que, dès ce moment, il me voua une haine implacable. Je ne conçois pas comment Victoire, qui le voyait ordinairement libre, gai, et aux petits soins avec moi, ne s’aperçut pas de l’air froid qu’il me marquait. La contrainte que j’avais éprouvée dans cette première visite m’en fit craindre une seconde ; le lendemain, je feignis une migraine pour m’en exempter ; le troisième jour on ne m’en parla plus, et je fus insensiblement délivrée de cette gêne, qui était devenue une sorte de tourment pour moi.
Au bout de huit jours, l’amant reparut, bien guéri, bien dispos, et en état de reprendre son plan d’attaque ; mais celui qu’il avait formé était bien loin de ma pensée : c’était à tort que je croyais qu’il pourrait se flatter de me trouver plus sensible, après ce que je lui avais coûté de peine et de souffrance. Il affecta, au contraire, de me regarder avec dédain, de ne jamais m’adresser la parole, et ce mépris fut si marqué, que, cette fois, Victoire ne put douter qu’il y eût quelque chose d’extraordinaire. Elle voulut en savoir les raisons, et le forcer de s’expliquer ; mais ce fut inutilement qu’elle employa prières et caresses ; il persista dans son refus. Quant à moi, je parus en ignorer absolument les motifs, et n’eus point l’air d’être offensée de son procédé.
Il était à peine sorti de l’appartement, que Victoire me conjura de lui expliquer ce mystère. Je m’y refusai d’abord, parce que je sentais bien tout ce qui allait résulter de mon aveu, et que je ne voulais pas me donner l’odieux de les avoir désunis par une indiscrétion ; mais, pour m’arracher mon secret, elle me menaça de me retirer son amitié ; il n’en fallut pas davantage ; je lui fis une confidence dont j’eus bientôt lieu de me repentir.
Cruellement affectée de voir ses soupçons éclaircis, elle dissimula cependant assez bien ses véritables sentiments, pour ne pas trop le paraître ; ce ne fut que le lendemain, quand Lechesne revint, qu’elle ne put se contenir. Ils eurent une explication très vive, à laquelle je n’assistai point, parce que, dès que je vis que la conversation s’échauffait, j’eus l’attention de me retirer dans ma chambre, et de ne reparaître que quand il fut parti.
Victoire me répéta toute leur conversation, et me dit qu’il exigeait que je sortisse de la maison, ou qu’il n’y remettrait plus les pieds ; mais qu’elle lui avait répondu, sur ce dernier point, de manière à lui faire comprendre qu’elle préférait me conserver. Persuadée du contraire, je voulais absolument qu’elle consentît à ce que je m’éloignasse ; mais quelques raisons que je pusse lui donner, il me fut impossible de les lui faire entendre. Je pris toutefois mon parti, parce qu’il n’était pas naturel qu’elle se contraignît au point de paraître, vis-à-vis de moi, brouillée avec un homme qu’elle chérissait au delà de l’imagination. Cependant, à dire vrai, je me trouvais un peu embarrassée dans le choix des moyens que j’employerais pour la forcer de me laisser partir ; car, en entrant chez elle, je l’avais fait dépositaire de tout ce que je possédais, et j’avais de la peine à prendre sur moi de lui en demander la restitution. Il fallait bien en venir là, si je persistais dans mon dessein, et je sentais parfaitement que, par beaucoup de raisons, je ne pouvais pas m’en dispenser. Je laissai néanmoins écouler quelques jours, pour voir comment les choses tourneraient. Lechesne ne reparut point. Victoire me confia qu’elle avait entièrement rompu avec lui : elle me dit même que depuis longtemps elle désirait cette séparation, parce que cet homme commençait à lui devenir à charge, et prenait chez elle un ton d’autorité auquel, à tous égards, il n’avait pas droit de prétendre : que rien ne s’opposant plus à ce que je continuasse de rester avec elle, elle m’engageait, au nom de la plus tendre amitié, de ne pas l’abandonner. J’eus la bonhomie de croire à la sincérité de ses démonstrations, et je me déterminai, de bonne grâce, à faire ce qu’elle paraissait tant désirer.
Cette absence de l’amant, ce sacrifice apparent de la maîtresse en ma faveur, tout cela n’était qu’une feinte, pour pouvoir plus aisément me faire donner dans le piège qu’on me tendait et dont je ne m’aperçus pas.
Depuis que Lechesne ne paraissait point à la maison, Victoire, plus libre, ne s’y conduisait pas de la même manière. Elle ne se bornait plus à ses courses du matin : il lui arrivait souvent de sortir seule le soir, et de rentrer, peu de temps après, avec un homme inconnu, qui la suivait dans sa chambre, où on devine aisément ce qui se passait.
Je ne tardai pas à me dégoûter de ce genre de vie, et je m’en expliquai amicalement avec elle. Ma franchise lui déplut ; elle mit de l’aigreur dans ses observations ; je m’emportai ; nous oubliâmes insensiblement que nous étions amies, pour nous livrer aux transports de la passion qui nous guidait.
Dans un mouvement de colère, je lui dis que je voulais absolument la quitter, et qu’elle eût à me remettre, à l’instant, l’argent, les bijoux et les hardes que j’avais apportés chez elle, offrant de lui payer, comme il était naturel de le faire, les frais que je pouvais lui avoir occasionnés, par mon séjour dans sa maison.
Elle se mit à rire, et parut peu disposée à satisfaire à ma demande. J’insistai cependant ; et, forcée de me répondre, elle eut l’impudence de me dire qu’elle était surprise de mes réclamations, et qu’il fallait sans doute que je fusse devenue folle pour lui en faire de pareilles ; qu’elle n’avait jamais rien eu à moi, et me priait de ne plus lui en reparler.
Je l’avouerai, la foudre tombée à mes pieds m’eut moins atterrée que sa réponse. Je conservai pourtant assez de présence d’esprit pour lui reprocher, de sang-froid, la noirceur de son procédé, et pour lui faire sentir toute son injustice ; mais après m’avoir écoutée patiemment pendant quelque temps, lassée d’entendre des vérités dures, elle me laissa seule et se retira dans sa chambre : je l’y suivis, bien déterminée à ne la laisser en repos que lorsque je l’aurais trouvée plus raisonnable. Elle feignit enfin de se rendre à mes sollicitations ; m’allégua différentes raisons pour m’engager à cesser mes importunités, et me promit que le lendemain ne se passerait pas, sans que tout fût terminé entre nous.
Il fallut bien se résoudre à lui accorder le délai qu’elle exigeait ; j’y consentis, d’ailleurs, d’autant plus volontiers, que je crus qu’il lui était nécessaire pour lui donner le temps de remplacer ce dont elle avait pu faire usage ; car je ne pouvais pas me persuader qu’elle eût réellement l’intention de me voler.
Le lendemain, elle sortit de très bonne heure, et ne rentra point de la journée. J’augurai bien de cette absence, qui semblait me confirmer dans l’idée, que j’avais eue la veille, qu’elle s’occupait de moi. Il était nuit quand, à mon grand étonnement, elle revint avec l’inséparable Lechesne, suivi de deux hommes, dont la tournure sinistre n’annonçait rien de bon.
J’avais attendu son retour avec tant d’impatience, que je lui laissai à peine le temps de se reposer, et je profitai d’un moment où elle passa seule dans une autre pièce, pour lui rappeler la parole qu’elle m’avait donnée. Elle me dit qu’ayant été obligée d’employer, à des besoins pressants, l’argent que je lui avais confié, elle avait fait beaucoup de démarches pour se le procurer ; et qu’enfin elle y était parvenue, par l’entremise des personnes qu’elle venait d’amener avec elle ; mais que l’ami qui lui faisait ce prêt ne pourrait être en état de l’effectuer qu’à huit heures du soir, parce qu’il fallait qu’il fit lui-même quelques recettes pour le compléter ; qu’il avait donné rendez-vous chez lui pour cette heure, et que ne voulant pas s’exposer en sortant si tard, elle me priait de l’y accompagner. L’envie de terminer avec cette femme, et d’avoir mon argent, m’empêcha de faire aucune réflexion sur la singularité de cette proposition. En effet, qu’avais-je besoin de me mêler de ses affaires ? Ne valait-il pas mieux en attendre la réussite tranquillement à la maison ? C’est ce que j’aurais dû faire, et ce que, malheureusement, je ne fis pas.
À sept heures et demie, on fit venir une voiture de place ; Victoire et moi nous y montâmes, avec Lechesne et les deux hommes qui l’avaient accompagnée. L’ordre fut donné au cocher sans que je m’en aperçusse. Il nous conduisit à l’une des extrémités de la ville, dans un quartier qui m’était tout à fait inconnu. La voiture s’arrêta devant une maison à porte cochère ; je crus que c’était là que nous allions entrer, et comme on ouvrit la portière de mon côté, Lechesne en sortit avec précipitation, et me donna la main pour descendre. Nous en étions à peine dehors, que la voiture partit et disparut bientôt à mes yeux.
Restée seule avec ce gredin, dans une rue déserte, où on n’apercevait pas même une lumière, une terreur subite s’empara de tous mes sens ; je voulus parler, mais inutilement, il me fut impossible d’articuler un seul mot ; mais j’entendis très clairement ce qu’il était chargé de me dire de la part de l’infâme Victoire : elle me répétait qu’elle n’avait rien à moi, et me défendait très expressément de remettre les pieds chez elle, à moins que je ne voulusse m’en faire chasser ignominieusement. Il me parlait en fuyant, et je n’avais pas encore retrouvé l’usage de la parole, qu’il était déjà bien loin.
Épouvantée du coup qui venait de m’accabler ; indignée du procédé de l’abominable femme qui avait si cruellement abusé de ma crédulité, et révoltée de la scélératesse du monstre, qui n’avait que trop bien secondé son coupable dessein, mille idées confuses me passaient par la tête, sans que mon esprit incertain pût se fixer sur le parti que j’avais à prendre : mes yeux s’arrêtaient indistinctement sur tous les objets qui les frappaient, sans en distinguer aucun ; enfin, je sentis que je n’étais pas loin du mur, et reprenant, par degrés, mes sens, je parvins à gagner le bout de la rue, en tâtonnant mon chemin.
Quand je fus à cet endroit, j’aperçus quelques boutiques encore ouvertes, et je commençai à me rassurer un peu ; mais il était temps que j’y arrivasse ; car à peine revenue de mon saisissement, mes jambes fléchirent sous moi, et je n’eus que le temps de m’asseoir sur une borne, qui se trouva là fort à propos, pour m’empêcher de tomber.
Ma position terrible me fournissait une ample matière à réfléchir. Il me vint d’abord dans l’idée de prendre un fiacre et de me faire reconduire chez Victoire ; mais en me rappelant les adieux de son émissaire, je n’eus pas de peine à me persuader que je n’en obtiendrais rien, et je craignais qu’en voulant y rentrer de force, on ne me fit arrêter et mener en prison, parce qu’à coup sûr elle aurait feint de ne pas me connaître, et m’aurait fait passer pour une aventurière : je crus donc entrevoir qu’il n’était pas prudent de s’exposer à ce danger ; j’avais bien assez de mon malheur présent, sans courir encore les risques de l’accroître.
Il ne me restait qu’à chercher un abri pour la nuit, et de remettre au lendemain à aviser aux moyens de réparer mes pertes, ou du moins d’adoucir la rigueur du sort dans lequel ma fatale destinée venait de me plonger ; car il est bon de savoir que je n’avais qu’un louis en or et un peu de monnaie ; et qu’avec une somme si modique, on ne va pas ordinairement bien loin.
Je m’adressai donc à la première boutique, et je priai une dame que j’y trouvai, de m’indiquer une maison garnie où je pusse aller coucher. Elle eut l’honnêteté de sortir et de me montrer une rue, où elle me dit que je trouverais ce que je cherchais. Effectivement, je ne m’adressai qu’à une seule personne qui me conduisit à cette maison tant désirée.
Elle était tenue par un tailleur, qui occupait la boutique ; je lui demandai s’il avait vacant un cabinet garni, et s’il voulait me le louer : il me dit que la seule chambre qui lui restât était au second étage, sur le devant ; qu’il ne pouvait la louer moins de dix-huit francs par mois, et que l’usage de sa maison était de payer quinze jours d’avance. Ce n’était pas le cas de marchander ; je lui payai ce qu’il exigeait, et je pris possession de cette chambre.
La scélératesse de Victoire était toujours présente à ma pensée : livrée à moi-même, sans apercevoir le moment qui me rendrait à la société, dont je me croyais séparée pour jamais, cette solitude me fit sentir toute l’horreur de ma situation. Ce fut là, que du fond de l’abîme, où cette indigne amie m’avait précipitée, je m’abandonnai aux plus cruelles réflexions. Incapable de gagner ma vie par aucune espèce de travail, je sentis tout le vice de mon éducation : je reconnus que l’homme, dans quelque rang que la fortune le fasse naître, doit employer ses premières années à se donner un talent qui puisse l’élever au-dessus du besoin, s’il plaît à cette inconstante déesse de lui faire éprouver ses caprices. D’un côté, la misère s’offrait, sous les traits les plus hideux, à mes regards épouvantés ; de l’autre, je ne voyais, pour toute ressource, que l’infamie ; mais quelle cruelle alternative !… Le cœur navré de douleur, l’âme abattue, un froid mortel se répandit sur tout mon corps ; je me crus seule dans l’univers ; je fondis en larmes. Ce délire des esprits faibles, le désespoir, s’empara de moi ; vingt fois je voulus me précipiter par la fenêtre : dans mon égarement, je faisais le tour de ma chambre avec autant de promptitude que si j’eusse été poursuivie. Je ne pouvais longtemps résister à tant d’agitations ; excédée de fatigues, affaiblie par tant de mouvements, je me jetai tout habillée sur le lit, pour y chercher des secours que l’impitoyable Morphée eut la cruauté de me refuser.
Quelle nuit j’y passai, ou plutôt quel supplice il m’y fallut endurer ! Non, je ne crois pas qu’il y ait de tourments qui puissent égaler ce que j’ai souffert. Il faut s’être trouvé dans une pareille circonstance, pour en concevoir l’idée. C’est en vain que je voudrais décrire cette affreuse position, je serais trop loin de mon sujet, et je craindrais d’ailleurs que le tableau, s’il était ressemblant, ne me rendît l’impression qu’elle m’a faite.
Cependant le jour venait de dissiper les ombres de la nuit : tout avait repris une forme nouvelle ; mon cœur seul conservait sa tristesse. Accablée sous le poids de mon infortune, j’essayai de descendre de ce lit de douleur, où la nuit cruelle que j’y avais passée m’avait paru un siècle ; mais je ne pus me soutenir sur mes jambes ; je fus obligée de prendre une chaise, où j’attendis que la fille vînt faire mon lit. Elle me trouva dans cet état affreux, et s’apercevant que je ne m’étais pas couchée, elle me demanda si j’étais incommodée, et si j’avais besoin de quelque chose. Je la remerciai de son attention, mais je profitai de sa bonne volonté pour m’exempter de sortir. Elle m’acheta les choses les plus nécessaires à la vie, m’offrit tous ses soins, et me laissa seule abandonnée à mes chagrins.
Je restai huit jours dans cette chambre, à me creuser la tête pour chercher les moyens d’exister, sans en trouver aucun. Je ne voulais pas m’avilir au point de mendier dans la rue les secours du premier venu, en échange de la jouissance de mes appas ; cet abaissement répugnait à ma fierté ; cependant, que pouvais-je faire pour obvier à cet inconvénient ? Manquant absolument de tout, après avoir payé si chèrement quatre mois d’existence chez Victoire, il ne me restait qu’un parti, celui de me jeter, en détournant les yeux, dans les bras de l’une de ces femmes qui savent faire valoir les appas des autres, sans leur donner le désagrément de les offrir. Je ne me dissimulai pas que le crime est toujours le même ; mais je m’aveuglai sur la honte qu’il imprime à celle qui s’en rend coupable, en croyant trouver une excuse dans la manière de le commettre.
J’imaginai que, pour me faire connaître de cette espèce de femmes, il fallait me montrer au spectacle, et que c’était là la recette infaillible ; heureusement que j’avais fait un peu de toilette, quand j’étais sortie de chez Victoire ; je n’eus besoin que de me faire coiffer, et me rendis de bonne heure aux Italiens.
À peine étais-je placée, que je vis entrer dans la loge où j’étais, une femme attirée, sans doute, par le fumet d’un gibier qu’elle chassait souvent. Je jugeai, à sa tournure, qu’elle était une de celles que je cherchais ; en effet, elle ne tarda pas à lier avec moi une conversation, qui d’abord fut très indifférente, mais qui devint bientôt plus sérieuse. Quand je l’eus assez entendue, pour ne pas me tromper sur son compte, je glissai adroitement quelques mots sur la position où je me trouvais : elle me fit entrevoir la possibilité de la changer promptement, et de me placer chez une femme qui me procurerait les moyens de regagner, en peu de temps, tout ce que j’avais perdu.
— J’ai votre affaire, me dit-elle ; dès demain matin je vous présenterai à une de mes amies, qui n’admet chez elle que des gens comme il faut ; vous y trouverez l’utile et l’agréable.
Elle me tint parole : le lendemain, elle vint me prendre et me conduisit rue de Richelieu, chez madame Dupré, son amie. Cette femme, à laquelle j’eus le bonheur de plaire, me fit l’accueil le plus flatteur, et témoigna à mon introductrice sa reconnaissance, de la préférence qu’elle lui avait donnée sur beaucoup d’autres, qui auraient été bien flattées de me recevoir. Je lui fis quelques compliments pour toute réponse, et nous convînmes de nos faits.
Le lendemain, je fus admise au nombre des sultanes qui composaient son sérail. En me présentant aux deux compagnes qu’elle allait me donner, elle nous dit qu’à présent elle était sûre que l’amour ne déserterait pas sa maison, puisqu’elle était parvenue à y réunir les trois Grâces. En effet, ces deux jeunes filles étaient infiniment jolies ; et la Dupré, pour me faire sa cour, ne cessait de me répéter que j’étais encore plus jolie qu’elles.
Quelques jours suffirent pour me lier étroitement avec ces charmantes filles ; la bonne Dupré, de son côté, fit tout ce qui dépendait d’elle pour me faire oublier Victoire et sa perfidie. Je promis de n’y plus penser, et je m’abandonnai entièrement au nouveau sentiment qu’on venait de m’inspirer. L’amitié, ce besoin du cœur, qu’on éprouve rarement entre femmes qui sont exposées aux préférences des hommes, et d’où naissent ces rivalités, source de mille désagréments, ne tarda pas à nous unir toutes les trois, et nous donna assez de philosophie pour nous rendre insensibles à ce qu’on appelle ailleurs des mortifications, et que là, nous eûmes le bon esprit de trouver naturelles, persuadées que c’est plus souvent le caprice que le bon goût, qui détermine dans ces circonstances.
Cependant, pour adoucir, autant qu’il était possible, l’espèce d’humiliation que doivent ressentir des femmes qui n’ont pas totalement rompu avec les principes, lorsqu’il faut qu’elles passent en revue devant un homme, que le désir de jouir amène dans ces sortes de maisons, la Dupré nous avait fait peindre toutes les trois : nos portraits, parfaitement ressemblants, et point du tout flattés, étaient suspendus dans le salon, où l’amateur introduit pour faire son choix, désignait à la maman celle qui lui plaisait le plus : on la faisait avertir ; elle paraissait seule, et par ce moyen notre amour-propre ne se trouvait jamais compromis. Ce sont là de ces idées heureuses, dont on doit savoir gré aux personnes qui les conçoivent, puisqu’elles servent à entretenir la paix entre gens qui ont tant d’occasions de la voir troubler.
Il n’y avait pas longtemps que la Dupré avait mis ce moyen en pratique ; nous en avions cependant déjà ressenti les heureux effets ; mais plusieurs de ses habitués, absents pendant quelque temps, ignoraient même qu’il existât. Un d’eux, entre autres, jeune homme charmant qui, depuis dix-huit mois, voyageait en Allemagne, venait d’arriver à Paris. Un de ses premiers soins fut de venir visiter notre sérail. On le fit passer dans le salon, où il vit nos portraits. Nous étions toutes les trois entrées chez la Dupré depuis que ce jeune homme n’y avait paru : par conséquent, il n’en connaissait aucune de nous. Il fut surpris, à ce qu’il dit, de la réunion de trois personnes aussi intéressantes, et après nous avoir longtemps examinées en peinture, il avoua qu’il était dans le plus grand embarras, et que jamais, restât-il deux heures à nous contempler, il ne pourrait faire un choix qui lui fît oublier celles qu’il n’aurait pas demandées : qu’il ne voyait qu’un moyen de satisfaire ses désirs, et qu’il espérait que la Dupré, en faveur de leur ancienne connaissance, se priverait, pendant toute la journée, des beautés qu’elle offrait à ses regards, puisqu’il ne pouvait se décider à donner la pomme à l’une d’elles.
La bonne ne promit rien, parce qu’elle voulait auparavant savoir si nous accepterions cette partie ; il s’agissait d’aller dîner à la campagne, trois femmes avec un seul homme ; Sophie n’était pas de cet avis, elle craignait de s’ennuyer ; l’autre ne savait trop que répondre.
— Pourquoi refuserions-nous, leur dis-je, de faire une partie qui, d’abord, j’en conviens, paraîtra bizarre ; mais qui peut aussi nous procurer beaucoup d’agrément ? N’êtes-vous pas curieuses de voir comment se tirera d’affaire, un homme assez imprudent pour faire une pareille proposition à trois femmes comme nous, qui sommes, l’une après l’autre, en état de lui tenir tête ? Pour moi, je vous avoue que je suis prête à partir, bien convaincue que celui qui se propose n’est pas un homme ordinaire ; et qu’en supposant que nous ne trouvions pas en lui toutes les ressources qu’une seule aurait le droit d’exiger de ses forces, il doit les suppléer par un fonds inépuisable d’esprit, qui nous promet au moins les charmes de la société. Allons, il n’y a pas à balancer, le temps est superbe, il faut en profiter.
On céda à mes sollicitations, et la Dupré sortit, pour rendre notre réponse, et ne demander que le temps nécessaire à nous préparer.
Quand nous parûmes au salon, ce jeune homme vint à nous, et nous dit les choses les plus flatteuses, en s’adressant à nous trois en général, sans paraître s’attacher à l’une, de préférence à l’autre : il nous remercia beaucoup de notre bonne volonté, et nous montâmes en voiture. Il semblait tout rayonnant de gloire, entouré de trois femmes, qu’il appelait ses divinités, et dont les charmes allaient être en son pouvoir.
Pendant deux petites heures que dura notre voyage, la conversation fut très gaie, et notre Adonis en fit presque tous les frais ; nous nous regardâmes alors plusieurs fois, mes compagnes et moi, pour nous dire, par signe, que nous n’avions pas regret de nous être embarquées avec lui.
La maison de campagne où il nous conduisit était infiniment jolie ; on y trouvait tout ce que l’on pouvait désirer, et la promenade, surtout, y était charmante. Nous en profitâmes un peu avant le dîner ; mais notre conducteur eut grand soin de ne pas nous faire tout parcourir, pour nous procurer la surprise que devait nous donner la vue d’un bosquet, entouré de murs très élevés, consacré aux plaisirs du maître, et où nul mortel, hors d’état de sacrifier à la beauté, n’avait encore porté ses pas téméraires.
Nous avions déjà eu mille occasions de remarquer que notre hôte était rempli d’esprit ; mais ce fut au dîner, lorsque échauffé par le vin, les liqueurs et le punch, il eut donné un libre cours à son humeur gaillarde ; il n’y a pas de saillies, de bons mots, de plaisanteries qu’il ne fît, pas de fantaisie qu’il ne voulût satisfaire. Qu’on joigne à cela une belle figure, une voix agréable, et le talent de s’accompagner sur plusieurs instruments, on aura une juste idée de notre adorateur ; pour nous, nous fûmes alors obligées de convenir, que si nous n’étions pas chez l’homme le plus honnête, du moins, nous avions rencontré le libertin le plus aimable qu’on puisse trouver.
Quand on eut rendu à Bacchus tous les honneurs qu’on lui devait, on se leva de table ; je m’aperçus, et je sentis bien, pour mon compte, que mes compagnes et moi, n’avions pas juré de ne sacrifier qu’à ce dieu, et que l’amour voulait avoir part à nos hommages : un mouvement involontaire nous précipita toutes vers celui qui, seul, pouvait les lui faire agréer ; et nous le couvrîmes de baisers, qu’il nous rendit avec tant de profusion et d’ardeur, que nous nous livrâmes à des conjectures flatteuses, sur les scènes agréables dont ils n’étaient que le prélude.
On fit mille folies dans le jardin, et insensiblement on se trouva tout près du mur de ce fameux bosquet, qui devait être témoin des plaisirs que chacun se promettait ; car, de bonne foi, nous étions tous bien disposés à nous divertir. À l’instant, le jeune faune s’échappe, et nous voilà toutes à le poursuivre : il arrive à une porte, qui ressemblait à celle d’un souterrain, l’ouvre et y entre ; nous le suivons sans hésiter, il ferme après nous. On fait trente ou quarante pas dans l’obscurité ; enfin nous revoyons la lumière, et les allées épaisses d’un bosquet délicieux.
— Venez, mesdemoiselles, nous dit en riant notre guide, je vais vous conduire où vous désirez d’aller.
Il nous fait prendre un chemin couvert, et nous arrivons à une salle de verdure, entourée de marronniers, qui laissent à peine le jour pénétrer leur feuillage ; une statue en marbre, représentant l’Amour, est au milieu de cette salle.
— C’est ici, nous dit-il, que l’Amour, ou si vous l’aimez mieux, que la Folie a, depuis longtemps, établi son temple ; je vous crois toutes dignes d’être initiées dans les mystères qui me sont révélés ; et vous allez être consacrées par des voies différentes : qu’on se dépouille de tous ces vains ornements du luxe, pour paraître aux yeux de la divinité que nous allons adorer, comme les enfants de la nature, quand ils invoquent le soleil.
Et tout en parlant, il s’était déjà débarrassé de ses vêtements.
Nous nous regardions comme pour nous demander si nous devions en croire le grand-prêtre, qui nous exhortait.
— Eh quoi ! vous balancez, profanes que vous êtes, nous dit-il d’une voix qu’il semblait emprunter du dieu dont il était rempli. Vous balancez, et vous ne craignez pas mon courroux ? Obéissez, obéissez, vous dis-je, ou vous ne méritez plus d’approcher de ces lieux.
Cette plaisanterie nous fit rire aux éclats ; cependant nous étions bien aises d’en venir au dénouement, et il n’y avait pas d’autre moyen que de faire ce qu’on exigeait de nous.
Quand nous eûmes obéi, le grand-prêtre nous fit venir auprès de lui, et nous donna à toutes un baiser sur le front.
— Maintenant, nous dit-il, quelle est celle d’entre vous qui veut sacrifier la première ? Qu’elle paraisse !
Nous aurions bien voulu toutes commencer, parce que nous craignions que la lampe sacrée ne s’éteignît, et que les dernières n’eussent point de part au sacrifice ; mais pour ne pas paraître jalouses l’une de l’autre, nous voulûmes que le sort en décidât, et trois brins d’herbe, d’inégale grandeur, fixèrent irrévocablement nos rangs. Le plus long m’échut ; je ne fus pas fâchée de me trouver la première, quoique j’ignorasse absolument ce qu’il allait faire de moi.
Il me mena à une balançoire, faite de plusieurs cordes réunies, dont les deux bouts étaient attachés à deux marronniers, et au milieu desquels était retenu un banc à deux dossiers. Il s’y plaça le premier, et me fit monter ensuite sur lui, le visage tourné vers le sien, embrassant son corps avec mes cuisses, de manière que nous formions un X parfait. On s’imagine aisément, que dans la crainte que je ne tombasse par terre, il avait eu soin de me retenir par-dessous, avec une des flèches qu’il avait prise dans le carquois de l’Amour. Mes deux compagnes eurent aussi de l’emploi ; l’une fut chargée de nous balancer, en tirant à elle une corde attachée sous le banc ; et l’autre devait le pousser chaque fois qu’il revenait à elle, pour lui donner plus d’élasticité.
Cet arrangement fait, mon vis-à-vis donna le signal, et bientôt nous voguâmes dans les airs. La voiture m’avait paru si solide, que je n’eus pas la moindre frayeur ; de sorte que je m’abandonnai tout entière au plaisir du voyage. À peine avions-nous fait six tours, que je sentis ma tête se troubler, tout mon corps frissonna, je serrai dans mes bras mon compagnon de voyage, et ne le quittai que lorsque, revenue de l’extase où cette course aérienne m’avait jetée, je me sentis en état de retrouver l’équilibre que j’avais perdu pendant quelques instants, dans le tourbillon qui m’environnait.
Je descendis de la balançoire, très satisfaite de mon expérience, et je me promis bien de la recommencer le plutôt que je pourrais.
C’était à Sophie à sacrifier après moi ; mais ce devait être d’une autre manière : cependant le jeu de la balançoire lui avait paru si plaisant, qu’elle désirait que ce fût de cette façon que son hommage fût présenté ; elle le demanda avec instance : on se rendit à ses vœux. Je remarquai, quand elle prit sa place, que tout n’était pas disposé comme il l’avait été pour moi, et je craignis qu’elle ne glissât, n’apercevant rien pour la fixer sur le banc ; mais cela pouvait venir pendant le voyage, et cette espérance me rassurait un peu pour elle. J’avais tort d’y compter ; on s’arrêta comme on était parti, et la pauvre Sophie, bien désolée sans doute de l’accident qui lui arrivait, mais trop bonne pour s’en fâcher devant nous, prit le parti d’en rire aux dépens de son conducteur, qu’elle persifla de la bonne manière.
Pour moi, je riais sous cape, rendant grâce au sort de la faveur qu’il m’avait faite, et Sophie elle-même me félicitait de mon bonheur.
— Souffrirons-nous, dit Antoinette, qui prit un ton sérieux pour tromper l’infortuné galant, souffrirons-nous que cet impudent nous amène ici pour se jouer de nous, et croit-il avoir affaire à des femmes auxquelles on peut manquer sans conséquence ? Vengeons-nous, mesdemoiselles, armons-nous chacune d’une branche d’arbre, et corrigeons-le de sa présomption.
Et dans l’instant, elles furent toutes les deux en état d’effectuer leur menace.
— Eh quoi donc ! poursuivit Antoinette en me voyant sans armes, crois-tu pouvoir te dispenser de nous imiter, parce que tu t’imagines n’avoir pas à te plaindre ? Allons, allons, toute injure doit être commune entre nous ; tu dois, dans ce moment, oublier tes plaisirs pour nous seconder dans nos justes vengeances.
Je présumai bien que c’était une plaisanterie, je m’armai donc comme les autres.
Quand l’objet de notre feinte colère nous vit prêtes à fondre sur lui, il se jeta, en riant, à nos pieds, dans l’espérance de nous attendrir.
— Pardon, mesdemoiselles, nous dit-il, je vous le demande à mains jointes, mille fois pardon. Je n’avais pas trop présumé de mes forces quand j’ai formé le projet de vous fêter toutes les trois ; je suis même encore persuadé que cet effort ne m’est point impossible, et je vous promets de vous le prouver dans un moment plus favorable ; mais aujourd’hui que je suis enivré du plaisir de voir, pour la première fois, des beautés incomparables, dont les attraits célestes ont étonné mes regards et forcé mon admiration, aujourd’hui que Bacchus, jaloux des plaisirs que l’Amour me promettait, a, pour lui jouer un méchant tour, dont je suis la première victime, mêlé dans le nectar qu’il m’a versé, les vapeurs qui ont échauffé mon cerveau et répandu dans mes veines le froid mortel dont vous vous plaignez, je ne puis rendre à vos charmes divins tout l’hommage qui leur est dû. Jouissez de ma confusion et faites grâce au malheureux qui ne peut pas se reprocher l’injure qui vous irrite, puisqu’elle est involontaire.
Toutes ces raisons me paraissaient, à moi, fort bonnes ; mais les autres ne les jugèrent pas de même. Ni les supplications du patient, ni sa posture humiliée, ne purent le sauver de la correction qui l’attendait. Nous tombâmes toutes les trois sur sa peau, et je fus la seule qui l’épargnai, mes compagnes y allèrent bon jeu, bon argent.
Quand il sentit qu’on s’occupait trop sérieusement de lui, il se leva et voulut s’esquiver ; mais nous nous mîmes à sa poursuite, et il reçut encore en courant quelques petits coups, dont il ne se vanta pas. Nous avions déjà parcouru plusieurs allées ; soit que l’air ou les aiguillons des branches qui l’atteignaient lui eussent fait retrouver ce que nous croyons totalement perdu, il s’arrête, et, se tournant fièrement devant nous :
— Serez-vous encore en colère ? nous dit-il ; n’ai-je donc plus le moyen de vous apaiser ?
À l’instant toutes les branches nous tombent des mains, Sophie s’élance sur lui et veut absolument profiter de l’occasion, c’est d’ailleurs son tour ; elle ne croit pas qu’on puisse le lui disputer, mais l’autre, tout aussi pressée de jouir qu’elle, s’oppose à ses desseins, et soutient qu’ayant coopéré comme elle à rendre une nouvelle activité à l’objet de leurs désirs, il ne doit plus être question de la première désignation des tours, et que toutes y ont un droit égal. Grands débats à ce sujet ; j’observe que d’après ce raisonnement on ne peut pas même me priver de mes prétentions ; on est forcé d’en convenir. Cependant, trop généreuse pour rentrer encore en lice, j’abandonne volontiers mes droits et je me charge d’aider le sort à désigner sa favorite. Il tombe sur Sophie, qui s’entend nommer avec satisfaction ; mais, ô revers cruel et mortifiant ! l’oiseau chéri s’est envolé pendant la dispute, et n’a laissé à celle qui lui préparait une cage, que le regret de ne l’avoir pas assez tôt enfermé.
Sophie fut réellement piquée de ce nouvel accident ; et je crois que devant tout autres que nous, elle aurait fait éclater son dépit. Elle se contenta de plaisanter l’oiseleur maladroit qui n’avait pas su retenir dans ses filets l’oiseau de passage qu’il y avait arrêté quelques instants. Celui-ci s’excusa encore une fois de son mieux : tout le tort, en effet, n’était pas de son côté.
— Ce n’est plus à vous de quereller, lui dit-il, c’est à moi de vous corriger, pour avoir fait un si mauvais emploi de votre temps. Que cela vous serve de leçon et vous apprenne que, dans ces sortes de circonstances, il ne faut pas parler, mais agir.
Il avait bien raison. On se persuada de cette vérité ; d’ailleurs, l’espoir qu’on avait de rattraper un jour le petit fripon qui s’était échappé, acheva de calmer les esprits. Nous revînmes prendre nos habillements, et après quelques tours de promenade, nous montâmes en voiture pour revenir à la maison.
Notre jeune fou, en nous quittant, nous promit bien de réparer ses torts, et de temps en temps il nous reçut l’une après l’autre à sa campagne ; mais enfin, pour nous faire voir que ce n’était pas vainement qu’il s’était vanté de nous satisfaire toutes les trois un même jour, il disposa la partie, et quoique ce jour-là je ne fusse que la dernière à donner mon avis, je ne me plaignis pas de mon sort.
Ce sont là de ces folies qu’il est quelquefois bon de se permettre, pour que les plaisirs, qui se succèdent si rapidement, se montrent sous de nouvelles formes et ne cessent pas d’en être pour celles qui sont obligées, par état, de les entretenir. Elles ont bien quelquefois leurs petits désagréments ; mais aussi elles ont toujours un mérite réel, c’est qu’elles ne ressemblent point à celles qui les ont précédées.
Pour diversifier un peu nos amusements, la bonne Dupré nous menait de temps en temps au spectacle : je me rappelle qu’un jour j’étais seule avec elle au Théâtre Français ; on y donnait une pièce où la jalousie, peinte sous les couleurs les plus tragiques, m’avait vivement intéressée ; cependant je ne pouvais pardonner au héros de ce drame, l’excès de sa cruauté envers une femme que je savais innocente, et sa position malheureuse me faisait répandre des larmes bien sincères. J’allais me livrer à quelques réflexions sur les funestes effets de cette misérable passion, quand je vis entrer dans la loge où nous étions un jeune homme d’environ vingt-cinq ans. Après les compliments d’usage, il renouvela connaissance avec la Dupré, chez laquelle il allait fréquemment autrefois. J’observai que pendant qu’il lui parlait, ses yeux étaient presque toujours fixés sur moi. La pièce venait de finir.
— Voulez-vous, mesdames, nous dit-il, me permettre de vous donner la main jusque chez vous ?
La bonne Dupré accepta sans difficulté, et nous montâmes avec lui dans sa voiture. Ma directrice, qui s’était aperçu de l’effet que mes charmes avaient fait sur lui, l’engagea d’entrer : elle lui fit beaucoup de questions sur son état et sur sa fortune, parce qu’elle ignorait ce qu’il était devenu depuis plus de deux ans qu’elle ne l’avait vu.
Il lui donna tous les éclaircissements qu’elle parut désirer et lui apprit qu’il était marié depuis environ un an, mais que ce lien ne l’empêcherait pas de prétendre aux faveurs de mademoiselle (en me montrant), si je voulais consentir à lui accorder quelques instants.
Je répondis assez faiblement, parce que je craignais qu’il ne fût pressé de jouir et qu’il ne voulût, dès le soir même, user des droits qu’on allait lui donner. Cela m’eût beaucoup contrariée, car je ne me sentais point disposée à me livrer au plaisir ; la représentation à laquelle j’avais assisté m’avait singulièrement affectée, et calculant assez bien mes jouissances pour être presque toujours de moitié avec ceux auxquels j’en procurais, je sentais bien qu’un engagement si prompt ne pouvait pas me convenir. Heureusement il indiqua la partie au lendemain soir, chez lui, où nous serions très libres, nous dit-il, parce que sa femme partait le matin pour l’une de ses terres. Quand l’heure à laquelle je devais me rendre chez lui fut arrêtée, et qu’on fut convenu des moyens que j’employerais pour m’introduire dans l’appartement où nous étions attendus par la volupté, il sortit en laissant à la Dupré de bons garants de la parole qu’il me donnait.
Le lendemain, sur la brune, je pris une voiture de place, et je me fis descendre à dix pas de l’hôtel de mon nouvel adorateur. Un laquais que je crus le confident intime de son maître, m’y attendait. Il m’apprit que madame de Verneuil avait différé son voyage de quelques jours ; qu’elle était même alors dans l’hôtel ; mais que monsieur n’entendait pas se priver pour cela du plaisir de me recevoir ; qu’il me priait de le suivre et qu’il allait me faire passer par un escalier dérobé, où je ne serais vue de personne. Je fis d’abord quelques difficultés de suivre ce laquais ; mais comme il m’assura que je pouvais être parfaitement tranquille, je me laissai conduire, sans faire d’autre observation ; je l’avouerai même avec franchise, je mis une sorte d’orgueil à être préférée à madame de Verneuil ; et l’idée de faire faire à son mari une infidélité, pour ainsi dire, sous ses yeux, rendit la scène plus piquante. N’est-ce pas le comble de la dépravation ? N’importe, ce fut là la raison qui me fit braver les dangers que je pouvais courir, si nous étions découverts.
Je suivis donc mon guide : il m’introduisit mystérieusement dans une pièce de l’appartement de son maître, qui vint un instant après m’y rejoindre. C’était une espèce de boudoir dans lequel se trouvait un lit orné de glaces. Plusieurs bougies éclairaient ce petit réduit, fait pour recevoir l’Amour, et où peut-être il ne s’était jamais trouvé, même depuis le mariage de Verneuil.
Aussitôt qu’il fut entré, il ferma au verrou la porte qui communiquait de cette pièce aux autres appartements, et l’on ne tarda pas à s’occuper de l’objet qui m’attirait dans cette maison.
Ce voluptueux jeune homme, qui connaissait tous les raffinements de la jouissance, avait observé que, pour jouir véritablement, il faut ménager le plaisir, et ne s’y livrer que par gradation, en laissant toujours les désirs se succéder les uns aux autres. Pénétré de ces principes, il se serait bien gardé d’exposer à ses regards l’universalité de mes charmes ; il avait soin, au contraire, de voiler ceux qu’il avait déjà parcourus, à mesure qu’il en découvrait d’autres ; de sorte qu’il était possible que les mêmes redevinssent plusieurs fois l’objet de ses désirs. Je ne fus donc point obligée de me déshabiller. Il prit lui-même, bien volontiers, ce soin ; car c’était une nécessité pour lui de le faire, s’il voulait mettre ses leçons en pratique ; enfin, quand il eut épuisé tous les préliminaires que sa sensualité lui inspirait, il me joignit sur le lit, où il m’avait étendue depuis longtemps, et préparée, comme je l’étais, par tout ce qu’il avait mis en usage pour m’enflammer ; je le reçus dans mes bras, où il dut s’apercevoir, aux transports auxquels je me livrai, que sa leçon n’avait pas été infructueuse.
Déjà trois fois, je ne dirai pas l’amour, mais un je ne sais quel être qui lui ressemble fort, m’avait fait sentir son pouvoir redoutable ; déjà l’ardent Verneuil cherchait à retrouver ses forces énervées, dans un de ces moyens que le dieu du plaisir permet à ses favoris : on frappe à la porte du boudoir avec une force incroyable : nous ne répondons point ; on redouble. Verneuil, impatienté, demande avec humeur qui vient ainsi le troubler ?
— Ouvrez, c’est moi, dit sa femme, ouvrez.
Je tremblais qu’il ne commît cette imprudence ; mais heureusement, il ne le fit point. Nous nous rajustâmes du mieux qu’il nous fut possible, et Verneuil descendit par le petit escalier pour appeler le laquais qui devait protéger ma sortie, comme il avait assuré mon entrée. Son absence ne fut pas longue ; il revint, accompagné de ce laquais, auquel il me remit en m’abandonnant à ses soins. Pour lui, il est présumable, d’après ce qu’on va voir, que n’étant resté dans le boudoir que le temps nécessaire à mon évasion, il était immédiatement sorti, pour n’avoir pas d’explication avec sa femme.
Au lieu de me faire descendre l’escalier, ce laquais m’avait fait entrer par une porte qui se trouvait sur le même carré, en face de celle du boudoir. Il m’avait donné pour raison de cette différence, la crainte où il était que madame de Verneuil ne nous fît guetter par cet endroit, qui était la sortie naturelle du boudoir, et il me fit entendre qu’il n’y avait, pour échapper à sa poursuite, que le moyen de gagner le grand escalier.
Je crus bonnement cet imposteur, et je le suivis sans hésiter. Quand il m’eut fait traverser plusieurs pièces, à ce que je présume, car nous n’avions point de lumière, il me fit asseoir et me dit qu’il allait examiner s’il n’y avait personne à la découverte ; jusque là rien n’était plus simple que sa conduite, et mon intention était de lui donner, en sortant, un des louis de Verneuil, pour le remercier de ses bons offices ; mais le drôle, qui avait sur moi des projets que j’étais éloignée de lui soupçonner, s’embarrassait fort peu de mon cadeau, et ne m’avait quittée un moment, que pour, d’un côté, s’assurer que Verneuil n’était plus dans l’hôtel, et de l’autre, tromper sa femme, pour avoir le temps d’en venir à ses fins.
Il n’y avait pas cinq minutes qu’il m’avait quittée, quand je le vis rentrer. Il posa sur la table une bougie qu’il avait apportée, et me dit qu’il lui était impossible de me faire sortir dans ce moment, parce que madame Verneuil avait aposté ses domestiques pour m’arrêter au passage, et qu’il savait qu’il n’était pas prudent de s’exposer aux effets de la jalousie d’une femme, qui employerait toute sorte de moyens pour se venger de ce qu’elle appelait un affront.
— Je vous ai conduite dans ma chambre, me dit-il ensuite, mademoiselle, pour que vous soyez plus en sûreté, parce qu’on ne se doutera pas que vous y êtes, et qu’on vous croira sortie, en ne vous trouvant pas dans l’appartement ; et pour plus de prudence, je vais fermer la porte à double tour, et mettre le verrou.
Il parlait encore, que tout cela était déjà fait.
J’avais eu beau me persuader jusque-là qu’il était dans les meilleures intentions à mon égard, j’avoue que cet excès de précaution me donna quelques inquiétudes sur les suites de cet événement ; et bientôt mes doutes se trouvèrent parfaitement éclaircis.
— Nous sommes seuls, me dit-il, ma chère amie, je viens de m’assurer que personne ne peut troubler nos plaisirs ; ainsi j’espère que tu ne refuseras rien à l’homme du monde qui t’aime le plus.
Et tout en s’exprimant ainsi, d’une main, le drôle fourrageait mes appas ; et de l’autre, il mettait en liberté le terrible argument auquel il me fallait répondre. Indignée de ce procédé, furieuse, je me lève et veux crier au secours, contre un attentat qui compromettait, en quelque sorte, la réputation que pouvait me donner les bonnes grâces de Verneuil.
— Prends garde, me dit-il, à ce que tu vas faire, ce parti violent que tu veux prendre te mène à ta ruine ; car en faisant du bruit, tu fais venir les domestiques de madame, et tu tombes infailliblement dans ses mains ; au lieu qu’en m’accordant, de bonne grâce, ce que je te demande, pour prix de ta complaisance, je te fais esquiver, sans qu’il t’arrive la moindre égratignure. Délibère donc promptement, et fais bien attention que le parti que je te propose est pour toi le plus sage.
Loin de me rendre aux raisons qu’il me donne, et qu’il a la présomption de vouloir me faire trouver excellentes, je me débarrasse de ses bras, et je proteste hautement que je ne consentirai jamais à ce qu’il exige de moi.
— Ah ! ma petite amie, me dit-il, tu veux jouer la vertueuse en sortant du boudoir de Verneuil ! conviens avec moi, de bonne foi, que ce caprice est parfaitement ridicule, et puisqu’il faut employer la force, pour obtenir de toi ce que ta reconnaissance aurait peut-être dû m’offrir, tu vas voir si l’on a beau jeu quand on veut me refuser quelque chose.
Me faire cette douce observation, me prendre dans ses bras, et m’étendre sur le plancher, tout cela fut l’affaire d’un moment : le vigoureux compère, habile à profiter de ma chute, m’avait déjà mise hors d’état d’en détourner les inconvénients, que je n’avais pas encore eu le temps de m’y préparer. Ainsi, malgré mes prières et ma résistance, il fallut livrer une place qu’il n’était plus en mon pouvoir de défendre.
Quand ce perfide eut apaisé l’ardeur de ses feux, il m’offrit de me conduire hors de l’hôtel, pour qu’il ne m’arrivât rien. Il m’était plus permis que jamais de croire à sa parole, d’après ce qui venait de se passer, et je ne me doutais pas qu’une nouvelle trahison serait le prix de mes faveurs. Je le suivis donc, sans la moindre crainte. Il me fit entrer dans un salon dont il ferma, en dedans, la porte par laquelle nous étions entrés. Il courut ensuite à la porte opposée, l’ouvrit ; et, à un signal qu’il donna, trois femmes entrèrent et se précipitèrent sur moi. Deux d’entre elles étaient armées d’une poignée de verges ; la troisième, qui me parut être madame Verneuil, ordonna au traître qui m’avait livrée à leurs fureurs, de me tenir les mains, et elle me les lia avec un ruban. J’eus beau me récrier contre cette violence et faire retentir tout l’hôtel de mes cris, il me fallut endurer le supplice que ces dames avaient préparé pour moi. Le laquais me prit par le milieu du corps pour me contenir ; les deux femmes armées se placèrent à mes côtés ; puis, relevant mes jupons d’une main, de l’autre, elles me fustigèrent sans miséricorde pendant près d’un quart d’heure. Quant à madame Verneuil, qui voulait jouir à son aise du fruit de sa vengeance, elle s’était assise dans un fauteuil, en face de nous, et riait aux éclats en voyant les efforts inutiles que je faisais pour me débarrasser des mains de mes assaillants.
Cependant le sang ruisselait de mes fesses, et les douleurs devenaient si aiguës, que peu s’en fallait que je ne me trouvasse mal. Madame Verneuil vint à moi, et s’apercevant que la pâleur avait remplacé sur mon visage le pourpre qu’un instant auparavant la rage impuissante y avait répandu, ordonna à mes bourreaux de cesser la correction. On obéit : mais, remise en liberté, il me fut impossible de me tenir debout ou de m’asseoir. Je me laissai tomber le plus doucement que je pus sur le plancher, où je demeurai longtemps les yeux cachés par mes mains, trop humiliée de ce qui venait de m’arriver, pour oser les lever sur les objets de mon indignation.
Enfin, madame Verneuil, qui jusque-là s’était contentée de ma punition sans l’avoir rendue plus sévère, en m’accablant de reproches, m’adressa la parole, et du ton le plus méprisant, le plus injurieux :
— Apprenez, me dit-elle, que c’est ainsi que l’on punit les créatures de votre espèce, qui, sans respect pour les mœurs qu’elles outragent à chaque pas, vont semer la discorde et la désolation dans les familles. Je désire bien sincèrement que la leçon, que vous avez prise ici, vous soit utile pour l’avenir, et que vous ne soyez jamais tentée d’en mériter une seconde.
Après cette courte harangue, à laquelle je fus peut-être plus sensible qu’à la correction, elle sortit et me laissa livrée aux propos injurieux d’une valetaille insolente qui ne me ménagea pas.
Pour moi, je dévorais dans le silence la honte dont j’étais couverte, et je n’osais me lever pour m’en aller, parce que j’ignorais si j’étais à la fin du supplice que j’endurais : cependant, une de ces harpies me prit par un bras, et me soulevant de terre :
— Allons donc, me dit-elle, la belle éplorée, voulez-vous passer la nuit dans cette posture ? n’est-il donc pas temps que vous preniez congé de nous ?
Ce mot soulagea l’oppression dans laquelle mes craintes me retenaient, et je ne me le fis pas redire. Je me levai brusquement pour gagner la porte, sans ouvrir la bouche et sans regarder personne, n’espérant trouver que dans ma fuite la possibilité d’éteindre ma confusion. L’infâme laquais dont, pour tant de raisons, j’avais à me plaindre, me fit descendre par le grand escalier, et lorsque je fus dans la rue, il me dit adieu, en m’engageant à me souvenir de lui.
Je n’avais pas besoin de cette recommandation ; la bassesse de sa conduite était suffisamment gravée dans ma mémoire. Mais il ne s’agissait pas de songer à ce qui venait de m’arriver, il fallait m’occuper des moyens d’empêcher la Dupré de s’en apercevoir : mon amour-propre aurait trop souffert si elle ou mes compagnes en eussent été instruites. Je me rajustai donc du mieux que je pus, tout en marchant avec peine, car mes douleurs n’étaient point encore apaisées, et je composai assez bien ma figure pour qu’en entrant mon air de gaieté naturelle ne parut point altéré. Néanmoins, comme il aurait été possible à la longue qu’on fît quelques remarques défavorables, je montai à ma chambre, où je restai jusqu’au souper à bassiner mes plaies avec de l’eau fraîche, et à me mettre dans un négligé qui pût écarter le plus léger soupçon.
On me fit à table quelques questions sur le jeune homme auquel j’avais eu affaire ; tout ce que j’en racontai fut parfaitement à son avantage ; car, au fait, il n’avait eu aucune part aux outrages que j’avais reçus chez lui. La Dupré me demanda s’il m’avait promis de revenir, et quand nous le reverrions ; je répondis qu’à cet égard il ne s’était point expliqué ; et quoique je me sentisse du goût pour lui, je désirai, de bien bon cœur, qu’il ne revînt point. Je ne sais s’il fut instruit de la manière brutale dont on m’avait traitée ; je le présume au moins, car mon amour-propre me dit que je ne dois son éloignement qu’à l’aveu que lui en fit sa femme.
Pendant environ huit jours, je refusai, sous différents prétextes, toutes les parties qui m’étaient offertes. Je voulais attendre ma guérison entière, pour ne pas m’exposer aux plaisanteries que mes singulières blessures auraient pu m’attirer : je me contentai seulement de jouir des plaisirs qui faisaient le charme de notre petite société. Enfin, toutes les traces de ma honte disparurent ; je me trouvai bientôt en état de reprendre les exercices communs.
Dans l’intervalle de mon accident à ma guérison, plusieurs personnes, qui venaient habituellement chez la Dupré, lui avaient mis dans la tête de prendre une petite maison de campagne, pour rendre plus agréables les parties qu’on pourrait faire chez elle, avec nous. Elle y avait consenti, et venait d’en louer une toute meublée, dans les environs de Paris.
Avant de la consacrer à l’usage de ceux qui la lui avaient fait prendre, elle voulut nous y conduire seules avec elle, pour nous distraire, pendant quelques jours, des plaisirs bruyants qui nous obsédaient sans cesse. Rien n’était plus flatteur qu’une proposition qui avait pour but de nous rendre un moment à la tranquillité, et de nous mettre à portée de jouir enfin de nous-mêmes ; car nous étions rarement ensemble, quoique dans la même maison, à cause des occupations distinctes et séparées qui nous écartaient l’une de l’autre.
J’avais déjà remarqué, avec un plaisir infini, que mes compagnes s’exprimaient en bons termes et avec grâce ; qu’elles avaient des talents agréables, qui sont le fruit ordinaire d’une éducation suivie, et qu’elles n’avaient point été élevées pour l’état où je les voyais ; je brûlais d’impatience de les connaître mieux, et de savoir par quelle fatalité elles étaient tombées dans la malheureuse position où nous étions toutes les trois réduites.
L’occasion ne pouvait être plus favorable. Depuis plusieurs jours nous habitions cette maison de campagne où nous ne faisions que folâtrer, comme des enfants qu’on laisse en liberté, après les avoir longtemps occupés. En y rentrant un matin, après une longue promenade au dehors, nous nous assîmes sur un gazon qui entourait un large bassin, où une eau claire et renouvelée par une petite source, qui le traversait, laissait voir une quantité prodigieuse de poissons se jouer dans son sein. Après quelques folies faites en nous roulant sur l’herbe, j’amenai insensiblement la conversation sur le chapitre qui m’intéressait, et je fis part du désir que j’avais de leur entendre raconter leurs histoires. Elles ne se firent pas prier ; la seule restriction qu’elles mirent à leur complaisance, fut que je commencerais par la mienne.
J’avais trop envie de me satisfaire pour différer un instant de leur obéir : je leur fis donc le récit exact de tout ce qui m’était arrivé, jusqu’au moment où je les avais connues.
Quand j’eus fini, on me remercia beaucoup, en m’embrassant ; alors la belle Sophie prit la parole, et commença ainsi :
HISTOIRE
DE SOPHIE BELLMOUNT
 e suis la plus jeune des trois filles
d’Édouard Bellmount, baronnet, dont
l’habitation est située dans le comté de
Glocester. Ma mère, jeune encore,
resta veuve avec ses trois enfants en
bas âge. Sa tendresse pour nous lui
fit négliger les avantages que pouvait
lui promettre un second hymen, pour ne s’occuper
que de notre éducation. Aussi fût-elle
extrêmement soignée. On n’épargna rien pour
nous procurer tous les talents qui font briller
dans la société, et bientôt mes deux aînées trouvèrent
un établissement digne d’elles.
e suis la plus jeune des trois filles
d’Édouard Bellmount, baronnet, dont
l’habitation est située dans le comté de
Glocester. Ma mère, jeune encore,
resta veuve avec ses trois enfants en
bas âge. Sa tendresse pour nous lui
fit négliger les avantages que pouvait
lui promettre un second hymen, pour ne s’occuper
que de notre éducation. Aussi fût-elle
extrêmement soignée. On n’épargna rien pour
nous procurer tous les talents qui font briller
dans la société, et bientôt mes deux aînées trouvèrent
un établissement digne d’elles.
Non moins sensible que mes sœurs, j’avais aussi écouté favorablement les tendres protestations d’amour d’un jeune homme du voisinage que j’aimais éperdument ; mais l’inégalité de nos conditions fut un obstacle invincible à notre mariage. Ma mère, qui jouissait des prérogatives de la noblesse, et qui tenait fortement aux préjugés, ne voulut jamais consentir à donner sa fille au fils d’un roturier, quoique riche, d’une famille honnête et sans reproche : il n’y avait qu’un homme de condition qui pût espérer de m’obtenir ; l’amant que je chérissais fut éconduit, cependant avec tous les ménagements qu’on devait à sa position affligeante.
Comment ne pas gémir sur la faiblesse des parents qui sacrifient ainsi ce qu’ils ont de plus cher, à ce qu’ils appellent le point d’honneur ; qui, forçant impitoyablement l’inclination de leurs enfants, les rendent victimes de leurs sots préjugés, et les exposent à tous les égarements d’une jeunesse imprudente qui n’a que son cœur pour guide, et la jouissance pour but ?
Il semble qu’il suffise de défendre une chose, pour qu’on brûle de se la procurer, à quelque prix que ce soit ; aussi notre tendresse mutuelle, qui d’abord avait été très innocente, acquit de nouvelles forces par ce refus, et se changea en une passion impétueuse, qui nous fit connaître l’étendue de notre amour, en nous faisant chercher à le satisfaire.
Mon pauvre amant pleurait en silence la perte de sa maîtresse, et moi je perdais insensiblement toute ma gaieté : toujours mélancolique, la société m’était devenue insipide ; j’allais même jusqu’à sentir que ma mère, parce qu’elle contrariait ma passion, me devenait de jour en jour moins chère ; et quoique ce sentiment pesât sur mon cœur, il ne pouvait éteindre la violence de mon amour. Je n’étais occupée que des moyens d’adoucir les maux que me causait cette fatale séparation.
Déjà cinq semaines s’étaient écoulées, sans que nous eussions pu nous revoir, quoique mon amant n’eût pas manqué un seul jour de passer sous mes fenêtres ; mais je ne pouvais ni le voir, ni en être aperçue, parce que j’étais gardée à vue par ma mère qui craignait, avec raison, les entreprises d’un jeune homme passionné, capable de se porter aux dernières extrémités. Hélas ! les plus grandes précautions, dans ce cas, sont presque toujours inutiles : j’en ai fait la triste expérience, et si une mère attentive à garantir sa fille des pièges de l’Amour, y a réussi pendant longtemps, il ne faut qu’un instant pour rompre ses mesures : le fripon, habile à profiter de la moindre occasion qui lui est offerte, se rit de sa vigilance, et la met en défaut.
En proie à mes ennuis, tourmentée par la violence de ma passion, il ne m’était plus possible de me livrer au repos : les idées les plus tristes occupaient seules ma pensée, et cet état, pire que la mort, me la faisait désirer.
Mon amant au désespoir, l’âme absorbée, regardait la vie comme un fardeau insupportable, et faisait au ciel des vœux ardents pour succomber à son malheur ; le sommeil fuyait sa paupière appesantie : le cœur rempli de mon image, il allait, dès l’aurore, entretenir de son infortune les bois les plus sauvages ; la nuit l’y surprenait souvent, délicieusement occupé à faire retentir les échos du nom chéri qu’il se plaisait à répéter ; et, las d’appeler en vain celle qui ne pouvait l’entendre, il s’en retournait tristement, pour essayer de jouir d’un repos qui n’était plus fait pour lui.
Il y a cependant un terme à tout : les peines et les plaisirs ne sont pas éternels ; et si, par cette raison, ceux qui sont au faîte du bonheur peuvent avoir quelques craintes sur la perte de leur fortune et de leurs jouissances, pourquoi donc se livrer au désespoir quand on est malheureux ? Ne vaut-il pas mieux attendre patiemment cette révolution ordinaire, et dont nous fîmes l’épreuve.
Un jour que j’étais réveillée de grand matin, excédée des fatigues d’un songe pénible où m’avait jetée un instant de sommeil, pour faire diversion à mon chagrin, j’étais venue prendre le frais à la fenêtre de ma chambre à coucher, qui donnait sur le chemin, Johnson (c’était le nom de mon amant) s’offrit à mes regards. Qu’on se peigne, s’il est possible, la joie, les transports que nous éprouvâmes ! Pauvre amant ! que n’avais-tu des ailes pour voler dans mes bras ! Et moi, amante infortunée ! que ne pouvais-je m’élancer dans les tiens ! Nous voulions nous parler ; mais la peur d’être entendus nous arrêtait, nous nous contentions de nous regarder ; et nos regards, nos gestes exprimaient assez ce qui se passait dans nos cœurs.
Il était encore si matin que personne n’était levé ; nous pouvions donc, sans danger, profiter de ce moment précieux. Je lui fis signe d’attendre un instant, et après m’être assurée que ma mère dormait, j’écrivis le billet suivant, que je jetai par la fenêtre en me retirant :
« Trouvez-vous, cet après-midi, mon ami, à six heures précises, à la petite porte verte du pavillon qui donne sur l’avenue, au bout du parc : je ne puis vous en dire davantage… Fuyez… et croyez que je vous aime trop pour douter de votre fidélité. »
Il est aisé de concevoir l’effet que produisit ce billet sur cet amant aimé et digne de l’être : le doux espoir rentra dans son cœur ; ses chagrins se dissipèrent, et l’aimable sérénité reparut sur son visage, trop longtemps flétri par ses pleurs.
De mon côté, je m’occupai des moyens de tenir ma promesse.
Ma mère avait ce jour-là grand monde à dîner ; et ce qui paraîtrait d’abord devoir contrarier mon projet, servit à l’exécuter ; car, du nombre des personnes invitées, il y avait deux demoiselles de mon âge, avec lesquelles j’étais étroitement liée, et que ma mère aimait beaucoup. Cette intimité reconnue, autorisait une sorte de liberté que je n’aurais pu me procurer aussi facilement. On pouvait donc m’en laisser jouir sans conséquence ; et il eût été par trop ridicule de soupçonner même que j’en abuserais en si aimable compagnie.
J’avais un peu compté sur cette liberté, en indiquant à Johnson le rendez-vous dont mon amour m’avait empêché de prévoir les suites ; mais, de bonne foi, je n’avais eu d’autre dessein, en commettant cette imprudence, que de revoir un instant l’amant qui régnait en souverain dans mon cœur.
Attentive à profiter de l’occasion qui m’était offerte, je laissai les parties de jeu s’engager après le dîner ; je refusai, sous différents prétextes, les places qu’on voulut m’y donner, et je proposai à mes bonnes amies un tour de promenade à l’entrée du parc. Ma mère, qui n’avait vu dans cette proposition qu’un moyen de me donner un moment d’agrément, y consentit volontiers ; une seule femme de chambre fut chargée d’escorter la petite bande joyeuse.
Il y avait près d’une heure que nous avions quitté la compagnie : trop occupée de mon rendez-vous pour faire un pas qui pût m’en éloigner, j’avais insensiblement dirigé la marche du côté du pavillon. Quand je fus à environ une portée de fusil du lieu où devait bientôt se rendre celui que je chérissais plus que la vie, j’invitai mes compagnes à se reposer. Un bois touffu qui couvrait de son ombre un ruisseau dont l’onde argentée serpentait entre deux tapis de verdure, des points de vue ménagés dans l’épaisseur, le chant des oiseaux, tout enfin rendait ce séjour délicieux ; aussi je les déterminai sans peine à en goûter les douceurs.
Aussitôt que nous fûmes assises, on se mit à jouer à de petits jeux enfantins ; mais bientôt je m’aperçois, au déclin du soleil, ou plutôt aux battements de mon cœur, que l’heure du rendez-vous est arrivée : je me lève, et sous un prétexte très naturel, je quitte la petite société qui ne se doute de rien, en la priant de continuer un moment sans moi, et je m’échappe.
Amour ! tu conduisais mes pas ; tu me fais voler au pavillon : j’y entre, et d’une main tremblante, j’ouvre la porte à mon amant, qui se précipite à mes genoux.
Le temps presse : un mot va décider de notre sort. Il me conjure, par ce que j’ai de plus sacré, de terminer les maux qui l’accablent ; il ne peut plus désormais vivre sans me voir ; son bonheur dépend de moi ; sa mort est assurée, s’il n’obtient ma main ; il a cent moyens prêts pour se la procurer. Il ne demande que la confiance et le consentement de sa maîtresse. Aurai-je la force de refuser quelque chose à l’objet que j’adore ? Non ; l’amour l’emporte sur mon devoir ; je promets tout : le baiser que j’imprime sur la bouche de mon amant est le garant de mon acquiescement à ses volontés.
Entraînée par ses douces persuasions, j’ai promis de revenir le lendemain, dans la matinée, à l’endroit où je viens de jurer que j’aimerai toujours, pour aller ensuite, loin de ma famille, serrer des nœuds que l’orgueil dédaigne, et que l’amour brûle de former. Il ne nous a fallu qu’un instant pour convenir de nos faits et renouveler nos serments de fidélité : mon amant, ivre de joie et d’espérance, m’a laissée sous la garde de l’Amour, et j’ai rejoint mes compagnes.
C’est en vain qu’on voudrait rendre l’effet des divers sentiments qui nous agitèrent : qui pourrait exprimer ce que l’espoir d’être bientôt unis nous fit éprouver de véritable plaisir, et ce que la crainte d’être découverts nous causa d’inquiétude ? Aussi le reste de la journée et la nuit toute entière furent employés de part et d’autre à s’affermir dans une résolution qui devait nous faire sortir de ce pénible état.
Chacun de son côté réunit l’argent et les bijoux qu’il avait à sa disposition. Le lendemain, vers neuf heures du matin, je profitai de l’instant où ma mère terminait un compte avec un de ses fermiers ; je descendis au jardin, et je gagnai insensiblement une avenue du parc, d’où je me rendis au pavillon ; mais avec tant de précipitation, qu’à peine la porte fut ouverte que mes jambes fléchirent sous moi, et je tombai plus morte que vive aux pieds de mon amant. Celui-ci mit tout en usage pour me rassurer, et me pressa de partir. J’hésitais à le suivre : dès qu’il s’en aperçut, il me prit dans ses bras et me sortit du pavillon, en tirant à lui la porte dont la clef était restée en dedans.
Quand je me vis dehors, je fus saisie d’un repentir, un peu tardif à la vérité, mais bien sincère : je retournai vers la porte que je trouvai fermée. Sentant bien alors qu’il m’était impossible de réparer ma faute, je me mis à pleurer. L’amour qui avait à cœur d’achever son ouvrage, me rappela la cruauté de ma mère ; il n’en fallut pas davantage pour me rendre toute mon intrépidité. J’oubliai tout, pour ne m’occuper que de celui qui allait faire le charme de ma vie.
Forcés, pour de bonnes raisons, de hâter notre marche, nous fîmes à pied, par la chaleur du jour, plus de trois lieues, pour arriver à la ville, sans trouver en chemin un seul endroit où il nous fût possible de nous procurer les rafraîchissements dont nous avions besoin.
Pour éviter l’ardeur du soleil, nous n’avions pas suivi la grande route ; nous nous en étions même beaucoup écartés : allant bon pas, nous nous entretenions de notre tendresse, quand trois cavaliers armés se présentent à nous, et nous demandent la bourse. Johnson était sans armes ; mais le dieu qui nous avait déjà protégés veillait encore sur nous, et ne nous abandonna pas dans cette fâcheuse circonstance. Mon amant leur représenta qu’il était sans argent ; que, demeurant à quatre pas de là, il allait à Glocester avec sa sœur, pour voir un parent qui nous avait demandés ; que d’ailleurs nous n’avions rien sur nous qui pût mériter leur attention. Comme la peur m’avait fait jeter quelques larmes, peut-être aussi qu’elles attendrirent ces messieurs, ils consentirent à nous laisser passer sans nous dévaliser.
Nous pouvions être alors à environ un mille de Glocester : la crainte d’une pareille rencontre nous fit doubler le pas, et bientôt nous arrivâmes. Johnson qui connaissait cette ville, me conduisit dans une hôtellerie, et pendant qu’on préparait le dîner, alla louer une voiture pour Londres : il donna ordre au postillon de venir nous prendre à l’instant, ce qu’il fit, et dès que nous eûmes dîné, nous nous mîmes en route.
De Glocester à Londres, il n’y a que vingt-huit lieues ; en payant bien les guides, ce voyage-là ne fut pas long : aussi, avant minuit, nous étions dans la capitale.
C’était la première fois que nous la voyions ; nous nous laissâmes conduire indifféremment au premier hôtel, où nous demandâmes à coucher seulement pour une nuit, parce qu’il était trop tard pour nous présenter chez une parente, qui demeurait dans le Strand, à laquelle nous venions faire une visite de noces. Comme on croit aisément ce qui est vraisemblable, on nous donna une chambre et à souper, ce qui nous était très nécessaire, n’ayant pas mis pied à terre pendant toute la route, dans la crainte d’être arrêtés, si on nous poursuivait, et qu’on parvînt à nous rejoindre.
Après le souper, qui ne fut pas long, parce qu’on devine bien notre impatience, nous nous mîmes au lit, et malgré la fatigue du jour, la nuit fut témoin de notre bonheur. Amour ! pardonne, si je n’entreprends pas de décrire les plaisirs ravissants que tu m’as procurés cette nuit-là : hélas ! les malheurs qui les ont suivis, ont été si terribles, qu’ils en ont presque effacé le souvenir.
Le lendemain matin, Johnson se leva de bonne heure ; il fut louer, moyennant trois guinées par mois, un petit appartement garni, dans un quartier éloigné de celui où nous étions descendus, pour ne pas laisser de traces de notre fuite. Il revint après me chercher, et m’y conduisit dans une voiture de place.
Pour nous sauver l’embarras du ménage, auquel nous n’entendions pas grand’chose ni l’un ni l’autre, nous nous mîmes en pension chez une bonne femme de la maison, qui nous traita bien et à bon marché.
Comme nous étions partis sans emporter d’effets, il fallut nous pourvoir de linge et d’habillements ; cette dépense diminua considérablement nos fonds, et quoique nous n’eussions acheté que le nécessaire, il ne nous restait plus que dix guinées et quelques bijoux. Johnson (qui avait pris alors le nom de Lindner) sentit bien que cette faible somme ne pouvait pas toujours durer, et qu’il fallait chercher les moyens de subsister quand elle serait épuisée. La crainte de voir dans la misère celle qu’il aimait plus que lui-même, le détermina à tirer parti des talents que son père lui avait donnés : il savait peindre, et, quoique jeune, il y avait peu de maîtres qui fussent en état de lui donner des leçons. Il monta donc un petit atelier ; mais les frais indispensables qu’il fut obligé de faire, réduisirent le numéraire à zéro ; il fallut même entamer les bijoux, notre dernière ressource. Enfin, il se fit connaître chez les Grands, par la perfection de ses ouvrages ; et bientôt il fut assez occupé, pour n’avoir plus recours aux expédients.
Il s’était passé plus d’un an depuis que nous vivions ensemble : heureux de notre tendresse, nous nous croyions encore au premier jour de notre félicité, et le temps resserrait insensiblement les liens chéris qui nous unissaient. Pourquoi notre bonheur devait-il être troublé par l’Amour qui l’avait préparé lui-même ? Ce Dieu volage se plaît-il donc si fort au changement, qu’après avoir reçu l’hommage de deux cœurs qu’il a réduits, il se fasse un jeu de les désunir, dans l’espérance de doubler l’encens qu’on lui offrait ? Mais il n’y réussit heureusement pas toujours, et s’il pouvait voir, au travers de son bandeau, les maux qu’il cause par son inconstance, quand il rencontre deux amants bien unis, il rougirait peut-être de sa cruauté.
Du nombre des personnes que l’état de Lindner attirait chez lui, un jeune lord qui s’était fait peindre, et lui avait procuré quelques pratiques, avait eu occasion de me voir souvent. Frappé de ce qu’il appelait alors ma beauté, il s’était mis en tête de me faire la cour ; et sans considérer qu’en cherchant à me séduire il troublerait infailliblement la paix de notre ménage, même en n’y réussissant pas, il profita d’un moment où il me trouva seule pour me déclarer sa passion.
Il n’est pas difficile de se faire une idée de la manière dont il fut reçu : j’ai donné assez de preuves de mon amour à l’heureux Lindner, pour qu’on ne doive pas craindre que je le trahisse. Je parle avec tout le sang-froid de la vertu à cet inconséquent ; je lui fais de sages remontrances sur la légèreté de sa conduite ; je le plains d’être embrasé d’un feu qui sera sans récompense, et je finis par lui défendre de revenir chez moi, s’il ne veut pas me forcer d’en instruire mon mari.
Furieux de se voir rebuté, il se promet bien de se venger, s’il ne peut réussir : rien ne lui coûtera pour en venir à ses fins ; cependant, il veut encore essayer de plaire, malgré le peu d’espérance qui lui reste ; il revient à la charge. Fatiguée de tant d’importunités, je m’en explique vivement avec lui ; et un jour qu’il était plus pressant qu’à l’ordinaire, je le congédie un peu rudement.
Lindner rentrait précisément comme cette dernière scène venait de finir : il rencontre, dans l’escalier, ce jeune homme, qu’il engage à remonter avec lui ; mais, en s’excusant, celui-ci eut l’air si troublé, que Lindner, qui s’en aperçut, ne réitéra pas ses instances.
Monté chez lui, il crut voir de l’altération sur mes traits ; il m’en demanda la cause, avec tout l’intérêt que je lui inspirais. Craignant de l’affliger, j’hésitai longtemps à satisfaire sa curiosité ; mais voyant qu’il se plaignait sérieusement du peu de confiance que je paraissais avoir en lui, et, jalouse de détourner jusqu’au moindre soupçon que pouvait faire naître la situation où je me trouvais, je lui avouai tout ce qui s’était passé, avec la candeur qui peint la vérité et la fait reconnaître.
Je n’avais jamais donné sujet à mon amant de soupçonner ma fidélité ; il n’eut donc pas de peine à croire le récit de cette aventure, dont il ne redoutait pas les suites ; mais il observa le soupirant de plus près, pour trouver l’occasion de l’éloigner, et un jour qu’il le vit entrer à la maison, il le suivit de loin dans l’escalier, avec l’intention de voir, par lui-même, jusqu’à quel point il pousserait la témérité. Il eut la satisfaction d’être témoin des efforts que je fis pour l’empêcher d’entrer dans mon appartement ; d’entendre les reproches qu’il méritait, sur son obstination à revenir, quoique je l’eusse déjà prié, tant de fois, de n’en rien faire ; et, sans être aperçu, il le vit s’introduire, malgré moi, dans la chambre et en fermer la porte.
Observez que notre appartement était composé de plusieurs pièces et avait deux portes en face l’une de l’autre, sur le même carré. Lindner en portait toujours, sur lui, les doubles clefs : il monte doucement, ouvre, sans faire de bruit, la porte opposée à celle par laquelle son rival était entré ; de sorte qu’en se plaçant dans l’intérieur, distribué par de simples cloisons, il ne perd pas un mot de la conversation.
Mon poursuivant me pressait avec toute la vivacité d’une passion qui ne connaît plus de frein : discours flatteurs, prières, menaces, il mettait tout en usage, pour me corrompre ou m’intimider ; Lindner, à chaque instant, sentait s’élever en lui des mouvements de colère contre l’insolent qui abusait ainsi de sa confiance ; mais, néanmoins, il sut se contenir jusqu’à ce qu’enfin un cri perçant, que je poussai, parce qu’on me faisait violence, le fit voler à mon secours.
Il me trouva étendue sur le plancher, où je me débattais, cherchant à me débarrasser des mains de mon oppresseur. Lindner avait l’épée à la main ; il allait l’immoler à sa fureur, quand celui-ci s’arme de la sienne et se met en défense. Les voyant prêts à s’égorger, je me jette entre eux pour les empêcher de se battre ; mais l’un est trop fier pour demander pardon, l’autre trop offensé pour l’accorder ; ils sentent bien qu’ils ne pourront jamais, en ma présence, vider leur querelle ; ils sortent, malgré les efforts que je fais pour retenir mon amant, et vont hors la ville mettre fin à leurs débats. Bientôt, en présence l’un de l’autre, une égale fureur les enflamme ; ils fondent avec impétuosité l’un sur l’autre, et tous deux reçoivent à l’instant même un coup mortel.
Qu’on se représente ma situation, au moment où j’ai vu partir mon amant ; l’inquiétude cruelle qui m’agite pendant tout le temps que je le suppose aux prises avec son adversaire, et le désespoir qui s’empare de moi, lorsque le soir je ne le vois pas rentrer, et que je passe inutilement la nuit à l’attendre. Je crois qu’il n’y a pas de maux qui puissent être comparés aux angoisses que j’éprouvai dans cette circonstance.
La matinée du lendemain se passa, sans recevoir de nouvelles positives ; enfin, j’appris le funeste événement qui m’avait séparée de lui pour toujours, et malgré les ménagements qu’on prit pour m’en instruire, peu s’en fallut que je ne succombasse à ma douleur.
Privée du seul appui que j’eusse dans le monde, que pouvais-je devenir ? À quelle âme sensible avoir recours ? Je ne connaissais personne à Londres. Devais-je retourner au sein de ma famille, dont j’avais, par ma conduite, encouru l’indignation ? Pouvais-je espérer de fléchir une mère irritée, qui ne me pardonnerait jamais ? de rendre compatissantes des sœurs dont la fierté ne voudrait pas s’abaisser jusqu’à me tendre une main secourable ? Que faire ? Comment exister ? Ah ! si l’amour donne quelquefois des jouissances, il fait souvent payer bien cher ses faveurs.
Tant que j’eus des bijoux et des hardes, je les sacrifiai pour ma subsistance ; mais enfin, réduite aux seuls vêtements que je portais habituellement, sans argent, sans ressource, le désespoir dans le cœur, il ne me restait qu’à me précipiter dans la Tamise. Mon parti était pris, et je n’aurais pas tardé à mettre, par ce moyen violent, un terme aux maux affreux qui m’accablaient ; mais l’Amour, qui eut peut-être regret de m’avoir porté de si rudes coups, voulut m’éviter encore le plus funeste ; il me conserva la vie.
Lors de l’accident qui avait causé mes malheurs, chacun s’empressa de m’offrir tous les moyens de consolation qui pouvaient être en son pouvoir ; si j’en trouvai de réels, ce ne fut que dans l’estime publique, qu’une conduite, jusqu’alors irréprochable, à quelques formalités près, m’avait méritée des honnêtes gens ; je ne me doutais pas que ce qui excitait si fort mon orgueil, pourrait, un jour, me devenir aussi indifférent que je l’ai prouvé depuis.
Parmi les amis de la maison, un jeune peintre, qui, indépendamment d’un talent rare et cher à Johnson, s’était donné la peine de nous enseigner la langue française, qu’il avait étudiée par principes, n’avait pas été le dernier à répandre, sur ma plaie, le baume souverain qui devait la cicatriser. Tant que son ami avait vécu, il avait su respecter celle qui lui était si tendrement unie. Quoiqu’il m’aimât sincèrement ; que ses yeux eussent quelquefois, malgré lui, décelé son affection, notre intimité ne l’avait pas autorisé à m’en faire l’aveu ; jamais un mot indiscret ne lui était échappé : réservé près de moi, sa délicatesse scrupuleuse, qui ferait l’éloge de son sexe, s’il avait beaucoup d’imitateurs, en lui faisant trouver dans un amour désintéressé, des jouissances inconnues à beaucoup d’autres, lui avait assuré la seconde place dans un cœur qui ne devait pas lui faire partager la première.
Quand il me vit libre, et qu’il eut laissé à ma douleur le temps de se calmer, il me parla avec franchise de sa tendresse pour moi ; je l’avais deviné ; et, prévenue comme je l’étais en sa faveur, je ne pus lui cacher plus longtemps un penchant que j’aurais en vain voulu déguiser : il reçut enfin le prix d’un amour à l’épreuve, qui ne devait pas rester sans récompense.
Bientôt après, il se mit en tête de voyager : je ne fis aucunes difficultés pour le suivre ; nous passâmes en France. Ses parents furent instruits de son départ avec moi, et pour prévenir les suites d’une liaison qui leur parut dangereuse, ils nous poursuivirent. Mon ami fut arrêté dans la diligence de Calais, que nous avions prise pour nous rendre ici. On me laissa quelques guinées que la nécessité me força de prendre, et je continuai ma route, bien inquiète sur le sort qui m’attendait dans le monde nouveau où j’allais entrer.
Heureusement que la voiture n’était pas complète : ma confusion fut moins grande, en raison du peu de témoins qu’eut cette aventure ; car nous n’avions qu’une seule compagne de voyage. C’était cette même Julie que vous avez vue quelquefois chez la bonne Dupré, où elle demeurait alors. Elle revenait de faire la conduite à un Anglais qui retournait dans son pays, après avoir vécu quelque temps avec elle. Cette fille, qui est naturellement gaie, me fit supporter ce dernier malheur avec une résignation dont je ne me serais pas crue capable. Elle sut si bien gagner mon amitié, que je la suivis chez la maman Dupré, où j’attends, avec assez de patience, ce que le hasard peut faire en ma faveur. J’ignore encore si je rentrerai, quelque jour, en grâce avec ma mère, ou si je ne dois m’attendre à revoir ma patrie, qu’après que je l’aurai perdue ; c’est ce que le temps éclaircira.
Sophie termina ainsi son récit.
Après elle, Antoinette nous raconta ce qui suit.
HISTOIRE
D’ANTOINETTE WOLNER
 i l’on voit souvent des enfants causer
de grands chagrins aux auteurs de
leurs jours, on voit bien souvent aussi,
mes bonnes amies, des parents dont
les préjugés et les passions font le
malheur de leurs enfants.
i l’on voit souvent des enfants causer
de grands chagrins aux auteurs de
leurs jours, on voit bien souvent aussi,
mes bonnes amies, des parents dont
les préjugés et les passions font le
malheur de leurs enfants.
Sophie, dans son histoire, vient de nous peindre une victime des préjugés et de l’orgueil ; vous allez, dans la mienne, en reconnaître une de l’ambition.
Je dois le jour à Frédéric Wolner, riche commerçant de Bruxelles, qui avait épousé une villageoise, sans fortune, dont il eut deux filles, Adrienne Wolner et moi. Quoique mon père n’eût pas reçu, dans sa jeunesse, une brillante éducation, il sentit la nécessité de nous en donner une, proportionnée à ses moyens : rien ne fut épargné pour nous procurer les talents qui développent les grâces du corps, et les connaissances qui ornent le cœur. Son amour paternel et sa bonté lui auraient fait faire tous les sacrifices imaginables, s’il eût été persuadé que nous dussions en acquérir quelques lumières de plus.
Il s’en fallait de beaucoup que ma mère pensât de même. Comme elle était née de parents pauvres ; qu’elle ne devait son élévation qu’à sa beauté seulement, sans posséder une seule de ces qualités qui plaisent à tout le monde et nous font chérir de ceux qui nous environnent, elle avait acquis dans ce nouvel état, au lieu des vertus domestiques qui caractérisent la bonne femme de ménage, deux défauts essentiels, peu faits, au premier coup d’œil, pour aller ensemble, mais qui paraissent avoir de grands rapports entre eux, si on les examine de plus près : je veux dire la bigoterie et l’avarice. Ainsi donc, elle trouvait toujours folles, ou pour le moins inutiles, les dépenses qu’on faisait pour notre instruction. Pourvu qu’elle amassât du bien, sans trop s’inquiéter des moyens ; qu’elle reçût chez elle des prêtres et des moines, et qu’elle nous fît hanter, plus que de raison, le confessionnal et l’église, tout le reste lui était fort indifférent.
Ces habitudes pouvaient être sans conséquences, tant que nous serions enfants, parce que le caractère doux et liant de mon père en tempérait les désagréments, et nous les faisait supporter avec moins de dégoût : mais une fois arrivées à cet âge où on commence à fixer l’attention ; où le cœur qui vient, pour ainsi dire, de s’épanouir, cherche à distinguer l’objet qui peut lui convenir, dans cette foule d’adorateurs de tous genres qui fréquentent les maisons où il y a de riches héritières à marier, nous osâmes faire des représentations à ma mère, pour l’engager à ne pas nous exposer aux railleries du public, par les ridicules qu’elle nous donnait sans s’en douter.
Ces observations, quoique faites avec ménagement, lui déplurent. Au lieu de nous regarder comme ses enfants, elle nous traita en esclaves ; son caractère, qui n’avait pas eu de prétextes pour se montrer dans tout son jour, tant que nous avions été entièrement soumises à ses volontés, se développa tout entier, dès qu’il éprouva de la résistance. Comme je montrai le plus d’opiniâtreté, ce fut sur moi que tomba tout le poids de sa haine. Je devins dès lors insupportable : on me mit au couvent, pour se débarrasser de moi, et on colora cette résolution d’un mensonge plausible, en assurant à ceux qui en paraissaient étonnés, qu’on n’avait fait que me complaire et céder aux instances que ma vocation pour cet état m’avait fait faire.
À peine avais-je disparu de la société, que ma sœur, tirant un nouvel éclat d’une fortune anticipée, qui devait bientôt résulter de la profession en religion qu’on me croyait décidée à faire, se vit entourée de prétendants au bonheur de posséder sa main. Elle fit un choix selon son cœur ; mais ma mère, qui aurait voulu voir une couronne sur la tête de sa fille, ne l’approuva pas et la fit consentir à épouser un certain marquis bien impertinent, bien fat, sans autre ressource qu’un nom peut-être usurpé, et qui croyait beaucoup honorer ma famille, en voulant bien s’unir à une fille assez riche pour le tirer de la misère.
Pendant que ce mariage se préparait, on me tyrannisait dans mon couvent pour me forcer à prendre le voile qui devait assurer le bonheur de ma sœur et satisfaire le fol orgueil de ma mère. Bien déterminée à ne jamais engager ma liberté dans un état pour lequel je me sentais une répugnance invincible, je feignais de n’en être pas trop éloignée, pour ne point irriter ceux qui, sans cette apparente résignation, auraient pu resserrer encore mes liens. On me croyait donc prête à faire ce qu’on avait mis tant de chaleur à vouloir obtenir.
Les conditions du contrat furent bientôt arrêtées et signées. Mes parents firent tous les sacrifices qu’on exigea d’eux : ma mère surtout, qui se repaissait d’avance du doux plaisir d’appeler sa fille madame la marquise, ne croyait pas en faire assez pour jouir en réalité de ce qui la flattait tant en perspective. Le mariage se fit enfin avec une pompe digne de la vanité de celle qui en avait ordonné les apprêts. Les nouveaux époux montèrent leur maison selon leur rang. On prit un hôtel magnifique : laquais, chevaux, carrosse, et tout l’attirail que l’usage exige. Tant que durèrent les écus du beau-père, on ne se refusa rien de tout ce qui peut concourir aux besoins et aux charmes de la vie. Le marquis, que la détresse où il s’était trouvé avait éloigné de ses sociétés, reprit, avec plus d’ardeur que jamais, ses anciennes liaisons, et se livra sans réserve au jeu, sa passion favorite ; mais à peine six mois s’étaient écoulés dans le faste et la grandeur, qu’on se trouva hors d’état de fournir aux dépenses de pure nécessité. D’un autre côté, les anciens créanciers de mon beau-frère, qui, depuis longtemps avaient fait le sacrifice de sommes qu’ils croyaient perdues par l’insolvabilité reconnue de leur débiteur, réveillés tout à coup par le fracas de son luxe impudent, tombèrent sur lui sans aucun égard. Il se débarrassa des premiers, en obtenant, par ma mère, le cautionnement de notre maison ; et insensiblement mon père, par faiblesse pour sa femme qui l’aveuglait sur ses propres intérêts, par les espérances supposées du gendre, engagea tout son bien pour tirer celui-ci de l’embarras où il se trouvait.
Les créanciers qui avait su profiter de la facilité avec laquelle on enlevait à mon père tout ce qu’on lui demandait, n’avaient accordé que des délais très courts : de sorte qu’aux échéances, il lui fut impossible de réaliser les cautionnements ; ils excédaient d’ailleurs sa fortune : ce qui prouve qu’en les souscrivant, il avait eu trop de confiance dans les promesses de son gendre, pour croire qu’il serait un jour obligé de les acquitter. Faute de paiement, on fit des poursuites rigoureuses, et la vente de tout ce que nous possédions s’ensuivit.
Mon père, accablé de chagrin et de regrets, trop affecté de ses malheurs, qu’il pouvait se reprocher, pour survivre à sa ruine, tomba malade quelque temps après et mourut dans les bras de ma mère, qui ne tarda pas à le suivre, et qui eut cependant le courage, mourant victime de son ambition et de son orgueil, dont les fautes rejaillissaient sur moi, d’avouer son injustice à mon égard, en me retirant du couvent quelques jours avant sa mort.
Dès le commencement du désastre de ma famille, ma sœur et son mari s’étaient expatriés avec quelques débris, pour éviter les poursuites qu’on avait dirigées contre ce dernier. Personne ne savait où ils s’étaient réfugiés ; je l’ignorerais même encore, si deux ans après, un de mes compatriotes que j’eus occasion de voir à Paris, ne m’eût appris qu’ils étaient passés en Amérique, où mon beau-frère avait un parent dont il était allé implorer le secours.
Lorsque ma mère mourut, je me trouvai seule dans le monde, sans parents que je connusse, car ceux à qui je devais le jour n’étaient point de Bruxelles, ils étaient originaires d’Allemagne, et leur établissement dans cette ville avait été accidentel : sans amis, car d’ordinaire ils suivent la fortune, et sans biens, puisque mon père avait eu la faiblesse de s’en dépouiller, je ne possédais rien dans la nature que quelques attraits et dix-neuf ans, dont les trois derniers avaient été passés à gémir dans un cloître, et un cœur tendre fait pour aimer, mais qui n’avait pas encore rencontré l’objet qui devait partager ses affections. Légère par caractère et craignant avec raison de manquer d’expérience pour me conduire assez prudemment, je crus ne pouvoir mieux faire que de m’adresser à l’un des prêtres qui étaient reçus chez mon père, comme à celui qui m’avait paru le plus digne de ma confiance : c’était le curé de la paroisse sur laquelle nous avions demeuré ; car alors j’avais abandonné ce quartier, pour me retirer dans un autre où je vivais de ce que j’avais pu sauver du naufrage.
Cet ecclésiastique, quoique jeune encore, avait cependant un air grave et de dignité qui inspirait, au premier abord, la vénération. Ses manières douces, son désintéressement apparent, mille qualités que j’avais remarquées en passant, enfin, un je ne sais quoi qui plaît et qu’on ne peut définir, me l’avaient fait distinguer des autres. J’allai donc le trouver comme ancien ami de la maison, avec toute la confiance que je devais avoir dans un homme de son caractère, pour lui demander les conseils qui devaient me guider dans le sentier de la vertu, sentier étroit et périlleux où je me proposais d’entrer.
Il était occupé lorsque je me présentai ; cependant, il me reconnut et vint à moi dès qu’il m’aperçut. Ma visite parut le flatter infiniment, car la gaieté se répandit sur toute sa figure, et je ne fus pas, je crois, la seule à m’apercevoir de l’impression que je lui avais faite. Il me demanda avec intérêt le sujet qui m’amenait vers lui, et lorsque je lui eus dit que je désirais lui parler de quelques affaires qui m’étaient personnelles, il feignit de ne pouvoir m’entendre alors, pour avoir occasion de m’entretenir en particulier, et m’indiqua pour le soir un rendez-vous chez lui.
Je fus exacte, n’ayant aucuns soupçons sur la moralité d’un homme que je respectais à plus d’un titre ; je me trouvai cependant un peu embarrassée, quand, après m’avoir reçue affectueusement, il me conduisit avec mystère dans une chambre à l’extrémité du corps de logis qu’il habitait.
— Nous serons mieux ici, me dit-il en y entrant, personne ne nous interrompra ; nous pourrons, à loisir, nous occuper de ce qui vous intéresse.
Mon inquiétude n’avait pas été, jusque-là, bien grande ; je ne pouvais deviner les véritables intentions d’un homme à qui je rougissais d’en supposer de criminelles ; mais lorsqu’il eut fermé la porte, avec une précaution scrupuleuse, qu’il se fut placé, d’un air satisfait, à côté de moi, tout près de la chaise où il m’avait fait asseoir, je remarquai avec effroi qu’il n’était pas le même. Cette gravité qu’il affectait toujours en public avait disparu dans le tête-à-tête : son teint était animé, ses yeux me lançaient des regards perçants, qui m’obligeaient de perdre contenance chaque fois que ma vue se portait sur la sienne ; et la rapidité de ses gestes, de ses mouvements, ne laissait que trop apercevoir le feu dont il était dévoré. Je voulais parler : les mots expiraient sur mes lèvres, muettes d’étonnement. L’ardent curé ne pouvait m’entretenir de la cause de son agitation, qui était devenue trop violente pour lui permettre l’usage de la parole. Enfin, un baiser qu’il osa me donner, en m’accablant de louanges, bien fades de la part d’un homme que je n’aimais pas, rappela mon courage ; je me levai pour lui faire les reproches que méritait l’abus qu’il faisait de ma confiance : il ne m’en donna pas le temps, m’empêcha de lui faire la moindre objection, en me tenant serrée dans ses bras, la bouche fermée par la sienne. Je fais cependant des efforts continus pour me débarrasser de ses mains ; mais ma défense est si faible, en comparaison de la résistance d’un homme dans toute la vigueur de l’âge, que je ne peux y réussir.
Il ne me reste donc qu’une ressource, celle d’appeler du secours, pour faire cesser la violence qu’il exerce contre moi. Au premier cri qu’il m’est possible de faire entendre, il me met une main sur le visage, me presse contre le mur, et de l’autre, il prend dans sa poche un mouchoir qu’il me passe dans la bouche, en le liant autour de ma tête. Cette atrocité excite en moi une fureur dont je ne suis plus maîtresse : je redouble d’efforts et je parviens à lui échapper. Il me poursuit tandis que je tâche, en vain, de détacher le mouchoir qui m’ôte une partie de la respiration ; mais, soit que l’indignation dont j’étais saisie eût tout à coup suspendu mes mouvements, soit que les derniers efforts que j’avais faits eussent épuisé mes forces, trop longtemps essayées, il me fut impossible de me soutenir davantage, et je tombai évanouie aux pieds de mon persécuteur. Cet état de faiblesse qui, pour tout autre qu’un monstre accoutumé à de pareilles horreurs, aurait été le frein d’une passion, dont on ne peut pas quelquefois réprimer les premiers élans, servit, au contraire, à augmenter les désirs de celui-ci. Sans pitié pour l’état où il m’a réduite, il se précipite sur moi et met le comble à sa scélératesse en abusant de la supériorité que lui donne un être presque inanimé et hors d’état de lui opposer la moindre résistance.
La douleur, cependant, ranima bientôt mes sens : je me trouvai dans les bras du cruel, qui avait aussi inhumainement consommé ma ruine ; mais tellement maltraitée que, quand il m’eut quittée, après que ses feux amortis lui eurent laissé reprendre un peu de calme, il ne me fut pas même possible de me plaindre de sa cruauté. La honte, le désespoir, le désir de me venger, et tous les divers sentiments qui agitaient confusément mon cœur ulcéré, me rendaient immobile en présence même de l’auteur de ma destruction. Je ne sais ce qui se passait aussi dans le cœur de ce monstre : s’il était enivré du plaisir de contempler la victime sur laquelle il venait d’épuiser tous les traits de la brutalité, ou s’il était encore susceptible d’un regret, en me voyant endurer les tourments que sa victoire m’avait causés ; mais il était resté pétrifié devant moi, sans que je pusse deviner le sujet de cette inaction subite. Enfin, je romps le silence pour lui faire les reproches que méritait sa conduite infâme : il m’interrompt, et d’un air leste, trop voisin de l’outrage pour n’en être pas un aussi, il entreprend de se justifier.
— Pourquoi donc, me dit-il, affecter tant de courroux contre un amant passionné qui vient de vous donner la preuve la plus éclatante de sa tendresse ? Daignez réfléchir un instant sur se qui vient de se passer ; je suis sûr que vous me rendrez plus de justice. Celui que vous regardez maintenant avec mépris, vous paraîtra peut-être digne de quelque retour. Dépend-il, en effet, de nous de commander à nos passions ? L’amour ne s’accroît-il pas en raison de la résistance qu’il éprouve ? Une fois porté à l’excès, connaît-il des digues assez fortes qui puissent s’opposer à ses progrès ? Rien n’est alors sacré pour lui : il renverse indistinctement tout ce qui se trouve sur son passage, et pourvu qu’il arrive à son but, il s’inquiète peu des chemins qui l’y ont conduit. Vous vous êtes attiré, par vos refus indiscrets, les mauvais traitements dont vous vous plaignez ; oui, ma belle amie, vous êtes aussi coupable que moi, car vous ne pouvez me reprocher autre chose que d’avoir cherché à éteindre les feux dévorants que vous aviez allumés dans mon cœur.
Honteuse, pour lui, de l’insulte qui lui servait de défense, je ne réplique pas un mot : je me hâte seulement de sortir d’une maison que j’avais en horreur. Comme il n’avait plus alors de raisons pour me retenir, il m’ouvre une porte qui donnait sur un escalier dérobé, et je m’échappe, en me promettant bien de me venger de son abominable conduite.
Je recevais alors, quelquefois, les visites d’un jeune homme, nommé Lebrun, que j’avais vu souvent chez une voisine, avant qu’on me mît au couvent, et qui, depuis que j’en étais sortie, me faisait une cour assidue : je rentrais, quand il vint frapper à ma porte. J’étais encore trop animée, en lui ouvrant, pour pouvoir lui cacher le trouble qui m’agitait ; il s’aperçut aisément du désordre répandu sur toute ma personne, et m’en demanda la cause avec l’inquiétude que lui suggérait son amour, dont il me renouvela les assurances. Je l’aimais véritablement ; il l’avait ignoré jusque là, et je n’en serais vraisemblablement pas encore convenue, sans la circonstance qui m’obligeait de lui en faire l’aveu, si je voulais trouver en lui une partie presque aussi intéressée que moi à servir ma vengeance.
— Eh bien ! je me rends à vos vœux, lui dis-je, si vous voulez me venger d’un prêtre exécrable qui, sans pitié pour la fille infortunée d’un homme qui fut son ami, a osé employer la violence pour la déshonorer.
Il jure qu’il est prêt à m’obéir. Pour exciter son courage, je lui raconte ce qui vient de m’arriver. Dans la fureur qui le transporte, il veut aller le punir sur-le-champ : je m’y oppose ; j’exige même de lui qu’avant d’effectuer sa promesse, il se concertera avec moi sur la manière d’agir, sans compromettre sa sûreté ; et pour avoir le temps de méditer quelques projets dignes de l’offense, je remis au lendemain matin à en arrêter le plan.
Je n’avais pas beaucoup dormi ; je m’étais occupée de l’objet qui faisait mon tourment, sans avoir fixé une idée satisfaisante.
Lebrun revint, comme il l’avait promis, plus déterminé que jamais à tirer du curé une prompte vengeance. Il m’apprit qu’il avait conçu un excellent projet, dont la réussite lui était assurée, si nous pouvions trouver le moyen d’avoir ce prêtre en nos mains.
— Vous n’en serez point instruite d’avance, me dit-il, parce que je craindrais que vous n’y voulussiez pas consentir. Je préfère le parti que je prends à une dénonciation dont les suites, encore bien qu’elles lui attirassent beaucoup de désagréments, ne produirait pas tout l’effet que je me promets de mon stratagème. Attirons-le seulement ici, parce que nous y serons en sûreté, vu la disposition des lieux ; et quand l’expédition sera faite, je vous apprendrai encore un autre projet, dont l’exécution sera la suite indispensable du premier.
Il fut convenu que j’écrirais au curé un mot, pour l’engager à venir me voir le soir même ; ce que je fis sur-le-champ par le billet qui suit :
« Vous n’avez pas seulement, monsieur, daigné vous informer de moi : je ne m’aperçois que trop que vous m’avez abandonnée, malgré les droits que je crois avoir à votre protection. Cette conduite est la preuve du peu de cas que vous faites d’une infortunée dont vous avez fait le malheur. Hâtez-vous de prévenir les effets alarmants d’un désespoir que vous avez à vous reprocher.
» Je vous attends ce soir à sept heures.
» Le porteur de ce billet vous donnera mon adresse précise. »
Lebrun se chargea de le faire venir, et sortit en m’assurant qu’il reviendrait avant l’heure indiquée.
Il n’était que six heures quand il reparut, accompagné de deux de ses amis, armés comme lui d’une paire de pistolets, de quelques cordes et de plusieurs autres instruments dont je ne devinai pas d’abord l’usage.
Il n’est peut-être pas indifférent de donner une idée de mon logement, pour qu’on ne soit pas étonné que le bruit qu’a dû faire la scène que je vais décrire, n’ait été entendu de personne : il était au fond d’une grande cour, et faisait partie d’un petit bâtiment isolé, dont je n’occupais que le bas ; le haut était loué à une femme d’un certain âge, qui se trouvait alors en campagne. Ce que j’habitais était composé d’une salle et de deux cabinets en profondeur. Lebrun et ses amis passèrent dans le cabinet du fond, et moi j’attendis mon ennemi dans la salle d’entrée. Tout était bien clos.
Pendant que je fus seule, quelques terreurs vinrent m’agiter ; mais le désir de me venger prit le dessus et parvint bientôt à les dissiper.
Le curé ne se fit point attendre ; sept heures sonnaient quand il vint frapper à ma porte. J’avais eu soin de me tenir dans une toilette assez négligée, pour que la pâleur que les veilles de la nuit m’avait occasionnée, parut être l’effet de l’état désespérant que je lui avais annoncé, et dans lequel je voulais qu’il me trouvât. Je lui ouvris et le fit entrer dans le premier cabinet.
En le voyant reparaître, toute sa scélératesse vint se retracer à mon esprit ; je tremblai de tous mes membres. Il s’approcha de moi d’un air gracieux, me fit quelques compliments sur ma beauté, et malgré l’air froid que j’affectai pour les recevoir, quoique intérieurement je me sentisse dévorée du feu de la colère qui me possédait, il n’eut pas à se plaindre de mon accueil, mais aussi il ne m’inspira aucune pitié pour les tourments qu’on lui préparait.
Il s’était assis à côté de moi ; déjà, en me serrant doucement la main, il cherchait à adoucir mon ressentiment par les propos les plus flatteurs, lorsque tout à coup Lebrun et ses amis sortent du cabinet et fondent sur lui le pistolet à la main.
— Tu vas périr, lui dit mon vengeur, tu vas expier tes crimes. Apprête-toi à subir le supplice dû aux forfaits dont tu t’es rendu coupable envers la malheureuse Antoinette.
J’étais allée pendant ce temps fermer la porte de la salle d’entrée, et j’en avais mis la clef dans ma poche. Le curé, étourdi de cette subite apparition, n’avait pas encore essayé de se soustraire au danger qui le menaçait ; quelques moments suffirent pour le remettre de sa frayeur. Il se leva avec précipitation et se jeta sur un des amis de Lebrun, qu’il aurait désarmé, et peut-être blessé, si l’autre ne s’y fût opposé. On s’en empara alors. Quand il se vit serré de plus près, il voulut crier ; mais Lebrun, qui se ressouvint qu’en pareille occasion le curé avait usé envers moi d’un moyen violent pour m’en empêcher, lui fit attacher ensemble les mains derrière le dos, pendant qu’il lui mettait dans la bouche, comme il me l’avait fait, un mouchoir roulé, dont il lia les deux bouts par derrière. Puis, s’adressant au scélérat qui ne pouvait plus faire usage de ses mains, ni appeler du secours :
— Tu vas être pendu, lui dit-il, c’est la mort la plus douce que nous puissions t’accorder.
Pendant qu’il lui annonçait d’un air si positif le supplice effrayant qui lui était réservé, un des amis de Lebrun, monté sur une table, enfonçait à coups de marteau dans le mur un énorme crochet de fer, capable d’en tenir dix comme lui suspendus, et l’autre lui passait une grosse corde autour du cou.
J’étais assise, un peu éloignée des acteurs, pour jouir à mon aise du tableau qu’offrait la vivacité de la scène. Les reproches dont on avait accablé le coupable, les menaces même du supplice, tout cela m’avait procuré une douce satisfaction que savourait, avec délices, ma vengeance exigeante et trop bien servie ; mais je frissonnai d’horreur, quand je vis des apprêts qui me faisaient craindre que, pour m’obtenir plus sûrement, Lebrun ne crût pas même me venger assez par la mort du curé. Celui-ci, convaincu de l’impuissance de ses efforts, livré à la fureur d’un jeune homme bien secondé, qu’il soupçonnait d’être mon amant, en proie à ses alarmes, se croyait à la dernière heure de sa vie, sans pouvoir faire entendre un mot en sa faveur. Il s’était précipité à mes genoux, et semblait me demander pardon de ses outrages, et me prier d’intercéder pour lui. Ma pitié l’avait prévenu, je déliai le mouchoir qui l’empêchait de s’expliquer ; mais je lui enjoignis de ne pas jeter un cri, parce que je le rendrais aux tortures dont je voulais le préserver.
Dès qu’il put parler, il convint avec humilité de ses torts à mon égard, et me demanda quelle espèce de réparation j’exigeais de lui. J’étais fort embarrassée de répondre, et j’allais tout simplement le faire mettre en liberté, en me contentant, pour toute réparation, de la peur qu’on lui avait faite. Lebrun, qui avait un second projet que je ne devais connaître que quand le premier aurait eu son effet, prévint ma faiblesse, en s’adressant à lui avec un ton imposant, qui ne lui permit pas de réplique.
— Vous avez abusé, avec la dernière indignité, d’une orpheline sans expérience qui, dans son malheur, allait s’adresser à vous comme à un second père ; vous avez, par ce forfait, mis le comble à son infortune. La mort qui devrait punir ce crime impardonnable dans un homme ordinaire, assez malheureux pour s’écarter des principes de l’honneur, est trop douce pour vous, ministre d’une religion bienfaisante, qui vous ordonnait, à son égard, l’usage des vertus dont vous recommandez si sévèrement la pratique aux autres, tandis que vous ne rougissez pas de les fouler aux pieds. Et vous osez demander quelle réparation on veut exiger de vous ? Il n’en est point qui soit en votre pouvoir. Vous ne pouvez qu’adoucir des maux qui feront le tourment de sa vie ; pour y parvenir, il n’est qu’un moyen que je veux bien encore vous proposer : c’est d’offrir à mademoiselle Wolner, dont vous connaissez l’indigence, les secours qu’elle a droit d’attendre de vous.
Cette proposition ne parut pas être du goût du curé, il hésita longtemps à répondre ; ce ne fut que quand il se vit pressé de s’expliquer, qu’il jura qu’il lui était impossible de faire la moindre chose en ma faveur.
Lorsque Lebrun vit qu’il ajoutait la vilenie à ce qu’on pouvait, à si juste titre lui reprocher, il le mit dans l’alternative, ou de subir le supplice qu’on lui avait préparé, ou de s’en tirer en me payant à l’instant la somme de trois mille florins, à laquelle il le taxa. Le curé eut beau protester qu’il ne savait où trouver cette somme, il l’obligea, par les menaces épouvantables qu’il lui fit, de l’emprunter à des amis auxquels il écrivit de chez moi, en prétextant qu’il était en marché de quelques ornements pour son église, et qu’il ne pouvait aller jusque chez lui, de peur de manquer cette affaire qui lui paraissait avantageuse. Il priait ses amis, dans le cas où ils voudraient bien lui rendre ce service, de remettre avec confiance au porteur de sa lettre, qui servirait de reçu, la somme qu’ils lui prêteraient.
Muni de deux lettres, l’un des amis de Lebrun courut aux adresses indiquées et, en moins d’une demi-heure, nous rapporta les trois mille florins qu’il avait reçus sans difficulté. On remit alors le curé en liberté. En le conduisant jusqu’à la porte, on le félicita d’en avoir été quitte à si bon marché ; mais le saint homme n’était pas de cet avis, si l’on en juge par la mauvaise humeur qu’il témoigna en s’en allant.
Quand il fut retiré, Lebrun fit servir un joli souper, qu’on égaya de toutes les manières, aux dépens du généreux pasteur. Les deux amis nous quittèrent ensuite ; Lebrun resta seul avec moi, malgré quelques prières de ma part, pour l’engager à les suivre. Il me rappela la promesse que je lui avais faite, de le récompenser des soins qu’il aurait pris de ma vengeance, et je me vis forcée de lui en accorder le prix.
Il me restait à connaître le second projet dont il m’avait fait mystère : je le pressai de me l’apprendre, et je sus que son dessein avait été d’exiger de l’argent du curé, pour nous faciliter les moyens de faire le voyage de Paris, où il désirait depuis longtemps d’aller, pour des raisons que j’ignorais alors, et dont je ne fus malheureusement que trop bien informée. Afin de me déterminer plus sûrement à partir, parce qu’il fallait bien que je l’accompagnasse, pour qu’il eût un prétexte de s’emparer de l’argent, il me fit entrevoir que le curé, à qui sa place donnait des relations étendues, pourrait bien faire des démarches dont les suites incertaines nous exposeraient à mille désagréments, pour ne rien dire de plus ; je me laissai persuader, et les craintes qu’il m’inspira me déterminèrent à le suivre où notre intérêt commun semblait nous appeler.
Nos préparatifs furent bientôt achevés. Le temps que je ne donnai pas à l’amour (je parle de moi seulement, car je n’étais pas payée de retour), je l’employai à faire des paquets de mes effets, et le lendemain nous partîmes pour Paris. Nous n’y restâmes ensemble qu’environ huit jours ; après quoi Lebrun disparut, emportant tout l’argent qui nous restait, à l’exception de très peu de chose que j’avais dans ma poche. Un de ses amis qui avait été acteur dans la scène du curé, et que je rencontrai il y a quelque temps, m’apprit que Lebrun n’avait fait le voyage de Paris que pour rejoindre une jeune fille qu’il avait aimée pendant mon séjour au couvent, et que ses parents avaient envoyée chez une tante, pour l’éloigner, sans espoir, d’un jeune homme qu’ils ne jugeaient pas digne d’elle ; que mon aventure de Bruxelles lui ayant fourni l’occasion de se procurer de l’argent, il avait retrouvé cette belle qui l’aimait éperdument, et était parti avec elle, sans qu’il sût ce qu’ils étaient devenus.
Il est aisé de sentir l’embarras que j’éprouvai, quand Lebrun eut la lâcheté de m’abandonner. Je ne fus pas cependant très sensible à sa perte, parce que je n’avais pas eu le temps de m’attacher fortement à lui ; je trouvai d’ailleurs bientôt des motifs de consolation dans la connaissance que je fis d’une femme charmante, qui demeurait dans la même maison que moi, et à laquelle je dois le plaisir d’avoir fait celle de la bonne Dupré, que j’aime véritablement.
Ainsi finit le récit d’Antoinette.
Quelques jours après, nous retournâmes à
Paris, où bien des gens devaient s’ennuyer denotre absence. En y arrivant, nous remerciâmes de bien bon cœur la maîtresse du logis qui nous avait procuré, par cette charmante partie, de véritables plaisirs.
comme une bague d’or au museau
d’une truie.
Prov. de Salomon, chap. II,
verset 27.

AMÉLIE
OU
LES ÉCARTS DE MA JEUNESSE
 u’une femme sans pudeur serait à
plaindre, si, lorsque emportée par le
torrent du vice, et forcée, par état, de
se livrer sans réserve aux caprices
révoltants du premier venu, elle pouvait
réfléchir sur la bassesse de sa
condition ! Dégradée à ses yeux, elle
se regarderait avec raison comme la plus vile
de toutes les créatures : l’horreur qu’elle s’inspirerait
à elle-même l’obligerait bientôt de
changer de conduite ; mais malheureusement
elle perd sa sensibilité au milieu des excès qui
atténuent ses facultés : ce qui la couvre d’opprobre,
et devrait la faire rougir de honte, ne lui paraît qu’un jeu inventé par le plaisir, pour
préparer de nouvelles jouissances. Cette femme-là
n’est donc pas à plaindre, elle n’est que méprisable.
Je vais, en rapprochant quelques traits
qui pourront faire voir jusqu’à quel degré peut
aller l’avilissement de cette espèce de femmes,
prouver en même temps qu’il est des hommes
abrutis qui n’ont de l’espèce humaine que la
forme ; qui, blasés sur les plaisirs naturels, qu’ils
ne regardent que comme secondaires, croient
n’en trouver de réels que dans les fureurs d’une
imagination exaltée par le libertinage le plus crapuleux.
u’une femme sans pudeur serait à
plaindre, si, lorsque emportée par le
torrent du vice, et forcée, par état, de
se livrer sans réserve aux caprices
révoltants du premier venu, elle pouvait
réfléchir sur la bassesse de sa
condition ! Dégradée à ses yeux, elle
se regarderait avec raison comme la plus vile
de toutes les créatures : l’horreur qu’elle s’inspirerait
à elle-même l’obligerait bientôt de
changer de conduite ; mais malheureusement
elle perd sa sensibilité au milieu des excès qui
atténuent ses facultés : ce qui la couvre d’opprobre,
et devrait la faire rougir de honte, ne lui paraît qu’un jeu inventé par le plaisir, pour
préparer de nouvelles jouissances. Cette femme-là
n’est donc pas à plaindre, elle n’est que méprisable.
Je vais, en rapprochant quelques traits
qui pourront faire voir jusqu’à quel degré peut
aller l’avilissement de cette espèce de femmes,
prouver en même temps qu’il est des hommes
abrutis qui n’ont de l’espèce humaine que la
forme ; qui, blasés sur les plaisirs naturels, qu’ils
ne regardent que comme secondaires, croient
n’en trouver de réels que dans les fureurs d’une
imagination exaltée par le libertinage le plus crapuleux.
On se rappelle que, par suite de la correction que m’avait fait donner la sévère madame de Verneuil, je n’avais pu, pendant quelque temps, m’occuper des intérêts de la Dupré : je venais enfin de lui annoncer qu’elle pouvait disposer de moi, dès qu’elle le jugerait à propos, lorsqu’un messager lui remit dix louis, avec un billet par lequel, en substance, on lui disait qu’on avait eu l’avantage de me voir, et que m’ayant trouvée fort jolie, on désirait faire avec moi une partie qu’on tâcherait de me rendre agréable. Qu’on me priait, si j’acceptais la proposition, de me trouver, le jour même, à midi précis, aux Tuileries, où on se rendrait bien sûrement. Elle me montra le billet, et malgré la petite disgrâce qui m’était arrivée dans ma dernière affaire, je la chargeai d’y répondre et de promettre que je me trouverais au rendez-vous à l’heure indiquée. Je fis une toilette brillante, parce que je présumai bien qu’un homme qui s’annonçait si généreux, avant de savoir s’il serait écouté, ne pouvait qu’être un homme comme il faut, et midi sonnait, quand j’entrai dans le jardin.
Je n’y avais pas fait vingt pas, que je vis venir à moi, avec un air enjoué, un jeune homme bien mis et d’une jolie figure, qui me fit mille honnêtetés, et m’offrit sa main pour me conduire à sa voiture. Elle nous attendait, en effet, à la porte ; nous montâmes, et en moins d’une demi-heure, nous arrivâmes à Neuilly, dans une charmante maison de campagne, dont il était propriétaire. Il me la fit parcourir en attendant le dîner ; je la trouvai commode et bien distribuée ; mais les jardins surtout me semblèrent délicieux.
À deux heures, on nous servit un superbe dîner, où la délicatesse des mets et l’excellente qualité des vins avaient été soigneusement recherchées. Après le dîner, nous passâmes dans un salon orné de glaces et meublé dans le goût le plus exquis. Nous y restâmes environ une heure à causer, sans qu’il fût question de l’objet pour lequel il semblait m’avoir invitée. Je remarquai, avec assez d’étonnement, que depuis que nous étions ensemble, il ne m’avait pas seulement embrassée une fois : je ne savais à quoi attribuer tant de froideur, et mon amour-propre souffrait de son indifférence, quand enfin il me proposa de me déshabiller ; et sans attendre ma réponse, il m’en donna l’exemple, que je suivis sur-le-champ. Tous deux rendus à notre état naturel, je me flattais qu’au moins il allait offrir à l’ensemble de mes appas l’hommage que j’avais droit d’en attendre ; mais c’était une erreur d’y songer, il n’en avait pas plus l’envie que le pouvoir. Je crus qu’il fallait que j’aidasse à la nature, et je me disposais à la secourir ; il retira ma main avec beaucoup de vivacité, en me disant que cela n’était pas nécessaire : j’attendis donc en silence la suite de cette aventure.
Après avoir tourné autour de moi plusieurs fois, et m’avoir examinée sans me toucher, il s’étendit sur un sopha et me pria de me promener seule en tous sens dans le salon, en marchant à la fois sur les pieds et les mains : j’obéis, et les diverses attitudes que ce travail me faisait prendre, produisit sur lui un effet plus prompt peut-être que celui que mes mains auraient pu faire. Je le vis enfin en état de grâce, et je m’imaginais qu’il ne m’oublierait pas cette fois dans ses prières ; mais mon heure n’était pas encore venue : il tira le cordon d’une sonnette, qui vraisemblablement avait déjà servi en pareille occasion ; et à l’instant je vis paraître un jeune nègre de cinq pieds sept à huit pouces, assez bien de figure, nu comme nous, qui, stylé aux caprices de son maître, vint à moi tout de suite, sans en attendre l’ordre ; et me levant de terre avec ses bras nerveux, il me porta, malgré moi, sur une chaise longue, placée en face du sopha où son maître était couché, et m’y étendit en se jetant sur moi. Je me mis à crier de toutes mes forces, tant j’étais offensée de cette violence, et je faisais les plus grands efforts pour me débarrasser de ses bras ; mais réfléchissant sur ma position embarrassante, dans une maison inconnue, où j’étais à la merci de gens qui pouvaient à leur gré disposer de moi, peut-être aussi tentée de goûter d’un fruit que je ne connaissais pas encore, je souffris qu’il substituât deux fois son maître dans des fonctions que ce lâche n’était pas digne de remplir, et pour lesquelles il avait plus d’aptitude que lui.
Aussitôt que le nègre eut achevé sa besogne, il sortit sans proférer un seul mot : pour moi, je me levai et je vis le maître, dans une agitation incroyable, se débattre sur le sopha et rouler en bas sur le parquet, où il trouva infailliblement autant de plaisir que son nègre m’en avait procuré.
Quand il fut remis de cette étonnante convulsion, il tira un autre cordon, et deux femmes de chambre vinrent nous aider à nous r’habiller. Nous retournâmes ensuite à la salle à manger, où une bonne collation nous attendait. Sur les sept heures du soir, nous remontâmes en voiture, et il me reconduisit à la porte des Tuileries, où il me fit ses adieux, après m’avoir donné quelques louis, qu’il n’eut pas de peine à me faire accepter, et je n’entendis plus parler de lui depuis ce jour.
Dans la même semaine, la Dupré me fit part qu’un négociant fort riche, qui voulait rester inconnu, et qui lui avait été adressé par une de ses pratiques, l’avait chargée de lui procurer une jeune femme qui voulût bien se prêter à une fantaisie dont les suites n’avaient rien de redoutable pour celle qui la satisferait ; qu’elle était instruite, par le valet de chambre de ce ridicule personnage, du moyen plaisant qu’il employait pour forcer la nature à seconder ses désirs, mais qu’elle voulait m’en faire mystère pour me ménager le plaisir de la surprise ; que comptant sur moi, elle avait cru pouvoir promettre, et que le lendemain, sur la brune, on viendrait me prendre en voiture.
Ce mystère, que la Dupré m’avait fait, piqua singulièrement ma curiosité ; je brûlais d’être au moment de la satisfaire. Le jour suivant, ce jour trop long pour mon impatience, s’était enfin écoulé : à l’heure convenue, une voiture s’arrêta devant la porte ; la Dupré reconnut le valet de chambre et me fit signe de m’apprêter. Ce fut l’affaire d’un instant, parce que je m’étais préparée ; et en moins de cinq minutes je fus en voiture : on en ferma, avec le plus grand soin, les portières, dont les glaces étaient recouvertes par des persiennes à ressorts si serrées, qu’il était impossible de voir au travers. On me fit rouler, à ce que je présume, au moins trois bons quarts d’heure, sans que je pusse savoir où l’on me conduisait : de temps en temps, je faisais des questions à mon compagnon de voyage ; mais ses réponses vagues prolongèrent mon inquiétude jusqu’à notre arrivée. Enfin, un bruit sourd que j’entendis me fit présumer que nous entrions dans une cour ; et en effet, dans le même instant, la voiture s’arrêta.
Quand je fus descendue, comme il faisait nuit alors, il ne me fut pas possible de reconnaître si j’étais à la ville ou à la campagne ; tout ce que je pus voir, c’est que j’étais dans la cour d’une maison, qui paraissait d’une vaste étendue. Le valet de chambre qui m’avait accompagnée me donna la main, et après m’avoir fait traverser une enfilade d’appartements sombres, il m’introduisit dans un boudoir fort bien éclairé, où je trouvai le personnage en question, qui me fit le plus grand accueil et les compliments les plus agréables. C’était un grand homme sec, d’environ quarante ans, et d’une complexion faible, sur lequel, au premier aspect, je ne formai pas de grandes espérances de plaisir : il y avait une demi-heure que j’étais avec lui, lorsqu’on vint annoncer que les bains étaient prêts. Nous passâmes dans une salle, où, après nous être déshabillés, nous nous mîmes chacun dans une baignoire.
Quand cette cérémonie, dont je ne devinais pas la nécessité, fut achevée, mon galant me mena dans une pièce à côté, où le valet de chambre nous suivit, apportant sous son bras deux petits coffrets qu’il mit par terre, au milieu du salon. J’avoue que ces préparatifs me donnèrent de l’inquiétude : je me rappelai cependant que la Dupré m’avait dit que je ne devais rien craindre. Je me rassurai donc. On ouvrit enfin ces trésors, et j’eus bien regret de mes frayeurs, quand je vis retirer de l’une de ces boîtes, une longue queue et des oreilles de dogue : le valet de chambre me les remit et me montra l’usage que j’en devais faire.
Les deux oreilles étaient attachées à un bandeau, que je mis sur la tête de mon galant, et lui passai autour du corps une ceinture, à laquelle pendait la queue. Ainsi équipé, il marcha sur les mains et sur les pieds, et je ne pus alors m’empêcher de rire aux éclats, en le voyant, dans cet accoutrement, faire le tour de la pièce, en donnant à la queue et aux oreilles, dont je l’avais décoré, les mouvements naturels du chien, qu’il avait imité plus d’une fois, si l’on en peut juger par l’aisance avec laquelle il s’en acquittait. L’autre contenait un bassin d’argent, rempli de miel : je crus d’abord que c’était là le souper du dogue, et je ne me trompais pas ; mais j’ignorais de quelle manière il s’y prendrait pour le manger : je ne m’attendais sûrement pas que je serais le plateau sur lequel on le lui présenterait.
Pendant qu’il se promenait ainsi, le valet de chambre prit une petite brosse douce et me frotta de miel partout le corps, depuis les pieds jusqu’au cou. Quand je fus bien barbouillée, ce domestique nous laissa. Le dogue de nouvelle espèce vint alors à moi, me lécha d’abord les pieds, puis les jambes, puis … ; enfin, aucune partie de mon corps, la tête exceptée, ne put échapper à sa langue, pas même les plus secrètes ; c’était là surtout qu’elle s’arrêtait avec plus de complaisance. Je conviendrai, de bonne foi, que cet attouchement nouveau me causa des sensations délicieuses, et m’aurait mise dans un état bien cruel, s’il n’eut pas procuré à son auteur le pouvoir d’apaiser les désirs qu’il avait fait naître en moi ; mais j’observai qu’à mesure qu’il léchait mon corps, le sien prenait de la consistance, dans un endroit que je perdais de vue le moins possible, et quand il crut son thermomètre au degré de chaleur convenable, il se débarrassa de son attirail bizarre et me conduisit sur une ottomane où, par des exploits dont je ne le croyais pas capable, il sut mériter le pardon de son goût ridicule.
Nous retournâmes ensuite à la salle des bains, où l’on nous apporta nos vêtements, que nous ne prîmes qu’après nous être bien rafraîchis. Je fis ensuite mes adieux à cet amant d’espèce nouvelle ; en nous quittant, il me remit trente louis et me donna la main jusqu’à la voiture qui m’avait amenée, dans laquelle, en usant des mêmes précautions, on me reconduisit chez moi.
Quelque temps après cette brillante expédition, il se présenta à la maison un homme d’une trentaine d’années, qui me fit demander la permission de passer, dans l’après-midi, une heure avec moi ; j’accordai facilement le rendez-vous, et à quatre heures et demie, comme nous en étions convenus, j’entrai au salon, où j’étais déjà attendue. Mon premier soin fut d’examiner, de la tête aux pieds, l’homme auquel j’allais avoir affaire. Il était vêtu dans le genre simple, mais très proprement. Son extérieur, quoique grossier, avait pourtant quelque chose d’agréable, et son teint vif et coloré, annonçait une santé robuste. Il me balbutia, d’un air assez maladroit, quelques compliments mal tournés, auxquels j’eus l’air d’être sensible, et il m’embrassa avec assez de timidité, en me priant de me mettre à la légère, pour lui procurer le plaisir de voir les beautés que ma jolie figure semblait lui promettre. Toujours docile aux volontés des autres, je me débarrassai du peu de vêtements qui lui faisaient ombrage, et j’exigeai, à mon tour, qu’il quittât les siens. Cet ordre ne parut pas d’abord de son goût ; cependant, sur mes instances réitérées, et d’après les menaces que je lui fis de me r’habiller, s’il ne suivait pas mon exemple, il m’obéit assez lentement.
Je ne sais pourquoi je lui demandai ce sacrifice, car il devait m’être assez indifférent qu’il fût nu ou habillé ; cependant, je présume que ce jour-là mon humeur libertine avait pris le dessus, et que je voulais profiter de l’occasion, pour jouir plus à mon aise du plaisir que je me promettais avec ce champion, dont la vigueur apparente m’avait séduite ; mais je fus bientôt détrompée, quand je m’aperçus que mes charmes n’avaient pas fait le moindre effet sur lui, quoiqu’il eût eu le temps de les considérer depuis que je les étalais à ses regards. Je m’approchai de lui, je lui fis les caresses dont le charme est inévitable ; rien n’opéra. Il s’aperçut de mon dépit, et tacha de se réconcilier avec moi par des baisers, que j’avais à peine le courage de recevoir, tant son piteux état m’avait inspiré de dégoût pour lui. Quand il me vit aussi froide que j’avais d’abord parue animée, il m’avoua, avec confusion, que pour forcer la nature d’agir en lui, il était réduit à employer des moyens violents ; qu’il avait fait usage des verges et des mouches cantharides, mais qu’elles lui avaient été d’un faible secours ; que ce n’était que depuis peu que le hasard lui avait fourni le véritable spécifique.
— J’avais, me dit-il, mal aux yeux depuis quelque temps ; on me conseilla de me faire percer les oreilles : je m’y décidai, malgré le peu de confiance que j’eusse dans ce remède. J’entrai chez un orfèvre où le hasard me conduisit. Une jeune femme y tenait le comptoir ; elle était seule ; elle offre de me faire l’opération. Une main douce et potelée s’empare de l’une de mes oreilles, et l’autre est armée de l’instrument que j’aurais peut-être redouté dans celle d’un homme. À peine elle m’a percé, ô prodige ! ô bonheur incroyable ! je sens s’allumer en moi ce feu de la nature dont je n’avais jamais senti que les étincelles. Transporté de joie, j’achète l’instrument qui me rend à la vie, et quand je veux me livrer, sans réserve, aux plaisirs de l’amour, je le confie à de jolies mains comme les vôtres, qui, en renouvelant l’heureux procédé de ma charmante opératrice, me rendent le pouvoir de servir la beauté.
En achevant ces mots, il tira de sa poche l’instrument en question, et me le remit. J’étais si pressée de voir l’effet de ce bijoux, que je ne me le fis pas redire, et je m’emparai promptement d’une de ses oreilles ; mais le malheureux y avait déjà tant de fois aiguillonné la nature, qu’il ne restait presque plus de place intacte ; cependant, à force d’examiner, je trouvai encore de quoi opérer. Je venais d’enfoncer l’instrument magique : à l’instant, mes yeux se portent sur l’objet de mes désirs qui, jusque-là, était resté immobile : je le vois s’animer et s’apprêter à se dédommager du temps qu’il vient de perdre.
— Grâces vous soient rendues, ma belle, me dit-il, de la métamorphose que vous venez d’opérer : daignez me permettre actuellement, de vous en témoigner toute ma reconnaissance.
Et sans attendre ma réponse, qu’il devina, il me prit dans ses bras et me porta sur un sopha, où j’oubliai sans peine les moments de dépit que mes premières tentatives m’avaient causés.
Dans le même temps, un autre homme, qui pouvait bien avoir cinquante ans, vint un soir me trouver dans ma chambre, avec un air mystérieux et me dit que depuis plusieurs jours il cherchait l’occasion de me trouver seule, pour passer avec moi quelques instants délicieux. Qu’il osait espérer de ma complaisance, que je ne le refuserais pas, et qu’il serait très reconnaissant de cette marque de bonté.
L’air suppliant de cet adorateur ne m’annonça rien de bon ; je me doutai bien que sa visite n’avait pas pour but de me procurer de grands plaisirs, et que, si par hasard il lui était encore possible de m’en faire éprouver, quels qu’ils fussent, je serais obligée de les acheter un peu chèrement, par une patience à l’épreuve et un travail pénible. Je ne m’étais pas trompée, car dès que j’eus répondu que j’étais flattée de l’honneur qu’il m’avait fait de me choisir, pour lui rendre quelques services agréables, il quitta l’air soumis qu’il avait d’abord pour paraître satisfait de ma réponse, et après avoir fermé au verrou la porte de ma chambre, il vint à moi et me déshabilla lui-même de la tête aux pieds ; puis il délia, devant moi, un petit paquet qu’il avait sous le bras en entrant chez moi, et en retira d’abord une espèce de jupon, fait à peu près comme sont ceux des garçons brasseurs et des boulangers ; puis un bonnet de velours avec un bourrelet pareil ; et enfin, une robe faite à l’enfant, avec ses lisières. Quand il se fut déshabillé à son tour et qu’il eut endossé ce déguisement original, il prit un livre et me donna une poignée de verges pour le fustiger toutes les fois qu’il ferait des fautes dans la leçon qu’il me chargea de lui faire lire.
Quand il m’eut bien mise au courant de Ce qu’il voulait que je fisse, nous nous mîmes en besogne. Je lui fis d’abord faire plusieurs fois le tour de la chambre, en le promenant, comme un enfant, par la lisière ; et pour l’encourager à marcher tout seul, ou pour le récompenser quand il ne s’était pas laissé tomber, je lui faisais les caresses qu’une gouvernante fait ordinairement au poupon qu’on lui a confié, et j’étais obligée de l’embrasser de temps en temps et de lui promettre du bonbon et des joujous, s’il marchait comme un homme.
Mais quand nous en vînmes à la leçon, il n’y eut plus de quoi rire, car il ne pouvait pas lire deux mots de suite, et chaque fois qu’il se trompait, ce qu’il faisait souvent pour multiplier la correction, il fallait que je lui donnasse le fouet bien appliqué, en le menaçant toujours de le lui administrer plus fort, s’il ne lisait pas mieux. Enfin, à force de renouveler cette punition, qui me lassait fort les bras, je vis les fesses de mon grand enfant se couvrir d’une teinte un peu rougeâtre. À cette vue, qui était un signal donné pour fouetter à toute outrance, je m’armai de courage, et il tomba bientôt une grêle de coups de verges, qui, en un instant, firent ruisseler le sang de toutes parts.
C’était là que m’attendait mon petit libertin, qui me faisait toujours signe de ne pas cesser : ma foi, pour hâter le dénouement d’une scène dans laquelle je faisais un rôle si fatigant, j’employai tant de force pour appliquer mes coups, que bientôt les plaies s’agrandirent et qu’une partie des verges s’y introduisit en se rompant. Dans ce moment mon imbécile se laissa tomber par terre, où il s’étendit et se roula, en paraissant éprouver des sensations que je ne peux et que je ne cherche pas à définir : je présume cependant, d’après ce que j’ai remarqué dans ses traits et dans ses mouvements, que le plaisir qu’il ressentit lui avait fait totalement oublier le mal qu’il avait souffert pour se le procurer.
Je laisse à ceux qui voudraient faire usage de cette douce recette, toutes les jouissances qui en peuvent résulter, d’après l’exemple que je leur rapporte ; à mon égard, je me rappelle trop bien que quand on m’en fit user malgré moi chez Verneuil, j’aurais sacrifié, de bon cœur, au plaisir qu’il m’avait fait goûter dans son boudoir, toutes les prétendues voluptés qu’on avait essayées sur moi dans l’appartement de sa femme.
Je m’amusai beaucoup de ces singulières aventures avec la mère Dupré, et souvent depuis, dans nos parties de plaisir, j’égayais la conversation en les racontant.
Je ne finirais pas, si je voulais passer en revue toutes les aventures que le plaisir, l’usage, et même le dégoût m’ont fait rencontrer dans cette maison pendant les deux années que j’y suis restée ; mais comme elles n’ont varié que dans les accompagnements, et que le but en était toujours le même, je ne dois pas exposer le lecteur à l’ennui qui naîtrait à coup sûr de la monotonie des dénouements. La dernière cependant, quoique simple dans ses effets, doit être connue, puisqu’elle occasionna entre la Dupré et moi une rupture que mon désintéressement, dans toutes les occasions, aurait bien dû prévenir.
Un matin j’étais sortie seule pour aller prendre l’air aux boulevards. Je m’en revenais, lorsque je fis rencontre d’un jeune homme que j’avais vu chez la Dupré, dans les premiers temps que je demeurais chez elle, mais qu’elle avait éconduit, pour des raisons que j’ignorais. Il était en cabriolet, suivi d’un seul domestique : il me reconnaît, et du plus loin qu’il m’aperçoit, il précipite la marche de son cheval et s’arrête auprès de moi.
— Que je suis heureux, me dit-il, en s’élançant de sa voiture ! que je me sais bon gré de ma promenade, puisqu’elle me procure le plaisir de revoir la belle Amélie !
Tout en disant cela, il me donne la main pour monter en voiture, et nous voilà en route.
En un instant nous arrivons au bois de Vincennes : un déjeûner charmant nous prépare à renouveler connaissance ; nous le terminons par une offrande à l’Amour, ce dieu que nous avions autrefois servi sans le connaître et que je crus alors distinguer parfaitement aux plaisirs dont il s’était environné.
Nous étions à peine remis de l’extase où nous avait jeté le sacrifice, mon jeune amant me regarde avec un air passionné.
— Il me vient, ma belle, me dit-il, une idée excellente qu’il faut réaliser. Faisons ensemble une neuvaine pour obtenir du dieu que nous venons d’adorer les grâces nécessaires aux cœurs qui cherchent à s’unir éternellement.
— Je la ferais volontiers, lui répondis-je, si je pouvais disposer de mon temps ; mais la Dupré ne s’arrangerait pas de mon absence.
— Eh ! que t’importe ce que peut dire cette femme ? n’es-tu pas libre de faire ce qui t’est agréable, et l’homme du monde qui t’aime le plus ne l’emportera-t-il pas sur cette mégère ?
Le ton persuasif qu’il donna à ses sollicitations et l’envie de jouir une fois, pour mon compte, de la plénitude de ma liberté, m’ôtèrent la force de le refuser ; je promis tout, et après avoir consulté la bourse du pèlerin, qui parut suffisante, nous déterminâmes notre marche pour les neuf jours que devait durer notre pèlerinage.
Avant le départ, il fallait bien se munir de quelques bagages ; mon compagnon de voyage me reconduisit à cent pas de la maison de la Dupré, et le rendez-vous fut donné pour une heure, au plus tard, sur la place Vendôme, parce qu’il lui fallait aussi le temps de faire quelques arrangements.
Il était midi sonné ; je monte à ma chambre ; mon paquet fait, je redescends, et sans être vue de personne, je cours au rendez-vous : le pèlerin arrive en même temps que moi ; nous nous rejoignons, et fouette cocher.
On ne doit pas s’attendre à de grands évènements dans une partie faite entre deux personnes qui ne veulent devoir leurs plaisirs qu’à eux-mêmes : aussi n’eut-elle rien de remarquable ; elle me procura seulement l’agrément de voir une grande partie des maisons de plaisance qui se trouvent dans les environs de la capitale.
Les rites du pèlerinage furent suivis avec la plus scrupuleuse exactitude ; mais si les prières ferventes que nous fîmes aux neuf stations que nous avions fixées nous méritèrent les regards favorables de la divinité qui en était l’objet, elles me laissèrent à moi un souvenir bien cruel de mes bontés pour l’indigne acolyte que je m’étais choisi.
La neuvaine expirée, nous revînmes à Paris : malheureusement pour moi, mon conducteur me ramena trop près de la maison : comme je descendais de voiture, la Dupré sortait de chez elle. Dès qu’elle me voit, elle rentre et m’attend dans l’escalier. Je comptais bien sur un peu d’humeur de sa part, pour ne l’avoir pas prévenue d’une si longue absence ; mais j’étais loin de penser que, sans égards pour les services que je lui avais rendus, elle me traiterait avec la dernière indignité. En effet, les expressions les plus révoltantes, les manières les plus brusques, tout fut mis en usage contre moi par cette méchante femme ; et jamais on ne fit à quelqu’un une scène plus abominable.
Je l’écoutai d’abord avec assez de patience ; mais lasse enfin de son intarissable et brutale éloquence, je me débarrassai d’elle et courus à ma chambre. Elle voulut m’y suivre ; je m’y enfermai ; et si par ce moyen j’évitai sa présence, je ne pus me dispenser d’entendre les injures dégoûtantes qu’elle ne cessa de vomir contre moi, pendant plus d’une heure. Je démêlai, dans tout ce qu’elle me dit, que ce qui l’avait le plus choquée, c’était mes liaisons avec un homme qu’elle avait chassé de chez elle, et qu’elle me menaçait d’en faire autant de moi, pour me donner le temps de le voir à mon aise.
Je ne voulus point attendre cette humiliation ; je fis sur-le-champ mes paquets et je descendis chez elle pour lui demander compte de l’argent qu’elle avait à moi, car j’avais fait la sottise de ne garder que quelques louis pour mes menus plaisirs. Elle refusa de me remettre ce qui m’appartenait, en m’objectant que je ne pouvais pas sortir de chez elle avant d’être remplacée, et que si je me permettais de la quitter, sans son aveu, elle voulait avoir entre les mains de quoi la dédommager des pertes que je lui occasionnerais.
Indignée de ce dernier procédé, dont l’infamie surpassait tous les autres, je sors avec précipitation, bien décidée, quoi qu’il dût m’en coûter, à ne point rester chez une femme avec laquelle je ne sentais que trop qu’il ne m’était plus possible de vivre, et mes premiers pas me portent chez l’amant qui venait de me quitter. On me dit qu’il est reparti depuis près de deux heures pour la campagne, qu’on ne sait où il est allé, et qu’on ignore quand il reviendra.
Il était clair comme le jour que c’était une défaite ; que son caprice satisfait, il ne voulait plus entendre parler de moi ; je crus bonnement ce qu’on me disait, sans faire de réflexions sur un départ précipité qui pouvait être véritable ; mais je fus bientôt en état de connaître un autre motif de son refus, c’est qu’il m’avait mise dans le cas d’avoir de grands reproches à lui faire, et qu’il se serait bien gardé de reparaître devant moi, pour n’avoir pas à rougir de sa conduite à mon égard. Je m’étais flattée qu’étant la cause du désagrément que j’éprouvais, il s’empresserait de m’offrir un asile contre les vexations de la Dupré ; je fus bien trompée dans mon attente.
Désespérée de ce contre-temps, qui me mettait dans l’alternative, ou de retourner en suppliant chez cette méchante femme, ou de m’abandonner à moi-même, sans savoir ce que je deviendrais, mon amour-propre détourna mon attention des conséquences de ma fuite, et mon entêtement fixa mon irrésolution. La tête montée, je me détermine à me loger dans un quartier tout opposé à celui que je viens de quitter, et me voilà en route, très déterminée à ne revenir sur mes pas que pour enlever mes bagages. Il y a lieu de croire que la précipitation avec laquelle je cheminais, jointe à l’air égaré qui me donnait quelques petits mouvements de fureur, me rendaient parfaitement ridicule, car il n’y avait point de passant qui ne s’arrêtât pour me regarder : j’allais cependant toujours mon train ; je m’inquiétais fort peu de ce qu’on pouvait dire et penser de moi.
Il y avait déjà plus d’une demi-heure que je battais le pavé, lisant, en courant, tous les écriteaux de chambres à louer que j’apercevais, lorsqu’au détour d’une rue je fus rudement coudoyée par un jeune homme qui allait comme un fou. Le choc fut si violent que nous nous arrêtâmes tous deux en face l’un de l’autre, et que je manquai me trouver mal d’un coup de coude que je reçus dans la poitrine. Ce jeune homme me fit mille excuses de sa brutalité involontaire, et me voyant beaucoup souffrir, me dit que sa mère demeurait à quatre pas de l’endroit où nous étions ; qu’il m’engageait à l’y accompagner pour qu’il lui fût possible de me donner les secours qui m’étaient nécessaires. Les douleurs que je ressentais véritablement, et surtout l’espérance de trouver, par les soins de la mère de mon inconnu, un lieu sûr pour me réfugier, me firent accepter sans balancer l’offre obligeante qu’il me faisait. Je lui donnai le bras, car j’avais un peu de peine à me soutenir, et bientôt nous arrivâmes à la maison de la mère. Elle avait son entrée par une allée assez malpropre, au bout de laquelle était un escalier très sombre, où de la lumière, en plein midi, n’eût pas été de trop.
Parvenus au second étage, mon conducteur sonna ; une vieille servante vint ouvrir ; il me remit entre ses mains pour me conduire dans la pièce qui faisait face à la porte ; et il passa d’un autre côté, pour aller, me dit-il, chercher sa mère ; mais bien pour prévenir de ses desseins, celle à laquelle il allait donner ce titre.
J’étais à peine assise, que je sentis un grand mal d’estomac, et dans l’instant je tombai sans connaissance. On profita de ce nouvel accident pour me déshabiller de la tête aux pieds, et j’étais au lit quand je revins à moi. Une femme d’assez mauvaise tournure, assise auprès de mon lit, paraissait prendre intérêt à ma situation ; pour le jeune homme, il n’y avait pas de caresses qu’il ne me fît, pas d’attentions qu’il n’eût pour moi. Quand je parus n’avoir plus besoin de secours, la mère se retira, et je restai seule avec le prétendu fils. Mon homme, prompt dans ses expéditions, et habile à profiter de ma position avantageuse, sans autre cérémonial, met la main dans le lit. Je laisse aux amateurs à deviner le chemin qu’il lui fait prendre ; aucune route ne lui est étrangère, elle les parcourt toutes. Je veux m’opposer à ses entreprises en lui représentant l’indécence de sa conduite, surtout chez sa mère, à laquelle je dois des égards pour les soins qu’elle a bien voulu me donner ; il va toujours son train ; je crie, mais inutilement ; tout le monde est sourd, dans une maison où l’or est le mobile des actions, et je me vois contrainte à subir la loi du plus fort. D’une main il se prépare au combat, de l’autre, il fait tomber le drap et la couverture, et en même temps il me joint sur le lit, où je suis obligée d’acheter, en me résignant à ses volontés, l’espèce de protection qu’on veut bien m’accorder.
On nous avait sans doute examinés pendant le cours de cette opération, car mon inconnu descendait du lit quand sa prétendue mère entra. Dès que je l’aperçus, je me couvris les yeux avec mes mains, tant j’étais honteuse qu’une femme me surprît en cet état ; elle vint à moi, me plaisanta sur ce qui venait de se passer entre son fils et moi, et sous prétexte de me chatouiller pour m’enhardir à la regarder, elle releva ma chemise et la détourna plusieurs fois, malgré ma résistance, pour faire l’examen de mes charmes.
La conduite étrange de cette femme hardie me parut un peu suspecte : je ne pouvais concevoir comment une mère osait ainsi se prêter au libertinage de son fils, et l’y encourager par les propos les plus licencieux. J’eus beau réfléchir sur ce qui se passait sous mes yeux, je fus loin de toucher au but, et mes idées se perdirent dans un labyrinthe de conjectures, toutes plus fausses les unes que les autres. La vérité était, comme je le sus quelques jours après, que ce jeune homme, fin connaisseur en fait de femmes, avait cru voir, du premier coup d’œil, tout le parti qu’il pouvait tirer de l’aventure, et trop éloigné de chez lui pour me proposer de m’y conduire, ce que j’aurais pu d’ailleurs refuser, il avait imaginé de me faire monter chez une femme publique de sa connaissance, d’où il sortait quand nous nous étions rencontrés ; et pour de l’argent lui avait fait jouer le rôle dont elle s’était jusque-là acquittée avec assez d’intelligence, pour me faire donner dans le piège.
On me rendit pourtant mes habillements, et la chère mère, toujours plus officieuse, voulut absolument m’aider à me r’habiller. Quand ma toilette fut achevée, nous passâmes avec son fils dans un petit boudoir assez proprement décoré. Ce fut là qu’il me fallut essuyer une bordée de questions, de la part de cette femme intarissable. J’y répondis comme il me parut convenable de le faire ; mais ce que je fus obligée d’avouer, puisque c’était là la cause de mon embarras, c’est que j’avais quitté une maison dans laquelle je ne voulais plus retourner, et que je cherchais un petit logement pour me retirer, jusqu’à ce que je fusse en état de me décider à quelque chose.
— Vous n’irez pas plus loin, me dit alors le jeune homme, et si vous voulez habiter cet appartement avec ma mère et moi, vous nous ferez le plus grand plaisir.
Je le remerciai beaucoup de tant d’honnêtetés, et je fis d’abord, pour la forme, quelques difficultés d’accepter une proposition qui me flattait infiniment ; mais à la fin, je parus céder aux vives sollicitations qu’on me fit ; je consentis à rester dans cette maison, dont j’ignorais les usages, la regardant pour lors comme l’unique remède aux maux que mes inconséquences m’avaient attirés. On fut très satisfait de me voir accepter ; pour moi je me félicitai de mon côté d’avoir fait une heureuse rencontre.
Quand tout fut arrangé, mon nouveau galant sortit et ne revint que le soir. À onze heures, on nous laissa seuls dans la pièce qu’on m’avait destinée ; il nous y enferma et se mit au lit en m’invitant à venir l’y rejoindre ; quand j’aurais fait la difficile, il eût toujours fallu en venir là, et je n’aurais pas eu le mérite de faire de bonne grâce, ce qu’on avait d’abord exigé. Je ne me fis donc point prier, et je n’eus pas lieu d’avoir regret de ma complaisance ; car Hercule, dont on a si hautement vanté les exploits dans ce genre, ne s’est peut-être jamais autant signalé que mon vigoureux athlète.
Le lendemain, je retournai chez la Dupré, pour n’être pas tout à fait dupe de cette femme, qui n’aurait pas mieux demandé que je la laissasse en repos. Le ton de fermeté que je mis, en réclamant ce qui m’appartenait, l’empêcha sans doute de retenir mes effets, car elle me les remit sur-le-champ, à l’exception du peu d’argent qu’elle avait entre les mains, dont j’aimai mieux faire le sacrifice que d’avoir plus longtemps des intérêts à démêler avec une femme que j’avais en horreur.
Il y avait déjà quinze jours que j’étais dans cette maison ; tout semblait se réunir pour m’y attacher, quand un matin mon galant, que j’avais entendu nommer Sorbey, et qui, ce jour-là, s’était levé de meilleure heure qu’à l’ordinaire, rentra dans ma chambre, transporté de fureur ; il m’accabla d’injures, en m’accusant d’avoir empoisonné les plaisirs que je lui avais procurés, et de l’avoir livré aux horreurs d’une maladie dont il venait de voir et de ressentir les avant-coureurs. J’eus beau lui protester que j’étais innocente ; que s’il tenait de moi le mal dont il se plaignait, je l’ignorais et le devais à la bassesse d’un homme qui avait abusé de ma faiblesse pour lui, rien ne put éteindre son courroux ; j’en éprouvai bientôt les plus cruels effets. Il fondit sur moi à coups de canne, et m’aurait infailliblement assommée, si l’on ne fût venu à mon secours. La première qui accourut, au bruit que fit Sorbey, fut sa vénérable mère ; elle s’informa du sujet de notre querelle, et voulut à toute force se rendre médiatrice entre son fils et moi : elle eut beau faire, il soutint qu’il ne s’était point exposé, depuis longtemps, à ce danger ; qu’il était enfin plus que persuadé qu’il n’y avait que moi qui fût cause de ce dont il se plaignait. Il m’ordonna de sortir à l’instant de la maison et de ne jamais y remettre les pieds, parce que l’ingratitude dont je m’étais rendue coupable envers lui m’en défendait pour toujours l’entrée et me privait des droits que je pouvais avoir acquis sur son amitié. Il ajouta qu’il allait vaquer à ses affaires et qu’il espérait, qu’en rentrant le soir, il ne me retrouverait plus.
Quand il fut dehors, je m’excusai du mieux que je pus auprès de sa mère ; je lui jurai, sur ma reconnaissance envers elle, que je ne savais pas l’état auquel on m’avait réduite, quand le hasard m’avait amenée chez elle.
— Ne vous inquiétez pas, me dit cette femme, la situation dans laquelle vous vous trouvez m’intéresse beaucoup, et je ne vous abandonnerai pas.
Elle entra ensuite avec moi dans les plus grands détails ; ce fut dans ce moment-là que j’appris qu’elle n’était point mère de Sorbey, mais bien ce que j’ai déjà dit plus haut. Elle ne perdit point un instant, me conduisit chez une de ses amies de même profession qu’elle, où je fus parfaitement bien traitée, et où, en très peu de temps, je rétablis la brèche faite à mon tempérament.
Il n’est pas difficile de deviner de quelle manière je fus reconnaissante, et comment je payai les services que m’avait rendus cette femme obligeante, mais intéressée. Je tairai donc mes aventures chez elle : elles n’ont rien d’ailleurs de bien remarquable. Je dirai seulement qu’après quinze mois passés à concourir, par l’abandon de mes charmes, aux différents plaisirs des hommes que cette avaricieuse créature m’envoyait, sans avoir retiré aucun fruit de ma complaisance, dont elle s’attribuait tout le profit, j’eus le bonheur d’y rencontrer le secrétaire d’un lord, qui me présenta à son maître, auquel je plus. Ce seigneur me retira de l’état d’assujettissement où j’étais, et m’emmena à Londres, où il m’entretint avec magnificence, mais, apparemment qu’il craignit que mon introducteur ne conservât des droits sur sa protégée, car il le laissa à Paris, et il ne reparut point en Angleterre pendant tout le temps que je demeurai chez milord.
Portée, par le hasard, au plus haut degré de splendeur où puisse arriver une femme entretenue, je ne laissai pas longtemps briller les rayons du bonheur qui vinrent luire sur moi ; car une passion violente, que je conçus pour un autre homme que celui qui en était le centre, les fit totalement disparaître. Milord était vieux, je n’avais pas vingt et un ans : les faveurs de la fortune ne purent amortir les fougues indomptables de l’âge, et je perdis tout, pour avoir fait à mon amour le sacrifice de ma raison.
Un jeune ecclésiastique, auquel était confiée l’éducation d’un neveu orphelin, vivait avec nous à la campagne. Le dégoût que m’inspirait un vieillard exigeant, et l’habitude de voir tous les jours ce jeune homme dans une maison d’où la jalousie écartait tout être vivant, excepté ce favori du ciel qui, par son caractère, et comme chargé du soin de m’enseigner la langue anglaise, ne portait aucun ombrage, me donnèrent insensiblement du penchant pour lui. Il ne s’agissait plus que de tirer parti de mes bonnes dispositions. J’avoue que j’en avais grande envie. Je m’étais déjà aperçu plusieurs fois que l’aimable abbé m’avait fixée avec beaucoup d’attention. Je jugeai de là qu’il ne me serait pas difficile de l’amener au point où je le désirais : l’occasion seule m’avait manquée ; l’amour me servit trop bien : elle ne tarda pas à se présenter.
Milord reçut une lettre par laquelle on lui mandait que sa présence était absolument nécessaire à Londres, pour y régler quelques affaires qui concernaient son pupille. Il m’en avertit le soir même, et le lendemain matin, il monta en voiture avec son neveu, en m’assurant qu’il ferait la plus grande diligence, et que, dans deux ou trois jours, au plus tard, il serait de retour. J’eus l’air d’être désespérée de son départ précipité ; trompé par ces marques apparentes de mon attachement, il prit congé de moi, presque aussi satisfait de ma tendresse, que j’allais être flattée de son absence.
Rentrée avec l’abbé, qui avait aussi fait ses adieux, je parus désolée, pour lui, de l’espèce de solitude à laquelle ce voyage allait le livrer ; je le plaignis de l’ennui qui l’attendait pendant l’absence de milord et de son élève.
— Y pensez-vous, me dit-il, madame, de plaindre le plus heureux des hommes, quand un événement inattendu vient mettre le comble à son bonheur ?
Quoique je l’eusse mis sur la voie, pour connaître ses sentiments à mon égard, je feignis de ne le point entendre, et je remarquai, avec plaisir, que son teint et ses yeux s’animaient.
— Combien ne serai-je pas dédommagé, reprit-il, si vous me permettez de passer quelques instants auprès de vous !
Je le lui promis, par charité pour lui ; et j’ajoutai, en riant, que s’il était bien sage, nous irions, pour nous dissiper, faire un tour de parc.
Il est impossible de rendre la joie que lui fit cette proposition ; tout hors de lui, il me balbutia mille remerciements, me baisa la main, et sortit pour se disposer à m’accompagner et attendre mes ordres. Pour moi, je me gardai bien de faire une toilette, que j’étais sûre que la promenade dérangerait : un joli négligé fut toute ma parure, et me rendit cent fois plus belle aux yeux de mon charmant prestolet.
Il m’attendait déjà depuis longtemps, quand je le fis avertir. Je ne dirai pas qu’il courut à ma rencontre, il y vola pour me donner la main ; et nous fûmes bientôt dans le parc. Tout en allant, mon cher abbé m’édifiait par les discours les plus passionnés. Comme il avait de l’esprit, j’avais grand plaisir à l’entendre, et je ne faisais pas attention au chemin que nous suivions. Je m’en rapportais entièrement à lui, sur la route qu’il me faisait parcourir, bien persuadée qu’il ne m’égarerait pas, puisque nous tendions au même but.
Déjà nous avions suivi et traversé plusieurs allées, quand il m’en fit prendre une qui conduisait à une charmille, dans laquelle se trouvait un pavillon, où j’avais été m’ennuyer quelquefois avec milord. Je me doutais bien de l’intention de mon conducteur ; et, favorablement disposée, comme je l’étais pour lui, on n’a pas de peine à croire que je n’hésitai point à l’accompagner. Quand nous fûmes à la porte du pavillon, il m’invita, d’un air galant, à entrer pour prendre le frais. Je me rendis à l’invitation et me jetai sur un lit de repos, où l’abbé pris place à côté de moi. Ces messieurs sont très prompts dans leurs expéditions ; à peine se donna-t-il le temps de me reparler de sa tendresse, il voulut m’en convaincre ; déjà plusieurs baisers m’avaient été pris : un seul, que je rendis par hasard, mit le feu à la mèche ; et le fripon, en me renversant, m’apprit que l’éloquence et l’érudition n’étaient pas les seuls talents qu’il possédât.
Une heure entière s’écoula dans l’ivresse des sens et dans les raffinements d’une jouissance que le voluptueux abbé sut prolonger par tous les moyens possibles. Quand il eut mis fin à ses amoureux transports, chacun se rajusta de son mieux pour ne point éveiller le soupçon sur ce qui venait de se passer, et on reprit la promenade. Chemin faisant, mon amant me renouvela les protestations de son amour, et il fut convenu qu’en prenant toutes les précautions nécessaires, nous passerions la nuit ensemble.
De retour au château, nous nous retirâmes chacun dans notre appartement, pour ne nous réunir qu’à l’heure du dîner. Ce fut dans ce moment-là que nous prîmes toutes nos dimensions pour faire réussir nos projets de plaisir pour la nuit suivante. Il me tint compagnie toute la journée sans que cela parût étonnant, puisque nous étions seuls. Vers onze heures il me quitta sous prétexte d’aller se coucher ; et moi, je passai dans mon appartement.
Minuit sonnant, minuit, l’heure des amours, était précisément l’heure de notre rendez-vous ; l’abbé devait se rendre chez moi par un petit escalier dérobé qui donnait dans la garde-robe de ma chambre à coucher. Minuit sonne, il est dans mes bras ; déjà il recevait un nouveau prix de son amour, et nos âmes tout entières se noyaient dans une mer de délices, quand nous entendons quelqu’un entrer doucement dans ma chambre, dont l’impatient et trop imprudent abbé avait oublié de fermer la porte.
— Qui va là ? m’écriai-je avec humeur, et comme quelqu’un qui vient de se réveiller en sursaut.
— C’est moi, me répond une voix que je reconnais pour être celle de Fanny, ma femme de chambre.
Il est bon de savoir que cette fille était amoureuse folle de l’abbé, qui s’en souciait peu, et que, n’ayant pu parvenir par ses agaceries à s’en faire aimer, elle avait résolu d’obtenir, à quelque prix que ce fût, ce qu’il s’obstinait à lui refuser, et de le perdre ensuite. Elle avait cru l’absence de milord favorable à ses desseins et avait été à son appartement pour le forcer d’accepter des faveurs qu’elle ne pouvait plus voir aussi cruellement dédaignées ; mais n’ayant trouvé personne, elle s’était bien douté qu’il était avec moi, et était venue pour tirer de l’aventure le meilleur parti possible.
— Que voulez-vous à l’heure qu’il est, lui dis-je, et qui vous a permis de venir ainsi interrompre mon sommeil ?
— Pardon, madame, me répond cette fille tout essoufflée, et pouvant à peine parler, ce n’est pas vous que je cherche, c’est un infidèle qui vient de m’abandonner, et que je redemande à tout ce que je rencontre.
Et tout en disant cela, elle s’approche de mon lit, tâtonne et saisit par le bras le pauvre abbé, qui cherche à l’éviter.
— Te voilà donc, ingrat, lui dit-elle avec fureur, en élevant la voix ; tu as cru pouvoir échapper à ma poursuite, et tromper ainsi toutes les femmes ? Va, malheureux ! celle-ci sera la dernière, et je ne suis point venue sans être armée pour ma vengeance.
L’abbé ne soufflait pas le mot ; moi, j’essayais en vain de l’apaiser, car je voulais éviter l’esclandre et tâcher que cette histoire ne fût point connue des autres domestiques de la maison, qui s’en seraient amusés à mes dépens. D’un autre côté, j’étais piquée d’être prise au lit, par ma femme de chambre, avec un homme qu’elle disait son amant et que son silence me faisait regarder comme tel. Il fallait pourtant en finir.
— Eh bien ! repris-je, quand tout ce dont vous vous plaignez serait vrai, que prétendez-vous faire, et de quelle utilité peut vous être cette scène désagréable pour moi ?
— Je l’ignore, madame, me répond-elle fièrement ; mais je veux profiter de l’avantage que j’ai sur vous deux, et voici l’arrangement que je vous propose : Ou vous souffrirez que là, à côté de vous, dans ce lit, où vous avez reçu ce parjure, je reprenne les droits que vous m’avez enlevés sur son cœur, ou j’éveille, à l’instant, tous les domestiques de la maison, et je vous livre à leurs plaisanteries ; et bientôt milord me vengera de vous et de lui. Voyez maintenant ce que vous avez à faire, car je vous promets que je tiendrai parole.
Je voulus prendre le ton d’une maîtresse ; je ne réussis point, n’ayant pas le pouvoir de me faire obéir. Fanny devenait pressante.
— Vous ne répondez rien, dis-je avec dépit à l’abbé ; c’est cependant à vous qu’est remis le droit de nous accorder. Sont-ce donc toujours les gens d’esprit qui sont les plus embarrassés dans les affaires difficiles ? Levez-vous, et allez rendre chez vous, à Fanny, l’hommage que vous devez à ses appas.
— Non, non, reprit cette fille audacieuse, ce n’est point là ce qu’il me faut ; j’exige que ce soit dans votre lit.
— Vous souffrirez au moins que je me lève et que je ne sois pas témoin…
— Non, c’est la seule vengeance que je veux tirer de vous.
Comme l’abbé ne répondait rien, elle crut voir son consentement dans son silence, et en un instant elle fut déshabillée et placée dans le lit entre nous deux. Il fallait qu’il fût en état de grâce, pour que Fanny obtînt une vengeance complète ; cela me paraissait fort difficile, parce que, d’un côté, le pauvre diable venait de faire un violent exercice, et que, de l’autre, la peur avait peut-être un peu contribué à diminuer ses facultés ; cependant, cette fille industrieuse fit tant, qu’elle parvint à rendre, à l’objet de ses désirs, toute l’élasticité qui lui était nécessaire, et bientôt les soupirs qu’elle poussa me donnèrent la certitude qu’elle n’avait pas perdu ses peines.
Quand cette scène unique fut achevée, Fanny se rhabilla et sortit pour regagner sa chambre, bien satisfaite de ce qui venait de se passer. Le pauvre abbé, confus, désespéré de cette incartade, me fit un million d’excuses et m’assura que jamais il n’y avait rien eu de commun entre Fanny et lui ; que, s’il avait eu peur de ses menaces, c’était moins pour lui que pour moi, qui aurais été la première victime. Je ne répondis pas grand’chose à tout cela ; je le priai seulement de retourner chez lui, ce qu’il fit, en me demandant la permission de me revoir le lendemain matin.
Heureusement que cette comédie eut lieu pendant la nuit ; j’eus moins à rougir de la honte qu’elle m’inspira. Dès que je fus éveillée, Fanny vint à l’ordinaire pour me lever ; elle me demanda pardon de ce qu’elle avait fait, et m’avoua que son amour pour l’abbé lui avait fait oublier tout ce qu’elle me devait, pour le satisfaire. J’eus l’air de me contenter de ses raisons : elle me dit qu’à l’avenir elle se garderait bien de troubler nos plaisirs ; qu’elle ferait, au contraire, tout ce qui dépendrait d’elle pour les faciliter.
Un instant après, l’abbé parut ; il se jeta à mes genoux pour me demander excuse de l’infidélité qu’il avait été forcé de me faire pour éviter un plus grand malheur, et me promit d’effacer, à force de tendresse, jusqu’au souvenir du désagrément qu’il m’avait occasionné sans le vouloir. Mon amour lui fit trouver grâce devant moi, et tout fut oublié ; on ne se serait pas douté, la nuit suivante, que celle qui l’avait précédée eût été si orageuse.
Milord revint le troisième jour, comme il nous l’avait promis ; l’embarras était de savoir comment nous continuerions, l’abbé et moi, notre commerce de galanterie sans être découverts de notre Argus. Fanny, qui s’aperçut que ce retour nous contrariait, fit l’officieuse et se chargea de conduire à elle seule l’intrigue ; nous eûmes la faiblesse de nous fier à ses soins ; la perfide ne nous les avait offerts que pour nous trahir. En effet, quand tout le monde fut retiré, et à l’heure convenue, elle introduisit, avec mystère, le pauvre abbé dans mon appartement, et se retira en nous souhaitant bien du plaisir. Nous en eûmes effectivement, mais il ne fut pas de longue durée ; car milord, accompagné de deux domestiques, vint nous surprendre, et nous trouva dans une attitude qui ne lui laissa rien à désirer, pour s’assurer de la vérité du rapport qu’on lui avait fait. L’abbé fut, dès le lendemain matin, congédié de la maison avec défense d’y jamais revenir ; quant à moi, il paraît qu’on avait des projets de vengeance que je ne donnai pas le temps d’exécuter.
Avant de partir, l’abbé me fit remettre par le jardinier un mouchoir, qu’il lui dit avoir pris par mégarde chez moi ; comme il était blanc et plié, cet homme, qui ne se doutait de rien, me le remit tel qu’il l’avait reçu, et j’y trouvai le mot d’écrit suivant :
« Ô toi, que j’aime plus que ma vie, souffriras-tu que j’aille, loin de toi, mourir de douleur de t’avoir perdue ; et ne préféreras-tu pas mon amour, à l’or d’un maître absolu qui va te traiter en esclave ! Si tu m’aimes assez pour faire un sacrifice en ma faveur, cette nuit, je trouverai le moyen de te faire sortir de ton appartement par la fenêtre de ta chambre à coucher ; et nous irons, loin de nos tyrans, jouir du bonheur de vivre libres et passionnés.
« Adieu, les moments sont chers ; je vais tout préparer pour l’évasion que je médite. »
Je ne balançai point sur le parti que j’avais à prendre, et je fus bientôt décidée à me laisser enlever. J’aimais réellement l’abbé, et j’appréhendais les ressentiments de milord ; il n’en fallait pas davantage pour lever toutes difficultés. Celle qui me paraissait la plus grande, c’était la sortie de ma chambre par une fenêtre qui donnait, du premier, dans un fossé assez profond ; cependant, je ne voyais pas d’impossibilité à réussir, et je me fiai au génie de l’abbé, auquel l’amour donnerait sûrement du ressort.
Pendant toute la journée, milord ne me fit pas l’honneur de me demander. On me servit chez moi ; je n’en fus que plus libre pour prépaparer ce qui m’était nécessaire pour mon départ. Quand le soir les domestiques furent retirés, je m’enfermai aux verrous pour n’être pas surprise, et j’attendis avec impatience le moment où mon cher abbé paraîtrait ; je laissai même la croisée ouverte, pour ne pas le faire attendre et être prête au premier signal.
Vers une heure du matin j’entendis frapper dans le fossé au bas de ma fenêtre ; j’y courus pour voir ce que c’était ; je distinguai la voix de l’abbé qui me disait d’être tranquille, qu’il allait bientôt me rejoindre. Il ne cessait de cogner, et je ne pouvais pas deviner ce qu’il faisait.
Enfin, au bout d’une demi-heure il était à une toise de ma fenêtre ; je vis alors qu’il enfonçait, dans les jointures des pierres, des piques de fer, de distance en distance, pour y poser les pieds et en former une échelle pour parvenir jusqu’à moi. Il eut bientôt achevé son ouvrage, et je le reçus, avec plaisir, dans mes bras, où il prit le temps de se délasser de ses fatigues.
Ce n’était pas le tout que l’abbé fût monté ; il fallait qu’il descendît et que j’imitasse son exemple. Je n’avais pas une grande confiance dans un pareil escalier ; il me rassura cependant, et pour me déterminer il jeta dans le fossé les paquets que j’avais préparés ; il sortit ensuite le premier, en me disant d’examiner comment il s’y prendrait, et d’être bien tranquille sur la solidité de son travail. Je sortis donc, à reculons, de la fenêtre à laquelle je me retins par les deux mains ; à mesure que l’abbé descendait, il guidait mes pieds sur les pointes d’en bas, tandis que je m’agrippais à celle d’en haut ; et en suivant cette méthode, je parvins, sans le moindre accident au fond du fossé, dont nous ne pûmes sortir qu’en usant du même procédé. C’est ainsi que je quittai le château de milord, après avoir vécu onze mois dans la plus grande abondance.
Quand nous fûmes tout à fait dehors, nous et nos paquets, l’abbé s’en chargea ; et nous gagnâmes la première poste, sur la route de Londres, où nous arrivâmes de très bonne heure. Nous y vécûmes pendant trois mois dans une parfaite union ; mais l’infidèle, l’ingrat, pour qui j’avais tout sacrifié, s’apercevant qu’il ne restait presque plus rien de l’argent et des effets que j’avais emportés, dans la crainte de partager la misère qui me menaçait ou de travailler à la prévenir, un beau jour m’abandonna à moi-même et ne me laissa, pour prix de ce que j’avais fait pour lui, que le regret de l’avoir connu.
Tombée encore une fois, mais par ma faute, dans la misère la plus profonde, sans autre ressource que ma jeunesse et quelques attraits, je sentis la nécessité d’arrêter, dans sa fuite, la fortune qui m’était échappée. Ce n’était pas en restant chez moi à me désoler et à gémir sur l’inconstance des hommes, que je pouvais espérer d’y parvenir ; aussi je ne perdis pas mon temps à réfléchir sur ce que j’avais à faire dans la position où je me trouvais ; il ne me restait qu’un moyen, celui de rentrer dans la carrière que j’avais déjà parcourue : tant il est vrai qu’en tout, ce n’est que le premier pas qui coûte, et que quand une fois on s’est écarté du sentier de la vertu, on a bien de la peine à y rentrer.
Je m’étais aperçu qu’un étranger, qui demeurait dans le même hôtel garni que nous, m’avait souvent fixée avec attention et paraissait désirer de lier connaissance avec moi : je ne doutai point que ce qui l’en avait empêché jusqu’alors, n’eût été la présence de l’abbé, qu’il croyait mon mari, et je me flattai qu’il ne serait pas difficile de l’attirer chez moi dès qu’il me verrait seule. En effet, mon veuvage datait à peine de deux jours que mon étranger, que je guettais comme le chasseur fait la perdrix, entra dans mon appartement, dont je laissais presque toujours la porte entr’ouverte, pour lui faciliter le moyen de me parler.
— Bonjour, ma belle voisine, me dit-il en assez mauvais anglais (car il était Italien, originaire de Palerme, et me croyait Anglaise), d’où vient que depuis quelques jours je n’ai point aperçu le cher époux ? est-il indisposé ? daigneriez-vous m’en donner des nouvelles ?
Je me mis à pleurer pour rendre la scène plus attendrissante, et je ne répondis rien. Mon bon voisin, qui ne sait que penser d’une singerie qu’il croit sincère, est touché de mes pleurs et me serre dans ses bras avec attendrissement.
Le voyant en si bon train :
— Fermez, lui dis-je, la porte ; que personne que vous ne puisse être témoin de ma confusion.
Et puis me voilà lui forgeant un beau roman sur les malheurs qui m’ont accompagnée, depuis qu’un parjure a osé porter atteinte à mon innocence. Je lui parle de celui qu’il avait pris pour mon époux comme d’un vil scélérat qui, après m’avoir fait quitter d’honnêtes parents qui m’aimaient tendrement, a eu la bassesse de m’abandonner dans un pays étranger, où je n’ai personne de connaissance dont je puisse implorer les bontés.
Ce tableau, que j’ornai des couleurs qui lui étaient propres, fit sur mon étranger tout l’effet que j’en attendais : il mêla ses pleurs aux miens, ne vit en moi qu’une jeune innocente, victime de son penchant, pour un homme qu’elle avait cru trop légèrement, et m’offrit tous les secours qui dépendraient de lui. Je le remerciai avec ce ton qui laisse entrevoir qu’on est disposé à accepter ; et il me quitta en me demandant la permission de me revoir le soir.
Enchantée de la réussite d’un projet dont l’exécution allait me faire sortir de l’état affligeant où je me trouvais, j’attendis avec impatience le retour de mon étranger. Pendant son absence, mille réflexions me passèrent par la tête ; j’étais indécise sur la conduite que je devais tenir vis-à-vis de lui. Me laisserai-je aller à ses désirs, dès qu’il paraîtra vouloir user des droits que ses bienfaits lui donneront sur moi, ou continuerai-je à jouer la vertueuse ? voilà ce que je me demandais à moi-même, et ce qu’il n’était pas facile de résoudre parce que je ne connaissais point assez son caractère pour déterminer précisément le rôle qui me convenait dans cette circonstance. Cependant, en me rappelant ce qui avait accompagné et suivi mon récit, je crus qu’il ne fallait point m’écarter des principes que j’avais professés, et j’en demande pardon à la vertu, j’empruntai sa physionomie douce et attachante pour mieux tromper.
Borglia (c’était le nom de mon étranger), exact à sa parole, revint le soir comme il me l’avait promis ; l’air empressé qu’il me marqua, les soins et les attentions qu’il eut pour moi en me questionnant avec délicatesse sur la nature de mes besoins, tout servit à me confirmer dans l’idée qu’il prenait grand soin à ma petite personne, et que je ne devais plus, pour le moment, avoir d’inquiétudes sur mon sort. Trois ou quatre jours s’écoulèrent sans qu’il osât me faire la moindre proposition qui pût effaroucher mon austère vertu ; il semblait qu’il craignît de me regarder en face, et s’il m’arrivait de surprendre ses yeux attachés sur moi, il les baissait avec timidité, tant est grand le pouvoir de la vertu sur les âmes honnêtes. Je rougissais intérieurement de tromper un homme dont la passion pour moi croissait de jour en jour, et j’étais au désespoir de n’avoir point à lui offrir un cœur digne de son hommage.
Le huitième jour enfin, il osa me parler d’amour. Je rejetai bien loin cette idée dangereuse ; j’affectai de paraître décidée à ne contracter aucun engagement avec les hommes, que je me peignis tous devant lui, comme des séducteurs sans cesse aux aguets pour abuser de la crédulité d’un sexe faible, trop facile à égarer. Cependant, j’admis quelques exceptions à la sévérité de cette règle, parce que je m’aperçus que je l’avais un peu mortifié, et que mon intérêt était de le ménager. Il me parut flatté que je ne l’eusse pas compris dans le nombre de ces hommes pervers. Il m’en témoigna sa satisfaction en essayant de m’embrasser. J’eus encore la cruauté de lui opposer de la résistance ; trop de docilité lui fit abandonner l’entreprise : il se retira en se plaignant de mes rigueurs.
Le lendemain, dès qu’il sut que j’étais levée, il descendit et me demanda la permission de prendre le thé avec moi. J’y consentis volontiers, parce qu’enfin il fallait bien, pour le retenir, nouer avec quelque chose le filet que je venais de lui tendre d’ailleurs, je lui avais déjà des obligations, car, sans m’en avoir parlé, il s’était arrangé avec l’hôtesse, et j’étais quitte envers elle de tout ce que je lui devais. En déjeunant il m’apprit qu’il était garçon et qu’il avait une maison de commerce à Cadix, où il était établi depuis dix ans ; que ses affaires étant finies à Londres, il était sur le point de retourner chez lui.
Ce fut dans ce moment-là que je me trouvai le plus embarrassée : j’étais à la veille de perdre un homme qu’il m’était bien essentiel de conserver. Je craignais, avec raison, que mes refus réitérés ne refroidissent une ardeur que j’avais affecté de ne vouloir pas partager ; et je sentis qu’il était temps de me relâcher un peu de mon austérité, pour le forcer à prendre un parti sur mon compte.
Tout en me donnant ces détails, il s’était insensiblement approché de moi ; il me serrait la main, et dans un moment où je feignis de vouloir la retirer, il la porta à sa bouche et la couvrit de baisers. Je me plaignis de sa témérité, de manière à lui laisser entrevoir qu’il avait la permission de recommencer. Il ne se le fait pas redire, et me prenant dans ses bras il colle sa bouche sur la mienne ; je me débats pour la forme ; mais ma résistance est si douce qu’elle lui sert d’encouragement. Il croit le moment favorable, m’enlève de terre, me porte sur mon lit, et lisant dans mes yeux qu’il peut tout oser, il reçoit la récompense de ses amoureux transports.
Mon rôle n’était point encore achevé, il fallait faire agir la honte, la confusion, ces sentiments qui suivent ordinairement les sacrifices, où l’amour semble avoir triomphé seul de la pudeur ; aussi je me cachai la figure, et j’affectai de ne pas oser le regarder. Il m’accabla de caresses, me dit les choses du monde les plus flatteuses, sur mes bontés pour lui, et me força par degrés à retrouver un maintien que je cherchais depuis longtemps à reprendre.
Dès que je fus un peu remise, il me dit qu’il avait une grâce à me demander, qu’il espérait que je la lui accorderais.
— Après ce que vous venez d’obtenir, lui dis-je, il me serait bien difficile de vous refuser quelque chose.
— Ainsi donc, un voyage sur mer ne vous effrayerait pas, et vous vous sentez assez de courage pour m’accompagner à Cadix ?
— On brave tous les dangers, lui répondis-je, avec l’objet aimé, et rien que la mort ne me séparera de vous.
Cette preuve de mon amour lui causa tant de joie, qu’il me dit qu’il allait tout disposer pour notre embarquement.
En effet, il ne perdit point de temps et revint, deux heures après, m’annoncer qu’il venait d’avoir l’avis qu’un vaisseau marchand, en charge à Portsmouth, partait dans trois jours pour Cadix ; qu’il avait retenu nos places, et que, dès le lendemain, nous partirions pour ce port. Le reste de la journée fut employé à m’acheter les choses les plus nécessaires pour le voyage, et à faire nos malles. Le lendemain, nous nous rendîmes à Portsmouth. Bientôt on annonça le départ du vaisseau : nous nous embarquâmes, et, après une heureuse traversée, nous entrâmes sans accident dans le fameux port de Cadix, où j’eus le plaisir de voir arriver une flotte qui revenait des Indes ; et ce beau coup d’œil fut, en quelque sorte, pour moi un dédommagement des fatigues du voyage.
Transportée en Espagne, par l’effet du hasard, à près de quatre cents lieues de mon pays, sous la protection d’un homme que je connaissais à peine, je sentis bien qu’il n’était plus possible d’agir d’après moi ; qu’il ne me restait qu’à obéir aveuglément aux volontés de celui dont mon sort allait dépendre ; ainsi donc, dès ce moment je fis vœu tacite de soumission.
En débarquant, Borglia me dit qu’il me ferait passer chez lui pour la fille d’un de ses correspondants de Londres, qui, venant d’éprouver des pertes considérables, qui l’avaient totalement ruiné, m’avait confié à ses soins, pour me mettre au fait du commerce.
— Vous parlez fort bien anglais, me dit-il, il ne vous sera pas difficile de paraître ce que je vous annoncerai.
Nos mesures ainsi prises, nous nous rendîmes chez lui. Il avait un jeune frère, intéressé dans son commerce, sur lequel il se reposait entièrement du soin de sa maison, quand il était obligé de s’absenter ; il lui fit, en arrivant, le mensonge convenu entre nous, et je fus installée comme fille de Richard Black, dont le nom était connu de ce jeune homme.
La maison qu’occupait Borglia était très considérable : il m’y donna un appartement richement meublé, qui fut, en très peu de temps, fourni de tout ce qui pouvait m’être nécessaire. Il le fit si bien distribuer, que, sans paraître l’avoir fait à dessein, il y eut, entre nous deux, communication entière, et jamais le soupçon ne parut pénétrer le voile qui couvrait nos plaisirs.
Enchanté lorsqu’il pouvait trouver le moyen de m’être agréable, il prévenait en tout mes désirs, et avait formé le projet de perfectionner mon éducation ; mais il ne lui fut pas possible d’exécuter tout ce que son cœur lui avait fait imaginer ; je n’eus que le temps de me livrer à l’étude des langues espagnole et italienne, que j’appris en très peu de temps, parce que alors j’avais une mémoire excellente.
Déjà huit mois s’étaient écoulés dans les douceurs de notre union ; rendue pour ainsi dire à la vertu, par l’amour qui jusque-là m’avait causé tant de peines, je jurai de me respecter moi-même, en m’abandonnant sans réserve à mon bienfaiteur, qui toujours plus amoureux, et convaincu de ma sagesse, m’avait laissé entrevoir qu’il ne tarderait pas à m’épouser.
Cet établissement, flattant ma vanité, me l’avait singulièrement attaché : j’attendais avec impatience, sans cependant avoir témoigné mon empressement, l’heureux jour qui devait mettre le comble à mon bonheur, quand une maladie subite, dont il fut attaqué, me l’enleva en quelques jours, sans qu’il pût faire la moindre chose en ma faveur.
Je n’avais point encore éprouvé de perte aussi sensible : la fin tragique de Georges m’avait cruellement affectée : bien jeune alors, sans la moindre expérience, mon cœur avait été presque aussitôt guéri de sa blessure ; mais cette fois, ma raison, mûrie par plus de six années d’épreuves, me fit faire de tristes réflexions sur la situation malheureuse où je me voyais réduite. Je fondis en larmes, en pensant à la rigueur du sort qui m’accablait, et la peine que j’éprouvai serait difficile à rendre.
Pendant les premiers huit jours, Lelio, ce jeune frère de Borglia, fut aux petits soins près de moi ; il mit tout en usage pour me faire supporter, avec fermeté, ce fâcheux événement ; quoi qu’il ne connût pas parfaitement les véritable raisons qui m’arrachaient tant de larmes, il me croyait seulement sensible à la mort d’un homme bienfaisant, qui était venu au secours d’une famille malheureuse, en se chargeant de moi.
Tant d’égards de sa part calmèrent mes inquiétudes ; cependant mes idées se confondaient, et, bien persuadée qu’il n’y avait pour moi d’autres moyens que d’abandonner ma barque au gré des vents sur la mer orageuse que je parcourais, je ne voyais pas, sans frémir, les dangers que j’avais à braver jusqu’au port.
Lelio, seul héritier de son frère, se trouvait, à vingt-cinq ans, propriétaire d’une fortune immense et chef d’une des meilleures maisons de commerce de Cadix ; il me montrait de l’attachement, mais il était possible qu’il ne fût pas sincère ; qu’il n’eût d’autre dessein que de satisfaire un caprice, car il avait une maîtresse, nommée Léonida, que son frère m’avait dit fort jolie, et je pouvais craindre de ne pas l’effacer en beauté. Cependant, la cour assidue qu’il me faisait, augmentant chaque jour mes espérances, je me flattais de vaincre encore cette difficulté, pour peu que je voulusse m’en donner la peine. Je dressai donc mes batteries pour attaquer, en même temps, l’esprit et le cœur ; mes efforts ne furent pas inutiles : je sus enchaîner ses volontés à la mienne, avant d’avoir rien fait pour lui qui me fît mériter cet empire absolu.
Quand je l’eus ainsi attaché, comme un esclave, à mon char, et que je fus assez sûre de lui pour tout oser, je lui parlai de sa maîtresse : j’en exigeai le sacrifice, comme la seule preuve convaincante qu’il pût me donner de son amour ; et dans l’instant, il lui signifia son congé par ce billet, que je lui fis remettre, pour être assurée qu’il parviendrait à son adresse.
» La mort de mon frère me laissant seul chargé de la conduite d’une maison de commerce, dont les détails infinis absorbent tout mon temps et m’éloignent de la société, trouvez bon que je vous prévienne qu’il me sera désormais impossible de vous voir, et croyez que, si des circonstances impérieuses me forcent à me séparer de vous, votre souvenir sera toujours présent et cher à ma mémoire. »
Il ne me restait aucun prétexte pour différer de rendre heureux un homme qui ne pouvait rien me refuser : je me disposai donc à me rendre à ses désirs, la première fois que sa passion me le ramènerait. Cependant, comme il ignorait mes liaisons avec son frère, et qu’il devait croire que j’étais encore novice, j’avais le plus grand intérêt à lui laisser cette bonne opinion et à faire reparaître, s’il était possible, quelques signes de ma virginité qui, depuis si longtemps, étaient tous effacés. J’éprouvais, depuis deux jours, cette révolution qui, douze fois dans l’année, fait sentir aux femmes toute leur faiblesse ; il me restait encore quelques marques de son ravage ; je jugeai l’occasion favorable pour le tromper ; et, la tête occupée de ce beau projet, loin d’éviter la présence de celui que je voulais faire ma dupe, je cherchai tous les moyens de me trouver seule avec lui.
Cela ne devait pas être fort difficile, car il faisait, de son côté, tous ses efforts pour me seconder ; enfin, le soir nous nous trouvâmes seuls dans mon appartement, et bientôt il renouvela ses sollicitations. Il me reparla de la violence de son amour, me fit valoir les sacrifices qu’il avait faits, et qu’il était encore tout prêt à faire pour moi, si j’en avais à lui demander. Soit que je parusse opposer moins de résistance, soit qu’il se fût décidé à tout entreprendre, il me prit dans ses bras et me porta sur mon lit.
Ce fut là qu’il fallut mettre en œuvre tous les ressorts du grand art de tromper, et conserver toute sa tête en paraissant l’avoir perdue. Heureusement que l’obscurité favorisait ma trahison ; tout alla comme je m’en étais flattée ; les douleurs que je feignais de ressentir, le regret qu’il semblait avoir de les causer, en m’encourageant à les supporter avec patience, pour jouir ensuite d’un bonheur céleste, dont il me faisait pressentir les délices, formaient une scène tout à fait plaisante pour moi ; enfin, quand je crus lui avoir donné assez de temps pour qu’il ne lui restât pas de doute sur son triomphe, je le laissai pénétrer dans l’intérieur de la place, où il crut bien fermement n’être parvenu qu’après avoir forcé toutes les barricades.
Persuadée, par ses ardentes caresses, que l’illusion avait été complète, je me vis alors en possession du cœur de ce nouvel amant, et je crus que rien ne troublerait le bonheur que j’espérais enfin fixer auprès de moi ; mais c’est en vain que l’homme se flatte : un rien suffit pour détruire ses espérances. Je n’avais pas réfléchi qu’en bannissant du cœur de Lelio une femme qui, avant moi, y régnait en souveraine, j’avais allumé le flambeau de la vengeance, et que, pendant que je donnais des lois, on s’occupait à détruire mon pouvoir. Ah ! si j’avais pu deviner ce que me coûterait ma victoire, je n’aurais pas balancé entre la haine d’un amant rebuté et celle d’une femme qui se croit méprisée ; je me serais plutôt exposée, avec certitude, aux horreurs de la misère, en refusant constamment à l’un des faveurs dont l’autre devait bientôt me faire repentir.
Léonida, devenue ma plus cruelle ennemie, n’avait fait aucune réponse au billet que je lui avais fait remettre ; nous n’avions pas même entendu parler d’elle depuis plus d’un mois. Il y a lieu de croire que pendant ce temps elle avait médité son projet de vengeance ; et voici comment elle s’y prit pour le faire réussir : Fabricio, son frère, se présente un matin à la maison et demande à parler à Lelio. Celui-ci, qui le connaissait parfaitement, ayant été longtemps liés ensemble, le reçoit en ami et paraît enchanté de le revoir, après une absence de deux ans, employés par Fabricio au service d’Espagne ; mais loin de partager les transports qu’il fait naître, ce frère, qui se croit outragé dans la personne de sa sœur, qui n’a pas manqué de lui exagérer ses affronts, se plaint à Lelio de ce qu’il a séduit sa sœur en lui promettant de l’épouser, et de ce qu’il vient de l’abandonner, au lieu d’effacer son déshonneur par un hymen indispensable.
Il exige que Lelio lui donne sa parole de remplir la promesse qu’il a faite, et lui rappelle les lois de l’honneur, s’il s’y refuse. Lelio soutient qu’il n’a rien promis à Léonida ; que mille raisons d’ailleurs s’opposent à cette union, et que Fabricio est le maître d’oublier tout ce qu’il doit à l’amitié, pour servir la vengeance de sa sœur. On s’emporte de part et d’autre : on finit par se donner rendez-vous pour le soir même.
Cachée dans une pièce voisine de celle où cette scène se passait, je n’avais pas perdu un mot de toute la conversation. Dès que Fabricio fut sorti, je me jetai en pleurs au cou de Lelio ; je lui fis sentir tout le chagrin que me causait l’événement malheureux que j’avais provoqué, et je fis tous mes efforts pour que cette affaire n’eût point de suite ; mais ce fut sans fruit que je mis en avant larmes et prières : il me représenta la honte qui rejaillirait sur lui s’il suivait mes conseils ; je fus forcée de convenir qu’il ne pouvait pas se dispenser d’aller au fatal rendez-vous.
— Soyez parfaitement tranquille, me dit-il, ma bonne amie, je me tirerai, je l’espère, avec honneur, de cette affaire, et pour éviter toute surprise, je vais aller dîner chez Bernardo, qui se fera un vrai plaisir de m’accompagner. Il envoya prévenir cet ami, et sortit peu de temps après, en me promettant qu’aussitôt la querelle décidée il revolerait dans mes bras pour y goûter les douceurs d’un nouveau triomphe.
Je ne m’étais pas jusque-là sentie bien amoureuse de Lelio : l’intérêt plus que l’amour avait fait tous les frais de l’intrigue ; mais les dangers qu’il allait courir pour m’avoir donné la préférence sur une femme qu’il avait aimée, forçaient en quelque sorte ma reconnaissance, et me donnaient des alarmes réelles pour lui : d’ailleurs, je n’étais pas trop rassurée sur le sort qui m’attendait dans le cas où il succomberait. Ce point très essentiel l’emporta peut-être aussi sur le sentiment de ma reconnaissance. Quel que fût enfin le motif qui m’animât, l’homme du monde qui m’eût été le plus cher n’aurait pas alors reçu plus de marques d’attachement.
Le rendez-vous était pris pour huit heures : inquiète sur les suites d’un événement qui pouvait nous être funeste à tous deux, chaque fois que l’horloge sonnait, je l’accusais de sa lenteur ; j’aurais voulu que cette heure, que je redoutais tant, fût depuis longtemps expirée, et je craignais de l’entendre sonner. Enfin, le marteau a huit fois fait retentir le timbre. L’idée qu’en ce moment mon cher Lelio est aux prises avec un homme plus exercé que lui, me fait frissonner : je me le représente déjà frappé par son adversaire et baigné dans son sang : c’en est fait, me dis-je, mon ami vient de périr, et moi, malheureuse que je suis, victime de mon amour-propre et de ma coquetterie, je vais être livrée aux horreurs de la misère et du désespoir. Le tableau que je me fis me parut si effrayant, qu’une sueur froide se répandit sur tout mon corps, et je tombai sans connaissance.
J’étais seule alors dans ma chambre, privée des secours qui m’étaient nécessaires ; aussi je fus longtemps à revenir de mon évanouissement. Lorsque je repris mes sens, et qu’il me fut possible de distinguer les objets, je jetai les yeux sur la pendule. Il est neuf heures, me dis-je, et Lelio n’est pas rentré. Allons, j’ai tout perdu, mes pressentiments ne se sont que trop réalisés. Mais pourquoi Bernardo ne m’a-t-il rien fait dire ? Et sans plus délibérer, sans parler à personne, je sors dans l’intention d’aller chez cet ami pour éclaircir les doutes qui me tourmentent. À peine ai-je fait cent pas, qu’au détour d’une petite rue assez mal éclairée, deux hommes se présentent à moi : l’un se dit porteur d’un ordre du corrégidor et m’ordonne de le suivre chez ce magistrat.
L’esprit trop plein de l’objet qui l’occupe, je ne fais presque pas d’attention à ce qu’il me dit, et je m’échappe. Cependant je me retourne, et quand je les vois à ma poursuite, je précipite ma course. Le désir d’arriver chez Bernardo, plus encore que la peur de tomber dans les mains de ces fripons (car je ne m’étais point mise dans le cas d’être appelée chez le corrégidor), rendait ma fuite plus légère, et je les avais laissés bien loin derrière moi, quand par malheur une pierre se trouve sur mon passage et me fait tomber par terre. Mes persécuteurs, qui avaient ordre de m’amener morte ou vive, eurent le temps de me rejoindre. Ils profitèrent de la faiblesse qui fut la suite de mon accident : l’un d’eux alla chercher une voiture, dans laquelle on me porta, et nous étions déjà hors la ville quand je m’aperçus qu’il n’était plus temps de m’opposer aux desseins de mes ravisseurs.
Que de réflexions je fis sur la vicissitude des scènes de la vie et sur les dangers qui naissent à chaque instant, sous les pas d’une femme qui a méconnu ses devoirs ! J’aurais bien voulu me débarrasser de leurs mains ! mais c’était chose impossible : il fallut donc se résigner et attendre en silence le résultat d’un voyage qui ne laissait pas que de m’inquiéter. Enfin nous arrivons : la lune qui venait de se lever me facilita les moyens de remarquer que la maison où nous entrions était isolée ; alors mes frayeurs redoublèrent. Je me crus perdue, ou, pour le moins, destinée à de nouvelles horreurs. J’affectai cependant un calme parfait ; je ne fis pas à mes guides l’honneur de les questionner une seule fois sur ce qui m’était réservé. On me conduisit dans une chambre, où je trouvai à peu près le nécessaire ; et la nuit s’écoula sans que personne vînt troubler mon repos.
Le lendemain matin, je vis entrer dans ma chambre Fabricio, accompagné d’une femme, que je présumai sa sœur, car je ne l’avais point encore vue : la rage était peinte sur la figure de cette harpie, qui brûlait de la faire éclater.
— Te voilà donc, me dit-elle aussitôt qu’elle m’aperçut, méchante créature, te voilà donc en mon pouvoir, et je puis à mon aise me venger de l’injure que tu m’as faite, en m’enlevant le cœur de mon amant. Sache que jamais femme n’a pardonné un tel affront, et que tu ne fuiras pas le châtiment qui t’attend.
En même temps, je vois entrer les deux hommes qui m’avaient amenée. Ils me saisissent chacun par un bras, me font asseoir sur une chaise, où l’un d’eux me retient sans qu’il me soit possible de me remuer. Léonida, armée d’une paire de ciseaux, me coupe les cheveux à deux lignes de la tête ; puis, faisant retrousser mes jupons et ma chemise par l’un de ses valets, qui me les tient serrés autour du corps, tandis qu’un autre m’allonge les deux jambes et les écarte, elle fait la même opération à la cause principale de ses chagrins.
Assurément il lui eût été impossible de choisir un moyen de vengeance qui me fût plus cruel, car en me privant de la plus belle chevelure que jamais femme ait portée, elle me mettait pour longtemps dans l’impossibilité de reparaître dans le monde avec tout l’avantage que la figure, même la plus parfaite, tire d’ordinaire de cet utile ornement. Néanmoins, persuadée que ce serait en vain que je voudrais m’opposer à cette ignominie, je la supportai avec courage, sans proférer un seul mot, et sans me plaindre.
Quand elle eut achevé cette brillante expédition, elle fit ramasser avec soin tout ce qui avait cédé au fatal ciseau, et après en avoir fait un paquet en observant bien de ne pas confondre les deux espèces, elle sortit et me promit de revenir le lendemain pour mettre ma constance à une nouvelle épreuve.
J’avoue, de bonne foi, que je n’étais pas trop rassurée sur les suites d’une vengeance à laquelle je ne voyais point de bornes, puisque je me trouvais à la merci de mon ennemie, sans pouvoir compter sur aucuns secours. Que faire donc dans une circonstance aussi critique ? Fuir l’indigne rivale qui me menaçait de m’accabler du poids de sa colère était ma seule ressource, mais le moyen d’y parvenir ! Enfermée dans cette maison comme dans une prison d’État, sans espoir d’attendrir, par mes pleurs, mes inflexibles geôliers vendus à leur maîtresse, ou de les corrompre à force d’or, puisque je ne possédais pas une obole, je me résignais en tremblant au sort qui m’attendait, quand Fabricio ouvre doucement la porte de ma chambre et se présente à moi :
— Pardonnez, me dit-il, mademoiselle, si j’ose paraître devant vous, moi, que vous regardez sans doute comme le complice des forfaits de ma sœur, mais qui, bien loin d’approuver les cruautés qu’elle veut exercer sur vous, n’ai paru y donner les mains que pour les prévenir. Si vous saviez ce que j’ai ressenti de peine et de douleurs quand ce matin j’assistai, malgré moi, au premier supplice qu’elle vous a fait endurer, vous n’hésiteriez pas à me donner toute votre confiance.
— Eh bien ! monsieur, lui répondis-je avec vivacité, à quoi tend cet intérêt si grand, que vous paraissez prendre à ce qui me regarde, et quels sont vos projets ?
— Je ne vous parlerai pas, me répliqua-t-il, des tendres sentiments que vous m’avez inspirés, il semblerait que je cherche à vous forcer de m’accorder le prix des services que je veux vous rendre. Si je suis assez heureux pour vous être de quelque utilité, je me croirai trop payé par le plaisir de vous avoir obligé.
— Eh bien ! parlez donc, de grâce, que voulez-vous ?
— Vous faire sortir de cette maison, où tous les maux vont fondre sur vous ; vous reconduire sans accident à Cadix, dont nous ne sommes qu’à une lieue, et vous emmener ensuite à Gênes, où je viens d’obtenir de la république une place importante qui me facilitera les moyens de réparer les pertes que vous avez faites, et de vous mettre à l’abri des malheurs qui vous attendent.
— Ah ! si vous êtes si généreux, pourquoi ne pas me rendre à l’amour de Lelio ? votre ami saura bien m’en garantir. Mais, quoi ! vous vous taisez : lui serait-il arrivé quelque malheur ? et dans ce combat où vous l’avez engagé, aurait-il reçu un coup mortel, qui m’en séparerait pour jamais ?
— De grâce, mademoiselle, ne m’interrogez pas, et profitez des offres que je vous fais, car le temps presse.
Quelle est donc, me dis-je à moi-même, la rigueur du sort qui m’accable, puisqu’il me force d’accepter les secours du meurtrier de mon amant ? car je ne doutais pas qu’il le fût, d’après ce qu’il venait de me dire. N’importe, il vaut encore mieux hasarder de le suivre, sauf à le quitter quand l’occasion se présentera, que de donner à sa sœur le temps d’inventer et d’exécuter des supplices dont je serai peut-être la victime.
— Disposez donc de moi, lui dis-je après un moment de réflexion, je m’abandonne à vos soins.
Enchanté de ma réponse, et tout hors de lui-même, Fabricio ne se sent pas de joie ; il se précipite à mes genoux pour me remercier de mes bontés, et me baise modestement la main.
— Ma sœur, me dit-il, ne doit revenir ici que demain matin ; j’ai donné ordre à un domestique fidèle, dont l’attachement pour moi est à l’épreuve, de m’apporter cet après-midi un habit d’homme, qu’un de mes amis a fait faire pour sa sœur, de même taille que vous ; et à l’aide de ce déguisement, nous échapperons à toutes les poursuites qu’on pourrait faire pour vous retrouver.
Je consentis à tout et il me quitta, bien satisfait que j’eusse accepté ses propositions.
Il revint l’après-midi, comme il me l’avait promis, avec le costume qui devait me dérober à la vengeance de Léonida. Il voulut absolument m’aider à m’habiller, pour que ma nouvelle toilette fût plutôt faite : tout m’alla à merveille ; il ne restait que la difficulté de cacher la perte que j’avais faite de mes cheveux.
— Rien n’est plus aisé, me dit-il.
Et en même temps il tire de sa poche un mouchoir blanc, qu’il me met autour de la tête en le nouant par derrière, et couverte d’un grand chapeau rond, il n’était pas possible de s’en apercevoir.
Quand tout fut arrangé, je suivis Fabricio, qui me fit descendre par un petit escalier donnant dans le jardin, et bientôt nous fûmes dehors. Il eut la précaution de ne point me faire rentrer de jour dans Cadix : nous nous arrêtâmes sur la route dans une auberge, où nous attendîmes la nuit. Dès que nous crûmes que nous n’avions plus à courir le danger d’être reconnus, nous nous rendîmes à la ville, où nous descendîmes dans un hôtel garni, situé dans un quartier tout à fait opposé à celui que j’avais habité.
Je ne me sentais pas d’aise d’avoir échappé, par une espèce de miracle, aux cruautés de Léonida ; mais j’étais fâchée d’en avoir l’obligation à un homme que je devais haïr, et auquel ma situation présente me forçait cependant de demeurer attachée, tant que je ne serais pas assez heureuse pour m’en délivrer.
Fabricio me déposa dans cet hôtel, où il se fit passer pour un voyageur qui, ayant peu d’affaires à Cadix, n’attendait qu’un vent favorable pour s’embarquer ; quant à moi, dans l’accoutrement où j’étais, on me prit pour un page à son service, et cette méprise, que j’entretins, me fit naître des idées dont je sus profiter. Environ un quart d’heure après notre arrivée, il me dit qu’il allait retourner chez sa sœur pour ne lui donner aucun soupçon, et qu’il reviendrait souper avec moi. Je lui témoignai toute ma reconnaissance de ses attentions ; il parut de plus en plus satisfait, et me quitta en me promettant de faire la plus grande diligence.
Il me parlait encore, que mon esprit battait déjà la campagne pour trouver le moyen de lui échapper ; car je me doutais bien qu’il avait des vues sur moi, et qu’il ne prenait pas tant de soin de ma personne sans espérer le dédommagement de ses peines. Je sentais que jamais je ne pourrais lui accorder la moindre faveur. Plus je réfléchissais au parti que je devais prendre, plus je voyais croître mon embarras. Me représenter dans la maison de Lélio, dans l’état où j’étais, c’était chose impossible : y aurais-je trouvé quelqu’un qui eût voulu me recevoir, après l’événement malheureux dont j’avais été la cause ? Il ne me restait donc qu’à faire valoir, le plus tôt possible, le déguisement qu’une circonstance impérieuse m’avait forcée de prendre. La tête pleine de projets, plus bizarres les uns que les autres, je descendis à la cuisine, où je trouvai beaucoup de monde réuni pour causer, en attendant le souper, dont les préparatifs annonçaient l’heure prochaine. On ne fit point du tout attention à moi, j’en profitai pour observer les passagers.
Parmi les personnes qui se trouvaient là rassemblées, j’y remarquai un jeune homme d’une quinzaine d’années, qui me parut être au service de quelque voyageur descendu dans l’hôtel ; je m’approchai de lui et liai conversation. Je sus bientôt qu’il n’appartenait à personne, et qu’il était au service du premier qui voulait l’employer. Il me demanda si j’étais de la suite de l’officier qu’il avait vu arriver le soir. Je lui répondis que oui ; mais que je cherchais à le quitter, parce que son service était trop difficile pour moi.
— Je suis fâché, me dit-il, que vous ne soyez pas arrivé une heure plus tôt ; j’aurais pu vous procurer une place qui m’a été offerte, mais que j’ai refusée, parce qu’il faut voyager, et que je ne m’en soucie pas.
— Cela pourrait peut-être me convenir, lui répondis-je, et si vous croyez qu’il en soit encore temps, faites-moi le plaisir de me présenter.
— Très volontiers, me dit ce jeune homme, venez avec moi, si l’affaire est faite, eh bien ! nous en serons quittes pour nos pas ; au contraire, si vous réussissez, je serai charmé de vous avoir rendu ce petit service.
Et sans plus bavarder, nous partons.
Il me conduit à l’hôtel du roi d’Espagne, demande l’étranger auquel il a déjà parlé, et me présente à lui comme un jeune homme capable de remplir ses intentions. Après quelques questions d’usage sur les qualités, qui selon lui, me sont nécessaires dans l’état que je veux embrasser, il me demande mon nom, celui de mon pays.
— Je me nomme Deschamps, lui dis-je, originaire de France, et quoique jeune encore, j’ai déjà vu le monde et j’ai fait quelques voyages de long cours. Je parle les langues des royaumes que j’ai parcourus, l’anglais, l’espagnol, l’italien même, me sont aussi familiers que le français ; mais la meilleure des qualités que je puisse vous offrir, c’est la bonne volonté.
Ma franchise plut à l’étranger ; il me retint à son service, en me disant qu’il ne voulait pas faire de prix avec moi ; et il donna pour boire à celui qui m’avait amenée, pour le remercier de sa complaisance.
Comme je venais de me donner un maître, auquel des circonstances malheureuses n’avaient pour ainsi dire fait vendre mon temps et ma liberté, je reçus les ordres qu’il lui plut de me donner.
Je le quittai ensuite un instant pour témoigner toute ma reconnaissance à celui qui m’avait rendu cet important service, et je le priai de revenir le lendemain, de bonne heure, pour me donner des nouvelles de l’officier qu’il prenait pour mon maître, en lui recommandant bien de ne pas lui dire un mot de ce qui venait de se passer, parce que j’avais le plus grand intérêt qu’il ne sût pas ce que j’étais devenue. Il me promit de garder le silence sur tout ce qui pourrait me concerner, et de me donner les renseignements que je paraissais désirer.
Dès le soir même, je fis l’apprentissage de mon nouvel état ; car je fus obligée de servir à table et de préparer tout ce qui pouvait être nécessaire à celui dont le sort m’avait fait dépendre.
Le lendemain matin, le jeune domestique à qui je devais ma place vint me trouver pour m’apprendre ce qui s’était passé, à mon sujet, dans l’hôtel où j’étais descendue avec Fabricio. Celui-ci, furieux de ma fuite, et honteux de m’avoir vainement enlevée à la vengeance de sa sœur, avait juré ma perte s’il parvenait à me retrouver, et offrait une somme considérable à quiconque lui donnerait de mes nouvelles.
Je ne devais pas longtemps redouter sa fureur, puisque j’allais partir ; cependant j’attendis avec impatience l’heure du départ.
Elle arriva enfin ; quand je me vis en voiture, je me crus à l’abri des recherches de Fabricio, et rassurée sur ce que j’avais à redouter de ce forcené, je m’éloignai de Cadix avec autant de satisfaction que quand j’y étais entrée.
Mon maître était négociant à Malaga. Comme il retournait chez lui après une absence de quelques mois, nous prîmes la route de cette ville. Pendant la journée, je n’eus point à me plaindre de la conduite de mon compagnon de voyage à mon égard ; seule avec lui dans la même voiture, il ne s’était rien passé qui pût me donner la moindre crainte, et j’espérais qu’après cette épreuve, il n’y avait plus pour moi de danger à courir, quand le soir à Saint-Roch, où nous nous arrêtâmes, Majorno (c’était ainsi qu’il s’appelait), voulut absolument me faire coucher dans sa chambre. J’ignorais le motif qui le faisait agir ; il pouvait avoir peur et se croire plus tranquille, quand je serais près de lui ; voilà tout ce qui me vint d’abord à l’esprit ; mon déguisement d’ailleurs semblait me garantir des attaques que mon sexe connu aurait pu m’attirer, mais j’étais loin de m’imaginer que je ne lui étais chère que parce qu’il me croyait ce que je n’étais pas. Je ne me refusai donc point à ce que je savais bien qu’il était en droit d’exiger ; mais surtout pour ne lui donner aucun soupçon.
Nous étions à peine couchés, que Majorno se releva et vint à tâtons du côté de mon lit. Je ne pus me défendre d’un peu de frayeur, car je n’étais plus alors sous la sauvegarde de mon habillement ; je commençai à craindre qu’il ne m’eût devinée, et je m’apprêtai, dans le cas où je ne pourrais parvenir à cacher mon sexe, à résister du moins aux désirs d’un homme qui n’avait point encore pu mériter mes faveurs. Mais quelle fut ma surprise, quand j’entendis le discours dégoûtant qu’il me tint !
— Mon cher ami, me dit-il en s’approchant et faisant tous ses efforts pour introduire ses mains dans mon lit, dont je lui fermai longtemps l’accès, je me félicite bien sincèrement de l’heureux hasard qui vous a fait tomber dans mes mains : il semble que le ciel, sans cesse occupé de mon bonheur, ne cherche que les occasions de me procurer les plus douces jouissances. Jeune comme vous êtes, vous n’avez pas sans doute encore connu les femmes : le poison qu’elles distillent dans le cœur des jeunes gens n’a pu corrompre le vôtre ; je puis donc me promettre de goûter avec vous, et de vous faire partager les plaisirs les plus délicieux. En achevant ces mots, il me donne un baiser qu’il m’est impossible d’éviter, et se place à côté de moi dans le lit.
J’avais bien entendu parler quelquefois de ces femmes qui, pour assouvir leur brutale passion, intervertissent l’ordre de la nature, en se plaçant au-dessous même des animaux ; et dégoûtée d’avance des plaisirs qu’un même sexe peut se procurer, par la répugnance que je me sentais pour ces sales voluptés, je ne me doutais pas du tout des moyens que quelques hommes vils employent pour s’amuser entre eux ; occupée seulement de la manière dont je cacherais à celui-ci les formes qui pourraient me trahir, je me couchai sur le côté, la figure vers la ruelle, serrant les cuisses par devant et couvrant ma gorge avec mes deux mains.
Cette position, loin de déjouer ses projets, servit à les seconder, car je m’efforçais de cacher ce qu’il était loin de soupçonner, et qui d’ailleurs l’inquiétait fort peu, et je lui abandonnais précisément l’objet de ses désirs. Flatté de mon apparente résignation, il redouble ses caresses ; je n’ose m’y opposer, dans la crainte de dévoiler le mystère que je veux rendre impénétrable ; il profite de l’avantage que je lui donne, et dans l’instant je me sens percer dans un endroit où je ne me doutais pas que j’eusse encore un pucelage à perdre. La douleur que je ressentis me fit jeter un cri que je ne pus retenir : mon premier mouvement, pour me débarrasser de lui, fut de me retourner machinalement sur le dos : ce n’était pas là ce qu’il lui fallait ; il essaya de me faire changer de posture ; mais une de ses mains, glissant sur la surface de mon corps, alla se porter sur cet endroit où la nature a si distinctement établi la différence des sexes. Étonné de celui qu’il reconnaît en moi, il retire sa main avec autant de précipitation que s’il voulait la garantir d’un brasier ardent ; et cessant tout à coup de me prodiguer ses dégoûtantes caresses, il me dit avec surprise :
— Quoi ! vous êtes une femme ?
Indignée du propos insultant d’un homme qui, dans le lit avec une jeune femme, et je le dis sans vanité, avec une jolie femme, ose regretter de n’y avoir pas trouvé un homme aussi vil que lui, je veux me lever dans l’intention de m’habiller et de rester debout toute la nuit, pour n’être pas exposée aux nouveaux outrages de ce revenant de Sodome ; il s’y oppose et me retient auprès de lui.
— Malgré ma haine décidée pour tout ce qui est femme, me dit-il, vous m’avez inspiré je ne sais quel sentiment, dont je ne suis plus le maître, et je sens qu’en votre faveur je puis vaincre ma répugnance, si vous voulez vous prêter à me laisser satisfaire un goût dominant, que jamais femme, autre que vous, ne pourra se flatter d’avoir pu contenter.
Je me doutai bien que ce goût n’était autre chose que celui dont il m’avait fait sentir les atteintes ; aussi l’horreur qu’il m’avait inspirée, loin de me permettre de condescendre à ses volontés, lui aurait fait refuser des plaisirs naturels, quand bien même il aurait voulu mériter, en les demandant, le pardon de ses infâmes désirs.
— N’espérez jamais, lui répondis-je, que je puisse me prêter à ce que vous exigez de moi ; si le malheur et la force des circonstances m’ont réduite à la honte de vous servir, n’abusez pas de l’empire que je vous ai donné sur moi, vous me forceriez de recourir à des extrémités que le repentir pourrait suivre.
Cette menace produisit quelque effet sur lui ; il se décida à me laisser tranquille et à se retirer dans son lit.
Débarrassée de ce pesant fardeau, je ne m’amusai point à dormir, mais à faire encore de pénibles réflexions sur ce qui venait de m’arriver pour trouver les moyens de fuir, au plus vite, les dangers dont j’étais menacée.
Pendant que je me livrais à mes méditations, Majorno se mit à ronfler comme un bienheureux. Tristement étendue dans mon lit, n’ayant pas seulement une piastre à mon service, dévorée surtout du désir ardent de m’éloigner d’un homme que sa conduite me rendait méprisable, j’avais beau me tourmenter l’esprit, je ne pouvais me décider sur ce que j’avais à faire. Enfin, après m’être tournée et retournée cent fois, avant d’avoir pu fixer mes irrésolutions, une idée vint pourtant frapper mon imagination ; je m’y arrêtai. Elle présentait bien quelques inconvénients dans les moyens d’exécution, mais aussi, si je pouvais prendre sur moi de la faire réussir, je sortais de l’esclavage honteux dans lequel je me voyais forcée de ramper, sans apercevoir l’instant qui pourrait m’en affranchir ; cet espoir me détermina.
Je savais que Majorno avait une bourse bien garnie d’or ; le profond sommeil dans lequel il était enseveli favorisait mon attentat.
— Allons me dis-je, l’occasion est favorable, il faut en profiter.
Je me lève en tremblant ; et, me ressouvenant qu’il avait posé sa bourse sur une chaise, près de son lit, j’y vais sur la pointe des pieds, retenant mon haleine, de peur de l’éveiller : je m’en empare et retourne me coucher, en attendant que je puisse m’évader.
Le coup était hardi ; mais par mille raisons, je le crus nécessaire : voilà comme insensiblement on s’accoutume au crime, en trouvant toujours des prétextes quand on veut le commettre.
Je n’avais pas fermé l’œil de la nuit, attendant le jour avec une impatience qu’il est aisé de sentir : il venait enfin de paraître. Sa clarté bienfaisante en rétablissant, en quelque sorte, le calme dans mon cœur, agité par le sentiment de ma faute, avait aussi dissipé une grande partie de mes frayeurs. Je m’habille à la hâte pour ne pas donner à Majorno le temps de s’éveiller ; cinq minutes me suffisent, et semblable à l’éclair qui disparaît quand on l’aperçoit, je laisse la maison bien loin derrière moi, avant qu’on puisse se douter de ma fuite.
En sortant de Saint-Roch, je crus reconnaître le chemin que j’avais parcouru la veille : je me félicitai de ce hasard, qui me remettait dans la route de Cadix, dont je ne m’étais éloignée qu’à regret, avant d’avoir acquis la certitude que Lelio n’existait plus ; car ce que Fabricio m’avait dit à ce sujet ne me paraissait pas suffisant pour éclaircir mes doutes. Il était possible d’ailleurs que la réponse insignifiante qu’il m’avait faite, lorsque je l’avais interrogé sur le fatal combat, dont l’issue était encore un problème pour moi, ne l’eût été que dans le dessein de me cacher la vérité, pour profiter de la terreur que mes soupçons, bien ou mal fondés, pourraient m’inspirer. Je me déterminai donc à suivre le grand chemin, au risque d’être arrêtée par Majorno, s’il découvrait celui que j’avais pris. J’espérais cependant l’éviter, en réfléchissant que j’avais quelques heures en avant.
J’avais déjà fait en courant près de deux lieues, lorsque j’aperçus de loin une voiture à laquelle il était arrivé un accident. Je hâtai le pas, et en m’en approchant, je demandai à deux dames qui avaient mis pied à terre et qui attendaient qu’elle fut raccommodée, la permission de monter derrière, parce que j’étais déjà bien fatiguée. Elles consentirent volontiers à m’accorder une place et pour qu’elle fût plus commode que celle dont je paraissais me contenter, elles voulurent que je la prisse sur le siège, à côté de leur domestique. Je n’eus que le temps de monter, la voiture se remit en marche.
Je n’étais pas, cependant, sans inquiétudes : de temps en temps je me retournais pour m’assurer que je n’étais pas poursuivie ; enfin, je parvins à me débarrasser de mes craintes, en me persuadant qu’il était impossible de me rejoindre, à moins qu’on ne sût précisément par où je fuyais ; ce qui n’était pas présumable, puisque j’étais sûre de n’avoir été vue de personne, et que je n’avais demandé mon chemin à qui que ce fût.
Nous arrivâmes de bonne heure à Cadix : je pris un logement dans la même hôtellerie que les dames qui avaient bien voulu m’y amener ; et après leur avoir fait mille remerciements de leur bonté, je montai à la chambre qu’on m’indiqua pour aviser aux moyens qu’il me faudrait employer pour avoir, de Lelio, des nouvelles que je brûlais et que je craignais d’apprendre.
De retour dans une ville où j’avais connu le bonheur, je ne pus me défendre de verser quelques larmes, en comparant le temps que j’y avais passé dans une maison où tout prévenait mes désirs, avec celui où je me retrouvais, seule, abandonnée de toute la terre. Mes espérances détruites par la mort de Borglia ; le fatal combat qui avait renversé mes projets, tout se réunissait contre moi, pour m’accabler de souvenirs douloureux. Livrée à moi-même, je sentis plus que jamais la nécessité de prendre, sans différer, les informations qui, seules, pouvaient faire cesser l’incertitude qui me tourmentait. Je profitai donc de la facilité que me procurait mon déguisement, et dès le lendemain matin, j’allai dans les environs de la maison de Lelio, bien sûre de ne pouvoir être remarquée dans un quartier où, en supposant que je fusse rencontrée par des personnes qui pourraient m’avoir vue quelquefois, il était hors de toute vraisemblance que je pusse être reconnue sous l’habit que je portais.
J’entrai dans un café, où je me fis servir du chocolat, dans l’intention d’interroger, en particulier, un des garçons, sur un événement qui avait dû faire assez de bruit, pour que personne ne l’ignorât. Je craignais cependant de faire des questions qui pourraient me compromettre, et j’hésitais, flottant entre le désir et la crainte, lorsqu’un particulier entre avec précipitation, vient se placer à une table près de la mienne, où deux jeunes gens déjeunaient, et leur dit à mi-voix, assez haut cependant pour que je puisse l’entendre :
— Soyez tranquilles, Fabricio et sa sœur sont hors de danger, je viens de les accompagner jusqu’au vaisseau sur lequel ils se sont embarqués.
Je remarquai que, lorsque ces jeunes gens eurent appris cette nouvelle, leurs physionomies qui, auparavant, m’avaient paru assez tristes, s’étaient déridées pour prendre l’empreinte de la joie ; je présumai qu’ils étaient les amis de ces monstres.
Cet avis avait produit sur moi l’effet contraire, car, en apprenant la fuite de Fabricio, dont la mort de mon amant devait être la cause, je passais subitement d’une incertitude pénible, à la connaissance d’un malheur certain ; et mon esprit était trop faible pour soutenir ce choc épouvantable, sans en paraître altérée : un torrent de larmes vint inonder mon visage ; j’eus toutes les peines du monde à cacher la cruelle révolution qui s’opérait en moi.
Comme on a toujours de la peine à se convaincre des choses qui deviennent un tourment quand on n’en peut plus douter, je voulais être instruite de tous les détails qui avaient accompagné et suivi cette catastrophe ; pour y parvenir j’attendis que l’heure du déjeuner fut passée, et qu’il ne restât plus personne dans le café ; alors je m’adressai à l’un des garçons, homme d’un certain âge, qui me parut un bon diable.
— Mon ami, lui dis-je, il y avait tout à l’heure, à côté de moi, des jeunes gens qui s’entretenaient d’une affaire d’honneur qui a eu lieu ces jours-ci entre un certain Fabricio et un négociant de ce quartier, auriez-vous connaissance de cette querelle ?
— Oui, monsieur, me répondit ce garçon, j’en sais toutes les particularités, que j’ai entendu raconter ici par M. Bernardo, ami intime du jeune homme qui a succombé dans cette affaire. Si vous êtes curieux de les apprendre, je vais vous en instruire.
Dès que je lui eus fait connaître l’intérêt que je prendrais à l’écouter, il commença ainsi : — Monsieur Lelio, me dit-il, tenait une maison de commerce dans notre voisinage, depuis la mort de son frère, auquel il avait succédé. Du vivant de celui-ci, Lelio avait pour maîtresse une demoiselle, nommée Léonida, qu’il avait promis d’épouser ; mais le frère aîné, après un assez long séjour en Angleterre, pour les affaires de son commerce, ramena de ce pays une jeune fille avec laquelle il vécut jusqu’à sa mort. Cette aventurière, qui se trouvait alors sans ressource, parvint, à ce qu’on dit, à force d’artifice, à se faire aimer du jeune frère, qui eut la sottise d’abandonner pour elle celle à laquelle il avait promis sa main. Le frère de Léonida, pour venger sa sœur, appela en duel Lelio, qu’il blessa mortellement.
— Ne dites-vous pas, mon ami, dis-je en l’interrompant trop vivement, pour entendre la fin de sa phrase, que Lelio n’a été que blessé par son adversaire ?
— Oui, sans doute, reprit mon impertinent conteur qui ne m’avait pas ménagée dans son récit, oui, il a été blessé, mais si grièvement que, le lendemain du rendez-vous, il est mort de ses blessures.
En entendant ces mots, j’éprouvai une faiblesse qui ne me permit plus de rester debout, je fus obligée de m’asseoir.
— Rien de mieux jusque-là, dit mon bavard, en continuant son cruel récit, mais ce que je ne pardonne pas à M. Fabricio et à sa sœur, c’est d’avoir fait enlever cette fille, et d’avoir poussé trop loin leur vengeance, en la faisant empoisonner. Aussi la justice vient-elle de se mêler de cette affaire, et je ne sais pas ce que tout cela va devenir.
Comme je m’aperçus que ce garçon prenait le parti de Fabricio et de sa sœur, et qu’il leur passait tout, excepté le poison, je ne voulus point l’instruire de la fuite de ces assassins, dont je venais d’être informée ; je me contentai de le remercier de sa complaisance, et je sortis après avoir payé la tasse de chocolat que j’avais prise, bien punie de ma curiosité, par les mortifications qu’il m’avait fallu essuyer de la part d’un homme qui m’avait encore, avec cela, donné de fort mauvaises nouvelles.
Certaine de mon malheur, et trop convaincue par ce que je venais d’entendre, que je ne jouissais pas d’une réputation assez brillante pour m’encourager à faire quelques démarches auprès des personnes qui étaient attachées à Lelio, je me décidai à fuir, sentant bien que je ne pourrais jamais vivre que malheureuse dans une ville où le plaisir m’avait apparu sous tant de formes différentes. En conséquence de cette résolution, je me rendis sur le port, déterminée à passer sur le premier vaisseau que je trouverais prêt à partir, quelque part qu’il allât ; au moment où j’y arrivai, un bâtiment marchand allait mettre à la voile pour Livourne ; je m’embarquai.
La traversée fut prompte, et des plus heureuses. Parmi les passagers qui se trouvaient à bord, un jeune Espagnol, nommé Ferdinand, auquel je n’avais pu cacher mon sexe, m’avait fait une cour assidue, et paraissait désirer que je répondisse à son empressement. J’étais libre, et malheureusement mon cœur, qui s’était habitué depuis longtemps à des jouissances devenues nécessaires, ne pouvait plus éprouver de vide : je ne le fis pas soupirer après un bonheur idéal, auquel il mettait un prix infini ; le jour même de notre arrivée à Livourne, je mis le comble à ses désirs.
Ferdinand avait vingt ans ; une querelle de famille l’avait obligé de s’éloigner de la maison paternelle ; et comptant sur les ressources que lui offraient ses talents dans la musique, il avait résolu de passer en Italie, où il serait plus à portée de les faire valoir en les perfectionnant. Il m’instruisit de tout cela en débarquant, et nous allâmes descendre dans le même hôtel où je consentis à passer pour sa femme, en reprenant les habits de mon sexe.
Nous vécûmes en bonne intelligence pendant environ deux mois que nous restâmes ensemble ; mais l’argent qu’il avait apporté d’Espagne, celui qui m’était resté de la bourse de Majorno, tout cela ayant disparu, il fallait prendre quelques moyens, pour éloigner de nous le besoin qui commençait à se faire sentir. Je lui avais déjà conseillé cent fois de se présenter au concert, où je le flattais qu’il serait admis ; mais il aurait fallu travailler pour s’y montrer avec succès, et Ferdinand était l’être le plus paresseux qu’on pût trouver : il n’en fit rien.
Inquiète sur le sort qui m’était réservé avec cet insouciant, j’appréhendais à chaque instant qu’on nous mît à la porte de l’hôtel où nous étions logés, faute de pouvoir y payer notre dépense. Cette idée me poursuivait sans cesse ; enfin, un soir je ne vis pas rentrer Ferdinand, comme de coutume ; mes inquiétudes redoublèrent ; je me rappelai qu’en sortant le matin, il m’avait paru un peu agité ; j’en conclus ou qu’il avait eu dispute avec quelqu’un, et que, m’en ayant fait un mystère, dans la crainte de m’alarmer, il avait péri au rendez-vous qu’on l’avait forcé d’accepter, ou que nous voyant sans ressources, il avait plus écouté son désespoir que son amour, et avait terminé une vie qu’il ne supportait, à ce qu’il me disait depuis quelque temps, qu’à cause de moi.
Ces différentes réflexions m’avaient empêchée de dormir. Le lendemain de bonne heure, on vint frapper à ma porte. C’étaient des officiers de police qui avaient ordre de faire chez moi une exacte perquisition dans nos effets, parce que Ferdinand avait été arrêté la veille, comme complice d’un vol considérable, fait chez un banquier de la ville. Par bonheur, il ne se trouva rien de suspect ; on me laissa chez moi, sous la condition que je me représenterais, si ma présence devenait nécessaire dans le cours du procès.
Cet assaut fut si terrible pour moi, qu’il me réduisit presque au désespoir ; cependant, par réflexion, je ne jugeai pas à propos d’attendre l’effet d’une procédure qui pouvait me devenir fatale, quoique je fusse bien persuadée de mon innocence. Le hasard seul m’avait attachée à Ferdinand, dont rien ne m’obligeait de suivre la destinée : je me décidai donc à fuir une ville où je ne me croyais plus en sûreté, et, profitant du moment où l’hôtesse, étourdie de la scène qui venait de se passer chez elle, était entrée avec plusieurs personnes dans la salle à manger pour les consulter, sans doute, sur ce qu’elle devait faire à mon égard, je descendis promptement, sans être vue de personne, et je sortis de la ville, avant qu’on puisse soupçonner que j’en formais le dessein.
Sans argent, sans connaissances dans un pays étranger, mille autres à ma place auraient été fort embarrassées, et ne se seraient pas si aisément décidées au parti violent que j’avais pris : mais je commençais à être un peu aguerrie ; j’avais d’ailleurs tant de frayeurs de me trouver compromise dans l’affaire de Ferdinand, que je n’avais pas balancé un seul instant à prendre la fuite, la regardant comme indispensable.
J’avais marché toute la journée sans avoir fait beaucoup de chemin, parce que j’évitais la grande route, pour donner le change dans le cas où on me poursuivrait ; et je commençais à me fatiguer, lorsque sur les cinq heures de l’après-midi, passant près d’un petit bois, je fis rencontre d’un capucin, frère quêteur de son métier. L’égrillard avait au plus vingt ans, brun, l’œil vif et frais comme une rose ; un léger duvet couronnait à peine son menton ; du plus loin qu’il me voit, il accourt, et, se débarrassant promptement de l’énorme besace qui contenait sa collecte de la journée :
— Dieu soit loué, s’écrie-t-il en se frottant les mains et de l’air le plus satisfait : que je bénis le ciel de m’être un peu attardé, puisque je fais une aussi belle rencontre ! Dites-moi, la belle voyageuse, ne craignez-vous pas qu’il vous arrive quelque malheur, sur une route déserte, à deux lieues du plus prochain village ?
— Mon frère, lui répondis-je avec un ton hypocrite, je vous avoue que je suis un peu embarrassée dans un pays où je me trouve pour la première fois ; mais je me fie à la Providence ; elle ne m’a point encore abandonnée dans les périls que j’ai hasardés pour dérober ma vie ou mon honneur aux méchants qui, quelquefois, en ont conjuré la perte ; car, quoique je ne sois pas encore bien avancée en âge, le ciel m’a déjà mise à de rudes épreuves ; j’espère cependant encore assez en sa bonté, pour ne pas trop m’inquiéter.
— Vous fuyez donc quelque suborneur qui cherche à vous ravir ce bien si précieux auquel vous paraissez tant attachée.
— Oui, vous l’avez deviné, je fuis un homme dont la passion pour moi était si violente, que je me voyais forcée de me rendre à ses désirs, ou d’éprouver de sa part les plus durs traitements.
Pendant que je parlais, mon capucin me regardait avec des yeux pleins de luxure, où je voyais briller les éclairs du désir.
— Asseyons-nous un peu, me dit-il, vous paraissez fatiguée ; j’ai là des vivres et du vin, permettez que je vous offre un goûter, indigne sans doute de vous être présenté, mais que l’appétit et le bon cœur assaisonneront.
Je ne me fais point prier, j’accepte avec reconnaissance le goûter champêtre de l’amoureux quêteur. Il tire de sa besace du pain, un bon poulet rôti et une bouteille de vin, et me voilà en devoir de restaurer mon estomac, que la fatigue avait un peu délabré. Il faisait chaud, nous n’avions point de verre ; à même la bouteille, on boit plus qu’on ne veut ; la seconde entamée, il fallut l’achever : ma foi, ma raison se noya, et mon esprit perdit l’équilibre si nécessaire dans le voisinage des précipices.
Aussitôt que mon gaillard, qui s’était ménagé, vit le moment favorable, il se mit en devoir d’en profiter, et plus hardi qu’un page, il me renverse, me fait un oreiller de sa besace, et d’une main luxurieuse, et vraiment monacale, il découvre l’autel, où, de par saint François et son merveilleux cordon, il fait vœu d’aimer toute la vie. Hors d’état de me défendre contre une attaque aussi imprévue, je me laisse gouverner par ce saint directeur, et plusieurs fois dans un instant, car ces moments-là sont bien courts, les portes du paradis s’ouvrent pour moi, et me laissent jouir des plaisirs réservés aux bienheureux qui l’habitent.
Mon bonheur venait de cesser, l’ivresse de mes sens avait disparu, mais ma raison faisait encore de vains efforts pour retrouver le calme que Bacchus avait si vivement troublé : mon capucin, qui s’en aperçoit, pour détourner les reproches que méritait sa conduite, et dont il sentait bien que je l’accablerais, si j’étais une fois rendue à moi-même, eut recours à une fiole de liqueur qu’il avait dans un coin de sa besace ; il la porta à ma bouche, que j’ouvris machinalement, et en y répandant cette eau spiritueuse, il aggrava les torts qu’il devait réparer.
Immobile alors, et privée de toutes mes facultés, je m’étendis sur l’herbe, où je m’endormis profondément.
Il était presque nuit : l’endroit où nous étions n’était point passager ; le bon frère crut pouvoir m’abandonner à l’œil vigilant de saint François, et comme son couvent n’était qu’à un demi-quart de lieue de là, il y vola pour déposer sa besace et instruire le père gardien, dont il était le pourvoyeur en tout genre, de la bonne aubaine qui lui était échue. Mes deux enfroqués ne perdirent pas un instant, ils accoururent et me trouvèrent encore dans les bras du sommeil. Le frère me réveilla tout doucement, me parla de son amour pour m’exhorter à le suivre ; mais j’étais si troublée, que je l’entendais à peine, sans m’apercevoir qu’il n’était pas seul. Ils m’emmenèrent, me conduisirent à leur couvent, où on me fit entrer par une porte du jardin, dont mes conducteurs avaient seuls la clef, et je fus introduite, avec mystère, dans l’appartement du révérend père gardien. Tous les religieux étaient déjà rentrés dans leurs cellules : Hilarion comme quêteur, et le gardien à cause de sa dignité, avaient seuls le droit d’enfreindre la règle commune, et Dieu sait si les coquins savaient tirer parti de leur liberté.
Quand les vapeurs qui avaient absorbé ma raison furent entièrement dissipées, je fus bien surprise de me trouver parmi des moines et des femmes, qui se disposaient à prendre leur part d’un repas somptueux qu’on venait de servir chez le révérend : il faut croire que le sommeil s’était emparé de moi depuis mon arrivée, et qu’on m’avait laissée profiter de ses douceurs, pour jouir plus sûrement de mon réveil ; ce qu’il y a de certain, c’est que des bras de Morphée, je passai dans ceux du plaisir, si l’on peut toutefois donner ce nom à la grosse gaîté qui présida l’orgie scandaleuse de ce banquet séraphique.
Il y aurait de la folie à vouloir essayer de retracer les obscénités dont je fus, cette nuit-là, actrice et témoin : il faut être moine pour en inventer et en raconter de pareilles, et ce n’est que dans un cloître que peuvent germer et s’étendre les vices les plus dégoûtants, nés de la paresse et de la fainéantise. Quoi qu’il en soit, jetée, par hasard, dans cette maison de débauche, il fallut bien me prêter, malgré moi, au libertinage de mes hospitaliers, et me livrer, sans réserve, à leur lubricité ; mais deux mois s’étaient à peine écoulés, que je sentis mes forces diminuer, ma santé s’altérer par les veilles continuelles et par les excès de tous genres que j’étais obligée de faire avec ces infatigables libertins. Je songeai sérieusement à me retirer de cette vie trop active, dans laquelle j’aurais infailliblement péri victime de mon dévouement à leurs caprices. La difficulté était de trouver le moyen de sortir de cette infernale maison, dans laquelle j’étais, de jour en jour, plus resserrée, parce que les coquins sentaient combien j’étais devenue nécessaire à leurs plaisirs.
Seule dans le couvent, je n’y étais encore qu’à l’insu des moines admis aux plaisirs du chef. Quand ceux-ci me voyaient, ce n’était que dans les jours de débauche générale, où j’avais l’air d’avoir été introduite avec les autres femmes qu’on y faisait trouver. Enfermée tout le jour dans une chambre, je ne descendais que la nuit au jardin, accompagnée du gardien ou d’Hilarion, qui avait voulu conserver ses droits, et je m’y voyais souvent obligée de renouveler, avec l’un ou l’autre, les exercices du jour.
L’extrême désir que j’avais de me débarrasser de leurs mains me faisait inventer mille expédients pour leur échapper ; mais presque toujours l’impossibilité de réussir m’obligeait, en rompant mes mesures, de rester malgré moi le plastron de leurs débauches. Enfin, une idée heureuse vint me tirer d’embarras, et rendit à mon esprit agité l’espoir qu’il commençait à perdre.
Le gardien était d’une taille moyenne ; je présumai que ses habits de moine iraient à la mienne, en gardant par-dessous ceux de mon sexe, et qu’à l’aide de ce travestissement, je pourrais hasarder de sortir de cette maison et voyager plus sûrement dans ce pays inconnu. L’imagination une fois montée, il faut que cette idée s’effectue ; je ne m’occupe plus que des moyens de la faire réussir.
Dès le lendemain, pendant que le révérend père était allé figurer à l’office avec les autres, j’affublai la sainte guenille et le fameux cordon de saint François, et munie de la clef du jardin, que j’avais escamotée la veille au gardien, rentrant ivre-mort, je m’esquive de ce repaire diabolique en bénissant le ciel de m’avoir encore retirée, sans malheur, du gouffre dans lequel j’avais eu la faiblesse de me laisser entraîner.
J’étais sortie du couvent avec tant de précipitation, que je ne m’étais seulement pas donné la peine de regarder de quel côté je tournais, et le hasard faisait errer mes pas depuis une heure, sans avoir rencontré personne, quand enfin j’aperçus de loin un homme à cheval qui courait à toute bride. Je m’ajustai du mieux que je pus pour ne pas paraître suspecte au cavalier lorsqu’il passerait près de moi, et je fis bien de prendre mes précautions, car il s’arrêta quand nous fûmes à dix pas l’un de l’autre.
— Mon père, me dit-il, j’allais à votre couvent pour prier l’un de vous de venir assister, dans ses derniers moments, la signora Biancha, ma maîtresse, qui est actuellement à son château dans le plus grand danger. Puisque Dieu permet que je vous rencontre, j’espère que vous serez assez charitable pour ne pas me laisser aller plus loin. Montez en croupe, mon révérend, et que Dieu vous bénisse.
Le cas était épineux ; j’avais quelques risques à courir ; car, d’un côté, si on venait à découvrir que je n’étais qu’un capucin postiche, on pouvait me faire un mauvais parti et me livrer à la justice ; et de l’autre, en refusant le cavalier, dont j’ignorais l’humeur, je m’exposais peut-être à de mauvais traitements de sa part.
— Eh bien ! soit, me dis-je à moi-même, soyons capucin ; démentons le proverbe, et qu’une bonne fois l’habit fasse le moine.
Je monte donc derrière le cavalier, et nous voilà trottant dans le chemin du château. Les secousses que me donnait la marche forcée du cheval, m’élevant à plus de trois pouces de sa croupe, me faisaient retomber lourdement sur une des poches du froc dans laquelle j’ignorais qu’il y eût quelque chose, et ma pauvre fesse se meurtrissait fort ; d’une main je me retiens au manteau de mon guide, et je porte l’autre à la poche, qui m’était devenue si incommode. Je sens que la cause de mon mal était une paire de pistolets, que la prévoyance du père gardien lui faisait porter sur lui dans ses courses nocturnes. Je soulève cette poche, la place à côté de moi, crainte de danger, et nous arrivons.
En montant à l’appartement de la signora, je pris le ton qui me convenait dans le saint ministère que j’allais remplir. On ouvre ; à peine suis-je entrée dans la chambre où gisait la malade, je me prosterne à genoux, puis levant les yeux et les mains au ciel, je feins, d’un air cafard, d’implorer la divinité pour la pauvre pécheresse que je vais essayer de réconcilier avec son créateur. En approchant du lit de la malade, j’ai soin de me couvrir le visage avec mon mouchoir, pour n’être pas vue de trop près. Cependant j’étais bien aise de savoir à qui j’avais affaire, et si l’on était d’âge et de figure à obtenir la rémission des jolis péchés qu’on pourrait avoir commis ; j’observai donc ma pénitente du coin de l’œil : vingt-deux ans tout au plus ; de grands yeux noirs et un visage couvert de la mort, dont les traits laissaient encore entrevoir leur régularité, m’intéressèrent en sa faveur, et je me sentis disposée à lui pardonner toutes ses faiblesses.
— Allons, ma fille, lui dis-je d’un ton mielleux, ouvrez-moi votre cœur, et surtout ne me déguisez rien, si vous voulez trouver grâce auprès de celui que vous avez offensé.
Ma belle pénitente se rassura, me fit l’aveu de quelques infidélités qu’elle avait faites à un mari vieux et jaloux, absent dans ce moment, et qu’on l’avait forcée de prendre, à cause de l’immense fortune dont il jouissait. Je riais, sous cape, en lui entendant raconter ses petites fredaines, et d’après ce que j’avais vu dans le couvent que je quittais, et la réputation dont jouissent en général les prêtres et les moines, je rougissais de honte pour les hommes qui ont la faiblesse de croire qu’un ministre catholique, souvent perdu de crimes, a le droit inaliénable de faire disparaître, par l’absolution, les taches qu’on a faites à sa propre réputation et à celle des autres, et les torts de toute espèce qu’on peut avoir envers son prochain.
Quand la belle pécheresse eut défilé son chapelet, je fis la singerie du sage pour l’absoudre ; et l’œil élevé, le cœur contrit, elle reçut, d’un air satisfait, la bénédiction que je lui donnai en signe de réconciliation.
Comme j’allais me lever et quitter mon confessionnal de rencontre, la signora me prit par le bras et me dit :
— Mon père, je sens bien que je dois succomber dans la maladie dont je suis attaquée, et que bientôt je vais être ravie à la lumière. Oserais-je vous prier de vous charger d’une somme que j’ai renfermée dans cette bourse (elle la tira de dessous son oreiller), et de l’employer à faire dire des messes et des prières pour le repos de mon âme.
— Très volontiers, ma fille, lui répondis-je en recevant la bourse, vos intentions religieuses seront remplies, et Dieu vous saura gré du bon emploi que vous faites de vos richesses.
Après cela je la quittai, en lui promettant de revenir le lendemain.
Je n’avais guère envie de tenir ma parole ; de trop fortes raisons m’invitaient à y manquer. En traversant l’appartement, je rencontrai, dans l’antichambre, le même domestique qui m’avait amenée ; il m’offrit de me reconduire, et malgré mes refus réitérés, il insista et me força d’accepter ; mais pendant qu’il était allé chercher le cheval, je sortis du château et me mis à courir de toutes mes forces, en observant bien de ne pas reprendre le chemin du couvent.
Il n’était pas possible de me dérober à la vue de ce domestique, j’étais en rase campagne ; je me flattais seulement que, quand il me verrait loin de lui, dans une route opposée à celle que je devais tenir, il ne s’obstinerait plus à vouloir me reconduire malgré moi ; mais je ne savais pas le motif qui le faisait agir ; j’ignorais que le fripon avait vu la signora Biancha me remettre la bourse en question, et qu’il avait dessein de partager avec le couvent, ou plutôt avec moi, car elle était flambée pour les révérends pères. Il m’aperçoit ; quelque temps de galop suffisent pour m’atteindre.
— Où diable courez-vous donc avec tant de précipitation ? me dit-il ; qui croirait, à votre légèreté, que vous êtes si chargé d’or ? De bonne foi, n’y a-t-il pas de la conscience à se faire payer si chèrement une heure de temps, et ne serait-ce pas trop présumer que de croire que vous serez assez raisonnable pour me donner une partie du riche présent qu’on vient de vous faire.
Je ne répondis rien, et je continuai ma route. Mon gaillard s’apercevant bien que je n’étais pas d’humeur à me dépouiller pour lui d’une somme qui m’était venue si à propos, me poursuit et m’atteint par le capuchon. Je m’arrête, de peur qu’en le rabattant le capucin disparaisse à ses yeux ; il descend de cheval, me prend au collet et veut absolument me forcer, puisque j’ai refusé de partager, de lui remettre la bourse en entier. Ma foi, dès que je vis qu’il fallait sérieusement en venir aux mains, si je voulais défendre mon or, trop faible pour résister, je sors un des pistolets que le hasard avait fait trouver dans ma poche, je l’arme, n’ayant que l’intention de lui faire peur ; mais en le lui présentant sur la gorge, il part ; et mon coquin tombe à mes pieds. Le cheval eut tant de frayeur du coup, qu’il traîna à plus de dix pas son cavalier, qui tenait la bride attachée à son bras. Cet accident, quoique fâcheux, ne me fit point perdre la tête ; je me débarrassai seulement du froc, qui pouvait me trahir, et comme j’avais gardé dessous mes habillements de fille, je n’eus qu’à mettre sur ma tête un grand bonnet que j’avais dans ma poche ; je détachai ensuite le cheval, et, grimpée lestement dessus, je disparus comme un éclair.
Je ne m’étais pas trouvée embarrassée dans cette circonstance, parce que j’avais autrefois appris à monter à cheval chez milord, qui aimait cet exercice, et qui me le faisait prendre avec lui tous les jours à la terre qu’il habitait l’été, et où nous avions passé quelques mois, quand je m’évadai.
Montée comme un saint Georges, et la bourse garnie, je parcourus une étendue immense de pays sans rencontrer personne, ni même aucune habitation ; cependant, je m’apercevais que mon cheval, dont j’avais précipité la marche, commençait à se fatiguer ; et moi-même je sentais que le déjeuner que j’avais pris avant de sortir du couvent était déjà bien loin ; il fallait néanmoins marcher jusqu’au village le plus prochain, et se traîner tant que le hasard m’en ferait rencontrer un, car la peur m’avait égarée dans la campagne ; enfin, après encore une heure au moins de traversée, j’aperçus de loin quelques maisons éparses, où je jugeai que je pourrais trouver un gîte pour la nuit.
J’aiguillonnai de nouveau mon coursier ; bientôt j’arrivai à la première maison d’un hameau. C’était une petite ferme que de bonnes gens faisaient valoir ; j’y fus reçue avec cordialité. Le maître de la maison, vieillard respectable, Français d’origine, que des circonstances critiques avaient depuis trente ans relégué en Toscane, fut si enchanté que le hasard eût conduit chez lui une compatriote, qu’il ne sut quelle fête me faire, et me témoigna, par mille attentions, combien il était flatté de me posséder. Pour moi, ravie d’avoir rencontré d’aussi braves gens, j’oubliai mes aventures de la journée, pour me reposer de mes fatigues dans le sein de l’amitié qui venait de m’ouvrir, si tendrement, ses bras consolateurs.
Le lendemain matin, dès la pointe du jour, je me disposai à partir, parce que j’appréhendais que les événements de la veille ne m’eussent fait poursuivre. Mon hôte, que cette résolution chagrina beaucoup, parce qu’il avait intention de me garder quelque temps chez lui, me voyant décidée à ne pas m’arrêter davantage, pour arriver le plus tôt possible à Rome, où je supposai que j’avais des affaires importantes à terminer, m’offrit de me conduire jusqu’à Pise, qui n’était qu’à deux lieues de son habitation. J’acceptai volontiers pour ne pas m’égarer, et, après m’avoir forcée de prendre pour voyager plus à mon aise, une selle de femme qui lui était inutile depuis qu’il avait perdu la sienne, nous prîmes le chemin de Pise, où nous arrivâmes en très peu de temps. Je le quittai alors, après lui avoir témoigné toute ma reconnaissance de ses attentions, qu’il poussa jusqu’à me donner l’itinéraire de la route que je devais suivre pour me rendre à Florence.
Je mis le plus de célérité possible à m’éloigner du théâtre où tant d’événements m’avaient mise en danger, et je courus toute la journée sans m’arrêter, si ce n’est pour prendre les rafraîchissements qui m’étaient nécessaires, et faire reposer mon coursier. Le soir, à la couchée, j’eus la curiosité de compter l’or que j’avais reçue pour préparer les voies du salut à ma belle pénitente, et je trouvai dans la bourse, si bien défendue, environ mille écus de notre argent.
Satisfaite d’avoir en ma possession une somme aussi considérable, qui me mettait au-dessus du besoin, et en état de voyager pendant quelque temps, sans être obligée d’intriguer pour frayer à mes dépenses, je me promis bien de rester maîtresse de mon cœur, au moins tant que mon argent durerait ; et sans renoncer au plaisir qui était depuis longtemps pour moi un mal nécessaire, j’étais toute glorieuse de pouvoir choisir un objet capable de m’inspirer des désirs, après avoir été toujours forcée de condescendre à ceux des autres.
Plus heureuse que je ne l’avais encore été, puisque je ne dépendais de personne ; l’esprit dégagé de mes craintes, et fermement décidée à bannir toute inquiétude, à ne m’occuper que des jouissances que pourraient me procurer mon voyage et le chapitre des événements, je suivis la route de Florence, où mon intention était de séjourner quelques jours pour y voir à loisir toutes les curiosités que renferme cette superbe ville, dont j’avais autrefois entendu parler par un ami de mon oncle qui y avait voyagé dans sa jeunesse.
Rendue à Florence après deux petites journées de marche, sans qu’il me soit rien arrivé de remarquable sur la route, j’allai loger chez Carlo, Anglais d’origine, qui me fut indiqué comme tenant la meilleure auberge de la ville.
Plusieurs passagers que j’y trouvai, ayant su, à la table commune, que je voyageais pour mon plaisir (car ce fut là ma réponse à leurs questions), m’offrirent de m’accompagner dans les différents endroits où la curiosité pourrait m’attirer ; je les refusai tous, sans exception, dans la crainte de prendre avec eux des engagements que, sans goût ni penchant, mais seulement par habitude, j’aurais peut-être eu la faiblesse de tenir ; la meilleure raison que je puisse donner de mes refus, c’est que j’avais jeté mes vues sur un sujet intéressant dont je voulais faire mon profit.
Le fils de la maison où j’étais logée était un enfant de quinze ans, grand pour son âge, et beau comme un ange. Dès que je le vis, je crus trouver dans ses traits une ressemblance parfaite avec ceux de mon malheureux Georges. Cette conformité me fit naître des idées voluptueuses que je brûlai de satisfaire ; c’était un bonheur pour moi de ressaisir l’image de l’amant adoré, qui m’avait été ravi d’une manière si cruelle ; et je me sentais disposée à tout sacrifier, à tout mettre en usage, pour rendre à mon imagination, séduite par cet aimable prestige, les jouissances enlevées au cœur le plus passionné.
Le lendemain de mon arrivée, je fis appeler cet enfant : quand il fut monté dans ma chambre, je l’embrassai tendrement et lui demandai s’il voulait me faire le plaisir de venir avec moi pour me conduire dans Florence, partout où il pourrait se trouver quelque chose d’intéressant à voir ; que je serais très reconnaissante de sa complaisance ; il me dit qu’il le voulait bien, si sa maman y consentait ; j’obtins cette permission, et nous partîmes.
Je ne suis pas naturellement curieuse ; mais je me ressouvenais d’avoir entendu dire qu’un duc de Saxe (je crois qu’il se nommait Albert) trouvait la ville de Florence si belle, qu’il avait coutume de dire qu’il ne fallait la laisser voir aux étrangers que les fêtes et les dimanches ; cette singularité me fit désirer de voir si cette capitale méritait tant de renommée : et en effet, quoique je ne fisse que la parcourir, j’en vis assez pour être convaincue qu’il n’y avait rien d’exagéré dans la description brillante qu’on m’en avait faite.
Toujours occupée de mon projet de plaisir, quand nous rentrâmes pour dîner, je fis monter avec moi mon jeune conducteur ; je bouillais d’impatience d’éteindre, dans cette nouvelle jouissance, l’ardeur brûlante dont je me sentais dévorée : mais ce n’était pas peu de chose d’amener Marcello, mon petit ami (car c’est ainsi que je l’appelais), au point de me faire goûter les indicibles délices que je me promettais avec lui ; trop jeune pour sentir près de moi l’aiguillon des désirs, trop timide pour essayer de les satisfaire, quand même la nature les aurait déjà éveillés dans son cœur, je vis bien qu’il me fallait faire toutes les avances, si je ne voulais pas rendre mes tentatives infructueuses. Emportée par la violence de ma passion, aucune considération ne put m’arrêter : ni les dangers auxquels je m’exposais en devenant l’instrument de corruption de l’innocence dont je n’étais que dépositaire, ni la honte qui allait rejaillir sur moi, en recourant à des moyens qui font rougir la pudeur, rien ne fut capable de me retenir ; je m’aveuglai sur les résultats de ma conduite pour franchir toutes les bornes de la décence. Ma gorge, que je débarrassai promptement du voile qui la lui dérobait ; une cuisse que je découvris, sous prétexte de remettre une jarretière incommode dont le nœud venait de s’échapper, tout cela fixa bien ses regards ; mais voyant qu’il restait spectateur immobile de quelques-uns de mes attraits sans en deviner d’autres, je l’attirai sur mes genoux, et par mille agaceries, mille inventions lubriques, j’essayai de monter les ressorts de cette machine que je voulais faire mouvoir à mon gré.
Quand je crus être parvenue au degré d’élévation nécessaire pour former les accords que je désirais, mes doigts se portèrent sur la corde principale ; je la trouvai suffisamment tendue. Pour ne pas lui donner le temps de se relâcher par un jeu inutile, je me levai brusquement en passant un bras autour du corps de mon aimable enfant, et tandis que, la bouche collée sur la sienne, d’une main je l’entraînais vers mon lit, de l’autre je dégageais cette corde enchanteresse des liens qui l’empêchaient de rendre les sons harmonieux que je voulais entendre. Quand les préparatifs de ce concert furent achevés, je me renversai sur le lit, et découvrant le pupitre où mon élève devait chanter sa première leçon de plaisir, je guidai sa voix d’abord tremblante, mais qui bientôt rassurée par mes encouragements, prit son essor et me fit éprouver des sensations si délicieuses, que toute ma raison se noya dans un torrent de voluptés.
Enivrée de plaisir, j’étais restée, sans aucun mouvement, étendue sur mon lit : Marcello, mollement penché sur moi, y ranimait pour ainsi dire sa jouissance, et puisait dans mes yeux et sur mes lèvres de nouvelles forces pour recommencer sa leçon ; je le serrais dans mes bras ; de nouveaux sons allaient se faire entendre : ô revers cruel ! pressée de jouir, et craignant de perdre la proie à laquelle je m’étais attachée, j’avais oublié de prendre les précautions nécessaires pour assurer nos plaisirs ; la porte de ma chambre était ouverte, la mère de Marcello entre, et furieuse de nous trouver dans une position qui ne lui laissait aucun doute sur nos occupations, elle s’élance avec impétuosité sur moi, m’accable d’injures, et tandis que par ses cris elle fait monter dans ma chambre une grande partie des locataires de la maison, auxquels le bruit fait craindre un événement de plus haute importance, elle me distribue des soufflets et des coups de poings que j’ai la honte de recevoir, pour la plupart, en présence de témoins ; aussi je conviens, de bien bonne foi, que je n’éprouvai jamais l’humiliation que j’endurai ce jour-là.
Pour le pauvre Marcello, tapi dans un coin de la chambre, la tête baissée et tournée du côté de la muraille, confus et n’osant regarder personne, il s’était rajusté de son mieux : sa mère le fixa d’un œil sévère et lui ordonna de descendre, en lui promettant la récompense due à son libertinage, dont j’étais seule la cause.
J’essayerais en vain de peindre la situation dans laquelle je me trouvai ; en proie à la colère d’une femme envers laquelle j’avais des torts réels que je ne cherchais point à excuser ; en butte aux plaisanteries d’une foule de curieux pour qui cette scène avait un caractère de gaieté insupportable pour moi ; je m’étais assise sur une chaise placée près de mon lit, et là, cachée par mes mains, sans oser montrer ma figure, où je sentais que la honte était peinte en traits de feu, j’attendais en silence le calme qui devait succéder à l’impétuosité de l’orage qui m’avait surprise en si beau chemin.
Enfin, la chère maman, fatiguée de quereller, d’injurier ; les spectateurs, ennuyés de la monotonie du spectacle (car on se lasse de tout), me laissèrent seule livrée aux réflexions qui devaient être la suite nécessaire de ce qui venait de se passer. Je ne m’amusai point à calculer si la masse de mes jouissances pouvait balancer celle des humiliations dont j’étais abreuvée ; je crus qu’il était prudent de quitter une maison dont j’allais être la fable, et de gagner un autre séjour, où, avec la certitude de n’être pas connue, je pourrais cacher ma honte et mes remords : je fis donc seller mon cheval, et après avoir fait payer ma dépense par le garçon d’écurie, auquel je remis ce qu’on me demanda, je pris le chemin de Rome, que je désirais voir, en me promettant bien d’être plus soigneuse à l’avenir, s’il m’arrivait encore de vouloir satisfaire quelques caprices de ce genre.
Il n’était que midi quand je montai à cheval ; je consultai mon itinéraire pour déterminer l’endroit où j’irais coucher ; je me décidai à pousser jusqu’à Sienne, qui n’est éloignée de Florence que de cinq postes et demie. Nous étions dans un de ces beaux jours d’été, où il n’y a presque pas de nuit ; je ne forçai point ma monture, et j’arrivai encore d’assez bonne heure après avoir parcouru un pays charmant, où l’œil est sans cesse récréé par la variété des sites et la fertilité des vallons couverts de vignes et d’oliviers. Je descendis chez Moncène, où je fus parfaitement bien traitée pendant les deux jours que je séjournai dans cette ville, l’une des plus célèbres de la Toscane, mais qui n’offre rien de merveilleux, si ce n’est la cathédrale et la place du palais de la seigneurie.
Le troisième jour je repris ma route, dans l’intention de m’arrêter le soir à Ponte Centino, bourgade distante d’environ quinze lieues de Sienne ; je ne fus pas, à beaucoup près, aussi contente de mon voyage que les jours précédents ; car, quoique la route soit très belle, on n’y trouve que des montagnes peu fertiles, et il faut toujours monter et descendre, ce qui est très fatigant ; enfin il n’y avait plus que patience : il ne me restait qu’environ trois lieues à faire pour arriver au gîte. Je venais de traverser un petit endroit, appelé Redicofani. À trois quarts de lieue de là, j’aperçus de loin un cabriolet arrêté et un homme qui essayait de faire relever le cheval qui s’était abattu. Je redoublai le pas, et lorsque j’abordai ce voyageur, je le trouvai dans le plus grand embarras ; son malheureux cheval, excédé de fatigue, venait d’expirer sur la route.
— Pour Dieu ! ma belle dame, me dit-il, daignez me rendre un important service. Vous voyez l’accident qui m’arrive ; je suis trop éloigné de l’endroit d’où je sors, pour y aller chercher du secours, et je ne puis abandonner ma voiture sur un grand chemin, sans m’exposer à être pillé. J’ose attendre de votre complaisance que vous voudrez bien me permettre d’atteler votre cheval à mon cabriolet, si votre intention est de vous rendre à Ponte Centino, par où je dois passer, et là, je prendrai la poste jusqu’à Rome, où j’ai dessein d’aller.
— Je suis trop heureuse, lui répondis-je en mettant pied à terre, de pouvoir vous être utile ; disposez de mon cheval ; je ne vous assure pas qu’il fera votre affaire, car je ne l’ai encore employé qu’à la selle, et j’ignore s’il est dressé à traîner une voiture.
— Essayons-en toujours, puisque vous le voulez bien ; avec de la prudence, j’espère qu’il nous mènera à bon port.
Et en un instant mon cheval fut attelé. On attacha la selle sur la malle qui était derrière, et nous montâmes en voiture. Il fit d’abord beaucoup de difficultés, et on ne tarda pas à s’apercevoir qu’il n’était point habitué à tirer ; cependant, après quelques écarts, il se mit en train, et nous nous crûmes sauvés. Mais à peine avions-nous fait cent pas, que le maudit cheval, impatienté du bruit de la voiture, auquel il n’était point accoutumé, s’emporte, quitte la route et nous mène à travers champs, d’écueils en écueils, sans qu’il soit possible de parvenir à l’arrêter. Déjà plusieurs fossés avaient été traversés sans que le choc de la voiture eût pu ralentir sa course ; un autre, beaucoup plus grand, se rencontre sous ses pas, il le franchit de même, et quand nous fûmes en haut de la berge, nous nous trouvâmes sur le point d’être précipités dans un trou d’une profondeur immense, parce que le chemin qui se trouvait entre ce précipice et le fossé que nous venions de quitter, était à peine suffisant pour le passage de la voiture.
Dès que mon compagnon de voyage s’aperçoit du danger que nous courons, il s’élance hors du cabriolet et se tient un instant sur le brancard pour saisir le premier endroit favorable où il pourra se jeter à terre ; par malheur son pied glisse, et malgré ses efforts pour se retenir, il tombe à la renverse dans le précipice qu’il voulait éviter. Cette chute épouvanta tellement le cheval, qu’elle lui fit faire, en sens contraire, un mouvement précipité qui m’écarta du péril ; mais les deux pieds de devant lui manquèrent à la fois, il s’abattit dans le fossé où il était redescendu ; ce qui me donna le temps de sauter en bas du cabriolet qui, heureusement, ne fut point endommagé. Mon premier soin fut de sauter à la bride du cheval. Il se releva, tremblant de tous ses membres, et je le contins pendant quelque temps pour le rassurer.
Quand je vis qu’il était assez tranquille pour l’abandonner un instant, je remontai sur la berge avec l’intention de voler, s’il était temps encore, au secours de mon malheureux inconnu ; mais ce fut inutilement que je le cherchai des yeux, il avait été vraisemblablement englouti dans une mare d’eau qui terminait ce précipice épouvantable. Ce fut alors que je vis avec effroi tous les dangers qui m’avaient menacée, et je fus un moment sans pouvoir me soutenir. Je pleurai amèrement sur le sort de cet infortuné, ne pouvant concevoir comment j’avais été préservée d’un si cruel destin, moi dont la vie était un scandale perpétuel. Sans chercher à affermir, par cet événement, les fausses idées que j’avais alors, et m’abandonnant plus que jamais, au hasard seul qui m’avait déjà plusieurs fois si bien servie, j’essayai de me tirer du mauvais pas où je me trouvais, et de profiter, s’il était possible, de cette circonstance fâcheuse pour éviter à l’avenir, pour mon compte, un pareil malheur.
Je revins à mon cheval, qui n’avait pas bougé depuis que je l’avais quitté : je me gardai bien de remonter en voiture ; je le pris par la bride pour le ramener sur la route que je n’avais pas perdue de vue. Il ne fit pas la moindre difficulté, me suivit tranquillement, et j’usai de ce moyen pour le conduire jusqu’à Ponte Centino. Il était nuit quand j’y arrivai. Chemin faisant, j’avais réfléchi sur ce que je devais faire dans la position où je me trouvais, et tout bien calculé, je me décidai à ne point m’arrêter dans cet endroit, trop voisin du lieu de la scène qui venait de se passer, quoiqu’il n’y eût point de témoins de l’événement ; mais le cheval, mort sur la route, pouvait être reconnu par des voyageurs qui l’auraient vu attelé au cabriolet dont je me servais, et ce seul indice aurait pu me trahir ; j’allai donc à la poste, où je demandai des chevaux ; je vendis le mien, et je partis, après avoir ranimé mes forces par un bon souper que je me fis servir.
Je n’étais plus qu’à vingt-deux lieues de Rome ; j’aurais bien désiré pouvoir franchir cet espace avec la rapidité de l’oiseau, pour me dérober plus promptement aux recherches que j’avais la sottise de craindre ; mais, par réflexion, je sentis bien que j’étais dans l’erreur, et que l’inconnu paraissait venir de trop loin, pour que j’eusse quelque chose à redouter dans un pays où il n’avait, comme moi, personne qu’il intéressât. Je remontai donc tranquillement en voiture, je payai largement les guides, pour être bien servie, et j’arrivai dans cette fameuse capitale du monde chrétien. Le postillon qui m’amena della Storta me conduisit place d’Espagne, chez Benedetto, où je descendis d’abord avec l’intention d’y rester pendant le temps que je comptais employer à voir les monuments et les antiquités que renferme cette ville magnifique, et de là me remettre en route, pour courir encore de nouveaux hasards.
Mon premier soin, en arrivant, fut de faire décharger la malle et vider le coffre et la cave du cabriolet qui regorgeaient de paquets de toute espèce ; je fis monter tout cela dans ma chambre, et je passai le reste de la journée à en faire l’examen. Je fus obligée de faire ouvrir la malle, car son maître en avait sans doute la clef sur lui lors de son accident. Elle contenait, en monnaie d’or de différents pays, plus de deux cent mille francs, sans compter quelques bijoux précieux, du linge et des papiers que je brûlai sans vouloir en lire aucun.
Devenue riche, par le plus grand hasard du monde, et surtout dans un pays où j’aurais été misérable sans ce bienfait de la fortune, je montai ma garde-robe des effets les plus nécessaires, en remettant à me donner le surplus au temps où, ayant choisi une ville dans toutes celles que j’avais vues pour y fixer mon domicile, je pourrais à loisir jouir des biens que je possédais.
Dès ce moment, je fis vœu de renoncer, pour la vie, au libertinage qui avait souillé mes plus belles années ; je me promis bien de racheter mes fautes passées, non pas par la pénitence, car je n’aurais jamais été tentée d’employer ce remède, mais par quelques bonnes actions, s’il était en mon pouvoir de les faire, et de me rapprocher ainsi, par degrés, du temple de la vertu que j’avais tant de fois profané.
Pour y parvenir, je me fis un plan de conduite dont je ne devais pas m’écarter ; et dès l’instant même, j’osai prendre pour habitude au bien, le désir que j’avais de le faire.
Quelques censeurs rigides observeront peut-être que ce changement subit n’est pas naturel, au milieu des excès auxquels ma jeunesse était abandonnée : je répondrai que, quand on n’a pas tout à fait le cœur corrompu, que ce n’est que par circonstance, et en quelque sorte malgré soi, qu’on a donné dans le libertinage, il ne faut qu’une occasion pour en sortir, et qu’il en coûte toujours moins pour revenir de ses égarements, qu’on n’a éprouvé de peine à s’y livrer, parce qu’on a le sentiment intime qu’on peut encore, par un retour sincère, mériter l’estime des gens honnêtes, que l’approche du vice avait effarouchés.
Il y avait déjà près d’un mois que j’étais à Rome. J’allais entrer dans l’église Saint-Pierre, suivie d’un domestique qui me conduisait partout, lorsqu’un jeune homme qui en sortait s’arrête devant moi tout interdit. Je le fixe : nous restons pendant quelques instants immobiles et muets de plaisir. Enfin, je romps le silence, et d’une voix tremblante, entrecoupée :
— Est-ce toi, lui demandai-je, mon cher Georges ?…
— Est-ce toi, me dit-il en même temps, ma chère Amélie ?
— Oui.
— Oui, répondons-nous ensemble… Mais par quel événement heureux nous rencontrons-nous dans un pays aussi éloigné du nôtre, après nous avoir crus séparés pour jamais ?
Et sans penser que nous étions sur une place publique, nous nous tenions étroitement serrés dans les bras l’un de l’autre.
— Quoi ! lui dis-je en le regardant avec une joie excessive, que l’étonnement seul pouvait contenir, et sans oser me persuader que ce fût lui, quoi ! c’est donc toi !… tu vis !… tu es rendu à mon amour… toi ! que j’ai laissé pour mort au moment où nous venions d’échapper à la barbarie de nos persécuteurs ?
— Oui… c’est bien moi… je suis ce malheureux Georges que la rigueur de son sort a si longtemps privé de celle qui devait faire son bonheur ; mais Georges, le plus heureux des hommes, puisqu’il vient de la retrouver. Et depuis quand es-tu dans cette ville ?
— Depuis un mois, ou plutôt depuis un siècle, puisque nous y étions sans nous voir.
— Qui t’y as conduite ?
— Le hasard.
— Dis plutôt mon bonheur.
— Mais je suis logée place d’Espagne, lui dis-je, viens me conduire, nous jouirons au moins du plaisir d’être quelques heures ensemble, après une aussi longue séparation.
Il me donna le bras ; nous revînmes à mon hôtel, où je fis servir un bon dîner pour célébrer notre réunion.
Au dessert, je priai Georges, qui ne revenait pas de son ravissement, de m’apprendre par quel miracle il avait survécu au coup fatal dont je l’avais vu frapper, et de me donner des détails sur ce qui lui était arrivé depuis que nous nous étions quittés. Il se prêta de bonne grâce à ma demande, et me satisfit de la manière suivante.
HISTOIRE
DE GEORGES BLAINVILLE
 e ne fus que légèrement blessé à l’épaule
du coup de pistolet qu’on me tira
du corridor, sur le toit d’où j’allais
m’élancer par terre ; je tombai sans
connaissance au pied du mur du château.
Ce fut apparemment dans ce
moment-là que la frayeur, qui s’empara
de tes esprits, te fit croire à ma mort, et
t’obligea de fuir avant que je fusse assez
remis de mon étourdissement pour te désabuser.
Un peu de patience et moins de crainte
nous auraient épargné bien des chagrins ; mais
je les pardonne de bon cœur à l’amour qui les
a causés, puisqu’il devait un jour nous réunir.
e ne fus que légèrement blessé à l’épaule
du coup de pistolet qu’on me tira
du corridor, sur le toit d’où j’allais
m’élancer par terre ; je tombai sans
connaissance au pied du mur du château.
Ce fut apparemment dans ce
moment-là que la frayeur, qui s’empara
de tes esprits, te fit croire à ma mort, et
t’obligea de fuir avant que je fusse assez
remis de mon étourdissement pour te désabuser.
Un peu de patience et moins de crainte
nous auraient épargné bien des chagrins ; mais
je les pardonne de bon cœur à l’amour qui les
a causés, puisqu’il devait un jour nous réunir.
Quand j’eus repris mes sens, je regardai autour de moi, aussi loin qu’il m’était possible de le faire dans l’obscurité ; juge de ma douleur, quand je ne te revis point, ainsi que ta compagne d’infortune : je vous appelai longtemps en vain l’une et l’autre ; je vous cherchai quelque temps ; mais craignant à la fin la poursuite des scélérats qui avaient voulu me faire périr, je pris au hasard un chemin dans la forêt, et après avoir marché toute la nuit, je me trouvai le lendemain à Beaugency, où il passait un détachement de cavalerie qui allait à Tours rejoindre son corps. J’étais alors, comme tu peux t’en souvenir, sans argent, et je me voyais très embarrassé de ce que je deviendrais. Je ne me sentais pas assez de courage pour aller braver la colère de ton oncle, qui m’aurait inquiété à cause de toi ; je craignais aussi que mon père, qui n’était pas instruit de la manière violente dont nous avions été enlevés de ton pays, ne crût que je t’avais obligée de fuir avec moi, et ne voulût me punir trop sévèrement, si toutefois j’en étais quitte pour cela ; je me décidai à l’instant ; je m’adressai au commandant de la troupe qui m’engagea. À peine étions-nous arrivés à notre destination, que le régiment reçut ordre de partir pour Brest, où on nous fit remplacer un corps d’infanterie qui venait de s’embarquer.
La paie de simple cavalier me parut, dans les commencements, bien faible pour un jeune homme accoutumé à l’opulence ; elle suffisait à peine au nécessaire ; je cherchai donc à l’augmenter par le travail. Je parvins à me placer dans les bureaux de l’état-major du régiment, et comme je connaissais passablement les comptes étrangers et les calculs qu’ils exigent, je trouvai encore de l’occupation chez un négociant pour la tenue de ses livres de commerce. Avec cette ressource, je fus bientôt en état de pourvoir à tous mes besoins, de me procurer même tous les amusements dont on jouit dans les grandes villes, sans m’écarter des devoirs qui m’étaient imposés.
Il n’y avait encore que deux mois que j’étais à Brest. Le négociant chez lequel je travaillais, m’avait insensiblement pris en affection. Pour me donner une preuve convaincante de son amitié, il me remit un matin mon congé en bonne forme, qu’il avait sollicité et payé, sans m’avoir prévenu des démarches qu’il avait faites pour l’obtenir, et me fit accepter un logement chez lui.
Tant de délicatesse et d’attachement de la part d’un homme que je connaissais depuis si peu de temps, et qui d’ailleurs me payait largement des services que je lui rendais, m’avaient inspiré un sentiment plus vif que celui de la reconnaissance ; j’éprouvais, près de lui, les douces émotions que procure la présence d’un père tendrement aimé, et je me plaisais quelquefois à voiler le passé, pour tromper, en le voyant, mes regrets sur la perte de celui que je ne m’attendais plus à revoir.
Ce brave homme était veuf depuis dix ans ; les chagrins qu’il avait eus pendant une union de douze années, avec une femme d’un caractère difficile, l’avaient empêché de former d’autres liens, de peur de retrouver, dans une seconde épouse, l’ombre seulement de celle qu’il ne pouvait se rappeler sans indignation. De plusieurs enfants qu’il avait eus de ce mariage, il ne lui restait qu’une fille, nommée Cécile, qui avait alors dix-huit ans : cette jeune personne était d’une rare beauté et douée des plus excellentes qualités ; mais elle se faisait surtout remarquer par sa tendresse pour son père, dont elle était la consolation depuis plusieurs années.
Il avait souvent parlé des malheurs qu’entraîne après soi une union mal assortie et désirait ardemment éviter à sa fille, qu’il aimait au-delà de l’imagination, un destin semblable à celui dont il avait ressenti les rigueurs. Il s’était expliqué ouvertement à ce sujet, et avait dit que lorsqu’il établirait sa chère Cécile, il s’embarrasserait peu de trouver un gendre fortuné, parce qu’il pouvait l’enrichir ; mais qu’il rechercherait, avec le plus grand soin, un homme dont les mœurs douces et la probité pourraient contribuer à faire le bonheur de sa fille.
J’étais loin alors de soupçonner que ce respectable père eût jeté des vues sur moi, lorsque, quelques mois après, il profita d’un après-dîner que sa fille employait auprès d’une tante qui, depuis longtemps était malade, pour m’informer de ses projets. Il me fit entrer dans son cabinet, et me prenant les deux mains qu’il serra affectueusement :
— Mon ami, me dit-il, depuis longtemps je désire vous entretenir sur un objet qui intéresse ma tranquillité ; qui peut me faire oublier les épines de ma vie, et procurer à ma vieillesse d’agréables jouissances. Le malheur instruit les hommes et rend plus pénétrants ceux qui ont passé par de dures épreuves, parce que, étant toujours défiants, ils mettent plus d’attention à examiner ceux en qui ils veulent établir leur confiance. Je vous ai donc jugé sans partialité, et je vous crois, à tous égards, digne de mon estime…
Je ne savais comment lui exprimer le plaisir dont il me pénétrait, et j’allais me jeter à ses genoux pour le remercier de sa bienveillance, il me retient et continue :
— De quel œil voyez-vous ma Cécile ? Croyez-vous qu’elle puisse un jour faire le bonheur de celui que le ciel associera à son sort ?
— Ô ! monsieur, si la beauté, jointe aux vertus, suffisent pour donner la félicité, quel mortel sera jamais plus heureux que l’époux fortuné qui l’aura rendue sensible ?
— Eh bien, mon ami, cet époux est déjà choisi dans mon cœur, et si j’en crois les doux pressentiments que cet avertisseur m’inspire, le bonheur de ma fille justifiera mon choix.
En me parlant, ce respectable père tenait ses yeux attachés sur les miens, pour y voir les pensées qui se formaient dans mon cœur, comme dans un miroir où elles devaient se réfléchir. Je gardais le silence, étonné, ravi de ce que je venais d’entendre ; cependant, quoiqu’il fût évident que c’était moi qu’il désignât pour l’époux de sa fille, je ne pouvais me persuader qu’il eût réellement l’intention de me la donner, à moi, dont il ne connaissait ni le véritable nom, ni la famille. Je savais aussi me rendre justice, je ne croyais pas avoir mérité un si grand bienfait, et je craignais de me tromper en interprétant, en ma faveur, une déclaration qui n’avait peut-être pour but que de me consulter sur le choix d’un autre époux que moi ; car j’avais remarqué que plusieurs jeunes gens, fils de riches négociants, qui étaient reçus à la maison, désiraient cette alliance, et il était possible qu’ils se fussent expliqués.
D’un autre côté cependant, je me rappelais la conduite de Cécile à mon égard ; quelques riens, qui sont beaucoup quand on se flatte, venaient changer mon illusion en espérance, et je ne regardais plus cette union comme impossible. Son père, qui s’était contenu d’abord pour m’éprouver, jouissait de mon embarras et y lisait mes sentiments. Enfin, plein de joie et d’impatience de s’expliquer sans contrainte, il me tend les bras.
— Viens, me dit-il, en voyant que je me précipitais dans les siens ; viens, mon ami, nos cœurs s’entendent, puisque tu m’as deviné : viens, tu seras bon époux, et si tu trouves ton bonheur dans celui que j’espère, rien ne manquera à ma félicité.
Je n’eus pas la force de répondre à cette marque touchante de son amitié. Une douce émotion de plaisir se fit sentir dans tout mon corps : quelques larmes d’attendrissement, ce doux langage du cœur, plus expressives que l’éloquence, vinrent seules attester ma sensibilité.
Il avait sans doute sondé les dispositions de sa fille à mon égard avant de me parler de ses projets, et il lui avait aussi fait part de l’explication que nous avions eue ensemble, car, quelques jours après, je remarquai, avec grand plaisir, que Cécile qui, auparavant, était avec moi d’une réserve excessive, devenait insensiblement plus confiante et plus attentive. Je redoublai donc de soins, de prévenances, et bientôt l’aveu de sa tendresse, qu’elle pouvait faire éclater sans crainte, vint ajouter une douceur de plus à celles sans nombre que son père ne cessait de répandre sur les jours brillants qui se levaient pour nous.
Au milieu des plaisirs qui cherchaient à m’environner ; placé devant ceux qui devaient leur succéder, dans un lieu fortuné qui ne se relâcherait jamais que pour me laisser cueillir les fleurs de l’hymen, je n’étais pas heureux. De cruels souvenirs minaient insensiblement l’édifice d’un bonheur qui n’était qu’idéal, rongeaient la chaîne qui m’attachait à cette aimable famille, et détruisaient, par degrés, toutes mes espérances. Je retrouvais bien un père tendre et généreux dans celui de Cécile, mais je ne pouvais oublier que j’en avais un que la nature réclamait, et les droits de la nature étant plus sacrés que ceux de l’amour, je ne voyais pas de possibilité à former un engagement qui pourrait contrarier les vues de celui qui devait y consentir, dans le cas où, n’ayant pas perdu l’espoir de me retrouver un jour, il aurait des projets que la tendresse filiale ne permet pas de traverser. Je m’attendais bien aussi que le père de Cécile, qui m’avait quelquefois parlé du mien, avec le désir ardent de le connaître, parce qu’il devait, selon lui, et d’après l’éloge que j’avais souvent osé en faire, devenir son ami, me demanderait au moins un consentement que je n’étais pas sûr d’obtenir.
D’un autre côté, ma chère Amélie, j’avais à me reprocher d’avoir séduit ton cœur ; d’être la cause de tes chagrins. J’ignorais, à la vérité, si tu étais réellement malheureuse, ou si tu avais regagné l’amitié de ton oncle ; si tu étais retombée dans les mains criminelles des premiers auteurs de notre infortune, ou si tu avais pu leur échapper ; mais quelque destin que tu dusses subir, je me sentais incapable de t’oublier : tant il est vrai de dire que les premières semences de l’amour jettent en nous de si profondes racines, qu’on ne peut jamais venir à bout de les extirper entièrement.
Plus le temps s’approchait où je devais être uni à l’aimable Cécile, plus je sentais redoubler mes inquiétudes et mon amour pour toi. Je n’étais cependant pas indifférent aux charmes et aux vertus de cette aimable fille ; je la voyais avec plaisir, et tu dois me croire d’autant plus facilement, que je ne cherche pas à te déguiser la vérité ; je n’avais pas pour elle ce penchant irrésistible qui m’entraînait vers toi, et cette différence, trop sensible, me faisait rougir intérieurement de ne pas mériter les bienfaits dont j’étais accablé. Une tristesse profonde s’était emparé de mon cœur ; une sombre mélancolie avait étendu devant moi son voile lugubre et obscurci la clarté du jour que je voyais encore briller dans le lointain. On s’aperçut bientôt de l’état pénible où je me trouvais ; on m’en demanda les raisons. Cécile fut la première à m’en parler ; mais j’eus bientôt dissipé les nuages qui s’étaient élevés dans son esprit ; elle m’aimait sincèrement, il ne me fut pas difficile de la persuader.
Il n’était pas aussi aisé d’échapper à la pénétration de son père, il n’avait que trop remarqué le chagrin qui me consumait. Sa vive amitié s’en était alarmée ; il était franc et sincère, il ne put me cacher longtemps la peine qu’il en ressentait.
— Mon ami, me dit-il un jour où je paraissais plus triste qu’à l’ordinaire, je sais que vous m’aimez ; mais vous avez des chagrins que vous me cachez ; je crois avoir le droit de me plaindre du secret que vous m’en faites. Ouvrez-moi votre cœur, et s’il est au pouvoir d’un ami tendre de le soulager de son oppression, sur qui pouvez-vous compter, si ce n’est sur le père de Cécile ?
— Ah ! monsieur, lui dis-je en lui jetant les bras autour du cou, je ne sens que trop que je ne dois rien avoir de caché pour le meilleur des hommes. Je serais un ingrat si je ne vous faisais pas lire dans le fond de mon cœur, après les bontés dont vous m’avez comblé ; mais promettez-moi de me pardonner les fautes que je vais vous révéler, comme je désire qu’elles me soient remises par celui qui a le plus à s’en plaindre.
Il rassura ma timidité par quelques discours flatteurs qui m’encouragèrent : je l’instruisis de toutes les circonstances qui ont précédé et suivi notre fuite de la maison de ton oncle. La seule chose que je lui déguisai fut la demeure de mon père.
Ces détails l’intéressèrent infiniment, et ne lui laissèrent, à mon sujet, aucune impression défavorable ; il me remercia, au contraire, de cette marque indubitable de confiance.
— L’aveu que vous venez de me faire, me dit-il, mon cher ami, n’a rien diminué de l’estime que j’ai pour vous. On n’est pas criminel, on n’a pas un mauvais cœur, pour avoir fait quelques étourderies de jeunesse. Une faute légère qu’on a sentie, et que le repentir a suivi de près, a toujours préservé celui qui l’a commise d’en faire de plus graves. Je ne change rien aux projets qui vous concernent, j’exige seulement de votre amitié que vous cherchiez à vous réconcilier avec votre père.
Il fut arrêté que je lui écrirais pour obtenir de sa tendresse paternelle le pardon qui m’était nécessaire avant d’épouser Cécile. Je demandai seulement quelques jours, pour avoir le temps de rassembler mes idées, dans une affaire aussi délicate que celle que j’avais à traiter.
Cette conversation avait un peu rétabli la tranquillité dans mon âme ; je me sentis soulagé d’un poids énorme par cette confidence qui ne m’avait rendu que plus cher à celui qui l’avait reçue ; je redoutais cependant le moment où mon père apprendrait par moi-même le lieu de ma résidence. Connaissant son caractère violent, il me semblait déjà le voir se mettre en fureur, prendre la poste, venir m’arracher des bras de mes amis, et me punir, par je ne sais quel châtiment, des maux que je lui ai fait endurer par ma démarche inconsidérée. Je ne pouvais pourtant pas me dispenser d’obéir aux ordres que le père de Cécile m’en donnait : mon cœur aussi se joignait à lui pour m’y engager ; mais ce qui m’aurait déterminé, c’était l’espérance dont je me flattais, que mon père s’apaiserait en faveur de mes amis, auxquels il sentirait qu’il a de véritables obligations, et qui, de leur côté, ne manqueraient pas d’intercéder pour moi.
Dès qu’on crut apercevoir que je ne m’abandonnais plus si constamment à mes rêveries, on voulut achever ma guérison. On me procura toutes sortes de dissipations. J’hésitais toujours à écrire cette lettre que mes frayeurs me faisaient trouver si difficile à tracer, quand une rencontre bien singulière m’ôta l’envie et la possibilité de le faire.
On venait de donner une réjouissance publique à l’occasion d’un événement heureux qui avait rendu la paix à deux nations rivales ; elle avait duré plusieurs jours et se terminait par une illumination générale, à la suite de laquelle la ville donnait un bal de nuit. On saisit cette occasion, on me demanda si je voulais y accompagner Cécile et son père, qui se proposaient d’y aller ; je le promis, et vers minuit je me rendis avec eux au lieu de l’assemblée. Elle était brillante : Cécile en fut enchantée, et je vis avec satisfaction qu’une démarche, qu’elle avait faite pour me procurer un moment d’agrément, lui donnait aussi de véritables plaisirs.
Nous parcourions depuis une heure au moins les différentes salles où la variété des costumes et des décorations, qui font l’ornement d’un bal masqué, attire l’œil avide de voir ces curiosités toujours nouvelles, parce qu’elles sont rares ; Cécile, un peu fatiguée, voulut prendre quelques rafraîchissements ; je la conduisis à un buffet qui se trouvait dans l’un des angles de la salle où nous étions alors. Son père, qui avait rencontré un de ses amis, nous avait quittés pour un moment et devait nous y rejoindre.
Nous nous débarrassions, tout en y allant, des masques qui nous avaient beaucoup échauffés, lorsqu’en approchant de ce buffet, où je n’avais de loin remarqué que deux femmes qui venaient de reprendre leurs masques, l’une d’elles, en me voyant, recule avec un mouvement qui marquait l’épouvante, tombe assise sur une banquette qui venait finir à l’entrée du buffet, et laisse aller ses deux bras comme une personne qui vient d’éprouver un saisissement violent à l’apparition subite d’un spectre ou d’un homme dont elle croit avoir à se plaindre.
Aussitôt que je m’aperçois de son état, je m’empresse de lui offrir les secours qu’il est en mon pouvoir de lui donner : je veux délier le masque qui peut intercepter la respiration ; elle sent à peine ma main, qu’elle la repousse, se lève avec précipitation sans me parler, me fait avec la tête un signe de remercîment, prend le bras d’un négresse qui l’accompagnait, et rentre dans le salon, où je la crois perdue dans la foule.
Je ne pouvais deviner le sujet d’une frayeur que je paraissais avoir occasionnée ; et je voulais pourtant cacher le trouble dont je ne pouvais me défendre ; mais je faisais de vains efforts : Cécile aussi m’embarrassait par des questions épineuses, à travers lesquelles je voyais percer son inquiétude, et j’essayais de la rassurer, en voulant lui persuader que je n’étais pas l’objet qui avait causé l’état de faiblesse où elle avait vu cette dame : qu’il pouvait se faire que la chaleur seule eût déterminé cet évanouissement ; mais elle n’était pas convaincue par mes raisonnements : la jalousie ingénieuse à se tourmenter elle-même, grossit toujours les objets et fait quelquefois voir du mystère où le plus souvent il n’y a rien du tout.
Nous nous entretenions cependant avec assez de chaleur sur ce sujet, qui ne m’aurait plus occupé sans les soupçons de Cécile, lorsqu’en traversant un passage peu éclairé qui conduisait à une autre salle, la même personne qui avait fait la scène du buffet, et qui m’avait sans doute épié pour saisir l’occasion de me jeter quelques mots au hasard, m’arrête dans le passage au moment où Cécile me précédait pour percer la foule qui entrait et sortait, et me dit à l’oreille, d’une voix basse qui ne put être entendue de personne, et que le masque qui la déguisait m’empêcha de reconnaître :
— Georges ! vous souvient-il des environs d’Orléans et du château… ?
Cette question, à laquelle j’étais loin de m’attendre, jeta la consternation dans mon âme ; je rejoignis Cécile, qui, en se retournant pour s’assurer que je la suivais, avait vu s’éloigner de moi le masque qui lui donnait de si vives alarmes. Elle me parut singulièrement agitée, comme j’en pus juger par le tremblement de son bras qui était appuyé sur le mien, car nous avions repris nos masques. Elle ne me fit plus de questions, mais le froid de ses réponses, quand par hasard je lui adressais la parole, malgré le trouble où j’étais moi-même, ne me fit que trop connaître la situation de son cœur.
Le mien était alors dans une perplexité désespérante : il ne pouvait suffire aux violentes sensations qu’il éprouvait ; l’incertitude cruelle où j’étais plongé est un tourment qu’on ne peut que sentir. Qui m’avait fait l’étrange demande qui m’inquiétait si fort ? Qui pouvait être instruit d’un événement qui avait eu si peu de témoins ? Quelle était enfin la personne qui me rappelait le fatal secret ? telles étaient les questions que je me faisais, sans trouver assez de présence d’esprit pour en résoudre une seule.
Nous retrouvons enfin le père de Cécile, qui était assis avec son ami tout près d’une fenêtre qu’on avait ouverte pour renouveler l’air. On fit place à Cécile : et je me tins un instant debout devant elle. Je bouillais d’impatience de trouver un prétexte pour quitter décemment la compagnie et me mettre à la poursuite de mon inconnue : il ne s’en présentait aucun. Cependant, au bout d’un quart d’heure, un jeune homme de ma connaissance, que j’avais déjà rencontré dans le bal, passe en saluant la compagnie ; je le prends par le bras, le pousse en avant : il m’entraîne en riant, et nous voilà partis. Nous n’avions pas fait trente pas, que le masque qui m’occupait plus que tout le reste, et qui de son côté ne m’avait pas perdu de vue, reparaît, passe et repasse deux ou trois fois à côté de nous. Je l’examinais de la tête aux pieds, avec une attention particulière, pour tâcher de découvrir dans sa taille ou dans sa démarche ce qu’était cette femme qui paraissait instruite de particularités qui me touchaient de si près : je crus un moment deviner que c’était toi ; mais en mesurant des yeux la taille de cette femme, je la jugeai plus grande, mon espoir m’abandonna. Cependant, comme je ne t’avais pas vue depuis plus de vingt mois, il était possible que tu eusses pris de la force ; cette réflexion ranima mes espérances. Plein de cette idée dont les charmes enflammèrent mon imagination, je quittai l’ami qui m’accompagnait, et je courus sur les pas de celle qui m’entraînait malgré moi.
— Oh ! qui que vous soyez, cruelle inconnue, lui dis-je en l’abordant, ne désespérez pas un cœur longtemps noyé dans ses larmes, au moment où il vient de se rouvrir à l’espérance : parlez, de grâce ; êtes-vous l’adorable Amélie, cette amante infortunée, sans laquelle la vie m’est insupportable ?
— Vous l’aimez donc toujours ? répond le masque, et l’absence n’a pas diminué cette ardeur que je vous ai connue ?
— Non, non, je l’aime plus que jamais : c’est l’idole chérie que je veux adorer jusqu’au dernier soupir.
Plus je l’interrogeais, plus mon illusion puisait de forces dans ses réponses étudiées pour l’entretenir. Tout me disait alors que c’était toi ; les questions même qu’elle me faisait sur ma tendresse, ne me semblaient dictées que par l’amour inquiet qui voulait se convaincre qu’il n’avait rien perdu de ses droits.
Tout en nous entretenant de ce qui m’intéressait à tant de titres, l’inconnue m’avait insensiblement fait gagner l’escalier, et je le descendais avec elle, sans presque m’en apercevoir, quand me trouvant à la porte, l’air piquant de la nuit vint m’avertir que je laissais en haut l’intéressante Cécile dans une inquiétude mortelle sur mon absence, qui violait à son égard toutes les lois de la tendresse et de la reconnaissance. Je fis un pas pour remonter…
Ah ! mon aimable amie, pardonne-moi ce premier mouvement de l’honneur, qui exigeait davantage ; j’en fis deux pour prendre la main de la fausse Amélie, qui me la tendait, en m’invitant à l’accompagner jusque chez elle. Mon erreur, qui se prolongeait encore, me fit entendre ta voix touchante ; je lui obéis et je fus ingrat envers mes bienfaiteurs, pour courir après une ombre qui devait bientôt m’échapper.
L’inconnue était logée dans un hôtel situé sur le port, à une très grande distance du bal où je l’avais rencontrée. Nous n’avions point de voiture pour nous y conduire, de sorte que le chemin fut très long : le jour commençait à paraître quand nous arrivâmes. Le temps employé à faire le chemin, l’avait été aussi en partie à entendre mille questions sur ce que j’avais fait depuis l’aventure de la forêt d’Orléans, sur la belle dame à laquelle je donnais la main dans le bal ; et tout cela avec un intérêt si vif, qu’il n’y avait pas de doute que je fusse aimé de la personne qui m’interrogeait avec une sollicitude si tendre : c’était donc toi, mon aimable Amélie ; tu m’allais être rendue ; tous les avantages d’une autre union disparaissaient devant toi : j’allais retrouver dans mes premières amours le bonheur que j’avais vu fuir ; que je craignais de ne plus ressaisir.
Monté à l’appartement de l’inconnue, je la pressai de quitter ce masque qui dérobait sans doute à mes regards les traits de celle dont l’image était gravée dans mon âme ; elle fut encore longtemps à m’accorder cette faveur précieuse. Enfin, elle voulut bien se rendre à mes désirs ; je m’attendais à te voir : mes yeux prévenus pénétraient déjà l’insupportable carton qui nous séparait en quelque sorte l’un de l’autre lorsqu’il tomba ; et quoique le temps qu’elle employa à délier les cordons fût très court, l’attente du plaisir que je me promettais me fit éprouver une impatience telle que je n’en ai jamais ressenti de plus vive dans ma vie. Mais, ô ciel ! quel fut mon malheur, quand je me vis trompé dans mes flatteuses espérances ! Quel fut mon étonnement quand je reconnus… Adélaïde ! cette même Adélaïde qui était sortie avec toi du fatal château, lorsque ma blessure m’avait empêché de fuir avec vous. Un mouvement de dépit me fit reculer quelques pas en arrière ; mais bientôt, me rappelant que nous lui devions la liberté, je me précipitai dans ses bras en l’assurant du plaisir que j’avais à la revoir.
Ce retour de ma part répara un peu le froid momentané de l’accueil involontaire que je lui avais fait d’abord ; aussitôt que ma surprise m’a permis de parler, je lui demandai de tes nouvelles. Elle prit alors un ton douloureux pour m’annoncer que je ne devais plus m’attendre à te revoir. Je voulus être informé des détails du nouvel accident qui portait le dernier coup à mon amour constant et malheureux ; elle se recueillit un peu pour préparer un mensonge, et pendant que je pleurais ta perte, elle poursuivit ainsi :
« Lorsque Amélie et moi nous fûmes persuadées que vous aviez reçu un coup mortel, nous nous hâtâmes de nous éloigner, car nous pouvions craindre d’être reprises par vos assassins, Nous nous enfonçâmes dans le bois ; mais la peur avait tellement troublé nos esprits, qu’au lieu de nous éloigner directement du château, après avoir couru, traversé différents sentiers, dont l’obscurité nous empêchait de découvrir les issues, nous revînmes insensiblement nous jeter dans les mains des scélérats qui faisaient d’exactes recherches pour nous découvrir. Amélie, qui marchait devant moi à une distance assez grande, fut arrêtée et ses cris m’avertirent du danger que je courais moi-même, si je ne m’échappais promptement. Incapable de lui donner le moindre secours, je rebroussai chemin avec une si grande légèreté, que je n’entendis bientôt plus ni les coups que lui portaient ces monstres, ni les cris de la malheureuse victime qu’ils ont sans doute immolée à leur fureur et à leur vengeance. Pour moi, je ne m’arrêtai qu’à la pointe du jour : je me trouvai à peu de distance d’Orléans, où je fis rencontre d’un négociant qui avait particulièrement connu mon père et qui me rendit service, en considération de leur ancienne amitié. Il m’amena à Paris avec lui ; au bout de six semaines, il me fit épouser un de ses amis, avec lequel je passai à l’Île-de-France où mon mari, déjà vieux, voulait faire un dernier voyage pour vendre ses possessions et revenir en France ; mais les fatigues d’une traversée longue et pénible altérèrent si fort sa santé, qu’il tomba malade quelques jours après notre arrivée, et mourut sans me donner le temps de le connaître assez pour savoir apprécier la perte que je faisais.
« Il m’avait fait heureusement, par contrat de mariage, une donation en toute propriété de ses biens : nous avions emporté avec nous les titres qui m’étaient nécessaires pour faire valoir mes droits : je les exerçai sur-le-champ, et après avoir reçu en payement des traites sur les meilleures maisons de quelques ports de France, je m’embarquai pour repasser ici. J’y arrivais, quand on commença les apprêts de la fête qu’on vient de donner, et dans laquelle le hasard m’a procuré le plaisir de vous rencontrer. »
Je l’avais écoutée en silence, bien moins occupé de son bonheur que des maux que tu avais dû éprouver. Pour me distraire d’un sujet aussi triste que celui qui m’accablait, elle reprit ainsi :
« Vous êtes libre, Georges, par la mort d’Amélie, dont il ne faut plus douter ; les serments que vous lui aviez faits sont péris avec elle ; vous pouvez donc contracter de nouveaux engagements. Je suis jeune et assez riche pour nous deux ; acceptez ma main ; je vous aime assez pour vous faire oublier la perte que vous avez faite. »
Cette déclaration précipitée était loin de produire l’effet qu’Adélaïde s’en promettait. En supposant que je me décidasse à former un nouvel engagement comme elle m’y excitait, j’en avais de trop sacrés avec Cécile et son père, pour les rompre en faveur d’une femme que je n’avais vue qu’un instant ; pour laquelle aussi je n’avais point de sacrifice à faire. Je la remerciai de ses bonnes dispositions pour moi ; je lui fis entendre qu’il m’était impossible de profiter de ses offres.
Elle voulut connaître mes raisons : je les lui donnai sans hésiter ; je ne fis pas même difficulté de lui dire que j’avais instruit le père de Cécile de tout ce qui te concernait, et que j’étais dans l’intention de lui faire part des dernières nouvelles qu’elle me donnait. Elle parut approuver mes résolutions ; me demanda le nom et la demeure du négociant chez lequel je demeurais. Je satisfis à cette question, qui me paraissait sans conséquence, et je sortis en lui promettant de la revoir avant son départ.
Quand je fus dehors, le souvenir de ma conduite inconséquente envers Cécile et son père, vint se retracer dans toute sa force à mon imagination. Que pouvais-je leur dire pour excuser cette faute ? de quel œil voyaient-ils la légèreté impardonnable qu’ils devaient me reprocher ? Tel était le fond des questions que je me faisais en retournant au logis. Lorsque j’y arrivai, il était encore de bonne heure ; tout le monde était couché ; je regagnai ma chambre pour tâcher de trouver, dans un sommeil de quelques heures, l’assurance dont j’avais besoin pour me représenter devant le père de Cécile qui me ferait, à coup sûr, des reproches mérités.
J’étais déjà remis à mes occupations ordinaires quand il parut : en entrant dans le magasin où j’étais, il vint à moi d’un air sévère et me demanda quelle était cette femme qui m’avait entraîné avec elle et dont j’avais préféré la société à celle de sa fille ; je voulus lui cacher la vérité : je cherchai un mensonge qui ne put la remplacer, et il me quitta, persuadé que j’avais été en mauvaise compagnie, puisque je refusais de la lui faire connaître. Cécile, de son côté, ne me donna pas l’occasion de me justifier ; elle évita de se trouver seule avec moi pendant toute la journée. Je n’en fus pas très fâché, parce que cette circonstance me donnait le temps de me préparer sur ce que j’avais à lui dire pour ma défense. Je me persuadais que le premier feu une fois passé, je regagnerais sans peine l’amitié de deux personnes qui ne pouvaient pas encore me l’avoir retirée entièrement.
Plein de cette confiance, je me promettais même, pour ma tranquillité, d’avouer aussitôt que je pourrais mon aventure de la nuit, lorsque le soir je reçus, par la négresse d’Adélaïde, un message de celle-ci par lequel elle me priait à déjeuner pour le lendemain. Je ne répondis point par écrit ; je fis seulement à cette femme un signe qu’elle crut entendre et elle s’en alla.
On ne me parla de rien ; je fus muet aussi sur ce nouveau sujet d’alarmes pour Cécile ; je n’allai point au déjeûner. Adélaïde, qui avait ses vues sur moi, piquée d’une négligence qui lui faisait voir assez clairement le peu de cas que je faisais de sa fortune et de sa main, résolut de s’en venger ; et profitant de l’indiscrétion que j’avais commise, en lui disant que mon protecteur connaissait mon aventure avec toi, elle vint le trouver, prit ton nom et parvint par un air naïf, soutenu de ses larmes, à lui persuader qu’elle était la malheureuse Amélie que j’avais eu la lâcheté d’abandonner dans un bois, après l’avoir séduite.
Cette horreur, qui n’était que trop vraisemblable, puisque je ne pouvais pas prouver la fausseté de cette supposition, me rendit odieux à mes bienfaiteurs ; ils me retirèrent leurs promesses ; et je me vis réduit, par cette noire perfidie, à la honte de paraître criminel aux yeux d’une famille vertueuse, qu’il m’était impossible de désabuser. Je ne voulus pas attendre qu’on me signifiât mon congé, je partis le lendemain, avant le jour, sans dire adieu à personne ; et je ne laissai à l’indigne Adélaïde que le regret d’avoir fait, sans profit, une action abominable.
Mon projet étant de m’éloigner assez pour qu’on n’entendit jamais parler de moi, je dirigeai ma marche vers l’Italie. J’arrivai à Chambéry, en économisant beaucoup l’argent que j’avais épargné chez le père de Cécile ; mais je me voyais très embarrassé pour continuer ma route, quand un jeune seigneur napolitain qui allait passer quelque temps à Rome après avoir parcouru l’Allemagne et la France, s’arrêta dans l’hôtellerie où j’étais logé. J’eus occasion de lui parler plusieurs fois ; il me prit en amitié et m’offrit de me conduire dans cette ville, où j’arrivai avec lui, environ deux ans après notre séparation. Comme il avait des lettres de recommandation, il me présenta chez différentes personnes qui me reçurent parfaitement bien, et dans lesquelles j’ai trouvé, par la suite, de sincères amis. J’ai d’abord travaillé comme commis chez plusieurs négociants de cette ville ; et depuis dix-huit mois, je suis associé dans une maison de banque des plus accréditées.
Tel fut le récit de Georges.
Je ne pus m’empêcher de le plaindre des chagrins que la perfide Adélaïde lui avait causés ; mais en y réfléchissant avec plus d’attention, nous trouvâmes des raisons pour nous féliciter de sa conduite, car nous lui devions encore le bonheur d’être réunis, puisque sans l’horrible moyen qu’elle avait employé pour rompre le mariage de mon amant avec l’intéressante Cécile, nous étions à jamais perdus l’un pour l’autre.
Georges, à son tour, voulut que je l’instruisisse de ce que j’étais devenue, depuis le temps que nous ne nous étions vus, et surtout du hasard singulier qui m’avait conduite précisément au lieu de sa résidence. Je le priai de me permettre de ne lui faire qu’un récit succinct de mes aventures, et d’en remettre les détails à un autre temps. Je lui en racontai cependant assez pour lui laisser voir que ma conduite n’avait pas été des plus régulières ; et je l’engageai à me pardonner des fautes dans lesquelles je ne serais sûrement pas tombée, si j’eusse pu prévoir que j’aurais un jour à en rougir en sa présence. Je ne sais s’il avait aussi quelques reproches à se faire, et si, par cette raison, il était plus porté à l’indulgence, mais il me dit, en m’embrassant :
— Allons, tirons le rideau sur le passé, puisqu’il n’a pas été en notre pouvoir de l’éviter ; jouissons du présent, et tâchons de nous préparer, pour l’avenir, le repos et la tranquillité nécessaires après une vie orageuse.
Parfaitement rassurée sur son amour, que je craignais d’avoir affaibli par la peinture de mes actions, quoique je les eusse un peu dégagées du mauvais vernis qui les couvrait, je me sentais bien disposée à accorder à sa tendresse le prix tant désiré d’une constance à toute épreuve ; il me pressait aussi très vivement de me rendre à ses ardents désirs ; mais j’avais fait un serment que je ne voulais pas violer ; je résistai aux tentations de toute espèce qu’il me fallut éprouver ; je poussai même la rigueur jusqu’à lui dire qu’il ne devait rien attendre de mon amour que l’hymen (s’il me croyait encore digne d’aspirer à ce bonheur) n’eût resserré plus étroitement les liens qui nous unissaient dès l’enfance. Cette privation était un sacrifice que j’offrais à la vertu pour expier mes dérèglements.
Georges, fâché de ma résistance, mais forcé d’admirer l’effort pénible que je faisais pour suivre ma résolution, me quitta pour retourner chez lui, où il n’avait pas paru de toute la journée. Il m’avait promis de revenir souper avec moi, il me tint parole. Ce fut dans ce moment que nous fîmes nos petits arrangements, et dès le lendemain on commença de les exécuter. Il me loua un appartement dans son quartier, et tous les jours j’avais le plaisir de l’y recevoir. Enfin, au bout de quelque temps, il parla de moi à son associé, qui voulut absolument me voir : je me liai très étroitement avec sa femme, et trois mois après mon arrivée à Rome, je devins l’épouse de mon amant.
Les fonds que j’apportai dans le commerce donnèrent à notre maison une nouvelle activité, ce qui nous mit dans le cas de faire en très peu de temps une fortune brillante. Aussi, après avoir passé dix années dans cette société à travailler utilement, nous réalisâmes notre portion pour revenir en France jouir paisiblement du fruit de nos travaux.
Arrivés à Orléans on nous apprit que le père de Georges y était mort depuis huit ans ; que Joseph avait péri sur mer en allant aux Grandes Indes ; de sorte que la succession du père de mon mari était tombée entre les mains d’avides collatéraux, qui en avaient déjà dissipé une grande partie. Il en recueillit cependant quelques débris chez les plus honnêtes d’entre eux, et en tira environ cent mille francs.
À l’égard de mon oncle, il était mort presque aussitôt mon départ, après avoir fait un testament par lequel il avait légué son bien à un ami intime qu’il avait dans le village.
N’ayant donc, ni l’un ni l’autre, personne qui nous attachât dans ce pays, il nous était indifférent d’aller demeurer ailleurs : ce qui fut cause que Georges fit l’acquisition de la terre où nous vivons, en Touraine. Mon mari y fait valoir ses domaines, et moi je m’occupe de l’intérieur, et je veille surtout à l’éducation d’une fille unique que j’idolâtre, et qui fait tout mon bonheur.
Si, après avoir lu cette histoire, une jeune fille pouvait encore avoir le malheur de désirer de m’imiter, par l’espoir de jouir un jour du bien-être que le hasard seul m’a procuré, qu’elle tremble à cette seule pensée, et qu’elle se persuade bien, avant d’entrer dans cette carrière affreuse que, pour une seule femme qui a pu la fournir tout entière, il en est mille qui ont subi le sort épouvantable qui les y attendait.
