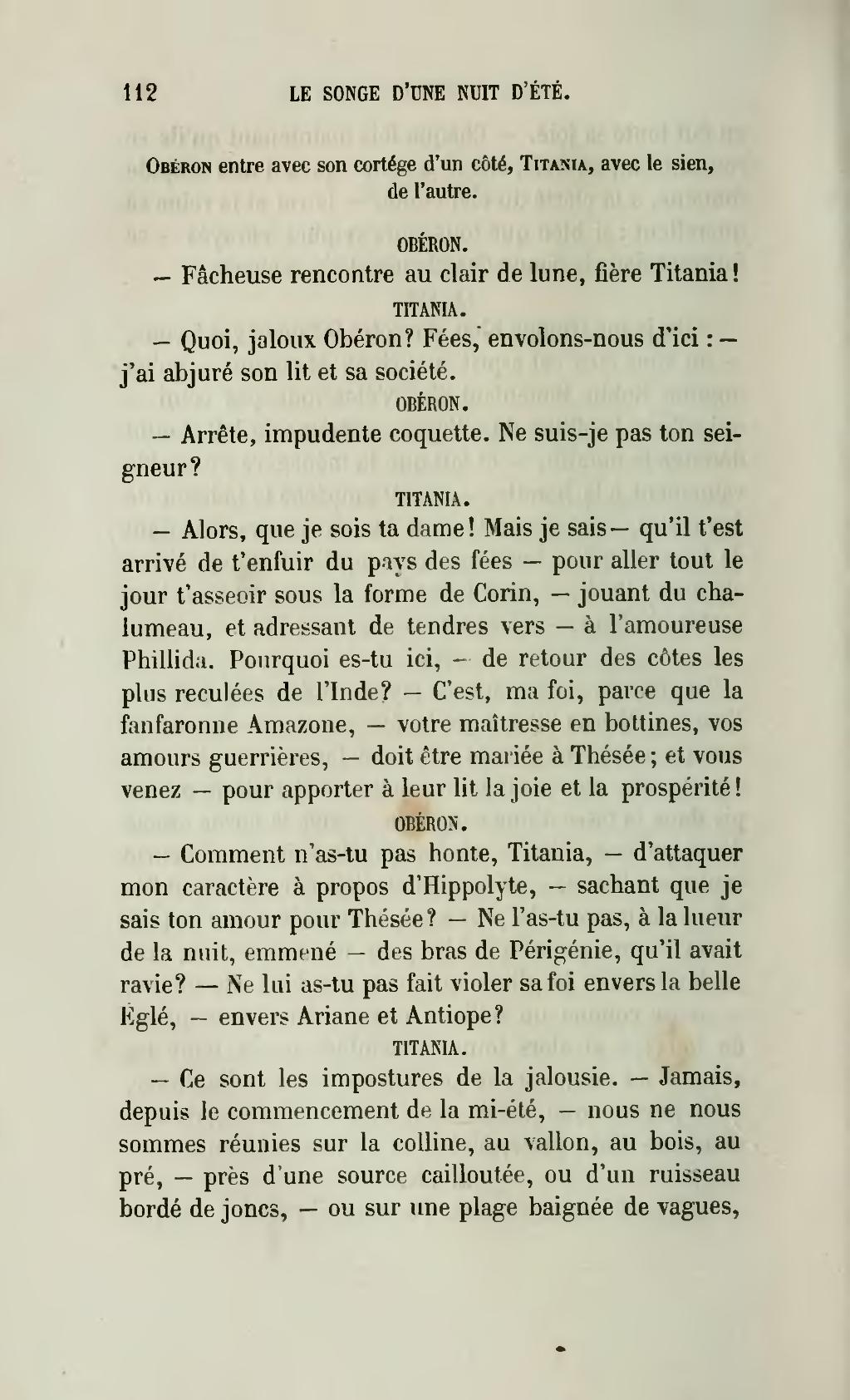— Fâcheuse rencontre au clair de lune, fière Titania !
— Quoi, jaloux Obéron ? Fées, envolons-nous d’ici : — j’ai abjuré son lit et sa société.
— Arrête, impudente coquette. Ne suis-je pas ton seigneur ?
— Alors, que je sois ta dame ! Mais je sais — qu’il t’est arrivé de t’enfuir du pays des fées — pour aller tout le jour t’asseoir sous la forme de Corin, — jouant du chalumeau, et adressant de tendres vers — à l’amoureuse Phillida. Pourquoi es-tu ici, — de retour des côtes les plus reculées de l’Inde ? — C’est, ma foi, parce que la fanfaronne Amazone, — votre maîtresse en bottines, vos amours guerrières, — doit être mariée à Thésée ; et vous venez — pour apporter à leur lit la joie et la prospérité !
Comment n’as-tu pas honte, Titania, — d’attaquer mon caractère à propos d’Hippolyte, — sachant que je sais ton amour pour Thésée ? — Ne l’as-tu pas, à la lueur de la nuit, emmené — des bras de Périgénie, qu’il avait ravie ? — Ne lui as-tu pas fait violer sa foi envers la belle Églé, — envers Ariane et Antiope ?
Ce sont les impostures de la jalousie. — Jamais, depuis le commencement de la mi-été, — nous ne nous sommes réunies sur la colline, au vallon, au bois, au pré, — près d’une source cailloutée, ou d’un ruisseau bordé de joncs, — ou sur une plage baignée de vagues,