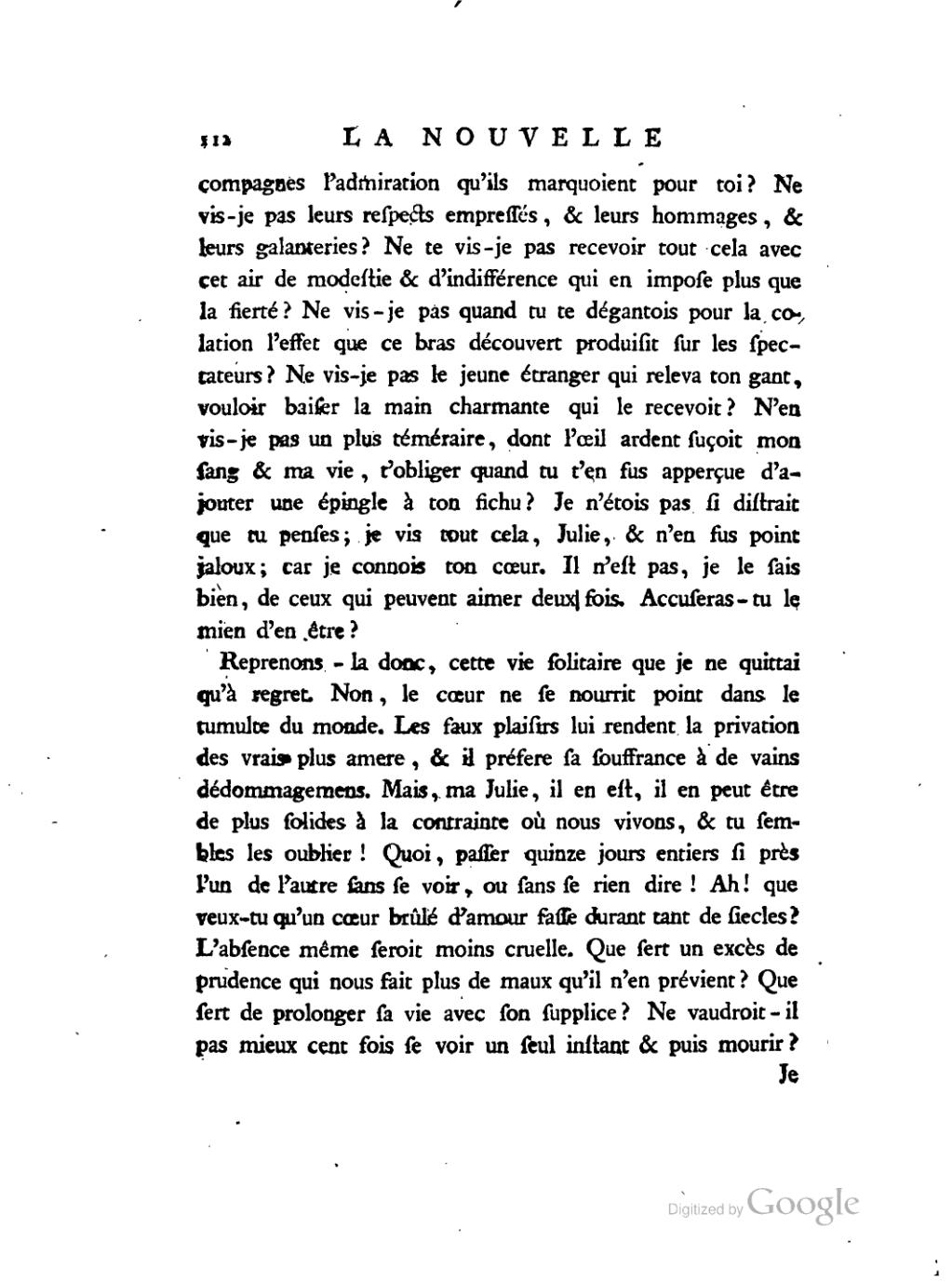compagnes l’admiration qu’ils marquoient pour toi ? Ne vis-je pas leurs respects empressés, & leurs hommages, & leurs galanteries ? Ne te vis-je pas recevoir tout cela avec cet air de modestie & d’indifférence qui en impose plus que la fierté ? Ne vis-je pas quand tu te dégantois pour la collation l’effet que ce bras découvert produisit sur les spectateurs ? Ne vis-je pas le jeune étranger qui releva ton gant vouloir baiser la main charmante qui le recevoit ? N’en vis-je pas un plus téméraire, dont l’œil ardent suçoit mon sang & ma vie, t’obliger quand tu t’en fus apperçue d’ajouter une épingle à ton fichu ? Je n’étois pas si distrait que tu penses ; je vis tout cela, Julie, & n’en fus point jaloux ; car je connois ton cœur. Il n’est pas, je le sais bien, de ceux qui peuvent aimer deux fois. Accuseras-tu le mien d’en être ?
Reprenons-la donc, cette vie solitaire que je ne qui toi qu’à regret. Non, le cœur ne se nourrit point dans le tumulte du monde. Les faux plaisirs lui rendent la privation des vrais plus amere, & il préfere sa souffrance à de vains dédommagements. Mais, ma Julie, il en est, il en peut être de plus solides à la contrainte où nous vivons, & tu sembles les oublier ! Quoi ! passer quinze jours entiers si près l’un de l’autre sans se voir, ou sans se rien dire ! Ah ! que veux-tu qu’un cœur brûlé d’amour fasse durant tant de siecles ? L’absence même seroit moins cruelle. Que sert un exces de prudence qui nous fait plus de maux qu’il n’en prévient ? Que sert de prolonger sa vie avec son supplice ? Ne vaudroit-il pas mieux cent fois se voir un seul instant & puis mourir ?