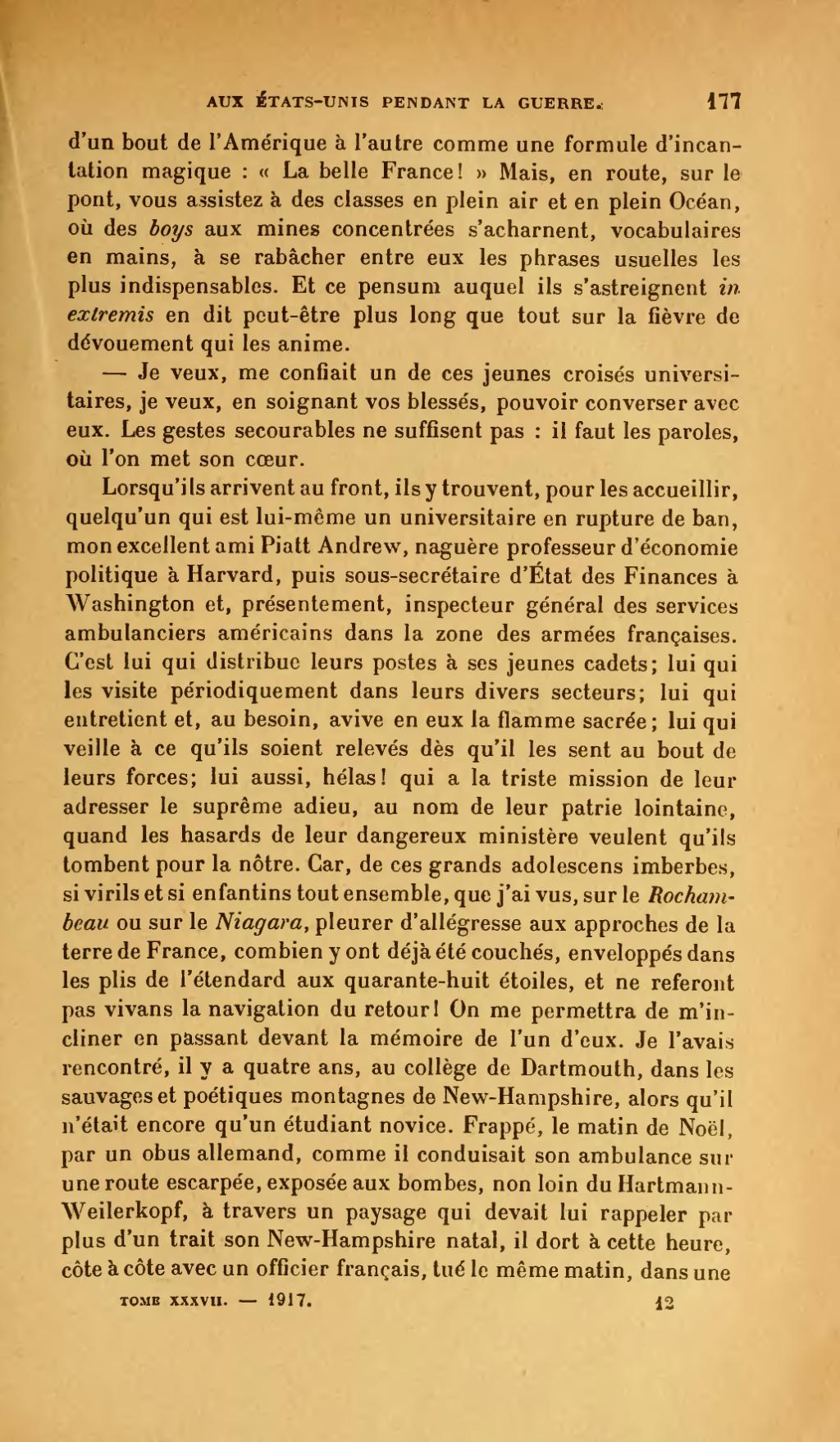d’un bout de l’Amérique à l’autre comme une formule d’incantation magique : « La belle France ! » Mais, en route, sur le pont, vous assistez à des classes en plein air et en plein Océan, où des boys aux mines concentrées s’acharnent, vocabulaires en mains, à se rabâcher entre eux les phrases usuelles les plus indispensables. Et ce pensum auquel ils s’astreignent in extremis en dit peut-être plus long que tout sur la fièvre de dévouement qui les anime.
— Je veux, me confiait un de ces jeunes croisés universitaires, je veux, en soignant vos blessés, pouvoir converser avec eux. Les gestes secourables ne suffisent pas : il faut les paroles, où l’on met son cœur.
Lorsqu’ils arrivent au front, ils y trouvent, pour les accueillir, quelqu’un qui est lui-même un universitaire en rupture de ban, mon excellent ami Piatt Andrew, naguère professeur d’économie politique à Harvard, puis sous-secrétaire d’Etat des Finances à Washington et, présentement, inspecteur général des services ambulanciers américains dans la zone des armées françaises. C’est lui qui distribue leurs postes à ses jeunes cadets ; lui qui les visite périodiquement dans leurs divers secteurs ; lui qui entretient et, au besoin, avive en eux la flamme sacrée ; lui qui veille à ce qu’ils soient relevés dès qu’il les sent au bout de leurs forces ; lui aussi, hélas ! qui a la triste mission de leur adresser le suprême adieu, au nom de leur patrie lointaine, quand les hasards de leur dangereux ministère veulent qu’ils tombent pour la nôtre. Car, de ces grands adolescens imberbes, si virils et si enfantins tout ensemble, que j’ai vus, sur le Rochambeau ou sur le Niagara, pleurer d’allégresse aux approches de la terre de France, combien y ont déjà été couchés, enveloppés dans les plis de l’étendard aux quarante-huit étoiles, et ne referont pas vivans la navigation du retour ! On me permettra de m’incliner en passant devant la mémoire de l’un d’eux. Je l’avais rencontré, il y a quatre ans, au collège de Dartmouth, dans les sauvages et poétiques montagnes de New-Hampshire, alors qu’il n’était encore qu’un étudiant novice. Frappé, le matin de Noël, par un obus allemand, comme il conduisait son ambulance sur une route escarpée, exposée aux bombes, non loin du Hartmann-Weilerkopf, à travers un paysage qui devait lui rappeler par plus d’un trait son New-Hampshire natal, il dort à cette heure, côte à côte avec un officier français, tué le même matin, dans une