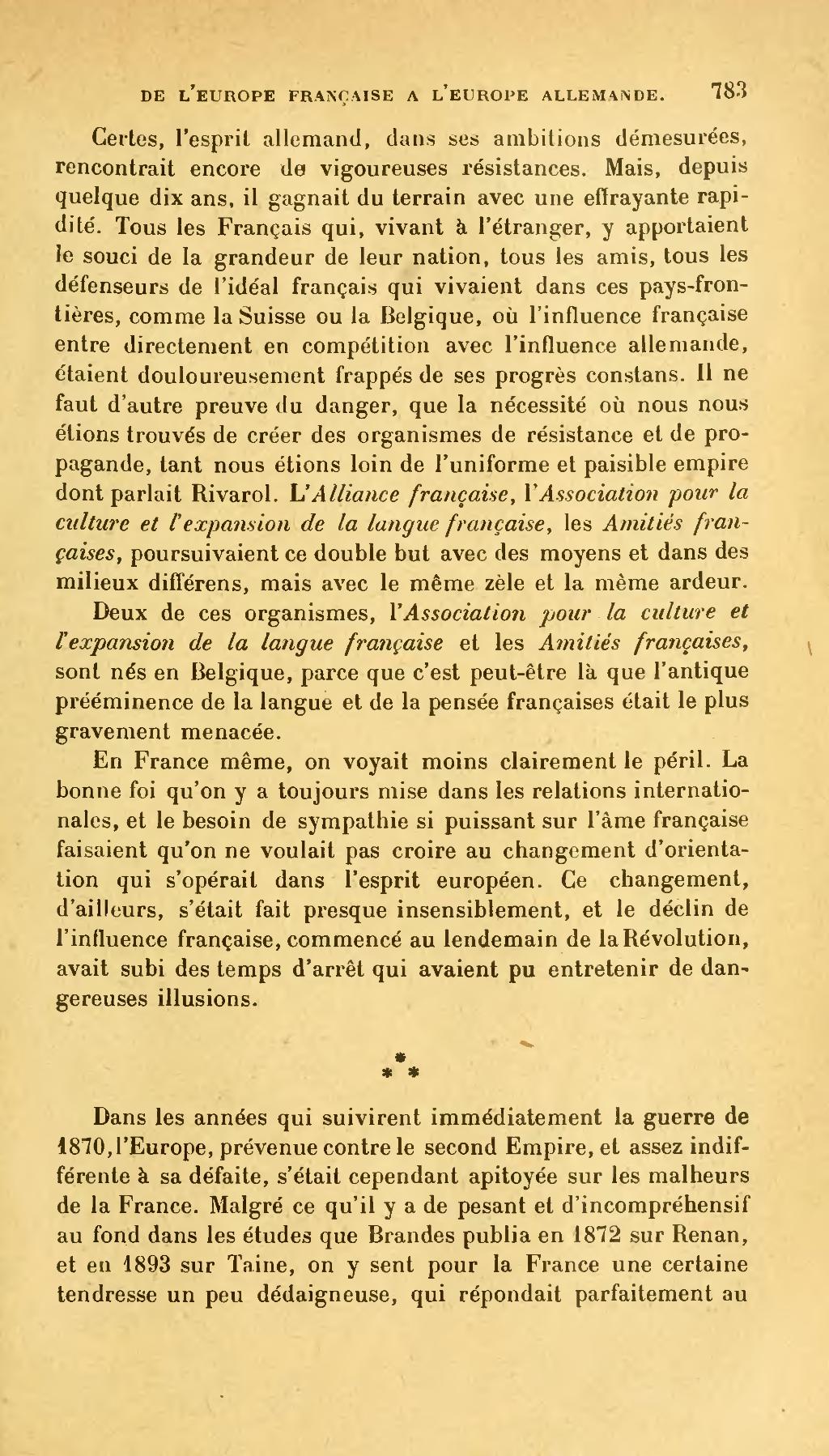Certes, l’esprit allemand, dans ses ambitions démesurées, rencontrait encore de vigoureuses résistances. Mais, depuis quelque dix ans, il gagnait du terrain avec une effrayante rapidité. Tous les Français qui, vivant à l’étranger, y apportaient le souci de la grandeur de leur nation, tous les amis, tous les défenseurs de l’idéal français qui vivaient dans ces pays-frontières, comme la Suisse ou la Belgique, où l’influence française entre directement en compétition avec l’influence allemande, étaient douloureusement frappés de ses progrès constans. Il ne faut d’autre preuve du danger, que la nécessité où nous nous étions trouvés de créer des organismes de résistance et de propagande, tant nous étions loin de l’uniforme et paisible empire dont parlait Rivarol. L’Alliance française, l’Association pour la culture et l’expansion de la langue française, les Amitiés françaises, poursuivaient ce double but avec des moyens et dans des milieux différens, mais avec le même zèle et la même ardeur.
Deux de ces organismes, l’Association pour la culture et l’expansion de la langue française et les Amitiés françaises, sont nés en Belgique, parce que c’est peut-être là que l’antique prééminence de la langue et de la pensée françaises était le plus gravement menacée.
En France même, on voyait moins clairement le péril. La bonne foi qu’on y a toujours mise dans les relations internationales, et le besoin de sympathie si puissant sur l’âme française faisaient qu’on ne voulait pas croire au changement d’orientation qui s’opérait dans l’esprit européen. Ce changement, d’ailleurs, s’était fait presque insensiblement, et le déclin de l’influence française, commencé au lendemain de la Révolution, avait subi des temps d’arrêt qui avaient pu entretenir de dangereuses illusions.
Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre de 1870, l’Europe, prévenue contre le second Empire, et assez indifférente à sa défaite, s’était cependant apitoyée sur les malheurs de la France. Malgré ce qu’il y a de pesant et d’incompréhensif au fond dans les études que Brandes publia en 1872 sur Renan, et en 1893 sur Taine, on y sent pour la France une certaine tendresse un peu dédaigneuse, qui répondait parfaitement au