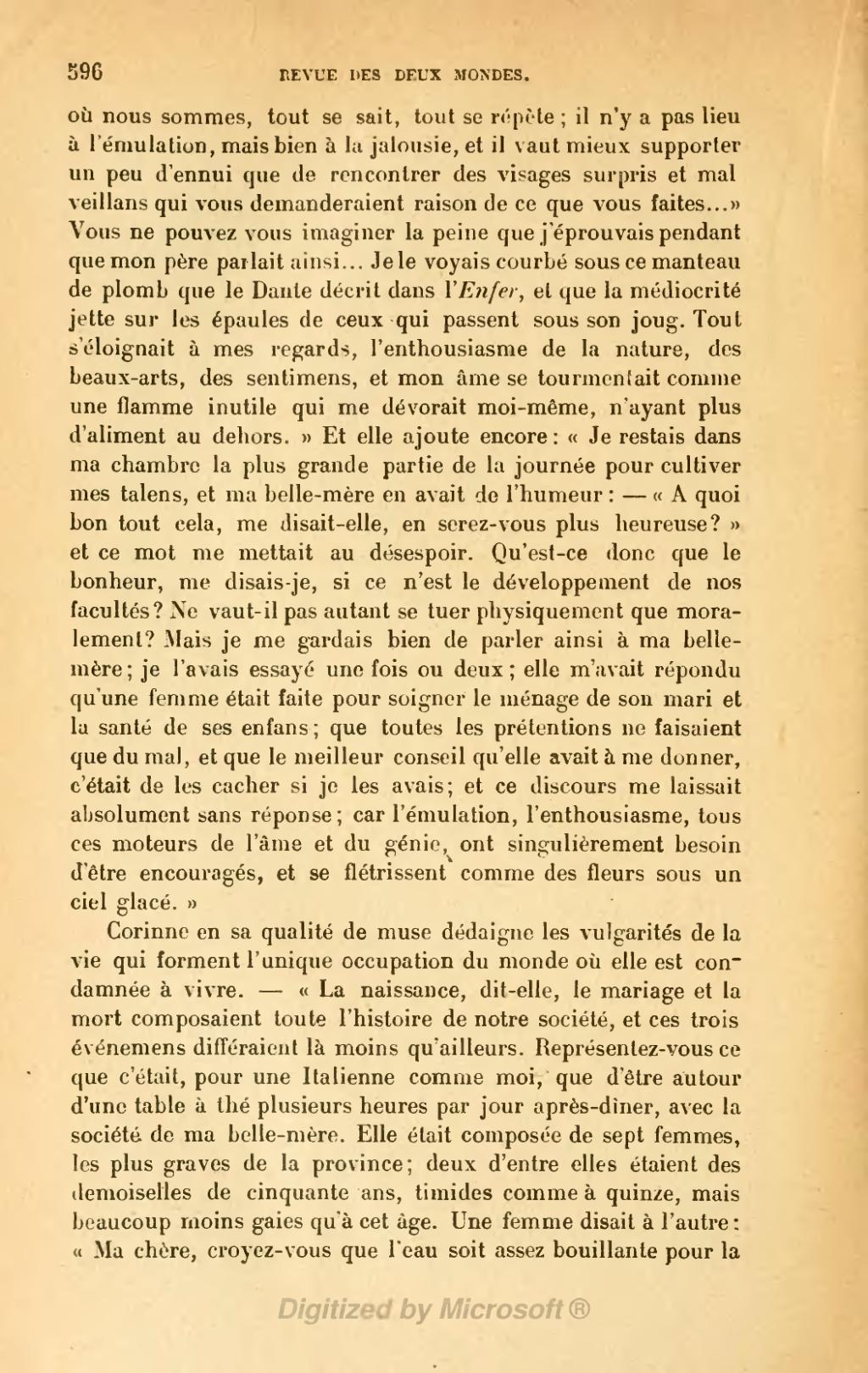où nous sommes, tout se sait, tout se répète ; il n’y a pas lieu à l’émulation, mais bien à la jalousie, et il vaut mieux supporter un peu d’ennui que de rencontrer des visages surpris et malveillans qui vous demanderaient raison de ce que vous faites… » Vous ne pouvez vous imaginer la peine que j’éprouvais pendant que mon père parlait ainsi… Je le voyais courbé sous ce manteau de plomb que le Dante décrit dans l’Enfer, et que la médiocrité jette sur les épaules de ceux qui passent sous son joug. Tout s’éloignait à mes regards, l’enthousiasme de la nature, des beaux-arts, des sentimens, et mon âme se tourmentait comme une flamme inutile qui me dévorait moi-même, n’ayant plus d’aliment au dehors. » Et elle ajoute encore : « Je restais dans ma chambre la plus grande partie de la journée pour cultiver mes, talens, et ma belle-mère en avait de l’humeur : — « À quoi bon tout cela, me disait-elle, en serez-vous plus heureuse ? » et ce mot me mettait au désespoir. Qu’est-ce donc que le bonheur, me disais-je, si ce n’est le développement de nos facultés ? Ne vaut-il pas autant se tuer physiquement que moralement ? Mais je me gardais bien de parler ainsi à ma belle-mère ; je l’avais essayé une fois ou deux ; elle m’avait répondu qu’une femme était faite pour soigner le ménage de son mari et la santé de ses enfans ; que toutes les prétentions ne faisaient que du mal, et que le meilleur conseil qu’elle avait à me donner, c’était de les cacher si je les avais ; et ce discours me laissait absolument sans réponse ; car l’émulation, l’enthousiasme, tous ces moteurs de l’âme et du génie, ont singulièrement besoin d’être encouragés, et se flétrissent comme des fleurs sous un ciel glacé. »
Corinne en sa qualité de muse dédaigne les vulgarités de la vie qui forment l’unique occupation du monde où elle est condamnée à vivre. — « La naissance, dit-elle, le mariage et la mort composaient toute l’histoire de notre société, et ces trois événemens différaient là moins qu’ailleurs. Représentez-vous ce que c’était, pour une Italienne comme moi, que d’être autour d’une table à thé plusieurs heures par jour après-dîner, avec la société de ma belle-mère. Elle était composée de sept femmes, les plus graves de la province ; deux d’entre elles étaient des demoiselles de cinquante ans, timides comme à quinze, mais beaucoup moins gaies qu’à cet âge. Une femme disait à l’autre : « Ma chère, croyez-vous que l’eau soit assez bouillante pour la