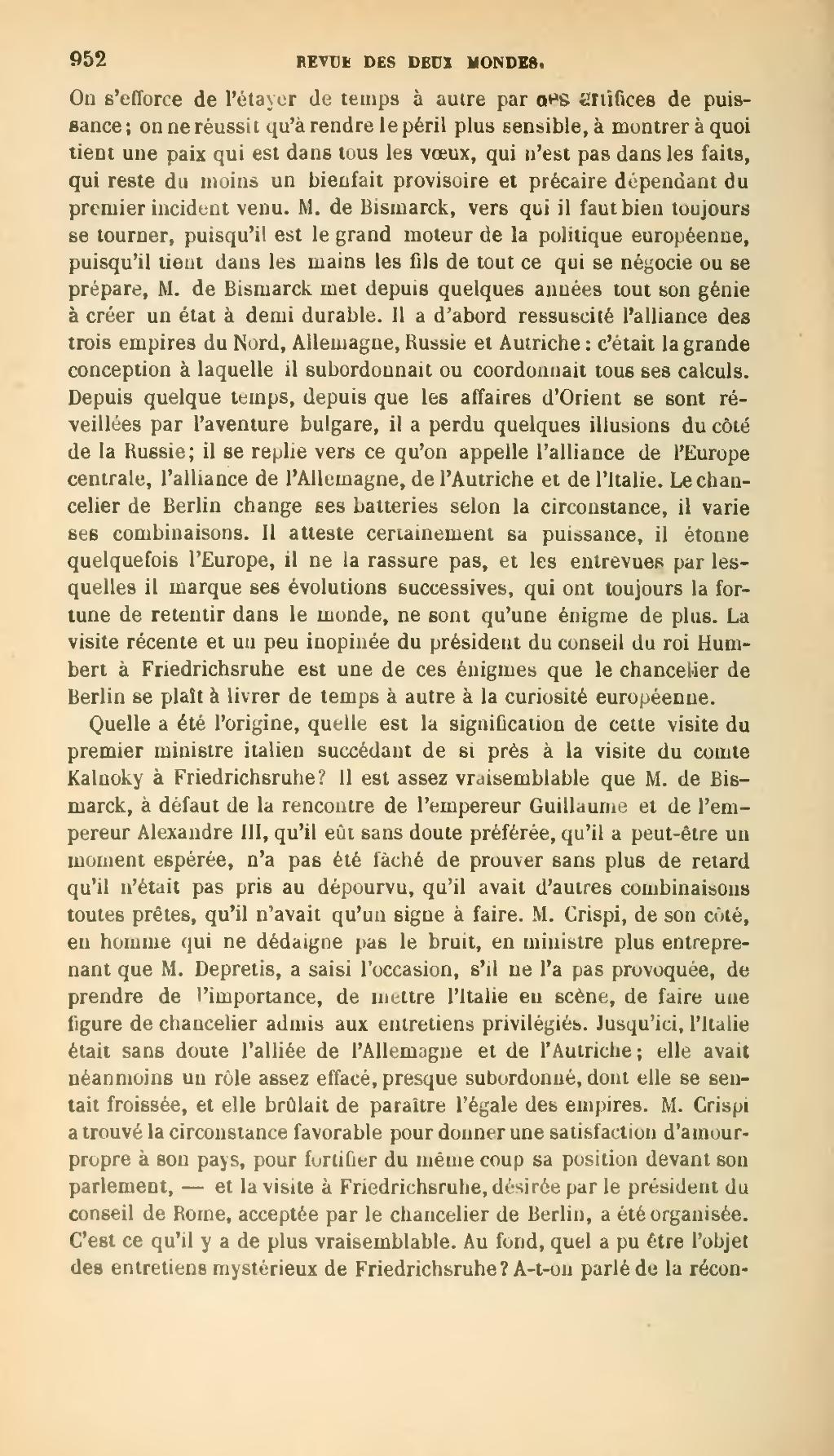On s’efforce de relayer de temps à autre par ans artifices de puissance; on ne réussit qu’à rendre le péril plus sensible, à montrer à quoi tient une paix qui est dans tous les vœux, qui n’est pas dans les faits, qui reste du moins un bienfait provisoire et précaire dépendant du premier incident venu. M. de Bismarck, vers qui il faut bien toujours se tourner, puisqu’il est le grand moteur de la politique européenne, puisqu’il tient dans les mains les fils de tout ce qui se négocie ou se prépare, M. de Bismarck met depuis quelques années tout son génie à créer un état à demi durable. Il a d’abord ressuscité l’alliance des trois empires du Nord, Allemagne, Russie et Autriche : c’était la grande conception à laquelle il subordonnait ou coordonnait tous ses calculs. Depuis quelque temps, depuis que les affaires d’Orient se sont réveillées par l’aventure bulgare, il a perdu quelques illusions du côté de la Russie; il se replie vers ce qu’on appelle l’alliance de l’Europe centrale, l’alliance de l’Allemagne, de l’Autriche et de l’Italie. Le chancelier de Berlin change ses batteries selon la circonstance, il varie ses combinaisons. Il atteste certainement sa puissance, il étonne quelquefois l’Europe, il ne la rassure pas, et les entrevues par lesquelles il marque ses évolutions successives, qui ont toujours la fortune de retentir dans le monde, ne sont qu’une énigme de plus. La visite récente et un peu inopinée du président du conseil du roi Humbert à Friedrichsruhe est une de ces énigmes que le chancelier de Berlin se plaît à livrer de temps à autre à la curiosité européenne.
Quelle a été l’origine, quelle est la signification de cette visite du premier ministre italien succédant de si près à la visite du comte Kalnoky à Friedrichsruhe? Il est assez vraisemblable que M. de Bismarck, à défaut de la rencontre de l’empereur Guillaume et de l’empereur Alexandre III, qu’il eût sans doute préférée, qu’il a peut-être un moment espérée, n’a pas été fâché de prouver sans plus de retard qu’il n’était pas pris au dépourvu, qu’il avait d’autres combinaisons toutes prêtes, qu’il n’avait qu’un signe à faire. M. Crispi, de son côté, en homme qui ne dédaigne pas le bruit, en ministre plus entreprenant que M. Depretis, a saisi l’occasion, s’il ne l’a pas provoquée, de prendre de l’importance, de mettre l’Italie en scène, de faire une figure de chancelier admis aux entretiens privilégiés. Jusqu’ici, l’Italie était sans doute l’alliée de l’Allemagne et de l’Autriche; elle avait néanmoins un rôle assez effacé, presque subordonné, dont elle se sentait froissée, et elle brûlait de paraître l’égale des empires. M. Crispi a trouvé la circonstance favorable pour donner une satisfaction d’amour-propre à son pays, pour fructifier du même coup sa position devant son parlement, — et la visite à Friedrichsruhe, désirée par le président du conseil de Rome, acceptée par le chancelier de Berlin, a été organisée. C’est ce qu’il y a de plus vraisemblable. Au fond, quel a pu être l’objet des entretiens mystérieux de Friedrichsruhe? A-t-on parlé de la réconciliation