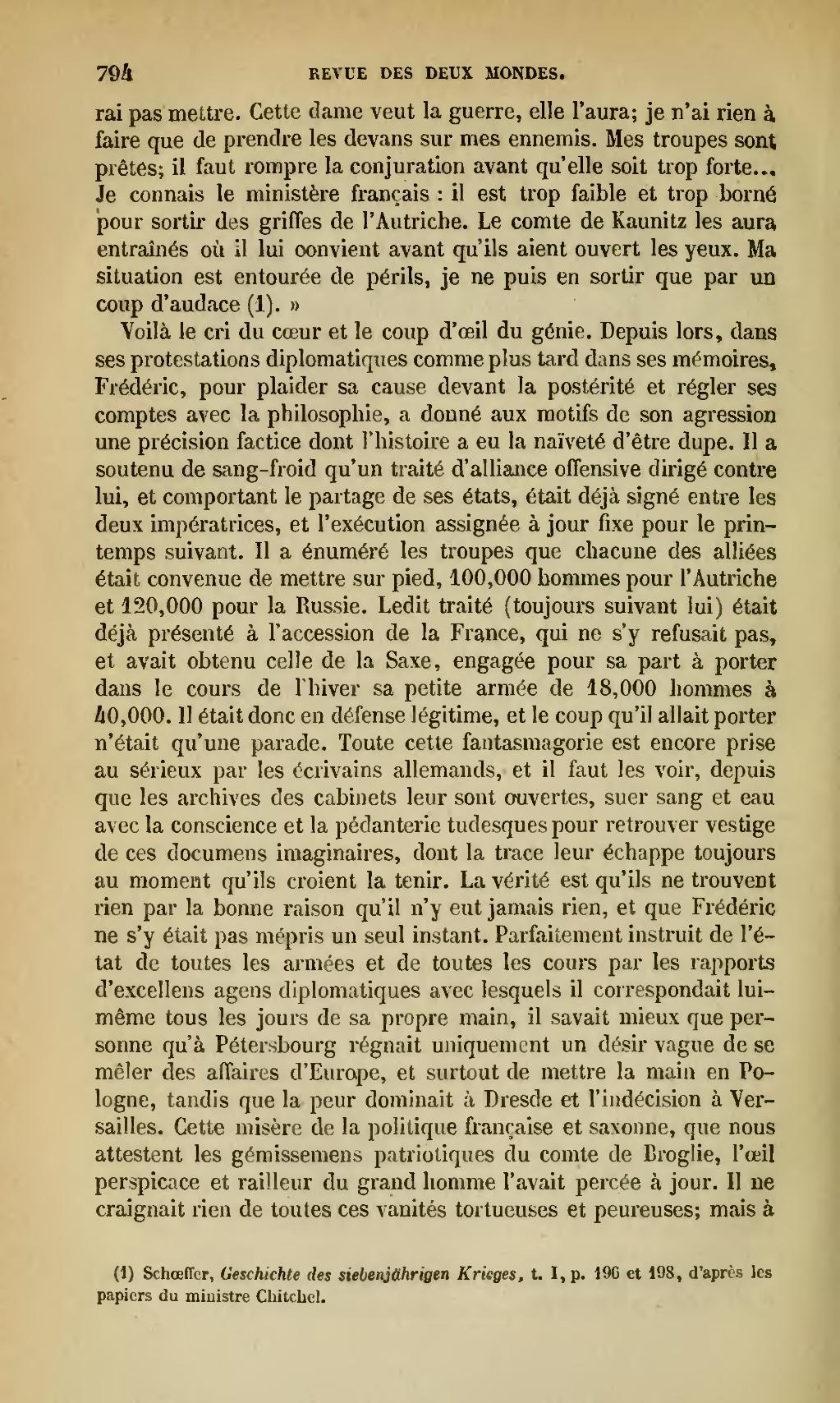laisserai pas mettre. Cette dame veut la guerre, elle l’aura ; je n’ai rien à faire que de prendre les devans sur mes ennemis. Mes troupes sont prêtes ; il faut rompre la conjuration avant qu’elle soit trop forte… Je connais le ministère français : il est trop faible et trop borné pour sortir des griffes de l’Autriche. Le comte de Kaunitz les aura entraînés où il lui convient avant qu’ils aient ouvert les yeux. Ma situation est entourée de périls, je ne puis en sortir que par un coup d’audace[1]. »
Voilà le cri du cœur et le coup d’œil du génie. Depuis lors, dans ses protestations diplomatiques comme plus tard dans ses mémoires, Frédéric, pour plaider sa cause devant la postérité et régler ses comptes avec la philosophie, a donné aux motifs de son agression une précision factice dont l’histoire a eu la naïveté d’être dupe. Il a soutenu de sang-froid qu’un traité d’alliance offensive dirigé contre lui, et comportant le partage de ses états, était déjà signé entre les deux impératrices, et l’exécution assignée à jour fixe pour le printemps suivant. Il a énuméré les troupes que chacune des alliées était convenue de mettre sur pied, 100,000 hommes pour l’Autriche et 120,000 pour la Russie. Ledit traité (toujours suivant lui) était déjà présenté à l’accession de la France, qui ne s’y refusait pas, et avait obtenu celle de la Saxe, engagée pour sa part à porter dans le cours de l’hiver sa petite armée de 18,000 hommes à 40,000. Il était donc en défense légitime, et le coup qu’il allait porter n’était qu’une parade. Toute cette fantasmagorie est encore prise au sérieux par les écrivains allemands, et il faut les voir, depuis que les archives des cabinets leur sont ouvertes, suer sang et eau avec la conscience et la pédanterie tudesques pour retrouver vestige de ces documens imaginaires, dont la trace leur échappe toujours au moment qu’ils croient la tenir. La vérité est qu’ils ne trouvent rien par la bonne raison qu’il n’y eut jamais rien, et que Frédéric ne s’y était pas mépris un seul instant. Parfaitement instruit de l’état de toutes les armées et de toutes les cours par les rapports d’excellens agens diplomatiques avec lesquels il correspondait lui-même tous les jours de sa propre main, il savait mieux que personne qu’à Pétersbourg régnait uniquement un désir vague de se mêler des affaires d’Europe, et surtout de mettre la main en Pologne, tandis que la peur dominait à Dresde et l’indécision à Versailles. Cette misère de la politique française et saxonne, que nous attestent les gémissemens patriotiques du comte de Broglie, l’œil perspicace et railleur du grand homme l’avait percée à jour. Il ne craignait rien de toutes ces vanités tortueuses et peureuses ; mais à
- ↑ Schœffer, Geschichte des siebenjährigen Krieges, t, I, p. 196 et 198, d’après les papiers du ministre Chitchel.