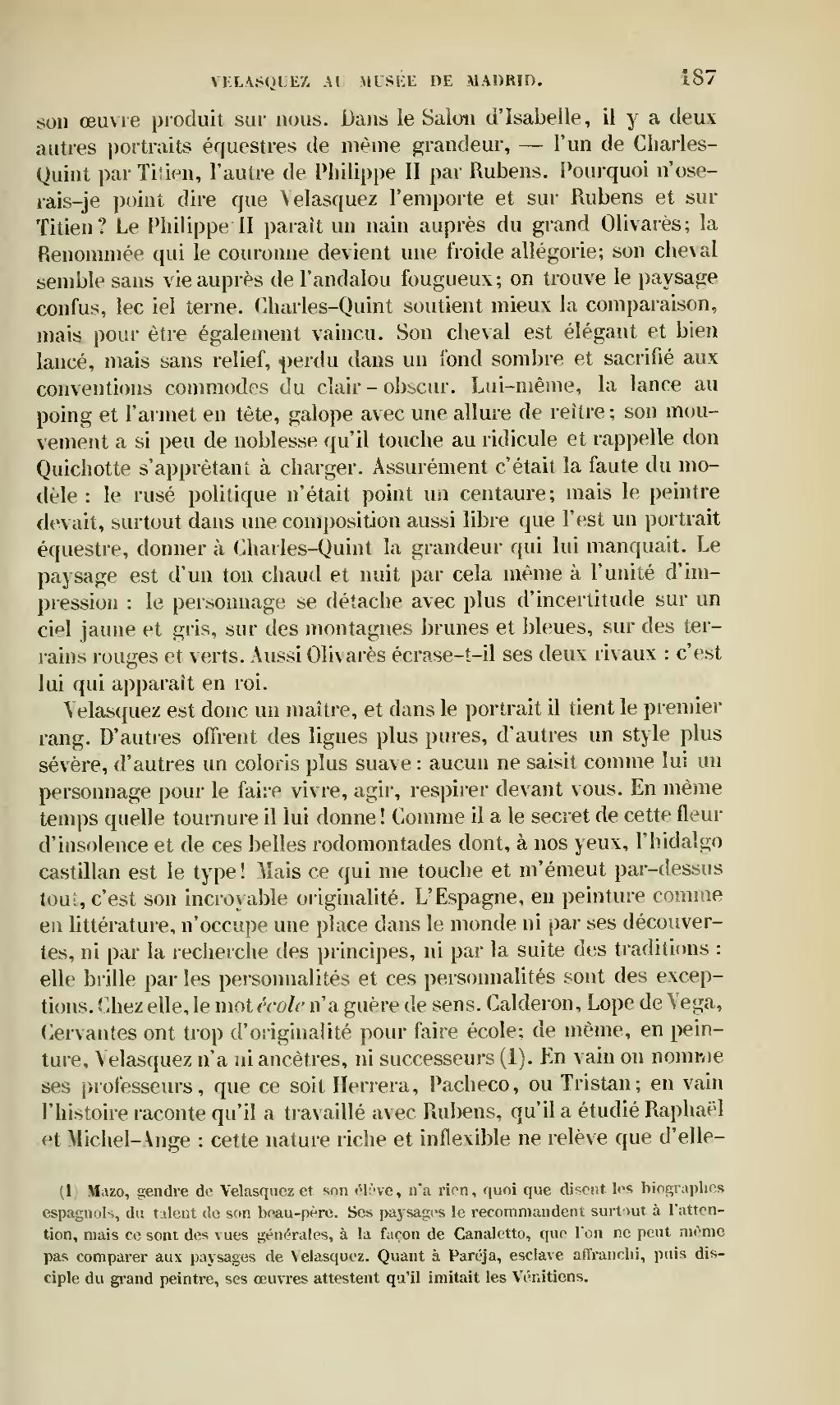son œuvre produit sur nous. Dans le Salon d’Isabelle, il y a deux autres portraits équestres de même grandeur, — l’un de Charles-Quint par Titien, l’autre de Philippe II par Rubens. Pourquoi n’oserais-je point dire que Velasquez l’emporte et sur Rubens et sur Titien ? Le Philippe II paraît un nain auprès du grand Olivarès ; la Renommée qui le couronne devient une froide allégorie ; son cheval semble sans vie auprès de l’andalou fougueux ; on trouve le paysage confus, le ciel terne. Charles-Quint soutient mieux la comparaison, mais pour être également vaincu. Son cheval est élégant et bien lancé, mais sans relief, perdu dans un fond sombre et sacrifié aux conventions commodes du clair-obscur. Lui-même, la lance au poing et l’armet en tête, galope avec une allure de reître ; son mouvement a si peu de noblesse qu’il touche au ridicule et rappelle don Quichotte s’apprêtant à charger. Assurément c’était la faute du modèle : le rusé politique n’était point un centaure ; mais le peintre devait, surtout dans une composition aussi libre que l’est un portrait équestre, donner à Charles-Quint la grandeur qui lui manquait. Le paysage est d’un ton chaud et nuit par cela même à l’unité d’impression : le personnage se détache avec plus d’incertitude sur un ciel jaune et gris, sur des montagnes brunes et bleues, sur des terrains rouges et verts. Aussi Olivarès écrase-t-il ses deux rivaux : c’est lui qui apparaît en roi.
Velasquez est donc un maître, et dans le portrait il tient le premier rang. D’autres offrent des lignes plus pures, d’autres un style plus sévère, d’autres un coloris plus suave : aucun ne saisit comme lui un personnage pour le faire vivre, agir, respirer devant vous. En même temps quelle tournure il lui donne ! Comme il a le secret de cette fleur d’insolence et de ces belles rodomontades dont, à nos yeux, l’hidalgo castillan est le type ! Mais ce qui me touche et m’émeut par-dessus tout, c’est son incroyable originalité. L’Espagne, en peinture comme en littérature, n’occupe une place dans le monde ni par ses découvertes, ni par la recherche des principes, ni par la suite des traditions : elle brille par les personnalités et ces personnalités sont des exceptions. Chez elle, le mot école n’a guère de sens. Calderon, Lope de Vega, Cervantes ont trop d’originalité pour faire école ; de même, en peinture, Velasquez n’a ni ancêtres, ni successeurs[1]. En vain on nomme ses professeurs, que ce soit Herrera, Pacheco, ou Tristan ; en vain l’histoire raconte qu’il a travaillé avec Rubens, qu’il a étudié Raphaël et Michel-Ange : cette nature riche et inflexible ne relève que d’elle-même.
- ↑ Mazo, gendre de Velasquez et son élève, n’a rien, quoi que disent les biographes espagnols, du talent de son beau-père. Ses paysages le recommandent surtout à l’attention, mais ce sont des vues générales, à la façon de Canaletto, que l’on ne peut même pas comparer aux paysages de Velasquez. Quant à Paréja, esclave affranchi, puis disciple du grand peintre, ses œuvres attestent qu’il imitait les Vénitiens.