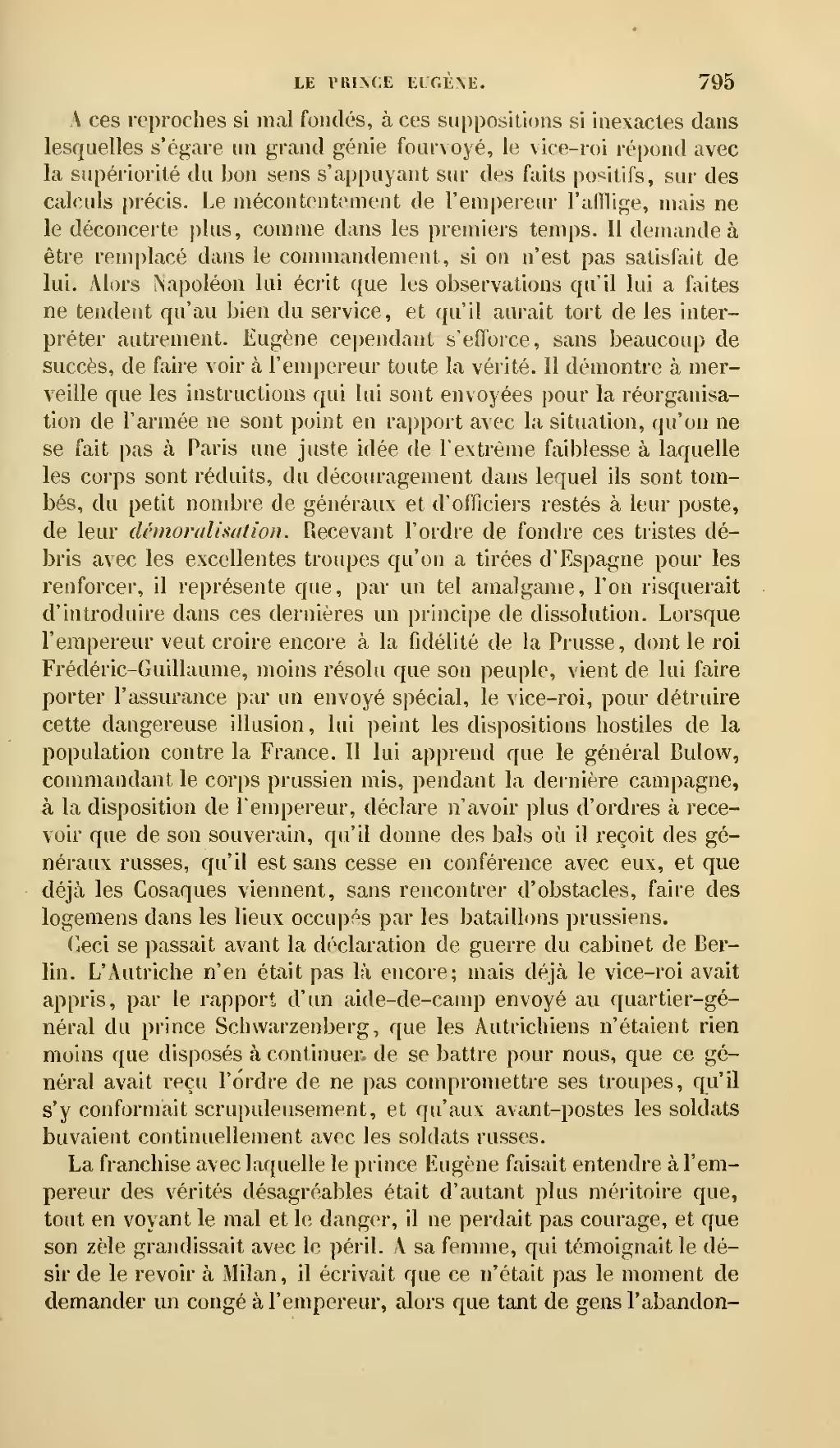À ces reproches si mal fondés, à ces suppositions si inexactes dans lesquelles s’égare un grand génie fourvoyé, le vice-roi répond avec la supériorité du bon sens s’appuyant sur des faits positifs, sur des calculs précis. Le mécontentement de l’empereur l’afflige, mais ne le déconcerte plus, comme dans les premiers temps. Il demande à être remplacé dans le commandement, si on n’est pas satisfait de lui. Alors Napoléon lui écrit que les observations qu’il lui a faites ne tendent qu’au bien du service, et qu’il aurait tort de les interpréter autrement. Eugène cependant s’efforce, sans beaucoup de succès, de faire voir à l’empereur toute la vérité. Il démontre à merveille que les instructions qui lui sont envoyées pour la réorganisation de l’armée ne sont point en rapport avec la situation, qu’on ne se fait pas à Paris une juste idée de l’extrême faiblesse à laquelle les corps sont réduits, du découragement dans lequel ils sont tombés, du petit nombre de généraux et d’officiers restés à leur poste, de leur démoralisation. Recevant l’ordre de fondre ces tristes débris avec les excellentes troupes qu’on a tirées d’Espagne pour les renforcer, il représente que, par un tel amalgame, l’on risquerait d’introduire dans ces dernières un principe de dissolution. Lorsque l’empereur veut croire encore à la fidélité de la Prusse, dont le roi Frédéric-Guillaume, moins résolu que son peuple, vient de lui faire porter l’assurance par un envoyé spécial, le vice-roi, pour détruire cette dangereuse illusion, lui peint les dispositions hostiles de la population contre la France. Il lui apprend que le général Bulow, commandant le corps prussien mis, pendant la dernière campagne, à la disposition de l’empereur, déclare n’avoir plus d’ordres à recevoir que de son souverain, qu’il donne des bals où il reçoit des généraux russes, qu’il est sans cesse en conférence avec eux, et que déjà les Cosaques viennent, sans rencontrer d’obstacles, faire des logemens dans les lieux occupés par les bataillons prussiens.
Ceci se passait avant la déclaration de guerre du cabinet de Berlin. L’Autriche n’en était pas là encore ; mais déjà le vice-roi avait appris, par le rapport d’un aide-de-camp envoyé au quartier-général du prince Schwarzenberg, que les Autrichiens n’étaient rien moins que disposés à continuer de se battre pour nous, que ce général avait reçu l’ordre de ne pas compromettre ses troupes, qu’il s’y conformait scrupuleusement, et qu’aux avant-postes les soldats buvaient continuellement avec les soldats russes.
La franchise avec laquelle le prince Eugène faisait entendre à l’empereur des vérités désagréables était d’autant plus méritoire que, tout en voyant le mal et le danger, il ne perdait pas courage, et que son zèle grandissait avec le péril. À sa femme, qui témoignait le désir de le revoir à Milan, il écrivait que ce n’était pas le moment de demander un congé à l’empereur, alors que tant de gens l’abandonnaient