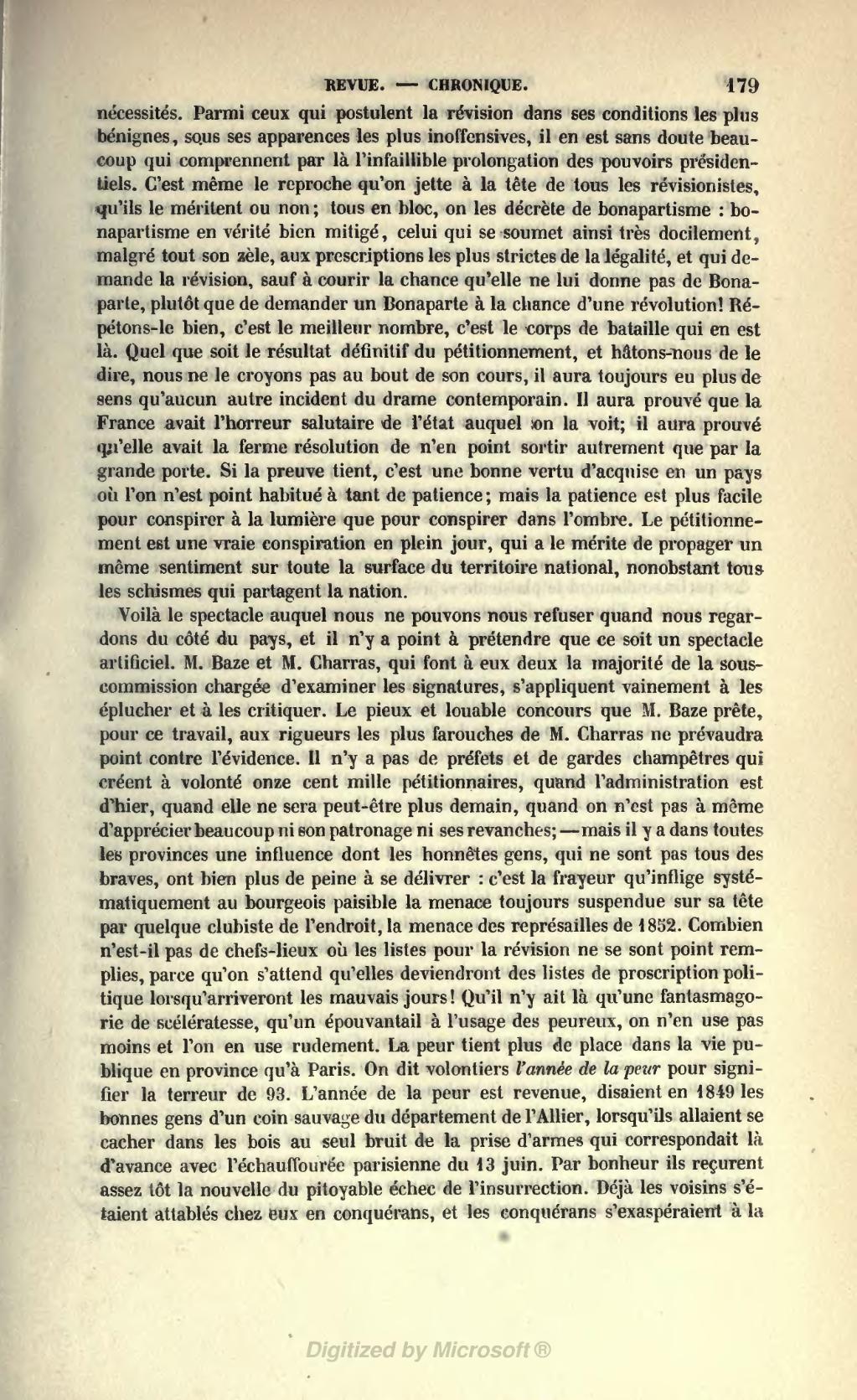nécessités. Parmi ceux qui postulent la révision dans ses conditions les plus bénignes, sous ses apparences les plus inoffensives, il en est sans doute beaucoup qui comprennent par là l’infaillible prolongation des pouvoirs présidentiels. C’est même le reproche qu’on jette à la tête de tous les révisionistes, qu’ils le méritent ou non ; tous en bloc, on les décrète de bonapartisme : bonapartisme en vérité bien mitigé, celui qui se soumet ainsi très docilement, malgré tout son zèle, aux prescriptions les plus strictes de la légalité, et qui demande la révision, sauf à courir la chance qu’elle ne lui donne pas de Bonaparte, plutôt que de demander un Bonaparte à la chance d’une révolution ! Répétons-le bien, c’est le meilleur nombre, c’est le corps de bataille qui en est là. Quel que soit le résultat définitif du pétitionnement, et hâtons-nous de le dire, nous ne le croyons pas au bout de son cours, il aura toujours eu plus de sens qu’aucun autre incident du drame contemporain. Il aura prouvé que la France avait l’horreur salutaire de l’état auquel on la voit ; il aura prouvé qu’elle avait la ferme résolution de n’en point sortir autrement que par la grande porte. Si la preuve tient, c’est une bonne vertu d’acquise en un pays où l’on n’est point habitué à tant de patience ; mais la patience est plus facile pour conspirer à la lumière que pour conspirer dans l’ombre. Le pétitionnement est une vraie conspiration en plein jour, qui a le mérite de propager un même sentiment sur toute la surface du territoire national, nonobstant tous les schismes qui partagent la nation.
Voilà le spectacle auquel nous ne pouvons nous refuser quand nous regardons du côté du pays, et il n’y a point à prétendre que ce soit un spectacle artificiel. M. Baze et M. Charras, qui font à eux deux la majorité de la sous-commission chargée d’examiner les signatures, s’appliquent vainement à les éplucher et à les critiquer. Le pieux et louable concours que M. Baze prête, pour ce travail, aux rigueurs les plus farouches de M. Charras ne prévaudra point contre l’évidence. Il n’y a pas de préfets et de gardes champêtres qui créent à volonté onze cent mille pétitionnaires, quand l’administration est d’hier, quand elle ne sera peut-être plus demain, quand on n’est pas à même d’apprécier beaucoup ni son patronage ni ses revanches ; — mais il y a dans toutes les provinces une influence dont les honnêtes gens, qui ne sont pas tous des braves, ont bien plus de peine à se délivrer : c’est la frayeur qu’inflige systématiquement au bourgeois paisible la menace toujours suspendue sur sa tête par quelque clubiste de l’endroit, la menace des représailles de 1852. Combien n’est-il pas de chefs-lieux où les listes pour la révision ne se sont point remplies, parce qu’on s’attend qu’elles deviendront des listes de proscription politique lorsqu’arriveront les mauvais jours ! Qu’il n’y ait là qu’une fantasmagorie de scélératesse, qu’un épouvantail à l’usage des peureux, on n’en use pas moins et l’on en use rudement. La peur tient plus de place dans la vie publique en province qu’à Paris. On dit volontiers l’année de la peur pour signifier la terreur de 93. L’année de la peur est revenue, disaient en 1849 les bonnes gens d’un coin sauvage du département de l’Allier, lorsqu’ils allaient se cacher dans les bois au seul bruit de la prise d’armes qui correspondait là d’avance avec l’échauffourée parisienne du 13 juin. Par bonheur ils reçurent assez tôt la nouvelle du pitoyable échec de l’insurrection. Déjà les voisins s’étaient attablés chez eux en conquérans, et les conquérans s’exaspéraient à la