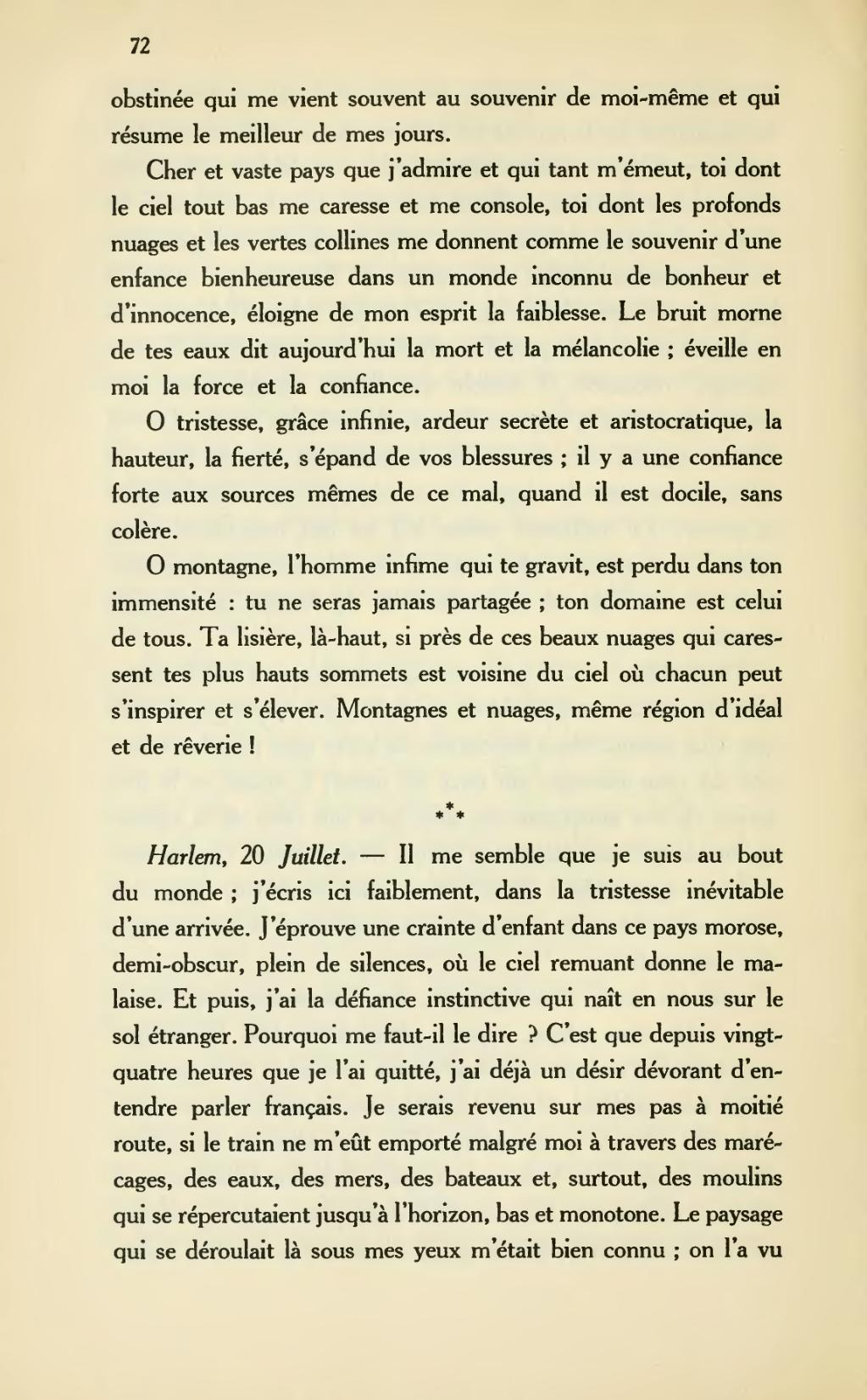obstinée qui me vient souvent au souvenir de moi-même et qui résume le meilleur de mes jours.
Cher et vaste pays que j’admire et qui tant m’émeut, toi dont le ciel tout bas me caresse et me console, toi dont les profonds nuages et les vertes collines me donnent comme le souvenir d’une enfance bienheureuse dans un monde inconnu de bonheur et d’innocence, éloigne de mon esprit la faiblesse. Le bruit morne de tes eaux dit aujourd’hui la mort et la mélancolie ; éveille en moi la force et la confiance.
O tristesse, grâce infinie, ardeur secrète et aristocratique, la hauteur, la fierté, s’épand de vos blessures ; il y a une confiance forte aux sources mêmes de ce mal, quand il est docile, sans colère.
O montagne, l’homme infime qui te gravit, est perdu dans ton immensité : tu ne seras jamais partagée ; ton domaine est celui de tous. Ta lisière, là-haut, si près de ces beaux nuages qui caressent tes plus hauts sommets est voisine du ciel où chacun peut s’inspirer et s’élever. Montagnes et nuages, même région d’idéal et de rêverie !
Harlem, 20 Juillet. — Il me semble que je suis au bout du monde ; j’écris ici faiblement, dans la tristesse inévitable d’une arrivée. J’éprouve une crainte d’enfant dans ce pays morose, demi-obscur, plein de silences, où le ciel remuant donne le malaise. Et puis, j’ai la défiance instinctive qui naît en nous sur le sol étranger. Pourquoi me faut-il le dire ? C’est que depuis vingt-quatre heures que je l’ai quitté, j’ai déjà un désir dévorant d’entendre parler français. Je serais revenu sur mes pas à moitié route, si le train ne m’eût emporté malgré moi à travers des marécages, des eaux, des mers, des bateaux et, surtout, des moulins qui se répercutaient jusqu’à l’horizon, bas et monotone. Le paysage qui se déroulait là sous mes yeux m’était bien connu ; on l’a vu