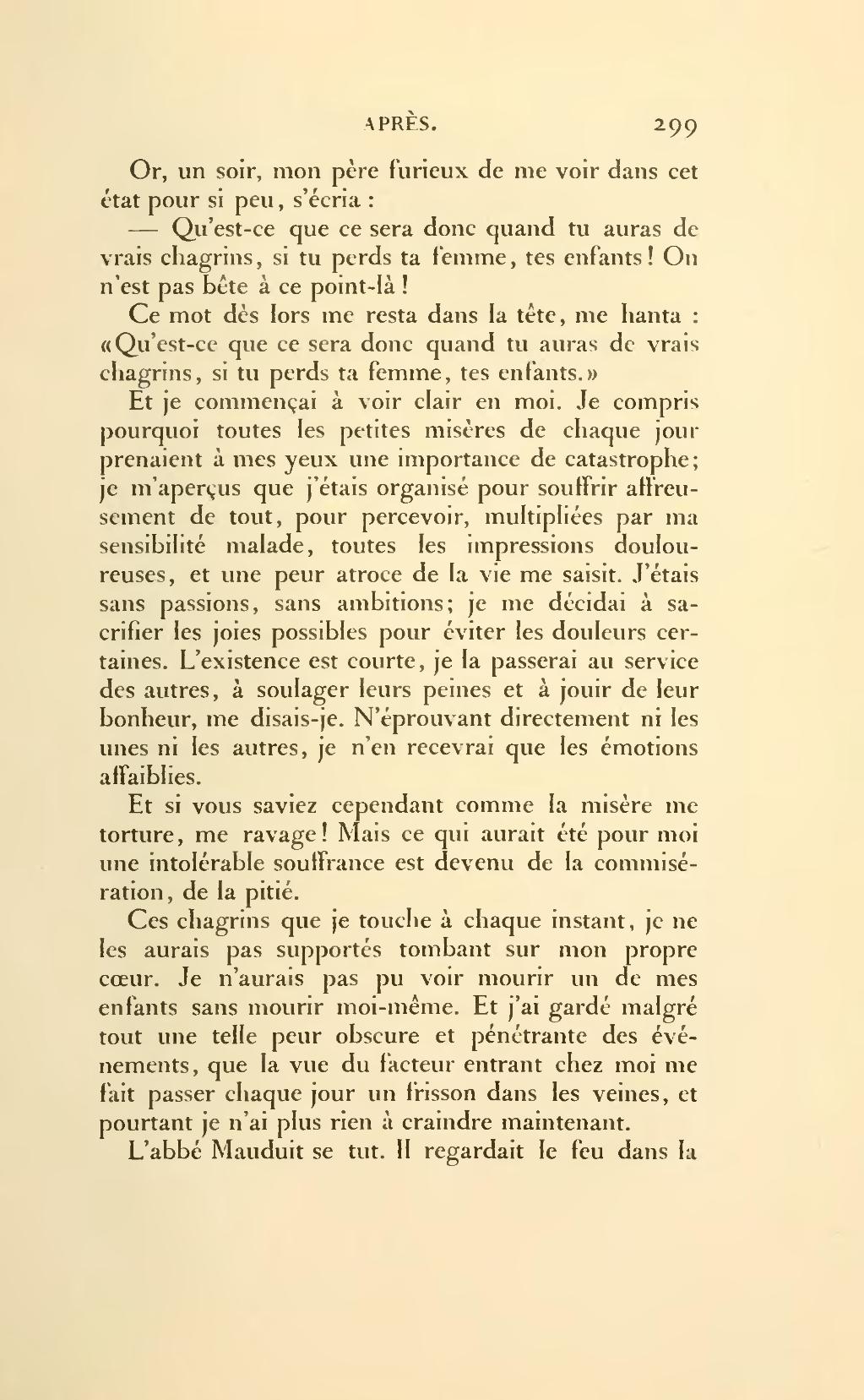Or, un soir, mon père furieux de me voir dans cet état pour si peu, s’écria :
— Qu’est-ce que ce sera donc quand tu auras de vrais chagrins, si tu perds ta femme, tes enfants ! On n’est pas bête à ce point-là !
Ce mot dès lors me resta dans la tête, me hanta : « Qu’est-ce que ce sera donc quand tu auras de vrais chagrins, si tu perds ta femme, tes enfants. »
Et je commençai à voir clair en moi. Je compris pourquoi toutes les petites misères de chaque jour prenaient à mes yeux une importance de catastrophe ; je m’aperçus que j’étais organisé pour souffrir affreusement de tout, pour percevoir, multipliées par ma sensibilité malade, toutes les impressions douloureuses, et une peur atroce de la vie me saisit. J’étais sans passions, sans ambitions ; je me décidai à sacrifier les joies possibles pour éviter les douleurs certaines. L’existence est courte, je la passerai au service des autres, à soulager leurs peines et à jouir de leur bonheur, me disais-je. N’éprouvant directement ni les unes ni les autres, je n’en recevrai que les émotions affaiblies.
Et si vous saviez cependant comme la misère me torture, me ravage ! Mais ce qui aurait été pour moi une intolérable souffrance est devenu de la commisération, de la pitié.
Ces chagrins que je touche à chaque instant, je ne les aurais pas supportés tombant sur mon propre cœur. Je n’aurais pas pu voir mourir un de mes enfants sans mourir moi-même. Et j’ai gardé malgré tout une telle peur obscure et pénétrante des événements, que la vue du facteur entrant chez moi me fait passer chaque jour un frisson dans les veines, et pourtant je n’ai plus rien à craindre maintenant.
L’abbé Mauduit se tut. Il regardait le feu dans la