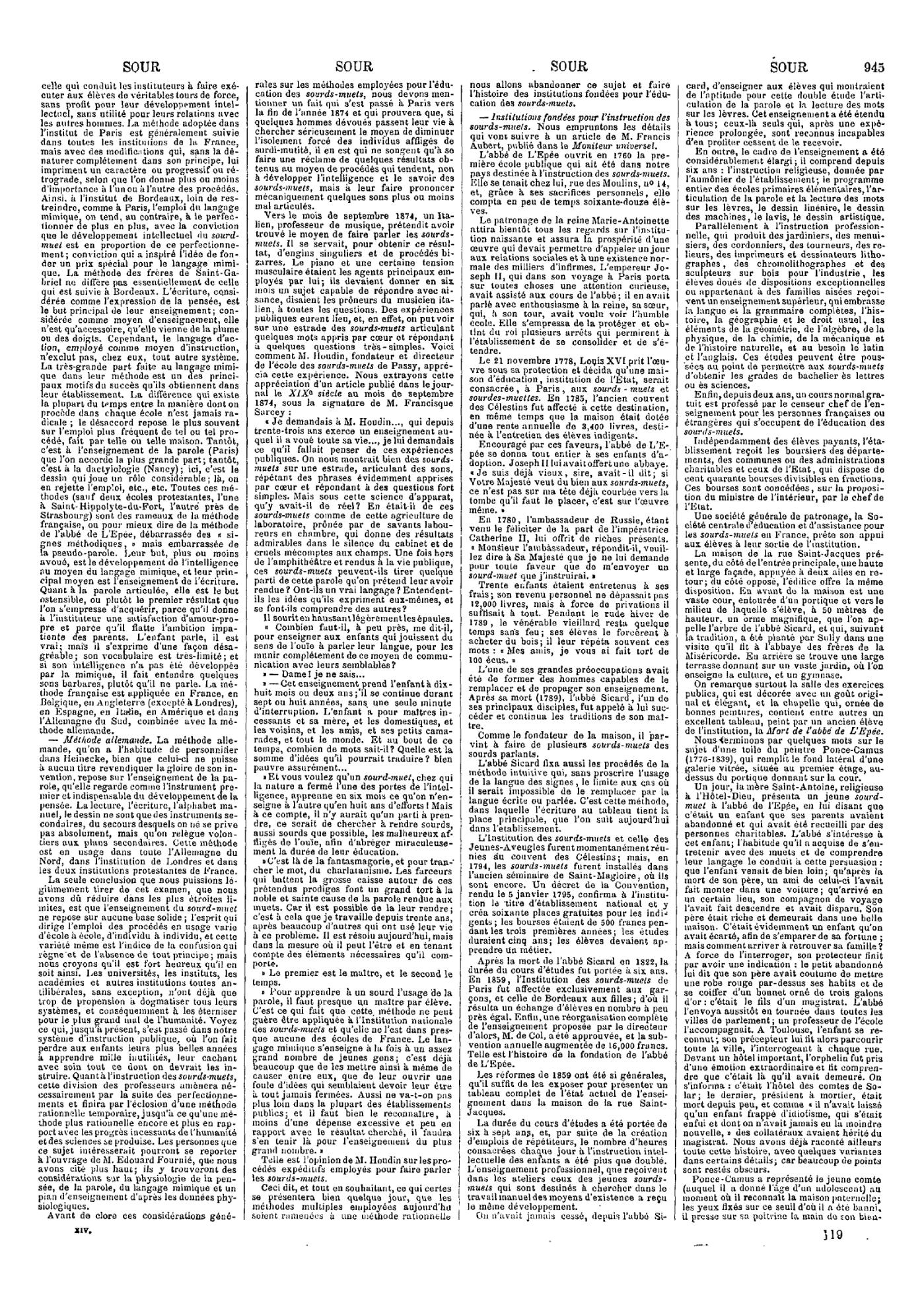celle qui conduit les instituteurs à faire exécuter aux élèves de véritables tours de force, sans profit pour leur développement intellectuel, sans utilité pour leurs relations avec les autres hommes. La méthode adoptée dans l’institut de Paris est généralement suivie dans toutes les institutions de la France, mais avec des modifications qui, sans la dénaturer complètement dans son principe, lui impriment un caractère ou progressif ou rétrograde, selon que l’on donne plus ou moins d’importance à l’un ou à l’autre des procédés. Ainsi, à l’institut de Bordeaux, loin de restreindre, comme à Paris, l’emploi du langage mimique, on tend, au contraire, à le perfectionner de plus en plus, avec la conviction que le développement intellectuel du sourd-muet est en proportion de ce perfectionnement conviction qui a inspiré l’idée de fonder un prix spécial pour le langage mimique. La méthode des frères de Saint-Gabriel ne diffère pas essentiellement de celle qui est suivie à Bordeaux. L’écriture, considérée comme l’expression de la pensée, est le but principal de leur enseignement ; considérée comme moyen d’enseignement, elle n’est qu’accessoire, qu’elle vienne de la plume ou des doigts. Cependant, le langage d’action, employé comme moyen d’instruction, n’exclut pas, chez eux, tout autre système. La très-grande part faite au langage mimique dans leur méthode est un des principaux motifs du succès qu’ils obtiennent dans leur établissement. La différence qui existe la plupart du temps entre la manière dont on procède dans chaque école n’est jamais radictrle le désaccord repose le plus souvent sur l’emploi plus fréquent de tel ou tel procédé, fait par telle ou telle maison. Tantôt, c’est à l’enseignement de la parole (Paris) que l’on accorde la plus grande part ; tantôt, c’est à la dactylologie (Nancy) ; ici, c’est le dessin qui joue un rôle considérable ; là, on en rejette l’emploi, etc., etc. Toutes ces méthodes (sauf deux écoles protestantes, l’une à Saint-Hippolyte-du-Fort, l’autre près de Strasbourg) sont des rameaux de la méthode française, ou pour mieux dire de la méthode de l’abbé de L’Epée, débarrassée des « signes méthodiques » mais embarrassée de la pseudo-parole. Leur but, plus ou moins avoué, est le développement de l’intelligence au moyen du langage mimique et leur principal moyen est l’enseignement de l’écriture. Quant à la parole articulée, elle est le but ostensible, ou plutôt le premier résultat que l’on s’empresse d’acquérir, parce qu’il donne à l’instituteur une satisfaction d’amour-propre et parce qu’il flatte l’ambition impatiente des parents. L’enfant parle, il est vrai ; mais il s’exprime d’une façon désagréable son vocabulaire est très-limité ; et si son intelligence n’a pas été développés par la mimique, il fait entendre quelques sons barbares, plutôt qu’il ne parle. La méthode française est appliquée en France, en Belgique, en Angleterre (excepté à Londres), en Espagne, en Italie, en Amérique et dans l’Allemagne du Sud, combinée avec la méthode allemande.
— Méthode allemande. La méthode allemande, qu’on a l’habitude de personnifier dans Hemecke, bien que celui-ci ne puisse à aucun titre revendiquer la gloire de son invention, repose sur l’enseignement de la parole, qu’elle regarde comme l’instrument premier et indispensable du développement de la pensée. La lecture, l’écriture, l’alphabet manuel, le dessin ne sont que des instruments secondaires, du secours desquels on ne se prive pas absolument, mais qu’on relègue volontiers aux plans secondaires. Cette méthode est en usage dans toute l’Allemagne du Nord, dans l’institution de Londres et dans les deux institutions protestantes de France.
La seule conclusion que nous puissions légitimement tirer de cet examen, que nous avons dû réduire dans les plus étroites limites, est que l’enseignement du sourd-muet ne repose sur aucune base solide ; l’esprit qui dirige l’emploi des procédés en usage varie d’école à école, d’individu à individu, et cette variété même est l’indice de la confusion qui règne et de l’absence de tout principe ; mais nous croyons qu’il est fort heureux qu’il en soit ainsi. Les universités, les instituts, les académies et autres institutions toutes antilibérales, sans exception, n’ont déjà que trop de propension à dogmatiser tous leurs systèmes, et conséquemment à les éterniser pour le plus grand mal de l’humanité. Voyez ce qui, jusqu’à présent, s’est passé dans notre système d’instruction publique, où l’on fait perdre aux enfants leurs plus belles années à apprendre mille inutilités, leur cachant avec soin tout ce dont on devrait les instruire. Quant à l’instruction des sourds-muets, cette division des professeurs amènera nécessairement par la suite des perfectionnements et finira par l’éclosion d’une méthode rationnelle temporaire, jusqu’à ce qu’une méthode plus rationnelle encore et plus en rapport avec les progrès incessante de l’humanité, et des sciences se produise. Les personnes que ce sujet intéresserait pourront se reporter à l’ouvrage de M. Edouard Fournié, que nous avons cité plus haut ; ils y trouveront des considérations sur la physiologie de la pensée, de la parole, du langage mimique et un plan d’enseignement d’après les données physiologiques.
Avant de clore ces considérations géné-
rales sur les méthodes employées pour l’éducation des sourds-muets, nous devons mentionner un fait qui s’est passé à Paris vers la fin de l’année 1874 et qui prouvera que, si quelques hommes dévoués passent leur vie à chercher sérieusement le moyen de diminuer l’isolement forcé des individus affligés de surdi-mutité, il en est qui ne songent qu’à se faire une réclame de quelques résultats obtenus au moyen de procédés qui tendent, non à développer l’intelligence et le savoir des sourds-muets, mais à leur faire prononcer mécaniquement quelques sons plus ou moins mal articulés.
Vers le mois de septembre 1874, un Italien, professeur de musique, prétendit avoir trouvé le moyen de faire parler les sourds-muets. Il se servait, pour obtenir ce résultat, d’engins singuliers et de procédés bizarres. Le piano et une certaine tension musculaire étaient les agents principaux employés par lui ; ils devaient donner en six mois un sujet capable de répondre avec aisance, disaient les prôneurs du musicien italien, à toutes les questions. Des expériences publiques eurent lieu, et, en effet, on put voir sur une estrade des sourds-muets articulant quelques mots appris par cœur et répondant à quelques questions très-simples. Voici comment M. Houdin, fondateur et directeur de l’école des sourds-muets de Passy, apprécia cette expérience. Nous extrayons cette appréciation d’un article publié dans le journal le XIXe siècle au mois de septembre 1874, sous la signature de M. Francisque Sarcey :
« Je demandais à M. Houdin. qui depuis trente-trois ans exerce un enseignement auquel il a voué toute sa vie . . ., je lui demandais ce qu’il fallait penser de ces expériences publiques. On nous montrait bien des sourds-muets sur une estrade, articulant des sons, répétant des phrases évidemment apprises par cœur et répondant à des questions fort simples. Mais sous cette science d’apparat, qu’y avait-il de réel ? En était-il de ces sourds-muets comme de cette agriculture de laboratoire, prônée par de savants laboureurs en chambre, qui donne des résultats admirables dans le silence du cabinet et de cruels mécomptes aux champs. Une fois hors de l’amphithéâtre et rendus à la vie publique, ces sourds-muets peuvent-ils tirer quelque parti de cette parole qu’on prétend leur avoir rendue ? Ont-ils un vrai langage ? Entendent-ils les idées qu’ils expriment eux-mêmes, et se font-ils comprendre des autres ?
Il sourit en haussant légèrement les épaules.
« Combien faut-il, à peu près, me dit-il, pour enseigner aux enfants qui jouissent du sens de l’ouïe à parler leur langue, pour les munir complètement de ce moyen de communication avec leurs semblables ? »
» Dame ! je ne sais.
» - Cet enseignement prend l’enfant à dix-huit mois ou deux ans ; il se continue durant sept ou huit années, sans, une seule minute d’interruption. L’enfant a pour maîtres incessants et sa mère, et les domestiques, et les voisins, et les amis, et ses petits camarades, et tout le monde. Et au bout de ce temps, combien de mots sait-il ? Quelle est la somme d’idées qu’il pourrait traduire ? bien pauvre assurément . . .
» Et vous voulez qu’un sourd-muet, chez qui la nature a fermé l’une des portes de l’intelligence, apprenne en six mois ce qu’on n’enseigne à l’autre qu’en huit ans d’efforts ! Mais à ce compte, il n’y aurait qu’un parti à prendre, ce serait de chercher à rendre sourds, aussi sourds que possible, les malheureux affligés de l’ouïe, afin d’abréger miraculeusement la durée de leur éducation.
» C’est là de la fantasmagorie, et pour trancher le mot, du charlatanisme. Les farceurs qui battent la grosse caisse autour de ces prétendus prodiges font un grand tort à la noble et sainte cause de la parole rendue aux muets. Car il est possible de la leur rendre ; c’est à cela que je travaille depuis trente ans, après beaucoup d’autres qui ont usé leur vie à ce problème. Il est résolu aujourd’hui, mais dans la mesure où il peut l’être et en tenant compte des éléments nécessaires qu’il comporte.
» Le premier est le maître, et le second le temps.
» Pour apprendre à un sourd l’usage de la parole, il faut presque un maître par élève. C’est ce qui fait que cette méthode ne peut guère être appliquée à l’institution nationale des sourds-muets et qu’elle ne l’est dans presque aucune des écoles de France. Le langage mimique s’enseigne à la fois à un assez grand nombre de jeunes gens ; c’est déjà beaucoup que de les mettre ainsi à même de causer entre eux, que de leur ouvrir une foule d’idées qui semblaient devoir leur être à tout jamais fermées. Aussi ne va-t-on pns plus loin dans la plupart des établissements publics ; et il faut bien le reconnaître, à moins d’une dépense excessive et peu en rapport avec le résultat cherché, il faudra s’en tenir là pour l’enseignement du plus grand nombre. »
Telle est l’opinion de M. Houdin sur les procédés expéditifs employés pour faire parler les sourds-muets.
Ceci dit, et tout en souhaitant, ce qui certes se présentera bien, quelque jour, que les méthodes multiples employées aujourd’hui soient ramenées à une méthode rationnelle
nous allons abandonner ce sujet et faire l’histoire des institutions fondées pour l’éducation des sourds-muets.
— Institutions fondées pour l’instruction des sourds-muets. Nous empruntons les détails qui vont suivre à un article de M. Francis Aubert, publié dans le Moniteur universel.
L’abbé de L’Epée ouvrit en 1760 la première école publique qui ait été dans notre pays destinée à l’instruction des sourds-muets. Elle se tenait chez lui, rue des Moulins, n° 14, et, grâce à ses sacrifices personnels, elle compta en peu de temps soixante-douze élèves.
Le patronage de la reine Marie-Antoinette attira bientôt tous les regards sur l’institution naissante et assura la prospérité d’une œuvre qui devait permettre d’appeler un jour aux relations sociales et à une existence normale des milliers d’infirmes. L’empereur Joseph II, qui dans son voyage à Paris porta sur toutes choses une attention curieuse, avait assisté aux cours de l’abbé ; il en avait parlé avec enthousiasme à la reine, sa sœur, qui, à son tour, avait voulu voir l’humble école. Elle s’empressa de la protéger et obtint du roi plusieurs arrêts qui permirent à l’établissement de se consolider et de s’étendre.
Le 21 novembre 1778, Louis XVI prit l’œuvre sous sa protection et décida qu’une maison d’éducation, institution de l’Etat, serait consacrée à Paris aux sourds muets et sourdes-muettes. En 1785, l’ancien couvent des Célestins fut affecté à cette destination, en même temps que la maison était dotée d’une rente annuelle de 3,400 livres, destinée à l’entretien des élèves indigents.
Encouragé par ces faveurs, l’abbé de L’Epée se donna tout entier à ses enfants d’adoption. Joseph II lui avait offert une abbaye. « Je suis déjà vieux, sire, avait-il dit ; si Votre Majesté veut du bien aux sourds-muets, ce n’est pas sur ma tête déjà courbée vers la tombe qu’il faut le placer, c’est sur l’œuvre même. »
En 1780, l’ambassadeur de Russie, étant venu le féliciter de la part de l’impératrice Catherine II, lui offrit de riches présents. « Monsieur l’ambassadeur, répondit-il, veuillez dire à Sa Majesté que je ne lui demande pour toute faveur que de m’envoyer un sourd-muet que j’instruirai. »
Trente enfants étaient entretenus à ses frais ; son revenu personnel ne dépassait pas 12,000 livres, mais à force de privations il suffisait à tout. Pendant le rude hiver de 1789 le vénérable vieillard resta quelque temps sans feu ; ses élèves le forcèrent à acheter du bois ; il leur répéta souvent ces mots « Mes amis, je vous ai fait tort de 100 écus. »
L’une de ses grandes préoccupations avait été de former des hommes capables de le remplacer et de propager son enseignement. Après sa mort (1789), l’abbé Sicard, l’un de ses principaux disciples, fut appelé à lui succéder et continua les traditions de son maître.
Comme le fondateur de la maison, il parvint à faire de plusieurs sourds-muets des sourds parlants.
L’abbé Sicard fixa aussi les procédés de la méthode intuitive qui, sans proscrire l’usage de la langue des signes, le limite aux cas où il serait impossible de le remplacer par la langue écrite ou parlée. C’est cette méthode, dans laquelle l’écriture au tableau tient la place principale, que l’on suit aujourd’hui dans l’établissement.
L’Institution des sourds-muets et celle des Jeunes-Aveugles furent momentanément réunies au couvent des Célestins ; mais, en 1794, les sourds-muets furent installés dans l’ancien séminaire de Saint-Magloire, où ils sont encore. Un décret de la Convention, rendu le 5 janvier 1795, confirma à l’institution la titre d’établissement national et y créa soixante places gratuites pour les indigents les bourses étaient de 500 francs pendant les trois premières années ; les études duraient cinq ans ; les élèves devaient apprendre un métier.
Après la mort de l’abbé Sicard en 1822, la durée du cours d’études fut portée àsix ans. En 1859, l’Institution des sourds-muets de Paris fut affectée exclusivement aux garçons, et celle de Bordeaux aux filles ; d’où il résulta un échange d’élèves en nombre à peu près égal. :nfiu, une réorganisation complète de l’enseignement proposée par le directeur d’alors, M. de Col, a été approuvée, et la subvention annuelle augmentée de 16,000 francs. Telle est l’histoire de la fondation de l’abbé de L’Epée.
Les réformes de 1859 ont été si générales, qu’il suffit de les exposer pour présenter un tableau complet de l’état actuel de l’enseignement dans la maison de la rue Saint- Jacques.
La durée du cours d’études a été portée de six à sept ans, et, par suite de la création d’emplois de répétiteurs, le nombre d’heures consacrées chaque jour à l’instruction intellectuelle des entants a été plus que doublé. L’enseignement professionnel, que reçoivent dans les ateliers ceux des jeunes sourdsmuets qui sont destinés à chercher dans le trav ail manuel des moyens d’existence a reçu la même développement.
On n’avait jamais cessé, depuis l’abbé Si-
card, d’enseigner aux élèves qui montraient de l’aptitude pour cette double étude l’articulation de la parole et la lecture des mots sur les lèvres. Cet enseignement a été étendu à tous ; ceux-là seuls qui, après une exlérience prolongée, sont reconnus incapables d’en profiter cessent de le recevoir.
En outre, le cadre de l’enseignement a été considérablement élargi ; il comprend depuis six ans l’instruction religieuse, donnée par l’aumônier de l’établissement ; le programme entier des écoles primaires élémentaires, l’articulation de la parole et la lecture des mots sur les lèvres, le dessin linéaire, le dessin des machines, le lavis, le dessin artistique.
Parallèlement à l’instruction professionnelle, qui produit des jardiniers, des menuisiers, des cordonniers, des tourneurs, des relieurs, des imprimeurs et dessinateurs lithographes, des chromolithographes et des sculpteurs sur bois pour l’industrie les élèves doués de dispositions exceptionnelles ou appartenant à des familles aisées reçoivent un enseignement. supérieur, qui embrasse la langue eL la grammaire complètes, l’histoire, la géographie et le droit usuel, les éléments de la géométrie, de l’algèbre, de la physique, de la chimie, de la mécanique et de l’histoire naturelle, et au besoin le latin et l’anglais. Ces études peuvent être poussées au point de permettre aux sourds-muets d’obtenir les grades de bachelier ès lettres ou ès sciences.
Enfin, depuis deux ans, un cours normal gratuit est professé par le censeur chef de l’enseignement pour les personnes françaises ou étrangères qui s’occupent de l’éducation des sourds-muets.
Indépendamment des élèves payants, l’établissement reçoit les boursiers des départements, des communes ou des administrations charitables et ceux de l’Etat, qui dispose de cent quarante bourses divisibles en fractions. Ces bourses sont concédées, sur la proposition du ministre de l’intérieur, par le chef de l’Etat.
Une société énérale de patronage, la Société centrale 0 éducation et d’assistance pour les sourds-muets en France, prête son appui aux élèves à leur sortie de l’institution.
La maison de la rue Saint-Jacques présente, du côté de l’entrée principale, une haute et large façade, appuyée à deux ailes en retour du côté opposé, l’édifice offre la même disposition. En avant de la maison est une vaste cour, entourée d’un portique et vers le milieu de laquelle s’élève, à 50 mètres de hauteur, un orme magnifique, que l’on appelle l’arbre de l’abbé Sicard, et qui, suivant la tradition, a été planté par Sully dans une visite qu’il fit à l’abbaye des frères de la miséricorde. Eu arrière se trouve une large terrasse donnant sur un vaste jardin, où l’on enseigne la culture, et un gymnase.
On remarque surtout la salle des exercices publics, qui est décorée avec un goût original et élégant, et la chapelle qui, ornée de bonnes peintures, contient entre autres un excellent tableau, peint par un ancien élève de l’institution, la Afort de l’abbé de L’Epée.
Nous terminons par quelques mots sur le sujet d’une toile du peintre Ponce-Camus (1776-1839), qui remplit le fond latéral d’une galerie vitrée, située au premier étage, audessus du portique donnant sur la cour.
Un jour, la mère Saint-Antoine, religieuse à à l’Hotel-Dieu présenta un jeune sourdmuel à l’abbé de l’Epée, en lui disant que c’était un enfant que ses parents avaient abandonné et qui avait été recueilli par des personnes charitables. L’abbé s’intéresse à cet enfant ; l’habitude qu’il a acquise de s’entretenir avec des muets et de comprendre leur langage le conduit à cette persuasion que l’enfant venait de bien loin ; qu’après la mort de son père, un ami de celui-ci l’avait fait monter dans une voiture ; qu’arrivé en un certain lieu, son compagnon de voyage l’avait fait descendre et avait disparu. Son père était riche et demeurait dans une belle maison. C’était évidemment un enfant qu’on avait écarté, afin de s’emparer de sa fortune mais comment arriver à retrouver sa famille ? A force de l’interroger, son protecteur finit par avoir une indication le petit abandonné lui dit que son père avait coutume de mettre une robe rouge par-dessus ses habits et de se coiffer d’un bonnet orné de trois galons d’or : c’était le fils d’un magistrat. L’abbé l’envoya aussitôt en tournée dans toutes les villes de parlement ; un professeur de l’école l’accompagnait. A Toulouse, l’enfant, se reconnut son précepteur lui fit alors parcourir toute la ville, l’interrogeant à chaque rue. Devant un hôtel important, l’orphelin fut pris d’une émotion extraordinaire et fit comprendre que c’était là qu’il avait demeuré. On s’informa : c’était l’hôtel des comtes de Solar le dernier, président à mortier, était mort depuis peu, et comme il n’avait laissé qu’un enfant frappé d’idiotisme, qui s’était enfui et dont on n’avait jamais eu la moindre nouvelle, » des collatéraux avaient hérité du magistrat. Nous avons déjà raconté ailleurs toute cette histoire, avec quelques variantes dans certains détails car beaucoup de points sont restés obscurs.
Ponce-Camus a représenté le jeune comte (auquel il a donné l’âge d’un adolescent) au moment où il reconnaît la maison paternelle ; les yeux fixés sur ce seuil d’où il a été banni, il presse sur sa poitrine la main de son bien-
xiv. 119