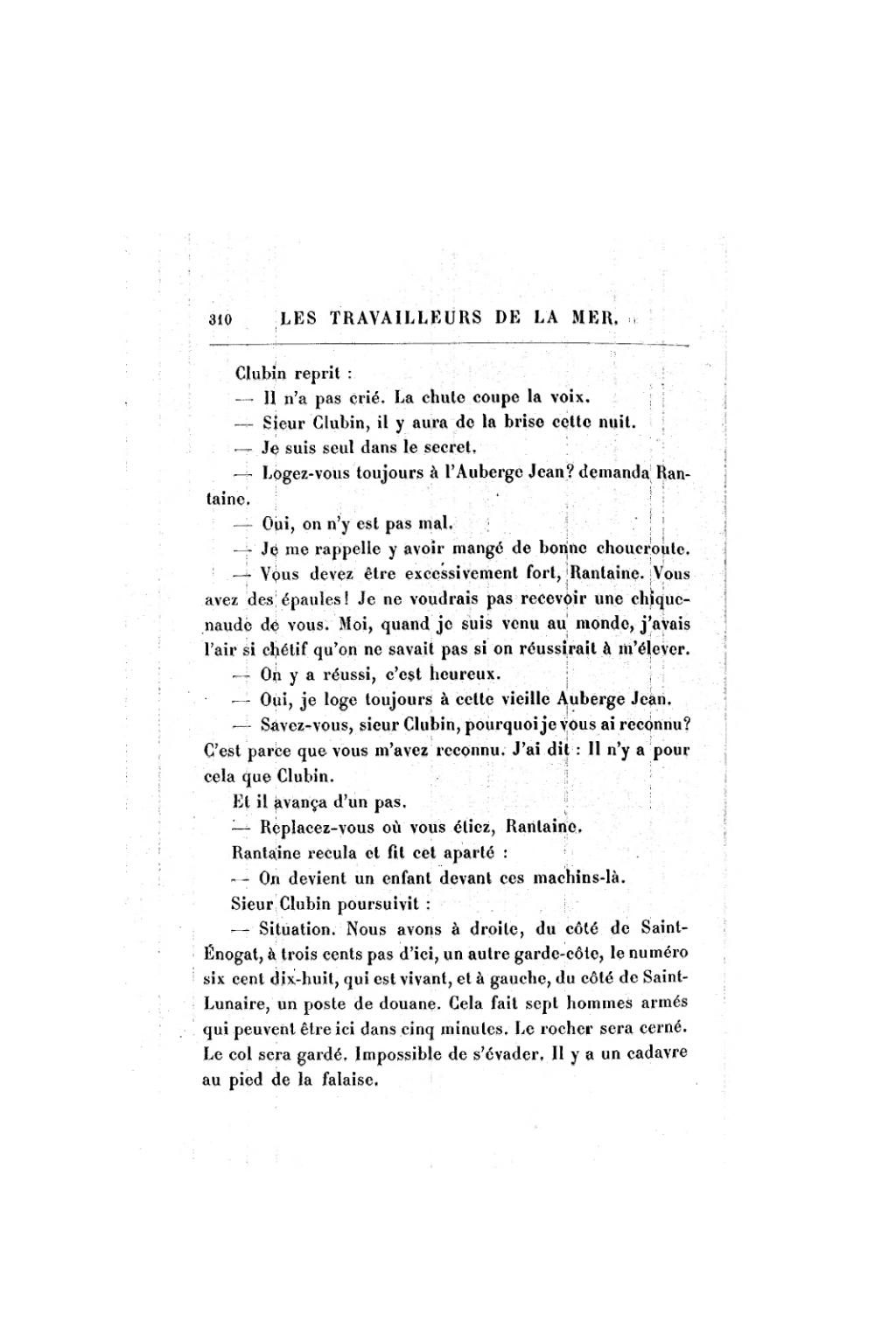Clubin reprit :
— Il n’a pas crié. La chute coupe la voix.
— Sieur Clubin, il y aura de la brise cette nuit.
— Je suis seul dans le secret.
— Logez-vous toujours à l’Auberge Jean ? demanda Rantaine.
— Oui, on n’y est pas mal.
— Je me rappelle y avoir mangé de bonne choucroute.
— Vous devez être excessivement fort, Rantaine. Vous avez des épaules ! Je ne voudrais pas recevoir une chiquenaude de vous. Moi, quand je suis venu au monde, j’avais l’air si chétif qu’on ne savait pas si on réussirait à m’élever.
— On y a réussi, c’est heureux.
— J’ai gardé mes habitudes, je loge toujours à cette vieille Auberge Jean.
— Savez-vous, sieur Clubin, pourquoi je vous ai reconnu ? C’est parce que vous m’avez reconnu. J’ai dit : il n’y a pour cela que Clubin.
Et il avança d’un pas.
— Replacez-vous où vous étiez, Rantaine.
Rantaine recula et fit cet aparté :
— On devient un enfant devant ces machins-là.
Sieur Clubin poursuivit :
— Situation. Nous avons à droite, du côté de Saint-Énogat, à trois cents pas d’ici, un autre garde-côte, le numéro six cent dix-huit, qui est vivant, et à gauche, du côté de Saint-Lunaire, un poste de douane. Cela fait sept hommes armés qui peuvent être ici dans cinq minutes. Le rocher sera cerné. Le col sera gardé. Impossible de s’évader. Il y a un cadavre au pied de la falaise.