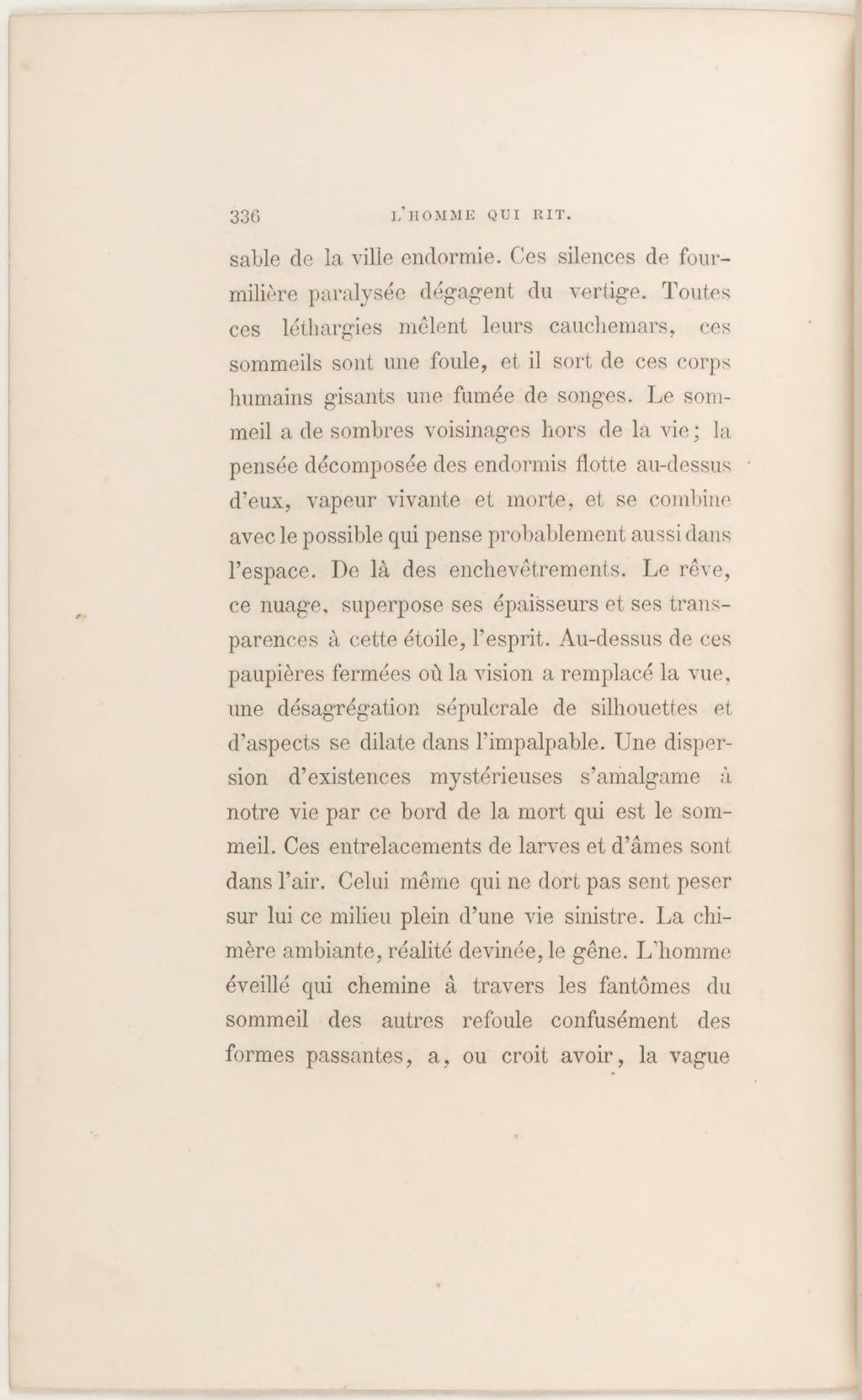sable de la ville endormie. Ces silences de fourmilière paralysée dégagent du vertige. Toutes ces léthargies mêlent leurs cauchemars, ces sommeils sont une foule, et il sort de ces corps humains gisants une fumée de songes. Le sommeil a de sombres voisinages hors de la vie ; la pensée décomposée des endormis flotte au-dessus d’eux, vapeur vivante et morte, et se combine avec le possible qui pense probablement aussi dans l’espace. De là des enchevêtrements. Le rêve, ce nuage, superpose ses épaisseurs et ses transparences à cette étoile, l’esprit. Au-dessus de ces paupières fermées où la vision a remplacé la vue, une désagrégation sépulcrale de silhouettes et d’aspects se dilate dans l’impalpable. Une dispersion d’existences mystérieuses s’amalgame à notre vie par ce bord de la mort qui est le sommeil. Ces entrelacements de larves et d’âmes sont dans l’air. Celui même qui ne dort pas sent peser sur lui ce milieu plein d’une vie sinistre. La chimère ambiante, réalité devinée, le gêne. L’homme éveillé qui chemine à travers les fantômes du sommeil des autres refoule confusément des formes passantes, a, ou croit avoir, la vague
Page:Hugo - L'Homme qui rit, 1869, tome 1.djvu/346
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.