L’Amour paillard/Texte entier

I
À Asnières, dans une maisonnette entourée d’un jardin, clos par des murs assez élevés, vivait une famille, étroitement unie, et composée de cinq membres. C’étaient Jacques Phoncinot, trente-deux ans, et sa femme Thérèse, chatain-blonde de dix-neuf ans ; Antoine Gorgon, cinquante-cinq ans, et sa femme Lina, vingt-cinq ans, gentille brune, cousine de Jacques ; Léa Dorial, blonde cendrée, dix-sept ans, sœur de Thérèse. Trois femmes, deux hommes. Vivant pour eux, n’ayant aucune profession apparente, allant souvent à Paris ou en voyage, sans qu’on s’inquiétât pourquoi, ils ne faisaient pas de bruit et nul ne les troublait. Cependant, s’il eût été permis à quelque voisin de jeter un œil curieux sur ce qui se passait dans l’intérieur du ménage, il aurait eu à réfléchir et à faire des hypothèses à perte de vue. Pas de serviteur pour l’extérieur et le travail du logis. Antoine Gorgon se chargeait des provisions au marché, et des courses au dehors ; Jacques veillait à la cuisine ; Lina et Thérèse se réservaient les chambres, Léa la lingerie et le couvert. Était-ce un phalanstère ? Non.
Cette famille exploitait simplement les plaisirs de l’amour dans leurs tableaux suggestifs, près de quelques hautes notabilités de la vieille aristocratie ou de la finance, près de quelques horizontales huppées voulant réchauffer les sens d’un entreteneur sérieux, ou en découvrir un nouveau. Métier peu banal et pas facile, qui nécessitait une entente très serrée et une liberté absolue entre soi, pour se satisfaire d’abord dans ses goûts personnels afin de bien les traduire pour les fantaisies d’autrui, pour n’éprouver ensuite aucune contrainte dans les aventures qui parfois en résultaient. Aussi, si le maire et le curé avaient consacré les mariages, la volonté familiale avait décrété qu’on userait sans jalousie les uns et les autres des caprices d’une sensualité souvent excitée par les tableaux qu’on répétait pour bien les rendre devant les clients. On s’était expliqué bien gentiment et bien franchement, pour que les goûts particuliers se déroulassent sans choquer aucun des associés, et pour que l’on jouit largement, honnêtement, généreusement, des joies paradisiaques réservées à un pacha dans son sérail. Jacques était le baiseur hors-ligne de la bande : il distribuait loyalement ses coups de queue aussi bien à Lina qu’à Thérèse, et même quelquefois à Léa, à la charbonnière, pour ne pas trop endommager le pucelage. Il possédait une langue très experte pour les minettes, alors qu’Antoine adorait la lune, en plein, en quart ou en demi-apparition, parfois même voilée par les jolis et luxueux dessous que revêtaient les trois nymphes précieuses, dont Jacques et lui se considéraient comme les heureux sultans. Lina et Léa brillaient dans des arrangements plastiques pour le saphisme, étant plutôt passives qu’actives, au lieu que Thérèse, nature très vibrante, gamahuchait et jouissait tantôt de l’une, tantôt de l’autre. La femme de Jacques était, de plus, une suceuse de premier ordre, et par cet art mignon elle savait à propos mettre en train soit son mari, soit son cousin Antoine. Elle avait toujours les lèvres et la langue des mieux disposées.
On ne manquait pas d’agrément dans la maison, quand on ne travaillait pas au dehors ; on y triturait des étoffes de soie, satin, velours, etc., pour créer des merveilles de toilettes originales, s’adaptant au genre de beauté de chacune des trois femmes ; on confectionnait des blouses, des culottes courtes, même des caleçons riches pour les hommes ; on essayait les modèles, on imaginait des scènes, des pantomimes, on s’échauffait le tempérament, on se lançait dans des postures excitantes et paillardes, on étudiait la finesse des caresses, on se lutinait, on ne s’embêtait pas, et le baisage se produisait toujours dans d’excellentes conditions.
Or, le jour où commence ce récit, Jacques, tout son monde assemblé, venait de terminer la lecture d’une lettre, écrite par un sportman distingué, Arthur des Gossins, amant en titre de La Férina, dont il ne parvenait pas à dissiper la noire mélancolie, ce à quoi il espérait parvenir par les scènes mignardes et polissonnes que la famille rendait avec tant de talent, et qu’il avait admirées chez un de ses amis. Il était facile de voir la profonde impression que le montreur de plaisirs et son monde avaient produite. Arthur des Gossins s’étendait longuement sur la façon coquette, élégante, suggestive, avec laquelle ils donnaient la vision des voluptés amoureuses, excluant toute pensée grossière, et il ne doutait pas que sa chère maîtresse, assistant à un tel spectacle, ne sentit s’émouvoir ses sens et ne le récompensât de l’amour qu’il lui vouait. Jacques, la lettre à la main, se rengorgeait. Il s’écria :
— Hein ! on arrive à nous comprendre, on ne nous injurie pas.
— Il ne manquerait plus que ça, répliqua Thérèse : on leur montre trois femmes, jeunes, jolies, bien bâties, habiles à jouer de leur corps, et ils ne seraient pas contents ! Ils peuvent toucher, ils peuvent obtenir une caresse, ils ou elles, et tu voudrais qu’ils fissent les méchants !
— La clientèle est si restreinte, qu’il faut toujours s’étonner d’un nouveau qui se présente pour son propre compte.
— Le fait est, intervint Lina, que les nouveaux, en général, aiment mieux nous retrouver là où ils nous ont rencontrés ; ils ne nous appellent que rarement chez eux. Et, comme les trois quarts du temps nous travaillons surtout chez quelques cocottes intelligentes recevant beaucoup de Messieurs, qu’elles veulent attirer en leur montant le tempérament grâce à nous, les Messieurs ne demandent presque jamais notre adresse.
— Cette fois, c’est le contraire qui arrive : l’amant de la cocotte nous invite à aller aguicher les sens de sa belle. Qu’est-ce qui connaît La Férina ? Je l’ignorais avant cette heure.
— J’en ai entendu parler, répondit Antoine ; il paraît que c’est une jolie blonde, très froide et très faiseuse d’embarras. On a prononcé son nom l’autre soir ; on disait qu’elle avait une bonne amie, avec qui elle se moquait de son amant.
— Ça, ce ne sont pas nos affaires. On ne sait rien de la dame, l’amant nous invite à aller chez elle, il paye pour les tableaux, occupons-nous de ce qu’on lui servira.
— Je te crois, mon beau, dix fois plutôt qu’une.
— Que jouerons-nous à cette princesse ?
— Si elle est froide pour les hommes, on lui montrera le gamahuchage des femmes.
— Tu as raison : tu t’emballeras sur Lina et sur Léa ; on musiquera à l’espagnole ; en avant tulles et mousselines, torsions des reins et des cuisses, danses du ventre et du cul, petits bécots, grosses lippées ! Elle pissera dans ses bas ! Je suis sûr de votre triomphe, mes belles déesses. Maintenant, en place pour la répétition des poses.

II
D’un landau, le montreur de plaisirs et son monde descendirent à la porte d’un immeuble de la rue Marbeuf. Antoine Gorgon, le visage entièrement rasé de frais, le corps sanglé dans une redingote, présentait, on ne peut mieux, le type d’un brave tabellion de province. Quant à Jacques Phoncinot, la moustache brune en croc, l’allure dégagée sous un complet marron, il précédait toute sa bande, les dames en toilette modeste de soie noire, sans falbalas tapageurs, le suivant à la queue leu leu. Antoine s’informa de l’étage où habitait Mme La Férina ; le concierge répondit poliment de grimper jusqu’au troisième, où l’on attendait ces dames et ces messieurs.
Sur le tapis de l’escalier, les pas de nos gens glissaient sans bruit ; ils virent la porte de l’appartement ouverte sur le palier. On les attendait, ils pensèrent qu’ils n’avaient qu’à pénétrer. Jacques continua à s’avancer le premier, puis immédiatement derrière lui, sa femme Thérèse, suivie de Lina et de Léa, Antoine fermant la marche. Une longue galerie donnait sur le vestibule ; la troupe s’y engagea, sans échanger une observation ; on se trouva au bout devant une porte entrebâillée, la tenture soulevée ; Jacques la franchit et pénétra dans une pièce en demi-obscurité. Il s’arrêta soudain, stupéfait et très ennuyé ; en face de lui, sur un sopha, il apercevait une jeune femme, le peignoir défait et rejeté sur les côtés, la chemise relevée jusqu’au cou, les cuisses et le ventre nus, exhibant le minet blond, sous lequel disparaissait dans le con une queue, manœuvrant avec vigueur. La dame était à cheval sur les genoux du cavalier, le dos appuyé contre sa poitrine ; elle tenait la tête tournée en partie de son côté, pour tendre les lèvres à ses baisers, ce qui expliquait qu’elle n’entendait rien, et continuait le manège du coït, se trémoussant de plus en plus. Jacques atterré, comprenant qu’il commettait une maladresse, n’osait ni s’avancer ni reculer, il se cramponnait à la main de Thérèse, aussi stupéfiée que lui, et à la suite du couple, Lina et Léa regardaient de tous leurs yeux, tandis qu’Antoine, complètement affolé, s’était accroupi pour s’enfourner sous les jupes de cette dernière, cachette qu’il estimait la plus sûre et la plus sacrée.
Les deux hommes portaient une petite valise, où ils avaient leurs costumes pour les tableaux de luxure qu’ils devaient représenter, costumes très sommaires. La valise, tenue par Jacques, tremblait à sa main ; celle d’Antoine reposait sur le tapis. Tout à coup la dame, ayant échangé une dernière langue avec son amant, tourna la tête et vit le montreur de plaisirs. Elle poussa un cri, laissa retomber sa chemise, réunit les pans de sa matinée, et, s’esquivant des genoux de son cavalier, partit comme une folle. L’homme, se reboutonnant vivement après avoir rajusté son débraillage, se redressa très irrité et demanda :
— Qu’est-ce ? Que faites-vous là ?
— Vous êtes sans doute M. Arthur des Gossins ?
— Non, vous vous trompez, ce n’est pas moi.
— Mme La Férina ?
— Vous venez de la faire se sauver.
— Ah, c’était elle !
Le cavalier, un jeune homme brun d’une vingtaine d’années, devina la sottise qu’il venait de laisser échapper, et furieux s’exclama :
— Adressez-vous aux domestiques, ou allez au diable !
— Trop aimable, cher Monsieur.
Jacques reconquérait son sang-froid ; le hasard lui donnait barre sur la maîtresse de céans. Il ne s’opposa pas à ce que le jeune homme se retirât sur son apostrophe, et, dodelinant de la tête, en signe de vif contentement, il fit volte-face, commandant à son monde de le suivre. On revint à travers la galerie vers la porte d’entrée, non sans avoir été obligé d’arracher Antoine de dessous les jupes de Léa, où déjà il se livrait à de furibondes feuilles de rose sur la lune encore celée, et on carillonna. Une servante accourut, une gentille brunette qui, toute rieuse, demanda :
— Ah, c’est vous, le monde qu’on attend ?
— Oui, ma chère enfant, c’est bien nous. Conduisez-nous auprès de M. des Gossins ou de Mme La Férina.
— Venez par ici. Monsieur vous attend dans une chambre, pour que vous vous y nippiez. Alors, vous allez jouer la comédie rien que pour Madame et ses invités ?
— Votre maîtresse vous le racontera.
Arthur des Gossins, personnage très avenant et très élégant, orné de trente-cinq printemps et d’une fleur à la boutonnière, accueillit de façon fort aimable le montreur de plaisirs, et lui dit de se considérer comme chez lui dans la pièce qu’on mettait à sa disposition.
— Je sais, dit-il que vous avez coutume de ne pas vous séparer pour vos changements de costumes, chose très naturelle avec les jolis mets sucrés que vous servez ; je vous laisse donc pour que vous vous arrangiez. Je cours annoncer votre arrivée à ma belle Férina, qui a un très fort mal à la tête, et dès que vous serez prêts, vous sonnerez sur ce timbre, et l’on vous conduira dans le salon, où nous admirerons vos charmants tableaux.
— Y aura-t-il beaucoup de monde ?
— Cinq à six personnes tout au plus.
Arthur des Gossins se retira, et Jacques, qui déballait le contenu des valises, se plantant en arrêt sur ses jambes, comme un escrimeur dans une salle d’armes, s’écria : « On sollicitera de sa belle dame une légère augmentation. »
— Pas besoin, Jacques, riposta Thérèse, elle la donnera sans qu’on la demande ; montrons-nous discrets et convenables.
— N’aie pas peur, ma poulette, on sait bien ce qu’est la vie ! Arthur l’assomme, elle se console avec un tout jeune, cela ne nous regarde que pour nos intérêts. Je ne l’ai pas bien reluquée, mais il me semble qu’elle est munie de tout ce qu’il faut pour patiner et rigoler.
— Patiner et rigoler, c’est chose qui appartient ici à ce dindon d’Arthur, et aussi au petit jeune homme.
— Bah ! et à d’autres, ma belle.
— En voudrais-tu tâter, par hasard ? Si je le savais, monstre d’homme, il n’y aurait plus jamais rien entre nous, et je ne figurerais plus dans aucune de vos scènes !
— Ne te fâche pas, ma bichette, on peut être aimable avec les dames sans pour cela leur apporter ce qui appartient à ma cocotte en sucre Thérèse, ainsi qu’à Lina et Léa.
— Bon, bon, tu es prévenu ; passe-moi la blouse, et cache le godemiché pour le cas où on le demanderait.
Thérèse était toute nue, avec des chaussettes noires et des petits souliers découverts ; son mari lui remit une blouse de soie bleue qui tombait jusque sur les genoux, et qu’elle serra à la taille par une ceinture noire. Le vêtement, largement échancré sur le cou, pour bien le dégager, laissait les bras nus ; elle posa sur sa tête une toque noire, inspirant à la physionomie un air très mauvais sujet et très fripon. Quant à Lina, elle se revêtit d’une longue jupe blanche, avec une tunique verte dessinant les contours des hanches. Pour Léa, elle passa sur sa chemise un jupon court de surah rose, avec un simple corsage que retenaient deux seuls boutons, corsage de soie noire, soutaché de rubans roses, permettant à la chemise de faire jabot au-dessus de la ceinture. Jacques et Antoine ne portaient qu’un caleçon, comme les lutteurs, et avaient le buste et les jambes nus, avec des babouches aux pieds. Ils jetèrent une veste sur leurs épaules, et Jacques, après avoir glissé dans sa poche le godemiché, prit un tambour basque, tandis qu’Antoine se chargeait d’un phonographe, destiné à servir d’orchestre pour les exercices qu’on allait rendre. Là-dessus, on appuya sur le timbre, et la soubrette vint les chercher.

III
La Férina, vêtue d’une matinée blanche, toute fanfreluchée de dentelles, sous laquelle sa jolie tête fine et idéale de blonde apparaissait, légèrement pâlie, avec les yeux bleus cernés, les cheveux frisottant avec des mèches rebelles sur le front, attendait, un peu angoissée, à demi-couchée sur une chaise longue, dans son salon Louis XV, écoutant d’une oreille distraite les explications que lui donnait son amant Arthur des Gossins, assis à ses pieds. C’était bien la femme de trente ans, dans toute sa splendeur de formes et de beauté ; elle représentait bien la séduction incarnée pour subjuguer les cœurs et les sens, et devant un tel ensemble de grâces et d’attraits, il fallait qu’un amant fût bien dépourvu d’esprit pour recourir à des éléments étrangers afin d’en animer les chairs.
De temps en temps, elle échangeait un regard furtif et ennuyé avec un jeune homme brun, celui-là même avec qui elle venait d’être surprise enconnée, Alexandre Brollé, l’air fat et satisfait, lequel paraissait taquiner un autre jeune homme, un blond de son âge, son ami Émile Sauton, étudiant, qui n’avait d’yeux que pour une autre femme, une brune assez grande, élancée, accusant aussi la trentaine, la belle Horacine des Tilleuls, l’intime de La Férina, dont on la disait la gamahucheuse. La soubrette entra pour annoncer que les comédiens étaient là, et demander s’il fallait les introduire. À ce moment, La Férina, dans une agitation extrême, se souleva et dit :
— Eh bien, non ! Je ne veux pas de ça ou j’entends que le spectacle soit pour moi seule. Il ne me plaît pas qu’en ma présence vous assistiez à de douteuses exhibitions. Je veux les connaître avant de décider si je les autoriserai un autre jour.
— Mais nous étions d’accord lorsque je t’en ai parlé, intervint Arthur, je t’assure que cela mérite d’être vu.
— Si je dois rougir, il est inutile qu’il y ait des témoins pour le constater. Payez ces gens et qu’il se retirent ; ou laissez-moi seule avec eux.
— Vos caprices, ma chère, sont des ordres, et malgré le plaisir que je me promettais en contemplant de nouveau ces ébats, je suis certain que personne ne s’opposera à ce qu’il n’y ait d’autre spectatrice que vous.
— Margot a raison, appuya Horacine, allons, Messieurs, accompagnez-moi au billard, on carambolera jusqu’à ce qu’elle nous fasse rappeler.
— Retirez-vous avec eux, Arthur.
Les trois Messieurs et Horacine quittèrent La Férina, dite Margot, ou Marguerite pour ses amis ; celle-ci reprit sa posture sur la chaise longue et commanda à Mourette de faire entrer le montreur de plaisirs. Jacques et son monde pénétrèrent, et ne s’étonnèrent pas de ne voir que l’horizontale. La saluant sans embarras, Jacques lui dit :
— Je croyais. Madame, que nous devions traduire nos tableaux devant plusieurs personnes ? Faut-il que nous commencions, ou que nous attendions ?
— Vous pouvez commencer, j’ai tenu à être seule.
— Nous n’en serons que plus flattés et plus encouragés ; de nombreux spectateurs gênent souvent.
La Férina eut un sourire, et, réglant de suite la question de l’indiscrétion commise par la troupe, elle sortit de sa matinée trois billets de banque de cent francs, et les tendit à Jacques, en disant :
— Voilà une part supplémentaire que je vous verse, afin que vous pensiez surtout à vous, en vous rappelant plus tard votre arrivée chez moi.
Jacques les mit dans la poche de sa veste, et s’inclinant, répondit :
— Je commencerai par vous présenter mon monde, et on jouera sous vos yeux : « Amours de femmes ». Cela vous convient-il ?
— Parfaitement.
Elle s’allongea dans une pose langoureuse, pour bien voir en face cette étrange famille, et Jacques s’agenouillant saisit par le bas la jupe de Lina, qu’il découvrit jusqu’à la ceinture, et dit :
— Je vous présente notre jolie brune Lina, fruit de paradis, fruit de volupté, dont le ventre invite à l’amour, dont la toison ordonne les caresses, dont les cuisses attirent les désirs de l’homme, et dont les fesses de satin sont douces à la main et aux lèvres ! La voyez-vous assez dans sa nudité, dans sa complaisance à me laisser la peloter et la baisoter ? Elle va rester là, ainsi, sous vos yeux, vous montrant sans fausse honte bête tous ses trésors d’amour, pendant que je vous révélerai nos deux autres merveilles. Voici Léa, la timide, la chaste colombe, jeune fleur, non encore tout à fait épanouie par sa grotte non violée. Léa, la jolie fille à la chair déjà appétissante, au fin duvet, aux cuisses déjà fermes et fortes, au derrière rondelet et velouté, qu’on châtie par la fouettée ou qu’on lèche de la langue avec la même volupté. Voyez-la bien dans sa délicate luxure, à côté de Lina, et dites-moi si elles ne sont pas pour dicter les plus fougueuses passions ? Et maintenant, c’est le tour de ma belle Thérèse, l’amante et l’amant, aux nerfs de fer, au ventre éblouissant, aux poils agrippeurs de baisers, au cul splendide et solide, pour lui permettre tous les plaisirs sexuels. Sous sa blouse relevée, elle ne nous cache rien. N’est-ce pas qu’il est difficile de décerner le prix à l’une d’elles, ce qui ne serait plus, belle patronne, si vous preniez rang au milieu de leur groupe, pour former un quatuor de célestes houris ?
— Flatteur ! vous ne dites pas ce que vous pensez, sans quoi ces charmantes beautés vous arracheraient les yeux.
— Par leurs ébats, elles vous prouveront que devant leur âme, il n’existe plus que la beauté immortelle de la femme. Commençons.
Ayant prononcé, il s’assit à la turque sur ses talons, vis-à-vis la chaise longue, et à deux pas de lui s’installa de même Antoine, qui déclencha le phonographe.
Dès les premières notes musicales, Thérèse, laissant retomber sa blouse, s’avança en se dandinant avec grâce au devant de Lina, pour l’inviter aux doux jeux de l’amour. Jacques plaça debout à sa droite Léa toute troussée, en frappant du tambour de basque pour accompagner le motif exécuté par le phonographe. Il tapait tantôt avec sa main libre, tantôt avec les fesses de la jeune fille. Une lente mélopée entraînait Thérèse et Lina ; elles soulevaient leurs atours, et face à face, elles mimaient la danse du ventre, se le tendant, se le rapprochant, se le heurtant. Elles tournaient et retournaient autour l’une de l’autre, et finirent par attirer Léa dans leur jeu ; alors, les fesses et les ventres rivalisèrent de lascivités. Les mains pelotaient, les jambes se recherchaient, les doigts chatouillaient les clitoris ou s’égaraient dans la fente des culs, les lèvres se souriaient ou s’aguichaient, les baisers se distribuaient n’importe où, selon les contorsions des corps. Des accouplements se formaient, pour virer sur place dans un enlacement habile des cuisses, permettant aux cons de s’aspirer ; la luxure se développait par le maniement des étoffes, et La Férina, les yeux fixes, put voir Jacques qui bandait dur derrière son caleçon.
Elle lui sourit, en s’apercevant qu’il la contemplait ; elle lui lança des œillades en dessous, s’impatientant de ce que les trois femmes, au milieu de leurs évolutions, passassent à sa portée pour en être patouillées ou embrassées, agissant de même avec Antoine. Puis le phonographe arrivant au bout de sa plaque, les mimeuses ralentirent leurs mouvements, pour terminer par une pose paillarde très suggestive. Jacques s’apprêtait à annoncer un second numéro, mais La Férina se leva et lui dit :
— Mon cher Monsieur, je désirerais vous dire deux mots en particulier pour la continuation de vos scènes. Venez un instant dans la pièce à côté.
Le montreur de plaisirs s’empressa d’obéir, sans que son personnel s’étonnât de cette sortie, qui se produisait souvent, un spectateur ou une spectatrice ayant à indiquer une fantaisie qu’il désirait voir rendre. La porte refermée, Jacques se trouva dans un second salon un peu plus grand, plongé dans une obscurité relative par l’ameublement de couleur foncée et les épaisses tentures retombées sur les fenêtres. Il distingua cependant les yeux de La Férina qui le fixaient et brillaient comme des escarboucles. Il ne pouvait douter : il agissait sur les sens de la jeune femme. Il tendit les bras, et instantanément elle s’y jeta pour le baiser sur la poitrine, sur les pectoraux, sous les aisselles, murmurant :
— Oh, que tu es beau, et quel homme tu dois être pour avoir inventé de tels tableaux ! Veux-tu m’aimer ? Je mets à la porte mon amant, et cet imbécile d’Alexandre, que j’ai eu le tort d’écouter, et avec qui tu m’as vue ! Ô mon dieu ! te dégoûterais-je, que tu te recules ?
— Toi, me dégoûter ! Mais tu es un trésor de femme, comme il n’y en a pas de pareil ! Ma femme Thérèse, Léa, Lina, s’effacent devant ta beauté. Tout mon sang s’échauffe à te sentir palpiter contre ma poitrine. Ah ! viens vite sur ce sopha, je te montrerai l’effet que je ressens à t’admirer, à t’aimer. Je veux te faire minette, je veux dévorer tes fesses, je veux jouir de ton corps à t’emporter dans l’autre monde.
— Ah, ah, ah, rien que de t’entendre me parler, je deviens folle d’amour ! Viens, viens, fais-moi minette, mange mes fesses, prends-moi toute, toute ! Tiens, vois, je suis belle, bien faite, et pour toi je serai passionnée à te ravir le souffle !
Elle s’écroula sur un sopha, ayant rejeté sur le tapis sa matinée, ne gardant qu’une chemise courte de fine mousseline, qu’elle ramassa prestement sous son cou, pour offrir la nudité de ses chairs aux regards lubriques qui les recherchaient ; elle avait des bas à jour qui s’arrêtaient sous les genoux ; ses cuisses magnifiques offraient de puissantes blancheurs ; son minet, son ventre, ses nichons ronds et fermes se tendaient vers les lèvres de Jacques, qui s’affaissa entre ses jambes, pour fourrer la bouche à son con, à son clitoris, les couvrir de caresses, qui l’excitèrent au point de lui faire lancer les jambes en l’air et de tous côtés.
Alors il dévora vraiment le beau corps de cette femme qui s’abandonnait. Sa langue voyageait dans le vagin, pour de là se précipiter vers la fente du cul ; il la tournait et la retournait pour bien appliquer ses léchées, ses suçons sur tous les points sexuels ; elle se prêtait à toutes ses fantaisies, se pelotonnant en boule, ou s’étendant en croix, les bras et les jambes bien écartés, ou entortillant son cou de ses cuisses. Elle ne songeait plus à rien ; les baisers, les caresses qu’il lui prodiguait, l’enivraient d’une félicité ignorée jusqu’à cette heure ; la volupté les subjuguait dans une longue et langoureuse extase ; leur âme se joignait à la luxure dont ils se repaissaient ; ils erraient loin des étroites exigences de ce monde ; un bonheur inattendu les enveloppait ; il ne se hâtaient pas de se ruer aux affres du coït. Ils allaient enfin commencer l’assaut, mais un cri les arrêta au suprême moment : Thérèse, sur la porte qu’elle avait ouverte, sans qu’ils l’entendissent, s’exclamait :
— Oh ! le cochon, le cochon, il nous trompait !
Elle disparut en refermant la porte avec violence ; Jacques et La Férina, effarés, mais encore dans les bras l’un de l’autre, se regardaient, ne sachant quel parti prendre ; elle posa la bouche sur la sienne, et dit :
— Je voulais chasser tout le monde pour ton amour : laisse-les partir, et reste avec moi.
— C’est ma femme, c’est toute ma famille ; s’ils me manquent, je suis ruiné, perdu, je n’ai plus rien.
— Je te la remplacerai.
— Oh ! non, laisse-moi jouir de ton corps, et puis je les rejoindrai.
— Je ne le veux plus ; tu ne m’auras que si tu renonces à eux.
— Tu es cruelle et méchante ; on ne rompt pas ce qui est uni par le sang et par la chair, et par les intérêts comme par les espérances. Je souffrirais loin d’elle, loin de tous.
— Eh bien, va-t’en ! Je me suis trompée sur ton compte, il ne me plaît plus de te voir, adieu !
Malgré la fièvre de ses désirs, Jacques eût la force de quitter les bras de La Férina, et de retourner dans la pièce voisine. Il n’y trouva qu’Antoine, toujours assis sur les talons, causant avec Lina, debout devant lui.
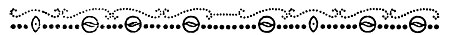
IV
— Où est Thérèse ? où est Léa ? demanda Jacques avec emportement.
— Elles se sont sauvées toutes les deux, avec un monsieur qui est entré ici, accompagné d’un des jeunes gens de tantôt.
— Vous les avez laissées partir ? Pourquoi ? qu’y a-t-il ? Pourquoi ne les avez-vous pas suivies ?
— Elles n’ont rien dit, répliqua Lina. Nous n’avons remarqué que la colère de Thérèse, quand elle eut ouvert cette porte ! Elle a pris par la main le monsieur, Léa a pris celle du jeune homme, et elles nous ont plantés là sans dire un mot.
— Mais que s’est-il donc passé, pendant que je n’étais pas là ?
— À peine fus-tu sorti, et tandis que nous causions pour tâcher de deviner ce que La Férina pouvait bien te vouloir, qu’un monsieur d’un certain âge apparut, accompagné d’un jeune homme, pas celui que nous avons vu en arrivant. Ils nous complimentèrent, en disant qu’ils avaient assisté à une grande partie de nos jeux, à travers la tenture d’une porte du fond. Cela nous importait peu. Ils se mirent à plaisanter avec nous ; le monsieur âgé complimentait beaucoup Léa, qui l’écoutait avec plaisir, et le jeune homme agissait de même avec Thérèse. Nous ne nous occupions guère de ces manœuvres, tu le sais, puisque cela amorce davantage. Je notais bien cependant qu’ils ne s’adressaient jamais à moi, et qu’ils avaient l’air de dédaigner Antoine ; ils parlaient aussi souvent tout bas à Thérèse. Celle-ci montrait de plus en plus de l’humeur, et elle ne se fâchait pas des très grandes libertés que prenait le jeune homme, lui permettant de peloter ses fesses et de les embrasser. Tout à coup elle courut vers la porte, nous l’entendîmes crier, elle revint comme une folle, et ils s’envolèrent tous les quatre. Où ils sont allés, je n’en sais rien. Nous supposions, avec Antoine, qu’ils allaient te rejoindre dans une autre pièce, et nous attendions qu’on vînt nous chercher, lorsque tu es entré.
— Elles sont parties, elles sont parties, ne cessait de répéter Jacques ! Ah, quel malheur ! Il faut fouiller tout l’appartement, les retrouver si elles sont encore ici. On s’expliquera. Va d’un côté, Antoine, moi, j’irai de l’autre.
— Oui, oui, appuya Antoine : retourne près de La Férina, elle t’apprendra peut-être quelque chose ; moi, je sortirai de ce côté-ci, par où nous sommes arrivés, et je ferai tout le tour de l’appartement.
— Lina restera avec moi, elle m’accompagnera, je ne veux pas me rencontrer seul à seul avec La Férina ; elle a dû comploter l’affaire pour se venger de ce que nous l’avons surprise.
— Tu as raison, approuva Antoine, garde Lina pour parler à cette femme, elle saura mieux le faire que toi.
Antoine jeta sur ses épaules son veston, et, emportant le phonographe, il sortit du côté par où on les avait introduits, tandis que Jacques se dirigeait avec Lina vers le salon voisin, espérant y retrouver l’horizontale.
Espoir déçu : en fait de La Férina, il ne vit que son peignoir gisant sur le tapis ; embarrassé sur la décision à prendre, il hésita à s’aventurer plus loin. Lina n’osait le conseiller. La soubrette Mourette entra à cet instant, et, les apercevant debout au milieu de la pièce, leur dit de retourner dans la chambre où se trouvaient leurs affaires, afin de se revêtir et de partir. Elle venait de remettre à l’autre comédien, de la part de M. des Gossins, le prix qui avait été convenu pour la représentation. Jacques, irrité, lui demanda ce qu’étaient devenues les deux autres femmes de la troupe, et elle répondit qu’elle n’en savait rien, que du reste elles avaient suivi M. Gressac et M. Émile, après avoir repris leur costume de ville à la hâte.
On ne pouvait insister : en somme leur toilette plus que sommaire gênait Lina et Jacques ; il se résignèrent à être ramenés dans la chambre où ils s’étaient préparés pour ce spectacle qui se terminait si mal, et ils y rejoignirent Antoine, déjà aux trois quarts rhabillé.
Évitant de se communiquer leurs observations, ils ne tardèrent pas à être prêts, et ils se retirèrent, ignorant où étaient passées Thérèse et Léa. Qui interroger ? Ils ne doutaient pas que La Férina et Arthur des Gossins refuseraient de les recevoir, de les renseigner, et causer du scandale risquait de compromettre à jamais leur chère entreprise. Ils aviseraient dehors. C’était la première fois qu’une pareille mésaventure leur arrivait.
Après un court conseil tenu dans la rue, on se rangea à l’avis de Lina, de rentrer à Asnières, où probablement on aurait des nouvelles des deux fugitives, si toutefois elles n’étaient pas revenues au bercail. Le mouvement de colère auquel avait cédé Thérèse se serait dissipé, et la raison dominant, avec Léa, ayant lâché leurs cavaliers, elles attendaient le retour de la famille au logis.
Hélas ! à Asnières, on ne fut pas plus heureux qu’à Paris. Pas de Thérèse, pas de Léa. Le montreur de plaisirs, tout déconfit, passa une maussade soirée, entre Lina et Antoine, à guetter le bruit des voitures, dans l’espérance que de l’une d’elles descendraient les deux méchantes créatures. Quoi ! pour sa petite peccadille avec La Férina, Thérèse allait-elle ruiner la combinaison voluptueuse si savamment et si habilement créée ? N’était-il pas sous-entendu qu’une certaine tolérance devait régner de part et d’autre, et se fâchait-il lorsqu’un godelureau payant bien pelotait une des trois femmes, en obtenait même quelques mignardises, pour une éjaculation externe qui ne laissait aucune trace susceptible de se transformer en marmot encombrant ?
Ses sens surexcités éprouvaient le besoin du changement : on ne pouvait se plaindre qu’il en abusât, et dans le cas présent, l’érotisme de ses désirs, éveillés par la gentillesse de La Férina, subsistant encore malgré la peine qu’il éprouvait, ne le poussait pas à la gaudriole, témoignant ainsi de l’influence exercée par sa femme sur son cœur et son esprit. Très tard, lorsqu’il se coucha, il ne voulut pas voir le tendre regard de pitié que lui décochait Lina, pour l’inviter à partager sa couche, afin de tâcher d’oublier dans ses bras, avec les joies de la volupté, l’infidèle qui le délaissait. Antoine, plus âgé et de nature moins affectueuse, se tourmentait très superficiellement de la disparition de Thérèse et de Léa, affirmant que leur absence ne se prolongerait pas au delà d’une semaine, et qu’il valait mieux attendre de leurs nouvelles que se désespérer en pure perte.
L’accident devait se produire tôt ou tard ; il se classait dans les risques de l’entreprise. Aujourd’hui il sévissait par la légèreté de Thérèse et de Léa ; demain, rien n’assurait que Lina n’imiterait pas l’espièglerie de ses cousines. De l’indulgence, et beaucoup d’indulgence, les brebis réintégreraient leur foyer, où elles se savaient aimées et chez elles. Chacun se retira pour s’enfermer dans sa chambre. Par une sage organisation de la famille, le mari et la femme possédaient leur chambre particulière, les trois femmes logeant au premier étage, les deux hommes au rez-de-chaussée. Cela permettait de vivre ses fantaisies personnelles et du moment, sans déranger des couples qui eussent couché dans un même lit, car si Thérèse s’accusait si intraitable pour La Férina, elle ne s’offusquait pas quand son mari consacrait une partie de la nuit soit à Lina, soit à Léa.
De trois jours, la maison d’Asnières ne connut une absolue tranquillité ; aucune nouvelle ne parvint des fugitives, et Jacques écrivait en vain à La Férina pour en être reçu et avoir des renseignements sur les ravisseurs de sa femme et de sa belle-sœur. Il n’en obtint aucune réponse. Lina compatissait à son chagrin ; Antoine se confinait dans le jardinage, pour lequel il nourrissait une grande passion. On ne parlait plus d’amour, on ne pensait plus à la volupté, on vivait comme des chastes, on aurait dit que les absentes avaient emporté tout l’esprit paillard de la famille.
Le quatrième jour, on reçut une lettre de Thérèse, qui sema la rage dans le cœur de Jacques. Elle écrivait de Tours qu’elle voyageait avec Léa et les deux jeunes messieurs aperçus chez cette putain de La Férina. Le monsieur mûr n’avait pas convenu longtemps à Léa, et elle l’avait remplacé par un joli garçon qui baisait à merveille. On faisait très bon ménage à quatre, toujours en noce, et Léa n’était plus du tout pucelle. On ne reviendrait jamais plus à Asnières.
À la lecture de cette lettre, Jacques parla de partir sur champ pour aller massacrer les misérables. Lina le raisonna, le calma, le câlina. Ses fluides féminins portaient, elle le comprit, elle joua des postures aguichantes. La chair agissait chez Jacques, la réserve des jours écoulés avait emmagasiné des forces viriles ; elle tressaillit de fièvre à ses mains qui se précipitaient sous ses jupes pour la peloter, elle sentit la furie érotique qui se déchaînait à la même seconde, par un effet inconnu d’électricité, chez les deux hommes. Il fallut courir à la pièce qu’on avait aménagée pour les répétitions des tableaux, et exécuter à trois la fameuse danse du ventre. Lina, à la hauteur des circonstances, s’appliqua à exciter les deux hommes l’un par l’autre : les jupes entortillées à la ceinture, les cuisses et les fesses nues, elle tourbillonnait devant Antoine, devant Jacques, approchait le ventre, le cul, en mouvements lascifs et désordonnés, pour attirer la queue la plus vaillante et l’inciter, soit à l’enfiler, soit à l’enculer. Antoine, fatigué par ses cinquante-cinq ans, ne brillait pas pour bander, mais il s’entendait à merveille dans les poses cochonnes, et savait mettre en relief les excellentes dispositions de sa femme, jouissant cérébralement de ses allures friponnes. Si Lina attendait depuis trois jours le coup de queue de Jacques, elle fut amplement dédommagée.
Au milieu des évolutions de la danse du ventre, le ventre mâle et le ventre femelle ne se quittèrent plus, la queue se faufila vers le con, à travers les cuisses qui s’écartaient, et disparut bientôt dans le vagin. Antoine, à deux genoux, soutenait de ses deux bras le corps de sa femme plaqué contre sa poitrine, et lui envoyait des coups de langue au bas des reins et sous la ceinture. Il ne broncha pas tant que Jacques n’eut pas lancé sa décharge.
C’était la reprise des voluptés ; elles se continuèrent durant la journée de cette longue séance et une partie de la nuit. Jacques reconquit son énergie et sa lucidité d’esprit.
Le lendemain, à la première heure, il prenait le train pour Paris, avec une résolution bien arrêtée. Il perdait sa femme à cause de La Férina, celle-ci lui devait une compensation. Il se présenta hardiment chez elle sur les dix heures du matin : le destin le protégeait. Le service était-il occupé en courses, ou était-il négligent, il trouva la porte de l’appartement entrebâillée, ce qui lui permit de s’introduire sans sonner.
Personne dans la galerie, pas plus que la fois précédente. Décidément, La Férina se faisait bien mal garder. Il marcha droit vers le salon où il l’avait gamahuchée ; aucun obstacle ne se dressa pour l’en empêcher ; il traversa un boudoir et se trouva subitement dans la chambre de l’horizontale.
Dormait-elle encore ? On n’avait pas donné le jour, et la lampe de nuit brûlait. Il distingua le lit, et sans hésiter, s’en approcha avec précaution. Que La Férina y fût, et il la baisait ! Il demeura bouche bée, à la vue d’une jolie paire de fesses qui s’agitaient au-dessus d’un corps. Pas possible de douter, le joli duo d’amour s’exécutait sous ses yeux, et la manœuvre plaisait au couple qui ne portait aucune attention à son arrivée.
Jacques reconnut bientôt que La Férina, couchée sur le dos, ouvrait les cuisses au godemiché que maniait de fort experte façon sa belle amie, Horacine des Tilleuls, propriétaire de la superbe paire de fesses qu’il voyait évoluer. Oh ! ces fesses, elles se soulevaient avec méthode, se roulaient, se rabaissaient, se serraient pour imprimer un léger coup des reins, et les deux ventres féminins, se rejoignant, frissonnaient en un doux clapotement des chairs.
Le montreur de plaisirs n’apportait aucune mauvaise grâce à constater que, pour avoir dirigé souvent cette fantaisie entre son ingrate moitié et la gentille Lina, on la vivait ici dans toutes les conditions de postures aguichantes, propres à raviver la fureur de ses sens, si elle se fût éteinte. Cette gaillarde d’Horacine accusait un développement idéal de hanches, et il brûlait du désir d’appliquer une douzaine de gros baisers gloutons sur chacune, non seulement pour témoigner qu’il ne jalousait pas l’excellent travail auquel il assistait en intrus, mais encore pour encourager à le bien continuer.
Le godemiché s’enfonçait avec lenteur dans le con, et en ressortait de même, sur le retrait en arrière du beau cul d’Horacine, qui poursuivait ainsi un habile chatouillement du vagin, tout en branlant d’un doigt savant le clitoris de son amie. Les deux femmes luxuraient sans échanger un mot, certainement très intéressées à fonctionner de leur mieux dans la félicité qu’elles recherchaient. Jacques, toujours très attentif, apercevait de temps en temps les bras de La Férina, qui s’enroulaient à la taille d’Horacine, sur la ceinture qui retenait le godemiché, sans doute pour l’engager à appuyer plus ou moins fortement ; il s’échauffait de plus en plus à contempler un si suggestif tableau, il bandait sous la fièvre du désir, il ne sut observer plus longtemps l’immobilité absolue qu’exigeait son irruption inattendue dans l’appartement, et il poussa un soupir, qui fit retourner la tête à Horacine.
Celle-ci le vit et bondit à bas du lit, en proie à une folle colère ; La Férina la suivit, et les deux femmes lancèrent des regards très courroucés au montreur de plaisirs, qui balbutia :
— Ne vous fâchez pas, attendez que je vous explique…
— Que faites-vous ici, vous ? clama La Férina, lui coupant la parole ; qui vous a permis d’entrer dans ma chambre ?
— Pardonnez-moi, Madame, je ne voulais pas vous déranger, vous troubler ; le souvenir de votre bienveillance de l’autre jour…
— Ah oui, ma bienveillance ! Parlons-en, elle m’a bien servie ! Elle est cause que je suis brouillée avec mon amant Arthur des Gossins et que votre sale femme m’a enlevé mon petit amoureux, Alexandre Brollé. Tout ça ne m’apprend pas comment vous vous trouvez dans ma chambre ! On ne s’introduit pas ainsi chez les gens ! Je vais sonner pour qu’on vous emmène chez le commissaire de police. Vous veniez pour me voler, pour m’assassiner peut-être !
— Moi ! moi !
— Sait-on qui vous êtes, avec le métier que vous faites ? Vous m’avez déjà assez porté malheur, pour que je me défie de votre présence dans ma chambre.
Jacques n’avait pas le beau rôle ; Horacine se débarrassait rapidement de son godemiché, passait une chemise de nuit, posée sur un fauteuil, au pied du lit. La Férina leva le bras pour presser le bouton électrique ; il retint sa main, et murmura :
— Ne soyez pas méchante ; est-ce ma faute si tout cela est arrivé ? Dites-moi où je puis retrouver ma femme, et vous reprendrez votre amoureux, si vous y tenez. C’est la première fois que je suis victime d’un tel désagrément. Moi, dans les scènes où mes femmes se montrent, je ne cherche qu’une chose, être agréable aux autres, aux vrais viveurs, en gagnant largement mon existence, et il est bien laid, bien déshonnête, qu’on m’ait enlevé ma femme et ma belle-sœur. Chacun s’arrange comme il peut pour manger son pain, lorsqu’on n’a pas la chance de naître d’un papa ayant le sac. Vous avez été bonne et j’espère que vous le serez encore : vos exploiteurs sont les miens, il convient de ne pas nous nuire mutuellement. Pourquoi sonner vos domestiques ? Pourquoi m’accuser de vous vouloir du mal, alors qu’au contraire… mais ça suffit.
— Vous avez été trop curieux, intervint Horacine.
— Eh, Madame, ne l’auriez-vous pas été à ma place ? Supposez-vous qu’un homme ne resterait pas ému devant… ce que vous affichiez ! Songez que ce joli jeu auquel vous vous livriez avec votre amie, bien des fois je l’encourageais entre ma femme et ma cousine. Ah ! on s’aimait bien dans notre cambuse ; on rigolait de la… farce avec les autres.
Il eut une larme à l’œil ; mais la détente survenait, les deux femmes trahissaient moins d’emportement, bien mieux elles paraissaient s’intéresser à ses paroles, il comprit qu’il pouvait se risquer, et il murmura :
— Le jeu vous eût été bien plus agréable, si vous l’aviez pratiqué d’après notre expérience. Ainsi, par exemple, tandis que vous baisiez votre amie avec le godemiché, croyez-vous que vous n’auriez pas mieux joui, si j’étais intervenu pour vous planter ce joli petit oiseau dans le trou du cul ? Avouez qu’il se présente mieux que votre imitation en caoutchouc ?
— Il fallait l’essayer, grand nigaud.
— L’occasion est-elle perdue ?
— Tout à fait, répliqua sèchement La Férina. Je ne sonnerai pas, mais vous allez vous retirer tout de suite. Je ne puis pas vous donner des nouvelles de votre femme ; mais rendez-vous chez M. Gressac, rue de Longchamps, c’est avec lui qu’elle est partie d’ici, et il doit être furieux qu’on l’ait plaqué. Il vous aidera peut-être. Maintenant, filez, je ne veux pas vous voir davantage. Je suis meilleure que je ne le devrais.
— Non, non, vous êtes cruelle.
— Filez, et ne me parlez pas. Je suis très vindicative. Allez-vous en, je ne veux rien savoir. En somme, je vous rends service, et j’avais juré de vous faire le plus de mal que je pourrais.
Il eut beau prier, supplier, il n’en obtint rien de plus.

V
Gaston Gressac, coureur de femmes malgré ses quarante-cinq ans, et son épouse Annette, belle et opulente brune de trente-huit ans, habitaient un pavillon rue de Longchamps, pas loin des fortifications. Que faisait-il ? Quels moyens d’existence avait-il ? On ne pouvait préciser d’une façon certaine, mais les intimes assuraient qu’il gagnait beaucoup d’argent à commanditer des cafés et des brasseries, des bars et des débits de vin, même des établissements interlopes, où l’on était servi par des filles, notoirement peu vêtues.
Il vivait dans son pavillon, en bon et honnête bourgeois, avec sa femme et une jeune nièce de treize ans, la blondinette Pauline Turlu, portant encore des jupes courtes exagérées, des bas de couleur très voyante, coiffée de deux nattes pendant sur le dos, petite et gentillette figure, hardie et timide, innocente et perverse. Une seule cuisinière s’occupait du service de la maison, et lorsqu’elle vaquait aux achats du marché, la jeune Pauline était déléguée aux importantes fonctions de concierge. C’est ainsi qu’elle tira le cordon à Jacques, arrivant chez Gressac, sur le conseil de La Férina. Elle répondit à sa demande que son oncle était sorti, et qu’il ne rentrerait pas avant une bonne heure, que sa tante achevait de s’habiller dans sa chambre, et que s’il voulait la voir, il n’avait qu’à attendre un moment dans le salon. Sur son désir de causer avec Mme Gressac, elle l’y fit entrer, et s’assit sur une chaise, pour lui tenir compagnie, vis-à-vis du fauteuil qu’elle lui avait avancé.
Un silence un peu embarrassé régna, et Jacques se sentit tout à coup ému sous les regards polissons et sournois que lui adressait la fillette. Il ne pouvait se le dissimuler, la vicieuse enfant lui faisait des avances, avec sa robe arrangée sur ses genoux découverts, ses jambes écartées et montrant l’ouverture du pantalon, et un petit sourire cynique qui se dessinait sur les lèvres. Dans quelle maison se trouvait-il ?
Bah ! il ne lui appartenait pas de s’étonner ; il allongea une jambe, qui heurta le pied de la fillette. Il la regardait, elle n’hésita pas à se lever et à venir s’asseoir sur ses genoux, qu’il désignait de la tête. De quel vertige devenait-il la victime ? Il palpait les jeunes mollets de la petite, qui lui laissait la jambe dans la main ; il bandait, alors qu’il se jugeait blasé par les jeux paillards exécutés avec ses femmes ; il glissa la main à travers le pantalon ouvert, Pauline écartait les cuisses autant qu’elle le pouvait ; il toucha son conin, et constata que l’enfant n’avait pas encore de poils au bas-ventre.
C’était donc bien une fillette impubère qui le poussait à la luxure, et cette impuberté, loin de lui répugner, le chatouillait dans ses instincts obscènes. Il voulut voir de près ; il la souleva et la plaça debout sur un fauteuil ; elle allait au devant de ses désirs, se retroussant mignardement, elle écartait les bords de son pantalon, et debout, étalait à hauteur de ses yeux, son ventre pas encore très développé, mais déjà muni d’un petit bouton de vice, trahissant la soif perverse de l’enfant. Il approcha la tête et baisa la place où serait plus tard le minet ; il envoya une langue entre les cuisses, et elle se tourna d’elle-même pour lui livrer son cul, rond et dodu, témoignant plus de la femme que le reste. Quel charme l’attirait vers ce fruit vert ?
Il ne le recherchait pas, il agissait sous une impulsion instantanée, contre laquelle il est impossible de se débattre. Il était un homme à femmes, un homme de plaisirs charnels, il pensait que ses goûts de dépravation ne dépasseraient jamais la jeune maturité vierge de sa belle-sœur Léa ; il ne supposait pas qu’un fétu de femme parlerait à ses sens, et aujourd’hui, là, dans ce salon, il subissait davantage l’influence de la fillette qu’il n’imposait la sienne.
Il existe des natures lascives, contre lesquelles on ne peut songer à se défendre ; ces natures commencent à jeter leurs fluides agrippeurs de luxure dès la plus tendre enfance. Il faut le crier bien fort, pour les magistrats des temps futurs : la chair est au-dessus des lois et des institutions, et, si la masse humaine grouille sous la peur du gendarme, ou encore de l’enfer, on rencontre des êtres qui sont prédestinés, malgré lois et institutions, à renverser les esprits les plus réfractaires à la volupté, par leur propre saveur physique ou par la finesse de leurs attirances libertines.
Jacques n’appartenait pas à ces hordes de vagabonds, sans feu ni lieu, errant sur les routes de province, qui, talonnés par la fureur sexuelle, se ruent sur la fille ou la femme passant à leur portée. Il aimait la volupté, et la pratiquait sans remords ni préjugés ; il ne manquait ni de femmes, ni d’occasions ; il pouvait se considérer comme à l’abri de toute défaillance anormale ; eh bien, il n’échappait pas au joug lascif de cette enfant, aux membres encore étriqués, ne possédant de son sexe que des organes encore imparfaits.
Elle se tenait debout sur le fauteuil, dans une pose très habile, et s’amusait de ses jupes courtes pour en frotter la figure de son compagnon, et le provoquer à tous les attouchements les plus illicites. Pelotant jambes et fesses de la morveuse, Jacques essayait d’en appeler à la stupidité de l’œuvre qu’il poursuivait, l’enfant esquissait un mouvement de recul ou d’avancement, il la happait et s’exaspérait de plus en plus dans ses nerfs.
Il la remit sur ses genoux, à cheval face à lui ; aucune puissance humaine ne l’eût arraché à l’exaltation qui le gagnait ; il ne savait plus où il était, le sperme roulait par ses veines, des pieds au cerveau, dans les reins, les cuisses, les couilles, jetant comme des buées sur ses yeux, sur son esprit.
Il déboutonna sa culotte par-dessous les jupes courtes de la fillette ; de suite, celle-ci expédia la main vers sa queue, s’en empara, la pressa entre ses doigts avec des mines de chatte ronronnante. Elle le masturbait, et tendait le ventre vers le gland, dans l’intuition qu’un jour il recevrait à l’intérieur ce qui allait le souiller à l’extérieur. Oh ! elle ne trahissait aucune ignorance du résultat qui se produirait ; de temps en temps d’une légère pincée sur l’extrémité, elle semblait vérifier si une humidité quelconque se révélait.
Il s’abandonnait à sa manœuvre, aspirant à la prompte solution qui le délivrerait de l’absorption intellectuelle qu’elle exerçait sur lui. Et la sensation fougueuse, tantôt prête à s’éprouver dans le jet violent du sperme, tantôt s’alanguissant sous un reflux de sang protestant contre un tel duo, sous la rage qui le saisissait, il se demandait s’il ne renverserait pas l’imprudente, s’il ne la violerait pas, s’il ne la tuerait peut-être pas.
La petite main marchait, marchait ; elle serrait le gland, elle enveloppait toute la queue, elle s’égarait sous les couilles pour les chatouiller, les secouer, et tout à coup le foutre jaillit, giclant à tort et à travers, maculant le pantalon, la chemise, la chair de l’enfant.
Alors, elle se cacha la tête contre sa poitrine, et y demeura quelques secondes immobile. Il n’osait pas remuer, craignant de s’être éclaboussé lui-même, étudiant le moyen de s’enfuir, s’effrayant à l’idée qu’il ne passerait pas inaperçu dans la rue, se jugeant perdu, sur le point d’être arrêté par le premier agent qu’il heurterait. Puis la petite se leva avec un sang-froid inouï, lui fit signe de la suivre pour se nettoyer les taches légères qui, en effet, se voyaient sur le bord de sa culotte. Il tremblait comme une feuille ; en silence, elle le mena à la cuisine, et avec une agilité de jeune femme, elle sut prestement effacer toute trace de jouissance. Elle agit de même pour elle, et toute fière, lui dit :
— On s’est bien amusé, n’est-ce pas ? Il ne faut pas le rapporter à personne.
— Cela vous arrive-t-il souvent ?
— Oh ! non ! c’est la seconde fois depuis que je suis chez mon oncle.
— Vous n’avez pas essayé avec d’autres ?
— L’occasion ne se présente pas tous les jours, et il faut qu’on me convienne.
Il s’inclina, et d’un ton railleur, il murmura :
— Je vous ai donc convenu ?
— Pas tout de suite. J’avais peur de votre air fâché ; mais j’ai bien vite vu que vous ne demandiez pas mieux et c’est pour ça que je vous ai montré toute ma jambe.
— Et si, par hasard, vous aviez continué d’avoir peur ?
— J’aurais été prévenir ma tante de votre visite. Elle ne sait pas que vous êtes là ; elle admire tant toutes ses toilettes, qu’elle n’entend rien de ce qui se passe dans la maison. Ah ! je vous le garantis, lorsque nous sommes toutes les deux seules, s’il me plaisait de mettre le feu, elle brûlerait sans s’en douter.
— Et maintenant, m’annoncerez vous ?
Elle le regarda avec malice, et répondit :
— Oui. Vous n’êtes pas comme l’autre Monsieur qui, après m’avoir mouillé le devant, a voulu me mouiller le derrière.
— Il faut garder les bonnes choses pour les déguster en plusieurs séances.
— On se reverra donc ?
— Et pourquoi pas ?
— Ah ! vous êtes gentil ! Je vais trouver ma tante, mais laissez-moi faire une caresse sur votre machinette ; vous ne me l’avez pas demandé, et l’autre Monsieur me l’a mise dans la bouche ; c’était bien amusant et bien drôle.
— Vous le voyez souvent, cet autre Monsieur ?
— Pas, presque pas, il habite la campagne.

VI
De sa courte entrevue, avec Annette Gressac, Jacques emporta une grande espérance. Elle le reçut très sympathiquement en demi-toilette, sur sa carte que lui porta Pauline, et lui témoigna combien elle était heureuse de le connaître, tout en s’étonnant que cette connaissance eût tardé si longtemps à se faire.
Elle avait entendu parler de ses tableaux vivants, elle brûlait de les voir, et savait l’ennui qu’il éprouvait de la disparition de sa femme et de sa **belle-sœur. Ennui réparable, parce que d’après les rapports qui lui parvenaient, il ne se passerait pas trois jours avant qu’il ne se retrouvât en leur présence.
Elle l’engagea à aller le lendemain dans la soirée au Café des Pommes, avenue Matignon, et à donner sa carte au garçon qui le servirait. On l’introduirait dans une partie réservée de l’établissement, où fréquentaient de nombreux luxurieux de Paris, et où il apprendrait du nouveau. Surtout qu’il y vienne en compagnie d’Antoine et Lina Gorgon, lesquels lui seraient probablement très utiles. Elle lui recommanda de se défier de La Férina, une femme dangereuse, qui soufflait les maris à leurs épouses, les amants à leurs maîtresses, et les femmes à tous les hommes, sous son apparence de tristesse mélancolique. Il l’avait du reste jugée ; pour s’être rendu chez cette courtisane, il courait le risque de perdre sa femme et sa belle-sœur. Elle savait s’y prendre de toutes les façons pour arriver au but qu’elle se proposait, et qui souvent apparaissait le contraire de celui qu’elle poursuivait.
— Dans les jolies choses de l’amour, lui dit-elle, il y a deux points de vue à observer. Il faut tenir compte de ceux qui s’entêtent dans les idées du vieux temps et avec lesquels il n’y a rien à espérer ; et il ne faut s’occuper que de ceux qui, assoiffés d’imprévu, cherchent à élargir le champ des voluptés. Parmi ces derniers, les seuls intéressants, il s’agit de cataloguer les riches et les intelligents ambitieux.
Le plaisir, sans le cadre luxueux et luxurieux, est le plaisir des brutes. Les intelligents savent ce que peut donner le cadre luxueux, les riches l’ignorent. Le terrain d’entente entre riches et intelligents se présente dans l’émancipation des idées. Malheureusement, les cocottes de l’époque bataillent individuellement et sottement. Elles s’exposent à rester les dupes des intrigants habiles. Lui, le montreur de plaisirs, il avait trouvé une formule précieuse dans l’exposition de ses tableaux de luxure. Sans doute, avant, on s’occupa des voyeurs, mais il y avait un abîme entre le passé et le présent tel qu’il le comprenait. Pour bien réussir, il ne devait pas pactiser avec des femmes comme La Férina, qui ne songeaient qu’à leur intérêt et à leur plaisir personnels.
Malgré tout ce discours d’Annette Gressac, malgré le chagrin de sa mésaventure conjugale, il pensait beaucoup à cette femme, dont il admirait l’éclat des chairs et la rectitude des formes, ainsi que la chaleur passionnée qu’elle lui marqua. Rentré à Asnières, ayant mis au courant de ses démarches Antoine et Lina, sans parler de l’incident Pauline, il rêvait plus à La Férina qu’à Thérèse et à Léa. Néanmoins, comme elles représentaient le succès de son entreprise, il ne manqua pas d’aller au Café des Pommes.
À Paris tout existe, tout se trouve. Sur la carte qu’il remit au garçon, et que celui-ci porta à qui de droit, on le fit passer, avec Antoine et Lina, par une petite porte, monter un étroit escalier, et au premier étage, il entra dans une vaste galerie, longue salle de café, avec des tables carrées entourées de fauteuils, le parquet couvert de tapis, les murs ornés de grandes glaces, sauf sur un côté, où par trois marches, on pénétrait dans deux salons contigus, convertis en salles de jeux, l’une avec une roulette, l’autre avec une table pour le baccarat.
Dans la salle de café, peu remplie encore, divers groupes, composés en majorité de femmes, se trouvaient disséminés. Jacques se dirigea droit vers une extrémité, où il apercevait deux tables libres, et près de celle qu’il se disposait à occuper, il vit deux jeunes hommes et deux jeunes femmes, consommant du champagne dans une posture très hardie ; du reste la liberté la plus absolue régnait partout. Une des deux femmes avait les jambes sur les épaules de son cavalier, qui la branlait avec hardiesse, les jupes ramassées sur la ceinture. pour qu’on ne doutât pas de ce qu’il faisait : et, dans cette femme Jacques reconnut sa chère épouse Thérèse Phoncinot ; l’autre, plus calme, quoique installée sur les genoux de son compagnon, était sa belle-sœur Léa Dorial.
Lina eut juste le temps de s’interposer pour l’empêcher de se précipiter sur les deux couples et de frapper brutalement. Aidée d’Antoine, elle le poussa sur un fauteuil, et s’assit entre lui et Thérèse, à qui elle faisait un rempart de son corps, et qui, sans se troubler, regardait avec insolence son mari, comme pour le défier. À voix basse, Lina murmura au montreur de plaisirs :
— Sois raisonnable, aie de la patience, cela vaudra mieux que du tapage. Ce n’est pas pour causer du scandale que la Gressac t’a prié de venir ici.
Il posa les mains sur son visage, prit ensuite son mouchoir, essuya la transpiration que la colère contenue attirait à son front, appuya les deux coudes sur la table, réfléchissant à cette rencontre inattendue, et ne répondit rien à la provocation de sa femme, criant :
— Ah ! elle est trop forte, celle-là. Il tire parti de notre corps, et il ne voudrait pas que nous en disposions à notre fantaisie !
Léa Dorial était toute pâle, et ses yeux non courroucés semblaient implorer Jacques, qui ne retirait pas la tête de dessous ses mains, afin qu’il demeurât tranquille.
En ce moment, comme si le ciel eût préparé une compensation aux sentiments complexes qui bouleversaient l’âme de ce mari, La Férina survint, accompagnée d’Horacine des Tilleuls, toutes les deux en élégante toilette noire ornée de dentelles, avec sur la tête un grand chapeau à larges ailes. Devina-t-elle le drame intime qui se jouait ? Elle s’approcha de Jacques, lui toucha la tête de la main, et très gracieuse, lui dit :
— Ah, que je suis heureuse de vous voir ; je vous ai aperçu en entrant, et je suis venue tout de suite à vous.
Il faillit pousser un rugissement de joie ; il prit les deux mains de la jeune femme, les baisa avec transport et répondit :
— Oh, c’est le Paradis qui arrive avec vous !
— Ça, c’est mignon, et ça mérite qu’on accorde toutes les permissions.
Elle toisait Thérèse, qui retirait les jambes de dessus les épaules de son cavalier, et se penchant sur Jacques, elle lui embrassa le cou, en ajoutant :
— Tu sais, tu peux me peloter et me caresser, ici tout est autorisé.
Jacques, sur le champ, expédia les mains sous les jupes de l’horizontale, remarquant que sous la robe, il n’y avait qu’un jupon et la chemise ; il lui saisit les fesses, et la voyant qui se retroussait, il se baissa pour embrasser les cuisses qu’avec cynisme elle montrait.
Si certains s’étonnent de ces libertés, nous les prierons d’aller examiner les rapports de police, soigneusement verrouillés dans les cartons de la préfecture, et mentionnant les nombreux attentats aux mœurs qui se perpétraient sous les massifs des Champs-Élysées, et sur les bancs de ladite promenade. On a pourchassé les amateurs des deux sexes, et de toutes les conditions sociales, qui fréquentaient ces parages pour y découvrir des fervents de la paillardise ; il faut bien fermer les yeux sur les immeubles respectables où ils se sont réfugiés, et où, évitant avec soin le scandale public, ils se livrent à l’orgie de la chair.
Rien n’était gracieux comme La Férina, les atours retroussés, étalant aux regards curieux le modelé de ses jambes, le contour de ses hanches, les rondeurs de ses fesses, son bas-ventre orné d’un joli petit chat blond. Jacques avait embrassé avec discrétion, il embrassait avec passion, résistant mal à la tentation de s’agenouiller devant la déesse.
— Bravo, mes agneaux, s’exclama Horacine, ne vous gênez pas, allez-y de vos bonnes lippettes ; je m’installe de ce côté-ci, assieds-toi près de ce beau garçon, Margot, je suis sûre qu’il ne te ménagera ni les minettes, ni les feuilles de rose.
— Tout, tout ce qu’il voudra, dit La Férina.
Un fauteuil long et large se trouvait près de la place occupée par Jacques. La Férina s’y laissa tomber, jupes relevées, et immédiatement, le montreur de plaisirs, comme une bête fauve, se précipita à ses pieds, fourra la tête entre ses cuisses. Ah ! les ardentes minettes dont il honorait le gentil con, et comme on comprenait la ferveur que celui-ci inspirait ! Cette chair blanche, qui ressortait sous le cadre noir de la robe, éveillait les idées libertines des voisins les plus proches ; le corps féminin, qui se tordait dans les délices des caresses, ondulait avec grâce et étalait ses sexualités alléchantes. La Férina se soulevait, découvrait ses fesses, et la langue de Jacques s’y ruait, passant des minettes aux feuilles de rose, selon le pronostic d’Horacine. On entendait le gourmand gloussement avec lequel il savourait le satiné de la peau, on admirait les gestes de luxure de La Férina, trahissant le plaisir qu’elle éprouvait à la langue qui lui chatouillait le clitoris, ou s’égarait dans la fente rosée de son cul.
Tout d’abord, Thérèse sembla vouloir se désintéresser de ce spectacle ; elle s’assit sur les genoux de son galant, tira la queue hors de sa culotte pour la masturber, ou peut-être même l’exciter à l’enconner. Elle multipliait ses agaceries, surtout si son mari levait un instant la tête pour surveiller ses actions. L’attirance de La Férina s’exerçait si despotiquement, qu’il repartait sans hésiter dans ses caresses. Puis cette indifférence qu’il affichait à son sujet commença à froisser Thérèse ; malgré elle, son attention demeurait figée sur son mari, dont elle suivait avec un dépit de moins en moins dissimulé les coups de langue sur le con et sur le cul de La Férina.
Son cavalier lui-même, Alexandre Brollé, répondait avec mollesse à ses provocations ; ses yeux brillants ne quittaient plus la maîtresse qu’il avait perdue, et ne cachaient pas le regret qui tracassait son esprit ; il contemplait avec colère la pose abandonnée dans laquelle elle allongeait peu à peu tout son corps sur le siège du fauteuil, pour mieux le livrer aux dévotions de Jacques. Elle dévoilait toute sa croupe éblouissante, elle se montrait nue de la ceinture aux genoux, le visage du caresseur s’appliquait en plein sur les fesses, et ce fût la façon gloutonne dont il lui mangeait le cul, qui arracha un cri de rage à Thérèse, la fit se dresser de dessus les genoux d’Alexandre, courir vers son mari qu’elle tambourina à grands coups de pied dans le postérieur, tandis que, se penchant, elle administrait une maîtresse fouettée à La Férina, se débattant en vain pour échapper à sa furie. Jacques, surpris, étendu sur le sol, piétiné par sa femme, juchée au-dessus, cherchait à l’attraper par les jambes pour la repousser. Les jambes de Thérèse étaient dures et solides comme du fer, tant la fureur la surexcitait. Elle ne reculait pas, et continuait à frapper de claques retentissantes le beau derrière de La Férina. Horacine se précipita pour la lui arracher des mains ; elle en reçut une bourrade en pleine poitrine qui la renvoya à deux pas plus loin. Jacques, sur les genoux, saisit Thérèse à bras le corps par-dessous les jupes pour l’attirer en arrière. Elle se retroussa avec prestesse, remonta les jupes sur ses reins, et montrant son cul, lui dit :
— Tiens, lèche celui-là, puisque tu en désires un, au moins ce sera celui que t’a donné M. le Maire.
Allait-il mordre ? Allait-il embrasser ? Il hésitait entre les deux ; son désir luttait entre la Férina et sa femme, mais son intérêt se trouvant du côté de celle-ci, il comprit que s’il obéissait, il la reconquerrait, et qu’il la ramènerait ensuite au bercail. Il se décida à baiser le cul de Thérèse. Alors elle cessa de fouetter La Férina, l’obligea à se lever, et lui montrant son mari, dit :
— Regarde cet homme ; il te léchait le cul tout à l’heure, à présent il en a au mien. Mais c’est mon mari, et je le garde.
Dans les salles de jeu, on avait colporté la nouvelle de la correction : un afflux de monde envahissait la galerie. Au devant de ce monde, accourait Annette Gressac, se doutant bien de ce qu’il en était. Elle vit la querelle apaisée, elle toucha l’épaule de Jacques, toujours occupé après les fesses de sa femme, et lui dit :
— Que faites-vous là ?
— J’ai retrouvé ma femme, j’en profite.
— Bravo, je vous approuve, mais vous avez le temps d’en profiter. Venez avec moi tous les deux, j’ai à vous causer.
Antoine, Lina, Léa, les entourèrent en disant :
— Nous aussi, nous les suivrons, nous ne voulons plus nous séparer.
— Oui, oui, venez tous.
La Férina, debout et digne, s’empara de la main de Jacques qui passait près d’elle, et lui dit :
— Vous savez, cher ami, je comprends les obligations du mariage, mais moi, si je ne vous appartiens pas avec l’autorisation de M. le Maire, je coucherai avec vous quand ça vous plaira. Vous n’avez qu’à m’écrire un mot pour me donner un rendez-vous, ou à venir me voir et ça y sera. Je vous promets que vous serez content.
— Chameau ! lança Thérèse, esquissant un mouvement pour lui sauter à la gorge.
Annette put la retenir par le bras, et réussit à l’entraîner. Horacine, à la même minute, présentait à la Férina un monsieur, M. Bertrand Lagneux, qui désirait vivement la connaître, et elle l’accueillait avec le plus charmant des sourires, malgré le regard prometteur qu’en dessous lui décochait Jacques.

VII
Annette Gressac circulait comme une reine à travers les deux salles de jeu, menant à sa suite le montreur de plaisirs et sa smalah reconstituée. Sous une magnifique toilette décolletée de satin rouge, elle offrait un autre type de beauté, tout aussi séduisant que celui des jeunes femmes installées aux tables de jeu, ou égarées dans la galerie pour varier leurs émotions entre le dieu Mercure et la déesse Vénus. De nombreux regards s’attachaient avec des lueurs concupiscentes sur ses épaules, cherchaient à s’élancer sur le globe des seins, ou sur le relief des hanches. Elle souriait et se prêtait volontiers à ces polissonneries cachées. Elle conduisit son monde dans un petit salon réservé, où les ayant invités à s’asseoir, elle leur révéla le but de leur entrevue.
D’accord avec son mari Gaston Gressac, elle avait organisé cette maison de passe et de jeu, où l’on pouvait trouver à se satisfaire dans toutes ses passions. Elle acceptait même des clients qui préféraient l’ivresse des boissons aux émotions de la chair et du jeu, et qu’on laissait se griser abominablement, pour les emporter dans un dortoir où ils dormaient tant qu’ils le voulaient, dès qu’ils commençaient à devenir gênants. Ceux-là représentaient l’exception.
Les salles de jeu alimentaient en général la galerie aux voluptés, et réciproquement celle-ci alimentait les salles de jeu. Quand on avait bien cochonné, on abordait la roulette ou le baccarat pour retaper sa bourse, et quand on avait gagné on cherchait quelque vaillant et savant compère, ou commère, pour bien terminer sa nuit.
Ayant entendu parler, par son mari, des tableaux voluptueux qu’ils exécutaient, elle leur proposait de les mimer sur un tréteau qu’on établirait dans la galerie. Ils seraient certainement imités par nombre de spectateurs et de spectatrices, et les bénéfices de l’entreprise augmentant, ils toucheraient des cachets plus importants que dans les salons particuliers où ils opéraient, forcément très limités. Qui sait s’ils ne rencontreraient pas des amateurs dans le public qui les applaudirait ?
Cette proposition délicate les embarrassa tous au même degré. Devant un public restreint, avancèrent-ils, ils se sentaient en sûreté, protégés par la paillardise de qui les payait ; devant un public aggloméré, comme dans un théâtre, ils redoutaient des moqueries, des avanies, des insultes, et peut-être même des violences.
— Vous n’avez rien à craindre de ceux qui fréquentent ici, s’écria Annette. Ce sont tous gens très indépendants d’esprit, et de mœurs très commodes. Il y a des hommes qui courent après d’autres hommes, et des femmes qui tiennent à honneur de s’afficher avec le godemiché sur le ventre.
En principe, on ne repoussait pas la proposition ; on demanda seulement deux à trois jours de réflexion, et Annette Gressac les accorda. Ce débat ramena la paix entre les époux. Jacques et Thérèse, discutant avec Annette, se retrouvaient dans leur union d’affection et d’intérêts, ils souhaitèrent de retourner à Asnières pour sceller leur réconciliation et oublier les causes qui les séparèrent. Ce souhait comblait trop le désir de tous les autres membres de la famille pour qu’on ne s’y ralliât pas.
Dans le cœur de ceux qui étaient restés, luisait la pensée de fêter le retour des deux fugitives ; le mari et la femme feraient leur paix définitive, la tête sur l’oreiller. Sur un simple regard on se jugea d’accord et on s’évada. Jacques et Thérèse se retirèrent ensemble presque de suite ; ils trahissaient par leurs regards devenus très tendres leur bonne volonté d’accomplir le devoir conjugal. Léa s’attarda avec Antoine et Lina ; elle voulait prouver au vieux cousin que si elle n’était plus pucelle, elle ne lui refuserait pas plus qu’autrefois la satisfaction de ses goûts cochons ; elle le mignarda avec tant de gentillesse qu’il se trouva en état de la baiser, ce qui lui arrivait rarement ; il est vrai qu’ils débutèrent par un délicat soixante-neuf, où Lina s’amusait à les éventer pour les maintenir en haleine.
Oh, dans cette admirable famille, on était bien tous les uns pour les autres, et il eut été très malheureux que le trouble subsistât entre ses membres. Mais l’œuvre la plus importante de la paix conclue s’accomplissait dans la chambre de Thérèse, où Jacques avait suivi sa femme.
Ils ne furent pas plus tôt seuls, qu’ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre, pour se supplier réciproquement de se pardonner leurs fautes. Touchant ménage, ils recoururent à la plus franche des confessions pour chasser tout nuage de leur ciel. Les mains de Jacques, tout en parlant, dégrafaient le corsage de Thérèse, dénouaient les cordons de la robe et des jupons, et de son côté, se laissant faire, elle lui déboutonnait sa culotte, prenait sa queue dans la main, lui tendait la bouche pour se pigeonner au milieu de ces premiers attouchements érotiques. Puis, prestement en chemise, prestement nus, ils s’agrippèrent ventre à ventre, échangeant leurs confidences, où il avouait n’avoir encore couvert que de minettes et de feuilles de rose La Férina, tandis qu’elle confessait, la vilaine méchante, avoir été baisée par les deux amis, Alexandre Brollé et Émile Sauton, sans oublier l’excellent mari de la belle Annette, Gaston Gressac, qui se contenta d’enfoncer la pine dans son con, après avoir enculé Léa.
De se raconter les obscénités qu’ils rêvèrent et exécutèrent, en dehors de leurs liens matrimoniaux, cela les émoustillait, et Jacques recommençait sur le corps de sa femme les dévotions prodiguées au corps de La Férina ; sa langue courait sur le clitoris, pénétrait dans le vagin, voltigeait sur le chat, soulevait les cuisses, s’égarait entre les fesses, revenait vers les seins, et déclarait ne pas se lasser de ce ravissant pèlerinage. Thérèse rendait au centuple les politesses qu’elle recevait ; elle attrapait la queue entre ses lèvres, l’attirait dans sa bouche, la croquignollait avec délices, la suçait très adroitement et embrasait les sens de son mari d’un feu inextinguible.
Ils ne s’arrêtaient plus dans leurs ardentes caresses, et tous les deux se pelotaient avec la même fièvre. Le sperme bouillonnait dans les veines de Jacques, il ne pouvait plus différer l’enconnage ; Thérèse s’y prêta à sa première attaque, et la queue s’engouffrant dans son vagin, elle répondit aux secousses de son mari, déchargeant, jouissant. La paix était bien faite. Par trois fois ils renouvelèrent cette suprême extase, et Jacques déclara que sa Thérèse demeurait indispensable à ses ivresses charnelles, lesquelles perdaient tout charme, loin de ses tendres regards, même en les éprouvant avec Lina ou Léa, ses pâles reflets.
Reconquérant son mari, sentant qu’il parlait en toute sincérité dans cette minute où elle l’enivrait de sa possession, elle eut le tort de vouloir souligner sa victoire, en lui rappelant que lorsqu’il fit minette pour la première fois à La Férina, elle venait justement d’être enfilée par Alexandre Brollé, à qui Horacine avait ménagé cette douce entrevue ; elle supposait du reste que cette femme lui servait de maquerelle, et appuyant sur la chose, elle continua :
— Et, mon beau chéri, tu as vraiment de la chance avec cette vache ; si la première fois, la régalant de minettes, tu achevas de la nettoyer du foutre laissé par Alexandre, ce soir encore tu atteignis le même but, en léchant le foutre d’un inconnu, dont elle sortait de se faire enfiler.
— Je ne veux penser qu’à toi ! L’avais-tu fait ce soir, dis ?
— Non, pas dans la soirée, je te le jure ; mais avant dîner, avec Alexandre, qui se montrait enragé.
— Eh bien, tant pis, parce que si tu avais gardé son foutre, je l’aurais sucé dans ton con, tant je l’aime, et pour voir aussi s’il m’eût excité comme avec La Férina. Ah ! ce qu’elle avait du montant dans les cuisses !
Il la regrettait, au lieu de la maudire ; elle le vit en cette seconde, et comprit la faute commise. Elle essaya de la réparer, en disant :
— Tu es le plus chéri de tous les plus gros cochons de la création.
Ce fut comme une nouvelle lune de miel, qui réunit dans l’érotisme tous les membres de cette famille exceptionnelle ! Pendant trois jours de suite, on oublia le monde extérieur, et Antoine devant l’exaspération sensuelle des femmes et du montreur de plaisirs, sembla retrouver une seconde jeunesse.
À la hauteur des circonstances, il affichait de l’énergie, de la vaillance amoureuse, et baisa Thérèse, Léa, Lina à diverses reprises, ces ensorcelantes sirènes sachant inventer des poses mignardes et paillardes pour ranimer les ardeurs de leurs cavaliers. Au diable les propositions étrangères ! D’un commun accord, on décida de décliner l’offre d’Annette Gressac ; Thérèse ne cachait pas sa répugnance à continuer l’exploitation des tableaux érotiques, où l’on pouvait finir par se brouiller, alors qu’on formait un aussi joli groupe familial. Elle s’accusait aussi chaude à jouer le rôle de mari vis-à-vis de Lina et de Léa, qu’à servir de femme à toute luxure à Jacques et à Antoine. Son godemiché, plus fort, plus long que celui de La Férina aperçu par Jacques, lui donnait l’allure d’un galant baiseur, et bien souvent, en folâtrant par le jardin, dans des tenues très légères, le corps à peine recouvert d’une chemise et d’un peignoir, elle répondait à un coup d’œil de Lina ou de Léa, leur sautait dessus pour les enconner et calmer leurs désirs de rut, que ne pouvaient satisfaire en cet instant leurs deux maris. Ils accomplissaient cependant des prodiges. Une nourriture abondante et saine reconstituait leurs forces ; les images lascives circulaient sous leurs yeux pour les attirer à la pratique des voluptés. Ils ne s’ennuyaient pas, ils ne cherchaient pas à reparaître en public.
À côté des paillardises, chacun s’occupait de la part de ménage qui lui était dévolue, chacun prenait ses distractions à sa fantaisie. Antoine jardinait, Jacques étudiait les étoffes et les costumes, Thérèse lisait, Lina peinturlurait et Léa s’amusait à des ouvrages au crochet. Le temps fuyait ; une lettre d’Annette vint rappeler les exigences de la vie ; Jacques répondit simplement qu’on n’acceptait pas sa proposition. Une, deux semaines s’écoulèrent ainsi.
Les économies réalisées permettaient de ne pas se fouler la rate, on avait de quoi vivre devant soi, en attendant qu’on songeât à quelque lucrative entreprise pour combler la caisse, quand elle commencerait à sonner le creux. En attendant on savourait cette période de bonheur et de tranquillité que traversait la famille. Si on tirait moins de coups de queue, les paillardises en revanche se multipliaient, et on s’évertuait pour se dépasser en inventions lubriques et en caprices libidineux. Malheureusement, les caprices qui forcent la nature sont ceux qui épuisent le plus vite. Les goûts personnels reprenaient le dessus ; Thérèse aimait de sucer, et Antoine aurait toujours laissé sa queue dans la bouche d’une suceuse. Ils s’entendaient à ravir pour se réfugier dans quelque coin, où Thérèse berlingotait la pine d’Antoine à lèvres que veux-tu ; elle le comblait de pattes d’araignée, le patouillait sous les couilles, sur le ventre, sur le cul, lui chatouillait l’anus avec le godemiché, elle aspirait le gland en un mouvement velouté des lèvres, elle le faisait bander, et hélas ! souvent jouir, au risque de le tuer. Elle en appelait à tout son sang-froid pour s’arrêter, elle voulait l’épargner, et, les sens en feu, elle courait après Lina, qu’elle jetait sur un lit et enfilait, se donnant l’illusion d’être vraiment un homme par le godemiché, et en éprouvant un plaisir relatif. Elle remplissait si bien le rôle que Lina s’énamourait et, ayant déchargé, à son tour la suppliait de changer de personnalité pour devenir sa petite maîtresse.
Si Thérèse savait en ce moment son mari incapable de la posséder, elle se rendait au désir de sa cousine, et après avoir été un amant modèle, elle devenait une incomparable maîtresse, affolant et surexcitant sa bien-aimée baiseuse. Jacques, pour sa part, soignait sa marotte, et cette marotte, il la devait à son aventure avec la petite Pauline Turlu, la nièce d’Annette Gressac. Il profitait de la jeunesse de Léa, de sa taille pas trop élevée, de la fine délicatesse de son corps, pour lui faire revêtir des costumes de petite fille, très suggestifs, et lui produisant d’autant plus d’effet que les mollets ici apparaissaient fermes et saillants, qu’il savait trouver sur le bas-ventre la délicate toison, absente encore sur celui de Pauline, et il s’enrageait, sa belle-sœur le poursuivant sous sa toilette de fillette, à très courtes jupes, à la prendre à cheval sur ses genoux, pour qu’elle le masturbât comme avait fait l’autre. Avec une si gentille et si savante partenaire, le jeu s’agrandissait. Léa pressait habilement la queue, s’en chatouillait les cuisses, le bouton, palpait toute sa longueur et sa grosseur, se servait de la paume de la main et des doigts alternativement, suivant la dureté que présentait l’érection, et quand elle sentait la jouissance sur le point de jeter au dehors le sperme, elle intercalait le gland à l’orifice du vagin, entre les lèvres secrètes : plaçant alors un mouchoir de dentelles sous ses cuisses et sous les couilles de Jacques, où leurs mains parfois se heurtaient pour lancer des frissons dans leurs veines, Léa masturbait et s’excitait par le frottement du gland contre sa vulve, contre son clitoris. Elle tenait bien dans sa petite main l’engin mâle et le dirigeait au mieux de son propre caprice, visant à ce que la décharge se produisant amenât son plaisir personnel ; et ce plaisir, elle l’obtenait par le jet du sperme sur son con, sur son chat, par l’humidité qui en résultait sur le mouchoir de dentelles, gagnant peu à peu les tissus de sa peau. La même passion les unissait dans cette seconde, et sous l’influence de la même pensée, leurs cuisses se disputaient la moite mouillure du mouchoir.
Il l’eût enconnée sans difficulté ; elle se serait livrée à son attaque avec ivresse, mais l’un et l’autre s’appliquaient à éviter l’extase du coït, pour transporter leur émoi sur le frisson procuré par le contact du mouchoir de dentelles entre leurs cuisses. La sensation montait, montait toujours ; ils se pâmaient dans les bras l’un de l’autre, se becquetaient, tressautaient, leurs parties sexuelles se collant sur le mouchoir de dentelles. Une impression de farouche bonheur se traduisait dans leurs yeux. Ne se quittant pas, ils sortaient la langue, se la léchaient, chacun leur tour ; les moindres idées qui traversaient leur âme n’étaient pas un secret pour l’un et pour l’autre ; leur cœur battait à l’unisson, ils prolongeaient leurs postures, actionnant, par une force de volonté extraordinaire, leurs sexualités, pour qu’elles atteignissent toutes les fibres agrippeuses de félicité.
Jacques la suppliait, après une délicieuse minute d’un repos engourdissant, de recommencer ; elle ne refusait jamais ; la main, retirée de dessous les jupes, où se prélassait la queue mendiant le masturbage, saisissait d’abord les couilles, puis toute la tige virile, et le branlage redoublait avec plus de vélocité ; le résultat se précipitait, le sperme restait moins longtemps à jaillir, les organes préparés ne demandaient plus qu’à fonctionner pour hâter la volupté. Jeu dangereux, jeu mortel, tous les deux s’y acharnaient avec la même fougue. Léa jouissait de masturber comme Jacques d’être masturbé de cette façon, comme Antoine d’être sucé par Thérèse, comme Thérèse et Lina de se posséder par le godemiché.
La folie s’emparait de tous ces cerveaux. Ni les uns ni les autres ne gardaient plus une juste mesure, et en quinze jours d’une telle existence, les caractères menaçaient de tourner à l’idiotie ; une femme seule dominait la situation, Thérèse, qui semblait absorber la vigueur des mâles, et imposait sa loi à toute la maisonnée.
Voyant qu’elle n’avait qu’à parler pour être obéie, voulant réagir contre le dangereux courant qui s’établissait, elle imagina un système quotidien de conduite, où les heures de travaux, de repos, furent marquées, pendant lesquelles on s’abstiendrait de rechercher les sensualités des plaisirs spéciaux, et où on les interdirait ensuite si on n’avait pas tiré un coup au moins dans la journée, affirmant que pour sa part elle refuserait tout rapport sexuel à qui enfreindrait ce qu’elle édictait dans l’intérêt de chacun. Et donnant l’exemple, elle apporta elle-même un frein à son goût du suçage.
Encore des jours passèrent, et malgré cette sage ordonnance, on usa et abusa des occasions sensuelles, pour arriver enfin à un assoupissement nerveux où l’on pût redouter d’être atteint d’impuissance. La virilité des hommes, la féminité des femmes, exaspérées par ce culte trop exagéré à l’autel de Cupidon, refusait de vibrer. On avait beau en appeler à toutes les pensées de luxure, la nudité, si on y recourait, produisait un effet déconcertant, où les deux cavaliers fuyaient leurs dames, et où celles-ci, privées de leurs services amoureux, pour se stimuler, se battaient entr’elles, se fouettant, se mordant, se déchirant les chairs à coups d’ongles.
Au bout de six à sept semaines d’une telle retraite, la nostalgie du mouvement altruiste se glissa dans les âmes, et un matin Jacques déclara qu’il descendait à Paris pour faire ses visites de politesse aux personnes qui les protégèrent, et particulièrement à M. et Mme Gressac, pour leur expliquer les raisons qui motivèrent leur refus de ne pas exécuter des tableaux vivants dans l’établissement qu’ils avaient avenue Matignon. Thérèse, émue plus qu’elle ne voulait le paraître, lui demanda si, pour alimenter la caisse familiale, il ne croyait pas nécessaire de chercher à donner deux ou trois séances chez ceux qui les sollicitaient.
— Dame, répondit-il, nos économies baissent, et nous n’avons encore rien trouvé pour réparer les brèches qu’elles subissent.
— Eh bien, mon chéri, si tu juges utile de recommencer pour un certain temps, n’hésite pas ; cela ne nous empêchera pas de réfléchir à nous débrouiller d’une autre manière. En somme, nous étions bien payés, nous n’avons eu d’accidents qu’à notre dernière représentation, et cet accident on l’a bien effacé, n’est ce pas ?

VIII
Jacques rencontra, rue de Longchamp, Annette Gressac seule. Sa nièce était à la pension, où elle faisait son instruction, et son mari dehors. Elle l’accueillit d’abord avec froideur, et ne prit une attitude aimable que lorsqu’il s’informa si sa création de l’avenue Matignon lui donnait satisfaction. Crut-elle qu’il revenait sur son refus, ou bien qu’il apporterait sa clientèle et celle de ses trois femmes, pour augmenter le clan des joueurs et des cocottes qui contribuaient à la fortune de l’entreprise ? Elle changea aussitôt de manière d’être et répondit à toutes ses questions, lui apprit les nouvelles du jour, appuyant sur ce qu’elle avait dû pourvoir à une compensation des tableaux vivants, par des mimeries que rendaient très volontiers les cocottes, habituées de ses salons.
À son grand étonnement, elle lui parla en termes très enthousiastes de La Férina, qu’elle dénigrait avec acharnement lors de leur dernière entrevue, la disant une femme très remarquable, richement entretenue par M. Bertrand Lagneux, qui prenait plaisir à la voir monter sur le tréteau et exécuter de jolies mignardises avec son amie Horacine, sous les étoffes légères et demi transparentes, où elles ne révélaient qu’une faible partie de leurs attraits, mais suffisamment pour suggestionner ces Messieurs, qui ne manquaient pas ensuite de se réfugier dans les chambres avec les belles hétaïres présentes dans les salles.
— Certes, conclut-elle, ça ne vaut pas vos tableaux vivants, mais cela les remplace très bien. Je ne vous le dissimulerai pas, La Férina vous a conservé un gros béguin ! Qui sait ce que vous eussiez pu en espérer en produisant ici vos femmes ; qui sait même ce que vous en obtiendriez, si vous veniez quelquefois passer la soirée avenue de Matignon ! Il est sûr qu’elle vous inspirerait le même béguin, et que vous y récolteriez de l’agrément, sinon plus. Elle vaut la peine que vous vous souveniez de sa beauté.
— Je viendrai, murmura-t-il.
Que s’accomplissait-il dans son esprit, dans son cœur ? La satiété n’existait-elle dans ses sens que vis-à-vis de sa femme, de sa belle-sœur, de Lina, par suite de leurs abus vénériens de la maison d’Asnières ? Rien qu’au nom prononcé de La Férina, rien qu’à l’évocation des minettes et des feuilles de rose dont il la gratifia, il avait senti renaître sa puissance virile, secouée par un désir subit, qui n’échappa pas à l’œil attentif de la belle Annette. Elle ajouta :
— Puisque vous consentez à venir, ne venez pas seul. Amenez votre femme, vos femmes, si vous voulez. Il peut se faire que vous finissiez par vous repentir de votre décision. Puis, j’ai intérêt à vous aider à regarder autour de vous. J’espère bien que vous n’êtes pas jaloux, et que l’escapade du passé, si elle se renouvelait, avantageuse cette fois-ci pour vos profits, vous ne la repousseriez pas ?
— Vous nourrissez une idée au sujet de ma femme ?
— Cette bêtise ! Je ne vous parlerais pas ainsi, s’il en était autrement.
— Qui… la désire ? Le petit jeune homme ?
— Bon dieu non ! L’ancien amant de La Férina, Arthur des Gossins.
— Vous n’ignorez pas que, malgré la raideur de nos tableaux vivants, nous n’admettions pas le don des personnes.
— Ceci était de l’enfantillage ! N’avez-vous pas, vous, personnellement, lardé de coups de canif votre contrat ? Et ne le mettriez-vous pas en pièces… pour La Férina ? N’en déchireriez-vous pas de morceaux pour d’autres, si ces autres se montraient disposées à être clémentes ? Vous devez être un bon mâle !
La conversation s’engageant sur cette voie, il bandait de plus en plus, et suivait avec plus d’attention Annette, remarquant l’ampleur de sa beauté, qui ressortait sous un déshabillé jaune et blanc ; elle jouait avec les attaches qui l’ornaient et la serraient, elle avançait et reculait les pieds chaussés de mules blanches, de bas à jour ; il admirait la finesse de la cheville, et se rappelait la superbe chûte des épaules ; il ne pouvait douter qu’elle coquetait sérieusement, il poussa un soupir, et dit :
— La Férina me doit son corps, je ne voudrais pas m’engager ailleurs sans en avoir goûté la saveur.
— Serait-il Dieu possible que vous fussiez un naïf, avec le cynisme de vos tableaux ? Voyons, voyons, mon cher ami, n’estimez-vous pas qu’il convient de nous entendre absolument, vous et moi ?
— Et votre mari ?
— Lui, c’est un monstre ! J’avais foi en son amour, je n’ai plus d’illusions. Savez-vous que votre femme y a passé ?
Le regard, qui accompagnait la phrase, en disait long. Il rapprocha son fauteuil, et elle fit de même ; il tendit la main, elle laissa tomber la sienne et il murmura :
— Vous mériteriez qu’on ne regardât pas plus loin ; mais nous sommes pour nous entendre, comme vous avez dit, et on s’entend bien mieux, quand on se connaît tout à fait ! Me favoriserez-vous pour La Férina, sans me conserver rancune ?
— À charge de revanche ! Je voudrais goûter… de votre femme. Elle est une gamahucheuse hors ligne… d’après certains rapports.
— Ah, ma femme !
Mais il s’assurait déjà des arrhes ; il avait glissé sur les genoux, et ses mains voyageaient entre les jambes d’Annette.
— Vous êtes douce au toucher, dit-il, vous devez être belle à contempler, voyons ?
D’un geste brusque il la retroussa et elle se renversa en arrière. Mais cette nouvelle chair qui se livrait à sa concupiscence réveillait ses ardeurs, éteintes depuis quelques jours. Le changement trahissait sa puissance fluidique. Les philosophes pourraient bien en étudier la vertu, au lieu d’accepter sans discussion les théories égoïstes de l’amour éternel.
À pratiquer les mêmes femmes, il s’affadissait, se dévirilisait, et leur inculquait le refroidissement génital qui le tourmentait. Les pores féminins, attractifs des énergies masculines, se fermaient et ne remplissaient plus leur office. La satiété, la lassitude provenaient d’un courant voluptueux trop activement employé et qui avait besoin pour se reconstituer de l’appoint de contacts étrangers : ainsi il retrouverait sa vigueur, ainsi il rouvrirait les pores féminins conjugaux. L’adultère se présentait comme régénérateur des liens matrimoniaux.
Jacques n’avait pas le temps de se lancer dans ces considérations, il ne réfléchissait pas, l’impatience de ses désirs ne lui laissait même pas la faculté de savourer les attouchements préventifs, d’essayer les caresses excitantes. La vue des nudités sexuelles d’Annette avait suffi pour le jeter dans la rage du coït. Apercevant à sa portée le con, ombragé d’une épaisse toison noire, il y poussait droit la queue, il se hissait sur les jarrets pour le prendre d’assaut, il luttait dans la frénésie de l’attaque, pétrissait les chairs d’Annette de ses mains crispées, la secouait de délicieuses violences qui la ravissaient, la disposaient à sa félicité ; elle se prêtait à sa fougue de son mieux, la comprenant, parce qu’elle jugeait la jeunesse de l’amant plus pressée que la maturité du mari, cette jeunesse étant d’un autre côté plus experte que l’adolescence d’Alexandre Brollé, qui lui fût soufflé par La Férina.
Elle s’abandonnait avec joie, elle apportait son con à la conquête de cette queue, qui le pointait, l’envahissait avec furie ; elle se sentait enfilée, maîtrisée, dominée, au milieu de spasmes furibonds, et pour la volupté qu’on versait dans ses veines, elle se fût prostituée en plein public. Bah ! qu’importe la morale, et qu’a-t-elle à voir en ceci ? La nature veut l’union des queues et des cons : les deux en présence se faisaient merveilleusement fête.
Jacques et Annette roulèrent en bas des fauteuils. L’attaque s’engageait passionnée ; sous la vaillante chevauchée d’amour, Annette râlait dans un désordre incomparable ; c’était à croire que jamais son mari ou d’autres, s’ils la labourèrent, ne surent provoquer ses vibrations à un tel degré. Elle s’épanouissait sous la puissance de cet homme, qui, la queue dans son vagin, la patouillait aux seins et aux fesses, lui léchait la bouche, lui meurtrissait le ventre sous la rudesse de ses secousses. Il ne décessait pas de la manœuvrer ; le sperme jaillissait à grosses gouttes épaisses et gluantes ; elle le recevait dans la matrice, elle se mourait, elle ne voulait pas laisser Jacques s’évader de ses bras, elle le pressait de toutes ses forces contre sa poitrine, elle le mangeait de baisers, elle lui susurrait dans l’oreille les plus doux propos, elle l’encourageait à tout oser, et il la bourrait de nouveau de gros coups de queue.
Puis, le calme renaissant peu à peu, ils furent aussi étonnés l’un que l’autre de ce robuste et forcené baisage. Leurs regards se fouillaient, ils se souriaient en rangeant leurs effets, ils se séparèrent en se promettant le secret réciproque, et d’accord pour s’aider mutuellement dans leurs projets futurs.
Jacques, tout étourdi de l’aventure, retourna à Asnières, où les questions l’assaillirent sur le résultat de ses visites. On devinait chez tous les membres de la famille le même besoin de quelque chose qui tranchât sur la monotonie de l’existence adoptée. Il fournit des explications plutôt vagues, tout en laissant entendre que la protection des Gressac serait indispensable si on voulait reprendre les tableaux, et on ne se formalisa pas qu’il allât seul avec sa femme, dès ce soir même, à l’établissement de l’avenue Matignon. Il fallait tâter le terrain avant de s’engager dans quoi que ce fût, prétexta-t-il, et si on s’y rendait tous ensemble on s’exposerait à être bêtement exploités.
De retour chez lui, ses sens, remis en branle par la passion d’Annette, s’étaient immédiatement réveillés pour les voluptés de sa femme, et par un contre-effet naturel, les pores fermés de celle-ci se rouvrirent pour attirer les idées sexuelles de son mari. Pensant qu’ils trouveraient avantage à retarder la satisfaction des désirs ressuscités, ils avaient décidé le voyage à Paris, par pressentiment que des agaceries altruistes ne serviraient qu’à les mieux mettre en train pour la nuit de félicités luxurieuses dans laquelle ils comptaient bien se ressaisir pour longtemps.
Étaient-ce leurs pressantes dispositions charnelles ? Dans les salles de l’avenue Matignon, ils s’ennuyèrent plus qu’ils ne s’amusèrent. Annette se montra très réservée ; il y avait peu de monde dans les salons, où l’on se défiait d’une trahison, menaçant d’amener une descente de police, malgré les précautions prises. Les gros joueurs, les horizontales de marque ne parurent pas. Jacques et Thérèse ne rencontrèrent aucune figure de connaissance et repartirent de bonne heure, sans qu’Annette intervint pour les retenir. Oh, qu’ils avaient hâte de se retrouver seuls ! Quoi ! la veille encore, après un court bonsoir, ils se retiraient chacun dans sa chambre, avec le besoin impérieux du sommeil et sous le poids d’un ennui insupportable ; ils éprouvaient à présent une fièvre intense à se frotter les épaules, à se regarder, à se pinçailler comme des gamins.
Le feu couvait dans leurs veines ; jamais Thérèse n’apparut aussi désirable au yeux de son mari, jamais Jacques n’afficha de telles gentillesses amoureuses aux yeux de sa femme. Ils furent vite sous les armes, ce qui n’empêcha pas les multiples gourmandises de la grande et de la petite oies. Au milieu des ébats polissons qui pimentaient leurs coïts, ils lurent à livre ouvert dans leur cœur ; ils ne doutaient pas de l’affection qui les unissait, ils acceptaient toutes les éventualités pour améliorer leurs conditions de vie, pour augmenter leurs chances d’ivresses sensuelles. Un souteneur exploitait salement et sottement sa marmite. Un mari et une femme d’accord pouvaient prétendre à une sécurité de vie heureuse, où la justice n’aurait rien à démêler.
Jacques et Annette avaient conclu un traité d’alliance ; le mari et l’épouse unissaient leurs intérêts et leurs plaisirs sur d’autres bases que celles fixées par les lois et conventions. Se donnant carte blanche pour la satisfaction de leurs caprices personnels, s’ils en éprouvaient au dehors du lien conjugal, ils se disaient que la franchise était ce qu’il y avait de mieux, et Jacques cependant ne parla pas du coup de queue dont il honora le con d’Annette, et Thérèse garda pour elle l’avis soufflé par Annette, qu’à côté de son mari, il lui convenait d’avoir un miché sérieux, ce dont elle se chargeait.

IX
Une soirée particulière, des apparitions fréquentes dans les salles de l’avenue Matignon, puis Jacques et sa famille prirent l’habitude de frayer avec tous les mondes, ce qu’ils n’avaient pas fait jusque là. Jacques se risquait au baccarat et gagnait, Thérèse liait conversation avec les cocottes et les Messieurs qui leur couraient après ; Lina ou Léa ne venaient qu’à tour de rôle pour les renforcer. Quant à Antoine, il gardait la maison, ne pouvant mener une vie de trop grande fatigue ; une des femmes demeurait toujours avec lui pour sa partie de cartes avant le coucher, et aussi pour le plaisir vénérien, quoiqu’il n’eut plus sur ce point que de lointains et rares appétits.
On ne demandait pas à Jacques d’organiser des tableaux vivants, mais il continuait ses relations avec Annette, et cherchait à causer intimement avec La Férina, qui lui battait froid, paraissait s’être réconciliée avec Thérèse, la comblant de gracieusetés et de petits bonbons.
Les cartes, la roulette, les femmes, les voluptés permises dans la pleine luxure : l’établissement mi-clandestin des Gressac avait tout ce qu’il fallait pour réunir les viveurs et les viveuses. La Férina et son amie Horacine des Tilleuls s’amusaient à jouer sur un tréteau des ébauches lesbiennes, qui activaient les passions très excitées en un pareil milieu. Ces ébauches, loin de déplaire à l’entreteneur sérieux du moment, lui convenaient fort, et il n’en désirait que davantage ensuite la jolie courtisane.
Arthur des Gossins, qu’Annette laissa entrevoir à Jacques comme épris de Thérèse, ne venait pas souvent dans les salons de l’avenue Matignon, et n’y abordait presque pas la jeune femme. Le danger qui plana un instant sur les destins de cette honnête entreprise se trouvait écarté. Un important personnage politique, de ceux-là qui s’affichent des plus intransigeants sur la moralité de leur concitoyens, était intervenu. On pouvait d’ailleurs ignorer très facilement l’existence du claque-dents lupanarisé.
Le Café des Pommes de l’avenue Matignon servait seulement de passage pour les clients nouveaux ; on entrait en général par deux immeubles situés dans des rues voisines, et où l’on avait su aménager les salons et la galerie. De plus un hôtel, où descendaient de nombreux voyageurs, était en communication directe avec les appartements, que les Gressac avaient convertis en chambres pour les passes, et permettait les entrées et les sorties des habitués, sans qu’ils éveillassent l’attention publique. Un soir, Jacques se trouva assis, à la table de roulette, à côté de La Férina ; personne de leur entourage n’était là, elle lui dit à demi voix :
— Demain, à trois heures, dans l’après-midi, je t’attendrai.
C’était la première fois que d’elle-même elle lui adressait la parole ; les yeux brillants, il lui répondit qu’il y serait. L’heure de la possession sonnait-elle enfin ? Il connaissait ce merveilleux corps, ces blancheurs laiteuses qu’il anima de frissons voluptueux sous la force de ses caresses. Son âme se rappelait, avec une vicieuse fièvre, comment ses baisers et ses suçons succédèrent au passage de l’amant dans ce con, qu’il brûlait de posséder.
Loin d’être dégoûté de ce souvenir, il en ressentait comme une attirance encore plus vive ; la décharge masculine provoquée dans son vagin versait un stimulant à sa luxure. Elle sortait d’être baisée lorsqu’il la mangea de minettes, de feuilles de rose, et elle vibra sous le jeu de sa langue, elle vibra avec tant d’intensité qu’elle lui offrit son amour.
Fort amateur de paillardises, ayant sous la main des femmes enchantées de s’y prêter, il voyait en La Férina un exquis poème à déchiffrer, que des amants antérieurs ne se donnèrent pas la peine d’étudier.
Plus rien n’existait devant le rendez-vous qu’elle lui fixait, et sa pensée ne s’en détacha ni dans la suite de la soirée, ni dans les heures à tuer avant de la voir. Aussi ce fut en proie à une très puissante émotion qu’introduit chez La Férina, il se revit dans le salon où pour la première fois il se reput de ses sexualités, après l’exécution de la danse du ventre par Thérèse, Léa et Lina.
Elle le rejoignit immédiatement, vision éblouissante de grâce et de gentillesse. Elle avait revêtu une originale toilette d’intérieur, bien faite pour exciter la luxure et les désirs de volupté, toilette rappelant l’antiquité et évoquant l’époque thermidorienne, pour se moderniser aux appétits sensuels de nos temps. Un tout mignon corsage enserrait les seins, sous lesquels était reportée la taille ; une longue jupe, très ouverte sur le côté droit, partait de la taille pour se terminer en superbe traîne par derrière et s’arrêter par devant, juste au-dessus des mollets ; des chaussettes de soie et de petites mules complétaient le costume de fines étoffes blanc-argent.
Par l’ouverture de la jupe, très échancrée, on apercevait la magnificence du corps nu, avec les rondeurs dodues des fesses, la délicatesse du contour des hanches, les séduisants appas des cuisses. Toilette de déesse accessible aux humains, toilette bien voulue pour jeter le feu des appétits vénériens dans le cœur d’un amant, toilette que soulignait la démarche souple et gracieuse de celle qui la portait !
Elle s’avança, souriante et amoureuse, elle ouvrit les bras, il s’y précipita, et ils échangèrent une brûlante caresse sur la bouche. Il s’enflammait déjà sous l’ardeur des désirs ; ses mains frissonnantes agrippaient les chairs ensorceleuses, elles couraient vers les sexualités, elles patouillaient avec fièvre ce corps qui s’abandonnait ; elle le pigeonnait, lui murmurait de doux propos, ne le contrariait pas dans la hâte de son pelotage.
Il s’écroula à ses pieds, ses lèvres parcoururent toute la féminité de l’horizontale, elles la chatouillèrent de ces experts suçons qu’elle aimait tant, et sous lesquels elle se pâmait. Elle se délectait de ses furieux baisers sur son con et sur son cul, elle lui livrait ses cuisses et ses fesses sous l’impulsion de ses mouvements, puis après quelques fortes lippées où il la secouait des pieds à la tête, elle lui toucha le visage d’un doigt tremblant, et dit :
— Assez, assez, pour le moment, j’ai quelque chose à te communiquer qui va bien te surprendre.
— Non, non, je ne m’arrêterai que pour te baiser, il y a assez de temps que j’aspire après cette joie.
— Patience encore, chéri, tu sais bien que je partage ton envie ! Il faut que je te parle, et je t’assure que cela t’intéressera beaucoup.
Pour appuyer sa volonté, elle frappa un léger coup de talon sur le tapis, le saisit par dessous les bras pour l’obliger à se relever, et il dut se résigner. Pour le consoler, elle glissa la main dans sa culotte, sortit sa queue, et eut un geste de regret en constatant combien elle bandait. Elle la branla avec mollesse, et reprit :
— J’attends quelqu’un et tu es à cent lieues de deviner qui ça peut être.
— Encore un ajournement.
— Je n’ai pu remettre le rendez-vous ; je ne savais rien hier quand je t’ai parlé. On m’a passé la lettre comme je partais ; tu n’étais plus là. Devine qui m’écrit.
— Ton ancien amant, Arthur des Gossins.
— Non, c’est une femme.
— Oh, alors, il n’y en a qu’une qui te tienne au cœur, Horacine des Tilleuls ; tu l’enverras au diable pour aujourd’hui.
— Tu n’y es pas, et je me garderai bien de ne pas recevoir celle qui m’a écrit ! Tiens, regarde, tu dois reconnaître l’écriture.
De la pochette qui enfermait son sein gauche, elle tira un billet et le lui tendit. Il le prit, mais la voyant sourire, il hésita de lire. Sur son signe de tête, qu’il pouvait le faire, il jeta les yeux sur l’épître. Il fut vite intéressé, c’était une très chaude déclaration d’amour de sa femme Thérèse, suppliant La Férina de la recevoir, à ce même moment où il se trouvait près d’elle, afin de lui fournir l’occasion de prouver combien elle l’adorait, par les ardentes et brûlantes caresses dont elle couvrirait tout son corps, caresses qu’elle apprécierait mieux que celles de son mari, jurant que si elle consentait à ce qu’elle la baisât avec le godemiché, elle ne voudrait jamais plus de personne, même d’Horacine. Quand il eût achevé sa lecture, elle dit :
— J’ai donné l’ordre de l’introduire, dès qu’elle se présenterait.
— Je ne supporterai pas cela, s’écria-t-il !
— Ne fais pas la bête ! Tu te cacheras derrière ce sopha, vis-à-vis de cette coucheuse ; ta femme ne soupçonnera pas ta présence, et tu verras si elle sait bien me déclarer son amour, et comment elle s’y prendra pour que je jouisse. Hein ? Je suis gentille ! Le spectacle t’enragera les sens, et quand elle s’en ira, si tu as été bien sage, si tu ne t’es pas montré, tu me tireras tant que tu voudras, tant que tu pourras.
Oh ! cette Férina, il était écrit qu’il n’arriverait jamais auprès d’elle qu’en second ! Jusqu’à sa femme qui se dressait, alors qu’il se croyait sur le point de la cueillir. Mais il recommençait son pelotage, ses caresses ; elle le frappa sur les doigts, le repoussa, simula une petite colère, et dit :
— Viens que je t’installe derrière ce sopha, pour qu’on ne se doute pas que tu es là.
— Encore quelques minettes.
— Non, ce n’est pas possible ; on m’a prévenue ; ta femme est dans la salle de billard, où on l’a introduite ; elle attend que je la fasse appeler, et il y a déjà assez longtemps. Veux-tu oui ou non te cacher ?
— Je veux ce que tu veux.
— À la bonne heure !
Elle l’installa on ne peut mieux pour qu’il suivit la scène sans se fatiguer, et de façon à ce que rien ne le trahît. Ensuite elle sonna, et retourna s’étendre sur sa coucheuse. Thérèse, très pâle, très émue, entra sous une toilette grise, la dessinant très bien dans l’harmonie de ses contours. La Férina, se soulevant avec nonchalance, murmura d’une voix langoureuse :
— Il est donc vrai que vous pensez à ma pauvre personne ?
Elle n’eût pas plus tôt prononcé ces mots, que Thérèse tombait à ses genoux, la baisait avec transports, et répondait :
— Ah ! dites, vous me pardonnez mon ancienne méchanceté ? Folle que j’étais ! je ne voulais pas reconnaître votre beauté, votre charme, et alors que je me croyais jalouse de mon mari, je n’en doute pas à cette heure, toute ma jalousie s’adressait à ceux qui vous aimaient, et qui m’empêchaient de découvrir ce qui se passait en moi. Oh, je saurai vous prouver la force de mon amour ! Laissez-moi me griser de vos trésors de femme !
— Vous rappelez-vous comme vous m’avez battue, fouettée ?
— Oubliez-le, je vous en supplie ! Songez aux sentiments qui me tuaient le cœur ! Mon mari se jouait de ma tendresse, de mon dévouement ; sous mes yeux il vous adorait, et affichait son dédain à mon égard ; la rage s’empara de mon âme ! Oh, cette rage, comme elle se serait vite transformée en cet amour qui me brûle, si je vous avais regardée ainsi que je le fais depuis que nous nous rencontrons avenue Matignon.
— Vous m’aimez vraiment ?
— Ne le sentez-vous pas ?
— Si, si, mais si je consens à écouter l’amour d’une femme, il faut que cette femme soit au moins aussi peu vêtue que je le suis ; il faut que je puisse juger si son corps frissonne réellement aux caresses que je lui permets de me faire.
En un bond Thérèse se redressa, et, sans hésiter, se dépouillant de toute sa toilette, se mit en complète nudité. La Férina, dans une pose énigmatique, demi-couchée, demi-assise, la laissait agir, la suivait des yeux. Nue, Thérèse s’approcha et s’agenouilla de nouveau, en disant :
— Suis-je comme vous le désirez ?
— Je veux vous voir debout, tout près. Venez, venez par ici que je contemple votre corps.
Thérèse s’empressa d’obéir : elle se plaça devant les yeux de La Férina avec grâce et finesse. Celle-ci lui toucha le minet, les fesses, les cuisses, les nichons, et reprit :
— Tu es belle, tu es jolie, tu mérites toi-même d’inspirer les désirs des femmes. Eh bien, puisque tu m’aimes, tâche d’effacer par tes caresses le doux et tendre souvenir que m’ont laissé celles de ton mari.
Elle se rejeta en arrière, en retirant vers son cou le faible voile qui cachait son con et ses cuisses, Thérèse s’accroupit entre ses jambes, et la gamahucha avec fougue, avalant sa motte, son clitoris, lorsqu’elle entendait sa voix murmurer :
— Plus fort, plus au fond, va, marche, je n’oublie pas encore ton mari.
À cette exclamation, une frénésie dominait Thérèse ; on eût juré qu’elle cherchait à se fondre dans cette femme qu’elle encensait de ses caresses, tant sa langue la picotait avec vélocité, tant ses mains la pelotaient avec passion, tant elle enfouissait le visage dans ses parties sexuelles. La Férina s’énamourait, malgré ses paroles ; elle commençait à se contorsionner, à secouer les jambes, à plisser le ventre, à appuyer les mains sur la tête de sa compagne, exigeant des caresses de plus en plus intimes, se convulsionnant pour lui tendre son cul, afin qu’elle lui en léchât toute la fente, lui reportant le con afin qu’elle suçât son clitoris et lui chatouillât le vagin avec le menton. Les impressions se succédaient de plus en plus ardentes. Si Thérèse ne pensait pas à son mari, La Férina ne se rappelait plus la présence de Jacques. L’émotion voluptueuse gagnait de façon impérieuse les deux femmes. Soudain La Férina demanda d’une voix haletante :
— As-tu un godemiché ? Je ne sais plus où est le mien.
— Tu veux que je te baise, mon amour, tu éprouves donc sous mes minettes et mes feuilles de rose ? Oh, ce que tu es belle, oh, oui, ma chérie, mon idole, j’espérais que tu me le demanderais : je l’ai apporté, et tu seras pour de bon ma petite maîtresse, mon adorée.
— Vite, vite, tire-moi ton coup, je suis à point, je jouis, vite, je veux décharger dans tes bras ! Oh, quel bon amant tu es !
Thérèse courut à sa robe, et dans une poche intérieure, ménagée dans un pli de la doublure, elle prit le godemiché et sa ceinture qu’elle accrocha rapidement à sa taille. Alors, apercevant La Férina qui étalait toute l’éblouissante blancheur de son corps par devant, elle lui conseilla de se coucher sur le tapis, où elles seraient plus à l’aise pour se mouvoir. L’horizontale ne se le fit pas répéter, mais elle se dépouilla d’abord de son original déshabillé et nue comme Thérèse, elle la reçut dans ses bras.
C’était bien là le contact d’un amant et de sa maîtresse. Avec habileté, Thérèse, juchée entre les cuisses de La Férina, pointait le godemiché, l’introduisait dans le con ; puis, se laissant aller, elles se saisirent toutes les deux à bras le corps, et le doux assaut s’engagea. Jacques, à demi sorti de sa cachette, distinguait la croupe de sa femme qui se soulevait et s’abaissait, comme quelques jours auparavant il avait vu celle d’Horacine le faire sur ce même corps.
Le godemiché remplissait à merveille son office ; il entrait dans le vagin, le chatouillait, et en ressortait, pour recommencer prestement la même besogne. Les deux femmes se tenaient pressées, poitrine contre poitrine, ventre contre ventre, et ne se ménageaient pas les baisers à la colombe. Plus petite que La Férina, Thérèse ne la maîtrisait pas moins. De tendres paroles s’échangeaient, la jouissance arrivait, les tressaillements se communiquaient de l’une à l’autre, le monde n’existait plus devant les sensations qui agitaient les deux lesbiennes, et cependant le monde ouvrait les yeux sur leur duo, non seulement par l’attention figée de Jacques, mais aussi par celle d’une troisième femme toute nue, qui venait de surgir et qui, pâle de colère, les bras croisés, assistait depuis une minute aux ébats de ce coït anormal.
Jacques l’avait aperçue, l’avait reconnue, et s’était recroquevillé derrière le sopha. Horacine, probablement en tendre conversation avec La Férina, avait dû être lâchée par celle-ci, courant d’abord recevoir Jacques et ensuite Thérèse. La décharge sous laquelle vibraient les deux femmes, la tira de la stupeur dans laquelle elle restait plongée : elle sauta sur la croupe de Thérèse et la frappa brutalement, en criant :
— Garce ! cochonne ! salope ! ah ! tu te permets de marcher sur mes brisées ; je te tuerai, chienne ! Tu sais, je suis l’amie de Margot depuis trop longtemps pour qu’elle me fasse une queue avec une impudente putain de ta famille !
La main claquait ferme sur les fesses de Thérèse, à qui, loin de déplaire, cette magistrale fouettée semblait produire un effet tout opposé ; les coups poussaient les ventres à se heurter plus violemment, les épidermes s’en électrisaient, et le godemiché s’enfonçait avec plus de vigueur ; la décharge finissait à peine qu’elle recommençait, et La Férina, dans un souffle, murmurait :
— Baise-moi encore, toujours, ma petite, je suis sûre que je t’aimerai plus qu’Horacine.
Le disait-elle pour exaspérer davantage celle-ci ? L’amie trompée repartait de plus belle :
— Ah, tu l’aimeras plus que moi, et tu oses le dire ! Attends, je m’en vais bien voir, garde-lui son godemiché, le mien va le chasser de ton con. Heureusement que je l’ai apporté.
Elle le tenait en effet dans une de ses mains ; elle se le rajusta au corps promptement, et se jetant à côte de Thérèse, elle lutta pour la chasser de sa position. Tout en résistant pour ne pas se laisser déposséder, Thérèse lui dit :
— Ne faisons pas les bêtes comme les hommes, entendons-nous plutôt ; pourquoi ne me baiserais-tu pas pendant que je la baise ! Moi, je sais faire pendant qu’on me le fait : nous jouirons bien plus toutes les trois.
Horacine abasourdie n’eût qu’une courte réflexion, puis s’écria :
— Tu es la plus chouette des filles de bordel ! Pour sûr, que je veux t’enfiler. Laisse-moi te le placer, et on rigolera en chœur.
La Férina, qui entendait ces propos dans un vague délicieux, murmura :
— Gigotons en chœur.
Thérèse la maintenait enfilée, et s’agitait légèrement pour que, derrière ses reins, Horacine guidât entre ses cuisses le godemiché qui appartenait à La Férina. Le nouvel enconnage fut vite chose accomplie ; d’un petit mouvement de dos, Thérèse donna à comprendre qu’on pouvait commencer la manœuvre ; elle formait le centre du trio, qui se mit à fonctionner avec beaucoup d’adresse dans le doux travail. Les deux baiseuses s’accordaient dans leurs gestes ; Thérèse chevauchait encore La Férina, Horacine la chevauchait, baisant avec volupté ses épaules, patouillant ses nichons, lui envoyant des langues sous les aisselles ; les trois femmes ne formaient plus qu’un groupe compact, où les sexualités s’accusaient en frissonnants contacts.
Jacques n’en perdait pas la vue. Le spectacle le ravissait à un tel degré qu’il n’éprouvait pas encore la tentation d’intervenir. Il admirait la prestance de sa femme sachant affirmer sa personnalité entre celle qui la baisait et celle qu’elle baisait. S’il apercevait surtout le cul d’Horacine, de temps en temps les fesses de Thérèse se dégageaient, comme si elles cherchaient à s’emparer de son attention, et il contemplait, la bouche sèche, ces cuisses féminines se tortillant, entendait avec émotion les soupirs, les râles d’amour, que les trois gougnottes ne contenaient plus ; les lascivités se déroulaient dans des postures enivrantes comme seules les femmes sont capables de les imaginer.
Elles s’actionnaient dans leurs caresses, elles se délectaient des rôles qu’elles remplissaient, ne se hâtaient pas de poursuivre les fougueuses décharges, combinant leurs efforts pour perdre à la même seconde la notion des choses de ce monde, et jouir ensemble.
Tribades incomparables, elles supprimaient toute jalousie, toute haine. Horacine s’extasiait sur la finesse des contours de Thérèse, et celle-ci tétait avec délices les nichons de La Férina. Elles s’appelaient : « m’amour », « chérie », « trésor », « mon chien », « feu de mon âme », « ma dragée céleste », « ma miniature », etc., et elles flanquaient du godemiché à tort et à travers, pour appuyer l’expression de leurs tendresses.
Les croupes bondissaient, fulgurantes de blancheurs ; les trois femmes s’allongeaient à côté les unes des autres, pour que le poids des corps ne portât pas tout sur La Férina, et elles se mignardaient, se patouillaient, se baisaient avec une science exquise. Les lèvres sifflaient sous les caresses énamourées et prolongées, les mains fouettaient, les voix se mouraient. Jacques, voyant les secousses qui se précipitaient, ne résista plus. Rapidement dévêtu, sans qu’elles s’en doutassent, il se rua sur Horacine, et avant qu’elle ne fut revenue de sa surprise, il fourrait sa queue dans les fesses, et l’enculait si brusquement qu’elle poussait un cri de douleur, tout en disant :
— Ah, ah, ah, quel est ce sot animal !
— Hein, qu’y a-t-il ? interrogea Thérèse.
— Ce qu’il y a ? Un monsieur qui ne se gêne guère et qui me fout sa marchandise dans le troufignon.
— Chut, taisez-vous, dit La Férina, comprenant ce qui arrivait. S’il y a un homme dans ton cul, ce ne peut être qu’un ami, laisse-le prendre sa part du festin. Je crois bien que ce doit être le mari de Thérèse, nous tenons sa femme à toutes deux, il est bien juste qu’il pisse son jus chez toi ou chez moi.
— Oh ! si c’est le mari de Thérèse, je ne proteste plus. Il peut bien m’enculer à sa fantaisie, on n’en jouira que davantage. Dis le monsieur, ne me tiens pas la tête, que je regarde et que je sache si tu es bien le mari de ma petite femme ? Ah ! c’est vrai, c’est lui. Va, chéri, ta queue est bien dans la place, chourine ferme, on jouira tous ensemble !
Les chairs se massaient ; les corps s’agrippaient ; les spasmes se poursuivaient ; une chaleur torride s’emparait des êtres ; la même soif de luxure les unissait, les empêchait de s’arrêter aux moites humidités qui collaient les membres. Les quatre paires de jambes gigotaient à qui mieux mieux ; la queue de Jacques ne le cédait en rien à la fermeté des godemichés ; elle manœuvrait, sans faiblesse, sans arrêt, luttant bravement, vigoureusement ; elle perforait sans pitié les fesses de la belle Horacine, qui s’époumonait à se maintenir en équilibre, entre l’enculage dont elle était l’objet et le coup qu’elle tirait à Thérèse.
Les ventres se heurtaient aux culs, et les têtes se cherchaient pour se pigeonner par-dessus les unes les autres. La Férina et Jacques formaient les extrémités du quatuor, l’une baisée par Thérèse, l’autre baisant Horacine. Un même souffle animait les jouteurs, faisant merveilleusement travailler celles qui, possédées, s’acharnaient à enfiler leurs compagnes ; Thérèse, le godemiché d’Horacine dans le con, enfonçait avec méthode le sien dans le vagin de La Férina, comme Horacine, enculée par Jacques, s’appliquait vis-à-vis d’elle à son rôle de baiseur.
Les femmes se montraient à la hauteur de leur mission de bonheur. Douce mission consistant à jouir et à faire jouir ! Le sperme gicla dans le cul d’Horacine, la cyprine suinta chez les trois femmes. On ne voulait pas terminer pareille fête, on voulait s’épuiser à l’œuvre de luxure. On se roula par le salon en folles postures érotiques, et si Jacques ne posséda pas encore cette fois La Férina, il accomplit des prodiges avec Horacine et Thérèse, qui rivalisaient à qui le ferait le mieux vibrer, pour le disputer à l’attirance de l’horizontale.
Était-ce un mari, cet homme qui s’excitait à provoquer les lascivités de sa femme, et jouissait de son érotisme enflammant les deux autres ? Était-ce un amoureux, cet être qui, réellement épris de La Férina, la laissait dévorer de minettes et de feuilles de rose par Thérèse et Horacine, enragées après sa féminité plus éblouissante et plus fine, et s’entendant pour ne pas se la disputer afin d’en profiter à leur aise ? Toutes les deux contractaient un pacte tacite, par lequel elles se réservaient La Férina pour leurs luxures personnelles, se promettaient assistance pour l’enlever à l’amour mâle qu’elle semblait prête à éprouver pour Jacques. Devant les plaisirs de la chair, devant le libertinage des paillardises, il n’y avait ni mari, ni famille, il y avait la soif de luxure.

X
Le montreur de plaisirs conservait son autorité sur tout son monde. Les jours qui suivirent cette libidineuse séance, la famille fut appelée à servir ses tableaux vivants en deux occasions. Jacques en profita pour affirmer de nouveau sa suprématie de directeur de l’entreprise et de chef de maison. Sur ce point, Thérèse s’appliquait à le favoriser, se rendant compte que le prestige dont elle l’entourait rejaillissait sur sa personne. Il est certain que Lina et Léa marchaient dans son ombre, et qu’Antoine ne demandait qu’à s’effacer.
Le mari et la femme, échangeant leurs confidences, essayaient de s’en imposer mutuellement, au sujet de leurs aspirations sur La Férina, paraissant se seconder dans le but d’amener à l’autre les douces satisfactions de cette voluptueuse créature. Jacques baisait Thérèse avec régularité, et prétendait qu’il l’aimait par dessus toutes les autres femmes ; Thérèse, dans les bras de Jacques, jurait que si elle avait couru après La Férina, si elle y courait encore, c’était pour la lui livrer sans qu’il y eut danger de compromettre l’union de leur communauté.
Tous les raisonnements sont admissibles. Peu à peu, le ménage à cinq reprenait ses habitudes, se décidait à continuer les spectacles des tableaux vivants érotiques, et à saisir les occasions de fête plus ou moins productives, selon les circonstances. Une seule différence s’accusait avec le passé, on recevait des visites, parmi lesquelles on remarquait celles des Gressac, d’Arthur des Gossins, de Bertrand Lagneux, d’Alexandre Brollé, d’Émile Sauton, d’Horacine et de La Férina, aimant à venir se distraire aux travaux de l’intelligente famille, ou aux flâneries sous les arbres de la propriété.
Existait-il des relations particulières et cachées entre les uns et les autres, on ne s’en inquiétait pas. Arthur des Gossins ne se pressait pas de courtiser Thérèse, ayant eu vent de son caprice pour La Férina, à qui il gardait rancune ; Alexandre Brollé et Émile Sauton, entrés dans l’intimité de Jacques par d’habiles flatteries et d’adroits cadeaux, paraissaient viser la conquête de Lina, après laquelle courait ouvertement Gaston Gressac, et quant à Jacques, il ne dédaignait pas les ardentes félicités que lui apportait Annette.
Un après-midi qu’il avait été obligé de descendre à Paris et d’y déjeuner, rentrant plus tôt qu’on ne l’attendait, il aperçut dans un coin du jardin, à l’ombre des superbes tilleuls, deux fillettes assises sur les genoux d’Antoine Gorgon, lui chatouillant chacune les narines ou le cou avec un brin de paille, tandis qu’il avait les mains sous leurs jupes. Il eut un sursaut de mauvaise humeur en reconnaissant dans l’une sa belle-sœur Léa, sous la toilette de gamine qu’il lui faisait prendre, et dans l’autre la petite Pauline Turlu, la nièce des Gressac. Quoique jamais la jalousie ne fut son défaut, la vue de son cousin, se livrant au genre de débauche qu’il affectionnait, le contraria, et il s’approcha avec irritation du groupe, auquel il cria :
— Est-ce ici une maison d’éducation pour jeunes filles ?
— Des fois, répondit Antoine, mais je crois que tu ferais bien mieux d’aller voir ce qui se passe dans la maison, et de nous ficher la paix.
L’irritation de Jacques n’échappait pas à l’œil d’Antoine qui, très calme, ne se troublait pas et continuait son pelotage. Les jeunes filles avaient cessé de le chatouiller, se consultant si elles le lâcheraient pour s’amuser avec Jacques. Elle n’eurent pas à choisir ; Antoine les maintenant sur ses genoux, elles ne firent aucun geste pour les quitter, et crièrent :
— Oui, oui, va à la maison, Jacques, et si on n’y est pas sage, tu nous appelleras.
Jacques devina que quelque chose d’anormal devait s’accomplir ; tournant le dos au groupe, il se dirigea vers l’habitation où l’on n’entendait aucun bruit. Thérèse et Lina devaient cependant s’y trouver. Sa méchante humeur s’accentua. Il parcourut tout le rez-de-chaussée sans rien découvrir. Parvenu au premier étage, il s’arrêta sur le seuil d’une chambre, dans laquelle il surprenait sa femme agenouillée devant un homme déculotté, qu’elle suçait à pleine bouche. L’homme n’était autre que Gaston Gressac qui, par des gloussements de dindon, priait la suceuse tantôt d’accélérer, tantôt de ralentir la manœuvre. La tête vautrée sur ces cuisses, Thérèse pompait la queue avec des lèvres gloutonnes ou la laissait s’évader pour en frotter sa gorge toute débraillée et dont les seins brillaient hors du corsage ; elle était en toilette de ville et n’avait pas sans doute jugé nécessaire de se dévêtir. La queue en voulant surtout à sa bouche, pas besoin n’était de donner la liberté aux cuisses et aux fesses.
Un petit cri, qui partit d’une pièce voisine, appela de ce côté l’attention de Jacques. Là, assise sur un sopha, il aperçut Lina qui se défendait des entreprises polissonnes de Bertrand Lagneux. Ah, ça ! que signifiait toute cette histoire ? D’après Annette Gressac, Arthur des Gossins désirait sa femme Thérèse, et elle suçait Gaston Gressac ! Et Bertrand Lagneux qui s’affichait toujours très épris de La Férina, s’attaquait à Lina, qui ne voulait pas lui céder. Pour cela, la chose apparaissait évidente ; elle se défendait bel et bien, évitant de causer du tapage, pour ne pas se rendre ridicule. Ce spectacle le captiva davantage que le suçage de sa femme, ou les paillardises d’Antoine.
Il assistait pour la première fois de sa vie à la scène d’une femme repoussant les tentatives d’un homme enragé après sa possession. Bertrand se traînait aux genoux de Lina, la suppliait de condescendre à ses désirs, puis se fâchait, menaçait, lançait les bras sous les jupes, saisissait ses mollets ; elle se débattait, frappait sur ses doigts, le renversait presque sur le tapis, et murmurait :
— Non, non, je vous dis que je ne veux pas ! Moi, en dehors des tableaux que nous représentons, je ne marche que d’après mon goût, et je n’en éprouve aucun pour vous, là ! D’ailleurs, allez avec votre Férina qui ne demande pas mieux que de vous donner son cul. Je ne sais pas pourquoi Thérèse s’entête à vouloir que vous me baisiez. Je ne veux pas, et cela ne sera pas. Je suis peut-être bien ma maîtresse.
— Si, si, tu céderas ! Je me moque de La Férina ; je l’ai prise parce que je ne te connaissais pas encore ; et depuis que je t’ai vue, je ne veux plus d’autre femme. S’il me plaisait de coucher avec Thérèse, elle n’y apporterait pas tant de façon. Tu es la seule que je veux ici, et je t’aurai.
— Ici ! Vous ne m’aurez pas.
— Je t’aurai, quand je devrais t’attacher.
— Essayez donc.
Elle riait nerveusement ; d’un geste brusque elle le jetait sur le tapis, se disposait à l’enjamber pour se sauver. Déjà sur les genoux, il l’attrapait par les cuisses ; elle se tordait sous ses mains, et plus elle se tordait, plus les mains s’emparaient de ses chairs, couraient des cuisses aux fesses ; il mordait la robe pour la déchirer, jurant qu’il la remplacerait par dix autres plus belles ; elle le souffletait.
Se redressant, il la saisit à bras-le-corps ; ils luttaient comme des forcenés, elle pour l’empêcher de l’étreindre, lui pour la renverser et l’enconner. Ils tournaient et retournaient ; il la pétrissait des épaules aux seins et des seins aux hanches. Elle avait le visage enflammé de défi, elle raidissait tous les membres, les efforts qu’il faisait décuplaient ses forces. Il dénoua ses jupes, elles tombèrent sur le sol, l’entravant dans sa défense ; lui appliquant un gros coup de poing sur la poitrine, elle lui dit :
— C’est lâche de vouloir une femme qui ne vous veut pas.
— Pourquoi ne me veux-tu pas ?
— Parce qu’il ne me plaît pas d’être prise ainsi. Puis, moi, je préfère Jacques à tous les autres hommes, et je ne suis qu’à lui, ou à celui qu’il me désignera, parce que celui-là ce sera encore comme si c’était lui qui me baise. Allez donc lui demander s’il veut que vous m’enfiliez !
— Il n’est pas là.
— Attendez qu’il y soit, et laissez-moi tranquille.
Bertrand Lagneux était dans toute la vigueur de l’âge ; il bandait comme un taureau, et ses trente-trois ans, juste un de plus que Jacques, valaient ceux du montreur de plaisirs. Agent de change, habitué à des conquêtes faciles par sa situation de fortune et ses fréquentations, il se toquait de cette femme qui lui résistait, plus qu’il ne le fit jamais des autres.
Tout en se trouvant flatté de l’amour qu’avouait ainsi sa cousine, et que du reste il n’ignorait pas, Jacques, très suggestionné par la scène qui se déroulait sous ses yeux, se jurait bien de ne pas intervenir. Thérèse pouvait bien sucer Gaston Gressac jusqu’à complet épuisement de son sperme, il s’émoustillait de cette lutte amoureuse qui se poursuivait de plus en plus implacable et il lui eût été difficile de dire ce qui l’exciterait le plus, du triomphe ou de la défaite de Lina.
Le combat s’accusait, plus âpre, plus violent. Peu accoutumée à la résistance, Lina, malgré la sincérité de ses paroles, faiblissait dans ses moyens. La queue de Bertrand, qui s’allongeait devant elle hors de la culotte, exerçait son magnétisme voulu. Elle se présentait très vaillante, très tenace, en belle érection, très fine de peau, ce qu’elle savait, l’ayant effleurée plusieurs fois de la main dans les soubresauts de la lutte. Elle voulut même la pincer pour décourager son audacieux persécuteur, mais cela lui avait semblé monstrueux. Bertrand la tenait maintenant par la taille, son corsage ouvert, le visage sur ses nichons, qu’il baisait et suçait, dans les contorsions auxquelles elle se livrait. Et, dans ces contorsions, sa main rencontrait à tout instant la queue, la touchait, la palpait, finissait par la garder. L’échauffement de la volupté la gagnait. Bertrand la sentait moins opiniâtre dans son refus ; les jupons avec la robe s’étalaient sur le sol ; elle demeurait en chemise, avec son corsage débraillé ; il lui pelotait le cul à pleines mains, et lui chatouillait le minet ; elle tenta encore de glisser hors de ses bras, mais la queue la battait dans les cuisses, s’intercalait par moments très habilement, heurtant le con ; elle frappait sur le ventre, baisotait le nombril, la fustigeait. Lina se troublait, perdait la tête, ses sens s’éveillaient ; il devenait évident que Bertrand arriverait à ses fins. Un rude coup d’ombrelle l’atteignit sur les reins, au moment où il s’apprêtait à se ruer sur Lina, trahissant l’intention de se rendre. C’était La Férina, sa maîtresse, qui entrait en scène, et qui, moins complaisante que Jacques, ne permettait pas à l’infidélité de se commettre. L’ombrelle se relevait pour appliquer un second coup, Bertrand furieux se retourna, et voyant à qui il avait affaire, cria :
— Quoi, c’est vous ! En voilà une raide ! De quoi vous mêlez-vous ?
— Un peu de ce qui me regarde, il me semble ! Puis, il est honteux de vouloir baiser une femme qui refuse de se laisser faire ! Et vous avez un rude toupet, vous qui prétendez m’adorer.
— Vous m’embêtez ! Je vous adore quand ça me plaît, et j’entends adorer ailleurs quand ça me dit.
— Vous êtes un goujat ! Vous adorerez où ça vous dira, mais plus de mon côté.
— Allons donc, vous vous fâcheriez après m’avoir régalé de votre méchant coup d’ombrelle ! Nous disputons dans le vide, ma chère Marguerite, pardonnez-moi mes vilains mots, je vous pardonne votre intempestive violence.
La Férina, au fond, était une excellente nature ; puis, on ne rompt pas avec un amant de l’importance de Bertrand Lagneux pour quelques mots de colère. Elle laissa tomber la main dans celle qu’il lui tendait, et avec un sourire d’acquiescement répondit :
— Vous avez raison, ne nous brouillons pas. N’importe, voici une amoureuse qui ne bout pas en votre faveur ! Voyez, comme elle ramasse ses jupes, et comme elle se sauve ! Dites, dites, ma chère amie, nous sommes dans votre chambre, et c’est nous qui devons nous retirer. Le hasard seul m’a poussée à venir ici. Restez, restez, nous vous abandonnons la place.

XI
À l’apparition de La Férina, Jacques s’était
éclipsé ; elle arrivait par une porte opposée à
celle près de laquelle il se dissimulait. Il revint
rapidement à la chambre de sa femme, et
constata que ni Thérèse, ni Gaston Gressac ne
s’y trouvaient. Avaient-ils terminé leurs petites
cochonneries ? Il dégringola l’escalier, et sortit
dans les jardins. Là, il vit tout son monde.
Léa et Pauline avaient quitté les genoux d’Antoine,
et cueillaient des fleurs. Thérèse causait
avec Arthur des Gossins et Alexandre Brollé,
débarqués du train avec La Férina. Apercevant
son mari, Thérèse cria :
— Tu étais de retour, Jacques ? Comment se fait-il que je ne t’ai pas vu ?
— Il a traversé le jardin sans s’arrêter, répliqua Antoine, goguenard.
— Vraiment, et il y a longtemps ?
— Ma fois, plus d’un gros quart d’heure.
Thérèse s’approcha de son mari, lui mit une main sur le bras, et lui demanda :
— Où vous cachiez-vous, petit mari ? M’espionnais-tu, par hasard ?
— À savoir…
— Qu’as-tu vu ?
— Je vois La Férina et M. Lagneux qui sortent de la maison. Ils étaient donc ici ? En voilà des visites !
Il venait de rejoindre le groupe de causeurs, et considérait Gaston Gressac, affalé sur un banc, trahissant un très vif essoufflement, résultat certain de l’abus qu’il avait fait des lèvres de la jolie et coquine Thérèse.
Le doute n’en pouvait subsister dans l’esprit d’un homme d’expérience comme Jacques. Sa femme avait arraché le sperme à fortes doses des couilles du brave homme, et elle ne s’était arrêtée que par pitié. Du reste, si elle aimait de sucer, Gressac, de son côté, s’enrageait à ce qu’on le suçât, et nul n’ignorait qu’il recherchait ce plaisir avec une passion à y récolter des troubles physiques et moraux. Était-ce à une suceuse à s’en préoccuper ?
La pine de l’homme bandait dur dès que les lèvres féminines l’aspiraient, et ne demandait grâce qu’après trois ou quatre décharges. Peu lui importait la mort ou la décrépitude. Gaston Gressac, rencontrant une femme aussi jeune, aussi gentille, aussi jolie, aussi complaisante que Thérèse, sachant qu’elle ne refusait pas cette volupté, n’avait pas craint de la solliciter, contrebalançant ainsi les projets de sa femme Annette, visant à la maquereauter pour Arthur des Gossins.
Jacques ne contint pas un frisson de commisération, en le voyant effondré au point de ne pouvoir se lever pour lui serrer la main. Gressac s’excusait, rejetant sa fatigue actuelle sur une maudite quinte de toux qu’il venait de subir, attendant d’en être bien remis pour quitter son siège.
La Férina, aussi à l’aise que chez elle, ayant laissé son chapeau dans la maison, s’avança, sous une toilette claire, rose et blanc, encadrant de façon idéale sa beauté de blonde ; Bertrand la suivait gravement. Elle prit Thérèse par le cou, l’attira dans ses bras, lui donna un chaud baiser sur la bouche, qui permit d’apercevoir leur langues s’unir avec tendresse, et dit :
— Ah, ma jolie petite cocotte, je te croyais dans la maison, et tu en sortais comme j’y pénétrais. Je suis montée jusqu’à ta chambre, et, j’ai découvert mon excellent ami Bertrand, en train de ramasser sa veste auprès de ta cousine. J’espère que cela le corrigera de sa manie de me faire des queues. Je n’aime pas beaucoup cela, Monsieur. Lorsqu’on a l’honneur de compter parmi mes amis sérieux, on l’apprécie et on ne porte pas ailleurs ses hommages. Puisque Arthur est là, je le prierai de cesser pour quelques secondes sa bouderie, et de témoigner que je suffis à contenter et satisfaire un homme qui me conserve sa fidélité.
— Seulement, répondit Arthur des Gossins, si vous suffisez à contenter et à satisfaire un ami fidèle, comme vous prétendez, vous ignorez absolument pour votre part les mérites et les vertus de la fidélité.
— Vous ne voudriez pas qu’il en fût autrement ? Une femme n’acquiert de la valeur qu’en trompant ses amants.
En prononçant ces mots, elle lançait un regard en dessous à Jacques, qui observait une très grande réserve, et qui lui sourit de suite. En cet instant Lina survint à son tour ; elle avait changé de robe, et se montrait le teint encore animé de la lutte soutenue. Jacques se précipita à sa rencontre, l’embrassa fortement en lui disant tout bas :
— J’allais voler à ton secours, quand La Férina a frappé son amant. J’arrivais.
Elle lui rendit sa caresse, et lui pressa la main très significativement. Thérèse et La Férina se jetèrent en travers, et cette dernière s’écria :
— Ah bien, si on s’effusionne en famille, on ne sera guère aimable pour les visiteurs !
Jacques s’empara des deux mains de La Férina, l’attira à lui, la baisa sur la bouche, et répondit :
— L’exclamation est un défi, je le relève en vous embrassant devant M. Lagneux.
— Eh ! mon cher, toutes ces dames sont assez parfaites de beauté et de caractère pour n’être pas jalouses les unes des autres, et permettre de caresser à tort et à travers. Je vais embrasser votre cousine pour me venger de ce baiser à ma belle Marguerite.
Bertrand ne perdait pas la tête ; il en tenait décidément pour Lina ; Thérèse semblait le favoriser ; elle le poussa vers sa cousine, et Lina dût recevoir la caresse.
On pensa ensuite à se distraire, et on accueillit à l’unanimité la proposition de jouer au tonneau. Toute la société, même Léa et Pauline, courut vers la partie du jardin où l’on avait aménagé un carré assez spacieux pour y installer divers jeux.
D’un hangar, on tira le tonneau et l’attirail nécessaire. On se distribua les rangs, dames et cavaliers entendant prendre part au jeu. Le tonneau placé, on s’apprêtait à commencer, lorsqu’une violente hilarité se communiqua à toute la bande, en voyant Léa et Pauline grimper à une série de gradins en bois, sur lesquels on étageait des vases et qu’Antoine avait enlevés pour les remplacer par de nouveaux. Elles se trouvèrent juchées à une certaine élévation, d’où leurs mollets sollicitèrent bientôt les regards, et aussi les jambes qu’on distinguait à cause des jupes très courtes. Léa continuait son rôle de petite fille, d’autant plus volontiers qu’elle se rendait compte du piment que cela lui donnait. Elle s’appliquait à imiter Pauline, qui la traitait en vraie camarade et ne la jalousait pas, gagnant à cette fréquentation une liberté encore plus excessive que celle dont elle jouissait. Et Dieu sait si on lui en accordait !
Cette enfant n’était pas une vicieuse précoce du seul fait de son tempérament ; l’oncle et la tante la poussaient vers le dévergondage, le premier pour satisfaire surtout ses paillardises, la seconde pour la même raison, et aussi par intérêt d’avenir. Une fille qui est dégrossie, qui est dessalée, peut prétendre à tout.
Les deux fillettes (!) ne tardèrent pas à remarquer l’attention que provoquaient leurs jambes, et loin de s’en émouvoir, elles s’amusèrent à adresser des pieds de nez à celui-ci, à celle-là, tant et si bien que tout-à-coup, le tonneau délaissé avant le début de la partie, on vit Bertrand Lagneux donner le signal de la polissonnerie.
Avant qu’on ne songeât à l’en empêcher, il montait sur le gradin au-dessous de celui où se tenaient les deux espiègles gamines, s’y asseyait, et, envoyant la tête en arrière, juste sous les jupes de Léa, qui ne bougeait pas, criait :
— Ohé ! les enfants, un superbe effet de lune, que ça vous jette des frissons dans tout le corps !
Thérèse s’élança à sa suite, aperçut le gonflement de sa queue derrière sa culotte, se laissa choir sur le gradin au-dessous de celui qu’il occupait, renversa crânement la tête sur ses cuisses, comme si elle voulait aussi contempler sous le ballonnement des jupes que sa sœur, experte en matière paillarde, agitait, et sentant la queue en érection, elle se tourna sur les genoux, disant à Bertrand de la sortir pour qu’elle la suçât ; elle se retroussa en même temps sur le dos, en face de la société ébahie, et s’exclama :
— S’il admire la lune au-dessus de sa tête, en voici une autre que je vous montre, afin que vous ne lui disputiez pas celle qu’il a découverte.
C’était la licence affichée. Jusqu’ici, si on se fréquentait, et cela depuis si peu de temps, on observait des limites ; on soupçonnait bien qu’il s’établissait des relations de luxure, on ne les accusait pas ouvertement, surtout pour les gens du monde que représentaient Bertrand Lagneux, Arthur des Gossins, Alexandre Brollé, et aussi Gaston Gressac, malgré ses louches entreprises, dirigées principalement par sa femme, qu’il avait épousée contre le gré de sa famille.
Thérèse se moquait donc du tiers et du quart en agissant avec un tel sans-gêne. Et contre ses fesses une main venait s’égarer, celle d’Alexandre Brollé, avec qui elle fit l’amour lors de sa fugue du foyer conjugal. Arthur des Gossins n’osait trop se risquer ; il n’avait cependant rien à redouter.
La famille Phoncinot acceptait des cachets pour figurer chez des particuliers les scènes érotiques de la volupté. Il l’avait payée pour une représentation chez sa maîtresse d’alors, La Férina : il en fut mal récompensé ; mais il se liait avec les femmes de cette famille, il se rencontrait dans leur maison d’Asnières avec des personnes de son monde, il serait un sot de ne pas profiter de la luxure qui couvait autour de lui et agissait sur ses sens. Il se trouvait tout près de Pauline Turlu, debout à l’extrémité du gradin, devant un petit espace vide, et d’où on pouvait facilement glisser sous sa jupe. Elle le devina hésitant, elle lui adressa un geste d’encouragement des yeux, et lui dit à haute voix :
— Venez voir la lune, moi aussi j’en ai une.
Allait-il franchir ce pas redoutable, qui le mettrait en contact avec une très jeune mineure ? Il oscillait sur ses jambes ; ses regards dévoraient les mollets de l’enfant, qui s’approchait à l’extrême limite du gradin pour achever de le tenter ; il succomba. Son front arrivait à la hauteur de ces mollets qui le fascinaient, quoique ne pouvant encore rivaliser avec ceux de Léa, de Thérèse. Il ne leva pas de suite la tête sous les jupes, il appuya les lèvres sur les fines chevilles, il les prit dans la main, il eut peur de voir Pauline trébucher, il ne sut comment cela se produisit, elle s’affaissait sur les pieds ; il tenait pressé sur son visage le jeune cul qui se trémoussait gentiment. La fillette avait glissé sur lui pour qu’il l’emportât loin du gradin.
Gaston Gressac avait secoué son apathie, il rejoignait la société, il assistait à l’ascension des gradins, s’esclaffant.
— Ah, les mâtines, elles ont plus de toupet que leurs aînées !
Entre La Férina et Lina, Jacques paraissait indécis. La Férina le poussa du coude, et dit :
— Je ne montre pas la lune en public, moi ! Si on veut la voir, on n’a qu’à me courir après.
Elle s’élança dans le jardin, Jacques bondit à sa suite, malgré le regard de Lina le suppliant de rester. Mais ce n’était pas encore l’heure de son triomphe sur la courtisane. Léa, qui venait de voir enlever Pauline par Arthur des Gossins et qui, debout au-dessus de la tête de Bertrand Lagneux, constatait avec ennui que non seulement il ne la pelotait pas, mais encore frémissait sous le suçage de Thérèse, descendit rapidement les gradins, et cria :
— Et le jeu du tonneau, on n’y pense plus ?
Antoine profita de l’exclamation pour jouer un mauvais tour à son cousin Jacques, en l’interpellant de ces mots :
— Hé, là-bas, reviens donc par ici, toi, on veut jouer au tonneau, et il me semble que tu laisses trop s’émanciper ta femme !
Thérèse, toute rouge, lâcha la queue de Bertrand, sauta à bas des gradins, se précipita sur Antoine, et le pinçant au bras, lui dit :
— De quoi te mêles-tu ?
— D’empêcher les bêtises.
Arthur des Gossins, qui tenait sur ses épaules la petite Pauline, laquelle se tortillait comme une anguille, pour mieux le favoriser dans ses hardiesses sur ses parties sexuelles, remit la fillette à terre, et rappelant sa raison, donna son appui au rappel du jeu de tonneau.
Bon gré, mal gré, Jacques et La Férina, qui s’étaient arrêtés à l’apostrophe d’Antoine, revinrent sur leurs pas, et on prit son rang pour lancer les plaques dans la bouche du crapaud. Le numéro 1 appartenait justement à La Férina ; elle les jeta avec une maladresse voulue, à tort et à travers, tout en ayant cependant l’air de viser.
— Ah ! lui dit Arthur, qui avait le numéro 2 et qui se trouvait à son côté, vous eussiez mieux fait de passer votre tour.
— Sûr, répondit-elle, chacun devrait être libre de prendre son plaisir comme il l’entend, et il y a des choses qui seraient plus agréables à lancer et à recevoir.
— Margot, si vous vouliez, on se raccommoderait ! Je crains bien que votre amoureux actuel ne soit un coureur enragé, tandis que tous les deux on s’entendait si bien. Puis, le passé nous unissait. Ah, je vous regrette, et je maudis la pensée que j’ai eue de vous amener ce monde. Qui sait où cela peut nous conduire ?
Elle fut touchée de ce que lui murmurait son ancien amant, et répliqua :
— Est-ce moi qui me suis fâchée, et n’est-ce pas plutôt vous qui avez rompu ?
— Je me repens, Margot, oublions notre brouille.
— Je ne dis pas non. Le Lagneux m’embête. Tiens, grosse bête, jette vite tes plaques et viens causer sur ce banc.
— Et… Jacques Phoncinot ?
— Ça, ce n’est pas le sérieux comme entre nous.
Envoyait-elle Jacques par dessus bord, dans son désir de renouer avec l’amant qui lui donnait tout ce qu’elle désirait, l’aimant vraiment et lui accordant beaucoup de libertés ? Les femmes sont volages… autant que les hommes. Antoine, qui succédait à Arthur des Gossins pour le tonneau, entendait ou n’entendait pas la conversation ; il les regardait d’un œil paterne ; ses préférences se marquaient pour Pauline et Thérèse. Léa, qui était derrière, lui allongea une forte claque sur les fesses, et dit :
— Que si on le voulait, on commettrait bien des farces avec le monde qui nous visite.
— Mon avis, petite, est qu’il vaudrait mieux garder ça pour soi. Ces messieurs ont trop de chic pour notre genre, ils se payent votre cul, et ils se foutent de nous. Examine-moi l’Arthur ; il ne perd pas du nez la jupe de son ex-maîtresse, et s’il pouvait la faire filer il ne mettrait pas souvent les pieds dans notre cambuse. J’ai bien remarqué qu’il vient les jours où il sait la rencontrer, et ça m’étonne qu’il ait marché avec la gosse. Vois-tu, ça ne me dit rien de bon que Jacques soit aussi attaché après cette cocotte.
— Et Thérèse, est-ce qu’elle n’y court pas après ?
— Vous n’avez pas fini de jaboter tout bas ? dit Lina, prenant le tour après Léa.
Mais le jeu ne trahissait aucun entrain, des impatiences se manifestaient, et des mauvaises humeurs s’affichaient. Jacques ne voulut pas jouer lorsque ce fût à lui. Il considérait avec ennui La Férina et Arthur, installés sur un banc et causant très intimement. D’un autre côté, Bertrand Lagneux paraissait se désintéresser de plus en plus de sa maîtresse, et accablait Lina de prévenances et de taquineries polissonnes. Jacques s’en irritait, parce qu’en dehors de La Férina, ses yeux ne cessaient de caresser ceux de sa cousine ; Thérèse se dépitait de se voir négligée par les deux principaux de ses visiteurs, et cependant Alexandre Brollé et Gaston Gressac ne la quittaient pas d’une semelle. Pour Pauline, elle trottinait autour d’Antoine et de Jacques.
On abandonna le tonneau, c’était le moment d’offrir à se rafraîchir. Léa et sa sœur Thérèse s’en occupèrent, et portèrent ce qu’il fallait sous une tonnelle qu’ombrageaient de beaux arbres. L’intimité allait-elle se rétablir ou bien les vraies licences s’autoriser ?
Les tendances à batifoler reparaissaient et ce joli cadre de jardin, animé par les membres de cette famille exceptionnelle faisant un art de la paillardise, disposait aux folichonneries de la chair des êtres bien créés pour les comprendre et les pratiquer. Les intérêts privés intervenaient néanmoins pour entraver les élans.
La Férina, lasse de Bertrand Lagneux, ne se cachait plus pour afficher la future reprise de ses relations avec Arthur. Les deux hommes auraient échangé des mots désagréables, s’ils se fussent trouvés dans un tout autre milieu. Malgré son dépit de voir La Férina si accaparée par son ancien amant, Jacques, craignant de perdre l’appui moral que lui valaient les visites de ces gens riches fréquentant sa maison, se préoccupant aussi du succès de son entreprise de tableaux vivants, s’appliquait à favoriser les petites audaces de luxure.
Sous la tonnelle, autour de la table rustique, étaient rangés des fauteuils en osier, et sur un des côtés un banc, d’où l’on montait sur deux hamacs installés aux arbres. Léa et Pauline, comme elles avaient grimpé sur les gradins, ne cessaient de se planter sur le banc, d’où elles apostrophaient dames et cavaliers avec beaucoup d’esprit libre et goguenard. Thérèse, ennuyée de l’effet hallucinant qu’exerçaient leurs jambes sous leurs jupes courtes, y monta, et retroussant ses robes à hauteur des genoux, cria :
— Abusent-elles de leur toilette de petites filles ! Ces petites cochonnes ne permettent pas à ces messieurs de s’apercevoir que nos mollets, pour ne pas être visibles, n’en sont pas moins tout aussi attrayants que les leurs. Là ! qui palpe les miens, pour juger de la différence ?
Gaston Gressac s’assit bravement sur le bord du banc, près de sa jambe, s’empara des deux mollets, et dit :
— Pristi ! que ça ravigote un homme de toucher si gentils mollets ; mais moi, quand je touche là, il faut que je touche les cuisses, et si je touche les cuisses, je ne sais plus ce que je fais.
Ses mains prenaient de plus en plus possession des sexualités de la jeune femme ; Thérèse se prêtait de son mieux à son pelotage, et il la patouillait au cul et au con. Levant les yeux, il murmura :
— Dis, ma belle enfant, si on retournait là-bas ? On y recommencerait à berlingoter.
Il poussa tout à coup un cri. Pauline, descendue du banc, s’était approchée tout doucement derrière Thérèse, avait glissé la tête sous ses jupes, et, trouvant la main de son oncle posée en plein sur les fesses, venait de la mordre. Puis elle se sauva, pour éviter la claque qu’il s’apprêtait à lui allonger. À demi furieux de l’incartade de sa nièce, il s’élança à sa poursuite pour la châtier. Thérèse, riant comme une folle, sauta à terre, courut après à son tour pour protéger la fillette, et aussi pour se rendre à la demande de berlingoter, qui lui souriait toujours. Lina, pour esquiver Bertrand Lagneux, monta sur le banc à la place de Pauline, et comme Jacques était tout près, elle l’attira à elle, et lui dit :
— Je veux que, pour ta part, tu compares mes mollets à ceux de Léa.
Celle-ci se mit bien vis-à-vis, dans l’intention de se prêter à la comparaison, tout en cherchant à taquiner Arthur des Gossins qui, avant de revenir à La Férina, la courtisait assez ouvertement. Jacques patouilla avec complaisance les mollets de Lina, qu’il connaissait cependant aussi bien que ceux de sa belle-sœur ; celle-ci se pencha, lui souffla tout bas dans l’oreille :
— Prépare-toi bien : je vais sauter sur les genoux de M. des Gossins, et tâche de suivre La Férina. Elle se dirige du côté de la maison, je le parierais, pour prendre son chapeau et s’en aller.
L’occasion se présentait-elle sérieuse ? La Férina s’éloignait en effet d’Arthur des Gossins. Leur accord était conclu ; elle lui avait annoncé qu’elle partait et qu’elle l’attendrait à la gare. Il la laissait aller à l’habitation, et elle ne fût pas plus tôt à mi-chemin que Léa, bravement, s’installa sur ses genoux, et lui dit :
— Petit monsieur, vous n’êtes pas du tout gentil pour les petites filles ! Vous ne leur offrez pas des bonbons, et vous ne les caressez pas !
Elle imitait à merveille une enfant mignarde ; elle sentit qu’il bandait à son contact, elle tortilla habilement les fesses, et continua :
— Savez-vous ce qui serait bien aimable ? Ce serait de me porter dans vos bras comme une gamine, jusqu’au jeu de tonneau, et nous y jouerions rien que tous les deux. On s’amuserait mieux que lorsqu’on était tous.
En même temps, elle lui passait les bras autour du cou, elle le câlinait des yeux. La Férina échappait à son attention ; il pensa qu’il serait bien sot de ne pas polissonner quelques secondes avec cette délicieuse tourterelle.
Il consentit à sa demande, se leva, et la tenant dans ses bras comme on tient une enfant, il se dirigea du côté du tonneau.
Lina n’osa intervenir devant la fièvre qui s’emparait de son cousin ; elle le vit partir de la tonnelle, s’engager dans l’allée que suivait La Férina. Elle ne défendit plus ses jambes aux entreprises de Bertrand, maître enfin de la situation. Elle était seule en sa présence. Alexandre Brollé accompagnait Antoine lui expliquant des modifications qu’il comptait faire dans le jardin. Comme Bertrand Lagneux glissait la tête sous sa robe, pour la manger de minettes, elle lui dit :
— Soit, léchez-moi, puisque vous êtes si tenace ; mais je vous préviens que vous ne m’aurez pas encore aujourd’hui. S’il vous faut baiser une femme, vous agiriez plus sagement en courant après votre maîtresse, La Férina, qui me semble vous lâcher pour reprendre son ancien amant.
— Je m’en fous, je ne veux que toi, et je te donnerais tout ce que tu voudrais pour t’entretenir, si tu consentais à m’aimer.

XII
Jacques rattrapa La Férina, avant qu’elle n’arrivât à la maison. À son pas pressé qu’elle entendit, elle se retourna, et lui souriant, murmura :
— Vous avez deviné que j’allais rentrer à Paris. Il le faut. J’ai soupé de cet animal de Bertrand. Arthur se repent, je serais une sotte de ne pas le reprendre comme amant. Mais, ne vous en inquiétez pas, nous lui tresserons ensemble une couronne de cornes.
Marchant à son côté, il avait saisi une de ses mains et la couvrait de baisers, tout en répétant :
— Pas encore aujourd’hui ! Il y a comme une fatalité qui se jette entre nous, lorsque j’espère enfin pouvoir te posséder.
— Ce ne sera que meilleur, quand nous le ferons. Modère-toi ; ne va pas empêcher ma réconciliation.
— N’aie pas peur, quelqu’un s’occupe de ton amant.
— Halte-là ! je ne veux pas qu’on me le souffle.
— Moi non plus. Il n’y a qu’une seule femme de ma famille en état de le faire, et celle-là, je la garde.
— Heureux pacha !
Il ne s’arrêtait pas de baiser sa main ; La Férina consentit à rentrer dans la maison par une petite porte, afin qu’il pût au moins adresser quelques dévotions à ses sexualités. Il espérait, dès qu’il aurait la bouche sur son cul ou sur son con, la grimper rapidement, et enfin jouir de cette femme, qu’il désirait depuis si longtemps. Comptait-elle de son côté qu’il saurait profiter de l’occasion ?
Ils traversèrent la cuisine, et apercevant dans un cabinet un canapé-lit, elle s’arrêta devant, et jeta un regard expressif à Jacques. Presto, il la retroussa par derrière, et voyant qu’elle tendait les fesses, il sortit la queue afin de la posséder en levrette. Elle ouvrit les cuisses, elle acceptait de se livrer. Il bandait dur. Les parties sexuelles de la jolie horizontale exerçaient leur attirance ; le cul, blanc et potelé, ressortait sous l’élégance de la toilette et des dessous, fascinait ses yeux, brûlait son ventre ; il pointait ferme ; elle s’affaissait légèrement, le buste en avant, pour qu’il s’appuyât bien à sa croupe, et qu’il pénétrât sans trop de difficulté dans son vagin ; elle s’émouvait en sentant la queue s’enfoncer, et se précautionnait néanmoins pour arranger sa robe afin d’éviter des plis accusateurs.
L’action débutait on ne peut mieux ; il la prenait et elle s’abandonnait ; la queue fouillait tout le vagin ; ils ne parlaient pas, mais échangeaient de hâtifs baisers et de très langoureux regards. Ils entendirent remuer dans une pièce peu éloignée, et ils tressaillirent à des petits rires étouffés ; d’un mouvement instinctif, ils se séparèrent ; la queue, sans débander, se trouva hors du con. Un certain émoi les troublait ; la même idée leur vint, se rendre compte de ce qui se passait ; les jupes de La Férina retombèrent, la queue de Jacques rentra dans la culotte.
Ils s’avancèrent sans bruit, et dans la salle qui servait pour les répétitions, ils virent Gaston Gressac juché sur l’estrade où l’on étudiait les postures érotiques, les jambes pendantes, et entre ses jambes écartées, Thérèse debout, la tête entre ses cuisses, le suçant de nouveau, tandis que par derrière elle, la petite Pauline, accroupie sur les talons, lui tenait les jupes relevées et lui léchait le cul.
Le spectacle valait la peine d’être contemplé pour l’ardeur que les trois personnages apportaient à leur œuvre de luxure. Jacques ressortit sa queue, et la montrant à La Férina lui demanda tout bas de la sucer. D’un signe de tête elle refusa, et murmura qu’elle ne savait pas caresser les autres, qu’elle préférait être caressée. Il affecta un tel dépit que levant les épaules, elle le menaça de reprendre son chapeau et de partir de suite. Mais Pauline, qui avait l’ouïe très fine, venait de percevoir le froissement des jupes et le chuchotement des voix. Elle se retourna, et les reconnaissant, se dressa tout à coup, en criant :
— Ah, zut ! elle est encore là, celle-là !
Thérèse suspendit son suçage, et, à la vue de son mari et de La Férina, elle eut un geste de désappointement et s’exclama :
— C’est bête de ne pas laisser les gens tranquilles, quand on cherche soi-même à commettre des sottises !
— Le hasard seul nous a conduits ici, riposta La Férina. Je venais chercher mon chapeau pour me retirer, et Jacques m’a suivie.
— Ah ben, il a un drôle de goût ! vociféra Pauline. Il te court après, alors qu’il fait l’amour avec ma tante !
— Qu’est-ce que c’est, que dit-elle ? hurla Gaston Gressac, assis sur l’estrade.
— Tu ne vas pas poser à la jalousie, continua la terrible Pauline. Tu fais des cochonneries avec Thérèse, avec Horacine, avec d’autres, et avec moi aussi, et ma tante a bien raison de vouloir être enfilée par le mari de Thérèse ! Mais moi, je ne veux pas qu’il tire des coups avec La Férina ; elle n’est pas de notre monde.
La jolie horizontale ne cachait pas que les apostrophes de la petite la tourmentaient fort ; elle avait déjà été très ennuyée du peu de politesse qu’elle lui témoignait, malgré ses avances très catégoriques ; elle surmonta l’embarras qu’elle ne parvenait pas à dissimuler, et dit :
— Je ne comprends pas, mademoiselle Pauline, pourquoi vous persistez à me montrer mauvais visage, et à me traiter de vilaine manière.
— Je te traite comme tu le mérites. Je n’aime pas qu’une ancienne domestique de mes parents se considère comme mon égale. Tu as été ma bonne, lorsque j’étais toute petite, et tu ne faisais pas ta fière à cette époque. Je sais bien que tu as mangé tout notre argent en faisant croire à mon père que tu l’aimais ! Ce n’est pas un motif, parce qu’il a payé ton genre, de te figurer avoir le droit de paraître dans les maisons où nous fréquentons. Je voulais te dire ça depuis longtemps. Cette fois-ci, c’est sorti. Tout le monde le saura. Oui, oui, oui, tu as été domestique chez mes parents, et tu as causé le chagrin de ma pauvre mère.
— Vous perdez le bon sens, Pauline. Je ne suis cause du chagrin de personne. Et si j’ai été domestique chez vos parents, je n’en suis pas moins plus instruite que vous ne le serez jamais, et élégante comme vous n’arriverez jamais à l’être. Le sort ne m’a pas permis de connaître mes parents. J’ai été très malheureuse dans mon enfance, et aussi chez vous. Maintenant je vis comme je l’entends, et je possède d’assez fortes économies pour me passer de qui me déplaît. Je ne mettrai plus les pieds chez votre oncle et chez votre tante, ni ici, puisqu’une mauvaise charogne de votre âge se déclare mon ennemie.
Gaston Gressac était descendu de l’estrade ; il attrapa sa nièce par une oreille et la secoua brutalement ; puis il lui allongea un coup de pied dans le derrière, en disant :
— Ah ! la sale teigne, elle pourrirait toute la terre ! Ah ! la vipère, elle se permet de faire du chahut chez les amis !
La nièce ne craignait pas l’oncle ; elle se recula pour éviter un second coup de pied qu’il lui destinait, et répliqua :
— Je pourrirai toute la terre, mon oncle ? Avec ça que ce n’est pas vous qui m’avez pourrie ! N’est-ce pas vous qui, quand j’avais dix ans, veniez m’éveiller dans mon petit lit pour que je vous suce la carotte, comme vous disiez ? N’est-ce pas vous qui vous cachiez derrière les rideaux, ou sous les meubles, pour me voir amorcer les hommes qui vous rendent visite ? Eh bien ! si je vous dénonçais tous, qu’est-ce qui ferait la tête ?
On pouvait craindre que Gaston Gressac ne suffoquât sous l’apoplexie qui lui gonflait les veines du cou ! Quant à Jacques, il était livide. La foudre éclatait sur sa maison par le fait de cette petite. Seule Thérèse gardait son sang-froid. Avec adresse, elle attira Pauline dans ses bras, et dit :
— Voyons, voyons, est-ce ainsi que tu me remercies de mes gentillesses ! Faudra-t-il que nous pleurions tous parce que tu es sottement en colère ! Si tu es froissée de te rencontrer avec Marguerite, et bien à tort, car il n’existe pas beaucoup d’aussi jolies femmes, pourquoi menacer ton oncle et nous tous ?
— Je ne menace que mon oncle, qui m’a battue, et qui ne doit pas se le permettre. Il est un ingrat ! Si je disais tout ce qu’il demande…
— Calme-toi, ma mignonne, et tais-toi. Viens, viens, allons dans ma chambre, nous raisonnerons les choses en bonnes petites camarades. Que ton oncle nous suive, tu verras, je vous ferai réconcilier.
Pauline se laissait entraîner, mais conservait son attitude mauvaise et menaçante ; Gaston Gressac marchait derrière comme un homme ivre. La Férina et Jacques demeuraient les seuls maîtres du terrain ; le sang bourdonnait aux tempes de celui-ci. La Férina s’approcha à petits pas, appuya une main sur son épaule, et murmura :
— Ne pense plus à cette scène ! Dis, Jacques, que veux-tu de moi ? Je te ferai tout ce que tu me commanderas, pour que tu m’aimes. Veux-tu… ce que tu me demandais tout à l’heure ? Je ne te refuserai plus ? Veux-tu me baiser, veux-tu que je me mette toute nue et que je t’excite ?
Il semblait ne pas entendre. La peur de la dénonciation proférée par Pauline pesait sur son esprit. La Férina se blottit contre sa poitrine, leva des yeux tendres sur les siens, et reprit tout bas :
— Dis, veux-tu que je te suce, pour chasser ton cauchemar ?
La douce chaleur de son corps agit sur les sens du montreur de plaisirs ; il pressa La Férina sur son cœur et son visage prit une ineffable expression admirative. Quoi, ce trésor de grâces féminines, qui se pressait entre ses bras, cela avait été une servante ! Sous ce luxe élégant et coquet de la toilette, sous ce cadre clair et de bon goût, se mouvait une femme issue de souche vulgaire ! Comprenait-elle sa pensée ? Elle dégrafait son corsage, elle ouvrait sa chemise, elle exhibait son cou, sa poitrine, ses seins, d’immaculée blancheur, et disait :
— Oui, je fus domestique, oui, je servis et j’eus de tristes débuts ! Cela empêche-t-il que je sois aussi pure, aussi fine, aussi délicate, aussi soignée qu’une dame de la haute aristocratie ? On m’a toujours adorée, Jacques, et je me suis toujours appliquée à me rendre belle et désirable, pour rester la jolie poupée qu’on me prétendait être ! Elle t’a conté que j’avais été sa bonne, que j’avais ruiné son père ; ce qu’elle n’a pu te dire, apprends-le. Dans un moment de noire misère, j’ai traversé cette épreuve, et c’est peut-être de là que je suis sortie la femme actuelle. Là où d’autres perdent leur personnalité, se salissent, je me suis élevée et instruite. On me gobait par périodes, mais j’étais si mignonne, si réservée, que jamais on n’exigea plus de moi que le service du coup à tirer. Je te le jure, et je sens que tu me croiras, je n’ai jamais caressé un homme, ni même une femme, parmi celles qui m’aimèrent, et on m’a toujours caressée avec de folles rages. Jacques, je n’ai vraiment éprouvé que le jour où je me livrai pour la première fois à tes caresses. Ah ! comme je parlais avec mon cœur en te proposant de tout quitter pour rester tous les deux seuls, ensemble ; et j’ai été bien fâchée de te voir courir après ta femme ! Dis, veux-tu maintenant ? Tu ne m’as pas encore eue depuis des mois que nous nous connaissons. Ah ! qu’as-tu ? Pourquoi me serres-tu si fort le bras ?
— Oh ! ne parle plus ainsi, ta voix me brûle l’âme et les sens ! Je ne puis plus rien, tant je te désire. Il faut que je te baise, que je jouisse de ton amour à ma soif. Viens, suis-moi chez moi, où nous serons seuls, et où nous oublierons tout, tout.
— Oui, oui, mène-moi au bout du monde.
Il l’entraîna dans sa chambre, et en quelques secondes ils se dépouillèrent de tous leurs vêtements. Il voulait se repaître de tout son corps, il voulait constater combien elle était vraiment déesse des pieds à la tête. Et alors, jouissant déjà de l’embarras qu’elle éprouvait à sa demande, il exigea le soixante-neuf, en se plaçant au-dessus d’elle. Ah ! les furibondes caresses ! Elle n’avait jamais sucé, mais elle ne se lassait pas de téter sa queue, pas plus que lui de fourrer la langue dans son vagin ; la frénésie des transports les emporta, ils roulèrent dans les bras l’un de l’autre, et enfin Jacques posséda La Férina, cette femme qu’on disait vibrer seulement sous les caresses d’Horacine, et qui faillit mourir suffoquée sous la sensation délirante qu’il lui procura.
L’amour accomplissait sa merveilleuse et réconfortante mission ; de l’époux dépravé qu’était Jacques, il faisait un amant ardent et tendre, épris de cette nouvelle maîtresse plus que de sa femme, de ses femmes de volupté ; il faisait de La Férina une amoureuse exquise et fine, apte à s’assurer la constance de l’amant sous les assauts duquel elle trouvait enfin la jouissance. Quelles fièvres ils vivaient ! Ils ne ressentaient pas de fatigue. Ils s’arrachèrent avec peine à leur passion, car la voix d’Antoine retentissait, criant :
— Ces dames au salon, dans la toilette où elles sont, ou je fous le feu à la baraque !
Un piétinement, des portes qui s’ouvrent, des pas de ci de là, étourdis et nus. La Férina et Jacques quittèrent leur chambre, accoururent ; ils se retrouvèrent avec Thérèse et Pauline, aussi peu vêtues qu’ils l’étaient. Antoine, seul costumé, avait une canne à la main.
— Mesdames, dit-il, je me moque de vous déranger ; mais ma femme Lina vient de m’administrer une paire de gifles, parce que je voulais monter tirer mon coup avec elle ; quant à la cousine Léa, occupée à jouer au tonneau avec ces messieurs, Bertrand Lagneux, Arthur des Gossins et Alexandre Brollé, à ma proposition de l’enculer, faite avec toute la discrétion convenable, elle a répondu : « zut ». Il ne me reste plus que vous ; quelle est celle qui me prête une de ses boîtes à décharge ?
— Tu nous appelles pour ça, cochon ? cria Thérèse.
— On voit bien que tu as ton affaire, toi ! Je suis sûr que Gressac te l’a foutu ailleurs que dans la bouche. Bast, ça ne t’estropiera pas de m’ouvrir ton petit paradis ! Non, tu ne veux pas ? La belle Férina me refuse ? Eh, oui ! ce n’est pas gentil. Le cousin vous a bouchée dans les grandes dimensions ! Bon, bon, ne vous fourrez pas dans son cul. Ben quoi, reste cette petite ! Hé, hé, elle a le poil qui pousse au ventre. Voyons, on a rigolé dans le jardin… tu ne dis pas non, mon enfant, ma chatte, ma petite tarte à la crème ?
— Je veux bien, moi, dit Pauline Turlu, mais tu me pousseras ta machine dans le trou du cul ; le reste est encore fermé, et il faut que ça soit un capitaliste sérieux qui crochète la serrure. Ma tante me tuerait autrement.
— Ô ! l’ange de ma pine, viens vite recevoir mon sperme !