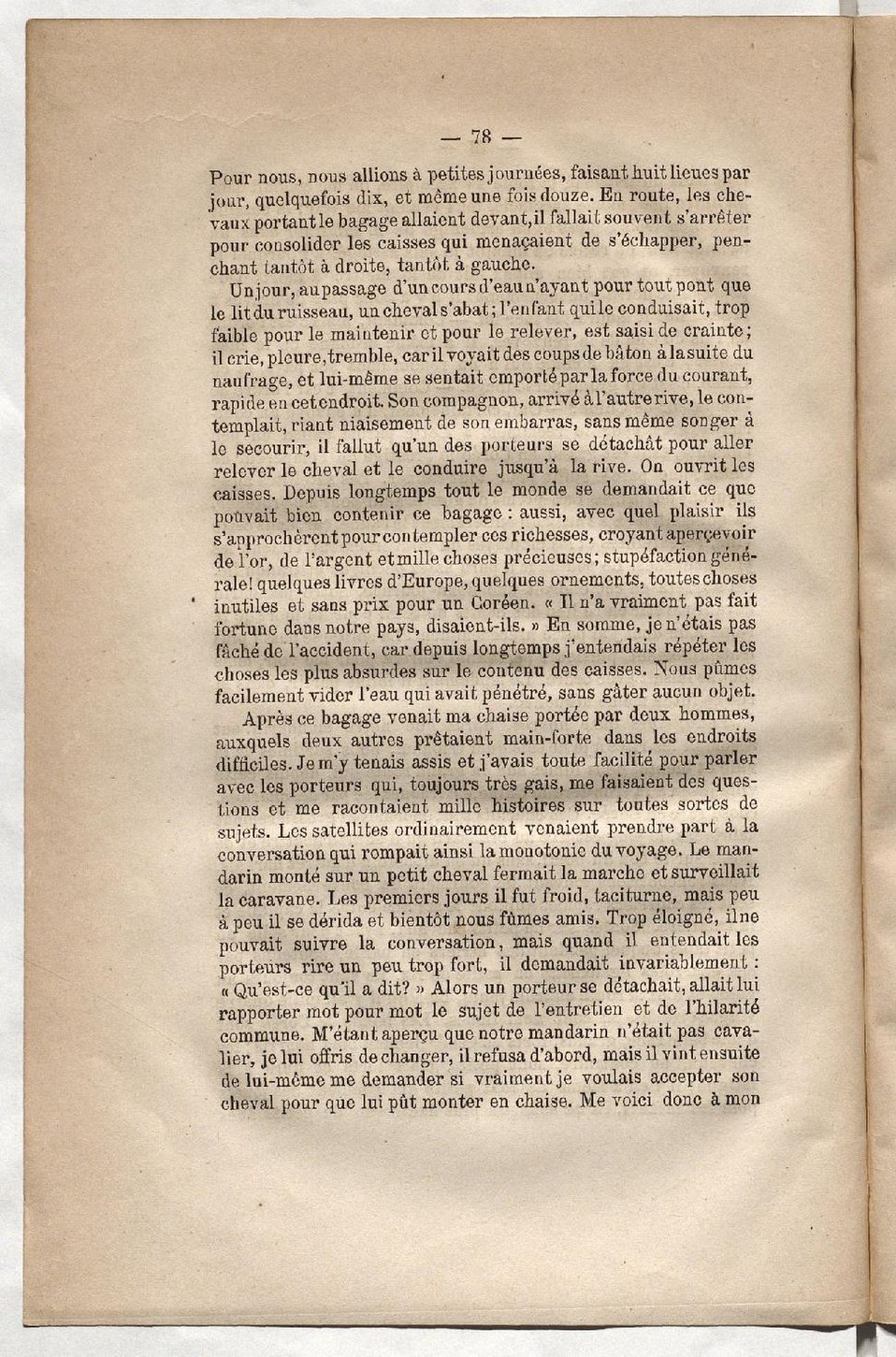Pour nous, nous allions à petites journées, faisant huit lieues par jour, quelquefois dix, et même une fois douze. En route, les chevaux portant le bagage allaient devant, il fallait souvent s’arrêter pour consolider les caisses qui menaçaient de s’échapper, penchant tantôt à droite, tantôt à gauche.
Un jour, au passage d’un cours d’eau n’ayant pour tout pont que le lit du ruisseau, un cheval s’abat ; l’enfant qui le conduisait, trop faible pour le maintenir et pour le relever, est saisi de crainte ; il crie, pleure, tremble, car il voyait des coups de bâton à la suite du naufrage, et lui-même se sentait emporté par la force du courant, rapide en cet endroit. Son compagnon, arrivé à l’autre rive, le contemplait, riant niaisement de son embarras, sans même songer à le secourir, il fallut qu’un des porteurs se détachât pour aller relever le cheval et le conduire jusqu’à la rive. On ouvrit les caisses. Depuis longtemps tout le monde se demandait ce que pouvait bien contenir ce bagage : aussi, avec quel plaisir ils s’approchèrent pour contempler ces richesses, croyant apercevoir de l’or, de l’argent et mille choses précieuses ; stupéfaction générale ! quelques livres d’Europe, quelques ornements, toutes choses inutiles et sans prix pour un Coréen. « Il n’a vraiment pas fait fortune dans notre pays, disaient-ils. » En somme, je n’étais pas fâché de l’accident, car depuis longtemps j’entendais répéter les choses les plus absurdes sur le contenu des caisses. Nous pûmes facilement vider l’eau qui avait pénétré, sans gâter aucun objet.
Après ce bagage venait ma chaise portée par deux hommes, auxquels deux autres prêtaient main-forte dans les endroits difficiles. Je m’y tenais assis et j’avais toute facilité pour parler avec les porteurs qui, toujours très gais, me faisaient des questions et me racontaient mille histoires sur toutes sortes de sujets. Les satellites ordinairement venaient prendre part à la conversation qui rompait ainsi la monotonie du voyage. Le mandarin monté sur un petit cheval fermait la marche et surveillait la caravane. Les premiers jours il fut froid, taciturne, mais peu à peu il se dérida et bientôt nous fûmes amis. Trop éloigné, il ne pouvait suivre la conversation, mais quand il entendait les porteurs rire un peu trop fort, il demandait invariablement : « Qu’est-ce qu’il a dit ? » Alors un porteur se détachait, allait lui rapporter mot pour mot le sujet de l’entretien et de l’hilarité commune. M’étant aperçu que notre mandarin n’était pas cavalier, je lui offris de changer, il refusa d’abord, mais il vint ensuite de lui-même me demander si vraiment je voulais accepter son cheval pour que lui pût monter en chaise. Me voici donc à mon