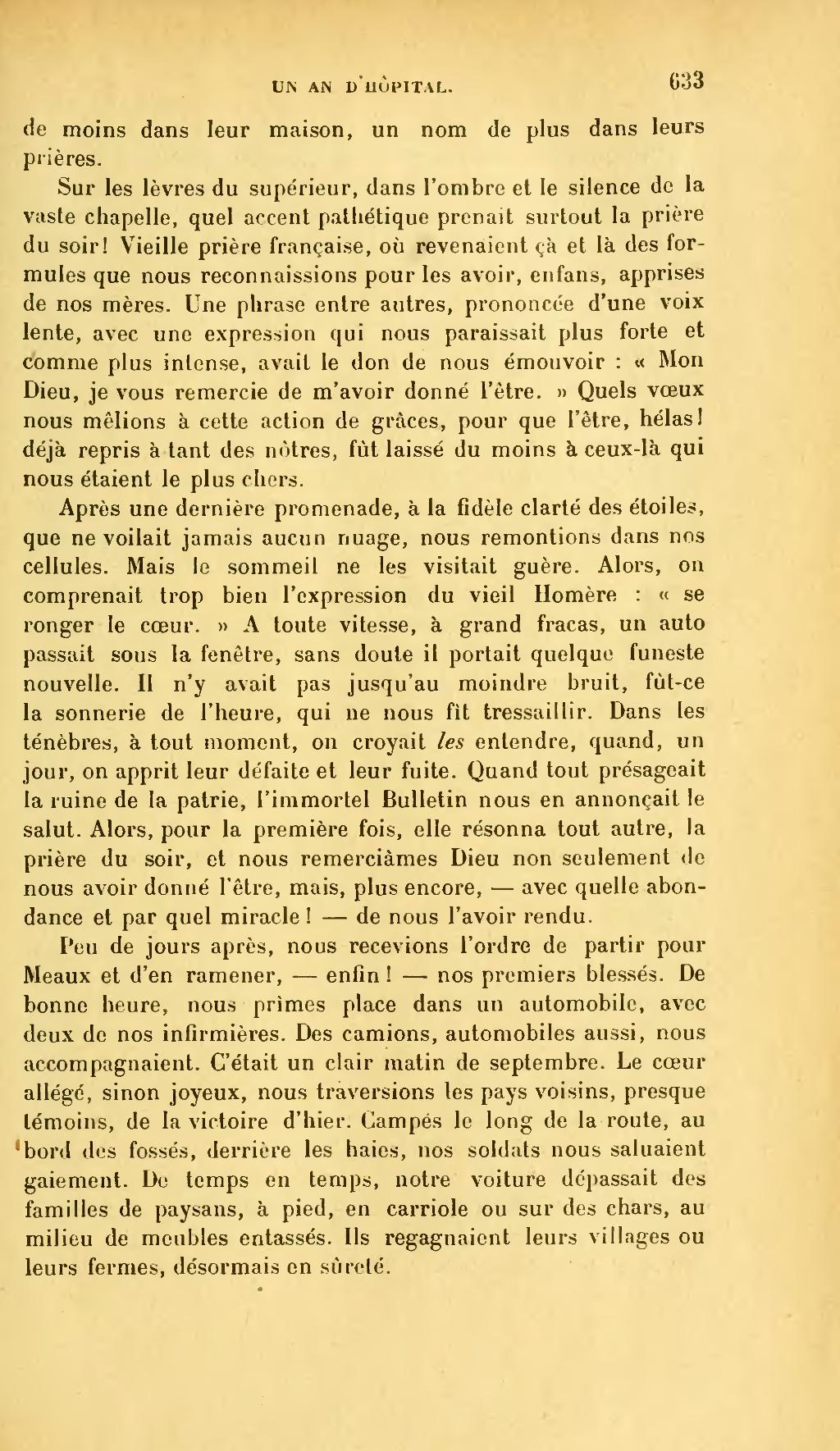de moins dans leur maison, un nom de plus dans leurs prières.
Sur les lèvres du supérieur, dans l’ombre et le silence de la vaste chapelle, quel accent pathétique prenait surtout la prière du soir ! Vieille prière française, où revenaient çà et là des formules que nous reconnaissions pour les avoir, enfans, apprises de nos mères. Une phrase entre autres, prononcée d’une voix lente, avec une expression qui nous paraissait plus forte et comme plus intense, avait le don de nous émouvoir : « Mon Dieu, je vous remercie de m’avoir donné l’être. » Quels vœux nous mêlions à cette action de grâces, pour que l’être, hélas ! déjà repris à tant des nôtres, fût laissé du moins à ceux-là qui nous étaient le plus chers.
Après une dernière promenade, à la fidèle clarté des étoiles, que ne voilait jamais aucun nuage, nous remontions dans nos cellules. Mais le sommeil ne les visitait guère. Alors, on comprenait trop bien l’expression du vieil Homère : « se ronger le cœur. » A toute vitesse, à grand fracas, un auto passait sous la fenêtre, sans doute il portait quelque funeste nouvelle. Il n’y avait pas jusqu’au moindre bruit, fut-ce la sonnerie de l’heure, qui ne nous fit tressaillir. Dans les ténèbres, à tout moment, on croyait les entendre, quand, un jour, on apprit leur défaite et leur fuite. Quand tout présageait la ruine de la patrie, l’immortel Bulletin nous en annonçait le salut. Alors, pour la première fois, elle résonna tout autre, la prière du soir, et nous remerciâmes Dieu non seulement de nous avoir donné l’être, mais, plus encore, — avec quelle abondance et par quel miracle ! — de nous l’avoir rendu.
Peu de jours après, nous recevions l’ordre de partir pour Meaux et d’en ramener, — enfin ! — nos premiers blessés. De bonne heure, nous prîmes place dans un automobile, avec deux de nos infirmières. Des camions, automobiles aussi, nous accompagnaient. C’était un clair matin de septembre. Le cœur allégé, sinon joyeux, nous traversions les pays voisins, presque témoins, de la victoire d’hier. Campés le long de la route, au bord des fossés, derrière les haies, nos soldats nous saluaient gaiement. De temps en temps, notre voiture dépassait des familles de paysans, à pied, en carriole ou sur des chars, au milieu de meubles entassés. Ils regagnaient leurs villages ou leurs fermes, désormais en sûreté.