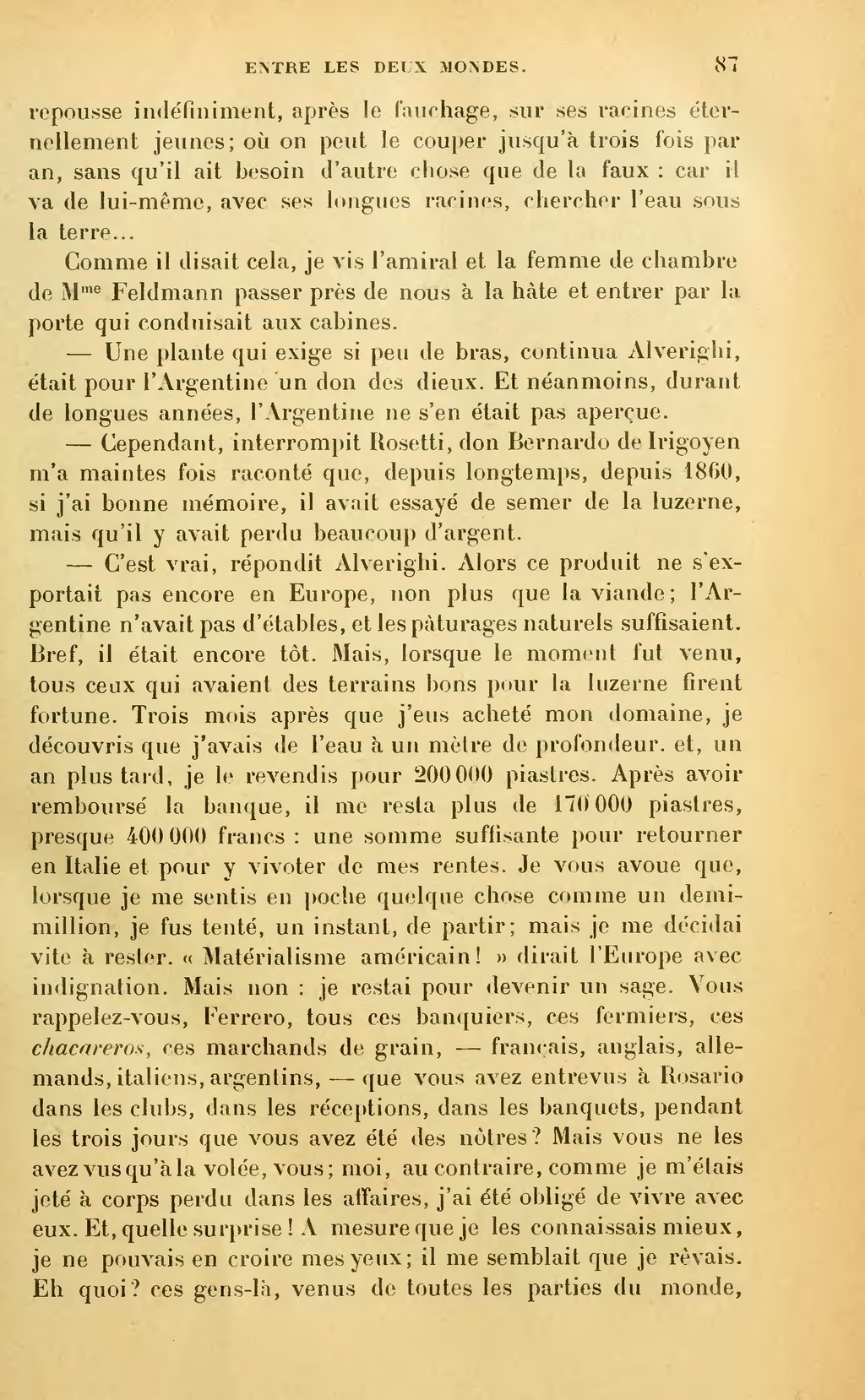repousse indéfiniment, après le fauchage, sur ses racines éternellement jeunes ; où on peut le couper jusqu’à trois fois par an, sans qu’il ait besoin d’autre chose que de la faux : car il va de lui-même, avec ses longues racines, chercher l’eau sous la terre...
Comme il disait cela, je vis l’amiral et la femme de chambre de Mme Feldmann passer près de nous à la hâte et entrer par la porte qui conduisait aux cabines.
— Une plante qui exige si peu de bras, continua Alverighi, était pour l’Argentine un don des dieux. Et néanmoins, durant de longues années, l’Argentine ne s’en était pas aperçue.
— Cependant, interrompit Rosetti, don Bernardo de Irigoyen m’a maintes fois raconté que, depuis longtemps, depuis 1860, si j’ai bonne mémoire, il avait essayé de semer de la luzerne, mais qu’il y avait perdu beaucoup d’argent.
— C’est vrai, répondit Alverighi. Alors ce produit ne s’exportait pas encore en Europe, non plus que la viande ; l’Argentine n’avait pas d’étables, et les pâturages naturels suffisaient. Bref, il était encore tôt. Mais, lorsque le moment fut venu, tous ceux qui avaient des terrains bons pour la luzerne firent fortune. Trois mois après que j’eus acheté mon domaine, je découvris que j’avais de l’eau à un mètre de profondeur, et, un an plus tard, je le revendis pour 200 000 piastres. Après avoir remboursé la banque, il me resta plus de 170 000 piastres, presque 400 000 francs : une somme suffisante pour retourner en Italie et pour y vivoter de mes rentes. Je vous avoue que, lorsque je me sentis en poche quelque chose comme un demi-million, je fus tenté, un instant, de partir ; mais je me décidai vite à rester. « Matérialisme américain ! » dirait l’Europe avec indignation. Mais non : je restai pour devenir un sage. Vous rappelez-vous, Ferrero, tous ces banquiers, ces fermiers, ces chacareros, ces marchands de grain, — français, anglais, allemands, italiens, argentins, — que vous avez entrevus à Rosario dans les clubs, dans les réceptions, dans les banquets, pendant les trois jours que vous avez été des nôtres ? Mais vous ne les avez vus qu’à la volée, vous ; moi, au contraire, comme je m’étais jeté à corps perdu dans les affaires, j’ai été obligé de vivre avec eux. Et, quelle surprise ! A mesure que je les connaissais mieux, je ne pouvais en croire mes yeux ; il me semblait que je rêvais. Eh quoi ? ces gens-là, venus de toutes les parties du monde,