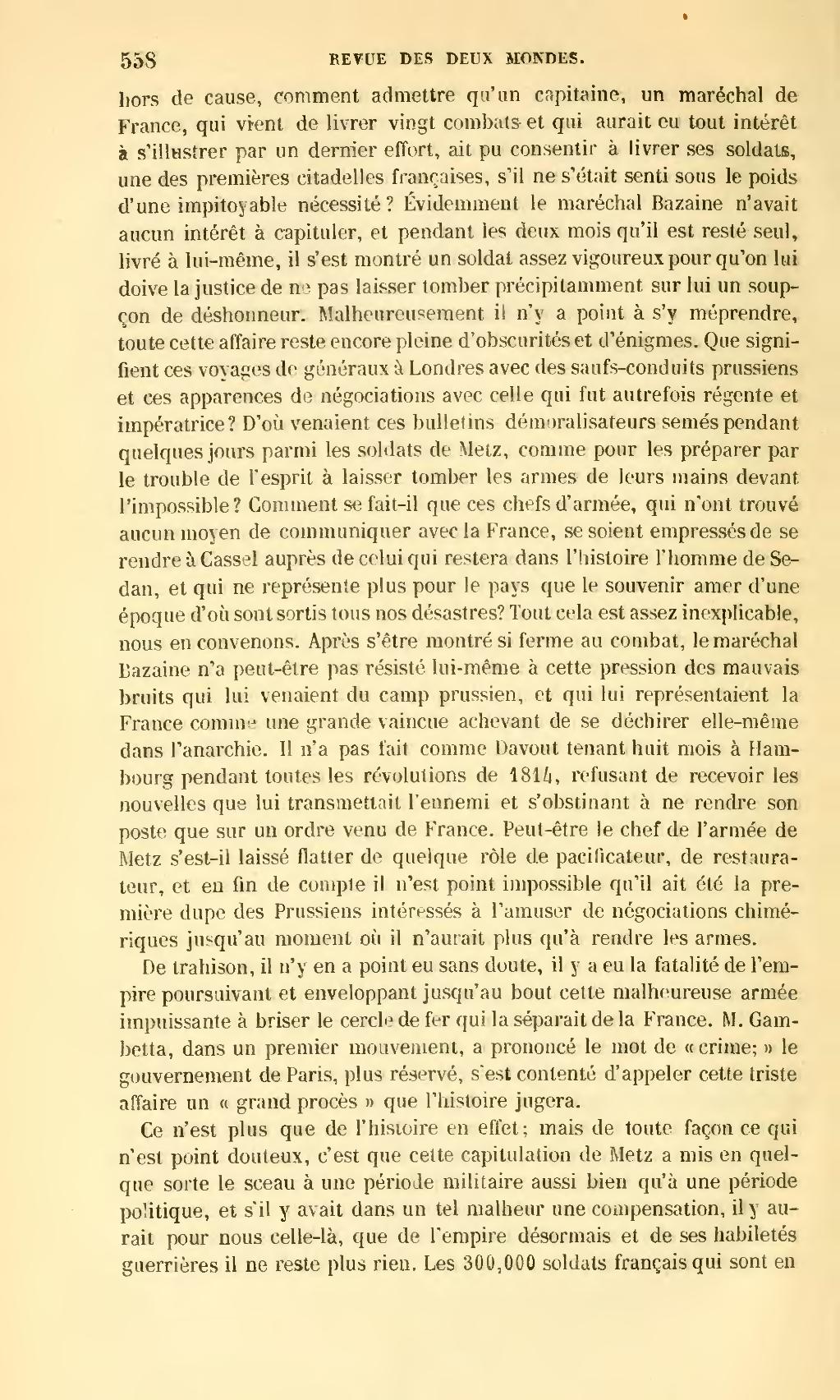hors de cause, comment admettre qu’un capitaine, un maréchal de France, qui vient de livrer vingt combats et qui aurait eu tout intérêt à s’illustrer par un dernier effort, ait pu consentir à livrer ses soldats, une des premières citadelles françaises, s’il ne s’était senti sous le poids d’une impitoyable nécessité ? Évidemment le maréchal Bazaine n’avait aucun intérêt à capituler, et pendant les deux mois qu’il est resté seul, livré à lui-même, il s’est montré un soldat assez vigoureux pour qu’on lui doive la justice de ne pas laisser tomber précipitamment sur lui un soupçon de déshonneur. Malheureusement il n’y a point à s’y méprendre, toute cette affaire reste encore pleine d’obscurités et d’énigmes. Que signifient ces voyages de généraux à Londres avec des saufs-conduits prussiens et ces apparences de négociations avec celle qui fut autrefois régente et impératrice ? D’où venaient ces bulletins démoralisateurs semés pendant quelques jours parmi les soldats de Metz, comme pour les préparer par le trouble de l’esprit à laisser tomber les armes de leurs mains devant l’impossible ? Comment se fait-il que ces chefs d’armée, qui n’ont trouvé aucun moyen de communiquer avec la France, se soient empressés de se rendre à Cassel auprès de celui qui restera dans l’histoire l’homme de Sedan, et qui ne représente plus pour le pays que le souvenir amer d’une époque d’où sont sortis tous nos désastres ? Tout cela est assez inexplicable, nous en convenons. Après s’être montré si ferme au combat, le maréchal Bazaine n’a peut-être pas résisté lui-même à cette pression des mauvais bruits qui lui venaient du camp prussien, et qui lui représentaient la France comme une grande vaincue achevant de se déchirer elle-même dans l’anarchie. Il n’a pas fait comme Davout tenant huit mois à Hambourg pendant toutes les révolutions de 1814, refusant de recevoir les nouvelles que lui transmettait l’ennemi et s’obstinant à ne rendre son poste que sur un ordre venu de France. Peut-être le chef de l’armée de Metz s’est-il laissé flatter de quelque rôle de pacificateur, de restaurateur, et en fin de compte il n’est point impossible qu’il ait été la première dupe des Prussiens intéressés à l’amuser de négociations chimériques jusqu’au moment où il n’aurait plus qu’à rendre les armes.
De trahison, il n’y en a point eu sans doute, il y a eu la fatalité de l’empire poursuivant et enveloppant jusqu’au bout cette malheureuse armée impuissante à briser le cercle de fer qui la séparait de la France. M, Gambetta, dans un premier mouvement, a prononcé le mot de « crime ; » le gouvernement de Paris, plus réservé, s’est contenté d’appeler cette triste affaire un « grand procès » que l’histoire jugera.
Ce n’est plus que de l’histoire en effet ; mais de toute façon ce qui n’est point douteux, c’est que cette capitulation de Metz a mis en quelque sorte le sceau à une période militaire aussi bien qu’à une période politique, et s’il y avait dans un tel malheur une compensation, il y aurait pour nous celle-là, que de l’empire désormais et de ses habiletés guerrières il ne reste plus rien. Les 300,000 soldats français qui sont en