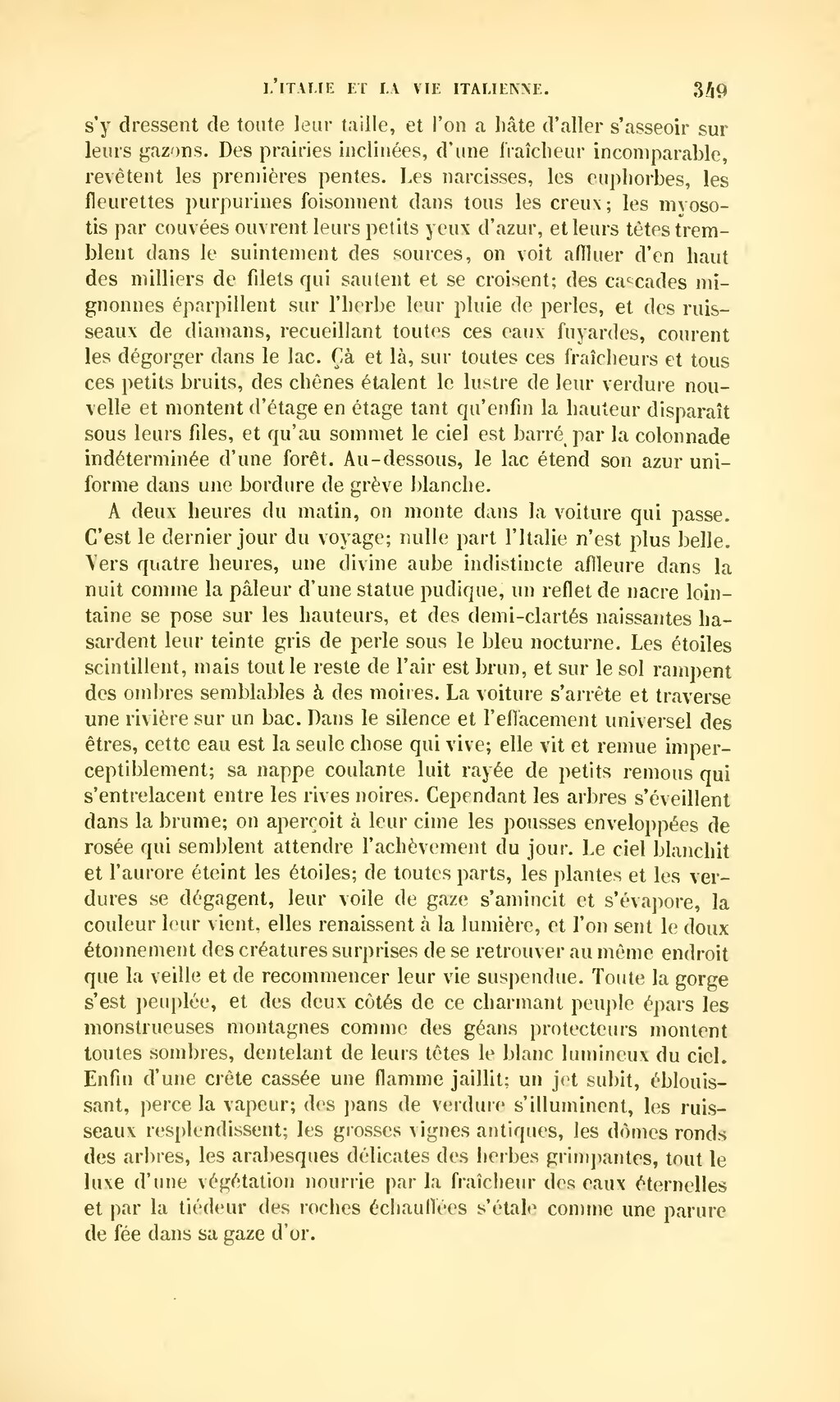s’y dressent de toute leur taille, et l’on a hâte d’aller s’asseoir sur leurs gazons. Des prairies inclinées, d’une fraîcheur incomparable, revêtent les premières pentes. Les narcisses, les euphorbes, les fleurettes purpurines foisonnent dans tous les creux ; les myosotis par couvées ouvrent leurs petits yeux d’azur, et leurs têtes tremblent dans le suintement des sources, on voit affluer d’en haut des milliers de filets qui sautent et se croisent ; des cascades mignonnes éparpillent sur l’herbe leur pluie de perles, et des ruisseaux de diamans, recueillant toutes ces eaux fuyardes, courent les dégorger dans le lac. Çà et là, sur toutes ces fraîcheurs et tous ces petits bruits, des chênes étalent le lustre de leur verdure nouvelle et montent d’étage en étage tant qu’enfin la hauteur disparaît sous leurs files, et qu’au sommet le ciel est barré par la colonnade indéterminée d’une forêt. Au-dessous, le lac étend son azur uniforme dans une bordure de grève blanche.
A deux heures du matin, on monte dans la voiture qui passe. C’est le dernier jour du voyage ; nulle part l’Italie n’est plus belle. Vers quatre heures, une divine aube indistincte affleure dans la nuit comme la pâleur d’une statue pudique, un reflet de nacre lointaine se pose sur les hauteurs, et des demi-clartés naissantes hasardent leur teinte gris de perle sous le bleu nocturne. Les étoiles scintillent, mais tout le reste de l’air est brun, et sur le sol rampent des ombres semblables à des moires. La voiture s’arrête et traverse une rivière sur un bac. Dans le silence et l’effacement universel des êtres, cette eau est la seule chose qui vive ; elle vit et remue imperceptiblement ; sa nappe coulante luit rayée de petits remous qui s’entrelacent entre les rives noires. Cependant les arbres s’éveillent dans la brume ; on aperçoit à leur cime les pousses enveloppées de rosée qui semblent attendre l’achèvement du jour. Le ciel blanchit et l’aurore éteint les étoiles ; de toutes parts, les plantes et les verdures se dégagent, leur voile de gaze s’amincit et s’évapore, la couleur leur vient, elles renaissent à la lumière, et l’on sent le doux étonnement des créatures surprises de se retrouver au même endroit que la veille et de recommencer leur vie suspendue. Toute la gorge s’est peuplée, et des deux côtés de ce charmant peuple épars les monstrueuses montagnes comme des géans protecteurs montent toutes sombres, dentelant de leurs têtes le blanc lumineux du ciel. Enfin d’une crête cassée une flamme jaillit ; un jet subit, éblouissant, perce la vapeur ; des pans de verdure s’illuminent, les ruisseaux resplendissent ; les grosses vignes antiques, les dômes ronds des arbres, les arabesques délicates des herbes grimpantes, tout le luxe d’une végétation nourrie par la fraîcheur des eaux éternelles et par la tiédeur des roches échauffées s’étale comme une parure de fée dans sa gaze d’or.