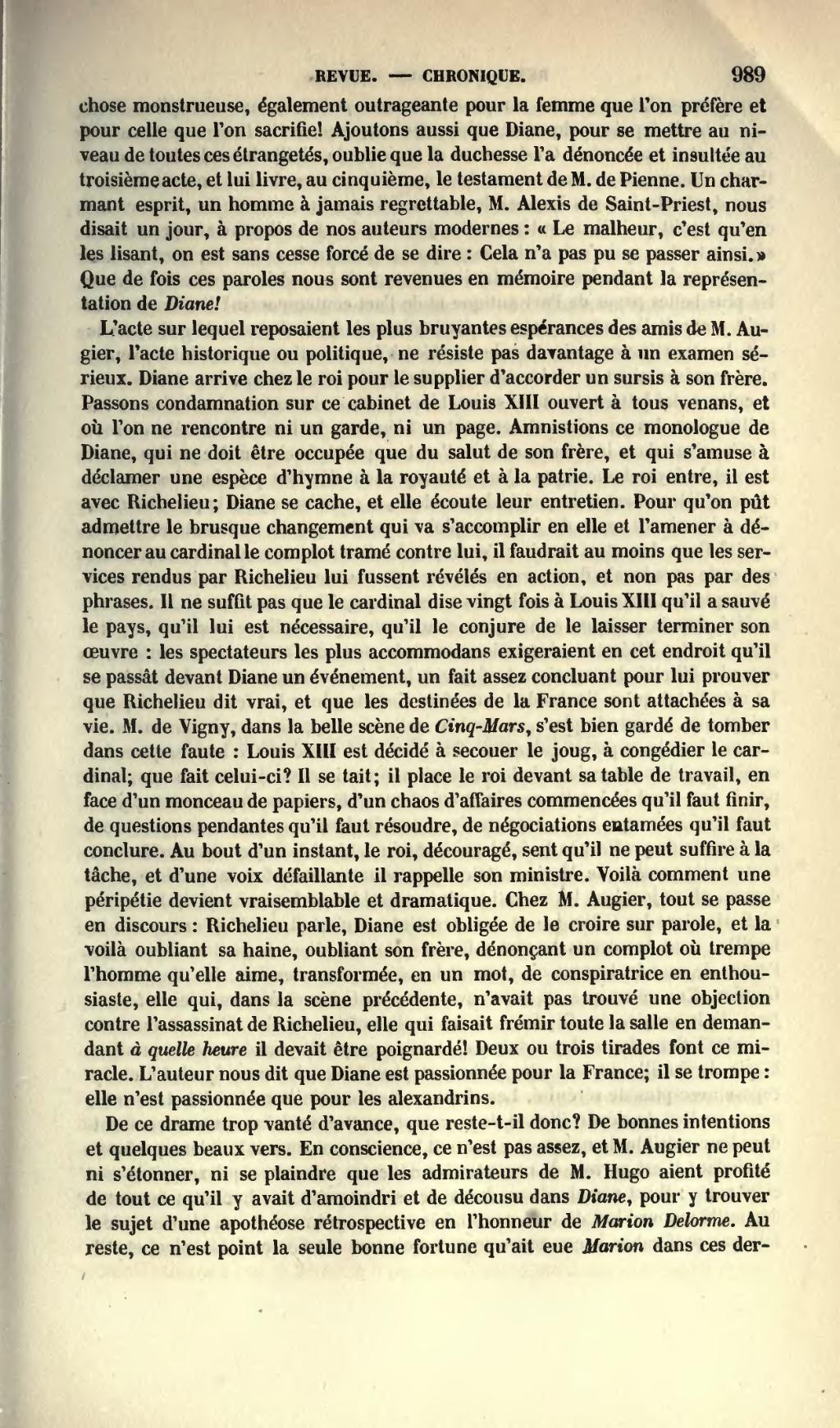chose monstrueuse, également outrageante pour la femme que l’on préfère et pour celle que l’on sacrifie ! Ajoutons aussi que Diane, pour se mettre au niveau de toutes ces étrangetés, oublie que la duchesse l’a dénoncée et insultée an troisième acte, et lui livre, au cinquième, le testament de M. de Pienne. Un charmant esprit, un homme à jamais regrettable, M. Alexis de Saint-Priest, nous disait un jour, à propos de nos auteurs modernes : « Le malheur, c’est qu’en les lisant, on est sans cesse forcé de se dire : Cela n’a pas pu se passer ainsi. » Que de fois ces paroles nous sont revenues en mémoire pendant la représentation de Diane !
L’acte sur lequel reposaient les plus bruyantes espérances des amis de M. Augier, l’acte historique ou politique, ne résiste pas davantage à un examen sérieux. Diane arrive chez le roi pour le supplier d’accorder un sursis à son frère. Passons condamnation sur ce cabinet de Louis XIII ouvert à tous venans, et où l’on ne rencontre ni un garde, ni un page. Amnistions ce monologue de Diane, qui ne doit être occupée que du salut de son frère, et qui s’amuse à déclamer une espèce d’hymne à la royauté et à la patrie. Le roi entre, il est avec Richelieu ; Diane se cache, et elle écoute leur entretien. Pour qu’on pût admettre le brusque changement qui va s’accomplir en elle et l’amener à dénoncer au cardinal le complot tramé contre lui, il faudrait au moins que les services rendus par Richelieu lui fussent révélés en action, et non pas par des phrases. Il ne suffit pas que le cardinal dise vingt fois à Louis XIII qu’il a sauvé le pays, qu’il lui est nécessaire, qu’il le conjure de le laisser terminer son œuvre : les spectateurs les plus accommodans exigeraient en cet endroit qu’il se passât devant Diane un événement, un fait assez concluant pour lui prouver que Richelieu dit vrai, et que les destinées de la France sont attachées à sa vie. M. de Vigny, dans la belle scène de Cinq-Mars, s’est bien gardé de tomber dans cette faute : Louis XIII est décidé à secouer le joug, à congédier le cardinal ; que fait celui-ci ? Il se tait ; il place le roi devant sa table de travail, en face d’un monceau de papiers, d’un chaos d’affaires commencées qu’il faut finir, de questions pendantes qu’il faut résoudre, de négociations entamées qu’il faut conclure. Au bout d’un instant, le roi, découragé, sent qu’il ne peut suffire à la tâche, et d’une voix défaillante il rappelle son ministre. Voilà comment une péripétie devient vraisemblable et dramatique. Chez M. Augier, tout se passe en discours : Richelieu parle, Diane est obligée de le croire sur parole, et la voilà oubliant sa haine, oubliant son frère, dénonçant un complot où trempe l’homme qu’elle aime, transformée, en un mot, de conspiratrice en enthousiaste, elle qui, dans la scène précédente, n’avait pas trouvé une objection contre l’assassinat de Richelieu, elle qui faisait frémir toute la salle en demandant à quelle heure il devait être poignardé ! Deux ou trois tirades font ce miracle. L’auteur nous dit que Diane est passionnée pour la France ; il se trompe elle n’est passionnée que pour les alexandrins.
De ce drame trop vanté d’avance, que reste-t-il donc ? De bonnes intentions et quelques beaux vers. En conscience, ce n’est pas assez, et M. Augier ne peut ni s’étonner, ni se plaindre que les admirateurs de M. Hugo aient profité de tout ce qu’il y avait d’amoindri et de décousu dans Diane, pour y trouver le sujet d’une apothéose rétrospective en l’honneur de Marion Delorme. Au reste, ce n’est point la seule bonne fortune qu’ait eue Marion dans ces derniers