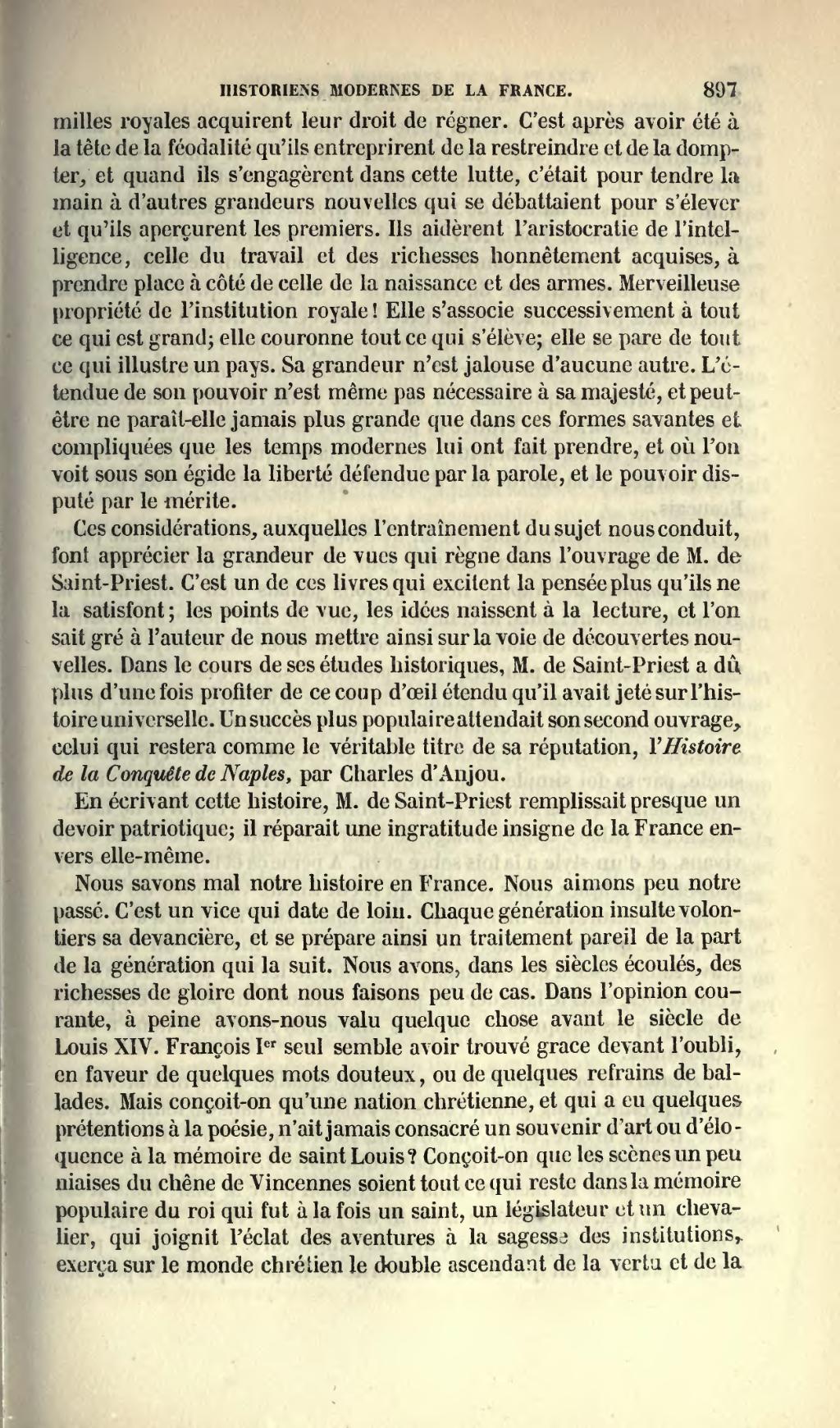royales acquirent leur droit de régner. C’est après avoir été à la tête de la féodalité qu’ils entreprirent de la restreindre et de la dompter, et quand ils s’engagèrent dans cette lutte, c’était pour tendre la main à d’autres grandeurs nouvelles qui se débattaient pour s’élever et qu’ils aperçurent les premiers. Ils aidèrent l’aristocratie de l’intelligence, celle du travail et des richesses honnêtement acquises, à prendre place à côté de celle de la naissance et des armes. Merveilleuse propriété de l’institution royale ! Elle s’associe successivement à tout ce qui est grand ; elle couronne tout ce qui s’élève ; elle se pare de tout ce qui illustre un pays. Sa grandeur n’est jalouse d’aucune autre. L’étendue de son pouvoir n’est même pas nécessaire à sa majesté, et peut-être ne paraît-elle jamais plus grande que dans ces formes savantes et compliquées que les temps modernes lui ont fait prendre, et où l’on voit sous son égide la liberté défendue par la parole, et le pouvoir disputé par le mérite.
Ces considérations, auxquelles l’entraînement du sujet nous conduit, font apprécier la grandeur de vues qui règne dans l’ouvrage de M. de Saint-Priest. C’est un de ces livres qui excitent la pensée plus qu’ils ne la satisfont ; les points de vue, les idées naissent à la lecture, et l’on sait gré à l’auteur de nous mettre ainsi sur la voie de découvertes nouvelles. Dans le cours de ses études historiques, M. de Saint-Priest a dû plus d’une fois profiter de ce coup d’œil étendu qu’il avait jeté sur l’histoire universelle. Un succès plus populaire attendait son second ouvrage, celui qui restera comme le véritable titre de sa réputation, l’Histoire de la Conquête de Naples, par Charles d’Anjou.
En écrivant cette histoire, M. de Saint-Priest remplissait presque un devoir patriotique ; il réparait une ingratitude insigne de la France envers elle-même.
Nous savons mal notre histoire en France. Nous aimons peu notre passé. C’est un vice qui date de loin. Chaque génération insulte volontiers sa devancière, et se prépare ainsi un traitement pareil de la part de la génération qui la suit. Nous avons, dans les siècles écoulés, des richesses de gloire dont nous faisons peu de cas. Dans l’opinion courante, à peine avons-nous valu quelque chose avant le siècle de Louis XIV. François Ier seul semble avoir trouvé grace devant l’oubli, en faveur de quelques mots douteux, ou de quelques refrains de ballades. Mais conçoit-on qu’une nation chrétienne, et qui a eu quelques prétentions à la poésie, n’ait jamais consacré un souvenir d’art ou d’éloquence à la mémoire de saint Louis ? Conçoit-on que les scènes un peu niaises du chêne de Vincennes soient tout ce qui reste dans la mémoire populaire du roi qui fut à la fois un saint, un législateur et un chevalier, qui joignit l’éclat des aventures à la sagesse des institutions, exerça sur le monde chrétien le double ascendant de la vertu et de la